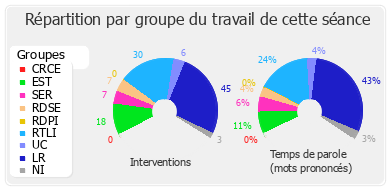Séance en hémicycle du 19 janvier 2016 à 21h00
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à vingt et une heures cinq, sous la présidence de M. Hervé Marseille.

La séance est reprise.

Mes chers collègues, je vais vous donner lecture des conclusions de la conférence des présidents, qui s’est réunie aujourd’hui, à dix-neuf heures.
La conférence des présidents a tout d’abord décidé d’ouvrir cette nuit et celle de demain, ainsi que, éventuellement, vendredi matin et après-midi, afin de terminer l’examen du projet de loi et de la proposition de loi organique relatifs à la biodiversité.
Elle a par ailleurs établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :
SEMAINES RÉSERVÉES PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
MARDI 19 JANVIER 2016
Le soir et la nuit
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (texte de la commission, n° 608, 2014-2015) et de la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la nomination à la présidence du conseil d’administration de l’Agencefrançaise pour la biodiversité (texte de la commission, n° 609, 2014-2015)
MERCREDI 20 JANVIER 2016
À 14 h 30, le soir et la nuit
- Suite de l’ordre du jour de la veille
JEUDI 21 JANVIER 2016
De 10 h 30 à 11 h 30, à 14 h 30et le soir
- Suite de l’ordre du jour de la veille
ÉVENTUELLEMENT, VENDREDI 22 JANVIER 2016
À 9 h 30 et à 14 h 30
- Suite de l’ordre du jour de la veille
MARDI 26 JANVIER 2016
À 9 h 30
- 26 questions orales
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
• n° 1182 de M. Richard YUNG à M. le ministre des finances et des comptes publics
Gestion des impôts dus en France par les non -résidents

• n° 1202 de M. Philippe MADRELLE à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Fonctionnement de la centrale nucléaire du Blayais
Accueil collectif des mineurs en refuge

• n° 1218 de M. Bruno SIDO à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
(Intégrité scientifique)
• n° 1224 de Mme Colette GIUDICELLI à M. le secrétaire d’État chargé des affaires européennes
Politique européenne d’identification des migrants

• n° 1228 de M. Jean-Claude LENOIR à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Menaces sur l’alternance intégrative pour les formations en travail social

MARDI 26 JANVIER 2016 (SUITE)
À 9 h 30(suite)
• n° 1234 de M. Cyril PELLEVAT transmise à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique
Ralentissement de l’activité de l’industrie du bâtiment et des travaux publics en Haute -Savoie

• n° 1238 de M. Daniel GREMILLET à Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité
Délais d’instruction des autorisations d’urbanisme

• n° 1240 de M. Martial BOURQUIN à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Glyphosate et pollution des rivières comtoises

• n° 1245 de Mme Anne-Catherine LOISIER à M. le ministre des finances et des comptes publics
Fermeture des trésoreries en milieu rural

• n° 1247 de M. Roland COURTEAU à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement
Expérimentation d’une nouvelle méthode de lutte contre le chancre coloré

• n° 1257 de Mme Agnès CANAYER à M. le secrétaire d’État chargé du budget
Localisation des services de douanes dans le cadre de la Normandie réunifiée
Service historique de la défense et préservation du château de Vincennes

• n° 1264 de M. François COMMEINHES à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Lutte contre la prolifération du moustique tigre

• n° 1274 de Mme Brigitte MICOULEAU à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche
Réalisation des lignes à grande vitesse Bordeaux -Toulouse et Bordeaux -Dax

• n° 1275 de M. Patrick CHAIZE à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique
Régime indemnitaire des exécutifs de syndicats intercommunaux

• n° 1277 de M. Hervé MAUREY transmise à M. le ministre des finances et des comptes publics
Comptes bancaires inactifs et contrats d’assurance sur la vie en déshérence

• n° 1280 de M. Yannick VAUGRENARD à M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique
Trésorerie des petites et moyennes entreprises

• n° 1283 de Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Fermetures de centres de sécurité sociale dans les Hauts -de -Seine
Augmentation importante des demandes d’asile en Guyane

MARDI 26 JANVIER 2016 (SUITE)
À 9 h 30(suite)
• n° 1288 de Mme Gisèle JOURDA à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique
Nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale

• n° 1289 de M. Jacques MÉZARD à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Pôle d’anesthésie dans les hôpitaux publics

• n° 1291 de M. Louis-Jean de NICOLAY à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Maisons de santé hospitalières

• n° 1294 de M. Olivier CIGOLOTTI à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Médicament dépakine et malformations

• n° 1301 de M. Jean-Pierre BOSINO à Mme la ministre de la culture et de la communication
Théâtre de la faïencerie de Creil

• n° 1316 de M. Jean Louis MASSON à M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports
Champ d’intervention de l’agence nationale pour la rénovation urbaine

À 14 h 30
- Explications de vote des groupes sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la nomination à la présidence du conseil d’administration de l’Agencefrançaise pour la biodiversité
• Temps attribué aux orateurs des groupes pour les explications de vote, à raison d’un orateur par groupe : 7 minutes pour chaque groupe et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe
• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 25 janvier, à 17 heures
De 15 h 15à 15 h 45
- Vote solennel par scrutin public, en salle des Conférences, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
À 15 h 45
- Proclamation du résultat du scrutin public sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et scrutin public ordinaire en salle des séances sur la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la nomination à la présidence du conseil d’administration de l’Agencefrançaise pour la biodiversité
MARDI 26 JANVIER 2016 (SUITE)
À 16 heureset le soir
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’information de l’administration par l’institutionjudiciaire et à la protection des mineurs (texte de la commission, n° 294, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 21 janvier, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 26 janvier matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 25 janvier, à 17 heures
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires (texte de la commission, n° 275, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 21 janvier, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 26 janvier matin et mercredi 27 janvier matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 25 janvier, à 17 heures
MERCREDI 27 JANVIER 2016
À 14 h 30
- Suite éventuelle de l’ordre du jour de la veille
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la prévention et à la luttecontre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actesterroristes dans les transportscollectifs de voyageurs (n° 281, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois, avec une saisine pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 20 janvier matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 25 janvier, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 27 janvier matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 26 janvier, à 17 heures
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat (n° 252, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques.
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 20 janvier matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 25 janvier, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 27 janvier matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 26 janvier, à 17 heures
MERCREDI 27 JANVIER 2016 (SUITE)
Le soir
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie (texte de la commission, n° 307, 2015-2016)
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 26 janvier, à 17 heures
- Suite de l’ordre du jour de l’après-midi
JEUDI 28 JANVIER 2016
À 10 h 30
- 1 convention internationale examinée selon la procédure d’examen simplifié :
=> Projet de loi autorisant la ratification du protocole relatif à la convention n° 29 de l’Organisation internationale du travail sur le travail forcé, 1930 (procédure accélérée) (n° 630, 2014-2015)
• Délai limite pour qu’un président de groupe demande le retour à la procédure normale : mardi 26 janvier, à 17 heures
- Suite éventuelle de l’ordre du jour de la veille
- Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombreminimal d’actionnaires dans les sociétés anonymesnon cotées (procédure accélérée)(texte de la commission, n° 296, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 20 janvier matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 25 janvier, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 27 janvier matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 30 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 27 janvier, à 17 heures
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur France 3, Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 28 janvier, à 11 heures
Éventuellement, à 16 h 15 et le soir
- Suite de l’ordre du jour du matin
SEMAINE SÉNATORIALE
MARDI 2 FÉVRIER 2016
À 14 h 30
- Proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste, présentéepar MM. Philippe BAS, Bruno RETAILLEAU, François ZOCCHETTO et Michel MERCIER (n° 280, 2015-2016) (demande du groupe Les Républicains)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 25 janvier, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 27 janvier matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 1er février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 2 février matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 1er février, à 17 heures
À 16 h 45
- Questions d’actualité au Gouvernement
Diffusion en direct sur Public Sénat et sur le site Internet du Sénat

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 2 février, à 12 h 30
À 17 h 45, le soir et, éventuellement, la nuit
- Suite de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste, présentéepar MM. Philippe BAS, Bruno RETAILLEAU, François ZOCCHETTO et Michel MERCIER (n° 280, 2015-2016) (demande du groupe Les Républicains)
MERCREDI 3 FÉVRIER 2016
De 14 h 30à 18 h 30(ordre du jour réservé au groupe socialiste et républicain)
- Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la lutte contre le gaspillagealimentaire (texte de la commission, n° 269, 2015-2016)
- Proposition de loi visant à permettre l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droitindividuel à la formation, présentée par M. Jean-Pierre SUEUR (procédure accélérée) (n° 284, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 25 janvier, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 27 janvier matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 1er février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 3 février matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 2 février, à 17 heures
De 18 h 30 à 20 heures et de 21 h 30 à minuit (ordre du jour réservé au groupe RDSE)
- Proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire les principesfondamentaux de la loi du 9décembre1905 à l’article 1er de la Constitution, présentée par M. Jacques MÉZARD et plusieurs de ses collègues (n° 258, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 25 janvier, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 27 janvier matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 1er février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 3 février matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 2 février, à 17 heures
MERCREDI 3 FÉVRIER 2016 (SUITE)
De 18 h 30 à 20 heures et de 21 h 30 à minuit (ordre du jour réservé au groupe RDSE)
(suite)
- Proposition de loi organique visant à supprimer les missionstemporaires confiées par le Gouvernement aux parlementaires, présentée par M. Jacques MÉZARD et plusieurs de ses collègues (n° 3, 2015-2016), et proposition de loi organique visant à supprimer le remplacement des parlementaires en cas de prolongation d’une mission temporaire (n° 4, 2015-2016), présentée par M. Jacques MÉZARD et plusieurs de ses collègues
Ces deux textes ont été envoyés à la commission des lois. Ils feront l’objet d’une discussion générale commune.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 25 janvier, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et les textes : mercredi 27 janvier matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 1er février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 3 février matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale commune : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale commune : mardi 2 février, à 17 heures
JEUDI 4 FÉVRIER 2016
À 10 h 30
- Proposition de résolution européenne sur les conséquences du traité transatlantique pour l’agriculture et l’aménagement du territoire présentée, en application de l’article 73 quinquies du Règlement, par M. Michel BILLOUT et plusieurs de ses collègues (rapport et texte de la commission n° 270, 2015-2016) (demande du groupe communiste républicain et citoyen)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 1er février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 3 février matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 3 février, à 17 heures
- Suite éventuelle de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste, présentéepar MM. Philippe BAS, Bruno RETAILLEAU, François ZOCCHETTO et Michel MERCIER (n° 280, 2015-2016) (demande du groupe Les Républicains)
JEUDI 4 FÉVRIER 2016 (SUITE)
À 14 h 30, le soir et, éventuellement, la nuit
- Proposition de loi favorisant l’accès au logement social pour le plusgrand nombre, présentée parM. Michel LE SCOUARNEC et plusieurs de ses collègues(n° 256, 2015-2016) (ordre du jour réservé au groupe communiste républicain et citoyen)
Ce texte a été envoyé à la commission des finances, avec une saisine pour avis de la commission des affaires économiques.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 25 janvier, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 27 janvier matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 1er février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 3 février matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 3 février, à 17 heures
- Suite éventuelle de l’ordre du jour du matin
- Proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autoritéspubliques indépendantes (n° 225, 2015-2016) et proposition de loi organique relative aux autorités administratives indépendantes et autoritéspubliques indépendantes (n° 226, 2015-2016), présentées par Mme Marie-Hélène DES ESGAULX, M. Jean-Léonce DUPONT et M. Jacques MÉZARD (demande du groupe Les Républicains)
Ces deux textes ont été envoyés à la commission des lois, avec une saisine pour avis de la commission de la culture. Ils feront l’objet d’une discussion générale commune.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 25 janvier, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 27 janvier matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 1er février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 3 février matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale commune : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 3 février, à 17 heures
SEMAINES RÉSERVÉES PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
MARDI 9 FÉVRIER 2016
À 9 h 30
- 27 questions orales
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
• n° 1229 de M. Patrick MASCLET à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique
Assouplissement des règles de gestion de trésorerie des communes

• n° 1231 de M. Jean-Claude LENOIR à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Obligation de contribution de la commune de résidence aux établissements d’enseignement privé

• n° 1244 de M. Dominique de LEGGE à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique
Communication du fichier DGF aux collectivités locales

• n° 1248 de M. Jean-Paul FOURNIER à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Prise en compte de la problématique des « ruisseaux couverts » de l’ex -bassin houiller cévenol

• n° 1258 de M. René DANESI à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Du glissement de la réglementation à la recommandation normative

• n° 1259 de Mme Sylvie ROBERT à M. le secrétaire d’État chargé du budget
Améliorations fiscales pour les établissements publics de coopération culturelle

• n° 1262 de M. Yannick BOTREL à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Mise en œuvre des temps d’activités périscolaires dans les établissements privés

• n° 1276 de Mme Maryvonne BLONDIN à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Situation des enfants intersexes

• n° 1282 de M. Rémy POINTEREAU transmise à Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité
Création d’une zone d’aménagement concerté

MARDI 9 FÉVRIER 2016 (SUITE)
À 9 h 30(suite)
• n° 1284 de M. Jacques GENEST transmise à Mme la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire
Assouplissement des normes pour les artisans et les petites et moyennes entreprises

• n° 1285 de M. Mathieu DARNAUD transmise à Mme la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire
Avenir de l’artisanat et du commerce de proximité

• n° 1287 de Mme Agnès CANAYER à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement
Difficultés d’accès aux mesures agro -environnementales et climatiques en Seine -Maritime

• n° 1290 de Mme Chantal DESEYNE à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Pénurie de médecins en Eure -et -Loir

• n° 1292 de M. Philippe KALTENBACH à Mme la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité
Destruction de 750 logements sociaux récemment rénovés à Clamart

• n° 1295 de M. Henri de RAINCOURT à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Traitement des déchets de certaines entreprises

• n° 1297 de Mme Corinne IMBERT à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Mutualisation des fonctions de direction et comptabilité des centres sociaux
Zones d’entraînement à très basse altitude et croissance verte

• n° 1299 de Mme Marie-Pierre MONIER à Mme la secrétaire d’État chargée de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et de l’autonomie
Désengagement financier de certains départements pour les actions de prévention spécialisée

• n° 1304 de M. Jean-Jacques FILLEUL à M. le ministre des finances et des comptes publics
Situation fiscale des établissements et services sanitaires, sociaux et médico -sociaux privés non lucratifs

• n° 1305 de M. Christian FAVIER à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice
Accueil des mineurs isolés étrangers dans le département du Val -de -Marne

• n° 1306 de M. François MARC à M. le ministre des finances et des comptes publics
Circuits d’évasion fiscale organisée

MARDI 9 FÉVRIER 2016 (SUITE)
À 9 h 30(suite)
• n° 1308 de Mme Nicole BONNEFOY à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Présence de chlorure de vinyle monomère dans l’eau potable

• n° 1309 de Mme Françoise FÉRAT à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche
Rénovation des voies de chemins de fer capillaires en France

• n° 1310 de M. Dominique BAILLY à Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Accueil des personnes handicapées au sein des établissements médico -sociaux en France

• n° 1314 de M. Jacques MÉZARD à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche
Desserte ferroviaire d’Aurillac à Brive

• n° 1324 de M. Thierry FOUCAUD à M. le secrétaire d’État chargé du budget
Urgence douanière

• n° 1331 de M. Roland COURTEAU à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche
Étapes de réalisation de la ligne à grande vitesse Montpellier -Perpignan

À 14 h 30, le soiret la nuit
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (n° 15, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission de la culture.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : jeudi 21 janvier, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mardi 26 janvier après-midi, mercredi 27 janvier matin après-midi et, éventuellement, le soir
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 4 février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 9 février matin et à la suspension de l’après-midi, mercredi 10 février matin et à la suspension de l’après-midi
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 2 heures
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 8 février, à 17 heures
MERCREDI 10 FÉVRIER 2016
À 14 h 30, le soiret la nuit
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (n° 15, 2015-2016)
JEUDI 11 FÉVRIER 2016
À 10 h 30
- Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes par M. Didier MIGAUD, Premier président de la Cour des comptes
• Temps attribué à la commission des finances : 10 minutes
• Temps attribué à la commission des affaires sociales : 10 minutes
- 4 conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :
=> Projet de loi autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République du Mali (n° 483, 2014-2015)
=> Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande concernant le statut des forces en visite et la coopération en matière de défense (n° 340, 2014-2015)
=> Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité (n° 74, 2014-2015)
=> Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération dans le domaine de la défense (n° 803, 2013-2014)
• Délai limite pour qu’un président de groupe demande le retour à la procédure normale : mardi 9 février, à 17 heures
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (n° 15, 2015-2016)
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur France 3, Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 11 février, à 11 heures
À 16 h 15, le soir et, éventuellement, la nuit
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (n° 15, 2015-2016)
MARDI 16 FÉVRIER 2016
À 15 h 15
- Explications de vote des groupes sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (n° 15, 2015-2016)
• Temps attribué aux orateurs des groupes pour les explications de vote, à raison d’un orateur par groupe : 7 minutes pour chaque groupe et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe
• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 15 février, à 17 heures
De 16 heuresà 16 h 30
- Vote solennel par scrutin public, en salle des Conférences, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (n° 15, 2015-2016)
À 16 h 30
- Proclamation du résultat du scrutin public sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (n° 15, 2015-2016)
À 16 h 45
- Questions d’actualité au Gouvernement
Diffusion en direct sur Public Sénat et sur le site Internet du Sénat

• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 16 février, à 12 h 30
À 17 h 45et le soir
- Sous réserve de sa transmission, nouvelle lecture du projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration (AN, n° 3128)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 8 février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 10 février matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 15 février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 16 février matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 15 février, à 17 heures
MERCREDI 17 FÉVRIER 2016
À 14 h 30
- Suite de l’ordre du jour de la veille
- Proposition de loi organique (n° 278, 2015-2016) et proposition de loi (n° 279, 2015-2016), adoptées par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation des règlesapplicables à l’élection présidentielle
Ces textes ont été envoyés à la commission des lois. Ils feront l’objet d’une discussion générale commune.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 8 février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et les textes : mercredi 10 février matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 15 février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 17 février matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale commune : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale commune : mardi 16 février, à 17 heures
À 17 h 30
- Débat préalable à la réunion duConseil européen des 18 et 19 février
Intervention liminaire du Gouvernement : 10 minutes
8 minutes attribuées à chaque groupe politique et 5 minutes aux sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 16 février, à 17 heures
8 minutes attribuées respectivement à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et à la commission des affaires européennes
Après la réponse du Gouvernement, débat spontané et interactif de 1 heure : 2 minutes maximum par sénateur avec possibilité d’une réponse du Gouvernement ou de la commission des affaires européennes
Le soiret la nuit
- Suite de l’ordre du jour de l’après-midi
JEUDI 18 FÉVRIER 2016
À 10 h 30
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraudefiscales en matière d’impôts sur le revenu (n° 249, 2015-2016)
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 30 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 17 février, à 17 heures
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse modifiant le protocoleadditionnel à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doublesimpositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (n° 251, 2015-2016)
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 30 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 17 février, à 17 heures
- Suite de la proposition de loi organique (n° 278, 2015-2016) et de la proposition de loi (n° 279, 2015-2016), adoptées par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de modernisation des règlesapplicables à l’élection présidentielle
JEUDI 18 FÉVRIER 2016 (SUITE)
À 14 h 30 et le soir
- Suite de l’ordre du jour du matin
- Sous réserve de sa transmission, nouvelle lecture de la proposition de loi relative à la protection del’enfant (AN, n° 3394)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires sociales.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 8 février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 10 février matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 15 février, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 17 février matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 17 février, à 17 heures
Je consulte le Sénat sur les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Ces propositions sont adoptées.

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et de la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité.
La discussion générale commune a été close.
Nous passons à l’examen du texte de la commission relatif au projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
TITRE Ier
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Le I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « terrestres et marins » ;
2° et 3°
Supprimés
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les processus biologiques et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.
« On entend par biodiversité, ou diversité biologique, l’ensemble des organismes vivants ainsi que les interactions qui existent, d’une part, entre les organismes vivants eux-mêmes, d’autre part, entre ces organismes, leurs habitats naturels et leurs milieux de vie. »

Depuis le 28 décembre 2015, les arrêtés de protection des géotopes sont publiés. Madame la ministre, vous avez respecté vos engagements face aux géologues et aux enseignants-chercheurs du Muséum.
Mieux, cette prise de conscience se retrouve désormais dans l’article 1er du présent projet de loi qui inclut dans le patrimoine la « géodiversité ». Il y va de nos paysages, des essences de nos forêts, des cultures et, pour prendre un exemple qui motive souvent le Sénat, des viticultures.
Ainsi, à exposition semblable, à altitude égale, à pente semblable, selon que le sous-sol est jurassique moyen ou jurassique supérieur, et son sol associé, vous aurez du vin Côtes de Nuits ou Côtes de Beaune… Et s’il y a de petites huîtres fossiles, ou Ostrea, l’appellation Chablis vous sera refusée…
Au-delà de ces incidences économiques et gastronomiques, l’attention portée au patrimoine géologique a toute son importance en matière de rôle joué par les sols et leur faune : tout comme notre organisme héberge deux kilogrammes de micro-organismes, biodiversité indispensable à notre santé, les sols non empoisonnés abritent une masse d’animaux et de bactéries contributeurs de fertilité et de résilience, dont le poids dépasse celui des troupeaux qui pâturent en surface.
Recevez donc, madame la ministre, la gratitude des géologues, des pédologues et des défenseurs de l’humus, et permettez-nous d’espérer pour les amendements n° 457 rectifié, 121 rectifié bis et 525 rectifié bis, qui ont reçu un avis négatif de M. Bignon, mais qui visent pourtant simplement à mentionner l’importance des sols dans le patrimoine pour la biodiversité.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.

Nous avons la responsabilité de mener une politique qui vise à protéger et entretenir notre écosystème trop souvent mis à mal par l’homme. La reconquête de la nature et des paysages est essentielle pour l’humanité et son devenir. Aussi, préserver la diversité de la vie naturelle, de la faune, de la flore, terrestre ou marine, doit être notre priorité.
À ce titre, l’article 1er permet d’enrichir le code de l’environnement par des concepts et un vocabulaire renouvelé et raisonné. Il donne une définition plus affinée de la biodiversité en intégrant l’ensemble des êtres vivants dans une dynamique.
Cet article contribue à rassembler, organiser et clarifier ce qui fait la biodiversité en tenant compte de l’avis des chercheurs.
La chaîne du vivant dont nous dépendons mérite que l’on soit d’accord sur l’évolution du code de l’environnement, sans pour autant omettre l’énorme chemin qu’il reste à parcourir pour préserver l’écosystème de notre planète.
Le groupe UDI-UC soutient la rédaction de cet article issue des travaux de la commission.

Cet article 1er permet de compléter la notion de patrimoine commun de la nation, telle que définie à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Reconnaître que les espaces, ressources et milieux naturels sont issus à la fois des mondes terrestre et maritime me semble par exemple une évidence, car la biodiversité englobe effectivement des espaces, ressources et milieux naturels tant terrestres que marins. Ainsi, la Méditerranée abrite près de 10 % des espèces marines connues dans le monde.
Mais, selon moi, la biodiversité inclut également les sites et paysages diurnes et nocturnes. Oui, il y a des paysages nocturnes affectés par la pollution causée par l’excès de lumière artificielle, ce qui touche directement la biodiversité et la vie des insectes, par exemple.
Pour moi, les paysages, tant diurnes que nocturnes, font donc partie du patrimoine commun de la nation et je regrette que cette référence ait été supprimée lors des travaux de la commission au Sénat.
Je regrette également que les sols ne figurent plus dans le texte de la commission. Je présenterai d’ailleurs des amendements sur ce sujet, car nous devons les considérer comme un bien commun, à l’instar de l’eau et de l’air, non dans leur seule et unique valeur foncière. Ce n’est pas un hasard si l’ONU a déclaré 2015 l’année internationale du sol.
Les sols – faut-il le rappeler ? – abritent un quart des espèces de la planète, font pousser nos forêts, nos fruits et nos légumes, stockent carbone et gaz à effet de serre et luttent contre les inondations. Ils rendent une multitude de services à l’humanité. Or nous détruisons ou dégradons nos sols agricoles dans l’indifférence générale. Entre 2006 et 2014, près de 500 000 hectares ont été artificialisés en France, soit l’équivalent d’un département ! Cette imperméabilisation empêche la circulation de l’air et de l’eau qui constituent des éléments vitaux pour les milliards d’organismes qui vivent dans les sols.
Nos sols sont aussi dégradés par l’épuisement des substances nutritives, l’acidification, la salinisation ou les pollutions. Cela entraîne une perte de fertilité et une réduction de la biodiversité.
Le phénomène est mondial : 33% des sols, dans le monde, sont dégradés.
Bref, la biodiversité est un tout et l’article 1er permet de renouveler et de préciser sa définition.
Je vous remercie, madame la ministre, d’attirer notre attention, par ce projet de loi, sur cette situation alarmante.
On apprend ainsi, dans une étude lancée sur l’initiative des Nations unies, que les espèces vivantes s’éteignent à un rythme 1 000 fois plus intense que celui dont font état les paléontologues pour les dernières 65 millions d’années… Qui pourrait rester inerte, alors que le monde est entré dans une sixième extinction de masse ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Joël Labbé applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je suis heureux de la tenue de ce débat sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il témoigne d’une volonté de donner une indispensable ampleur à la politique de protection de la nature et de mieux appréhender la diversité et la complexité de la biodiversité.
Comme vous le savez, ce sujet nous préoccupe au plus haut point, puisque les territoires français d’outre-mer sont riches d’espèces animales et végétales endémiques avec 3 600 plantes et 240 vertébrés.
Cette biodiversité foisonnante, unique, représente 1, 4 % des plantes du monde, 3 % des mollusques, 2 % des poissons d’eau douce, 1 % des reptiles et 0, 6 % des oiseaux. En outre, les récifs coralliens couvrent 55 000 kilomètres carrés et représentent 10 % de ceux qui existent dans le monde.
La biodiversité ultramarine représente 80 % de la biodiversité française. Le patrimoine naturel des collectivités françaises d’outre-mer est donc exceptionnel, tant par sa diversité que par son haut niveau d’endémisme.
Si ce tableau succinct témoigne de la place irremplaçable de l’outre-mer au sein de l’ensemble français, il ne peut occulter la fragilité de cette richesse patrimoniale, menacée par la surexploitation, la destruction et la fragmentation des habitats, l’introduction d’espèces invasives et les pollutions.
Le projet de loi qui nous est soumis a l’incontestable mérite de mettre en valeur une vision dynamique des écosystèmes, de valoriser le concept de solidarité écologique et, surtout, d’apporter des réponses pertinentes mobilisant les acteurs publics au service de la protection et de la restauration. Parmi ces réponses, je pense en particulier à la création d’un opérateur intégré, l’Agence française pour la biodiversité.
Vous avez déjà été sensibilisée, madame la ministre, à l’intérêt de la mise en place de délégations ultramarines, aux périmètres et aux compétences variables, qui auraient vocation à exercer tout ou partie des missions dévolues à la nouvelle agence.
En ce sens, l’article 32 du présent projet de loi prévoit la constitution d’établissements publics de coopération environnementale, ou EPCE, chargés d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement ainsi que leur diffusion, la sensibilisation et l’information des publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en œuvre d’actions de restauration des milieux.
Dans ce cadre, vous aviez été réceptive à l’idée de la mise en place d’une préfiguration de l’agence, qui conduirait à la création d’un établissement public de coopération environnementale en Martinique. Je m’inscris dans cette perspective de faire de la Martinique un EPCE pilote.
À ce titre, il me paraît vivement souhaitable que soient clarifiés par voie réglementaire le champ des missions de l’EPCE, les financements nécessaires, les mutualisations de moyens humains, la coopération avec les états de la Caraïbe, le mode de gouvernance et ses incidences sur celui des établissements publics que l’EPCE serait amené à intégrer, ainsi que les liens organiques entre l’EPCE et l’Agence française pour la biodiversité.
Je ne développe pas davantage cette question, sachant que j’y reviendrai lors de l’examen de l’article 32.
M. Joël Labbé applaudit.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le sujet de la biodiversité est parfois tourné en dérision. Je crois d’ailleurs avoir perçu quelques sarcasmes lors de la discussion générale, mais j’ai dû mal entendre… Toutefois, il est vrai que les urgences économiques et sécuritaires tendent à reléguer au second plan les défis écologiques, la biodiversité encore plus que le climat.
En outre, on oppose encore, parfois, environnement et développement, écologie et économie, nature et humanité. Or nous ne devons pas cliver nos débats, même si cette question peut faire appel aux fondements idéologiques, voire philosophiques, de notre engagement personnel.
Chers amis de la majorité, nous nous revendiquons, dans notre famille politique, d’une éthique de la responsabilité. Pour ma part, et sans craindre d’être taxé de conservateur, je crois que nous devons, avant tout, transmettre à nos enfants ce que nous ont légué nos parents. Davantage si nous pouvons, en tout cas pas moins ! La biodiversité, qui est décrite dans l’article 1er du projet de loi comme notre patrimoine commun, fait partie de cet héritage.
Alors que, dans la discussion générale, certains ont ri au sujet des ours, nous ne pourrions pas imaginer un monde sans lions, sans tigres ou sans éléphants.

Nous demandons aux peuples du tiers-monde de préserver ces fauves et pachydermes, beaucoup plus dangereux pour l’homme que les 30 ours et les 300 loups avec lesquels nous sommes manifestement incapables, en France, de cohabiter…
Même si vous ne partagez pas ce point de vue philosophique, plaçons-nous d’un point de vue purement utilitariste et anthropocentriste !
La biodiversité nous apporte d’infinis services, comme la pollinisation, mais elle est surtout le premier gisement de la pharmacopée. L’organisme animal ou végétal même le plus insignifiant contient en effet la molécule qui a sauvé, ou qui sauvera demain, des foules d’êtres humains.
Au cours de la discussion générale, plusieurs d’entre vous, mes chers collègues, ont rendu hommage à Hubert Reeves. Vous me permettrez de rendre, pour ma part, hommage au botaniste Jean-Marie Pelt, qui nous a quittés juste avant Noël. Il nous rappelait à quel point la biodiversité est une question essentielle pour l’humanité, en même temps qu’elle constitue, en faisant appel à notre esprit de responsabilité et à notre sentiment d’empathie, un test pour notre propre humanité.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, nous abordons le titre Ier du projet de loi dont je vous voudrais, en quelques mots, souligner la portée.
Ce titre contient d’abord trois grandes idées nouvelles.
Il affirme le principe selon lequel la biodiversité fait partie du patrimoine commun de la nation, comme cela a été rappelé lors de la discussion générale, de grande qualité, ce dont je vous remercie.
Il affirme également que la biodiversité génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. Elle est donc indispensable à notre vie, que ce soit, par exemple, sur un plan économique ou du point de vue de la santé publique.
Enfin, le titre Ier inscrit explicitement dans notre droit le triptyque éviter, réduire, compenser.
Je voudrais aussi rappeler que la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a inséré un article 2 bis, qui crée trois articles dans le code civil et est très important. Il est en effet relatif à la responsabilité environnementale. Bien évidemment, le Gouvernement soutient pleinement cet enrichissement du texte.
Les articles 3, 3 bis et 3 ter ajoutent les notions de continuité écologique et de pollution lumineuse, ainsi qu’un inventaire pédologique à la liste des inventaires du patrimoine naturel. Ce sont également des avancées.
L’article 4 définit le rôle de l’Agence française pour la biodiversité dans la stratégie nationale et sa contribution aux stratégies régionales.
Pour ce qui concerne l’article 1er que nous abordons maintenant, je souhaite préciser qu’il apporte des modifications très importantes à notre droit.
D’abord, il précise qu’il y a des milieux naturels qui sont terrestres et d’autres qui sont marins.
Ensuite, il inscrit dans le droit la notion de biodiversité. Par rapport au texte émanant de l’Assemblée nationale, qui avait repris la quasi-totalité de la définition issue de la convention internationale pour la diversité biologique telle qu’adoptée en 1992, la commission a simplifié la définition de la biodiversité. Cette dernière définition, qui fait consensus parmi les milieux associatifs et scientifiques, est également soutenue par le Gouvernement.
L’article 1er rappelle par ailleurs que la biodiversité est à la fois le produit de processus biologiques et de la géodiversité. C’est une vision plus dynamique que celle qui est en vigueur. Il est en effet essentiel de préserver les capacités d’évolution et d’adaptation des espèces et des écosystèmes, notamment dans le contexte du changement climatique.
Le patrimoine géologique, aussi appelé « géotope », est également pris en compte, comme vient de le souligner Marie-Christine Blandin.
Les discussions à l’Assemblée nationale ont abordé la question de la présence des sols dans les processus biologiques et la géodiversité. Les sols se situent effectivement exactement entre ces processus et la roche inerte ; ils constituent l’interface entre les deux.
La commission a retiré les sols du texte et nous aurons un débat sur ce sujet.
Des inquiétudes se sont manifestées pour ce qui concerne le droit de propriété et les activités agricoles. Nous devrons rassurer sur ces questions. Les sols sont bien des lieux majeurs de biodiversité. Ainsi, il existe en moyenne 260 millions d’animaux dans un mètre cube de prairie permanente et un hectare de sols forestiers compte davantage d’organismes vivants que la Terre compte d’êtres humains… En outre, la biomasse animale moyenne du sol est estimée à 2, 5 tonnes par hectare. Certes, il s’agit largement de micro-organismes, mais les enjeux sont considérables.
Nous devons donc lever les inquiétudes relatives au droit de propriété et aux activités agricoles, car les sols font bien partie de la biodiversité. Je serai très à l’écoute du débat qui aura lieu dans quelques instants sur ce point.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 456 est présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 524 rectifié est présenté par MM. Mézard, Amiel, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « sites, les paysages diurnes et nocturnes » ;
La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 456.

En ajoutant, dès cet article, les adjectifs « diurnes et nocturnes » au mot « paysages », il s’agit de permettre d’engager une lutte active contre les pollutions lumineuses et ainsi de préserver l’environnement nocturne. À nos yeux, l’importance des paysages s’apprécie de jour comme de nuit, et non pas uniquement de manière spatiale.
Par ailleurs, en commission, nous avons émis un avis favorable sur l’amendement n° 149 à l’article 3, qui a pour objet d’introduire dans le texte un objectif de sauvegarde de l’environnement nocturne. L’amendement n° 456 est donc pratiquement un amendement de cohérence par anticipation…

La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l’amendement n° 524 rectifié.

Cet amendement a pour objet de rétablir la précision introduite par l’Assemblée nationale.
L’alternance entre le jour et la nuit conditionne de nombreuses fonctions physiologiques, or la pollution lumineuse la met en cause, alors que 28 % des vertébrés et 64 % des invertébrés vivent partiellement ou totalement la nuit. Nous souhaitons donc préciser que les paysages tant diurnes que nocturnes font partie du patrimoine commun de la nation.

La commission a émis un avis défavorable.
Je rappelle à la Haute Assemblée que l’article L. 110-1 du livre Ier du code de l’environnement sur lequel nous travaillons est le premier article du code. Il s’agit non pas d’un article isolé dans un texte lointain, mais du premier article d’un code qui fonde le droit de l’environnement.
Si nous commençons à qualifier les sites et paysages, nous risquons de ne pas nous en sortir : il faudrait aussi parler des paysages montagnards, des paysages maritimes, des paysages vallonnés, avant ou après le coucher du soleil
Sourires.

On comprend bien le souci des auteurs, et l’idée est sympathique, encore que je ne sois pas complètement convaincu, car sait-on réellement ce qu’est un paysage nocturne ? Mais même si je prends pour argent comptant cette précision, elle n’a pas sa place ici.
Pour autant, les débats d’une assemblée parlementaire servent à enrichir la réflexion et chacun se souviendra que vous avez voulu sous-entendre que les paysages diurnes et nocturnes étaient concernés par le texte, ce à quoi la commission n’est pas hostile si la mention n’est pas expressément inscrite dans l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Le Gouvernement est favorable à ces amendements, par cohérence avec le vote de l’Assemblée nationale.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas les amendements.

Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 121 rectifié bis est présenté par MM. Courteau et M. Bourquin et Mme Bataille.
L'amendement n° 457 rectifié est présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 525 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après le mot : « végétales », sont insérés les mots : «, les sols » ;
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 121 rectifié bis.

Cet amendement vise à restaurer la mention des sols parmi les éléments constitutifs du patrimoine commun de la nation. En effet, ces derniers ont des fonctions écologiques, économiques et sociales inestimables.
Tout d’abord, ils constituent un patrimoine génétique immense à protéger : au moins 25 % de la biodiversité terrestre se trouve dans les sols, dont la grande majorité reste inconnue.
Ensuite, les services qu’ils fournissent sont très nombreux : le stockage et la transformation d’éléments nutritifs, le filtrage de l’eau, la production de biomasse, notamment pour l’agriculture et la foresterie ; ils jouent également un rôle important comme réservoirs de carbone ou encore dans la conservation du patrimoine géologique, archéologique et architectural.
En définitive, les sols sont le support du vivant. Or, selon le dernier rapport sur l’état des sols publié le 5 décembre 2015 par le Partenariat mondial sur les sols, 33 % des sols dans le monde sont dégradés par l’érosion, l’épuisement des substances nutritives, l’acidification, la salinisation, le tassement et la pollution chimique provoqués par les activités humaines.
En France, le constat est également alarmant, avec 11 millions d’hectares sur 56 millions, soit près de 20 % du territoire, qui sont aujourd’hui touchés par l’érosion, et 610 000 hectares qui sont urbanisés chaque année, soit l’équivalent d’un département comme l’Hérault artificialisé tous les sept ans, alors que 75 millions de Français attendront que l’agriculture pourvoie à leur alimentation en 2025.
Ainsi, reconnaître en France la composante des sols comme faisant partie du patrimoine national est un premier pas pour rappeler l’importance de la préservation de ces sols, avec tout le potentiel agronomique qu’ils représentent.

La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 457 rectifié.

Si l’amendement n° 456 n’était pas essentiel, il n’en va pas de même ici, car il me paraît pour le coup impossible de préserver la biodiversité sans préserver les sols. Comme l’a dit Roland Courteau, l’une des principales atteintes à la biodiversité est aujourd’hui la destruction des sols, notamment agricoles, la perte de ces derniers constituant un enjeu majeur.
Je ne comprends pas qu’il n’y ait pas dans cet article d’indication précise sur ce point absolument central pour la biodiversité, qui ne doit surtout pas être vu comme une contrainte par rapport aux activités. En effet, l’enjeu principal aujourd’hui n’est pas tant le déficit de réserves naturelles que la destruction des terres agricoles.
La préservation des sols doit donc figurer dès l’article 1er. Tel est le sens de cet amendement.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 525 rectifié bis.

Essentielles pour l’agriculture et la forêt, la production de biomasse ou encore le stockage de carbone, les fonctions écologiques, économiques et sociales des sols sont d’une importance qui mérite d’être soulignée dans le cadre de l’examen du présent projet de loi, d’autant plus que ces sols font l’objet d’une dégradation inquiétante.
En effet, l’érosion, l’acidification, la salinisation, le tassement ou encore la pollution chimique et l’épuisement des substances nutritives concernent, comme l’a dit Roland Courteau, 33 % des sols dans le monde et près de 20 % dans notre pays.
Le présent amendement vise donc à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale, qui mentionne les sols parmi les éléments constitutifs du patrimoine commun de la nation.
Nous avons décidé de déposer le même amendement que les écologistes.
Sourires.

C’est assez rare pour être signalé !
Pourtant, pour paraphraser Clemenceau, pour qui la guerre était une chose trop sérieuse pour être confiée aux militaires, je dirai que l’écologie est une chose trop sérieuse pour être confiée aux seuls écologistes…
Rires. – Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

L’avis de la commission est défavorable, cette référence ayant été supprimée tant sur mon initiative que sur celle de nombreux collègues.
Nous ne contestons pas l’intérêt des sols, mais la géodiversité qui est visée dans le texte inclut les sols. Si elle ne l’incluait pas, je comprendrais ces amendements, mais, selon les dictionnaires et les nombreux scientifiques que nous avons consultés, la géodiversité représente bien l’ensemble des éléments des sous-sols, sols et paysages, qui, assemblés les uns aux autres, constituent des systèmes organisés, issus de processus géologiques.
La notion de « géodiversité » est donc plus vaste que celle de « sols », mais elle comprend cette dernière, avec aussi les roches, les minéraux, les formes du relief, etc.
Nous avons retenu cette approche quasi sémantique pour supprimer la référence aux sols.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. Comme je l’ai souligné, les sols font partie de la biodiversité, les espèces animales et végétales pouvant se trouver dans ou sur les sols.
À mon sens, toutefois, intégrer les sols dans le texte aurait une portée normative assez limitée. Compte tenu des objections que nous avons entendues, s’agissant notamment de l’instabilité juridique que ferait peser la question des sols sur l’activité agricole et le droit de propriété, je le répète, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Certes, les sols sont par définition très importants par la richesse de la biodiversité, mais ils sont inclus dans la définition même du patrimoine naturel, telle qu’elle est rédigée de façon très complète dans le code de l’environnement et dans l’article qui vous est soumis.

Je suivrai la position de notre rapporteur, mais je voudrais, en toute amitié, faire quelques remarques à l’intention de certains de mes collègues.
Je suis d’accord avec eux sur l’importance des sols, mais je les incite à faire très attention à la véracité des chiffres qu’ils citent à l’appui de leurs amendements. Il y a non pas 600 000 hectares urbanisés dans notre pays chaque année, mais 60 000 hectares, ce qui est déjà énorme. Et si l’on considère que ce chiffre est faux, les autres pourcentages le sont sans doute aussi…
Je ferai une deuxième remarque. Beaucoup d’entre vous, ici, qui sont opposés à la mondialisation, bien qu’elle soit incontournable, seraient bien inspirés de ne pas mondialiser le discours et le débat dans les deux ou trois jours qui vont suivre.

… soient accusés de faire les mêmes erreurs que les agriculteurs de Chine, d’Amérique du Sud ou des pays anciennement communistes.
Un tel discours me gêne, car il est déshonorant pour les agriculteurs. Il est injuste de les accuser de ne pas connaître le fonctionnement d’un sol, de ne pas respecter le sol qu’ils vont transmettre à leurs enfants. C’est faux et je l’atteste ici : dans les différents organismes agricoles, les chambres d’agriculture et dans les coopératives, même si c’est avec un peu de retard pour ces dernières, des efforts considérables sont faits.
Certes, des erreurs ont pu être commises voilà quelques années, mais certains d’entre vous n’ont pas l’air de bien se rendre compte des évolutions techniques qu’a connues l’agriculture de notre pays. Les agriculteurs français ont en moyenne une formation de niveau IV, et beaucoup de BTS et d’ingénieurs s’installent en agriculture. Et ils savent comment fonctionne un sol, ils savent ce que c’est, un sol hydromorphe, un sol acide ou trop calcaire.
Je ne voudrais donc pas que l’on prenne uniquement des références mondiales pour illustrer le propos sur la dégradation des sols.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Mes chers collègues, il n’y a pas, de l’autre côté de l’hémicycle, les défenseurs des agriculteurs, et, de ce côté-ci, ceux qui leur tapent dessus.
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Pour rebondir sur l’amendement de nos collègues, je dirai que le sol est essentiel non seulement pour l’agriculture, mais également pour tout le vivant en général. Ce n’est pas être contre l’agriculture que de dire cela. Arrêtons de raisonner ainsi !
Je suis d’accord, les agriculteurs sont les premiers à avoir conscience de l’importance de leurs sols et nous savons bien pourquoi. M. Jean-Paul Emorine, que j’aperçois en face de moi dans l’hémicycle, sait parfaitement ce que représente la connaissance intime des sols et des climats en Bourgogne.

Je ne vois pas en quoi mes propos sont comiques, chers collègues !
En tout cas, nous le disons, nous sommes tous conscients de l’importance des sols. Et il s’agit non de s’opposer par principe à la rédaction de la commission, mais, au contraire, de voir dans quelle mesure nous pouvons faire en sorte de rapprocher les points de vue.
Certains collègues ont pensé qu’ils devaient déposer ces amendements. Je voulais les soutenir, mais j’ai suivi le débat et écouté le rapporteur, qui nous a expliqué que cette notion de « sols » est implicitement incluse dans le texte. Je n’aurais pas trouvé très grave de l’ajouter, mais je vais m’en remettre à la démonstration du rapporteur Bignon, car j’estime qu’il faut aussi savoir s’entendre les uns et les autres et éviter les clivages inutiles.
Pour conclure, j’aimerais bien que les élus de la majorité sénatoriale cessent de penser qu’ils sont les seuls à défendre l’agriculture !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et républicain, du groupe écologiste et du RDSE.

Quelle que soit la place que nous occupons dans cet hémicycle, nous nous accordons à considérer que le sol est un élément majeur, pour la survie de la biodiversité comme pour la survie de l’agriculture. Je pense aussi que personne, ici, ne souhaite faire un procès à quiconque, à aucun sénateur, sur aucune des travées. En effet je suis convaincue que la conscience de l’utilité du sol et de son importance est partagée.
Je m’adresse maintenant à notre collègue Roland Courteau, qui a dit sa préoccupation quant à l’érosion de terres. Le sujet a déjà été traité dans un certain nombre de lois ; je pense notamment aux textes qui limitent l’artificialisation des sols et privilégient la densification. Il y est déjà fait mention de cette consommation importante des terres, qu’il s’agit d’éviter.
Ce genre de sujet est typiquement de nature à exacerber les tensions inutiles ;particulièrement au moment où nous débattons d’un projet de loi pour la reconquête de la biodiversité.
À partir du moment où le rapporteur nous démontre que le terme de « géodiversité » est beaucoup plus large que la simple évocation des « sols », nous pouvons suivre ses recommandations. Cela nous permettra de ne pas attiser les tensions avec les agriculteurs et, au-delà, avec d’autres propriétaires, ceux qui, quand on leur parle de « sols », entendent « propriété du sol » et « droit du sol », avec toute l’insécurité juridique que cela peut susciter.
La sagesse commune qui est de mise dans cet hémicycle devrait nous conduire à suivre le rapporteur !

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.
On encourage affectueusement « l’abbé Pierre » sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain.

Je crois avoir entendu des encouragements destinés à « l’abbé Pierre » ! J’accepte cette référence avec fierté !
En tout cas, je voudrais, à mon tour, parler de sagesse. Cela a été dit, 2015 était l’année mondiale des sols. Le 1er décembre 2015, je faisais partie, dans le cadre de la COP 21, de la délégation qui accompagnait Stéphane Le Foll pour le lancement de l’opération « 4 pour 1 000 », une initiative soutenue par plus de cent États et organisations. Tout le monde en est d’accord, les sols sont importants pour la sécurité alimentaire, mais ils le sont aussi pour la régulation climatique.
Il faut mettre un terme au prétendu clivage entre agriculteurs, car ils s’accordent tous à penser que le sol vivant de la terre nourricière doit être préservé.
Je ne comprends pas que nous ne parvenions pas à nous rejoindre sur un point aussi évident. On sort de la COP 21, la France a tiré la négociation vers le haut, et nous ne sommes pas capables d’inscrire les sols dans notre texte ! Je suis terriblement déçu, je ne comprends pas et je me dis que le débat est mal parti.
Mais je me ressaisis et le dis calmement, cette mention des « sols » me semble d’un tel bon sens, elle est tellement simple, elle est tellement sage ! Cher rapporteur, cela, tu peux le comprendre ! Je conçois que tu ne puisses pas revenir sur la décision de la commission, mais Mme la ministre s’en remet à la sagesse de notre assemblée. Alors, soyons sages, et adressons à la population un véritable signe positif dans cette loi pour la reconquête de la biodiversité !

Je relève une petite difficulté dans le terme de « géodiversité », lequel contient l’idée de préserver la diversité des sols existants. Mentionner dans la loi le mot « sols » s’inscrit en effet dans une perspective économique, ce qui n’est pas du même ordre. Le terme de « géodiversité » reste extrêmement ambigu. Même si on parle de « sols », ce n’est plus leur diversité qui est visée.
C'est la raison pour laquelle je pense qu’il faut conserver cette mention des sols. D’autant qu’il serait dommage qu’un axe Dantec-Mézard – cela n’arrive pas si souvent !– n’aboutisse pas à un succès.
Sourires.

Surtout, je pense qu’il faut nous garder d’un clivage entre ceux qui seraient les défenseurs de l’agriculture et ceux qui ne connaîtraient pas les paysans. C’est absolument faux ! Celui qui s’est exprimé avant moi est fils de paysan.
Sans doute avons-nous, de part et d’autre de l’hémicycle, des visions de l’avenir de l’agriculture qui ne sont pas exactement les mêmes. J’ai tendance à penser que la nôtre est porteuse de création d’un plus grand nombre d’emplois d’actifs agricoles. Ce débat entre nous, on le connaît, il est de nature politique. En tout cas, sur ce point, ne restons pas dans la caricature !
Je suis élu de la Loire-Atlantique, département dans lequel un certain projet est contesté. Ce projet fait l’unanimité du monde agricole contre lui, même s’il y a des désaccords sur la manière de lutter contre.
L’ensemble des syndicats agricoles s’accordent aujourd'hui sur cette idée qu’il faut préserver les sols. C'est la raison pour laquelle il me paraît important de garder le mot « sols ».

Je partage le point de vue de M. Dantec sur l’ambiguïté du terme « géodiversité ».
Pour en revenir au texte de nos amendements, franchement, je ne vois pas en quoi le fait de reconnaître en France la composante des sols comme faisant partie du patrimoine de la nation serait contraire aux intérêts des agriculteurs ! Vraiment, je ne vois pas !

Il faut relire le texte ! Vos amendements sont satisfaits par la rédaction du projet de loi !

Je suis d’accord avec mon collègue Raison. Il y a deux choses : sur la protection des surfaces agricoles, nous sommes tous d’accord. C’est vrai, on l’a dit tout à l’heure, le nombre d’hectares abandonnés au profit de l’urbanisation ne cesse de croître. Qui voudra nourrir la planète demain ?
Mais, ce qui nous inquiète, et qui nous interroge, c’est l’objet de l’amendement. Qu’entend-on ici par « restaurer » ? Faut-il comprendre que les agriculteurs ont détruit les sols au point qu’il faut les restaurer ? Devons-nous nous attendre à une prochaine interdiction de labourer ? §Sera-t-il interdit, demain, de travailler la vigne à la main ?
Si nous nous posons des questions, c’est que nous vivons d’ores et déjà dans les exploitations les suites du Grenelle de l’environnement. Je vous invite à venir voir sur place !
Nous mesurons aussi les effets de la loi Santé, qui va jusqu’à nous empêcher d’aller chercher chez le vétérinaire de quoi traiter la mammite d’une vache ! C’est au vétérinaire de venir et de parcourir les kilomètres ! Et toujours au nom de l’environnement…
Aujourd'hui, ceux qui vivent dans les fermes voient toutes les conséquences de l’application des décisions prises au nom de l’environnement ! Ce dont nous avons peur, c’est que, demain, on interdise aux agriculteurs de labourer ou de retourner la terre. On a essayé de faire sans labours, c’est vrai. Dans certaines régions, cela marche très bien et il y a même des endroits où les agriculteurs ont vendu les charrues. Et puis, sept ou huit ans plus tard, il a fallu en racheter parce que les cultures n’étaient plus bonnes.
Ce que je ne voudrais pas, mesdames, messieurs, c’est que, demain, des décrets d’application viennent interdire aux agriculteurs, au nom de ces objectifs de restauration, de ne plus faire ceci ou cela. Telle est notre crainte, madame la ministre. Et, ces sols, les a-t-on à ce point détruits qu’il faille les restaurer ? C’est ce que je vous demande, madame la ministre !

M. le rapporteur a été très clair, mais n’a pourtant pas été compris. Je monte au créneau pour conforter son propos, qui est tout à fait exact.
Je suis allé vérifier la définition de la géodiversité en consultant le site de l’Inventaire national du patrimoine. La définition retenue pour la biodiversité est empruntée à Sharples. « Elle représente l’ensemble des éléments des sous-sols, sols et paysages qui, assemblés les uns aux autres, constituent des systèmes organisés issus de processus géologiques. »
On ne peut pas faire plus simple ! Si l’on veut être redondant, continuons, mais il ne faudra pas se plaindre, après, que les lois et les textes sont bavards ! Si l’on veut passer des heures et des heures sur les amendements, continuons !
Les choses sont claires et nettes. Dans la rédaction de la commission, la notion de « sols » est implicitement incluse. Ceux qui ne veulent pas le comprendre ne le comprendront jamais, même si la discussion doit se prolonger encore trois heures !
L’analyse des débats, à laquelle on procède toujours quand il y a doute, aidera à la compréhension du texte. Elle fera apparaître que nous avons voté en prenant en compte les sols dans leur totalité.

Je veux compléter ce que vient de dire M. le président de la commission. Si nous engageons des débats sémantiques qui n’ont pas lieu d’être, nous allons rentrer dans des guéguerres entre nous qui ne nous permettront pas d’atteindre l’objectif principal, qui est de faire en sorte de sauver cette biodiversité.
De grâce, essayons de nous concentrer sur l’essentiel et non pas sur une acception qui est complètement vérifiée et admise au niveau légal !

M. le président. Mes chers collègues, il nous reste plus de six cents amendements à examiner ; vous aurez donc matière à discuter encore !
Sourires.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 121 rectifié bis, 457 rectifié et 525 rectifié bis.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 1 er est adopté.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 122 rectifié est présenté par MM. Courteau et M. Bourquin et Mme Bataille.
L'amendement n° 458 est présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre … ainsi rédigé :
« Titre …
« Préservation et protection des sols
« Art. L. 230-… – Est d’intérêt général la protection des sols contre les processus de dégradation, tant naturels que provoqués par les activités humaines, qui compromettent la capacité des sols à remplir chacune de leurs fonctions écologiques, économiques, sociales et culturelles.
« L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la protection et l’utilisation durable des sols. Cette politique comprend des mesures de suivi des sols, de prévention de leur dégradation, d’utilisation rationnelle et durable ainsi que de remise en état et d’assainissement des sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité qui respecte les besoins des générations futures. »
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 122 rectifié.

M. Ronan Dantec. Cet amendement est opérationnel, mais, allez savoir pourquoi, je crains que cela ne suive pas…
Sourires.

J’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur ces amendements identiques. Ils visent à créer un nouveau titre au sein du code de l’environnement relatif à la préservation et la protection des sols et à énoncer qu’elle est d’intérêt général.
Nous avons eu ce débat en commission. L’article 1er du projet de loi, tel qu’il est rédigé, paraît suffisant. Il n’y a pas lieu de surcharger le nouveau code de l’environnement de dispositions qui relèvent de la simple incantation et qui sont donc dépourvues de valeur juridique.
Je suggérerai aux auteurs des amendements de bien vouloir les retirer, car la rédaction de l’article 1er, comme j’ai eu l’occasion de le dire au sujet des précédents amendements, donne satisfaction à leur légitime préoccupation.
Je demande, moi aussi, au nom du Gouvernement, le retrait de ces amendements. Nous comprenons l’objectif, mettre en place une politique nationale de prévention, de préservation et de protection des sols qui comprendrait des mesures de suivi des sols, de prévention de leur dégradation, d’utilisation rationnelle et durable, ainsi que de remise en état et d’assainissement des sols dégradés.
Je suis sensible à l’enjeu de la gestion durable des sols. C’est d'ailleurs la raison pour laquelle le ministre de l’agriculture et moi-même avons lancé sur ce sujet une enquête interministérielle suivie par nos deux inspections. Cette enquête doit aboutir à la définition d’une stratégie nationale des sols qui énoncera des mesures de suivi, de prévention et d’utilisation rationnelle et durable. Cette démarche permettra alors d’élaborer des dispositions législatives.
Je suggère le retrait de ces amendements, soulignant que ces travaux sont en cours avec les professions concernées et qu’ils doivent déboucher sur des dispositifs bien calibrés par rapport à l’objectif qui est le vôtre, monsieur Courteau, monsieur Dantec.

Non, monsieur le président, j’ai été convaincu par les propos de Mme la ministre et, par conséquent, je retire l’amendement.

L’amendement n° 122 rectifié est retiré.
Monsieur Dantec, maintenez-vous l’amendement n° 458 ?

L’amendement n° 458 est retiré.
L’amendement n° 266 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Poher, Madrelle, Guillaume, Bérit-Débat, Camani, Cornano et Filleul, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mme Tocqueville, MM. Cabanel, Yung, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 312-19 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle comporte également une sensibilisation à la préservation de notre biodiversité, notamment par la création de jardins de la biodiversité dans les écoles élémentaires. »
La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.

Cet amendement vise à faire mention dans le code de l’éducation, à l’article L. 312–19, d’une sensibilisation spécifique à la préservation de notre biodiversité.
En effet, nous savons que les habitudes s’ancrent dès le plus jeune âge. Par conséquent, si nous souhaitons que nos comportements sociaux évoluent de façon pérenne, nous devons mieux sensibiliser et former les nouvelles générations. Cette éducation à l’environnement dispensée dès l’école primaire en est l’un des vecteurs.
Je rappellerai par ailleurs que nous avons déjà modifié de façon similaire le même code de l’éducation pour y insérer une sensibilisation à l’alimentation – modification effectuée par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt – ; nous devrions bientôt introduire une modification similaire en faveur d’une sensibilisation au gaspillage alimentaire – la proposition de loi à ce sujet doit être débattue au début de février. Il me semble donc normal, sur le principe, de mentionner de même une sensibilisation à la biodiversité.
Il est indiqué dans mon amendement que cette sensibilisation peut passer par la création de « jardins de la biodiversité ». Il n’y a là, bien évidemment, aucune obligation : cela figure à titre d’exemple.
Pour en terminer, je voudrais rappeler que cette proposition figurait dans le rapport Pesticides, vers le risque zéro, que j’ai remis en 2012 et qui a été adopté à l’unanimité par la mission d’information. Sophie Primas, qui en était la présidente, avait voté les recommandations de ce rapport : je compte donc sur son soutien, comme sur celui du Sénat tout entier, pour cet amendement à mes yeux important.

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. En effet, son objet est pour le moins du domaine réglementaire. Certes, c’est une excellente idée que de chercher à sensibiliser les enfants à la biodiversité ; cependant, cela relève des activités et du temps périscolaires.

M. Alain Néri. Merci de conforter le temps périscolaire du Gouvernement !
Sourires.

On ne va tout de même pas écrire dans la loi que les enfants doivent créer des jardins de la biodiversité !
Je ne porte pas là de jugement de valeur sur cette idée, que je trouve plutôt ingénieuse ; du reste, je partage l’objectif de Mme Bonnefoy. Et notre collègue met beaucoup de cœur à défendre son amendement, ce qui est d’autant plus sympathique que nos discussions ont pu être dures…Cela dit, cet amendement ne relève pas du domaine de la loi : il faudrait plutôt suggérer à Mme la ministre de l’éducation nationale de reprendre cette bonne idée dans un arrêté traitant des activités périscolaires.

Mais on l’a décidé pour l’alimentation et on s’apprête à le faire pour le gaspillage alimentaire !
Je suggérerai aussi le retrait de cet amendement.
L’idée est bonne : d’ailleurs, dans le cadre des territoires à énergie positive, mon ministère finance des coins nature et des potagers dans les écoles. Néanmoins, cela ne relève pas du domaine législatif, d’autant que le dispositif serait facultatif. Par ailleurs, nous avons déjà beaucoup à faire avec la réforme du code de l’environnement ; il serait donc malvenu de commencer à modifier le code de l’éducation, comme vous le proposez ici.
Par conséquent, si je salue votre idée et votre initiative – je souhaite d’ailleurs qu’il existe des jardins éducatifs non pas seulement, comme vous le proposez, dans les écoles élémentaires, mais aussi dans tous les établissements scolaires, y compris donc les lycées et les collèges –, je demeure persuadée qu’il nous faut être extrêmement rigoureux dans l’élaboration dans la loi et rester dans le cadre du code de l’environnement.
Voilà pourquoi je vous suggère, madame la sénatrice, de retirer cet amendement.
I A
« Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. »
I. – Le II du même article L. 110-1 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;
b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots : «, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent » ;
2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce principe implique d’éviter les atteintes significatives à l’environnement ; à défaut, de les réduire ; enfin en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites. » ;
2° bis
Supprimé
3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires directement concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés. »
I bis (nouveau). – Après le dix-huitième alinéa de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un 18° ainsi rédigé :
« 18° De promouvoir le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture et la sylviculture, selon lequel les surfaces agricoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles et forestières peuvent être vecteur d’interactions écosystémiques garantissant, d’une part, la préservation des continuités écologiques, d’autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité. »
II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de non-régression et l’opportunité de l’inscrire dans le code de l’environnement.

Monsieur le président, madame la ministre, en examinant l’article 2, nous allons traiter, par notre volonté politique, de la question des usages. Sur cette question, et sur la biodiversité plus largement, je souscris à la position de la commission, qui n’a pas souhaité faire de cette discussion un débat sur la chasse et la pêche. Je voudrais simplement vous dire deux mots sur deux chasses traditionnelles dont vous avez pu entendre parler.
Dans le département des Landes, on pratique la chasse à deux types de passereaux : le pinson des arbres et le pinson du Nord, d’une part, le bruant ortolan, d’autre part. Je comprends que la chasse au pinson du Nord et au pinson des arbres puisse choquer quelque peu. Néanmoins, des études scientifiques font apparaître que leur population compte parmi les plus importantes du paléarctique. Alors, qu’on ne vienne pas me dire que c’est pour lutter en faveur de la biodiversité qu’on interdit ce prélèvement !
Il s’agit d’un prélèvement ancestral, historique, réalisé avec des pièges très légers qui ne blessent pas les animaux mais permettent de les relâcher. Que l’on surveille, que l’on sanctionne, que l’on punisse et que l’on interdise la vente, pourquoi pas ! Mais que l’on interdise la chasse au nom de la biodiversité, non !
S’agissant du bruant, c’est encore pire. Ce sont les chasseurs, dont je suis comme bien d’autres, ainsi que les collectivités territoriales qui financent une étude commise par le Muséum d’histoire naturelle afin de tenter de démontrer que les populations de bruants se portent bien. Je suis le seul, madame la ministre, à avoir eu le courage politique d’aller devant plus de mille chasseurs pour leur demander de voter que, en cas de mauvaise santé de l’espèce, nous cesserions tout prélèvement. En revanche, dans le cas où l’espèce se porterait bien, nous souhaiterions une dérogation.
Le pire, mes chers amis, c’est que, dans cette situation, nous avons des autorisations, mais de bouche à oreille. Personne n’ose aller devant les chasseurs, sauf votre serviteur, et pour leur dire que, parce qu’ils ont accepté de respecter les règles et de réduire leurs tenderies et leurs prélèvements, ils pourront encore chasser. Et pourtant, les mêmes chasseurs voient des plaintes déposées par des Parisiens qui arrivent harnachés de caméras : les magistrats instruisent ces plaintes et sanctionnent les chasseurs. Nous vivons là un moment absolument schizophrénique : d’un côté, l’exécutif tolère ; de l’autre côté, la magistrature sanctionne.
Pour ma part – vous le comprendrez, madame la ministre –, c’est comme un appel au secours que je vous lance ici : je vous demande de nous aider, d’aider notre territoire à vivre ce moment, qui sera dur à passer si l’on n’y met pas bon ordre.

L’article 2 du présent texte consacre la reconnaissance de la biodiversité et précise notamment les principes d’action préventive résumés dans le triptyque éviter- réduire- compenser, cet ERC qui se voit ainsi inscrit dans notre droit.
Cet article introduit aussi un nouveau principe, celui de solidarité écologique, qui implique de prendre en compte dans toute prise de décision publique ayant une incidence sur l’environnement les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés.
J’apprécie surtout que le texte pose l’obligation de compensation comme moyen ultime, après l’évitement et la réduction du dommage, de préservation de la biodiversité. L’objectif d’absence de perte nette de biodiversité est, selon moi, essentiel.
De fait, la meilleure des compensations écologiques est celle qui n’a pas lieu d’être, disait à raison Jacques Weber. En effet, mieux vaut éviter de détruire que d’être obligé de réparer : c’est d’ailleurs ce que faisait remarquer la mission Économie de la biodiversité.
Le problème est que les activités humaines ne parviennent pas toujours à éviter les impacts. Il convient donc de chercher à les éviter au maximum et, si cela n’est pas possible, à les réduire au minimum, mais il convient, si nécessaire, de les compenser. Cette compensation est donc bien l’un des moyens nous permettant d’aboutir à l’absence de perte de biodiversité.
Je reste convaincu que plus l’exigence de restauration écologique sera forte, plus la compensation aura un coût important, et plus les entreprises seront alors incitées à éviter et à réduire leurs impacts.
Voilà pourquoi ces dispositions me paraissent essentielles. Voilà pourquoi cet article me paraît important. Voilà pourquoi il serait maladroit de condamner par principe la compensation, dernière étape et moyen ultime d’une démarche plus large, qui vise d’abord à éviter et à réduire les impacts.

L’article 2, tel que rédigé par la commission, rappelle que la biodiversité est un patrimoine commun qui génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. Il rappelle aussi la responsabilité de tous, et notamment de ceux qui l’exploitent – les exploitants sont légitimes, à la différence des exploiteurs, là est toute la nuance – ; pour autant, la biodiversité n’appartient pas à certains, mais constitue un bien commun.
Très justement, cet article rappelle la nécessité d’éviter les atteintes à l’environnement, de les réduire et, en dernier lieu – si l’on évite à tout prix, alors on ne fait plus rien –, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ou réduites.
L’article 2 pose le principe de responsabilité, qui me tient à cœur comme il devrait tenir à cœur de tous les membres de ma famille politique, qui le revendique dans tous les domaines. J’évoquais déjà ce principe au sujet de l’article 1er.
Je voudrais à cet égard, monsieur le rapporteur, vous féliciter quelque peu en avance pour l’article 2 bis, qui aménage enfin le principe de responsabilité environnementale et l’intègre au code civil. Il reprend les dispositions d’une proposition de loi de Bruno Retailleau que nous avions adoptée à l’unanimité en mai 2013, mais que l’actuelle majorité de l’Assemblée nationale n’a manifestement jamais voulu adopter. Mme la garde des sceaux voulait accaparer le sujet, promettant de s’y dévouer, mais n’a jamais conclu ses travaux.
Il est temps selon moi d’intégrer la notion de « préjudice écologique » dans le code civil : c’est ce que fait l’article 2 bis, qui donnera son effectivité à la responsabilité environnementale introduite à l’article 2.

Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 1 rectifié quater est présenté par M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Vasselle, Mme Canayer, MM. Gilles, Pointereau, Milon, Mouiller et Panunzi, Mme Gruny, M. Kennel, Mme Lopez, MM. Bouchet, Laufoaulu, D. Laurent, Trillard, César, Mayet, Lemoyne, Cornu, Morisset et Laménie, Mmes Micouleau et Primas, M. Commeinhes, Mme Giudicelli, M. Charon, Mme Lamure, MM. Vaspart, Doligé, J.P. Fournier, Poniatowski, Genest, Danesi, Grand, Bizet, Pillet, Pellevat, Pinton, de Nicolaÿ, Revet, Lefèvre, B. Fournier, Longuet, Pintat, Vial et Darnaud, Mme Morhet-Richaud, MM. Allizard, Delattre, Masclet, P. Leroy et Lenoir, Mme Deseyne et MM. A. Marc, Dassault, Chasseing, Raison, Gremillet, Luche, Houpert, Savary, Médevielle, Guerriau, D. Dubois et Gournac.
L’amendement n° 79 rectifié ter est présenté par MM. Bérit-Débat, Patriat et Carrère, Mmes Cartron et D. Michel, MM. Vaugrenard, Camani, Labazée, Roux et Manable, Mmes Jourda, Herviaux et Bataille, MM. Montaugé, Lalande, Jeansannetas, Lorgeoux, J.C. Leroy, Chiron et Courteau, Mme Riocreux et MM. Mazuir, Madrelle, Cazeau et Raynal.
L’amendement n° 528 rectifié est présenté par MM. Bertrand, Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…°Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elles prennent en compte les valeurs intrinsèques ainsi que les différentes valeurs d'usage de la biodiversité reconnues par la société. » ;
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié quater.

Nous sommes là dans un débat assez technique concernant la composition de la biodiversité et la prise en compte de certaines valeurs.
Je ne répéterai pas l’objet de l’amendement, qui fait référence aux données objectives actuellement en vigueur, telles que la définition patrimoniale de la diversité qui figure dans le code de l’environnement et la définition de la valeur intrinsèque qu’est la biodiversité à l’égard d’elle-même.
En revanche, un certain nombre d’activités humaines constituent des valeurs d’usage. On est là au cœur du problème que j’ai évoqué dans mon propos liminaire : il faut comprendre que les paisibles activités humaines d’utilisation des choses de la nature font partie de la biodiversité. Ces activités sont rapidement définies dans l’objet de l’amendement : elles comprennent, bien évidemment, la chasse et la pêche, mais aussi la cueillette, la randonnée, l’alimentation ou encore l’énergie.
Je vous ferai grâce des détails de tout ce qui peut se transmettre depuis des siècles, de génération en génération. Je ne parlerai pas de la chasse : notre collègue Jean-Louis Carrère y a décrit en détail des techniques extrêmement précises. Je mentionnerai en revanche certaines médecines naturelles, l’utilisation d’herbes, certaines techniques de pêche, certaines techniques culinaires et gastronomiques, enfin certaines approches météorologiques qui sont des usages ancestraux…
Il faut pouvoir prendre en compte l’ensemble de ces usages.
Je ne comprends pas, sur ce point, la position de notre rapporteur. La commission a adopté un amendement de M. Dantec selon lequel le patrimoine commun de la nation génère des systèmes écosystémiques et des valeurs d’usage : nous sommes d’accord sur ce point. J’ai lu attentivement le rapport : le rapporteur nous y explique que, si les systèmes écosystémiques, c’est-à-dire ce qu’apporte la biodiversité elle-même, ou encore la relation des éléments naturels, faune et flore, entre eux, relèvent bien de ce texte, les valeurs d’usage que je viens de définir doivent quant à elles être fléchées par le code rural.
Je ne comprends pas cette nuance. En effet, nous définissons la biodiversité de façon novatrice. Il faudrait donc à mon sens, dès lors que cet amendement du groupe écologiste a été adopté par la commission, que les valeurs d’usage, dans toute leur diversité, se rajoutent aux valeurs patrimoniales et aux valeurs intrinsèques de la biodiversité.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour présenter l’amendement n° 79 rectifié ter.

Cet amendement est identique au précédent. Ce n’est pas le fruit du hasard : tous deux sont portés par le groupe d’études Chasse et pêche du Sénat. Les signataires de mon amendement partagent les arguments développés par M. Cardoux. En effet, au-delà de la dimension patrimoniale de la biodiversité, il importe à nos yeux de mentionner ici les valeurs d’usage, qui comprennent la chasse et la pêche, mais vont au-delà.
J’espère que cet amendement sera voté par l’ensemble des membres de cette assemblée.

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 528 rectifié.

Relisons l’article L. 110–1 du code de l’environnement : « Les espaces, les ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques font partie du patrimoine commun de la nation. »
La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a apporté une précision utile en reconnaissant expressément que ce patrimoine « génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage ».
En effet, la biodiversité, par l’ensemble des services qu’elle rend, a une valeur inestimable ; plusieurs études, notamment le rapport de Bernard Chevassus-au-Louis, ont tenté de les « monétariser ».
Deux des trois catégories de valeurs de la biodiversité ont été consacrées dans notre droit : sa valeur intrinsèque et sa valeur patrimoniale. Ce projet de loi est l’occasion de consacrer les valeurs d’usage que sont, par exemple, l’alimentation, la chasse, la pêche ou encore l’énergie.
Cet amendement a pour objet de préciser que les mesures prises en faveur de la biodiversité doivent prendre en compte ces valeurs.

La commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques, qui ont déjà été déposés en commission et rejetés. Ils me semblent d’ailleurs satisfaits par un amendement adopté en commission, qui inscrit de façon équilibrée dans ce projet de loi que le patrimoine commun de la nation génère des valeurs d’usage et des services écosystémiques.
J’ajoute, au risque de paraître insistant, que nous en sommes à l’article L. 110-1, soit le premier article du code de l’environnement, qui pose les grands principes du droit de l’environnement et affirme que la restauration, la protection et la mise en état des espaces et milieux naturels sont d’intérêt général.
Alors que nous ne cessons de réclamer des simplifications et des textes clairs, de vouloir que nos compatriotes comprennent ce que nous voulons dire dans les lois que nous faisons, nous ne pouvons nous empêcher – moi le premier – de tout compliquer et d’en rajouter. Ce faisant, nous créons de l’imprécision, de la complexité et des sources de contentieux. Nous nous prenons les pieds dans le tapis et tombons dans le travers même que nous combattons.
Je suis donc extrêmement prudent : nous rédigeons ici un article du code de l’environnement, pas un arrêté préfectoral !

J’ai écouté avec beaucoup d’attention l’avis de la commission. Avec toute l’amitié que j’ai pour le rapporteur, je me permets de lui faire remarquer que, si le texte issu des travaux de la commission précise que ce patrimoine « génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage », il ne s’agit là que d’un constat, et nous ne pouvons nous en contenter. C’est pourquoi ces amendements identiques défendus notamment par M. Cardoux visent à aller beaucoup plus loin, en prévoyant non pas le seul constat mais bien la prise en compte de ces usages, laquelle devient un élément opposable à tous ceux qui, d’aventure, voudraient faire en sorte que cela passe par pertes et profits.
Je comprends très bien que le rapporteur ne veuille pas surcharger le texte. Pour autant, je pense qu’il faut adopter ces amendements identiques et laisser à la commission mixte paritaire le soin de trouver une rédaction permettant d’intégrer à la fois ce qui est souhaité par la commission et ce qui est souhaité très majoritairement par les deux tiers, les trois quarts, voire les quatre cinquièmes des membres de la Haute Assemblée.
Rien ne s’oppose à ce que nous adoptions ces amendements identiques dès maintenant. Ce sera un signal fort témoignant que les valeurs d’usage doivent être prises en compte dans le cadre de ce texte, parce qu’il s’agit d’un élément essentiel de la biodiversité.

Je remercie Alain Vasselle d’avoir parfaitement explicité la démarche des signataires de ces amendements identiques, qui font référence à l'amendement de Ronan Dantec. On constate que le patrimoine commun génère des valeurs écosystémiques et des valeurs d’usage, mais, comme l’a souligné Alain Vasselle, nulle part il n’est mentionné que l’on prend en compte ces mêmes valeurs d’usage dans la défense de la biodiversité. Nous voulons donc que cette précision soit apportée.
Pour illustrer mon propos, je prendrai un exemple simple, voire simpliste, hors de notre pays – pardonnez-moi, cher collègue Raison, je vais faire de la mondialisation ! §En Amazonie, on découvre parfois des populations indigènes qui, vivant en autarcie, étaient jusque-là inconnues. Ces populations, qui sont très marginales, utilisent la biodiversité et en font partie, parce qu’elles ont des méthodes de vie très naturelles.
Si je suis la logique de l’amendement de Ronan Dantec, ces populations font partie de la biodiversité et on le constate. Cependant, il faut aller plus loin et les défendre. Si ce principe avait été appliqué, on ne les aurait pas chassées des territoires où elles vivaient depuis si longtemps, pour faire de la déforestation. Maintenant que le principe est posé que le patrimoine commun contient des services écosystémiques et des valeurs d’usage, nous devons nous engager à défendre ces dernières.

L’article L. 110-1 du code de l’environnement met en avant le principe du développement durable, principe qui prend en compte l’environnement, le social, mais également l’activité économique. Je crains d’ailleurs fort que la réécriture de l’alinéa 6, qui met en œuvre la solidarité écologique, ne sous-entende une primauté de l’écologie par rapport à l’activité humaine.
L’adoption de ces amendements identiques est donc importante, puisqu’elle permettra d’inscrire les usages dans le texte de façon positive et non pas comme un simple constat.
Voilà pourquoi j’ai cosigné l’amendement n° 1 rectifié quater et je le voterai.

Jusqu’à présent, sur ces amendements identiques, j’étais d’avis que le groupe CRC s’abstienne. Toutefois, après avoir entendu les explications de la commission et les différentes interventions, je prends conscience que l’on est en train de confondre l’outil et son utilisation, alors que c’est tout à fait différent. Pour définir un marteau, on donne sa description, on précise comment il est constitué, mais on ne mentionne pas, dans le même temps, tout ce que l’on peut faire avec cet outil. Outil et utilisation sont deux notions différentes.
L’explication du rapporteur est tout à fait juste. Mes chers collègues, vous êtes en train de vouloir imposer dans un texte une façon d’utiliser la biodiversité, parce que vous voulez tout verrouiller. Pour ma part, je ne crois pas que ce soit de bonne politique, car nous en sommes à la définition de ce qu’est la biodiversité. Il ne faut pas mélanger cette définition avec les usages.

Je relis l’alinéa 2 de l’article 2 dans la rédaction proposée : « Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. » Comment justifier une telle rédaction à nos concitoyens ? C’est un pur constat ! J’ai l’impression que l’on enfonce une porte ouverte !
Ce qui importe à nos concitoyens, c’est de faire en sorte que les habitudes qui découlent des usages soient prises en compte. Madame la ministre, il va bien falloir faire accepter à nos concitoyens cette loi à laquelle vous tenez tant, si nous voulons qu’elle soit respectée et, avec elle, la nature, qui est notre souci à tous.

Il nous appartient d’expliquer à nos concitoyens que ce patrimoine est extraordinaire. Pour ce faire, un certain nombre de concessions s’imposent. Il faut insister sur le fait que les usages pourront continuer dans les années à venir, car ils ne vont pas à l’encontre de la biodiversité.
C’est la raison pour laquelle on pourrait compléter l’alinéa 2 de l’article 2, qui me semble trop générique, en précisant par sous-amendement que ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage « qu’il est nécessaire de prendre en compte ». Ainsi, nous résumons bien les enjeux et nous soulignons que les usages sont bien pris en compte dans ce texte.

J’ai écouté attentivement les différentes interventions, notamment l’explication d’Alain Vasselle. Certes, l’article L. 110-1 fait le constat que ce patrimoine « génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage », mais le texte ne s’arrête pas là et tout ce que vous voulez ajouter, mes chers collègues, s’y trouve déjà : « Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable. »
Vous ne pouvez pas nous faire le procès de proposer un texte sec. Ce n’est pas vrai !
Par ailleurs, je ne comprends pas très bien ce qu’est une « valeur intrinsèque » et j’aimerais bien que l’on m’en donne un exemple précis et pratique.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 1 rectifié quater, 79 rectifié ter et 528 rectifié.
Les amendements sont adoptés.

L'amendement n° 18, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la fin du 1°, les mots : « à un coût économiquement acceptable » sont supprimés ;
La parole est à Mme Évelyne Didier.

Nous avions présenté cet amendement en commission et prévenu que nous le défendrions de nouveau en séance, malgré le sort qui risquait de lui être réservé.
Le principe de précaution est un principe fondamental du droit de l’environnement depuis qu’il a été posé dans la déclaration de Rio.
Or, depuis plusieurs années, ce principe est contesté, attaqué et même parfois presque détourné au motif qu’il constituerait un frein inutile à la recherche et développement et conduirait à l’inaction. Il a été démontré que c’était totalement faux ; une proposition de loi a même été déposée et débattue sur ce sujet.
Nous considérons, dix ans après l’adoption de la Charte de l’environnement, qu’il serait opportun que ce projet de loi, qui entreprend par ailleurs – nous venons de le voir - un travail de définition important concernant les principes fondamentaux du droit de l’environnement, revienne sur les contours du principe de précaution. Il convient en effet de retrouver plus précisément l’esprit de la déclaration de Rio, qui énonce clairement qu’« en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement ».
La législation française, par le biais de la loi Barnier de 1995, a complété la définition de Rio par les notions de « réaction proportionnée » et de « coût économiquement acceptable ». Aujourd’hui, c’est cette définition qui est reprise à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Nous proposons de supprimer la notion de « coût économique acceptable », qui laisse entendre non seulement que le principe de précaution est soumis, lui aussi, à des considérants financiers et que c’est ce qui doit primer, mais aussi que son application pourrait être écartée au regard du coût de sa mise en œuvre. Compte tenu des pressions fortes et de la volonté inébranlable du monde économique libéral de remettre en cause ce principe, nous estimons qu’une telle définition fragilise le principe de précaution.
Nous suggérons donc d’en revenir à une définition du principe de précaution qui lui donne plus de force, conformément à l’ambition de ce projet de loi, dont les promoteurs souhaitent donner les moyens aux pouvoirs publics de mieux protéger la biodiversité. Le principe de précaution en est l’un des outils.

Pour en être membre, Mme Didier sait bien que la commission a émis un avis défavorable, et j’en suis désolé, sur cet amendement qui tend à modifier la définition du principe de précaution figurant à l’article L. 110-1 du code de l’environnement en supprimant la notion de « coût économiquement acceptable ».
Ce principe, vous l’avez rappelé, a été introduit dans notre droit par la loi relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite « loi Barnier ». Il s’agit ici d’un principe procédural interprété comme tel par les juges afin d’encadrer l’exercice des pouvoirs de l’administration.
Un juste équilibre a été trouvé. Je ne pense pas utile de rouvrir les débats sur le principe de précaution à ce stade de notre discussion.
Le Gouvernement émet le même avis que le rapporteur.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 320, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce principe implique d’éviter les atteintes significatives à l’environnement et à défaut, de les réduire. Par dérogation au principe de prévention, pour les atteintes à la biodiversité qui n’ont pu être évitées ou réduites, des mesures de compensation doivent être prises en dernier lieu pour les réparer.
« Les mesures de compensation doivent être additionnelles, respecter l’équivalence écologique et être effectives pendant toute la durée des impacts. Leur réalisation est soumise à une obligation de résultat. » ;
La parole est à M. Ronan Dantec.

Cet amendement tend à proposer une nouvelle rédaction de l’alinéa 8, qui porte sur le principe éviter-réduire-compenser, afin que la compensation ne soit pas placée sur le même plan que les mesures d’évitement et de réduction.
La compensation doit clairement apparaître comme une dérogation au principe d’action préventive. Il s’agit là de l’un des grands débats que suscite le présent projet de loi.
La compensation vise non pas à empêcher la réalisation du dommage, mais bien à apporter une contrepartie à des dommages considérés comme inévitables. Elle se rapproche en ce sens davantage d’une déclinaison du principe pollueur-payeur. C’est d’ailleurs la solution retenue par le droit de l’Union européenne pour les sites Natura 2000 dans l’article 16 c de la directive 92/43/CEE. Les atteintes et, partant, les mesures compensatoires y sont définies explicitement comme des dérogations aux obligations de conservation.
En proposant que les mesures de compensation soient additionnelles, qu’elles respectent l’équivalence écologique et qu’elles soient effectives pendant toute la durée des impacts, en prévoyant en outre une obligation de résultat, nous nous inscrivons dans la logique européenne.

L'amendement n° 531 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Supprimer le mot
significatives
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Rires.

Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 225 rectifié est présenté par Mme Billon, MM. D. Dubois et Luche, Mme Loisier et MM. L.Hervé, Guerriau, Cadic, Longeot, Lasserre et Roche.
L'amendement n° 329 rectifié est présenté par M. Revet, Mme Lamure, M. Lenoir, Mme Canayer et M. D. Laurent.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 8
Après le mot :
compenser
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, lorsque cela est possible, les atteintes notables qui n’ont pu être évitées et suffisamment réduites. » ;
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 225 rectifié.

Les nouveaux principes ajoutés au code de l’environnement étant peu clairs, voire incohérents par rapport au droit existant, les risques d’insécurité juridique pour les entreprises actrices de la biodiversité ne sont pas négligeables.
Plus précisément, l’article R. 122-4, 7°, du code de l’environnement définissant déjà le mécanisme de compensation, on voit bien que la notion de compensation peut connaître des acceptions, des interprétations et des applications très diverses.
Tout en contribuant à préserver la biodiversité, nous devons protéger les projets d’aménagement acceptés contre toute insécurité juridique. Les trois dimensions environnementale, économique et sociale du développement durable doivent être respectées.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 329 rectifié.

La commission est défavorable à ces quatre amendements en discussion commune.
L’amendement n° 320 vise à réécrire le principe d’action préventive que nous avons déjà précisé en commission. Il tend à bien indiquer que les mesures relevant du dernier volet du triptyque ERC, à savoir les mesures de compensation, n’interviennent qu’en dernier lieu de manière additionnelle et respectent l’équivalence écologique et que, en outre, les mesures de compensation sont soumises à une obligation de résultat.
La finalité de cet amendement ne me paraît pas évidente. En effet, la notion de compensation est en soi déjà une obligation de résultat. Par ailleurs, si un organisme comme l’AFB s’occupe, lorsqu’elle sera créée, de la compensation, la progression sera rapide.
Enfin, il ne me paraît pas nécessaire de préciser que les mesures de compensation sont additionnelles. Le texte prévoit déjà qu’elles interviennent « en dernier lieu ».
La commission est également défavorable à l’amendement n° 531 rectifié, qui vise à supprimer une disposition adoptée en commission sur l’initiative de M. Pointereau. En effet, le principe ERC s’applique pour éviter les atteintes les plus importantes à l’environnement, afin de ne pas devenir un principe trop contraignant ou bloquant.
Enfin, la commission est défavorable aux amendements identiques n° 225 rectifié et 329 rectifié, qui tendent à préciser le principe d’action préventive défini à l’alinéa 8 de l’article 2 en ajoutant qu’il implique d’éviter les atteintes significatives à l’environnement ; à défaut, de les réduire ; enfin, en dernier lieu, de compenser « lorsque cela est possible », les atteintes « notables » qui n’ont pu être évitées et « suffisamment » réduites.
Il tend donc à prévoir d’atténuer le dernier volet du triptyque éviter-réduire-compenser en introduisant l’idée que la compensation n’est pas obligatoire, puisqu’elle ne vise que les atteintes « notables » et qui n’ont pas pu être « suffisamment » réduites.
Je rappelle que la définition que nous avons adoptée en commission a été proposée par nos collègues Michel Raison, Daniel Gremillet et Jean-Jacques Lasserre. S’il était adopté, cet amendement aboutirait en réalité à tuer l’idée même de compensation. La compensation est unique, on ne peut pas plus ou moins compenser ou compenser davantage.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat pour le premier amendement et suggère le retrait des suivants.
L’amendement n° 320 vise à réécrire la séquence éviter-réduire-compenser en renforçant la qualité de la compensation écologique. Il tend à préciser que la compensation écologique doit être additionnelle et qu’elle doit respecter l’équivalence écologique. Toutefois, il ne définit pas ce qu’est l’additionnalité. D’où mon avis de sagesse.
Ce point, vous le savez, a été débattu au sein du comité pour l’économie verte et n’a pas été bien défini. M. Dantec a réalisé un travail important et fait des propositions afin de mieux encadrer la compensation écologique. J’aurai d’ailleurs l’occasion de soutenir certains de ses amendements tout à l’heure. Toutefois, l’article 2 portant sur les grands principes du droit de l’environnement, je ne pense pas qu’il faille détailler autant sa rédaction.
L’amendement n° 531 rectifié vise à supprimer l’exigence d’une atteinte « significative ». Or la rédaction actuelle a été proposée par la commission du Sénat. L’Assemblée nationale avait, pour sa part, retenu une autre rédaction et préféré parler d’« incidence notable sur l’environnement », mais c’est bien la même notion, qu’il convient de conserver. Je suggère donc le retrait de cet amendement.
Les amendements identiques n° 225 rectifié et 329 rectifié visent, eux aussi, à préciser que la compensation ne porte que sur les atteintes à la biodiversité pouvant être qualifiées de « notables » et qu’elle n’est mise en œuvre que lorsque cela est possible.
Il est louable de vouloir apporter des précisions, mais le code indiquant qu’il faut éviter les atteintes « significatives » à l’environnement, je pense qu’il existe un risque de confusion juridique entre atteinte « significative » à l’environnement et atteinte « notable ». C’est pourquoi je suggère également le retrait de ces deux amendements.

Je ne voterai pas ces amendements, mais je m’interroge sur le caractère normatif du terme « significatif », ajouté sur l’initiative de notre collègue Rémy Pointereau.
Nous allons devoir attendre la jurisprudence pour savoir comment ce texte sera appliqué. Le risque est que les magistrats aient une interprétation très différente d’un endroit à l’autre du territoire. Certains d’entre eux considéreront que peut être qualifiée de « significative » une atteinte quasi totale, d’autres que peut l’être une atteinte à hauteur de 60 %, 70 % ou 80 %.
Je tenais à faire part de mon interrogation à la Haute Assemblée.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 531 rectifié est retiré.
Madame Billon, l'amendement n° 225 rectifié est-il maintenu ?

Je mets aux voix les amendements identiques n° 225 rectifié et 329 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 267 est présenté par M. Poher, Mme Bonnefoy, MM. Cornano et Filleul, Mme Herviaux, M. Miquel, Mme Tocqueville et M. Yung.
L'amendement n° 302 est présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 9
Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :
2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ; »
La parole est à M. Hervé Poher, pour présenter l’amendement n° 267.

Cet amendement est fondé uniquement sur l’interprétation logique de la langue française.
Tout d’abord, en acceptant le principe éviter-réduire-compenser, vous allez de facto valider la notion d’absence de perte nette. Si vous évitez les impacts sur la biodiversité, le capital de biodiversité reste le même. Si vous réduisez et compensez les impacts sur la biodiversité, le capital de biodiversité reste, dans ce cas aussi, le même.
En acceptant la démarche éviter-réduire-compenser, on officialise donc la notion « d’absence de perte nette ». Autant l’afficher clairement !
Ensuite, pourquoi ajouter la notion de gain, en la pondérant ? Tout simplement parce que, dès son intitulé, ce texte est « projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages » et non un « projet de loi pour le déclin, le maintien ou le sauvetage de la biodiversité ».
Jusqu’à preuve du contraire, à la fin d’une reconquête, on en a plus qu’au début de la démarche, sauf à envisager d’emblée la reconquête comme un échec ou à avoir une conception très masochiste du mot « conquête »…
En toute logique, si l’on ne veut pas inclure les notions de perte nette ou de gain dans le texte, il faut refuser la démarche éviter-réduire-compenser et modifier l’intitulé du projet de loi.
M. Joël Labbé applaudit.

Notre collègue Hervé Poher a bien expliqué la situation. La question est de savoir si nous voulons faire preuve d’ambition en matière de biodiversité.
Nous le savons, les pertes de biodiversité sont considérables dans tous les domaines, dans les zones humides ou en termes d’espèces. Ne pouvant plus accepter de continuer de perdre de la biodiversité, nous optons aujourd'hui pour une démarche dynamique, ce qui signifie regagner de la biodiversité.
L’amendement, qui propose une rédaction extrêmement mesurée, vise à prévoir qu’il faut aujourd'hui, lorsqu’on intervient sur la nature, y compris pour des raisons économiques – ’il ne s’agit pas de mettre la nature sous cloche – se poser la question de la dynamique de gain de biodiversité.
Adopter cet amendement serait envoyer le signal collectif que nous avons tous pris acte du fait que nous ne pouvons plus accepter de pertes de biodiversité et qu’intervenir sur la nature, c’est se placer dans une perspective de création de gains.
M. Joël Labbé applaudit.

L'amendement n° 533 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Amiel, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :
2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de la biodiversité ; »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Comme nous l’avons précédemment évoqué, l’article 2 permet de préciser le contenu du principe de prévention des atteintes à l’environnement.
Dans la version adoptée par l’Assemblée nationale, ce principe devait « viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ». Cette précision a été supprimée par la commission, qui a considéré qu’elle était dépourvue de portée normative.
Pourtant, l’application du triptyque éviter-réduire- compenser les atteintes à l’environnement implique de se fixer un objectif d’absence de perte nette de biodiversité.
L’amendement que nous vous proposons vise à consacrer cette précision dans le texte, sans pour autant retenir l’objectif de gain de biodiversité, qui ne nous semble pas relever du principe de prévention.

Les amendements identiques n° 267 et 302 tendent à réintroduire l’idée que le principe d’action préventive a pour objectif l’absence de perte nette, voire le gain de biodiversité, alinéa que nous avions supprimé en commission, sur l’initiative de Rémy Pointereau, de moi-même et de plusieurs autres collègues qui nous avaient soutenus.
Cette phrase, même si elle est intéressante, est floue et n’apporte pas de plus-value juridique justifiant qu’elle soit inscrite dans la loi. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire ce soir à plusieurs reprises, les termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement sont importants, puisqu’ils fondent les principes généraux du droit de l’environnement.
Nos travaux législatifs peuvent certes inspirer ceux qui auront à les commenter en les éclairant sur ce que certains législateurs avaient en tête. Toutefois, en cas de contentieux, on ne peut pas placer le juge devant la difficulté d’interpréter les concepts que vous proposez. Cela ne me paraît pas souhaitable juridiquement.
Les auteurs de l’amendement n° 533 rectifié ont limité l’objectif du principe en question à l’absence de perte nette de biodiversité. Comme pour les amendements précédents, cet objectif est trop flou pour être introduit dans le code de l’environnement, même si je comprends la perspective qu’il trace, qui peut servir d’indication pour ceux qui auront à se pencher sur ces dispositions et à les mettre en application.
Le Gouvernement est bien évidemment favorable à ces amendements identiques, un amendement analogue ayant été adopté à une large majorité à l’Assemblée nationale, à l’issue d’un vaste débat.
La reconquête de la biodiversité, ce n’est pas le recul de la biodiversité. L’absence de perte nette de biodiversité est un objectif global qui correspond complètement à l’esprit de la loi, qui n’en fait pas une obligation de résultat mètre carré par mètre carré.
Lors de la discussion générale, tout le monde a cité des exemples spectaculaires de la régression très dangereuse de la biodiversité, y compris pour les services qu’elle rend dans bien des domaines, qu’il s’agisse de l’agroalimentaire, du médicament, du biomimétisme, ainsi que les enjeux pour l’équilibre de l’air, des sols, des espèces animales et végétales. Ce recul est dramatique et il faut affirmer que l’objectif est bien l’absence de perte nette de biodiversité. Je le répète, ce n’est pas un calcul arithmétique, c’est un objectif global, un objectif civilisationnel de reconquête de la biodiversité.
Le Gouvernement est donc tout à fait favorable à ces amendements identiques tendant, je le répète, à revenir à la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale. Peut-être y a-t-il eu un malentendu sur la portée de ces amendements, mais je pense qu’ils sont totalement cohérents.
Le fait de repousser de tels amendements laisse d’ailleurs peser un doute sur l’objectif même du texte dont nous débattons et que chacun a défendu ici, sur l’ensemble des travées. Il s’agit bien de reconquérir ce qui a été détruit, dans une démarche dynamique et non pas statique. Quand on sait que le réchauffement climatique accélère le recul de la biodiversité, il est très important que ces combats soient menés. Ils le sont d'ailleurs, y compris par le monde agricole, qui est la première victime de la régression de la biodiversité notamment végétale, ainsi que de l’appauvrissement des sols et de l’air.
Mais si cet objectif est pour moi sans ambiguïté, peut-être convient-il de lever un certain nombre d’incertitudes par rapport au rejet dont ces amendements ont fait l’objet en commission.

Je voudrais tout d'abord faire remarquer à Mme la ministre que la disposition qu’elle vient de défendre ne figurait pas dans le texte initial du Gouvernement ; c’est un ajout de l’Assemblée nationale.
J’ajoute que nous avons adopté précédemment une disposition tendant à veiller à l’absence d’atteinte significative à l’environnement. Il convient de rester cohérent : nous ne pouvons pas dire que l’objectif est, d’un côté, de s’assurer de l’absence de perte nette de biodiversité et, de l’autre, d’éviter les atteintes significatives à l’environnement ; c’est l’un ou l’autre !
Il ne faut pas être maximaliste. La commission est cohérente en n’affichant pas un objectif d’absence de perte nette dès lors que la rédaction de l’alinéa précédent fait référence à des atteintes significatives à l’environnement. À défaut, il faudrait revoir la rédaction initiale, approuvée d’ailleurs par le Gouvernement.

L’argumentaire qui vient d’être développé ne me semble pas du tout juste. Nous sommes dans un principe d’opérationnalité. S’il n’y a pas d’atteinte « significative », on ne va pas s’engager dans une machinerie relativement lourde de diagnostic, de définition puis d’application de différentes mesures. Nous en sommes tous conscients et il n’y a aucun dogmatisme de ce point de vue. Si ce n’est pas significatif, on ne fait rien.
En revanche, si c’est significatif, on s’engage dans une opération beaucoup plus lourde, en mobilisant des moyens publics, et l’on se place dans la reconquête.
Il y a donc une véritable cohérence entre les deux, contrairement à ce que vous souteniez, monsieur Vasselle.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Pellevat et D. Dubois, est ainsi libellé :
Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Cyril Pellevat.

L’article 2 du projet de loi-cadre Biodiversité entend ajouter un principe de solidarité écologique aux principes énoncés à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Ce principe de solidarité écologique, qui introduit une solidarité entre les êtres vivants, dont l’homme, les écosystèmes et les milieux naturels ou aménagés, présente un caractère nébuleux propice à interprétations, le rendant juridiquement contestable et d’autant plus problématique qu’il est appelé à être pris en compte avant toute décision publique.
Tel qu’édicté, le principe de solidarité écologique ne répond pas aux objectifs de l’article L. 110-1, à savoir énoncer les principes directeurs du droit de l’environnement, dotés d’une portée juridique clairement identifiable et destinés, dans une visée opérationnelle, à inspirer les législations sectorielles qui en préciseront la portée.
Ce principe de solidarité écologique apparaît incantatoire ou déclaratoire et non pas à vocation normative, de sorte qu’il n’a pas sa place dans l’article visé.
D’ailleurs, contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs de la loi, le principe de solidarité écologique, en tant que grand principe d’interaction entre les activités humaines et la biodiversité, n’existe à ce jour dans aucune réglementation. La législation sur l’eau n’évoque que la solidarité financière ou territoriale des bassins. Quant à la solidarité écologique au sens de la législation des parcs nationaux, elle est évoquée en référence à deux espaces géographiques, ce qui correspond à une solidarité biologique qu’il est aisé d’appréhender.
En ce sens, le principe de solidarité écologique méconnaît aussi l’exigence constitutionnelle de normativité de la loi, de même que celle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
De plus, et surtout, si le principe de solidarité écologique a pour objet d’asseoir la nécessité de concilier le développement économique et la biodiversité, force est de constater qu’il serait dénué d’effet utile dès lors que préexiste à cet égard le principe de développement durable, figurant à la fois dans la Charte de l’environnement et à l’article L. 110-1.
Le principe de développement durable paraît en outre plus équilibré dans la prise en compte des trois piliers, économique, environnemental et social, tandis que la solidarité écologique sous-tend une primauté de l’écologie par rapport aux activités humaines et les enjeux socio-économiques.
Enfin, le principe de solidarité écologique est un facteur d’insécurité juridique pour les porteurs de projets : d’une part, ces derniers ne sont pas en mesure de déterminer les contraintes découlant de ce principe ; d’autre part, l’incertitude liée à cette notion fait peser un doute sur la validité des décisions dont ils bénéficient et qui sont supposées prendre en compte un tel principe. À cet égard, outre le risque, non négligeable, d’une multiplication des contentieux, cela revient à abandonner au juge le soin de définir a posteriori les contours de cette notion.
Par conséquent, il est proposé de supprimer l’introduction du principe de solidarité écologique à l’article L. 110-1 du code de l’environnement.

Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 226 rectifié est présenté par Mme Billon, MM. Longeot, Roche et Lasserre, Mme Loisier et MM. L. Hervé, Guerriau, Cadic et Luche.
L'amendement n° 330 rectifié est présenté par M. Revet, Mme Lamure, M. Lenoir, Mme Canayer et M. D. Laurent.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 11
Remplacer les mots :
toute prise de décision publique
par les mots :
les plans et programmes publics
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l'amendement n° 226 rectifié.

Toujours dans le souci d’une plus grande cohérence, le principe de solidarité écologique, qui fait l’objet de l’article 2, doit s’appliquer aux plans et programmes publics, qui sont connus et reconnus.

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 330 rectifié.

Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 268 est présenté par M. Poher, Mme Bonnefoy, MM. Madrelle, Bérit-Débat, Camani, Cornano et Filleul, Mme Herviaux, MM. J.C. Leroy, Miquel et Roux, Mme Tocqueville, MM. Cabanel, Yung, Daunis et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 303 est présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 526 rectifié bis est présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier, Vall et Barbier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 11
Supprimer le mot :
directement
La parole est à M. Hervé Poher, pour présenter l'amendement n° 268.

Il est précisé, à l’alinéa 11, que le principe de solidarité écologique « appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires directement concernés, ». Cet amendement vise à supprimer l’adverbe « directement ».
Tout d’abord, la notion de territoire est vague. Vous pouvez le concevoir comme un espace minimal ou, à l’opposé, comme une vaste étendue : territoire communal, intercommunal, bassin versant, territoire de parc, territoire cantonal, territoire départemental…
Ensuite, l’air, l’eau, les pollens, les insectes et la faune en général n’ont pas l’habitude de respecter les frontières ou les découpages administratifs.
Sourires.

Enfin, tout projet, important ou non, d’ailleurs, peut avoir des répercussions ou des conséquences sur un autre territoire, qu’il soit voisin ou parfois très éloigné, territoire qui peut subir des effets négatifs sur sa biodiversité, sans bénéficier des « plus » ou des « moins » de l’aménagement, mais qui ne pourrait pas, si on laisse le texte en l’état, profiter éventuellement d’une certaine solidarité écologique.
À cet égard, je citerai simplement deux exemples.
Premier exemple, une intervention sur un cours d’eau peut avoir des conséquences sur les territoires en aval, parfois très en aval et quelquefois même en amont.
Second exemple, les aménagements autoroutiers et les lignes de TGV, qui s’apparentent à de véritables barrières, peuvent détruire des zones riches en biodiversité, mais aussi influer sur le fonctionnement de la faune et sur les équilibres des territoires voisins. Nous connaissons tous, sur nos territoires, des cas éloquents. Je pourrais vous parler longuement des sangliers de ma commune, qui ont changé leurs habitudes de promenade après la construction de la ligne de TGV et ont pris la fâcheuse manie d’aller chatouiller les agriculteurs de territoires voisins…
Tout cela pour réaffirmer que tout projet peut avoir une répercussion environnementale sur le territoire qui l’accueille, bien entendu, mais aussi sur des territoires parfois éloignés ! Pourquoi ces territoires touchés indirectement devraient-ils se sentir exclus de la notion de « solidarité écologique » ? C’est pourquoi nous vous proposons la suppression de l’adverbe « directement ».

Pour compléter ce qu’a dit notre collègue Poher, par exemple, à partir du moment où l’on imperméabilise les sols en amont, il y a de vraies conséquences en aval.
Réfléchir aux incidences de l’aménagement d’un territoire sur d’autres territoires, avoir une approche des interactions, tout cela constitue une vraie progression dans notre conception et notre appréhension, y compris de notre intervention humaine. Je trouverais dommage que l’on supprime les deux alinéas.

La parole est à M. Raymond Vall, pour présenter l'amendement n° 526 rectifié bis.

Ces six amendements en discussion commune relèvent de trois catégories.
Le premier, l'amendement n° 172 rectifié, est isolé ; il vise à supprimer le principe de solidarité écologique, revenant donc sur le dispositif qui a été adopté en commission.
Le principe de solidarité écologique me semble au contraire très intéressant, notamment pour repenser la question de la responsabilité environnementale.
En outre, la rédaction proposée par le texte est celle qu’a proposée le Conseil d’État, qui a considéré que le principe n’avait pas de portée immédiate, mais qu’il invitera le législateur et le pouvoir réglementaire à se poser la question, dans les textes qu’il prévoit, de la déclinaison ou non de ce principe de solidarité écologique, par exemple pour améliorer les études d’impact.
J’ajoute que ce principe existe déjà dans le code de l’environnement pour les parcs nationaux.
Enfin, l’amendement que nous avions adopté en commission avait permis de préciser ce principe et d’en limiter le caractère flou en supprimant, sur la suggestion de Mme Primas, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, la notion de territoires « indirectement concernés ».
La commission émet donc un avis défavorable.
S’agissant de la deuxième catégorie, c'est-à-dire des amendements identiques n° 226 rectifié, présenté par Mme Billon, et 330 rectifié, présenté par Mme Lamure, le principe de solidarité écologique, défini à l’alinéa 11 de l’article 2, implique que l’on prend en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires directement concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés.
Ces deux amendements visent à préciser le champ d’application de ce principe en prévoyant qu’il s’appliquera aux plans et programmes publics qui ont une incidence notable sur l’environnement des territoires, et non pas à « toute prise de décision publique ».
Madame Billon, il me semble que le dispositif que vous prévoyez est contradictoire avec l’objet de votre amendement. Vous souhaitez en effet que le principe puisse être appliqué de manière plus large, et non pas seulement au moment de la prise de décision. Pourriez-vous nous apporter des précisions sur ce que vous souhaitez réellement faire ? Je comprendrais, à la limite, que vous souhaitiez compléter les mots « toute prise de décision publique » par les mots « les plans et programmes publics », mais ces derniers pris isolément n’ont pas de sens.
Au final, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements, sauf s’ils venaient à être rectifiés dans le sens qu’elle propose.
S’agissant, troisième et dernière catégorie, des amendements identiques n° 268 de M. Poher, 303 de M. Dantec et 526 rectifié bis de M. Mézard, nous avions décidé en commission de préciser, notamment sur la proposition de Mme Primas, le principe de solidarité écologique, qui, à l’origine, visait les territoires « directement ou indirectement concernés ».
Notre collègue avait en effet alerté sur le caractère flou de la notion de territoires « indirectement concernés » par le principe de solidarité écologique ; nous avions donc supprimé cette précision, qui pouvait avoir de lourdes conséquences dans la mise en œuvre des études d’impact de certains projets.
Ces amendements visent à supprimer la précision « directement », ce qui va à l’encontre des résultats des travaux de la commission. Leur adoption reviendrait à soumettre tous les territoires concernés au principe de solidarité écologique, ce qui est bien trop large.
La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.
Le Gouvernement partage l’analyse de la commission sur les amendements n° 172 rectifié, 226 rectifié et 330 rectifié. En effet, ces amendements, qui visent à supprimer le principe de solidarité ou à le limiter aux seuls plans et programmes publics, ne sont pas en cohérence avec les objectifs du projet de loi, comme les travaux de votre commission l’ont montré. Par conséquent, j’en suggère le retrait.
Les amendements identiques n° 268, 303 et 526 rectifié bis tendent à en revenir au texte dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale. Par cohérence, j’y suis favorable.
À cet égard, je voudrais faire part d’une petite nuance à M. le rapporteur.
Dans le texte voté par l’Assemblée nationale, la solidarité écologique s’appliquait aux « territoires directement ou indirectement concernés ». Les deux adverbes étaient donc bien dans le texte, ce qui constituait une certaine souplesse. M. le rapporteur s’interrogeait à juste titre à cet égard. Il convient donc ici de supprimer la référence aux territoires « directement » concernés, car en restant dans l’implicite on met moins de rigueur dans le texte.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur ces trois amendements identiques.

Mme la ministre nous explique qu’il faut étendre le principe de solidarité écologique aux territoires voisins, en quelque sorte, tandis que, selon M. le rapporteur, ce principe sera mis en œuvre finalement dans les futurs réglementations, décrets et autres décisions que prendront ce gouvernement ou les gouvernements qui lui succéderont.
C’est la raison pour laquelle, j’y insiste auprès de mes collègues, j’ai cosigné cet amendement de suppression des alinéas 10 et 11. Je voudrais relire devant vous l’alinéa 11 : « Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable » – encore faut-il définir ce qu’on entend par là – « sur l’environnement des territoires directement concernés, » – et peut-être même indirectement concernés – « les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés. »
Très clairement, cela signifie que, dès que l’on mettra en œuvre un projet sur n’importe quel territoire, en plus du principe de précaution auquel on est déjà confronté, on se heurtera au principe de solidarité écologique. Pour démontrer l’absence d’impact notable de telle ou telle prise de décision publique sur l’environnement, nous aurons à nous adjoindre les services de toutes sortes d’accompagnants.
Ce principe aura donc une incidence extrêmement lourde. Et qui sera concerné ? Encore une fois, les territoires ruraux, ceux qui y vivent, ceux qui en sont les élus ! C’est pourquoi j’y suis tout à fait opposé.
Avec le principe de précaution, on ne peut plus gérer ni bouger ; avec la loi ALUR, on a gelé tous les terrains dans les territoires ruraux ; avec le principe de solidarité écologique, il faudra tout démontrer.
Mais que peut-on faire encore aujourd’hui dans les territoires ruraux, à part y vivre comme dans des réserves d’Indiens ?

Avant de rassurer M. Pellevat et de lui expliquer pourquoi je ne voterai pas son amendement, je propose à M. Dubois, qui vient de brandir le spectre de lourdes études préalables qui seraient demandées à tout maire rural ayant un projet – effectivement, il y a de quoi avoir peur –, de transformer son alerte en demande adressée à la ministre pour que le décret qu’elle prendra soit raisonnable et ne prévoie pas de nouveaux schémas ou autres, qui font peur à tout le monde.
Je reviens sur l’argumentaire de M. Pellevat.
« Solidarité écologique », c’est effectivement une drôle de dénomination, parce que la solidarité est une valeur humaine qui procède de notre esprit, de notre pensée, de notre cœur, alors que la nature, les bestioles, ne sont pas solidaires avec nous. La seule chose, c’est que l’on en dépend, c’est une solidarité de fait, et cela s’appelle tout simplement l’interdépendance.
Mon cher collègue, vous proposez de supprimer l’alinéa 11 au motif que, selon vous, cela reviendrait à dire que la nature l’emporterait sur l’homme. J’attire votre attention sur la toute fin de l’alinéa, qui vise les « milieux naturels ou aménagés ». Il est question ici non pas de castors, mais de choses élaborées par l’homme. Par conséquent, l’activité économique de l’homme, son activité de bâtisseur sont concernées par cette solidarité écologique.
Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu’on demandera des études d’impact intelligentes, systémiques, prenant en compte toutes les interactions.
Monsieur Dubois, j’entends l’alerte que vous lancez et j’espère que vous serez rassuré à ce sujet. Mais tourner le dos à cette interdépendance, qui est aujourd’hui actée par tout le monde, ce serait dommage, surtout dans un texte sur la biodiversité. Nous sommes tous sur le même bateau planétaire et notre survie dépendra du bon état de fonctionnement de tous les écosystèmes !

L’intervention de Daniel Dubois m’amène à m’interroger sur un point. Lorsque l’on parle de l’intervention publique, on vise aussi bien les actions de l’État que celles des collectivités territoriales et des intercommunalités.
Demain, lorsque nous réaliserons des travaux routiers sur le territoire de nos communes, faudra-t-il systématiquement lancer des études d’impact ? Cette question mériterait quand même de la part du Gouvernement quelques précisions. Quelles limites seront apportées à ce principe de solidarité écologique ? Chaque fois qu’il sera envisagé un investissement, pour construire une salle polyvalente, une mairie, un local technique, il faudra s’interroger sur l’impact de ces constructions sur l’environnement ! Jusqu’où ira-t-on ? Jusqu’à présent, les études d’impact étaient menées lors de la réalisation de très grands projets structurants sur le plan national. En revanche, pour des projets purement locaux, il n’a jamais été demandé la moindre étude d’impact !
J’aimerais, concrètement, connaître la limite de l’application de ce principe pour nos collectivités.

Je rejoins les propos de nos collègues Daniel Dubois et Alain Vasselle.
Nous sommes nombreux ici à gérer des collectivités locales – commune, département, etc. – et nous avons tous en tête un certain nombre de dossiers qui ont connu des retards considérables – deux ans ou trois ans – parce qu’ils étaient contestés au nom de la protection de telles ou telles petites fleurs, ou de telle ou telle espèce de papillons, de crapauds, d’écrevisses - cela dit, j’ai le plus grand respect pour les écrevisses. §En tant que président de conseil général, je n’ai même jamais pu faire rectifier le virage d’une route départementale particulièrement dangereuse et accidentogène tout simplement parce que poussait en bord de voie, et uniquement là, une certaine variété de fleurs - des collègues m’ont apporté ces mêmes fleurs, cueillies ailleurs…Finalement, les travaux n’ont jamais pu être réalisés et ce virage est toujours aussi dangereux.
Tout cela relève de l’abus. C’est bien pour cette raison qu’il faut laisser dans le texte du projet de loi l’adverbe « directement », et c’est déjà aller bien loin !
Dans le Jura, et je ne pense pas que ce soit un cas particulier, on ne compte aujourd’hui qu’un seul champ photovoltaïque. Madame la ministre, aucun des dossiers qui ont été engagés n’a encore abouti. Sauf un, et encore : il était prévu pour quatorze hectares au départ, mais la commune à l’origine du projet a dû se résoudre à réduire sa taille à huit hectares, la DREAL ayant découvert sur une parcelle une espèce endémique de papillon – heureusement, cet insecte vit également ailleurs. Résultat ? Le coût supplémentaire pour la commune ne sera pas négligeable et elle ne retirera pas de ce champ autant d’énergie renouvelable qu’elle en escomptait au départ.
J’entends bien ce qu’a dit Mme Blandin sur les grands projets, et je suis favorable au débat public, à ces grandes discussions. Mais force est de constater que l’on bute bien souvent sur de toutes petites choses, et si notre pays en est là où il est aujourd’hui, c’est aussi parce qu’on introduit en permanence des contraintes supplémentaires. Ce n’est pas ce que nous sommes en train de faire aujourd’hui qui améliorera les choses, j’en suis convaincu !
L'amendement n'est pas adopté.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 226 rectifié et 330 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 268, 303 et 526 rectifié bis.
Les amendements ne sont pas adoptés.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 304, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Le principe de non-régression en matière d’environnement selon lequel les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour protéger l’environnement et la biodiversité ne doivent pas entraîner un recul dans le niveau de protection déjà atteint. »
II. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Ronan Dantec.

L’étude d’impact annexée à ce projet de loi – page 18 – précise que l’introduction d’un principe de non-régression a été une option suggérée, mais non retenue.
L’étude précise que ce principe peut s’entendre de différentes façons : « une non-régression du droit appliquée à la protection de la biodiversité » ; « une non-régression de la biodiversité, aussi appelée “pas de perte nette de biodiversité”, développée notamment dans la stratégie européenne pour la biodiversité. Aucune de ces deux acceptions n’a malheureusement été retenue.
Il s’agit d’essayer de réintégrer ce principe de non-régression en matière d’environnement, selon lequel les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour protéger l’environnement et la biodiversité ne doivent pas entraîner un recul dans le niveau de protection déjà atteint. Cela rejoint les débats que nous avons eus précédemment.

Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 3 rectifié quater est présenté par M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Vasselle, Mme Canayer, MM. Gilles, Pointereau, Milon, Mouiller et Panunzi, Mme Gruny, M. Kennel, Mme Lopez, MM. Bouchet, Laufoaulu, D. Laurent, Trillard, Mandelli, César, Mayet, Lemoyne, Cornu, Morisset et Laménie, Mmes Micouleau et Primas, M. Commeinhes, Mme Giudicelli, M. Charon, Mme Lamure, MM. Vaspart, Doligé, J.P. Fournier, Poniatowski, Genest, Danesi, Grand, Bizet, Pillet, Pellevat, Pinton, de Nicolaÿ, Revet, Lefèvre, B. Fournier, Longuet, Pintat, Vial et Darnaud, Mme Morhet-Richaud, MM. Allizard, Delattre, Masclet, P. Leroy et Lenoir, Mme Deseyne et MM. A. Marc, Dassault, Chasseing, Raison, Gremillet, Luche, Houpert, Savary, Médevielle, Guerriau, D. Dubois et Gournac.
L'amendement n° 81 rectifié ter est présenté par MM. Bérit-Débat, Patriat et Carrère, Mmes Cartron et D. Michel, MM. Vaugrenard, Camani, Labazée, Roux et Manable, Mmes Jourda, Herviaux et Bataille, MM. Montaugé, Lalande, Lorgeoux, J.C. Leroy, Jeansannetas, Chiron et Courteau, Mme Riocreux et MM. Mazuir, Madrelle, Cazeau et Raynal.
L'amendement n° 530 rectifié est présenté par MM. Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié quater.

Cet amendement est tout à fait à l’opposé de celui que vient de présenter M. Dantec.
Nous sommes un certain nombre de signataires à penser que ce principe de « non-régression écologique » qui, tel qu’il était issu des travaux de l’Assemblée nationale, devait faire l’objet d’un rapport émis dans les deux ans – nous avons réduit ce délai à un an –, repose sur un système d’une perversité telle qu’elle mérite que l’on y revienne. Pardonnez-moi, mes chers collègues, mais cela me rappelle « les avantages acquis » dans le dialogue social.
Cela signifie que, pour telle ou telle raison parfaitement fondée à partir d’une étude scientifique – le rapport fait aussi référence aux universitaires ; leurs travaux sont parfois de bonne qualité, mais pas toujours –, on va mettre le monde sous cloche et on n’avancera plus !
Je citerai quelques exemples pour illustrer mon propos.
Je me souviens d’une époque, voilà vingt-cinq ou trente ans, où, dans mon département, les riverains étaient mis en demeure, à juste titre d’ailleurs, de nettoyer le lit de la rivière et de dégager les arbres qui étaient tombés, et ce afin de ne pas provoquer d’inondation. Aujourd’hui, au même endroit, les castors européens sont revenus et ont construit des barrages. Or, bien que les terres soient inondées, on ne peut pas toucher aux castors. Allez faire comprendre au propriétaire qu’il doit aujourd’hui faire procéder, à ses propres frais, à des travaux importants parce qu’à une certaine époque on a décrété l’interdiction de toute élimination de ce rongeur…
Ainsi, ce principe de mise sous cloche de la biodiversité de la nature, en ce qu’il ne permet pas de revenir en arrière quand de mauvaises décisions ont été prises ou d’évoluer quand la situation a changé, ne saurait être satisfaisant.
Je pourrai vous citer d’autres cas, mais cet exemple est éloquent, car il illustre in fine ce à quoi aboutit un système extrêmement pervers dans lequel on aura voulu aller toujours plus loin et demander toujours plus, quitte à interdire tout espace d’utilisation humaine dans la biodiversité.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour présenter l'amendement n° 81 rectifié ter.

Mon argumentation est identique à celle de M. Cardoux. Je citerai, outre le castor, le cormoran, sur lequel nous ne pourrions pas revenir en arrière, ou le loup, qui fait sans doute débat ici. Avec mes collègues signataires, j’estime qu’il ne faut pas graver ce principe dans le marbre. C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet alinéa 14.

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l'amendement n° 530 rectifié.

À défaut de le consacrer au niveau législatif, le présent projet de loi prévoit la remise d’un rapport sur le principe de non-régression, ainsi que sur l’opportunité de l’inscrire au rang des principes généraux du droit de l’environnement. Il aurait pour objet d’empêcher tout retour en arrière en matière de protection de l’environnement.
Si une telle initiative part d’une bonne intention, elle pourrait soulever quelques difficultés juridiques et constituer une source de rigidité. Par exemple, en matière de protection des espèces, comment appliquerait-on un tel principe ? Une espèce aujourd’hui menacée ne le serait pas forcément à l’avenir, conformément à la vision dynamique de la biodiversité retenue par le présent projet de loi.
En outre, cette mesure ne va pas dans le sens de la simplification du droit de l’environnement et vient restreindre la souveraineté de la loi, qui autorise toute modification de cette dernière.
Le présent amendement vise ainsi à supprimer la remise d’un rapport sur l’opportunité d’inscrire ce principe dans le code de l’environnement.

L'amendement n° 216, présenté par MM. Antiste, Cornano et Karam, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Le II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le principe de non-régression en matière d’environnement selon lequel les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour protéger l’environnement et la biodiversité ne doivent pas entraîner un recul dans le niveau de protection déjà atteint. »
La parole est à M. Maurice Antiste.

Le principe de non-régression du droit de l’environnement a fait l'objet d’une résolution adoptée au dernier congrès mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature, l’UICN, et il est largement partagé par la communauté de juristes en droit de l’environnement.
C’est un principe d’action identifié lors des états généraux de modernisation du droit de l’environnement, puis validé par le Gouvernement au sein de la feuille de route pour la modernisation du droit de l’environnement.
Il est donc important, dans le cadre de cette loi, d’inscrire le principe de non-régression au rang des principes à valeur législative.
Le principe de non-régression est défini comme « excluant tout abaissement du niveau d’exigence de la protection de l’environnement » qui devrait figurer dans cette loi sur la biodiversité. En effet, la convention sur la diversité biologique de 1992 précise, dans son article 8-K, que chaque partie « maintient en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et les populations menacées ». Cela implique l’interdiction de supprimer les mesures de protection de la biodiversité et donc de régresser dans le niveau de protection déjà atteint.
La consécration législative du principe de non-régression en matière d’environnement entérinerait une idée déjà largement répandue et réclamée par de nombreux acteurs à l’occasion de la conférence de Rio. Elle permettrait, en outre, de satisfaire à des obligations juridiques au niveau de l’Union européenne.
Comme le prévoit la résolution de l’UICN, il conviendrait idéalement que ce principe, pour qu’il ait toute la portée qu’il mérite, soit adossé à la Constitution au sein de la Charte de l’environnement, et que son champ d’application soit plus large que celui de la biodiversité, ce qui pourrait être également envisagé à l’avenir.

Nous sommes confrontés à plusieurs amendements différents. La commission proposait la rédaction d’un rapport, en reprenant une proposition que le député UDI Bertrand Pancher avait introduite à l’Assemblée nationale, sur l’opportunité d’inscrire un principe de non-régression dans notre droit de l’environnement.
Certains collègues souhaitent inclure d’emblée le principe dans la loi, tandis que d’autres discutent de l’opportunité d’un rapport à ce sujet. Pour notre part, nous proposons la rédaction d’un rapport à la fois sur le principe de non-régression et sur l’opportunité d’inscrire ce principe. Le présent débat comporte donc plusieurs nuances.
Cela fait longtemps que nous nous interrogeons sur ce sujet. Notre législation environnementale en France est d’ailleurs largement influencée par un principe implicite de non-régression affirmé depuis longtemps au niveau de l’Union européenne. Dès 1987 et l’Acte unique, l’objectif de la politique environnementale européenne était en effet non seulement « la préservation et la protection », mais aussi « l’amélioration de la qualité de l’environnement ».
Parallèlement, force est de constater qu’il existe des tentatives de régression, volontaires, ou des circonstances, elles involontaires, aboutissant au même résultat.
Pour avoir rencontré certains experts en la matière, comme la directrice du Centre de recherches interdisciplinaires en droit de l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme, le CRIDEAU, qui a succédé au professeur Michel Prieur, l’un des grands spécialistes français de l’environnement – nombre d’entre vous les connaissent et ont déjà pris connaissance de leurs recherches –, je sais que leurs travaux sur ce principe sont déjà assez avancés.
Je connais la réticence, pour ne pas dire l’aversion de notre assemblée pour les rapports en général. Ayant intégré cette donnée dans mon logiciel
Sourires.

Nous pourrions poser, de façon précise et circonstanciée, les questions de la définition du principe de non-régression, de l’opportunité de l’inscrire dans notre droit, et sous quelle forme. Les réponses obtenues pourraient nous permettre, avant de légiférer, d’avancer de façon construite et prudente sur un sujet dont je comprends qu’il puisse inquiéter, ne serait-ce que compte tenu de l’intitulé du principe.
La commission avait précisé, sur l’initiative de M. Bizet, que les auteurs de ce rapport devaient aussi se prononcer sur le principe. Ce serait effectivement une bonne chose, nous avons déjà eu ce débat.
La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements qui s’écartent tous de sa position.
Le Gouvernement émet le même avis que la commission s’agissant de l’ajout du principe de non-régression dans le code de l’environnement, car il faudrait effectivement procéder à une mise à plat de l’ensemble des impacts juridiques qu’aurait l’adoption d’une telle mesure. C’est pourquoi le Gouvernement s’est engagé à remettre au Parlement un rapport sur le sujet dans un délai d’une année seulement à compter de la promulgation de la loi.
Par conséquent, je suggère le retrait de l’amendement n° 304. Sur les amendements identiques n° 3 rectifié quater, 81 rectifié ter et 530 rectifié, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée. En revanche, je sollicite le retrait de l’amendement n° 216, pour la même raison que celle que je viens d’exprimer : il est sans doute prématuré de faire figurer directement ce principe dans le droit, sans en avoir mesuré toutes les implications juridiques.

Je soutiens évidemment l’amendement n° 3 rectifié quater, que j’ai cosigné, comme ceux de mes collègues visant également à supprimer l’alinéa 14.
Ce principe de non-régression pourrait devenir une sorte de « nouveau droit de l’homme ». Je voudrais citer à ce propos un communiqué de Mme la ministre, du 3 avril 2015, dans lequel celle-ci se déclare « très attachée au respect des principes de modernisation du droit de l’environnement qui irrigue ces travaux : non-régression, efficacité et proportionnalité, sécurité juridique, effectivité. »
À l’appui de mon soutien à la suppression de l’alinéa 14, j’invoquerai plusieurs arguments.
Ce principe de non-régression soulève de très nombreuses questions, qui doivent être traitées avant même d’envisager sa possible inscription dans le code de l’environnement. Rédiger un rapport sur ce sujet, c’est mettre le doigt dans un engrenage dangereux.
En outre, doit-on considérer que toute loi traitant de l’environnement est par principe bonne et que les seuils qu’elle fixe ne pourront être revus qu’à la hausse ? Pourquoi le plus serait-il nécessairement associé à un mieux environnemental ? Le progrès est-il synonyme de lois éternelles, immuables ?

Notre histoire politique montre que la survie d’une société dépend de sa capacité à s’adapter au changement, à remettre en cause ce qui semblait acquis.
La prise en compte des générations futures implique également que nous restions modestes au regard des connaissances présentes. À cet égard, la promotion du principe de non-régression relève, de notre part, d’une forme de prétention.
La loi devra peut-être permettre demain ce qu’elle interdit aujourd’hui, du fait des avancées de la science et des connaissances, ainsi que de l’évolution du seuil d’acceptation des risques par la société. Pourquoi entraver notre liberté de décision, d’adaptation et d’évolution au nom d’un principe d’interdiction de remettre en cause ce qui a un jour été inscrit dans un texte de loi ? Cela reviendrait, au demeurant, à supposer que toutes les lois sont correctement écrites et conçues…
Mes chers collègues, voilà pourquoi je vous invite à supprimer l’alinéa 14.

M. le rapporteur s’est montré sensible au fait que la Haute Assemblée ne soit pas très encline à voter la remise de rapports, souvent voués, quand ils sont effectivement publiés, à s’accumuler et à s’empoussiérer dans les ministères…
En l’occurrence, Michel Raison a souligné à juste titre qu’en demandant la rédaction d’un rapport, on risque de mettre le doigt dans un engrenage.
Mes chers collègues, voilà peu, la commission des lois a examiné une proposition de loi constitutionnelle présentée par Rémy Pointereau, vice-président de la commission du développement durable. Ce texte ne concernait que les collectivités territoriales, mais il indiquait très nettement qu’il ne fallait pas aller au-delà de ce que prévoient les normes européennes, qu’il n’était pas la peine d’en rajouter.
Or, au travers de cet amendement, j’ai le sentiment que l’on veut d’ores et déjà aller plus loin que ce que le droit européen nous impose !
Madame la ministre, pas une année ne se passe sans que s’engage une bataille sans fin au sujet des dates d’ouverture ou de fermeture de la chasse de tels ou tels oiseaux migrateurs, par exemple. J’ai ainsi eu l’occasion d’accompagner Mme Roselyne Bachelot, alors ministre de l’environnement, dans un déplacement à Bruxelles pour attirer l’attention des instances européennes sur les difficultés posées par l’application des normes décidées au niveau communautaire.
Nous avons déjà suffisamment à faire avec les normes européennes : n’en rajoutons pas via notre droit national ! Il serait sage que nous ne votions pas la production d’un rapport relatif à la non-régression. Il sera toujours temps de légiférer et de transposer une directive européenne dans notre droit lorsque l’Europe se sera prononcée. Gardons-nous de tout excès de zèle !

À mon sens, le débat doit nous permettre d’avancer dans la réflexion, sans rester totalement figés sur nos positions de départ. En l’occurrence, notre discussion montre à quel point un rapport est nécessaire. C’est pourquoi je vais retirer mon amendement, dont le dispositif me semble prématuré.
Je lirai avec attention ce rapport, s’il survit au débat parlementaire, car je voudrais vraiment comprendre quel est l’enjeu.
Lorsqu’on évoque la non-régression du droit de l’environnement, on traite des grands enjeux environnementaux, des atteintes fortes portées à l’environnement, dans une logique de reconquête de la biodiversité. Or j’entends évoquer les cormorans, les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse à l’oie… Ce n’est pas le sujet ici : le débat se situe à un autre niveau. Au demeurant, les amendements tendant à supprimer le rapport en question sont surtout défendus par les membres d’un certain groupe politique.
Je le répète, l’élaboration d’un rapport me semble nécessaire pour préciser les enjeux. Je retire mon amendement, monsieur le président.

L’amendement n° 304 est retiré.
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

Certes, il est un peu délicat de débattre de quelque chose que l’on ne comprend pas…

Pour ma part, il me semble avoir compris le sujet dont il s’agit. Les exemples que vous avez cités sont familiers aux usagers de la nature, notamment aux chasseurs.
Le principe de non-régression relève d’une appréciation statique de la biodiversité.
À cet égard, monsieur Bignon, vous écrivez à la page 32 de votre rapport que « le principe de développement durable, qui repose intrinsèquement sur l’interaction entre l’homme et son environnement, proscrit d’envisager la protection de la biodiversité sous le seul angle de la conservation statique. Si cette approche peut être nécessaire afin de protéger des éléments de biodiversité uniques ou en danger d’extinction, elle compromet une préservation de la nature compatible avec le développement humain et donc la pérennité des efforts demandés. »
Nous sommes tout à fait d’accord, mais cette position me semble en contradiction avec l’inscription dans le présent texte d’une demande de rapport portant sur le principe de non-régression.
J’en reviens aux propos de M. Dantec et à l’éventuelle pertinence de contributions qualifiées de scientifiques ou d’universitaires.
À une époque déjà lointaine, on nous a déclaré, à nous autres chasseurs de gibier d’eau, que les sarcelles d’été étaient en voie de disparaître et qu’il fallait donc d’urgence inscrire cet oiseau sur la liste des espèces non chassables. Mais, deux ans plus tard, les sarcelles d’été ont réapparu : elles avaient tout simplement changé de lieux d’hivernage, par suite d’une sécheresse au Sahel. Si la sarcelle d’été avait été placée au nombre des espèces non chassables, l’application d’un principe de non-régression aurait rendu ce classement irrévocable.
M. Raison l’a souligné à juste titre, inscrire dans ce projet de loi la remise d’un rapport portant sur le principe de non-régression, c’est mettre le doigt dans un engrenage.
Cela étant, madame le ministre, personne ne vous empêche de demander à vos services d’établir un tel rapport. Nous sommes nombreux, je pense, à être prêts à travailler avec vous sur cette question. J’espère que, sur la base des éléments qui seront alors réunis, M. Dantec et moi-même pourrons bien comprendre ce qu’est la non-régression !

M. Cardoux propose, en somme, une solution médiane, susceptible d’être approuvée sur l’ensemble des travées.
En revanche, monsieur Dantec, je n’ai pas très bien compris la position que vous avez défendue. Vous avez déclaré que le principe de non-régression était un grand principe, sans aucun rapport avec les problèmes posés par les cormorans sur le terrain.
Eh bien, moi, je vois le rapport ! En effet, en tant que maire, je sais que, le cormoran étant une espèce protégée, l’avantage compétitif, si j’ose dire, dont il bénéficie de ce fait pourrait susciter un véritable problème demain ou après-demain, au regard d’une bonne gestion de la faune, si l’on n’a pas la possibilité de s’adapter aux évolutions à venir. Sur le terrain, la mise en œuvre des dispositions juridiques peut poser des difficultés majeures sur le plan pratique.

Je tiens à remercier Mme la ministre d’avoir entendu nos préoccupations et d’avoir émis un avis de sagesse.

Pourquoi légiférons-nous aujourd’hui, si ce n’est pour enrayer l’érosion de la biodiversité ?
Moi aussi, en tant que maire, je dois faire face à des problèmes posés par la présence de cormorans. Il s’agit d’éviter la régression de la biodiversité, et non pas de figer les situations ou de favoriser l’expansion de toutes les espèces ! Voter de tels amendements reviendrait à jeter le bébé avec l’eau du bain !

Il me semblait qu’un consensus existait au sein de la Haute Assemblée sur le point de mettre un terme à l’érosion de la biodiversité.

Il s’agit de préserver des équilibres, ce qui exige des ajustements constants. À cet égard, le pouvoir réglementaire devra certainement apporter de la souplesse afin que des adaptations soient possibles, par exemple en cas de surpopulation de telle ou telle espèce, mais nous ne débattons pas ici des modalités de mise en œuvre des dispositions législatives.
Je suis très attaché à ce que l’on inscrive dans la loi le principe de non-régression de la biodiversité, mais, j’insiste sur ce point, cela ne signifie pas qu’il faille instaurer un système complètement rigide. L’enjeu est de maintenir des équilibres auxquels de nombreux acteurs concourent, au premier chef les chasseurs. Pour cela, des adaptations sont en permanence nécessaires, car la donne change constamment.
M. Ronan Dantec et Mme Christine Prunaud applaudissent.

Mes chers collègues, au sujet de cette demande de rapport, il me semble que l’on joue à se faire peur.

Je ne vois pas dans quel engrenage on mettrait le doigt en engageant la réflexion !
Réfléchir, c’est préparer l’avenir. Or, je le répète, les instances européennes se penchent actuellement sur ce principe de non-régression. Dans cette perspective, il serait coupable de notre part de ne pas nous intéresser à cette question : le moment venu, nous risquons de nous voir imposer par Bruxelles des normes sur un sujet auquel nous n’aurons même pas réfléchi.
M. Ronan Dantec opine.

Au demeurant, ni la commission ni moi-même n’avons dit adhérer au principe de non-régression. Je me suis même opposé à l’amendement n° 304, tendant à inscrire ce principe dans le projet de loi. D’ailleurs, constatant que le sujet n’était pas encore mûr, M. Dantec a intelligemment retiré son amendement, indiquant qu’il valait mieux commencer par réfléchir au contenu exact du principe de non-régression, avant d’examiner la question de l’opportunité de l’inscription de celui-ci dans la loi. À l’heure actuelle, peu de gens sont en mesure de dire en quoi consiste précisément ce principe. Si nous décidons de l’inscrire dès maintenant dans la loi, sans avoir mené ce travail de réflexion, nous risquons fort de le regretter.
Mes chers collègues, quel risque courons-nous ? Vous connaissez le processus législatif aussi bien que moi : si nous votons la réalisation de ce rapport, beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts avant qu’un tel principe ne figure, le cas échéant, dans une loi. Nous n’en sommes pas du tout là : n’ayons pas d’inquiétudes prématurées à cet égard. Si nous n’engageons pas la réflexion sur ce sujet, un jour viendra où nous le regretterons !

Il me semble que la sagesse serait de retirer ces amendements et de suivre la proposition de Mme la ministre d’établir un rapport fondé sur l’observation, afin de nourrir notre réflexion.

Ce n’est pas la proposition de Mme la ministre, mais celle de l’Assemblée nationale !

L’amendement n° 216 est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 3 rectifié quater, 81 rectifié ter et 530 rectifié.
Les amendements sont adoptés.

Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 2 rectifié quater est présenté par M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Vasselle, Mme Canayer, MM. Gilles, Pointereau, Milon, Mouiller et Panunzi, Mme Gruny, M. Kennel, Mme Lopez, MM. Bouchet, Laufoaulu, D. Laurent, Trillard, César, Mayet, Lemoyne, Cornu, Morisset et Laménie, Mmes Micouleau et Primas, M. Commeinhes, Mme Giudicelli, M. Charon, Mme Lamure, MM. Vaspart, Doligé, J.P. Fournier, Poniatowski, Genest, Danesi, Grand, Bizet, Pillet, Pellevat, Pinton, de Nicolaÿ, Revet, Lefèvre, B. Fournier, Longuet, Pintat, Vial et Darnaud, Mme Morhet-Richaud, MM. Allizard, Delattre, Masclet, P. Leroy et Lenoir, Mme Deseyne et MM. A. Marc, Dassault, Chasseing, Raison, Béchu, Gremillet, Luche, Houpert, Savary, Médevielle, Guerriau, D. Dubois et Gournac.
L’amendement n° 80 rectifié ter est présenté par MM. Bérit-Débat, Patriat et Carrère, Mmes Cartron et D. Michel, MM. Vaugrenard, Camani, Labazée, Roux et Manable, Mmes Jourda, Herviaux et Bataille, MM. Montaugé, Lalande, Lorgeoux, J.C. Leroy, Jeansannetas, Chiron et Courteau, Mme Riocreux et MM. Mazuir, Madrelle, Cazeau et Raynal.
L’amendement n° 529 rectifié est présenté par MM. Bertrand, Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le principe de la conservation par l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages est un instrument au service de la conservation de la biodiversité. »
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié quater.

Cet amendement fait suite à l’amendement relatif aux valeurs d’usage précédemment adopté.
Les lois adoptées en matière de protection, de mise en valeur, de restauration, de remise en état et de gestion des espaces, des ressources et milieux naturels, des sites et paysages, de la qualité de l’air, des espèces animales et végétales, de la diversité et des équilibres biologiques obéissent à certains principes : principe de précaution, principe d’action préventive et de correction, principe pollueur-payeur, principe d’accessibilité des informations environnementales et principe de participation.
En matière de gestion et de conservation de la biodiversité, la liste des principes susvisés, cités au II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, n’inclut pas les nouveaux concepts et principes internationaux relatifs à l’utilisation durable de la biodiversité. Il convient donc d’en tirer les conséquences et d’inscrire dans le droit positif le principe de conservation par l’utilisation durable des ressources biologiques, prôné par la Convention sur la diversité biologique, parce que les avantages économiques, culturels et sociaux qui en découlent incitent les utilisateurs à conserver ces ressources, qui sont des éléments de la biodiversité.
Il s’agit de faire valoir un principe novateur qui replace l’homme au sein de la conservation de la nature. La défense d’un prochain amendement me donnera l’occasion d’évoquer quelques exemples montrant qu’inscrire ces usages dans le principe de biodiversité permet une conservation durable de certains biotopes.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour présenter l’amendement n° 80 rectifié ter.

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 529 rectifié.

Il s’agit de compléter les principes généraux du droit de l’environnement par l’introduction d’un principe de la conservation par l’utilisation durable des ressources biologiques.
L’introduction de ce principe, auquel fait référence la Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, apporterait une alternative à l’approche de la conservation de la nature par la mise sous protection stricte. Cela mettrait ainsi fin à la tendance à opposer protection de l’environnement et utilisation des ressources biologiques.

La commission est défavorable à ces trois amendements identiques, qu’elle avait déjà rejetés.
L’idée est d’insérer un nouveau principe à l’article L. 110-1 du code de l’environnement : celui de la conservation par l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages est un instrument au service de la conservation de la biodiversité.
Je le redis, je suis très défavorable à la multiplication des principes sans portée normative au sein de cet article du code de l’environnement, tendance que nous dénonçons régulièrement. Comme le dit notre collègue Pointereau, « il faut cesser d’ajouter des phrases et des phrases qui ne prescrivent plus rien, mais qui se contentent d’affirmer telle ou telle chose et s’empilent dans des lois qui deviennent bien trop bavardes ».
La conservation par l’utilisation durable n’est en rien un principe : il ne s’agit en aucun cas d’une vérité générale. La pratique des usages n’est pas nécessairement un instrument au service de la conservation de la biodiversité.
Ce n’est faire insulte à personne que de dire cela : il n’y a pas de principe qui permette de décider qu’une activité est a priori au service de la conservation de la biodiversité. Certaines pratiques le sont ; il faut les promouvoir, et vous avez raison de vous y employer, mes chers collègues.
Je rappelle néanmoins que nous avons adopté en commission un amendement promouvant la conservation par l’utilisation durable des continuités écologiques, ce qui satisfait ces amendements, sans pour autant introduire un principe dénué de sens.
Le Gouvernement partage l’avis du rapporteur. Ces amendements sont en effet satisfaits, dans la mesure où, par définition, une loi pour la reconquête de la biodiversité ne saurait conduire à interdire des usages qui lui seraient favorables.
En revanche, nous devons effectivement veiller à ne pas alourdir la loi de concepts nouveaux qui donneront lieu à des contentieux. Le Gouvernement suggère donc le retrait de ces amendements.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 2 rectifié quater, 80 rectifié ter et 529 rectifié.
Les amendements sont adoptés.

L’amendement n° 417, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Après le mot :
lequel
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
certaines surfaces agricoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles et forestières doivent contribuer à la préservation des continuités écologiques et de la biodiversité. »
La parole est à M. Ronan Dantec.

Il s’agit, par cet amendement, de rendre une forme d’hommage aux activités agricoles et forestières.

La commission a émis un avis défavorable.
Cet amendement présente une nouvelle définition du principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture et la sylviculture inscrit à l’article L. 1 du code rural, en précisant que certaines surfaces agricoles et forestières seulement sont porteuses d’une biodiversité spécifique. Je crois au contraire que toutes ces surfaces sont dans ce cas et peuvent être vecteurs d’interactions écosystémiques.
Je suggère le retrait de cet amendement. La formulation « certaines surfaces » est juridiquement très imprécise et risque de donner lieu à des contentieux. Elle me semble en outre affaiblir la portée de l’article.

L’amendement n° 417 est retiré.
L’amendement n° 379 rectifié, présenté par Mme Jourda et M. Cabanel, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 13
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du principe de solidarité́ écologique prévu au 6° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
La parole est à Mme Gisèle Jourda.

La prise en compte des notions novatrices de « solidarité écologique » et, tout particulièrement, d’incidence « notable » dans les décisions publiques est nouvelle et sera forcément soumise à des interprétations.
L’aspect novateur de ce principe de solidarité écologique, lequel constitue une véritable avancée en matière de solidarité environnementale, mérite d’être évalué et mesuré. Nous disposerons ainsi d’une bonne connaissance de l’efficacité de cette mesure et de la façon dont elle aura été interprétée, et surtout traduite en actions concrètes.
Un rapport sur ce sujet peut constituer, en ce sens, un outil très efficace, dont le Gouvernement comme le Parlement ne doivent pas se priver.

La commission est défavorable non pas à une réflexion sur le bilan de la mise en œuvre d’un principe nouveau, mais, d’une manière générale, aux demandes de rapports. Il existe d’autres moyens, pour le Parlement, de faire son travail de contrôle : par exemple, en mettant en place une mission d’information sur l’efficacité du dispositif.
Je partage l’avis du rapporteur et suggère le retrait de cet amendement. Ce travail relève en effet de la mission du Parlement.

Non, je le retire, monsieur le président, mais je ne comprends pas tout à fait la réponse qui m’est faite. Concernant le principe de non-régression, le rapporteur soutient la rédaction d’un rapport ; en revanche, il s’y oppose à propos d’une notion aussi novatrice que celle-ci ! Je ne perçois pas très bien la logique de cette réponse.

L’amendement n° 379 rectifié est retiré.
La parole est à M. Daniel Dubois, pour explication de vote sur l’article.

L’article L. 110-1 du code de l’environnement met en exergue le principe même du développement durable, appuyé sur trois piliers : l’économique, le social et l’environnemental.
Au travers de la mise en œuvre du principe de solidarité écologique, l’alinéa 11 de cet article 2 va donner la primauté à l’écologie. Toute action publique sur les territoires se verra donc confrontée à des difficultés importantes. Dès lors qu’un projet ne conviendra pas à une certaine catégorie de la population ou à une association, des occupations de terrains se produiront. Cet alinéa promet de beaux jours aux « zadistes », en particulier dans les territoires ruraux ! Je ne voterai donc pas cet article.

J’ai senti tout à l’heure le rapporteur très contrarié par l’opposition d’une large majorité de la Haute Assemblée au rapport sur le principe de non-régression. Il a expliqué qu’en prenant une telle position nous nous tirions une balle dans le pied, parce que nous refusions ainsi d’engager la réflexion sur le sujet et risquions de nous voir un jour imposer une norme européenne sans nous y être préparés.
Je comprends tout à fait les préoccupations du rapporteur, mais est-il nécessaire que le Gouvernement remette un rapport ? Rien ne s’oppose à ce que la commission du développement durable prenne une initiative dans ce domaine.
J’observe d’ailleurs que le rapporteur a ensuite émis un avis défavorable sur une autre demande de rapport, en se fondant sur des arguments qui auraient pu être invoqués pour rejeter le rapport sur le principe de non-régression.
En définitive, si le Parlement souhaite vraiment se saisir de ce sujet pour déterminer s’il serait pertinent d’introduire dans la loi française le principe de non-régression, il peut le faire, notamment en auditionnant des scientifiques : cela fait partie de ses missions.

Je ne suis pas contrarié qu’un amendement présenté par la commission ne soit pas adopté ! C’est le jeu normal du débat parlementaire.
Concernant l’amendement défendu par Mme Jourda, le problème n’était pas du tout le même : dans un cas, il s’agissait de proposer un rapport pour engager la réflexion sur l’instauration dans notre droit positif d’un principe dont nous ne connaissons pas exactement les contours et d’en vérifier à la fois l’opportunité et le contenu ; dans l’autre cas, il s’agissait d’apprécier une politique déjà inscrite dans notre droit positif.
Enfin – je le dis avec l’autorisation du président de la commission –, rien n’interdira à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable de mener un travail de réflexion sur le principe de non-régression, notre assemblée ayant besoin, me semble-t-il, d’être éclairée sur ce sujet.
L'article 2 est adopté.

Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 13 rectifié ter est présenté par M. Cardoux, Mme Cayeux, M. Vasselle, Mme Canayer, MM. Gilles, Pointereau, Milon, Mouiller et Panunzi, Mme Gruny, M. Kennel, Mme Lopez, MM. Bouchet, D. Laurent, Trillard, Mandelli, César, Mayet, Lemoyne, Cornu, Morisset et Laménie, Mmes Micouleau et Primas, M. Commeinhes, Mme Giudicelli, M. Charon, Mme Lamure, MM. Vaspart, Doligé, J.P. Fournier, Poniatowski, Genest, Danesi, Grand, Bizet, Pillet, Pellevat, Pinton, de Nicolaÿ, Revet, Lefèvre, B. Fournier, Longuet, Pintat, Vial et Darnaud, Mme Morhet-Richaud, MM. Allizard, Delattre, Masclet, P. Leroy et Lenoir, Mme Deseyne et MM. A. Marc, Dassault, Chasseing, Luche, Gremillet, Houpert, Savary, Médevielle, Guerriau et D. Dubois.
L'amendement n° 82 rectifié ter est présenté par MM. Bérit-Débat, Patriat et Carrère, Mmes Cartron et D. Michel, MM. Vaugrenard, Camani, Labazée, Roux et Manable, Mmes Jourda, Herviaux et Bataille, MM. Montaugé, Lalande, Lorgeoux, J.C. Leroy, Jeansannetas, Chiron et Courteau, Mme Riocreux et MM. Mazuir, Madrelle, Cazeau et Raynal.
L'amendement n° 532 rectifié est présenté par MM. Bertrand, Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du III de de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« 2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ; »
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié ter.

Cet amendement vise à faire explicitement référence à la préservation des services et des usages parmi les finalités du développement durable, telles que définies à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
En effet, les usages ne doivent pas être vus uniquement comme un problème, mais également comme une partie de la solution, dans la mesure où les utilisateurs de la ressource ont aussi un intérêt à la conserver. Préservation et usages de la biodiversité doivent donc être mis en balance.
À titre d’illustration, permettez-moi de vous donner lecture d’un article paru récemment dans une revue cynégétique et concernant les efforts consentis par un chasseur aménageur pour remettre en eau son marais. Il s’agit bien ici de la préservation des usages et de la biodiversité.
Ce chasseur s’est adressé à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, l’ONEMA, afin d’entreprendre un certain nombre de travaux. Cet article témoigne des contraintes administratives auxquelles il s’est vu exposé :
« Il est toujours possible de déposer auprès de l’ONEMA du département un dossier étayé justifiant une intervention technique. Il est toujours répondu qu’une étude d’impact est indispensable. L’ONEMA désigne alors un cabinet. […] Des années sont nécessaires pour les résultats. Les frais de cette enquête sont imputables au demandeur. Souvent ils sont d’un coût supérieur au coût réel des travaux ! Dans la majeure partie des cas, l’ONEMA, en finale, s’oppose à l’intervention.
« Toutes les raisons sont bonnes pour qu’il n’y ait plus en France aucun entretien de la nature. Ne cherchez pas ailleurs une des causes de la plupart des inondations répétées et meurtrières. Ces contraintes administratives datent d’une vingtaine d’années, c’est pourquoi certaines zones humides partent en déshérence ou certaines communes vendent leurs marais communaux qu’elles n’arrivent plus à gérer. Quand le chasseur aménageur se lassera ou n’aura plus les moyens physiques ou financiers de continuer sa tâche […], il y aura de moins en moins de chasseurs consommateurs. »

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour présenter l'amendement n° 82 rectifié ter.

Sans revenir sur l’argumentation développée par M. Cardoux, je dirai simplement que la sauvegarde des usages est indispensable au regard de leur utilité en matière de gestion durable de l’environnement, ainsi que de mobilisation des utilisateurs directs, qui doivent être associés aux objectifs fixés par la loi en termes de reconquête de la biodiversité. L’exemple cité à l’instant par M. Cardoux est tout à fait parlant.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 532 rectifié.

Ces amendements avaient été examinés et rejetés par la commission en juillet dernier. Ils visent à compléter l’article L. 110-1 du code de l’environnement, qui prévoit que l’objectif de développement durable répond à cinq finalités, dont la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources : ils tendent à y ajouter la sauvegarde des services qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent.
Je reste défavorable à ces amendements, essentiellement pour une question de droit : on peut bien répéter indéfiniment le contraire, la préservation des usages n’est pas un principe. Les usages peuvent seulement être un instrument au service du principe de préservation des milieux. La commission émet donc un avis défavorable.

Si je lis les trois amendements en faisant abstraction de la qualité de leurs auteurs, je ne peux deviner que leurs dispositions concernent des pratiques de chasse. De quels usages s’agit-il ? De nombreux randonneurs cueillent des bouquets d’aconits et de digitales en montagne alors que c’est interdit. Trop de gens jettent encore leur vieux matelas dans les ravines…
Tout à l’heure vous vous êtes opposés à des amendements au motif que leur adoption risquerait de bloquer l’évolution du droit de l’environnement. Or, avec l’inscription dans la loi de la « préservation des usages » que vous proposez, rien ne pourra plus bouger ! Il n’est même pas précisé qu’il s’agit des usages licites… Il y a cinquante ans, avec une telle rédaction, vous auriez préservé le droit de clouer des chouettes sur les portes !
Je sais que l’intention des auteurs de ces amendements était en fait de préserver les pratiques de chasse, mais la formulation proposée est dangereuse !

Madame Blandin, je vous ferai d’abord observer que, en défendant un premier amendement relatif aux usages, j’ai cité la randonnée, la cueillette de champignons, l’herboristerie…
Il est vrai que ces amendements ont été rédigés par des chasseurs, mais si vous n’aviez pas eu de cesse, depuis des années, d’attaquer les chasseurs d’une manière inconsidérée au travers d’amendements relevant de la désinformation, ils ne seraient pas sur la défensive comme ils le sont actuellement !

J’ai pris tout à l’heure l’exemple de la réhabilitation d’un marais pour la chasse de la bécassine. Beaucoup de chasseurs ouvrent leurs marais aux randonneurs en dehors des périodes de chasse afin qu’ils puissent observer les oiseaux. Certains construisent même des miradors d’observation de la faune.
C’est donc un mauvais procès que vous leur faites.

Je le redis : si l’on conteste à l’activité humaine, et en particulier au chasseur aménageur, son rôle dans la préservation de la biodiversité, le texte sera incomplet.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 13 rectifié ter, 82 rectifié ter et 532 rectifié.
Les amendements sont adoptés.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2.
Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :
« TITRE IV TER
« DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT
« Art. 1386-19. – Toute personne qui cause un dommage à l’environnement est tenue de le réparer.
« Art. 1386-20. – La réparation du dommage à l’environnement s’effectue prioritairement en nature.
« Lorsque la réparation en nature du dommage n’est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l’État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, à la protection de l’environnement.
« Art. 1386-21. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu’elles ont été utilement engagées. »
Le Gouvernement soutient tout à fait l’introduction par la commission du développement durable de l’article 2 bis, qui insère dans le code civil trois articles relatifs à la responsabilité environnementale.
Le premier dispose que toute personne qui cause un dommage à l’environnement est tenue de le réparer. Le deuxième prévoit que la réparation des dommages se fait prioritairement en nature et, à défaut, que l’État ou un organisme désigné par lui peut percevoir le dédommagement. Enfin, le troisième prévoit la possibilité de dommages et intérêts.
Le Gouvernement se rallie à cet ajout, tout à fait opportun.

Cet article constitue la reprise d’une proposition de loi dont j’étais l’auteur et qui avait été votée au printemps 2012 à l’unanimité par le Sénat.
Je voudrais préciser l’origine de ce dispositif, indiquer pourquoi il me semble important de l’inscrire dans le code civil et enfin expliquer pourquoi le Gouvernement ne pourra pas se tenir quitte avec cette rédaction, qui mérite d’être complétée.
En premier lieu, ce dispositif a été inspiré par la catastrophe de l’Erika, survenue en décembre 1999. J’ai ensuite mené un combat juridique de treize ans, qui a abouti en septembre 2012 à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation reconnaissant le préjudice écologique. Je remercie M. le rapporteur d’avoir repris le texte de la proposition de loi que j’avais déposée.
En deuxième lieu, s’il me semble important d’introduire le préjudice écologique dans le code civil, c’est d’abord parce qu’il existe désormais : c’est une construction prétorienne, jurisprudentielle, avec les avantages et les inconvénients que cela suppose. Des dizaines de décisions de justice, parfois contradictoires ou conduisant à des doublons en termes d’indemnisation, ont été prises sur le territoire français depuis l’arrêt de septembre 2012. Comme disait Victor Hugo, il est temps de faire entrer le droit dans la loi.
Par ailleurs, j’observe que le droit de la responsabilité a du mal à appréhender la notion de préjudice écologique. En effet, pour qu’un dommage soit réparable, il doit normalement être personnel. La nature n’étant pas une personne, il n’y a donc pas de victime et, partant, pas de préjudice ou de dommage.
Enfin, le droit de la réparation est parfaitement inapte à appréhender la réparation, notamment en termes de nature, du préjudice écologique.
Je suis très heureux que Mme la ministre soit favorable à cet article. En 2012, la garde des sceaux avait demandé à un groupe de travail présidé par le professeur Jégouzo de définir des modalités d’application, le principe en lui-même soulevant un certain nombre de questions.
Ainsi, à partir de quel seuil de gravité le fait générateur est-il constitué ? Le groupe de travail avait proposé de retenir la notion d’« anormalité » du préjudice, pour signifier la nécessité d’une forme de gravité pour le déclenchement du processus. Cela me semble important.
En outre, qui a intérêt à agir ? L’État, par le biais du ministère public, les collectivités, des associations reconnues d’utilité publique ? Cette question devra être tranchée.
Quel est le régime de réparation ? Alain Anziani, rapporteur de la proposition de loi, et moi avions estimé qu’une réparation en nature était nettement préférable.
Enfin, quid des délais de prescription ? Même si cette question n’était pas abordée dans la proposition de loi, le groupe de travail avait proposé de retenir un délai de prescription de deux ans à partir de la manifestation du préjudice.
On le voit, le sujet est complexe. Le terrain a été pour partie défriché par le groupe de travail ; il appartient désormais au Gouvernement, madame la ministre, de rendre le dispositif opérationnel.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 173 est présenté par M. Pellevat.
L'amendement n° 482 rectifié est présenté par MM. Kern, Luche, Guerriau, Bonnecarrère, Détraigne et L. Hervé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Cyril Pellevat, pour présenter l’amendement n° 173.

Au vu des éléments présentés par mon collègue Bruno Retailleau, je le retire, monsieur le président.

L'amendement n° 173 est retiré.
L’amendement n° 482 rectifié n’est pas soutenu.
L'amendement n° 305, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :
« TITRE IV TER
« DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT
« Art. 1386 -19. – Toute personne qui cause un dommage à l’environnement est tenue de le réparer.
« Art. 1386 -20. – Le dommage à l’environnement s’entend de l’atteinte anormale aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ainsi qu’aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.
« Art. 1386 -21. – Sans préjudice des procédures instituées par les articles L. 160-1 et suivants du code de l’environnement, l’action en réparation du dommage à l’environnement visé à l’article 1386-19 est ouverte à l’État, au ministère public, aux collectivités territoriales ainsi qu’à leurs groupements dont le territoire est concerné, aux établissements publics, aux fondations et associations, ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement.
« Art. 1386 -22. – La réparation du dommage à l’environnement s’effectue prioritairement en nature, par des mesures de réparation primaire, complémentaire et le cas échéant, compensatoire.
« Lorsque la réparation en nature du dommage n’est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l’État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, à la protection de l’environnement.
« Art. 1386 -23. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu’elles ont été utilement engagées.
« Art. 1386 -24. – Lorsque l’auteur du dommage a commis intentionnellement une faute grave, notamment lorsque celle-ci a engendré un gain ou une économie pour son auteur, le juge peut le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende civile. Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l'auteur ou aux profits qu'il en aura retirés. L’amende ne peut excéder le décuple du montant du profit ou de l’économie réalisés. Si le responsable est une personne morale, l’amende peut être portée à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice au cours duquel le dommage a été commis. Cette amende est affectée au financement d’opérations de protection et de restauration de l’environnement dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Ronan Dantec.

La commission a introduit dans le texte un article 2 bis visant à intégrer la notion de préjudice écologique dans le code civil, en reprenant la teneur de la proposition de loi de M. Retailleau.
Ce texte mérite d’être complété et précisé avec les éléments du rapport Jégouzo. Il est en effet indispensable de donner une définition du dommage environnemental, de préciser qui peut agir et d’ouvrir largement l’action, en respectant ainsi les engagements internationaux de la France.
La question de la biodiversité ne se limite pas aux dates d’ouverture de la chasse au gibier d’eau ! Cette vision, centrée sur une seule activité liée à la nature, était en voie d’affaiblir la qualité de nos débats. On en revient, avec l’article 2 bis, à la vocation profonde du texte, à savoir trouver les moyens de répondre aux grands enjeux de la biodiversité.
M. Retailleau et moi-même avons été marqués par la catastrophe provoquée par le naufrage de l’Erika. On ne peut laisser impunis de tels délits. Le dispositif de cet article permettra une avancée importante à cet égard.
Pour l’heure, il importe – c’est un point d’accord entre nous – d’inscrire dans la loi la notion de préjudice écologique. On peut débattre de l’opportunité d’intégrer d’ores et déjà les éléments du rapport Jégouzo. Pour une fois que nous pouvons parvenir à un consensus sur les enjeux de la protection de la nature, ne boudons pas notre plaisir !

Je rejoins MM. Retailleau et Dantec : il convient de compléter le dispositif.
Cet article, introduit par la commission, reprend tel quel le contenu de la proposition de loi de M. Retailleau, qui représentait une avancée juridique importante. La commission s’est interdit de compléter ses dispositions, estimant qu’il convenait d’établir les modalités d’un travail commun entre le ministère de l’environnement, la Chancellerie, la commission des lois du Sénat et elle-même.
Les apports proposés par notre collègue Ronan Dantec me paraissent pertinents, de même que les préconisations du rapport Jégouzo. Dans le cadre de la préparation de l’examen de ce projet de loi, j’ai auditionné, notamment, les professeurs Laurent Neyret et François-Guy Trébulle, ainsi que Mme Makowiak, directrice du Centre de recherches interdisciplinaires en droit de l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme. Reste à définir les voies et moyens pour avancer.
Ce n’est pas faire acte de faiblesse ou de lâcheté que de me tourner vers le Gouvernement à cet instant : même si le Parlement doit apporter sa pleine contribution, le sujet est éminemment régalien, comme l’a souligné Bruno Retailleau. Peut-être pourriez-vous réunir, madame la ministre, des juristes et des parlementaires pour l’examiner plus à fond ? Notre pays doit se doter d’instruments juridiques permettant de répondre aux questions soulevées par la proposition de loi de M. Retailleau.
Pour l’heure, je propose de nous en tenir à la rédaction adoptée par la commission, afin qu’elle serve de base de travail. Qu’en pensez-vous, madame la ministre ?
Mon département, voisin de la Vendée, a lui aussi été victime du drame de l’Erika, même si ce fut dans des proportions moindres.
Je propose que cet article serve de base de travail. Depuis les travaux en commission, nous avons continué à travailler sur ce sujet. Nous pouvons constituer un groupe de travail technique rassemblant des juristes et des parlementaires, en vue de préciser au maximum les choses et de préparer la deuxième lecture au Sénat. Il faut avancer sur les questions du délai de prescription, de l’articulation avec la police de l’environnement, de la définition des personnes ayant intérêt à agir, de la fixation des niveaux d’indemnisation…
Tel est l’engagement que je peux prendre ce soir devant la Haute Assemblée.

J’accepte la proposition de Mme la ministre de mettre en place un tel groupe de travail. Je suis disponible pour travailler sur cette question extrêmement importante d’ici à la deuxième lecture.
Dans cette perspective, je retire l’amendement, monsieur le président.

L'amendement n° 305 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 58 rectifié est présenté par M. Pointereau, Mme Morhet-Richaud, MM. Chaize, Commeinhes et Mouiller, Mme Cayeux, MM. Pinton, de Nicolaÿ, Milon, Mayet, Cardoux, Vaspart et Cornu, Mme Primas, MM. Poniatowski et D. Laurent, Mme Lamure, M. Danesi, Mme Troendlé, MM. Bizet, César, Laménie et Pierre, Mme Canayer, MM. Lenoir, P. Leroy, B. Fournier et Bas, Mme Gruny et MM. Raison, Savary, Kennel, Bockel et Husson.
L'amendement n° 483 rectifié est présenté par MM. Kern, Luche, Guerriau, Bonnecarrère, Détraigne et L. Hervé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 4 et 5
Après le mot :
dommage
insérer les mots :
grave et notable
La parole est à M. Rémy Pointereau, pour présenter l’amendement n° 58 rectifié.

L’article 2 bis a pour objet d’inscrire dans le code civil un principe de responsabilité en matière d’atteintes à l'environnement, sans définir le périmètre de cette dernière notion, ni prévoir une gradation de la compensation en fonction de la gravité du dommage. Tel est l’objet du présent amendement.
Par ailleurs, les espèces protégées relevant déjà d’un régime de protection et de compensation, l’article prévoit de dépasser largement le cadre des espèces protégées. Sans remettre en cause l’intérêt d’instaurer dans la loi un principe de réparation des dommages causés à l'environnement, il convient de préciser à quel type de dommages ce principe doit s’appliquer : en l’occurrence, les dommages exceptionnels, tels ceux qui ont été causés par le naufrage de l'Erika. L’absence de précision sur la nature des dommages à l’environnement visés entraînerait un risque de jurisprudence important.

L’amendement n° 483 rectifié n’est pas soutenu.
L'amendement n° 404 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Lenoir, Bizet, Milon, J.P. Fournier et G. Bailly, Mme Deromedi, M. Chatillon, Mmes Lamure et Lopez, MM. Pellevat, Savary, Morisset, Calvet, Mandelli et Pierre, Mmes Primas et Morhet-Richaud et M. Mouiller, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
dommage
insérer les mots :
grave et durable
La parole est à M. Daniel Gremillet.

Nous proposons de restreindre le champ d’application de l’article 2 bis en visant les dommages graves et durables et d’envisager une gradation de la compensation en fonction de l’importance du dommage causé à l’environnement. Au regard de la jurisprudence, la notion de durabilité est souvent mieux interprétée que d’autres.

L'amendement n° 174, présenté par M. Pellevat, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un dommage à l’environnement toute détérioration grave et mesurable de l’environnement.
La parole est à M. Cyril Pellevat.

Au vu des éléments fournis par M. Retailleau et Mme la ministre, je retire cet amendement, ainsi que les quatre suivants. Je suis disponible pour participer au groupe de travail annoncé.

L'amendement n° 174 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 58 rectifié et 404 rectifié ?

Certes, on pourrait accepter ces amendements, mais il me semble préférable de travailler d’ici à la deuxième lecture sur la base du texte de M. Retailleau, comme l’a proposé Mme la ministre, et donc de ne pas amender l’article. C’est d’ailleurs dans cet esprit que M. Dantec a retiré son amendement. Je vous propose donc, mes chers collègues, de faire de même, sachant que vos contributions seront versées au dossier et étudiées par le groupe de travail réunissant des juristes et des parlementaires dont Mme la ministre a annoncé la création. Pour l’heure, il serait prématuré d’adopter vos propositions.
Je sollicite à mon tour le retrait de ces deux amendements, même si, sur le fond, ils sont tout à fait justifiés. Il est évident que le dommage devra être grave et notable pour ouvrir droit à réparation. Le rapport Jégouzo avait préconisé de retenir la notion d’« atteinte anormale à l’environnement ». Je vous propose de mettre rapidement en place le groupe de travail, afin qu’il puisse approfondir la réflexion sur cette question d’ici à la deuxième lecture au Sénat, en vue d’assurer la stabilité de la jurisprudence et le caractère opérationnel du dispositif.

Il convient de rassurer un certain nombre d’acteurs économiques en expliquant que notre objectif est de mieux établir la sécurité du dispositif.
Le préjudice écologique existe, dès lors qu’il a été consacré par la Cour de cassation. Le problème tient à un foisonnement des interprétations et à des contradictions de jurisprudence, auxquels la loi doit mettre un terme.
Par ailleurs, je rappelle que, à l’origine, la proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil tendait à instaurer un régime de responsabilité pour faute. Puis notre collègue Alain Anziani avait expliqué que l’on allait finalement évoluer vers une responsabilité sans faute. Dans ces conditions, comme vous l’avez indiqué à demi-mot, madame la ministre, la question se pose de la compatibilité avec les régimes d’autorisation administrative des installations. Le groupe de travail présidé par le professeur Jégouzo avait levé cette difficulté en ayant recours à la théorie du trouble anormal de voisinage.
Il ne s’agit pas pour moi, par esprit de contradiction, de prendre le contre-pied de M. le rapporteur ou de Mme la ministre, mais il me semble que nous pourrions dès à présent inscrire dans la rédaction de l’article la notion de gravité : nous savons très bien que, de toute façon, seul un fait générateur présentant un certain niveau de gravité pourra déclencher la mise en jeu d’une responsabilité. Cela permettrait peut-être de rassurer les acteurs économiques.
Je tiens à dire que je suis pour la liberté, bornée par la responsabilité, qui en même temps lui donne toute sa force. On ne peut pas vouloir, en économie, la liberté sans la responsabilité ! Le principe pollueur-payeur s’inscrit dans cette philosophie. Il reste à encadrer le dispositif pour le sécuriser. Je pense que nous pourrons largement le faire, d’ici à la deuxième lecture, en nous fondant sur les travaux juridiques déjà réalisés.
Dans cette attente, je propose d’inscrire sans attendre la notion de gravité dans le projet de loi, afin de donner un signal.

Des inquiétudes s’expriment parmi les acteurs économiques, comme M. Retailleau vient de le signaler, en particulier dans le monde agricole.
Les agriculteurs craignent d’être mis en cause pour les micro-dommages qui se produisent parfois, par exemple lorsqu’un bidon de produits phytosanitaires se renverse.
J’ai proposé d’ajouter, après le mot « dommage », les termes « grave et notable ». Notre collègue Daniel Gremillet propose la formulation « dommage grave et durable ». J’ignore quelle rédaction est la meilleure sur le plan juridique.

En tout cas, je veux bien retirer mon amendement au profit de celui de Daniel Gremillet.

L’amendement n° 58 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 404 rectifié.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.

L’amendement n° 175, présenté par M. Pellevat, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 1386-19-… – Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage à l’environnement ne peut en demander réparation sur le fondement du présent titre.
L’amendement n° 176, présenté par M. Pellevat, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 1386 -19-… – Sont seuls habilités à agir en réparation du dommage à l’environnement :
« – Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements et organismes publics exerçant une compétence spéciale en matière environnementale. Un décret en Conseil d’État précise la liste de ces établissements ou organismes ;
« – Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement dès lors que le dommage en cause a un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires.
L’amendement n° 177, présenté par M. Pellevat, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
supprimer le mot :
prioritairement
II. – Alinéa 6
Après les mots :
se traduit par
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
des mesures de restauration globales compensatoires de l’élément environnemental endommagé.
L’amendement n° 178, présenté par M. Pellevat, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le juge détermine les mesures de réparation sur la base de celles proposées par le demandeur et débattues entre les parties.
Ces quatre amendements ont été précédemment retirés.
L’amendement n° 306, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 1386 -21. – Les dépenses exposées par le demandeur pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage à l’environnement, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable, dès lors qu'elles ont été utilement engagées.
La parole est à M. Ronan Dantec.

De même que j’ai retiré l’amendement n° 305, je retire cet amendement et le suivant ; je les verse tous trois au débat qui s’ouvrira au sein du groupe de travail.

L’amendement n° 306 est retiré.
L’amendement n° 307, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 160-1 du code de l’environnement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre … : De la responsabilité du fait des atteintes à l'environnement
« Art. L. 160-… – Toute personne qui cause un dommage à l'environnement est tenue de le réparer.
« Art. L. 160 bis-… – La réparation du dommage à l'environnement s'effectue prioritairement en nature.
« Lorsque la réparation en nature du dommage n'est pas possible, la réparation se traduit par une compensation financière versée à l'État ou à un organisme désigné par lui et affectée, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, à la protection de l'environnement.
« Art. L. 160 ter-… – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, en éviter l'aggravation ou en réduire les conséquences peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts, dès lors qu'elles ont été utilement engagées. »
Cet amendement a été précédemment retiré.
Je mets aux voix l’article 2 bis, modifié.
L'article 2 bis est adopté.
Le premier alinéa de l’article L. 110-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « sain et » sont remplacés par les mots : « sain. Ils » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que la préservation et l’utilisation durable des continuités écologiques ».
L’article 3 du projet de loi inscrit dans le code de l’environnement la notion très importante de continuités économiques, qui recouvre de nombreux dispositifs mis en œuvre sur les territoires, tels que les trames verte et bleue ou les schémas régionaux de cohérence écologique.
Voilà bien longtemps que l’on sait combien la richesse de la biodiversité dépend de ces continuités écologiques, qui mettent en connexion les diverses zones de biodiversité, de richesse variable, définies par les schémas régionaux de cohérence écologique, en prenant en compte les identités particulières des différents territoires. Il est essentiel que ces continuités écologiques puissent être restructurées et, le cas échéant, réparées, car leur rupture précipite la dégradation de la biodiversité.

L’amendement n° 308, présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
et l’utilisation durable
La parole est à M. Ronan Dantec.

Cet amendement vise à supprimer la mention, introduite par la commission, de l’« utilisation durable » Il s’agit de prévenir la fragilisation juridique qui pourrait résulter de son caractère un peu vague. De surcroît se pose la question des moyens employés pour assurer cette durabilité.
Surtout, les schémas régionaux de cohérence écologique, ainsi que les plans d’action stratégiques correspondants, prennent déjà en compte la dimension des usages. Ainsi, les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévoient que l’élaboration des plans d’action stratégiques « tient compte d’aspects socioéconomiques, de la conciliation des usages et de la pertinence de maintenir certains obstacles susceptibles de limiter la dispersion d’espèces ».
En l’occurrence, la notion d’« utilisation durable » n’est pas claire. Veut-on parler de l’utilisation des continuités écologiques par les espèces, par les randonneurs ? Mieux vaudrait, dans ces conditions, supprimer cette formule.

Nous avons précisé, à l’article L. 110-2 du code de l’environnement, que les lois et règlements « contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ». L’article 3 du projet de loi le complète pour intégrer « la préservation et l’utilisation durable des continuités écologiques ». Il est bon que les lois et règlements tendent à une utilisation durable des continuités écologiques. Cette précision nous paraissant utile, nous ne sommes pas favorables à l’amendement visant à la supprimer.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 149 est présenté par Mmes Billon et Jouanno, M. Médevielle et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L’amendement n° 309 est présenté par M. Dantec, Mme Blandin, M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le deuxième alinéa de l’article L. 110-2 du code de l’environnement est complété par les mots : «, y compris nocturne ».
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 149.

Cet amendement a pour objet d’introduire un dispositif de sauvegarde de l’environnement nocturne dans les principes généraux du projet de loi, aux fins de donner une traduction concrète à l’ambition suivante, énoncée dans la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement : « les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation ». Plus précisément, il s’agit d’indiquer que l’objectif de préservation des continuités écologiques, que l’article 3 du projet de loi introduit à l’article L.110-2 du code de l’environnement, vaut de jour comme de nuit.

À l’article 1er du projet de loi, l’expression « paysages diurnes et nocturnes » n’a pas été retenue. Nous proposons d’y revenir ici : un paysage au clair de lune mérite d’être préservé !

Ces deux amendements identiques visent à mentionner l’environnement nocturne à l’alinéa 2 de l’article L. 110-2 du code de l’environnement, aux termes duquel « il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement ».
Nous avons longuement débattu de l’opportunité de supprimer la mention « diurnes et nocturnes » pour caractériser les paysages qui font partie du patrimoine de la nation. Nous avons supprimé cette précision pour assurer une meilleure lisibilité du droit et garantir la nécessaire normativité de la loi. J’ai dit, à cette occasion, que je ne comprenais pas très bien ce qu’était un paysage nocturne.
Toutefois, la question se pose ici dans des termes différents, le caractère nocturne pouvant être affecté par un excès d’éclairage. À titre personnel, je suis assez favorable à ces amendements. La commission, quant à elle, a émis un avis de sagesse.
Je suis favorable à ces amendements identiques, qui visent à prendre en compte la dimension nocturne de l’environnement. En effet, des travaux scientifiques récents font apparaître que les activités nocturnes contribuent à la fragmentation des espaces et de la biodiversité.
Les amendements sont adoptés.
L'article 3 est adopté.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue le mercredi 20 janvier 2016, à zéro heure quarante-cinq, est reprise à zéro heure cinquante.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 47 rectifié quater, présenté par M. G. Bailly, Mme Mélot et MM. Trillard, Vasselle, Revet et Lenoir, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 110-… ainsi rédigé :
« Art. L. 110-… – Certaines activités économiques telles que l’élevage herbivore sont reconnues comme contributrices à la protection de l’environnement. »
La parole est à M. Gérard Bailly.

En matière de biodiversité, il a beaucoup été question, depuis le début de nos échanges, d’insectes, d’oiseaux, de gibier, de poissons, bref d’animaux sauvages. Il ne faudrait pas pour autant oublier les animaux d’élevage, en particulier les herbivores. Sans eux, que seraient en effet nos montagnes, nos prairies, nos pâtures, nos paysages ?
Si le présent projet de loi insiste largement sur les services que la nature rend aux hommes – services d’ailleurs parfaitement intégrés par les agriculteurs –, il ne rend à l’inverse aucunement compte des externalités positives pour l’environnement et la biodiversité que créent des activités économiques comme l’élevage herbivore.
En effet, il nous faut considérer une réalité totalement absente de ce texte et pourtant primordiale : la plupart des espaces naturels à préserver sont avant tout des constructions humaines, qui ont été entretenues par plusieurs générations d’agriculteurs.
Le présent amendement vise donc à compléter la rédaction du code de l’environnement, en y insérant un nouveau principe de reconnaissance de la contribution de ces activités économiques à la protection de l’environnement.

L'amendement n° 150, présenté par Mmes Billon et Jouanno, M. Médevielle et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants–UC, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 110-… ainsi rédigé :
« Art. L. 110-… – Certaines activités économiques, comme l’élevage herbivore, peuvent être reconnues comme contribuant à la protection de l’environnement et de la biodiversité. »
La parole est à Mme Annick Billon.

La commission est défavorable à ces amendements.
Il est exact que certaines activités économiques peuvent avoir un effet positif sur l’environnement ou la biodiversité. Pour autant, en quoi cela justifie-t-il d’ériger ce constat en principe ? Quelle serait la portée normative de ces dispositions si on les inscrivait dans le code de l’environnement ? Ces amendements sont certes intéressants, mais déclaratifs. Il ne me semble pas utile d’empiler des dispositions n’emportant aucune conséquence juridique.
Cela étant, monsieur Bailly, je me souviens que la commission a donné un avis favorable à un autre de vos amendements soulignant la contribution des grandes prairies aux paysages. Je pense donc que vous aurez satisfaction.
Le Gouvernement reconnaît le rôle très important de l’élevage herbivore. Comme je l’ai constaté encore récemment dans des zones de moyenne montagne, cette activité économique permet d’éviter des déprises agricoles et rurales, ainsi que des problèmes de dégradation des paysages et des sols.
Cependant, il ne paraît pas tout à fait opportun d’introduire un article à cet endroit du texte pour souligner ce rôle. D’ailleurs, bien d’autres activités contribuant au maintien des paysages et des continuités écologiques mériteraient aussi d’être mises en valeur.

Je remercie M. le rapporteur et Mme la ministre d’avoir souligné l’importance du rôle de l’élevage herbivore dans nombre de nos départements, de montagne en particulier. Je vais suivre la suggestion de M. le rapporteur et retirer mon amendement.
Néanmoins, après un tel credo dans le rôle positif de l’élevage herbivore en matière environnementale, il faudra mentionner celui-ci dans le texte, à un endroit plus approprié.

L’amendement n° 47 rectifié quater est retiré.
Madame Billon, l'amendement n° 150 est-il maintenu ?
(Non modifié)
Au 5° de l’article L. 219-8 du même code, après le mot : « sous-marines, », sont insérés les mots : « ou de sources lumineuses ». –
Adopté.
(Non modifié)
À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 411-5 du même code, après le mot : « géologiques, », il est inséré le mot : « pédologiques, ».

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 405 rectifié est présenté par MM. Gremillet, Lenoir, Bizet, Milon, J.P. Fournier et G. Bailly, Mme Deromedi, M. Chatillon, Mmes Lamure et Lopez, MM. Pellevat, Savary, Morisset, Calvet, Mandelli et Pierre, Mme Primas, M. D. Laurent, Mme Morhet-Richaud et M. Mouiller.
L'amendement n° 484 rectifié est présenté par MM. Kern, Luche, Guerriau, Bonnecarrère, Détraigne et L. Hervé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° 405 rectifié.

La suppression de l’article 3 ter permettrait de gagner en efficacité et de faire des économies.
Cet article prévoit de confier la réalisation d’un inventaire du patrimoine naturel au Muséum national d'histoire naturelle, alors que le groupement d’intérêt scientifique « sol », ou GIS « sol », qui rassemble le ministère de l'agriculture, le ministère de l’environnement, l'Institut national de la recherche agronomique, l’INRA, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l’ADEME, l'Institut de recherche pour le développement ou l'Inventaire forestier national, constitue déjà et gère un système d'information sur les sols de France.
Par ailleurs, un tel inventaire n’aurait pas de portée opérationnelle. Il serait plus efficace de confier à des structures dont c’est la vocation première, tel l’Observatoire des espaces agricoles naturels et forestiers, un travail qui ne se bornerait pas à recueillir et à mettre à disposition des données, mais viserait à proposer des outils et des méthodologies opérationnelles pour mieux préserver la qualité des sols agricoles, naturels et forestiers.

L'amendement n° 484 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 405 rectifié ?

La commission réitère l’avis défavorable qu’elle avait formulé en juillet dernier.
Cet amendement vise à supprimer l’article 3 ter, qui étend le champ de l’inventaire dont le Muséum national d’histoire naturelle a la responsabilité scientifique de réaliser aux richesses pédologiques.
La crainte exprimée par notre collègue est légitime, mais elle n’est pas fondée : si le Muséum a la responsabilité scientifique de conduire cet inventaire, c’est bien l’État qui pilote et qui peut décider de confier ce travail au GIS « sol ».
En outre, comme je l’avais indiqué en commission, le Muséum travaille sur cette question en lien avec les chambres d’agriculture, notamment par le biais de l’Observatoire agricole de la biodiversité.
Il n’y a donc pas d’inquiétudes à avoir, ni sur la qualité du travail scientifique mené par le Muséum ni sur le contrôle exercé par l’État.
Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.
Je suggère le retrait de cet amendement.
Si le code de l’environnement dispose déjà que les inventaires nationaux sont pilotés par l’État et « conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle », il n’est nullement dit que ce dernier réalisera tous ces inventaires. Au contraire, la tâche reviendra à un certain nombre d’opérateurs procédant à des inventaires et disposant de services de recherche. À ce titre, monsieur Gremillet, le groupement d’intérêt scientifique « sol » pourra tout à fait être sollicité, comme vous le proposez.
Il est d’autant plus important de laisser le dispositif en l’état que je vais dans un instant présenter, au nom du Gouvernement, un amendement visant précisément à rendre l’ensemble de ces données accessibles en open data. Cela favorisera la création d’entreprises dans le domaine du génie écologique.
De la même façon, nous ouvrons toutes les données liées à l’énergie pour permettre le développement d’entreprises actives dans le secteur des services intelligents. Il est impératif que la France ne prenne pas de retard à cet égard. Cela nécessite que nos start-up puissent accéder aux données. La transition numérique doit accompagner la transition énergétique et la préservation de la biodiversité.

Compte tenu des explications fournies par M. le rapporteur et Mme la ministre, j’accepte de retirer mon amendement. La garantie qu’aucune structure nouvelle ne sera créée et que le Muséum fera travailler les entités existantes est de nature à nous rassurer. Ma proposition allait cependant encore un peu plus loin, notamment en prévoyant qu’un travail soit réalisé, sous l’autorité du Muséum, avec l’Observatoire national des espaces naturels, agricoles et forestiers.

L'amendement n° 405 rectifié est retiré.
L'amendement n° 596 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa de l'article L. 371-3, le mot : “régionaux” est remplacé par le mot : “territoriaux” ;
2° La seconde phrase du III de l'article L. 411-3 est supprimée ;
3° L’article L. 411-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411 -5. – I. – L'inventaire national du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire national du patrimoine naturel, l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.
« L’État en assure la conception, l’animation et l’évaluation.
« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire national par la saisie ou, à défaut, le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts, réalisés dans le cadre de l’élaboration des plans et programmes mentionnés à l’article L. 122-4 et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative.
« On entend par données brutes de biodiversité, les données d’observation de taxons, d’habitats d’espèces ou naturels obtenues par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d’organismes détenant des données existantes.
« La saisie ou le versement de données s’effectue au moyen d’une application informatique mise gratuitement à la disposition des maîtres d’ouvrage par l’État.
« II. – En complément de l’inventaire national du patrimoine naturel, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux ou territoriaux ou d’atlas de la biodiversité, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3 ou à la mise en œuvre des articles L. 412-2-1 et suivants lorsque la région concernée a adopté la délibération prévue à l’article L. 412-12-1.
« Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces réalisations.
« III. – Les inventaires mentionnés au présent article sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle qui en assure la validation et la diffusion conformément aux principes définis aux articles L. 127-1 et suivants.
« Sauf cas prévus par l’article L. 124-4, les données brutes contenues dans les inventaires mentionnés au présent article sont diffusées comme des données publiques, gratuites, librement ré-utilisables. » ;
4° Le titre 1er du livre III est abrogé.
La parole est à Mme la ministre.
L’article 3 ter, dans la rédaction ici proposée, répond à la préoccupation exprimée dans le cadre des travaux de la commission : le Gouvernement renonce à demander l’autorisation de légiférer par ordonnance sur cette question de l’inventaire national du patrimoine naturel. J’ai transformé cette demande en amendement, dont vous allez pouvoir débattre, mesdames, messieurs les sénateurs.
Quel est l’objectif ? Il s’agit de consolider, de procéder à une montée en puissance, en termes de densité, de l’inventaire national du patrimoine naturel.
Je rappelle que, à l’heure actuelle, l’inventaire mis en ligne par le Muséum national d’histoire naturelle rassemble 14 millions de données, plus de 145 000 espèces, 24 600 contours d’espaces naturels, 13 600 photos en ligne. Ces données, ouvertes aux chercheurs mais aussi, comme je l’indiquais à l’instant, aux entreprises développant des services intelligents liés par exemple à la biodiversité ou à la transition énergétique, donnent déjà lieu à 110 000 connexions par mois.
Il s’agit de prévoir le versement obligatoire à l’inventaire national du patrimoine naturel de toutes les données collectées par les maîtres d’ouvrage, par exemple dans le cadre de la réalisation d’études d’impact sur la biodiversité. Cela se pratique déjà, d’ailleurs, le Muséum recueillant en général toutes ces données.
Les collectivités locales sont aussi concernées, au titre des observatoires régionaux ou des atlas communaux de la biodiversité, actuellement en cours de déploiement dans tout le pays, notamment dans les territoires à énergie positive pour la croissance verte. J’ai réuni leurs représentants ce matin et je peux témoigner de l’engagement des communes, en particulier rurales, dans la réalisation de ces atlas retraçant leur patrimoine. Ces éléments font partie des données accessibles en open data.

Comme vient de le souligner Mme la ministre, cet amendement est la traduction, très concrète et rapide, d’une décision arrêtée récemment de ne pas légiférer par ordonnance sur ce sujet. Il s’agit d’expliciter et de mettre en œuvre les modalités de réalisation de l’inventaire national du patrimoine naturel. Nous aurons l’occasion de revenir sur le sujet en deuxième lecture.
Enfin, madame la ministre, je vous remercie d’avoir accepté de rectifier votre amendement, afin d’éviter que ne disparaisse l’article 3 ter, introduit par la commission.
Au bénéfice de ces explications, l’avis de la commission est très favorable.

Cet amendement est vraiment le bienvenu, madame la ministre.
Sur la forme, vous tenez la promesse que vous nous aviez faite d’éviter le recours aux ordonnances ; nous vous en remercions.
Surtout, sur le fond, nous allons ainsi pouvoir tous disposer d’un outil similaire au système d’information géographique, nous offrant une vision partagée de la biodiversité et de son évolution. Nous pourrons procéder à des superpositions entre réseaux, cadastres, accéder à de nombreuses données sur les parcelles, les cours d’eau, l’état des forêts, des différents sols. C’est une avancée considérable !
Il s’agira d’un outil essentiel, permettant de lever certaines craintes, de se poser les bonnes questions, de réfléchir à partir de données établies scientifiquement, et non plus d’impressions, de préjugés, d’a priori. Nous aurons ainsi l’occasion, me semble-t-il, de faire un grand pas en avant.
L'amendement est adopté.

En conséquence, l'article 3 ter est ainsi rédigé.
Mes chers collègues, nous avons examiné 59 amendements au cours de la journée ; il en reste 492.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 20 janvier 2016, à quatorze heures trente, le soir et la nuit :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n° 359, 2014-2015) et de la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la nomination à la présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité (n° 364 rectifié, 2014-2015).
Rapport de M. Jérôme Bignon, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 607 tomes I et II, 2014-2015).
Texte de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 608, 2014-2015).
Avis de Mme Françoise Férat, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 581, 2014-2015).
Avis de Mme Sophie Primas, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 549, 2014-2015).
Texte de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 609, 2014-2015).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 20 janvier 2016, à une heure dix.