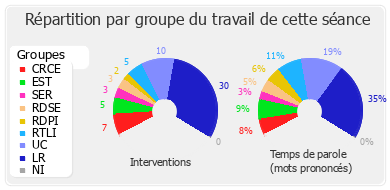Séance en hémicycle du 16 juillet 2019 à 14h30
Sommaire
- Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire du royaume-uni
- Organisation et transformation du système de santé (voir le dossier)
- Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire d'irak
- Organisation et transformation du système de santé
- Suite de la discussion et adoption définitive des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire (voir le dossier)
- Création de l'office français de la biodiversité (voir le dossier)
- Adoption définitive des conclusions de commissions mixtes paritaires sur un projet de loi et un projet de loi organique (voir le dossier)
- Communication relative à une commission mixte paritaire
- Mise au point au sujet d'un vote (voir le dossier)
- Énergie et climat (voir le dossier)
La séance
La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Jean-Marc Gabouty.

La séance est reprise.

M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, j’ai le plaisir de saluer, dans la tribune d’honneur du Sénat, une délégation de six parlementaires britanniques du groupe d’amitié Royaume-Uni–France, issus de la Chambre des Communes et de la Chambre des Lords, conduite par Stephen Crabb.
Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mme la ministre des solidarités et de la santé, se lèvent.

Ils sont accompagnés par notre collègue Jean-François Rapin, vice-président du groupe interparlementaire d’amitié France–Royaume-Uni.
Arrivée en fin de matinée, la délégation s’est entretenue avec note collègue Jean Bizet, président de la commission des affaires européennes, qui copréside le groupe de suivi sur le retrait du Royaume-Uni et la refondation de l’Union européenne.
Cette après-midi, la délégation participera à un débat sur les conséquences du Brexit pour les entreprises, organisé conjointement par le groupe d’amitié et la délégation aux entreprises.
Aujourd’hui, plus que jamais, il est important de réaffirmer les liens historiques forts qui unissent nos deux pays. La France et le Royaume-Uni doivent œuvrer pour conserver d’excellentes relations et agir dans leur intérêt commun.
Le Sénat est particulièrement attaché au dialogue interparlementaire avec le Parlement britannique, auquel il souhaite témoigner sa fidèle amitié.
Mes chers collègues, permettez-moi de souhaiter, en votre nom à tous, à nos homologues du Parlement britannique, la plus cordiale bienvenue, ainsi qu’un excellent et fructueux séjour.
Applaudissements.

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé (texte de la commission n° 587, rapport n° 586).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avant tout, je souhaite vous dire ma profonde satisfaction de voir les deux assemblées parlementaires aboutir à une rédaction commune sur un texte important, appelé à structurer notre système de santé pour plusieurs années.
Au terme de nos travaux, le projet de loi, qui comportait initialement 23 articles, en compte 63 ; 28 d’entre eux avaient été adoptés par le Sénat dans une rédaction conforme à celle de l’Assemblée nationale ou moyennant de simples ajustements rédactionnels. Au cours de la commission mixte paritaire, 31 articles ont été adoptés dans la rédaction issue du Sénat, avec parfois quelques aménagements formels ; 14 articles insérés par notre assemblée ont été maintenus.
Certes, le texte adopté par la CMP n’est pas parfait : les défauts du projet de loi initial, déjà largement soulignés, n’ont pas disparu. Le texte opère toujours un renvoi que nous jugeons bien trop large au décret et aux ordonnances ; il constitue sur plusieurs sujets majeurs, comme la réforme du statut des personnels hospitaliers ou les évolutions de la carte hospitalière, un simple cadre d’orientations, voire une forme de « chèque en blanc » au Gouvernement. De surcroît, il laisse de côté les enjeux majeurs de la gouvernance et, selon moi surtout, du financement de notre système de santé.
Je n’y reviens pas, car nous avons déjà largement évoqué ces éléments lors de nos discussions de première lecture.
Nous resterons vigilants quant aux moyens qui seront déployés pour accompagner la mise en œuvre de ce texte : c’est bien ce qui signera ou non la réussite de la nouvelle loi Santé, la troisième en dix ans.
Ces réserves étant dites, je me félicite de ce que l’esprit constructif dans lequel notre assemblée avait souhaité travailler ait été partagé par le rapporteur de l’Assemblée nationale, Thomas Mesnier, et, plus généralement, par l’ensemble des membres de la commission mixte paritaire. À l’heure où la demande d’accès aux soins se fait de plus en plus urgente dans nos territoires et où nous pouvons tous constater la souffrance des personnels hospitaliers, il aurait été dramatique de ne pas nous accorder sur la volonté de répondre à ces difficultés.
Je suis très satisfait, en particulier, que le texte adopté par la commission mixte paritaire prenne largement en compte les préoccupations exprimées par le Sénat sur deux sujets majeurs : l’amélioration de l’offre de soins dans les territoires et l’accompagnement de la transformation numérique de notre système de santé.
Sur le premier volet, nous sommes parvenus à un accord sur une disposition emblématique de l’article 2 introduite en séance publique par le Sénat : la mise en place d’une professionnalisation de la dernière année d’internat de médecine, sous la forme d’une année de pratique ambulatoire en autonomie se déroulant en priorité dans les zones sous-dotées.
Cette disposition résultait d’une démarche transpartisane portée par nos collègues Corinne Imbert, Yves Daudigny et Daniel Chasseing. Elle visait à répondre à l’attente immense que nous entendons tous dans nos territoires et qui s’est largement exprimée lors du grand débat national. On ne saurait attendre dix ou quinze ans pour traiter les difficultés d’accès aux soins que subissent des millions de nos concitoyens, en comptant sur les effets encore incertains de la réforme du numerus clausus.
Nos débats au Sénat ont été vifs à ce sujet, comme ils l’avaient d’ailleurs été à l’Assemblée nationale. Je dois dire que l’accord auquel nous sommes parvenus en CMP a fait l’objet d’âpres négociations avec la majorité de l’Assemblée nationale comme avec les représentants des internes en médecine, concernés au premier chef.
À mon sens, la rédaction retenue permet à la fois de proposer une première réponse efficace et pragmatique à l’urgence territoriale, dans un horizon temporel accessible et acceptable, et de prendre en compte les inquiétudes légitimement exprimées par les étudiants quant à la qualité de leur formation.
Le dispositif adopté prévoit de systématiser le stage ambulatoire en soins premiers en autonomie supervisée, ou Saspas, pour les étudiants de dernière année de médecine générale, en l’ouvrant aux étudiants d’autres spécialités. Si le Saspas existe depuis 2004, cette expérience de pratique ambulatoire n’est pas suivie par l’ensemble des étudiants en médecine générale, notamment en raison du manque de maîtres de stage. Ce stage, désormais obligatoire et généralisé, devra avoir une durée d’au moins un semestre – douze mois auraient été encore mieux.

Dans l’organisation actuelle du troisième cycle, cela permettra aux étudiants de se succéder sur un même terrain de stage semestre après semestre, ces terrains de stage devant être prioritairement définis dans les zones sous-dotées.
Ce stage sera effectué sous le régime de l’autonomie supervisée. Ses contours seront définis par un décret, qui pourra notamment ouvrir la possibilité d’une supervision à distance, afin de laisser davantage de souplesse dans l’organisation des terrains de stage.
Toutefois, madame la ministre, nous sommes tous d’accord sur ce point : il serait plus satisfaisant de pouvoir disposer de maîtres de stage en nombre suffisant, et donc de déployer très largement leur formation au cours des prochaines années.
Ce stage obligatoire permettra à l’ensemble d’une promotion, c’est-à-dire près de 3 500 étudiants, de découvrir l’exercice ambulatoire dans les territoires, puis d’y poursuivre – pourquoi pas ? – son exercice professionnel. Surtout, il permettra de déployer dans deux ans l’ensemble d’une promotion sur les territoires. Ainsi, ces derniers disposeront du renfort d’étudiants parvenus presque au terme de leur formation.
Cette disposition laisse en suspens la question de l’alignement de la formation de médecine générale sur celle des autres spécialités. Il me semble que la réflexion sur la mise en place d’une quatrième année en médecine générale devra être poursuivie.
Le volet territorial du texte contient également une invitation des partenaires conventionnels à ouvrir des négociations sur les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins. Cette disposition, introduite au Sénat sur l’initiative de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, me semble un signal positif, d’autant qu’elle ne restreint pas a priori la palette des outils qui pourront être déployés pour atteindre ce but.
Sur le volet numérique, les enrichissements substantiels du projet de loi opérés par le Sénat ont été conservés. L’ouverture de l’espace numérique de santé et du dossier médical partagé, leviers de la coordination indispensable des parcours de soins, sera donc automatique.
Pour éviter un retard qui pourrait ensuite être impossible à rattraper, notre assemblée avait également souhaité renforcer les exigences d’interopérabilité applicables au secteur en instituant un mécanisme de certification accompagné d’instruments à visée incitative pour les éditeurs : je me félicite de le voir figurer dans le texte que nous nous apprêtons à voter.
Bien entendu, j’ai également quelques regrets.
Nous n’avons pu maintenir certaines propositions sénatoriales qui nous paraissaient importantes. Je pense notamment à la composition des commissions médicales des groupements hospitaliers de territoires, les fameux GHT : le Sénat avait souhaité qu’elles émanent des commissions médicales des établissements parties, pour qu’elles ne deviennent pas des instances hors-sol, ou au sein desquelles les établissements supports seraient parfois les seuls représentés.
Madame la ministre, nous comptons sur vous pour veiller à ce que l’application de la loi et les ordonnances qui suivront sur ce sujet préservent un équilibre entre les établissements supports et les établissements périphériques dans le cadre de l’acte II des GHT.
Je regrette également que nous n’ayons pu tomber d’accord sur l’intégration dans la procédure de qualification de l’article 21 des praticiens à diplôme étranger hors Union européenne, les Padhue, exerçant au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les Ehpad.
L’ambition de régler l’ensemble des cas d’ici à 2021 ne pourra être satisfaite si nous commençons par exclure une partie des praticiens contribuant au bon fonctionnement de notre système de santé, d’autant que, pour ce qui concerne les Padhue, la plupart des acteurs ont agi aux frontières de l’illégalité. Contrairement aux annonces gouvernementales, nous devrions donc entendre de nouveau parler des Padhue au cours des prochaines années.
Enfin, nous avons accepté de supprimer certaines des dispositions introduites par le Sénat au regard des engagements pris par le Gouvernement.
Il en est ainsi des mesures incitatives à l’installation rapide des jeunes médecins dans nos territoires : nous suivrons avec attention les mesures que vous nous proposerez dans le cadre du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Plus généralement, nous veillerons à ce que le contenu des nombreuses ordonnances prévues par le texte corresponde bien aux orientations présentées dans le cadre de nos débats.
Pour ce qui concerne l’organisation de la santé au sein des territoires, nous avons insisté sur la nécessaire souplesse dans les démarches de structuration des acteurs, pour prendre en compte la diversité des situations locales. Un projet revenant à faire entrer tous les territoires dans un même moule est voué à l’échec. Blaise Pascal l’a exprimé mieux que moi par ces mots : « La multitude qui ne se réduit pas à l’unité est confusion ; l’unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie. »
Mes chers collègues, sous le bénéfice de ces observations, je vous invite à adopter le texte issu des travaux de la CMP ainsi que l’amendement de coordination qui sera présenté par le Gouvernement.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe La République En Marche.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur et président de la commission, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est une grande satisfaction lorsque les deux chambres du Parlement aboutissent à un texte commun. Une satisfaction renforcée s’agissant de ce projet de loi, car, chacun le sait sur ces travées, il y a urgence à réformer notre système de santé.
Cette loi permettra ainsi, avec les autres volets de « Ma santé 2022 », de nous armer face aux nombreux défis auxquels nous devons faire face, et de garantir une offre de soins égale et de qualité pour tous. Elle nous permettra aussi de répondre aux inquiétudes légitimes des Français, aux sollicitations des élus et aux aspirations des professionnels de santé, tout aussi légitimes. Les attentes sur les territoires sont très fortes et nous devons rapidement mettre en œuvre la loi pour que les résultats soient visibles.
Si le changement de paradigme engagé autour du projet Ma santé 2022 porte déjà ses fruits, puisque les professionnels de santé libéraux ont signé les accords avec l’assurance maladie sur le déploiement des assistants médicaux et le financement des communautés professionnelles territoriales de santé, il nous faut maintenant traduire concrètement ces avancées pour nos concitoyens.
La première orientation de Ma santé 2022 est de construire le système autour du patient, et c’est bien l’usager qui sera l’évaluateur de notre réussite.
Mesdames, messieurs les sénateurs, les débats au Parlement ont été riches. Ils ont permis d’améliorer plusieurs dispositions, de lever certaines craintes et de répondre au mieux aux situations des territoires. J’aimerais revenir quelques instants sur les apports sénatoriaux retenus lors de la réunion de la commission mixte paritaire.
Je pense d’abord à l’article visant à fusionner les multiples dispositifs d’aide à la coordination des parcours des patients qui coexistent aujourd’hui : Paerpa – parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie –, plateformes territoriales d’appui, MAIA – maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer –, méthodes d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie.
Cette simplification que vous avez envisagée dans un précédent rapport est plus que bienvenue.
Je pense également à la question du numérique en santé. Vous avez initié une avancée très importante en prévoyant l’ouverture automatique du dossier médical partagé pour tous dès 2021 et l’interopérabilité des systèmes, qui fait aujourd’hui défaut sur le terrain.
Je souhaiterais aussi saluer l’équilibre qui a été trouvé à l’article 2 concernant le développement des stages d’internes en médecine de ville. Je sais que plusieurs d’entre vous étaient très attachés à cette disposition et je suis heureuse qu’un compromis ait pu être trouvé pour maintenir une formation encadrée tout au long des études. Loin des mesures coercitives, le texte obligera aussi les universités et les services de l’État à trouver des terrains de stage en priorité dans les territoires en tension.
Ce projet de loi prépare les futurs soignants aux besoins du système de santé de demain : nous aurons désormais des professionnels de santé mieux sélectionnés, aux profils variés et davantage formés à travailler ensemble.
Dans le même temps, nous créons sur tous les territoires un collectif de soins au service des patients et nous offrons aux professionnels de santé les outils pour se rassembler et coopérer.
L’accord trouvé par la commission mixte paritaire porte un message fort de l’ensemble des forces politiques. Les deux chambres parlementaires ont été déterminées à répondre indépendamment des clivages partisans aux inquiétudes de nos concitoyens concernant l’accès aux soins dans tous les territoires.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je conclurai mon intervention par une note plus personnelle, car j’aimerais vous remercier des échanges sincères et éclairés que nous avons eus en audition, dans cet hémicycle ou en dehors. La question de la santé et de l’accès aux soins charrie beaucoup d’expériences personnelles, et je pense que chacun a pu exprimer ses convictions sur ce sujet.
Nous nous devons à présent de réussir. Je vous remercie d’avoir donné votre accord pour engager la transformation du système de santé que nous proposons.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après nos débats, je reste persuadée, avec l’ensemble des membres de mon groupe, que le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé ne va absolument pas régler les problèmes que connaît notre système de soins, singulièrement l’hôpital public.
Alors que les personnels et les praticiens dénoncent leurs conditions de travail, les patients leurs difficultés quant à l’accès aux soins, les élus et les usagers l’absence de prise en compte de leurs avis dans les décisions des établissements, vous poursuivez dans la même logique que vos prédécesseurs : limiter les dépenses publiques. C’est une réponse qui a prouvé son inefficacité ou plutôt sa nocivité, plongeant notre système de santé dans une crise profonde.
Madame la ministre, vous n’entendez pas la colère des professionnels, vous refusez de prendre en compte les propositions de notre groupe, qui, pourtant, sont de nature à redonner à notre système de santé les moyens de fonctionner.
Aujourd’hui, ce sont 205 services des urgences sur 524 qui sont en grève dans notre pays pour réclamer des effectifs en personnels pluridisciplinaires supplémentaires, des lits d’aval nécessaires pour atteindre l’objectif « zéro patient sur les brancards » et une revalorisation des salaires de 300 euros. Travailler dans de bonnes conditions pour une meilleure prise en charge des patients, quoi de plus normal ?
Or, madame la ministre, vous avez décidé avec Bercy qu’il n’y aurait pas d’augmentation des effectifs. Vous avez donc cherché des solutions ailleurs, en dégageant du temps médical pour les praticiens avec les délégations de tâches et la création des auxiliaires médicaux.
Ces mesures pourraient être efficaces si la situation de l’hôpital n’était pas telle qu’elle est aujourd’hui. Vous sous-estimez totalement les réalités de terrain. Après des années de suppression de postes à l’hôpital, les équipes sont épuisées et n’arrivent plus à répondre aux missions qui sont les leurs.
Alors que les personnels se mobilisent contre la détérioration des conditions de prise en charge des patients et de leurs conditions de travail, votre gouvernement fait adopter un amendement au projet de loi de transformation de la fonction publique pour étendre le recours aux contrats temporaires et saisonniers dans les hôpitaux. Le secrétaire d’État Olivier Dussopt ne connaît visiblement rien à la fonction publique hospitalière : il tient des propos mensongers qui me conduisent à faire un rappel au règlement. Face à des personnels qui n’en peuvent plus, vous faites le choix de la précarisation à outrance : ils jugeront !
Vous proposez également de réorganiser les hôpitaux en trois niveaux, pour éviter soi-disant que les patientes et les patients restent plusieurs heures sur un brancard. Vous vous vantez de labelliser deux fois plus d’hôpitaux de proximité, mais cela signifie en réalité deux fois plus d’hôpitaux qui ne réaliseront plus d’activités de chirurgie ou d’obstétrique, pour ne citer que ces deux exemples. Sous prétexte que les hôpitaux de proximité manquent de praticiens, vous préférez acter la carence et les amputer de leurs principales missions.
Ce faisant, d’une part, vous accélérez le phénomène de concentration de l’expertise et des moyens financiers dans les grandes structures hospitalières des métropoles au détriment des zones rurales et périurbaines ; d’autre part, vous éloignez les services de soins des habitants.
À l’inverse de ce que vous prévoyez de faire avec votre loi, il est indispensable de maintenir, sur notre territoire, un maillage d’hôpitaux de proximité disposant chacun d’un service des urgences, d’un service de médecine, de chirurgie, d’une unité obstétrique, de soins de suite et de structures pour les personnes âgées, le tout en liaison avec la médecine de ville et le réseau de centres de santé, ainsi qu’avec la psychiatrie de secteur. Pour y parvenir, il faut notamment embaucher, donc rendre plus attractive la fonction publique hospitalière.
La gradation des soins n’a de sens selon nous que si le premier niveau est le plus complet possible et accessible au plus grand nombre.
L’accord trouvé entre le Gouvernement, l’Assemblée nationale et la majorité du Sénat sur la désertification médicale illustre l’importance de ne pas transformer les hôpitaux de proximité en coquilles vides.
En obligeant les étudiantes et les étudiants à effectuer six mois de stage pour leur troisième et dernière année d’internat dans un territoire sous-doté, vous faites un premier pas dans la bonne direction. Mais ces 3 500 étudiants devront trouver des médecins maîtres de stages pour exercer dans les déserts médicaux. Or les maîtres de stages vont préférer choisir les hôpitaux spécialisés où se situent les services d’urgences, de maternité et de gériatrie plutôt que les hôpitaux de proximité tels que vous les concevez. En outre, nous savons toutes et tous que les étudiants souhaitent majoritairement exercer la médecine dans des structures collectives, de type centre de santé, pour avoir une activité salariée.
Nous déplorons que la commission mixte paritaire ait supprimé notre amendement qui visait à mettre fin à l’exercice non salarié dans les centres de santé. Votre avis de sagesse aurait mérité plus d’engagement de votre part, madame la ministre, afin que, peut-être, les députés de votre majorité nous suivent.
Par ailleurs, comment ne pas évoquer le scénario antidémocratique et contraire aux droits des femmes qui s’est joué pour faire retoquer l’amendement qui avait été adopté pour allonger le délai légal de l’IVG ?
Enfin, notre déception est profonde concernant les praticiens à diplôme hors Union européenne, notamment pour celles et ceux qui disposent de la nationalité française. Le Sénat avait adopté l’élargissement de l’exercice des Padhue dans le secteur médico-social, sur lequel est revenue la commission mixte paritaire, abandonnant les Padhue du médico-social à la précarité du travail illégal et à la non-reconnaissance de leurs qualifications.
Ce sont autant d’arguments qui nous conduisent à ne pas voter cette loi, d’autant qu’elle ne tire aucun enseignement de la mise en œuvre, à marche forcée, des groupements hospitaliers de territoire et qu’elle continue d’ignorer la démocratie sanitaire.
Dans son Discours de la méthode, Descartes nous invitait à douter de tout. Le moins que l’on puisse dire est que ce n’est pas la marque de fabrique de ce gouvernement. C’est fort regrettable, madame la ministre, car cela vous conduirait enfin à écouter et à entendre les professionnels de santé qui, tout comme notre groupe, ici, dans l’hémicycle, vous enjoignent à changer de politique dans l’intérêt commun.
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – Mme Maryvonne Blondin applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons les conclusions de la commission mixte paritaire qui, le 20 juin dernier, est parvenue à un accord sur le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé. Deux voix s’exprimeront pour le groupe socialiste et républicain et, avant Nadine Grelet-Certenais, j’aborderai deux sujets.
Conjuguée aux inégalités de santé – espérance de vie, prévalence de certaines pathologies dépendantes des conditions sociales ou environnementales –, la faible accessibilité aux soins d’environ 5 millions de Français, en territoires ruraux ou urbains, est l’un des facteurs les plus destructeurs de notre pacte républicain.
Trois amendements initiaux portés par Corinne Imbert, Daniel Chasseing et moi-même, un travail commun où l’intérêt général et la volonté d’agir ont écrasé les rivalités partisanes, une majorité forte de 311 voix, une difficile négociation entre les deux rapporteurs – je salue l’engagement d’Alain Milon sur ce dossier – ont abouti à un vote unanime de la commission mixte paritaire sur un amendement de compromis porteur de l’essentiel, à savoir la réalisation par les étudiants de médecine générale en dernière année de troisième cycle d’un stage d’un semestre au minimum en régime d’autonomie supervisée, en priorité dans les zones sous-denses, avec une extension possible à certaines autres spécialités.
Ainsi, chaque année, les étudiants en fin d’études, dans un cadre de formation réaffirmée – je pense aux remarques formulées par ces derniers – découvriront l’exercice ambulatoire dans tous les territoires, y compris dans les territoires en difficultés. Le gain en temps médical disponible pour les habitants sera immédiat. Qui soutiendra que des vocations ne naîtront pas au contact d’une réalité inégale selon les bassins d’emploi, difficile parfois sans doute, mais aussi une réalité d’abord humaine et attachante ?
Bien sûr, personne ne pense que tout est réglé, mais un sillon supplémentaire a été creusé dans la lutte contre les déserts médicaux. Il témoigne de la valeur du travail parlementaire, de l’intérêt du bicamérisme, de la capacité d’initiatives du Sénat. Parce qu’il s’est fondé sur le seul intérêt général, il honore notre Haute Assemblée.
Madame la ministre, mes chers collègues, le second point de mon propos sera d’une autre nature. Lors de la discussion, nous avions exprimé de fortes oppositions sur les articles 8, 9 et 10. Le renvoi massif à des ordonnances utilisé dans la plupart des textes examinés depuis deux ans contourne le débat démocratique et réduit à l’extrême l’apport possible des parlementaires.
La notion de proximité inséparable de celle de qualité est fondamentale pour les services publics. La notion de gradation des soins est partagée. Cependant, malgré les précisions apportées à l’article 8 sur la nature des missions socles, trop d’incertitudes génératrices de craintes pour les acteurs locaux demeurent sur ce que pourrait être la future carte des hôpitaux de proximité.
L’article 9 avait été voté conforme au Sénat. Le régime d’autorisations des activités de soins et des équipements lourds sera donc modifié par ordonnances. Les autorisations sont des actes essentiels dans le dessin de la carte sanitaire, « le trésor des hôpitaux » me disait un directeur d’établissement.
La commission mixte paritaire a rétabli la presque totalité de l’article 10 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, réactivant ainsi les craintes déjà formulées sur l’avenir des commissions médicales d’établissement, sur leur lien avec les commissions de groupement, sur la future gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques.
Ainsi, le Gouvernement se donne les moyens de dessiner à sa seule main une nouvelle carte sanitaire de notre pays, sans possibilité pour le Parlement d’en approfondir les orientations et les conséquences pour les territoires, les citoyens et les professionnels.
J’évoquerai rapidement la problématique financière. Si elle n’est pas prise en compte, la réforme ne pourra porter ses fruits. Vous devez garder, madame la ministre, une extrême vigilance sur la situation des hôpitaux, dont le mouvement des services d’urgences exprime, encore aujourd’hui, la grave instabilité. Ce n’est pas sans danger pour les patients et pour les professionnels.
Pour conclure, les points d’opposition que j’ai soulignés, un certain nombre de regrets – je pense au texte sur les Padhue, certainement incomplet –, mais aussi des éléments de convergence et un total engagement du groupe socialiste et républicain sur l’article 2 de compromis ouvrant une nouvelle piste de lutte contre les déserts médicaux nous amèneront à nous abstenir sur l’ensemble du texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c’est avec plaisir que je m’exprime au nom du groupe du RDSE pour la dernière étape du processus législatif de ce texte, dont nous saluons l’esprit et l’équilibre.
Nous en saluons l’esprit d’abord, car il propose des outils aux mains des professionnels. Cette souplesse attendue est de bon augure pour répondre aux enjeux de la santé du XXIe siècle et à la nécessaire transformation de notre système de santé.
Nous en saluons également l’équilibre grâce à un compromis entre sénateurs et députés, mais aussi grâce à un débat, parfois animé, mais toujours constructif, entre des courants différents qui, d’ailleurs, s’affranchissent des lignes partisanes.
Je parle, bien sûr, des désaccords qui persistent entre les tenants et les opposants de la coercition. Au sein même de notre groupe, des divergences se sont exprimées. À titre personnel, je me réjouis de l’absence de mesures coercitives dans ce texte final, grâce à l’engagement continu de la ministre et de notre rapporteur.
Cette prise de position ne nous fait toutefois pas oublier l’urgence qui existe sur nos territoires et dont le Sénat s’est légitimement fait l’écho. Si les débats ont été vifs, c’est que l’inquiétude est grandissante sur cette question si centrale de l’accès aux soins.
L’avenir de notre système de santé passera par des mesures fortes, qui inscrivent dans le marbre l’attachement de la France à une médecine de qualité partout et pour tous.
Je crois en cette loi, car elle redit la confiance de l’État envers les professionnels de santé, dont les nouvelles aspirations sont enfin prises en compte.
La coopération, d’abord, prend toute sa place dans la nouvelle organisation de notre système de santé. Nous le voyons dans nos départements, les territoires qui se portent le mieux sont ceux dont les professionnels et les élus se saisissent des outils de coordination, créant ainsi une dynamique attractive pour les jeunes qui aspirent à exercer en équipe. À cet effet, la signature récente d’un accord entre la Caisse nationale de l’assurance maladie, la CNAM, et les syndicats sur le déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, est à saluer.
Les études médicales telles qu’elles sont réformées semblent, par ailleurs, mieux correspondre aux aspirations de nos jeunes. Il s’agit d’un véritable changement de philosophie, qui donne plus de place aux valeurs humanistes et s’ouvre davantage sur les territoires.
J’en viens à l’article 2, qui a concentré l’essentiel des débats de la commission mixte paritaire.
J’ai déjà exprimé mon désaccord sur l’introduction d’une année de professionnalisation en internat de médecine, considérant qu’elle porterait atteinte à la formation. Un accord satisfaisant a été trouvé en CMP. Sans révolutionner ni mettre en péril les exigences de l’enseignement universitaire, il inscrit dans la loi un stage de six mois, en autonomie supervisée et en médecine ambulatoire, pour les étudiants de fin de troisième cycle, ce qui les incite à se tourner davantage vers les zones en tension. Il s’agit d’un signal fort envoyé aux élus et à nos concitoyens. À charge, maintenant, pour le pouvoir réglementaire de définir l’« autonomie supervisée ».
J’aimerais toutefois insister sur le fait que la question posée ici est non pas tant celle de la durée du stage ou du degré d’autonomie du stagiaire que celle de l’existence même de stages variés et formateurs en nombre suffisant.
D’une part, les conditions requises pour l’obtention du statut de maître de stage sont si contraignantes qu’elles découragent bon nombre de médecins. Sur ce point, l’article 2 ter offre une première réponse, grâce à l’engagement de notre collègue Élisabeth Doineau, en assouplissant les conditions de délivrance des agréments.
D’autre part, l’environnement des stages en zones sous-dotées doit également être interrogé, notamment en termes de logement et de mobilité, sans quoi ils restent inaccessibles aux étudiants.
En outre, il n’est pas inutile de rappeler que les hôpitaux sont fortement dépendants des internes dans leur fonctionnement. Même si l’on considère que les formations sont encore trop « CHU-centrées », ces stages demeurent indispensables. Les études ne peuvent à elles seules être une variable d’ajustement pour compenser la carence des médecins sur les territoires.
S’agissant du numérique, nous ne pouvons que saluer les avancées de cette loi, notamment les apports du Sénat conservés dans le texte final. Je citerais ainsi la généralisation de l’espace numérique de santé et du dossier médical partagé, qui permettront de centraliser les informations et les données, tout en garantissant un haut niveau de confidentialité et de sécurité. S’ils doivent bien sûr être accompagnés de garde-fous compte tenu de la sensibilité des données concernées, les apports du numérique en santé sont un enjeu majeur de notre siècle, et nous nous réjouissons qu’ils soient envisagés ainsi par le Gouvernement.
Sur le même sujet, nous notons le maintien dans le texte final de notre proposition visant à adosser un plateau de télésanté à chaque hôpital de proximité. Je remercie ainsi la ministre, que nous avons réussi à convaincre du bien-fondé de cette mesure, notamment pour les patients à qui nous offrons un cadre professionnel et sécurisé pour la pratique de la télémédecine.
Puisqu’il est question des hôpitaux de proximité, j’en profite pour revenir à un sujet qui a fait débat : la composition des commissions médicales d’établissement des GHT. L’Assemblée nationale a préféré renforcer la gouvernance des GHT via la création de commissions médicales de groupement et la mutualisation de la gestion des ressources humaines médicales. Sur ce point, il convient d’être pragmatique : les GHT ont vocation à assurer une continuité et une cohérence des soins hospitaliers à l’échelle d’un bassin de vie.
Toutefois, l’existence d’une stratégie de groupe et d’une mutualisation plus aboutie des ressources humaines doit se faire au profit des plus petites structures, qui peinent, seules, à recruter et à fidéliser les praticiens. Il faudra veiller à ce que cette nouvelle organisation améliore la présence médicale sur tout le périmètre des GHT.
Un bémol tout de même, je tiens à évoquer le cas des praticiens à diplôme hors Union européenne. Le Gouvernement ne souhaitant pas évoluer sur ce point, nous avons dû revenir en commission mixte paritaire sur les ouvertures accordées par le Sénat. Compte tenu des pénuries de médecins que connaissent certains territoires, des situations difficiles que vivent certains Padhue, mais surtout des nombreux garde-fous qui existent pour le contrôle de leurs compétences, cette loi aurait pu prévoir de plus grandes avancées, tout en conciliant qualité et sécurité des soins.
Cela étant, satisfait par le maintien de ses cinq amendements et par la philosophie générale du texte, le groupe du RDSE dans son immense majorité votera ce projet de loi. À charge maintenant pour le Gouvernement d’offrir des conditions d’application suffisantes à cette loi puisque la question du financement demeure en suspens. Nous serons ainsi attentifs et nous ferons des propositions à l’occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Au-delà des moyens financiers, j’y tiens particulièrement, il faudra renforcer l’accompagnement de nombreux territoires que je qualifierais d’atones et pour qui la prise en main des outils législatifs est loin d’être une évidence. Pour ne pas creuser l’écart entre ces territoires et les métropoles, plus dynamiques, élus et professionnels comptent sur le soutien d’agences régionales de santé souples, aidantes et à l’écoute, afin que cette loi irrigue l’ensemble du territoire.
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi que sur des travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.
M. Jean-François Longeot applaudit.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le 20 juin dernier, j’ai eu l’honneur de présider, pour la première fois, une commission mixte paritaire, celle qui s’est tenue sur ce projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé. C’est une première expérience que je qualifierai d’heureuse puisqu’elle s’est soldée par un accord. J’en ai été ravie !
Cette issue n’était pas nécessairement la plus évidente quelques jours plus tôt. L’un des principaux points de blocage portait sur l’article 2, plus précisément sur l’obligation, introduite par le Sénat, pour les futurs médecins généralistes de faire leur dernière année de troisième cycle « en autonomie » dans une zone sous-dotée. La commission mixte paritaire a convenu de ramener la durée à un semestre en « autonomie supervisée ».
Les députés et les sénateurs ont, sur ce point, fait preuve d’un sens des responsabilités qui honore le Parlement. Alors oui, certains regretteront que leurs amendements n’intègrent pas le texte final. J’en connais quelques-uns parmi vous. Mais des compromis ont dû être concédés. J’ai moi-même renoncé à certains de mes amendements pour que, en définitive, le texte soit soutenu par le plus grand nombre, ce qui facilitera son appropriation sur les territoires.
Notre responsabilité pour demain est la suivante : que les professionnels s’emparent de l’ensemble des outils mis à disposition par ce projet de loi et de ceux qui existent déjà pour apporter des réponses concrètes à nos concitoyens. Il est question non pas de reproduire la même organisation des soins de la Bretagne à la région Occitanie, mais de donner à l’ensemble des acteurs des territoires les moyens organisationnels et techniques appropriés.
Les Français nous attendent sur le terrain pour construire avec les usagers, les professionnels de santé et les élus locaux un projet structuré et adapté. Nous voulons faire du sur-mesure en somme, pour gommer progressivement les inégalités territoriales dans l’accès aux soins.
C’est pourquoi je me félicite de ce que perdure dans le texte final l’instauration d’une concertation au moins une fois par an entre le directeur général de l’ARS et les élus locaux sur l’organisation territoriale des soins. Dans le même esprit, les élus pourront demander à inscrire toute question à l’ordre du jour. Ils pourront, enfin, solliciter l’organisation d’une réunion spécifique lorsque les circonstances le justifieront.
Que retenir, in fine, du texte issu de la commission mixte paritaire ?
Concernant les études en santé, nous avons entériné la suppression du numerus clausus, péage injustement trop sélectif. Désormais, le nombre d’étudiants autorisés à passer en deuxième année sera décidé au niveau de chaque université, en liaison avec les agences régionales de santé suivant les besoins des territoires.
Ensuite, nous avons convenu que la diversification et la multiplication des lieux de stage sont une priorité, si ce n’est « la » priorité. Les stages sont un levier majeur pour faire découvrir aux futurs professionnels les réalités des territoires fragiles ainsi que la richesse des modes d’exercice, et mieux orienter ainsi les vocations. Mais il n’est pas possible de développer les stages sans, dans le même temps, développer l’émergence des maîtres de stage. L’année dernière, leur nombre a augmenté de 14 %, soit 10 736 praticiens référencés. C’est important, mais il nous faut aller plus loin.
En termes d’organisation, l’accent est mis sur le développement des projets territoriaux de santé et des communautés professionnelles territoriales de santé. Je souscris à ces orientations, qui doivent prendre désormais leur pleine mesure. Mises à la disposition des professionnels de santé et constituées à leur initiative, ces organisations ont tous les atouts pour s’adapter au contexte local, pour structurer les liens ville-hôpital et pour fédérer les coopérations.
En contrepartie d’un financement maximal de 380 000 euros, l’objectif est de faciliter l’accès à un médecin traitant et d’améliorer la prise en charge des soins non programmés en ville.
Rappelons que 8, 6 % des Français n’ont pas de médecins traitants, ce qui les exclut du parcours de soins prévu par la loi et les prive d’un suivi régulier et adapté, ainsi que d’un meilleur remboursement des frais engagés.
En complément du projet territorial, j’avais proposé que les médecins puissent être désignés conjointement médecins traitants dès lors qu’ils participent à une même communauté professionnelle territoriale de santé. La commission mixte paritaire a jugé cette mesure prématurée. J’entends l’argument. Cette proposition devra néanmoins être réévaluée lorsque les CPTS seront plus matures et auront maillé l’ensemble du territoire. Ces dernières décennies, nos dirigeants ont fortement manqué d’anticipation sur les besoins en santé des Français. Il n’est pas juste que nos concitoyens en payent les conséquences. Des points d’ajustements sont à mon sens nécessaires.
J’ajouterai un point de vigilance sur les CPTS : là où les professionnels sont si peu nombreux qu’ils sont trop accaparés par la patientèle, dégager un temps suffisant à consacrer à la réflexion d’une nécessaire organisation territoriale relève de l’exploit.
Il faut en tenir compte et répondre à cette réalité.
Si les assistants médicaux doivent d’abord permettre de libérer du temps médical, il est probable que ce temps disponible soit en définitive utilisé uniquement pour participer au travail de coordination.
Dans cet esprit de réorganisation territoriale de l’offre de soins, le projet de loi crée les hôpitaux de proximité. Ils assureront le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers : médecine, gériatrie, réadaptation, entre autres. Ils n’auront cependant pas d’activité d’obstétrique ou de chirurgie, sauf dérogation.
Mais la presse se fait régulièrement l’écho d’accouchements inopinés hors établissement à la suite de la fermeture d’une maternité. Madame la ministre, vous devez apporter une réponse forte à cette angoisse des jeunes et futurs parents avec le « pack maternité », qui devrait être intégré au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Pourriez-vous envisager d’y travailler en amont avec quelques parlementaires et, éventuellement, avec le groupe-contact national que vous avez mis en place ? Les élus ont en effet de fortes attentes à cet égard.
Enfin, je tiens à attirer votre attention sur deux points qui ont été rappelés par mes collègues.
D’une part, malgré votre volonté d’apurer la situation des praticiens à diplôme hors Union européenne, celle-ci ne sera pas réglée pour un certain nombre d’entre eux, ce qui créera de facto une injustice ou du moins un sentiment d’injustice qui ne peut être oublié.
D’autre part, je note la désaffection significative des étudiants pour les métiers d’aide-soignant, d’infirmier, et d’autres professions du soin et de l’accompagnement des personnes âgées et handicapées. Est-ce une question de représentation ou de rémunération ? Les écoles ont actuellement beaucoup de mal à atteindre leurs objectifs, comme j’ai pu le constater en Côte-d’Or la semaine dernière. Quelques ajustements du dispositif Parcoursup seraient sans doute nécessaires.
Pour conclure, je suis convaincue de la nécessité du dialogue et de l’accompagnement. Il convient de communiquer au plus près du terrain pour fédérer tous les acteurs et favoriser le partage des responsabilités afin d’imprimer une véritable dynamique.
Le chantier de la réorganisation de notre système de santé passera davantage par le terrain que par la loi. Votons donc définitivement ce projet de loi et mobilisons-nous sur le terrain !
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – M. Michel Amiel applaudit également.

M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, j’ai le plaisir de saluer la présence dans la tribune d’honneur d’une délégation de députés du Parlement irakien, conduite par Mme Ala Talabani, présidente du groupe d’amitié Irak-France.
Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mme la ministre des solidarités et de la santé, se lèvent.

La délégation est accueillie par le groupe d’amitié France-Irak, présidée par notre collègue Bernard Cazeau, pour une visite consacrée au rôle de la France dans la reconstruction de l’Irak.
La délégation participera à un déjeuner de travail avec le groupe d’amitié, ainsi qu’à un petit-déjeuner économique avec l’Agence française de développement, la direction générale du Trésor et plusieurs entreprises françaises qui souhaitent développer leur présence en Irak.
Elle sera également auditionnée par le groupe de liaison, de réflexion, de vigilance et de solidarité avec les chrétiens, les minorités au Moyen-Orient et les Kurdes, présidé par notre collègue Bruno Retailleau.
Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une intensification des relations interparlementaires, avec la perspective de la prochaine visite à l’automne du président du Parlement irakien, Mohammed al-Halboussi.
La France s’est tenue aux côtés de l’Irak au sein de la coalition internationale contre Daech. Elle entend également le soutenir dans le processus de reconstruction politique et économique pour lequel le Parlement, clé de voûte des institutions irakiennes, est appelé à jouer un rôle central.
Le Sénat sera attentif à toutes les sollicitations formulées par nos partenaires irakiens contribuant au renforcement des parlementarismes, garantie d’une participation inclusive de l’ensemble des citoyens à la vie politique.
Mes chers collègues, permettez-moi, en votre nom à tous, de souhaiter à nos homologues du Parlement irakien la bienvenue au Sénat français ainsi qu’un fructueux séjour. (

Nous reprenons le cours de la discussion générale.
La parole est à M. Daniel Chasseing.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui les conclusions de la commission mixte paritaire, réunie le jeudi 20 juin dernier, sur les dispositions du projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé.
L’accord qui en résulte témoigne de la qualité du travail des deux assemblées et de la bonne volonté de chacun d’enrichir le texte sans le dégrader.
Il témoigne également de l’urgence d’agir pour garantir l’accès aux soins à tous dans tous les territoires.
L’amendement transpartisan, à l’article 2, que le Sénat a adopté pour professionnaliser la dernière année des études de médecine, avec un stage ambulatoire de six mois, a constitué le cœur des débats.
Notre groupe se félicite du maintien de cette disposition. Plus de 45 % des médecins sont âgés de plus de 55 ans. Les départs à la retraite des généralistes vont s’accentuer dans les prochaines années. Si le problème de la désertification médicale est évoqué depuis près de vingt ans, le plus important est encore à venir et les zones rurales ne seront pas les seules concernées.
Par cet amendement du Sénat, la mobilisation de jeunes étudiants et professionnels dans les zones sous-dotées représente un levier d’action important pour résorber ou améliorer fortement – nous l’espérons – en quelques années le problème de l’accès aux soins dans les territoires, grâce au renforcement du dispositif des maîtres de stage. Je veux remercier à cet égard M. le président de la commission des affaires sociales, Alain Milon, de son soutien.
L’accès aux soins ne saurait se réduire à la disponibilité des médecins. Nous savons que les ruptures de stock de médicaments se sont amplifiées au cours des dernières années : un Français sur quatre a déjà été confronté à l’indisponibilité d’un médicament ou d’un vaccin. Sur l’initiative de Jean-Pierre Decool, le Sénat a mené une mission d’information à ce sujet l’été dernier.
Madame la ministre, vous avez présenté la semaine dernière une feuille de route visant à mettre en œuvre une partie des 30 propositions du rapport du Sénat. La loi Santé prévoit d’ores et déjà d’autoriser le pharmacien à remplacer un médicament prescrit indisponible par un autre de la même famille lorsqu’il s’agit d’un médicament d’intérêt thérapeutique.
Encore faut-il qu’un tel médicament soit disponible. Vendredi dernier, dans mon canton en Corrèze, j’ai constaté que de nombreuses pharmacies ne disposaient plus d’aucun corticoïde, médicament pourtant indispensable en premier recours pour de nombreuses maladies chez l’enfant et l’adulte. Il est toujours possible, bien sûr, d’adresser les patients aux urgences, mais celles-ci sont suffisamment encombrées.
Toutes les actions d’amélioration sont donc absolument nécessaires, vont dans le bon sens et témoignent de notre volonté commune, madame la ministre, de répondre au principal défi sanitaire de la France, qui est de garantir l’accès aux soins dans tous les territoires.
Si l’accès aux soins est prioritaire, la prévention a également un rôle important, dans toutes ses dimensions : alimentation, environnement, promotion des pratiques sportives, éducation, détection, etc. La prise en charge globale de la santé nécessite d’adopter une approche territoriale et transversale, au travers des CPTS, les projets territoriaux de santé, les réseaux d’hôpitaux et les maisons de santé, qui devront fonctionner ensemble, en concertation avec les élus locaux et les ARS, pour trouver les bonnes réponses à chaque situation territoriale, à chaque bassin de vie, notamment en renforçant les services d’urgences et les Ehpad, avec une augmentation sensible des infirmiers et des aides-soignants. Cela est primordial pour la prise en charge des patients, en parallèle du nécessaire renforcement des effectifs de ces formations.
La stratégie de transformation de notre système de santé, engagée par le Gouvernement au travers du plan Ma santé 2022 se déploiera sur plusieurs années. Elle poursuit l’effort de réorganisation de la médecine de ville et de la médecine hospitalière, modernise le déroulement des études médicales et accompagne l’évolution des pratiques au travers de la numérisation de la santé, notamment avec le projet médical partagé, ou PMP, la continuité de l’aide pour les maisons de santé, le soutien à l’installation des médecins. Le financement de la sécurité sociale, qui prend en compte ces propositions, est bien sûr capital.
Avec l’adoption de ces mesures importantes, à commencer par la levée progressive du numerus clausus, nous espérons une implication de l’hôpital et des facultés de médecine dans l’accès à la santé pour tous, en liaison avec les élus locaux et les CPTS, l’objectif étant que chaque maison de santé dispose d’un médecin. Nous saluons également la régularisation prochaine de la situation d’une partie des praticiens diplômés hors Union européenne, les Padhue, même si nous regrettons l’exclusion de ceux qui travaillent en Ehpad privés.
Globalement, cette vaste réforme de la santé est très attendue. Notre groupe la soutient pleinement.
Mme Véronique Guillotin applaudit.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons ce texte intitulé « organisation et transformation du système de santé », le troisième en dix ans après la loi HPST de 2009 et la loi Touraine de 2016.
Traduction de la stratégie Ma Santé 2022, annoncée par le Président de la République le 18 septembre dernier, ce texte a pour ambition de transformer en profondeur notre système de santé pour assurer à chaque Français la qualité et la sécurité des soins.
Réformer les études de médecine, notamment en supprimant le numerus clausus, réarticuler médecine de ville et hôpital, développer l’offre numérique, améliorer l’offre hospitalière de proximité, promouvoir les communautés professionnelles territoriales de santé : tels ont été les points centraux de nos discussions.
Si les deux assemblées n’avaient pas la même vision de ces enjeux, je me félicite de ce que les échanges en commission mixte paritaire aient abouti à un compromis, un texte équilibré qui reprend en particulier les avancées du Sénat, représentant des territoires, sur la lutte contre les déserts médicaux.
Sur la réforme des études de santé, si je réitère ma crainte sur la suppression du numerus clausus, qui n’aura d’effets – l’arrivée sur nos territoires des professionnels formés – que dans dix à quinze ans, j’applaudis l’ambition d’un véritable changement de culture qui permettra à des étudiants non issus de la première année commune aux études de santé, la Paces, d’accéder aux études médicales.
Restent, comme je le rappelais lors des explications de vote sur l’ensemble du texte en première lecture, des inconnues : la capacité des universités et des hôpitaux d’accueillir les étudiants, l’orientation des étudiants via Parcoursup, et les critères de définition des besoins en professions médicales des territoires, discutés entre universités et ARS. Sur ces points, notre groupe restera attentif. Il le sera aussi sur les modalités modifiant l’accès au troisième cycle, et donc au choix de spécialité, avec le vote de la suppression de l’examen classant national actuel pour le remplacer par un dispositif qui, s’il visera à s’assurer du niveau de connaissances des étudiants, prendra également en compte les compétences cliniques acquises, les qualités humaines développées et l’ensemble du parcours des candidats.
Mais si une réforme des études médicales a d’abord pour ambition de mieux former les étudiants, elle vise aussi à offrir aux territoires un meilleur accès aux soins. Comme vous l’avez dit vous-même, madame la ministre, cela « ne réglera pas le problème de la démographie médicale ».
Aussi, je salue l’accord trouvé concernant la professionnalisation de la dernière année de l’internat de médecine. Proposé par les sénateurs soucieux d’assurer une prise en charge dans l’ensemble des territoires qu’ils défendent et représentent, cela prendra la forme d’un stage devant être effectué en ambulatoire, en priorité dans les zones sous-dotées, pendant six mois – contre un an dans la version initiale du dispositif sénatorial –, le tout encadré par un maître de stage.
À cet effet, les conditions pour devenir maître de stage ont été assouplies.
Je salue tout autant la volonté de développer les CPTS, outil d’organisation donné aux professionnels du terrain, qui sont les mieux à même d’évaluer les besoins et d’élaborer les solutions de circuits de prise en charge de la population.
Mes chers collègues, la notion et la prise en compte de la responsabilité populationnelle des professionnels de santé doivent être encouragées, car le médecin, l’infirmier mais aussi les aides-soignants et les kinésithérapeutes sont bel et bien des acteurs de santé publique.
Je regrette toutefois que les avancées prévues par le Sénat n’aient pas été suivies en ce sens, notamment l’ambition de réaffirmer la notion d’infirmier référent, outil majeur dans le cadre d’une coordination des soins promue par les CPTS.
Toujours dans l’objectif de simplifier la prise en charge coordonnée des personnes, le numérique – et les outils qu’il offre, notamment pour le suivi des patients – constitue un virage essentiel qu’il convient d’encourager, mais surtout de faciliter. Aussi, l’automaticité de l’ouverture du dossier médical partagé, ou d’un espace numérique de santé, l’ENS, permettra de déployer cet outil pour tous. Les acteurs de la santé pourront ainsi mieux prendre en charge, et de manière plus coordonnée, leurs patients.
À ces fins, nos assemblées ont pu s’accorder sur la nécessité d’une offre de proximité de qualité.
Les hôpitaux de proximité sont un des éléments forts du maillage territorial et de la vision d’un exercice coordonné de la médecine. La gradation des soins doit être vue non pas comme une médecine à deux vitesses, mais bien pour ce qu’elle est : une réorganisation d’un système à bout de souffle, comme l’ont montré les difficultés des services d’urgences qui s’amplifient, et une meilleure coordination ville-hôpital.
Enfin, notre groupe se félicite des enrichissements du texte, qui bénéficieront aux territoires d’outre-mer, particulièrement en ce qui concerne l’autorisation d’exercer des praticiens à diplôme hors Union européenne.
Le groupe s’est par ailleurs montré vigilant sur la question de Mayotte, où l’urgence sanitaire est on ne peut plus alarmante. Il le restera quant au financement de la future agence régionale de santé.
Mes chers collègues, si cette nouvelle loi de structuration de l’offre de santé dans notre pays a pour objectif l’amélioration des conditions d’exercice de la médecine et d’accès aux soins, il faudra aussi penser dès la rentrée, avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale, aux mécanismes de financement d’un tel projet qui devra s’inscrire dans la durée.
Madame la ministre, vous avez avec beaucoup de sagesse montré la voie. Puisque M. Milon a cité Pascal et Mme Cohen Descartes, j’évoquerai quant à moi Confucius : quand le sage montre la lune du doigt, l’insensé regarde le doigt.
Sourires.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en premier lieu, je tiens à excuser notre collègue Corinne Imbert, absente pour cause de décès dans sa commune, et qui m’a chargé de lire son intervention. Je vous ferai part, en second lieu, de mes réflexions personnelles.
La question des difficultés de l’accès aux soins est devenue omniprésente dans la plupart des débats relatifs à la santé. En effet, la désertification médicale touche aujourd’hui l’ensemble de nos territoires.
Si les centres urbains ont longtemps été épargnés par ce phénomène, on note aujourd’hui que même les grandes villes peinent à proposer une offre de soins satisfaisante pour leurs habitants.

La médecine générale est bien entendu en proie à ces difficultés, mais le manque de spécialistes se fait également ressentir.
Pour prendre en charge les patients, il faut, madame la ministre, croire davantage dans les femmes et les hommes professionnels de santé que dans les organisations, certes nécessaires mais chronophages, et surtout prévues à des échelons qui n’incarnent en rien la proximité.
Afin d’apporter une réponse concrète à ces difficultés, Corinne Imbert avait proposé à l’occasion de nos débats de transformer la dernière année du troisième cycle de médecine en une année de pratique ambulatoire en autonomie dans les zones sous-dotées.
Loin de constituer une contrainte pour les internes en médecine, cette proposition avait pour objectif d’apporter une solution rapide et pragmatique aux difficultés rencontrées dans nos territoires. Ce sont ainsi 3 500 étudiants, pour la seule médecine générale, qui auraient pu venir travailler en renfort aux côtés des médecins installés, maîtres de stages ou non.
Ce format présentait plusieurs avantages.
Premièrement, c’était l’occasion de faire découvrir des coins de France où qualité de vie et environnement sont préservés, ce qui aurait permis de déconstruire certains a priori dont font l’objet nos territoires ruraux.
Deuxièmement, la durée d’un an aurait permis d’inscrire cet apprentissage professionnalisant en zones sous-dotées dans un temps long, optimisant ainsi l’éventualité d’une installation des internes dans ces territoires.
Troisièmement, enfin, la notion de pratique ambulatoire en autonomie est essentielle, car, contrairement à ce qui est d’usage dans un stage classique, le médecin n’aurait pas besoin d’être en permanence avec l’étudiant. L’effet direct serait d’augmenter le nombre de patients pris en charge.
Cette proposition a d’ailleurs été reprise par d’autres groupes politiques du Sénat et votée par la quasi-totalité des sénateurs, ce qui illustre le caractère transpartisan et consensuel d’une telle mesure. Corinne Imbert remercie l’ensemble des sénateurs, qui, dans un esprit de défense de l’intérêt général et de l’intérêt de nos territoires, ont su mettre de côté leurs divergences idéologiques pour défendre collectivement une mesure de bon sens.
Non, le Sénat n’est pas tombé sur la tête ce jour-là ! Une nouvelle fois, il a fait honneur à sa réputation, à son esprit constructif et à la qualité de ses propositions.

À force de discussions et d’échanges sur ce sujet, le Sénat et l’Assemblée nationale sont parvenus à un compromis, aux termes duquel chaque étudiant de dernière année de troisième cycle de médecine devra réaliser un stage de six mois minimum dans un territoire sous-doté, en autonomie supervisée.
Bien que cette mesure ne soit pas entièrement satisfaisante, elle est un début de réponse aux difficultés rencontrées par nos concitoyens. Dans les mois et années à venir, nous devrons être en mesure de proposer d’autres solutions innovantes afin de répondre à l’urgence rencontrée en matière d’accessibilité aux soins. Il n’y a pas une sénatrice ou un sénateur dans cet hémicycle qui n’ait été sollicité par un élu ou un administré sur cette thématique.
La colère gronde, madame la ministre.
L ’ orateur se tourne un instant vers les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Le Sénat s’est également employé à renforcer la place des élus locaux dans le pilotage territorial de la santé. En effet, l’organisation territoriale de notre système de santé ne peut être pensée et exécutée par des structures souvent déconnectées des réalités du terrain. C’est pourquoi le Sénat a voté le renforcement des prérogatives du conseil de surveillance des établissements publics de santé, où siègent les représentants des collectivités territoriales.
De la même manière, cinq maires seront désignés dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de santé et de ses orientations, notamment sur l’accès aux soins et l’évolution de l’offre de santé.
La Haute Assemblée est historiquement le lieu de représentation des territoires. Les sénateurs connaissent le caractère pluriel de notre pays et les spécificités de chaque département. Afin de tenir compte de cette diversité, le Sénat a voté des amendements visant à apporter de la souplesse aux dispositifs de structuration du système de santé. Les besoins spécifiques de chaque territoire seront donc pris en compte dans le cadre des projets territoriaux de santé.
Malgré une commission mixte paritaire conclusive, que nous saluons, ce texte nous laisse un sentiment d’inachevé. En effet, de nombreuses mesures seront prises par ordonnance malgré la mise en garde des sénateurs. De la même manière, on peut regretter que ce texte ne réponde pas à la nécessité d’une restructuration de la gouvernance et du financement de notre système de santé.
Lors des futurs textes de loi consacrés à la santé, vous pourrez compter, madame la ministre, sur la force de proposition que constitue le Sénat pour continuer à répondre à la problématique de l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire français. Dès le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous aurons à cœur de discuter de certains dispositifs qui n’ont pu être adoptés lors de l’examen de ce texte en raison de leur impact financier.
À titre d’exemple, l’exonération de cotisations sociales pour les jeunes médecins, dès lors qu’ils s’installent dans les trois ans suivant l’obtention de leur diplôme dans les zones déficitaires, pourra constituer une réponse au manque d’attractivité que connaît actuellement la médecine libérale. De la même manière, le financement des hôpitaux de proximité demeure encore incertain et il faudra apporter des précisions dans ce domaine. Ce débat fondamental aura également lieu, nous n’en doutons pas, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Corinne Imbert vous remercie de l’attention que vous avez portée à son intervention. Je m’associe à ses remerciements, notamment à l’endroit de notre rapporteur et président de la commission des affaires sociales.
Ces remarques étant faites, la majorité du groupe Les Républicains votera, j’en suis certain, ce texte en espérant voir ses résultats se réaliser au plus vite sur le terrain.
Madame la ministre, il me reste quelques minutes pour intervenir à titre personnel et vous faire part de certaines remontées de terrain. Les sénatrices et les sénateurs sont en effet en contact permanent avec vos services, notamment les ARS, et un certain nombre de personnes viennent nous voir dans nos permanences pour nous informer des problèmes qui se posent.
Des mesures incitatives pour l’installation des médecins peuvent ainsi devenir des mesures contraignantes. J’en veux pour exemple mon territoire, qui est désertifié : trois jeunes médecins qui se sont installés dans la commune de Vertus ont eu un « mal de chien », pour des raisons administratives, à obtenir leurs aides spécifiques à l’installation, et ce financement ne leur est parvenu qu’au terme de deux ans. C’est la direction de l’ARS qui a réglé le problème.
Je pense également aux malades qui connaissent des difficultés particulières, car le traitement de leur pathologie est très onéreux.
Je connais une jeune fille qui souffre d’un déficit en lipase acide lysosomale : son traitement, administré toutes les trois semaines, et qui coûte 500 000 euros par an, a été pris en charge par l’hôpital d’Épernay. Vous connaissez le problème : du fait des actes techniques médicaux, les ATM, de l’autorisation temporaire d’utilisation, l’ATU, le remboursement n’est pas pris en compte dans le cadre du groupe homogène de séjour, le GHS. Par conséquent, l’hôpital d’Épernay estime désormais que le traitement coûte trop cher : il faut donc qu’elle soit prise en charge à l’hôpital Necker.
Prenons garde à ce que ne s’exerce pas, dans des cas très particuliers de pathologies lourdes, une médecine à plusieurs vitesses. Je vous demande, madame la ministre, d’y être très attentive.
C’est la raison pour laquelle j’avais proposé que le conseil de surveillance des ARS soit présidé par un président de région, un élu ou son représentant. Ce conseil serait ainsi devenu un lieu de discussion et de contre-pouvoir où l’on aurait pu régler un certain nombre de problèmes que l’on connaît sur le territoire.
Par ailleurs, avec Catherine Deroche et plusieurs de nos collègues, nous menons des auditions communes très intéressantes. Nous recevons, entre autres, des biotech. Tous ces acteurs de l’innovation nous répètent le même discours : les délais sont trop longs entre la délivrance de l’ATU, l’AMM, l’autorisation de mise sur le marché, et la fixation des prix ; la teneur des discussions diffère selon qu’elles se passent au niveau de la Haute Autorité de santé ou du Comité économique des produits de santé, le CEPS, quant à la fixation des tarifs.
Pour ce qui concerne les médicaments innovants, des exemples montrent que notre dispositif n’est pas aussi performant que précédemment. Les biotech, qu’il s’agisse d’entreprises françaises ou de filiales de sociétés étrangères, ont du mal à mobiliser leurs investisseurs, parce que la France est réputée pour pratiquer de longs délais, alors même que sa réputation est extraordinaire dans le domaine de la recherche et de l’innovation.
Je pense au cas spécifique de la bêta-thalassémie, pour laquelle il y a désormais un one shot et une thérapie génique, ce qui évite des transfusions régulières. Or notre modèle de tarification – en particulier l’article 65 de la LFSS 2019 – ne correspond pas à ce type de pathologie.
Nous avons également été confrontés à un problème complexe avec des nouvelles technologies destinées à soigner le cancer de la prostate à bas risque, lesquelles concilient un médicament, donc soumis à l’AMM, un dispositif médical, ce qui suppose une autre voie de tarification, et un acte chirurgical, lequel doit être codifié par la sécurité sociale. Il faudra trouver, pour ces thérapies innovantes, un nouveau modèle de tarification.
Dans le domaine de la prévention, il convient d’aller plus loin, d’oser davantage.
Par exemple, pour ce qui concerne la lutte contre le tabagisme, le plan anti-tabac ne suffit pas. Mais il y a des fumeurs qui ne parviennent pas à arrêter de fumer ! Il faut donc réfléchir à un concept de diminution des risques, puisqu’on ne parviendra pas à les supprimer totalement. Dans cette perspective, le vapotage ou le tabac chauffé et non brûlé, qui réduisent considérablement les effets cancérologiques, sont des solutions de remplacement qui méritent d’être étudiées. Elles existent dans d’autres pays et peuvent aider des fumeurs acharnés, même si ce n’est bien sûr pas la panacée. J’y insiste, il faut trouver des solutions pour limiter les effets toxiques du tabac.
Vous le savez, madame la ministre, le vote de la loi Santé ne signifiera pas que le travail est terminé, car un certain nombre de dispositifs méritent d’être pris en compte. Vous pouvez compter sur les sénatrices et les sénateurs pour avancer sur ces dossiers !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Indépendants – République et Territoires.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous touchons ici à la dernière étape de l’examen d’un projet de loi qui focalisait tellement d’attentes de la part de nos territoires, marqués par la désertification médicale et par une crise de confiance sans précédent.
Il aurait fallu aller plus loin, et vous le savez, madame la ministre, pour répondre à l’anxiété des élus locaux que nous rencontrons chaque semaine.
Par peur de manquer de médecins, les collectivités, qui ne peuvent prendre des mesures de régulation efficaces, tentent d’attirer par tous les moyens des médecins généralistes, parfois – il faut bien le dire – aux dépens d’autres collectivités.
Cette concurrence malsaine entre territoires n’est pas à la hauteur du principe d’égal accès aux soins et laisse nombre d’élus locaux sans solution.
La récurrence des grèves dans les urgences, en Sarthe et sur l’ensemble du territoire, démontre combien la situation est tendue.
Comme l’a très bien exposé notre collègue Yves Daudigny, des avancées notables ont pu être obtenues grâce à l’apport du Sénat, notamment à l’article 2, obligeant les internes à effectuer, en dernière année de troisième cycle de médecine générale, un stage de six mois en ambulatoire prioritairement en zones sous-denses. Cette généralisation du Saspas, que nous avons proposée et qui a emporté notre non-opposition, pourrait avoir des effets concrets à court et moyen terme.
À la différence de ladite « suppression » du numerus clausus, mesure de bon sens mais qui n’aura que peu d’effets directs et instantanés – cela a été également dit –, ce stage constitue l’une des solutions pour lutter contre le phénomène de désertification médicale. Les territoires attendent beaucoup de cette mesure emblématique de souche sénatoriale. Nous serons donc très vigilants quant à sa mise en place rapide par le Gouvernement.
Autre point positif de cette loi, le développement de la télémédecine : il est évident que le télésoin peut apporter un service efficace et permettre de régler certaines situations délicates, notamment pour des publics incapables de se déplacer.
Toutefois, je tiens à le rappeler fermement, la télémédecine ne peut se substituer à la présence physique d’un médecin. Sans parler des problématiques d’accès au numérique, lequel demeure un sujet dans nos territoires ruraux, le risque est évidemment de créer une médecine à deux vitesses, l’une présentielle pour les territoires attractifs, l’autre virtuelle pour les territoires délaissés et déjà impactés par la disparition excessive de services publics comme privés.
À ce sujet, je ne me résous pas à l’abandon de l’article 13 bis A, qui introduisait un principe de médiation numérique en santé pour les usagers distants des nouvelles technologies, principe particulièrement pertinent en zone rurale et recommandé par le Défenseur des droits.
Il n’est pas nécessaire, madame la ministre, de vous rappeler l’importance du maintien d’une offre de santé diversifiée au plus près des territoires. Je pense notamment à l’accès à l’interruption volontaire de grossesse, qui peut être remis en cause par le simple départ à la retraite d’un gynécologue, comme ce fut le cas l’été dernier en Sarthe à l’hôpital du Bailleul.
Alors que le sujet est extrêmement sensible et qu’une tribune de nos collègues députés vous appelle à inscrire dans notre Constitution ce droit à l’IVG afin de le protéger, il est étonnant de constater quelles sont les positions du Gouvernement et de la majorité à l’Assemblée nationale. Quand le Gouvernement exprime par votre voix, madame la ministre, un avis défavorable à l’extension des délais légaux d’accès à l’avortement, une mesure portée ici même avec pugnacité par notre collègue Laurence Rossignol, la majorité ne réintroduit pas le regretté article 27, qui tendait à demander à vos services un rapport sur l’accès effectif à l’IVG dans nos territoires.
J’avais proposé à l’automne dernier de mettre sur pied un groupe de travail au sein de la commission des affaires sociales du Sénat ; en vain. C’est donc avec une réelle déception que je vois ce rapport abandonné, car il aurait permis de mettre en lumière les difficultés de beaucoup de femmes qui ne peuvent plus, en France, avoir accès à leur droit. Vous pouvez compter sur le groupe socialiste et républicain pour porter cette question de justice à chaque occasion jusqu’à ce que votre discours, a priori volontariste, se concrétise enfin. Nous attendons plus de cohérence, madame la ministre !
Ainsi, loin de clore certaines questions, cette loi ouvre des débats dont nous serons amenés à reparler dans un avenir proche. Je pense notamment à la question des données et à celle du recueil du consentement des patients.
Nous avons défendu le principe du consentement comme fondement de la licéité du traitement des données personnelles en santé, et donc de l’ouverture de l’espace numérique de santé, en lieu et place de l’ouverture automatique initialement prévue et portée par le groupe majoritaire.
À l’heure où les croisements de données vont devenir exponentiels, il s’agit de replacer le patient au cœur du système et d’affirmer le principe de consentement libre et éclairé, qui n’en devient que plus fondamental alors que nous ne mesurons pas forcément les conséquences de l’utilisation des « applis » de santé et de bien-être. De manière identique, les modalités de création et de gestion du Health Data Hub, ou « plateforme des données de santé », ne sont pas suffisamment encadrées par le projet de loi.
Nous aurons assurément l’occasion d’en reparler lors des débats à venir sur le projet de loi relatif à la bioéthique.
Néanmoins, nous pouvons nous réjouir du maintien dans le texte final de plusieurs de nos amendements visant, par exemple, à étendre l’usage de l’ENS aux bénéficiaires de l’aide médicale d’État, à intégrer des données relatives à l’accompagnement social et médico-social dans l’ENS ou encore à renforcer la protection des données lors de l’application ou la conclusion de tout contrat.
Au regard de ce bilan mitigé, nous nous abstiendrons sur ce texte qui ne prend pas suffisamment à bras-le-corps le sujet de la désertification médicale et qui ne répond que partiellement aux problèmes rencontrés par les élus locaux.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
TITRE Ier
DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Chapitre Ier
Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie
I. – L’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 631 -1. – I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l’article L. 611-1, de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’État. Ces formations permettent l’orientation progressive de l’étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d’études et ses aptitudes ainsi que l’organisation d’enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l’acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.
« Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l’université sur avis conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d’objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l’État pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants.
« L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
« Ces modalités d’admission garantissent la diversité des parcours des étudiants.
« Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent également être admis en deuxième cycle.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d’accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;
« 2° Les conditions et modalités d’admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;
« 3° Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés au I ;
« 3° bis Les modalités de définition d’objectifs de diversification des voies d’accès à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;
« 4° Les modalités d’évaluation des étudiants et les conditions de délivrance des diplômes ;
« 5° Les modalités de fixation du nombre d’élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie et leur répartition par université ;
« 6° Les modalités de fixation des objectifs d’admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie des élèves des écoles du service de santé des armées et leur répartition par université ainsi que les conditions dans lesquelles ces nombres sont pris en compte par les universités et les agences régionales de santé pour la détermination des objectifs d’admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie ;
« 7° Les conditions et modalités d’accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour les titulaires d’un diplôme d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d’Andorre ;
« 8° Les conditions et modalités d’accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour les titulaires d’un diplôme des pays autres que ceux cités au 7° du présent II ;
« 9° Les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme sanctionnant des études de santé validé à l’étranger permettant d’exercer dans le pays de délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants. »
II. – L’article L. 631-2 du code de l’éducation est abrogé.
III. – L’article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est ainsi rédigé :
« Art. 39. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la rentrée universitaire 2020, autoriser l’organisation des formations relevant du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation selon des modalités permettant de renforcer les échanges entre les formations, la mise en place d’enseignements en commun et l’accès à la formation par la recherche.
« Les conditions de mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation des expérimentations en vue d’une éventuelle généralisation.
« Au cours de la sixième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. »
IV. – Le second alinéa de l’article L. 632-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « arrêtés du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé » sont remplacés par le mot : « décret » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
V. – Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le l du 2° de l’article L. 1431-2 est complété par les mots : « et se prononcent, dans les conditions prévues par le code de l’éducation, sur la détermination par les universités des objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle des études de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique » ;
2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle est consultée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation. »
VI. – Au 3° du V de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, les mots : « ou à une première année commune aux études de santé » sont supprimés.
VII. – Les I, II et III sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
Les étudiants ayant suivi soit une première année commune aux études de santé prévue à l’article L. 631-1 du code de l’éducation, soit une première année commune aux études de santé adaptée prévue au 1° bis de l’article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, soit une à trois années d’un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence prévues au 2° du même article 39, avant la publication de la présente loi, et qui auraient eu, en application des dispositions antérieures à la présente loi, la possibilité de présenter pour la première ou la seconde fois leur candidature à l’accès en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques conservent cette possibilité selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du premier cycle des études mentionnées à l’article L. 631-1 du code de l’éducation en 2021 et en 2023. Ce rapport porte notamment sur les informations apportées aux lycéens et aux étudiants concernant les modalités d’accès aux études de santé, le taux de succès des candidats selon la modalité d’accès et la diversité des profils d’étudiants admis dans les études médicales. Le rapport transmis en 2023 présente en outre une analyse de la réussite des étudiants à l’issue de leur premier cycle.
I. – L’article L. 632-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 632 -2. – I. – Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine :
« 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l’article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un État membre de l’Union européenne, un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d’Andorre. L’admission est alors subordonnée à l’obtention d’une note minimale à des épreuves nationales permettant d’établir que l’étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle ;
« 2° Les médecins en exercice.
« I bis. – Les étudiants de médecine générale réalisent au cours de la dernière année du troisième cycle de médecine au minimum un stage d’un semestre en pratique ambulatoire. Ce stage est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Il est effectué sous un régime d’autonomie supervisée.
« Cette pratique ambulatoire peut être étendue par décret à d’autres spécialités à exercice majoritairement ambulatoire.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° A Les modalités nationales d’organisation des épreuves de connaissances et de compétences mentionnées au 1° du I ;
« 1° Les conditions et modalités d’accès au troisième cycle des études de médecine pour les étudiants et professionnels mentionnés au même I ;
« 2° Les modalités d’organisation du troisième cycle des études de médecine et de réalisation de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stages des universités ;
« 3° Les modalités de répartition des postes ouverts aux étudiants accédant au troisième cycle des études de médecine par spécialité et par subdivision territoriale, compte tenu des capacités de formation et des besoins prévisionnels du système de santé en compétences médicales spécialisées ;
« 4° Les modalités d’affectation sur ces postes, par spécialité et centre hospitalier universitaire. L’affectation par subdivision territoriale et par spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées au 1° dudit I s’effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux épreuves mentionnées au même 1° ainsi que le parcours de formation, le projet professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap ;
« 5° Les modalités de changement d’orientation ;
« 5° bis Les modalités d’établissement de la liste des postes mentionnés au 3° permettant une adéquation optimale entre le nombre de ces postes et le nombre de postes effectivement pourvus ;
« 5° ter Les modalités de mise en œuvre de l’autonomie supervisée en pratique ambulatoire et les conditions de la supervision ;
« 6°
Supprimé
II. – L’article L. 632-3 du code de l’éducation est ainsi rétabli :
« Art. L. 632 -3. – Les postes ouverts aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées par subdivision territoriale et par spécialité sont inscrits sur une liste établie, en fonction des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles ces postes sont répartis entre ces élèves. »
II bis. – Le 1° de l’article L. 632-12 du code de l’éducation est abrogé.
III. – Le titre VIII du livre VI du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 681-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 612-1 à L. 612-7 » sont remplacées par les références : « L. 612-1 à L. 612-2, L. 612-3-1 à L. 612-7 », la référence : « L. 632-1 à » est remplacée par la référence : « L. 632-4 et » et la référence : « L. 631-1, » et la référence : « L. 632-12, » sont supprimées ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612-3, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-3 et L. 632-12. » ;
1° bis L’article L. 683-1 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 612-1 à L. 612-7 » sont remplacées par les références : « L. 612-1 à L. 612-2, L. 612-3-1 à L. 612-7 », la référence : « L. 632-1 à » est remplacée par la référence : « L. 632-4 et » et la référence : « L. 631-1, » et la référence : « L. 632-12, » sont supprimées ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612-3, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-3 et L. 632-12. » ;
1° ter L’article L. 684-1 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 612-1 à L. 612-7 » sont remplacées par les références : « L. 612-1 à L. 612-2, L. 612-3-1 à L. 612-7 », la référence : « L. 632-1 à » est remplacée par la référence : « L. 632-4 et » et la référence : « L. 631-1, » et la référence : « L. 632-12, » sont supprimées ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612-3, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-3 et L. 632-12. » ;
2° L’article L. 681-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des articles L. 631-1 et L. 633-3 à Wallis-et-Futuna, la référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’agence de santé de Wallis-et-Futuna. » ;
3° L’article L. 683-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des articles L. 631-1 et L. 633-3 en Polynésie française, la référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’autorité compétente en matière de santé. » ;
4° L’article L. 684-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des articles L. 631-1 et L. 633-3 en Nouvelle-Calédonie, la référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’autorité compétente en matière de santé. »
III bis. – Au premier alinéa du III de l’article L. 713-4 du code de l’éducation, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 4° du II ».
IV. – L’article 39 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités est abrogé.
V. – A. – Les dispositions des I et II sont applicables aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2020.
B. – Les modalités d’affectation en troisième cycle des étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine de la rentrée universitaire 2020 à la rentrée universitaire 2022 sont précisées par décret.
VI. – Les étudiants qui ne répondent pas aux conditions du I sans avoir épuisé, à l’issue de l’année universitaire 2021-2022, leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales prévues par les dispositions antérieures à la présente loi peuvent accéder au troisième cycle des études médicales dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
VII. – Sont abrogés :
1° L’article 20 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
2° Le III de l’article 125 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.
VII bis
VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement en 2024 un rapport d’évaluation de la réforme du deuxième cycle des études de médecine résultant du présent article. Ce rapport porte notamment sur l’apport des nouvelles modalités d’évaluation des connaissances et des compétences des étudiants, sur le processus d’orientation progressive des étudiants, sur la construction de leur projet professionnel et le choix de leur spécialité et de leur subdivision territoriale d’affectation.
L’article L. 632-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Elles permettent aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et selon différents modes d’exercice. Elles permettent la participation effective des étudiants à l’activité hospitalière. Elles favorisent la participation des patients dans les formations pratiques et théoriques. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours des deuxième et troisième cycles, elles offrent aux étudiants la possibilité de participer à des programmes d’échanges internationaux.
« Le déploiement tout au long des études de médecine d’une offre de stage dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définies en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, fait l’objet d’une évaluation tous les trois ans par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. Cette évaluation est transmise au Parlement. » ;
3° À la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 632-2 », sont insérés les mots : « du présent code ».
L’article L. 4131-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A Après les mots : « étudiants de », sont insérés les mots : « deuxième cycle et de » ;
1° Le mot : « générale » est supprimé ;
2° Les mots : « généralistes agréés » sont remplacés par les mots : « agréés-maîtres de stage des universités » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de l’agrément des praticiens agréés-maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’exercice des professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme, de pharmacien, d’infirmier, de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue visant à :
1° Créer une procédure de certification indépendante de tout lien d’intérêt permettant, à échéances régulières au cours de la vie professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l’actualisation et le niveau des connaissances ;
2° Déterminer les professionnels concernés par cette procédure de certification, les conditions de sa mise en œuvre et de son contrôle, les organismes qui en sont chargés, les conséquences de la méconnaissance de cette procédure ou de l’échec à celle-ci, ainsi que les voies de recours ouvertes à l’encontre de ces conséquences.
II. – Les ordonnances prévues au I sont prises :
1° Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, pour celle relative à la profession de médecin ;
2° Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, pour celles relatives aux autres professions mentionnées au premier alinéa du même I.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
(Supprimé)
Le 10° de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « et continue » ;
2° Le mot : « ultérieur » est supprimé.
Chapitre II
Faciliter les débuts de carrière et répondre aux enjeux des territoires
I. – L’article L. 632-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « de deuxième et troisième cycles des études de médecine ou d’odontologie et, de façon distincte, de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique » ;
b) Les mots : «, admis à poursuivre des études médicales à l’issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidatures à la signature d’un contrat d’engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé au premier alinéa du présent article, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « étudiants et internes » sont remplacés par le mot : « signataires » ;
b) La même première phrase est complétée par les mots : « ou odontologiques ou de leur parcours de consolidation des compétences » ;
c) À la deuxième phrase, le mot : « étudiants » est remplacé par le mot : « signataires » ;
d) À la même deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « À l’issue des épreuves mentionnées à l’article L. 632-2 du présent code, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « public », sont insérés les mots : « et réunissant les conditions pour accéder au troisième cycle » ;
c) Les mots : « un poste d’interne » sont remplacés par les mots : «, au regard des critères mentionnés au 4° du II du même article L. 632-2 du présent code, un poste » ;
5° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Au cours de la dernière année de leurs études, » sont supprimés ;
b) Les mots : « internes ayant signé » sont remplacés par les mots : « signataires d’ » ;
6° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de ne pas remettre en cause la réalisation des projets professionnels des signataires, précisés et consolidés au cours de leur formation, ou de leur parcours de consolidation des compétences, le Centre national de gestion peut maintenir sur la liste des lieux d’exercice des lieux qui remplissaient les conditions relatives à l’offre et à l’accès aux soins fixées au cinquième alinéa du présent article, dans les trois ans précédant la publication de la liste. » ;
7° Le cinquième alinéa est supprimé ;
8° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « médecins ou les étudiants ayant signé » sont remplacés par les mots : « signataires d’ » ;
b) À la même première phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
c) À la fin de la même première phrase, les mots : « dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi qu’une pénalité » sont remplacés par les mots : « ainsi que d’une pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire » ;
d) Les deux dernières phrases sont supprimées.
II. – L’article L. 634-2 du code de l’éducation est abrogé.
II bis. – Au troisième alinéa du II de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les références : «, L. 632-7 et L. 634-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 632-7 ».
III. – Le 4° du I est applicable aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine ou d’odontologie à compter de la rentrée universitaire 2020 et, pour les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, à compter du 1er janvier 2020.
Le 21° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« 21° Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins ; ».
(Supprimé)
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4131-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, soit à titre de remplaçant d’un médecin, soit comme adjoint d’un médecin en cas d’afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département, » sont remplacés par les mots : « à titre de remplaçant d’un médecin » ;
b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « les services de l’État » sont remplacés par les mots : « l’agence régionale de santé » ;
2° Après le même article L. 4131-2, il est inséré un article L. 4131-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131 -2 -1. – Les personnes remplissant les conditions définies aux 1° et 2° de l’article L. 4131-2 peuvent être autorisées à exercer la médecine comme adjoint d’un médecin :
« 1° Dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé en application du 1° de l’article L. 1434-4 ;
« 2° En cas d’afflux saisonnier ou exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département ;
« 3° Dans l’intérêt de la population, lorsqu’une carence ponctuelle est constatée dans l’offre de soins par le conseil départemental de l’ordre des médecins, le cas échéant sur proposition du maire de la commune.
« Ces autorisations sont délivrées, pour une durée limitée, par le conseil départemental de l’ordre des médecins, qui en informe l’agence régionale de santé.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’études exigé selon la qualification du praticien assisté ainsi que la durée maximale des autorisations, les modalités de leur délivrance et les conditions de leur prorogation. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 4421-1, après la référence : « livre Ier de la partie IV », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » ;
2° Le 1° de l’article L. 4421-1-3 est ainsi rédigé :
« 1° Pour l’application à Wallis-et-Futuna des articles L. 4131-2 et L. 4131-2-1 :
« a) Les références au représentant de l’État dans le département et au conseil départemental de l’ordre des médecins sont remplacées par la référence à l’administrateur supérieur ;
« b) La référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’agence de santé ; »
3° Les 2° et 3° du même article L. 4421-1-3 sont abrogés.
III. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 4431-1, après la référence : « présente partie », sont insérés les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » ;
2° Après l’article L. 4431-6, il est inséré un article L. 4431-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4431 -6 -1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 4131-2 et L. 4131-2-1, les références au représentant de l’État dans le département, au conseil départemental de l’ordre des médecins et à l’agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l’administrateur supérieur. »
L’article L. 1434-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : «, pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d’aide sont prévus en application du 4° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas déterminé les zones prévues au 1° du présent article pour une spécialité médicale, celles arrêtées pour la profession de médecin s’appliquent. »
L’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « certificat », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « attestant le décès, établi par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les modalités d’établissement de ce certificat lorsqu’il est établi par des médecins retraités. »
(Supprimé)
Chapitre III
Fluidifier les carrières entre la ville et l’hôpital pour davantage d’attractivité
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter les conditions d’exercice et les dispositions relatives aux statuts des personnels mentionnés au titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, des personnels mentionnés à la section 3 du chapitre II du titre V du livre IX du code de l’éducation et des personnels employés dans les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles pour :
1° Faciliter la diversification des activités entre l’activité hospitalière publique, des activités partagées entre structures de santé ou médico-sociales et un exercice libéral, dans leur établissement ou non, pour décloisonner les parcours professionnels et renforcer l’attractivité des carrières hospitalières ;
2° Simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements, notamment dans les spécialités où ces derniers rencontrent le plus de difficultés à recruter, et pour faciliter l’intervention des professionnels libéraux à l’hôpital.
II. – L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
L’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6152 -5 -1. – I. – Lorsqu’ils risquent d’entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l’article L. 6151-1, au 1° de l’article L. 6152-1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152-1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.
« Le directeur de l’établissement fixe, après avis des instances mentionnées aux articles L. 6143-5 et L. 6144-1, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, selon des modalités définies par voie réglementaire.
« L’interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s’appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier alinéa du présent article exercent à titre principal.
« En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l’interdiction n’est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d’activité.
« Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, le directeur de l’établissement notifie au praticien la décision motivée fixant le montant de l’indemnité due calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d’activité.
« II. – Les praticiens mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 exerçant à temps partiel ne peuvent user de leurs fonctions hospitalières pour entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé dans lequel ils exercent à titre principal dans le cadre d’une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.
« La décision d’exercice à temps partiel du praticien peut comprendre une interdiction d’exercer une activité rémunérée dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal.
« Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, il est mis fin à l’autorisation d’exercer à temps partiel.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 6151-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « soixante-cinq » est remplacé par le mot : « soixante-sept » ;
b) La référence : « l’article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État » est remplacée par la référence : « l’article L. 952-10 du code de l’éducation » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une partie de ces fonctions hospitalières est réalisée dans un ou plusieurs établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers et universitaires créés en application de l’article L. 6142-1 du présent code. Elle peut également l’être dans un ou plusieurs établissements sociaux ou médico-sociaux publics. Lorsque, en raison de la nature de sa spécialité, les fonctions hospitalières du consultant ne peuvent être réalisées dans un établissement autre qu’un centre hospitalier et universitaire, il effectue une activité d’expertise et de conseil portant sur le fonctionnement des établissements dans la région ou le territoire dans lequel il exerce. Un décret fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. »
TITRE II
CRÉER UN COLLECTIF DE SOINS AU SERVICE DES PATIENTS ET MIEUX STRUCTURER L’OFFRE DE SOINS DANS LES TERRITOIRES
Chapitre Ier
Promouvoir les projets territoriaux de santé
(Supprimé)
À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique, après le mot : « composé », sont insérés les mots : « des députés et sénateurs élus dans le ressort du territoire concerné, ».
Au début de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique, il est ajouté un I A ainsi rédigé :
« I A. – L’ensemble des acteurs de santé d’un territoire est responsable de l’amélioration de la santé de la population de ce territoire ainsi que de la prise en charge optimale des patients de ce territoire. »
À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 162-12-22 du code de la sécurité sociale, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A
Supprimé
1° L’article L. 1434-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, ainsi que sur les projets médicaux partagés mentionnés à l’article L. 6132-1 et les contrats locaux de santé. Il prend également en compte les projets médicaux des établissements de santé privés et les projets d’établissement des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
a bis) À la première phrase du troisième alinéa du même II, après la référence : « L. 6327-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
a ter) À l’avant-dernière phrase du premier alinéa du III, après les mots : « locaux de santé », sont insérés les mots : «, des conseils locaux de santé mentale » ;
b) Le même III est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le diagnostic territorial partagé donne lieu à l’établissement de projets territoriaux de santé, élaborés et mis en œuvre par des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434-12 ainsi que par des établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux, afin de coordonner leurs actions. L’élaboration d’un projet territorial de santé est initiée par au moins une communauté professionnelle territoriale de santé dont le projet de santé a été validé, avec le concours éventuel de l’union régionale des professionnels de santé mentionnée à l’article L. 4031-1, et un établissement ou un service de santé, social ou médico-social.
« Le projet territorial de santé tient compte des projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434-12, du projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire prévu à l’article L. 6132-1, du projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221-2, des projets médicaux des établissements de santé privés, des projets des établissements et services médico-sociaux et des contrats locaux de santé.
« Les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées peuvent participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet territorial de santé, après autorisation du ministre de la défense.
« Les associations agréées mentionnées à l’article L. 1114-1 et les collectivités territoriales et leurs groupements participent à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet territorial de santé, selon des modalités définies par décret.
« Le projet territorial de santé définit le territoire pertinent pour la mise en œuvre par ses acteurs de l’organisation des parcours de santé mentionnée au 5° de l’article L. 1411-1.
« Le projet territorial de santé décrit les modalités d’amélioration de l’accès aux soins, de la continuité des soins et de la coordination des parcours de santé, notamment l’organisation de l’accès à la prévention, au dépistage, aux soins de proximité, aux soins non programmés et aux soins spécialisés, sur tout le territoire. Il peut également décrire les modalités de coopération interprofessionnelle relatives aux pratiques médicales ou de soins.
« Le projet territorial de santé est transmis au directeur général de l’agence régionale de santé. Celui-ci peut s’y opposer, dans un délai de deux mois, en se fondant sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1 ou sur la pertinence du territoire du projet territorial de santé, après avis du conseil territorial de santé.
« Les projets territoriaux de santé font l’objet d’une évaluation par le conseil territorial de santé. » ;
c) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé s’appuient sur les contrats locaux de santé, lorsqu’ils existent. » ;
2° L’article L. 1434-12 est ainsi modifié :
aa et a)
Supprimés
b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé est réputé validé, sauf si le directeur général de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois en se fondant sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1 ou sur la pertinence du territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 1434-13 est ainsi rédigé :
« Pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1434-10 et sur la base des projets de santé des équipes de soins primaires, des projets de santé des équipes de soins spécialisés, des projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé lorsque ces derniers ont été validés, ainsi que des projets territoriaux de santé mentionnés au même article L. 1434-10, l’agence régionale de santé peut conclure des contrats territoriaux de santé. » ;
4° Au 1° de l’article L. 1441-5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et les sept derniers alinéas du III » ;
5° Le II de l’article L. 1441-6 est ainsi rétabli :
« II. – Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 1434-10, la deuxième phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : “Ce conseil veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondés sur la participation des habitants.” »
II. – Les communautés professionnelles territoriales de santé qui, à la date de publication de la présente loi, ont transmis leur projet de santé en application du troisième alinéa de l’article L. 1434-12 du code de la santé publique et conclu un contrat territorial de santé mentionné à l’article L. 1434-13 du même code sont réputées disposer d’un projet de santé validé, sauf opposition de leur part signalée à l’agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.
III. – Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Concertation avec les élus
« Art. L. 1434 -15. – Afin d’assurer une bonne coordination de l’action des collectivités territoriales et des agences régionales de santé, dans chaque département, les élus sont concertés sur l’organisation territoriale des soins au moins une fois par an par le directeur général ou le directeur de la délégation départementale de l’agence régionale de santé. Les élus peuvent demander à inscrire une question à l’ordre du jour. Ils peuvent, en outre, solliciter l’organisation d’une réunion spécifique lorsque les circonstances le justifient.
« Les élus mentionnés au premier alinéa sont le président du conseil régional ou son représentant, le président du conseil départemental ou son représentant, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département et au moins cinq maires du département désignés par l’association départementale des maires. S’il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires sont désignés par le représentant de l’État dans le département après consultation desdites associations. S’il n’existe aucune association de maires dans le département, les maires sont désignés par le représentant de l’État dans le département.
« La concertation des élus intervient en présence du délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant. »
IV. –
Supprimé
I. – Le chapitre VII du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Dispositifs d’appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes
« Art. L. 6327 -1. – Les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux et, le cas échéant, les structures qui les emploient peuvent solliciter un appui à la coordination des parcours de santé qu’ils estiment complexes afin d’améliorer le service rendu à la population et de concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 1411-1.
« Art. L. 6327 -2. – Le dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes :
« 1° Assure la réponse globale aux demandes d’appui des professionnels qui comprend notamment l’accueil, l’analyse de la situation de la personne, l’orientation et la mise en relation, l’accès aux ressources spécialisées, le suivi et l’accompagnement renforcé des situations, ainsi que la planification des prises en charge. Cette mission est réalisée en lien avec le médecin traitant, conformément à son rôle en matière de coordination des soins au sens de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et les autres professionnels concernés ;
« 2° Contribue avec d’autres acteurs et de façon coordonnée à la réponse aux besoins des personnes et de leurs aidants en matière d’accueil, de repérage des situations à risque, d’information, de conseils, d’orientation, de mise en relation et d’accompagnement ;
« 3° Participe à la coordination territoriale qui concourt à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 6327-1 du présent code.
« Art. L. 6327 -3. – Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes disposent d’une gouvernance assurant la représentation équilibrée des acteurs des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, intégrant notamment des représentants des usagers, du conseil départemental et des communautés professionnelles territoriales de santé.
« Cette gouvernance s’assure du respect du principe d’une intervention subsidiaire du dispositif d’appui par rapport à celle des professionnels mentionnés à l’article L. 6327-1.
« Art. L. 6327 -4. – Les établissements autorisés à exercer sous la forme d’hospitalisation à domicile peuvent participer au fonctionnement d’un ou de plusieurs dispositifs d’appui.
« Art. L. 6327 -5. – Les centres locaux d’information et de coordination mentionnés à l’article L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles peuvent intégrer le dispositif mentionné à l’article L. 6327-2 du présent code sur délibération du conseil départemental.
« Art. L. 6327 -6. – Pour les activités soumises à autorisation en application de l’article L. 6122-1 nécessitant une expertise particulière, des dispositifs spécifiques régionaux peuvent organiser un appui spécialisé aux professionnels de santé, aux établissements de santé ainsi qu’aux agences régionales de santé.
« Art. L. 6327 -7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »
II. – Les dispositifs d’appui existants en application des articles L. 6321-1, L. 6321-2, L. 6327-1 à L. 6327-3 du code de la santé publique et de l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles en vigueur antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi intègrent les dispositifs mentionnés aux articles L. 6327-2 à L. 6327-3 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de la présente loi dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. À l’échéance de ce délai, les articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code de la santé publique et l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.
III. – Les organisations assurant les fonctions d’appui à la coordination prévues au V de l’article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 en ce qu’ils concernent les expérimentations conduites dans le cadre de l’article 48 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 intègrent les dispositifs unifiés mentionnés aux articles L. 6327-2 à L. 6327-3 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de la présente loi au plus tard à leur date d’expiration.
L’article L. 4311-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. La liste de ces pathologies et de ces traitements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d’analyses de biologie médicale, sauf en cas d’indication contraire du médecin, et sous réserve d’une information du médecin traitant désigné par le patient. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : «, des solutions et produits antiseptiques ainsi que du sérum physiologique à prescription médicale facultative ».
(Supprimé)
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions diverses
« Art. L. 4312 -15. – Les infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, à ce titre, une rémunération forfaitaire par patient ne sont pas soumis à l’interdiction de partage d’honoraires au sens du présent code.
« Ces professionnels ne sont pas réputés pratiquer le compérage au sens du présent code du seul fait de l’exercice en commun de leur activité et du partage d’honoraires réalisé dans ce cadre compte tenu de la perception d’une rémunération forfaitaire par patient. »
Au premier alinéa de l’article L. 4322-1 du code de la santé publique, les mots : « provoquant l’effusion de sang » sont remplacés par le mot : « chirurgicale ».
I. – Le 7° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : «, dans le cadre des coopérations prévues par l’article L. 4011-1 du présent code, » et les mots : « au sein de l’équipe de soins » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « chroniques », le signe : «, » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et effectuer des bilans de médication destinés à en optimiser les effets » sont supprimés.
I bis. – L’article L. 5521-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, la référence : « L. 5125-1 » est remplacée par la référence : « L. 5125-1-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 5125-1 et L. 5125-1-1 A sont applicables dans le territoire de Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. »
II. – Le j du 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III. – Pour une période n’excédant pas trois ans à compter de la publication de la présente loi et par dérogation à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, le montant, les modalités et les conditions d’éligibilité pour les rémunérations des pharmaciens mettant en œuvre les dispositions du 7° de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique.
Le premier alinéa de l’article L. 5125-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « affecté », sont insérés les mots : «, d’une part, » ;
2° La référence : « à l’article L. 4211-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 4211-1 et L. 5125-24 » ;
3° Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, au conseil pharmaceutique et à l’exercice des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A ».
I. – L’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Peuvent, dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3, délivrer pour certaines pathologies, et dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé, des médicaments dont la liste est fixée par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les conditions d’application du 10°, notamment les conditions de formation préalable des pharmaciens et les modalités d’information du médecin traitant. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 4151-2, les mots : « du nouveau-né » sont remplacés par les mots : « de l’enfant, dans des conditions définies par décret » ;
2° L’article L. 4421-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4421 -14. – Les articles L. 4151-1 et L. 4151-4 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016. L’article L. 4151-2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 4161-1, après la première occurrence du mot : « qui », sont insérés les mots : « prescrivent des vaccins ou » ;
1° bis À l’article L. 4424-1, après le mot : « Wallis-et-Futuna », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » ;
2° Le 9° de l’article L. 5125-1-1 A est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet arrêté peut autoriser, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la prescription par les pharmaciens de certains vaccins. Il en fixe les conditions ; ».
L’article L. 4342-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : «, hors verres correcteurs d’amétropie et lentilles de contact oculaire correctrices, » sont supprimés ;
2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « est précisée » sont remplacés par les mots : « et les conditions de l’adaptation prévue au septième alinéa sont précisées ».
L’article L. 5125-23 du code de la santé publique est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Par dérogation au I, le pharmacien peut, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121-30, remplacer le médicament prescrit par un autre médicament conformément à la recommandation établie, après consultation des professionnels de santé et des associations d’usagers du système de santé agréées, par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet. L’agence informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de la publication de chaque recommandation.
« Lorsque le pharmacien procède au remplacement du médicament prescrit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent V, il inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le prescripteur de ce remplacement. »
(Supprimés)
Chapitre II
Développer une offre hospitalière de proximité, ouverte sur la ville et le secteur médico-social, et renforcer la gradation des soins
I A. – L’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6111 -3 -1. – I. – Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés, ou des sites identifiés de ces établissements. Ils assurent le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers et orientent les patients qui le nécessitent, conformément au principe de pertinence des soins, vers les établissements de santé de recours et de référence ou vers les autres structures adaptées à leurs besoins. Les missions des hôpitaux de proximité sont exercées avec la participation conjointe des structures et des professionnels de la médecine ambulatoire avec lesquels ils partagent une responsabilité territoriale.
« II. – En prenant en compte les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé et en coopération avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire, les établissements et les services médico-sociaux et d’autres établissements et acteurs de santé, dont les établissements d’hospitalisation à domicile, les hôpitaux de proximité :
« 1° Apportent un appui aux professionnels de santé de ville et aux autres acteurs de l’offre de soins pour répondre aux besoins de la population, notamment le cadre hospitalier nécessaire à ces acteurs pour y poursuivre la prise en charge de leurs patients lorsque l’état de ces derniers le nécessite ;
« 2° Favorisent la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité et leur maintien dans leur lieu de vie, en liaison avec le médecin traitant ;
« 3° Participent à la prévention et à la mise en place d’actions de promotion de la santé sur le territoire ;
« 4° Contribuent, en fonction de l’offre présente sur le territoire, à la permanence des soins et à la continuité des prises en charge en complémentarité avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire.
« III. – Pour la réalisation, dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, des missions définies aux I et II, de façon obligatoire, les hôpitaux de proximité exercent une activité de médecine, qui comprend, le cas échéant, des actes techniques, proposent, en complémentarité avec l’offre libérale disponible au niveau du territoire, des consultations de plusieurs spécialités, disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie, de biologie médicale et à des équipements de télésanté, et n’exercent pas d’activité de chirurgie ni d’obstétrique.
« À titre dérogatoire et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pour favoriser l’accès aux soins et au regard des besoins de la population et de l’offre présente sur le territoire concerné, un hôpital de proximité peut, sur décision du directeur général de l’agence régionale de santé, pratiquer certains actes chirurgicaux programmés. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste limitative des actes pouvant intégrer ces dérogations, après avis conforme de la Haute Autorité de santé.
« En fonction des besoins de la population et de l’offre de soins présente sur les territoires sur lesquels ils sont implantés, les hôpitaux de proximité exercent d’autres activités, notamment la médecine d’urgence, les activités prénatales et postnatales, les soins de suite et de réadaptation ainsi que les activités de soins palliatifs, et peuvent apporter leur expertise aux autres acteurs par le biais d’équipes mobiles.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, en vue de renforcer et développer des établissements de santé de proximité qui assurent le premier niveau de gradation des soins hospitaliers, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1°
Supprimé
2° Déterminer les modalités selon lesquelles la liste des établissements de santé de proximité est établie par l’autorité compétente ;
3° Définir les modalités d’organisation, de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements, notamment en ouvrant leur gouvernance aux acteurs du système de santé du territoire concerné ;
4° Déterminer dans quelles conditions ces dispositions peuvent être applicables à une structure dépourvue de la personnalité morale et partie d’une entité juridique.
II. – Les ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
III. – Le I A entre en vigueur à une date définie par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.
Chapitre III
Renforcer la stratégie et la gouvernance médicales au niveau du groupement hospitalier de territoire, et accompagner les établissements volontaires pour davantage d’intégration
I. – Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 6144-2, il est inséré un article L. 6144-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6144 -2 -1. – Il est institué une commission médicale de groupement dans chaque groupement hospitalier de territoire. La commission médicale de groupement contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale du groupement et du projet médical partagé du groupement. Elle contribue notamment à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.
« La commission médicale de groupement est composée de représentants des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques. Elle élit son président.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment la composition et les règles de fonctionnement des commissions médicales de groupement ainsi que les matières sur lesquelles elles sont consultées. » ;
2° Le 5° du II de l’article L. 6132-2 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du b, après les mots : « directeurs d’établissement, », sont insérés les mots : « le président de la commission médicale du groupement, » ;
b) Le même b est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le directeur de l’établissement support est le président du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire. Le président de la commission médicale de groupement en est le vice-président ; »
c) Le d est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il se prononce sur la stratégie du groupement hospitalier de territoire. Il donne notamment un avis sur le projet médical partagé, le projet de soins partagé ainsi que les conventions de partenariat et d’association entre le groupement hospitalier de territoire et des établissements non parties au groupement. » ;
3° Le I de l’article L. 6132-3 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, en cohérence avec la stratégie médicale du groupement élaborée avec le concours de la commission médicale de groupement. » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6144-1, après le mot : « contribue », sont insérés les mots : « à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie médicale de l’établissement et de son projet médical en lien avec le projet médical partagé du groupement, et ».
II. – Après l’article L. 6132-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6132-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6132 -5 -1. – Les établissements parties à un même groupement hospitalier de territoire peuvent être autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, au regard de l’intention et des capacités de l’ensemble des établissements parties, à :
« 1° Mettre en commun leurs disponibilités déposées auprès de l’État, par dérogation aux articles L. 312-2, L. 511-5 et L. 511-7 du code monétaire et financier et à l’article L. 6145-8-1 du présent code ;
« 2° Élaborer un programme d’investissement et un plan global de financement pluriannuel uniques par dérogation aux 4° et 5° de l’article L. 6143-7 ;
« 3° Conclure avec l’agence régionale de santé, par dérogation à l’article L. 6114-1 et au 1° de l’article L. 6143-7, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique pour l’ensemble des établissements du groupement. »
III. – A. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, en vue, d’une part, de tirer les conséquences des dispositions du I du présent article sur les établissements publics de santé et les groupements hospitaliers de territoire et de renforcer leur gouvernance médicale et, d’autre part, d’ouvrir une faculté aux établissements parties à un groupement hospitalier de territoire d’approfondir l’intégration de leurs instances représentatives ou consultatives, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Mettre en cohérence le fonctionnement et les champs de compétences des commissions médicales d’établissement et des commissions médicales de groupement ainsi que les attributions de leurs présidents respectifs ;
2° Étendre les compétences des commissions médicales d’établissements et de groupements ;
3° Définir l’articulation des compétences respectives en matière de gestion des ressources humaines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques des directeurs d’établissements parties à un groupement hospitalier de territoire et des directeurs d’établissements support de groupement hospitalier de territoire ;
4° Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent décider de fusionner ou substituer leurs directoires et le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
5° Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent décider de fusionner ou substituer leurs commissions médicales d’établissement et leur commission médicale de groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux b et c du 5° du II de l’article L. 6132-2 et aux articles L. 6143-7-5, L. 6144-1 et L. 6144-2 du même code ;
6° Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent décider de fusionner ou substituer leurs comités techniques d’établissement, leurs comités techniques de groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public et la conférence territoriale de dialogue social du groupement hospitalier de territoire, par dérogation aux articles L. 6144-3, L. 6144-3-1, L. 6144-3-2 et L. 6144-4 dudit code ;
7° Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent décider de fusionner ou substituer leurs commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement, par dérogation à l’article L. 6146-9 du même code ;
8° Organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire peuvent décider de fusionner ou substituer leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par dérogation aux articles L. 4611-1 et L. 4611-2 du code du travail, demeurés applicables en vertu du I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
9° Préciser les modalités de constitution, les règles de composition et les attributions des instances qui résulteront des fusions ou substitutions prévues aux 4° à 8° du présent A ainsi que les conditions permettant de mettre fin à ces fusions et substitutions, de nature à garantir la représentation effective des personnels de chacun des établissements du groupement et le respect du principe d’élection.
B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement pour chaque ordonnance prévue au présent III dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
IV. – L’article L. 6132-7 du code de la santé publique est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les conditions de mise en œuvre des autorisations prévues à l’article L. 6132-5-1, ainsi que celles permettant d’y mettre fin en garantissant la continuité des activités et des parcours de soins. »
V. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.
VI. – Les mandats des présidents et des membres élus des commissions médicales d’établissement mentionnées à l’article L. 6144-1 du code de la santé publique et des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire sont prorogés jusqu’à la date d’institution des commissions médicales de groupement fixée par le décret prévu au V du présent article et, au plus tard, le 1er janvier 2021.
(Supprimé)
Après le premier alinéa de l’article L. 6143-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un volet spécifique consacré à la qualité de vie au travail des personnels médicaux et non médicaux est intégré au projet social défini par chaque établissement. »
(Supprimé)
L’article L. 6143-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au seizième alinéa, les mots : « peut se faire » sont remplacés par les mots : « se fait » ;
2° Le même seizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur communique à la présidence du conseil de surveillance les documents financiers pluriannuels élaborés en concertation avec le directoire ainsi que les documents stratégiques relatifs au projet d’établissement et à la participation à des coopérations et réseaux validés en concertation avec le directoire. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est informé du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’agence régionale de santé et l’établissement ainsi que de ses modifications. »
(Supprimé)
TITRE III
DÉVELOPPER L’AMBITION NUMÉRIQUE EN SANTÉ
Chapitre Ier
Innover en valorisant les données cliniques
I A. –
Supprimé
I. – L’article L. 1460-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « recueillies à titre obligatoire et » sont supprimés ;
b) À la même première phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : «, aux professionnels de santé » ;
c) À ladite première phrase, les mots : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont supprimés ;
d) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Les traitements réalisés à cette fin » sont remplacés par les mots : « Ces traitements » ;
e) Au début de la dernière phrase, les mots : « Sauf disposition législative contraire, » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « des recherches, des études ou des évaluations à des fins de santé publique » sont remplacés par les mots : « des traitements de données concernant la santé ».
II. – L’article L. 1461-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est complété par des 6° à 10° ainsi rédigés :
« 6° Les données destinées aux professionnels et organismes de santé recueillies à l’occasion des activités mentionnées au I de l’article L. 1111-8 du présent code donnant lieu à la prise en charge des frais de santé en matière de maladie ou de maternité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et à la prise en charge des prestations mentionnées à l’article L. 431-1 du même code en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
« 6° bis Les données relatives à la perte d’autonomie, évaluée à l’aide de la grille mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque ces données sont appariées avec les données mentionnées aux 1° à 6° du présent I ;
« 7° Les données à caractère personnel des enquêtes dans le domaine de la santé, lorsque ces données sont appariées avec des données mentionnées aux 1° à 6° ;
« 8° Les données recueillies lors des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541-1 du code de l’éducation ;
« 9° Les données recueillies par les services de protection maternelle et infantile dans le cadre de leurs missions définies à l’article L. 2111-1 du présent code ;
« 10° Les données de santé recueillies lors des visites d’information et de prévention, telles que définies à l’article L. 4624-1 du code du travail. » ;
2° Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Le système national des données de santé est mis en œuvre dans le cadre d’orientations générales définies par l’État, en concertation avec les organismes responsables des systèmes d’information et des données mentionnés au I du présent article.
« Les responsables ou les catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et leurs rôles respectifs sont définis par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les responsables de ces traitements sont nominativement désignés par arrêté. » ;
3° Au 4° du IV, la référence : « 36 » est remplacée par la référence : « 78 ».
III. – L’article L. 1461-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation » sont remplacés par les mots : « des traitements » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont remplacés par les mots : « de données concernant la santé » et les mots : « la procédure définie à la sous-section 2 de » sont remplacés par les mots : « les procédures définies à » ;
b) Au a du 2°, les mots : « de la recherche » sont remplacés par les mots : « de la mise en œuvre du traitement » ;
c) Le b du même 2° est ainsi modifié :
– les mots : « de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation » sont remplacés par les mots : « du traitement » ;
– après le mot : « méthode », sont insérés les mots : « et, pour les traitements mentionnés à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ».
IV. – L’article L. 1461-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
2° Les II et III sont abrogés.
V. – Au 1° de l’article L. 1461-5 du code de la santé publique, les mots : « recherches, les études ou les évaluations demandées » sont remplacés par les mots : « traitements de données concernant la santé demandés ».
VI. – L’article L. 1461-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Pour les finalités de recherche, d’étude ou d’évaluation » sont remplacés par les mots : « Pour les traitements mentionnés aux articles 65 et 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » ;
2° La référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 10° ».
VII. – L’article L. 1461-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° Le 6° devient le 5° ;
3° Le 6° est ainsi rétabli :
« 6° Définit les catégories de responsables des traitements du système national des données de santé et les responsables de traitement et fixe leurs rôles respectifs ; »
4° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Précise les modalités d’application du 6° du I de l’article L. 1461-1. »
VIII. – Le chapitre II du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Plateforme des données de santé » ;
2° L’article L. 1462-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1462 -1. – Un groupement d’intérêt public, dénommé “Plateforme des données de santé”, est constitué entre l’État, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé.
« Il est notamment chargé :
« 1° De réunir, organiser et mettre à disposition les données du système national des données de santé mentionné à l’article L. 1461-1 et de promouvoir l’innovation dans l’utilisation des données de santé ;
« 1° bis D’informer les patients, de promouvoir et de faciliter leurs droits, en particulier concernant les droits d’opposition dans le cadre du 1° du I de l’article L. 1461-3 ;
« 2° D’assurer le secrétariat unique mentionné à l’article 76 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 3° D’assurer le secrétariat du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé ;
« 4° De contribuer à l’élaboration, par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, de référentiels et de méthodologies de référence au sens du b du 2° du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. Il facilite la mise à disposition de jeux de données de santé présentant un faible risque d’impact sur la vie privée, dans les conditions prévues au II de l’article 66 de la même loi ;
« 5° De procéder, pour le compte d’un tiers et à la demande de ce dernier, à des opérations nécessaires à la réalisation d’un traitement de données issues du système national des données de santé pour lequel ce tiers a obtenu une autorisation dans les conditions définies à l’article L. 1461-3 du présent code ;
« 6° De contribuer à diffuser les normes de standardisation pour l’échange et l’exploitation des données de santé, en tenant compte des standards européens et internationaux ;
« 7° D’accompagner, notamment financièrement, les porteurs de projets sélectionnés dans le cadre d’appels à projets lancés à son initiative et les producteurs de données associés aux projets retenus.
« Il publie chaque année un rapport transmis au Parlement. » ;
3° Il est ajouté un article L. 1462-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1462 -2. – I. – Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1462-1 peut recruter des personnels dont les contrats relèvent du droit privé. Il peut également employer des agents titulaires des trois fonctions publiques en position de détachement ou de mise à disposition et employer ou recruter des agents non titulaires de droit public sous contrats à durée déterminée ou indéterminée.
« II. – Le groupement d’intérêt public est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Par dérogation à ces règles, il peut déposer des fonds au Trésor public. Il peut percevoir des recettes correspondant à des prestations facturées à des tiers en application du 5° de l’article L. 1462-1.
« Le groupement d’intérêt public n’est pas soumis à l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.
« Le groupement d’intérêt public est soumis au contrôle économique et financier de l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et adaptées à ses missions et conditions de fonctionnement. »
IX. – Le groupement d’intérêt public « Institut national des données de santé », mentionné à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient le groupement d’intérêt public « Plateforme des données de santé », mentionné au même article L. 1462-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi, à la date d’approbation de la convention constitutive de celui-ci. À cette date, l’ensemble des biens, personnels, droits et obligations de l’Institut national des données de santé sont transférés de plein droit à la Plateforme des données de santé.
X. – Au 3° de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, les mots : « recherches, les études ou les évaluations dans le domaine de » sont remplacés par les mots : « traitements de données concernant ».
XI. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article 30 est complété par les mots : « ou servant à constituer des bases de données à des fins ultérieures de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé » ;
1° bis L’article 65 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les traitements mis en œuvre par l’État aux fins de conception, de suivi ou d’évaluation des politiques publiques dans le domaine de la santé ainsi que ceux réalisés aux fins de collecte, d’exploitation et de diffusion des statistiques dans ce domaine. » ;
2° L’article 66 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « l’Institut national des données de santé mentionné » sont remplacés par les mots : « la Plateforme des données de santé mentionnée » ;
b) À la seconde phrase du premier alinéa du V, les mots : « l’Institut national des données de santé » sont remplacés par les mots : « le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé » ;
3° Au début du second alinéa de l’article 72, les mots : « L’Institut national des données de santé mentionné à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « Le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé » ;
4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 73, les mots : « l’Institut national des données de santé mentionné » sont remplacés par les mots : « la Plateforme des données de santé mentionnée » ;
5° L’article 76 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, pour les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent article.
« Ce comité est composé de manière à garantir son indépendance et la diversité des compétences dans le domaine des traitements concernant la santé et à l’égard des questions scientifiques, éthiques, sociales et juridiques. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Il comporte, en son sein, des représentants d’associations de malades ou d’usagers du système de santé agréées désignés au titre des dispositions de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique.
« Les membres du comité, les personnes appelées à collaborer à ses travaux et les agents relevant du statut général des fonctionnaires ou du statut général des militaires qui en sont dépositaires sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, études ou évaluations, aux personnes qui les organisent ou aux produits, objets ou méthodes faisant l’objet de la recherche.
« Ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de l’investigateur de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation examinée.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la composition du comité éthique et scientifique et définit ses règles de fonctionnement. Les membres du comité sont soumis à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « l’Institut national » sont remplacés par les mots : « la Plateforme » ;
6° L’article 77 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la Caisse nationale d’assurance maladie responsable du traitement » sont remplacés par les mots : « des responsables des traitements » et les mots : « l’Institut national » sont remplacés par les mots : « la Plateforme » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « le responsable du traitement mentionné » sont remplacés par les mots : « les responsables des traitements mentionnés » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « le responsable du traitement mentionné » sont remplacés par les mots : « les responsables des traitements mentionnés » ;
d) À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie peut » sont remplacés par les mots : « les responsables des traitements mentionnés au II de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique peuvent » et les mots : « s’il dispose » sont remplacés par les mots : « s’ils disposent » et, au début de la deuxième phrase du même dixième alinéa, les mots : « Il doit » sont remplacés par les mots : « Ils doivent ».
XII. – Le présent article entre en vigueur, sous réserve des dispositions du XIII, le lendemain de la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.
XIII. – Le a du 2°, le 4°, le b du 5° et le a du 6° du XI entrent en vigueur à la date d’approbation de la convention constitutive de la Plateforme des données de santé, et au plus tard le 31 décembre 2019.
XIV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport sur le groupement mentionné à l’article L. 1462-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le rapport s’attache à déterminer dans quelle mesure la structure et la gouvernance de ce groupement sont de nature à garantir aux utilisateurs d’exploiter les données de santé de manière plus efficace.
(Supprimé)
I. – L’article L. 1413-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les droits sur les bases de données anonymisées qui sont constituées par les personnes, structures ou centres mentionnés aux 1° et 2° du présent article à la demande et selon les modalités, notamment financières, définies par l’agence pour lui permettre d’exercer ses missions sont exercés par l’État.
« Les ressources mentionnées au 3° de l’article L. 1413-8 recueillies ou collectées dans les mêmes conditions sont la propriété de l’État. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 1524-2 du code de la santé publique, la référence : « l’ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017 » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ».
Chapitre II
Doter chaque usager d’un espace numérique de santé
I. – Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1110-4-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110 -4 -1. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, doivent être conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique :
« 1° Les systèmes d’information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé et les personnes exerçant sous leur autorité, les établissements et services de santé, le service de santé des armées et tout organisme participant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code ;
« 2° Les systèmes d’information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels des secteurs médico-social et social et les établissements ou services des secteurs médico-social et social mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 3° Les systèmes d’information ou les services ou outils numériques mis en œuvre par les organismes d’assurance maladie, ayant pour finalité principale de contribuer directement à la prévention ou au suivi du parcours de soins des patients.
« Ces référentiels sont élaborés en concertation avec les représentants des professions de santé, d’associations d’usagers du système de santé agréées, des établissements de santé, des établissements et services des secteurs médico-social et social ainsi que des opérateurs publics et privés du développement et de l’édition des systèmes d’information et des services et outils numériques en santé. Ils sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les référentiels d’interopérabilité mentionnés au premier alinéa du présent article s’appuient sur des standards ouverts en vue de faciliter l’extraction, le partage et le traitement des données de santé dans le cadre de la coordination des parcours de soins, de l’amélioration de la qualité des soins et de l’efficience du système de santé ou à des fins de recherche clinique, chaque fois que le recours à ces standards est jugé pertinent et possible par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24 du présent code. » ;
2° Après le même article L. 1110-4-1, il est inséré un article L. 1110-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110 -4 -2. – I. – La conformité d’un système d’information ou d’un service ou outil numérique en santé aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110-4-1 est attestée dans le cadre d’une procédure d’évaluation et de certification définie par décret en Conseil d’État.
« II. – Est conditionnée à des engagements de mise en conformité aux référentiels d’interopérabilité dans les conditions prévues au I l’attribution de fonds publics dédiés au financement d’opérations de conception, d’acquisition ou de renouvellement de systèmes d’information ou de services ou outils numériques en santé mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 1110-4-1.
« III. – Les conventions d’objectifs et de gestion mentionnées à l’article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens mentionnés à l’article L. 1435-3 du présent code et les contrats ayant pour objet d’améliorer la qualité et la coordination des soins mentionnés à l’article L. 1435-4 du même code comprennent des engagements relatifs à l’acquisition ou à l’utilisation de systèmes d’information ou de services ou outils numériques en santé dont la conformité aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110-4-1 dudit code est attestée dans les conditions prévues au I du présent article.
« IV. – Des modalités complémentaires d’incitation à la mise en conformité des systèmes d’information et services ou outils numériques en santé aux référentiels d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110-4-1 peuvent être prévues par décret en Conseil d’État. »
II
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Espace numérique de santé, » ;
2° Au début, il est rétabli un article L. 1111-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111 -13. – Afin de promouvoir le rôle de chaque personne, tout au long de sa vie, dans la protection et l’amélioration de sa santé, un espace numérique de santé est mis à sa disposition, dans un domaine sécurisé, lui permettant de gérer ses données de santé et de participer à la construction de son parcours de santé en lien avec les acteurs des secteurs sanitaire, social et médico-social, favorisant ainsi la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1110-4-1. » ;
3° Après le même article L. 1111-13, sont insérés des articles L. 1111-13-1 et L. 1111-13-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1111 -13 -1. – I. – L’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informé de l’ouverture de l’espace numérique de santé, des conditions de fonctionnement de cet espace, de ses responsabilités en tant que gestionnaire de données de santé dans un espace numérique et des modalités de sa clôture en application du 3° du IV. La personne concernée ou son représentant légal est également informé des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture de l’espace numérique de santé.
« Chaque titulaire dispose gratuitement de son espace numérique de santé.
« Pour chaque titulaire, l’identifiant de son espace numérique de santé est l’identifiant national de santé mentionné à l’article L. 1111-8-1 lorsqu’il dispose d’un tel identifiant. Pour le bénéficiaire de l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, l’identifiant de son espace numérique de santé est créé selon des modalités précisées par le décret en Conseil d’État mentionné au V du présent article.
« II. – L’espace numérique de santé est accessible en ligne à son titulaire, ou au représentant légal de celui-ci, dûment identifié et authentifié. Il permet au titulaire d’accéder à :
« 1° Ses données administratives ;
« 2° Son dossier médical partagé ;
« 3° Ses constantes de santé éventuellement produites par des applications ou des objets connectés référencés en application du III ou toute autre donnée de santé utile à la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins ;
« 4° L’ensemble des données relatives au remboursement de ses dépenses de santé ;
« 5° Des outils permettant des échanges sécurisés avec les acteurs du système de santé, dont une messagerie de santé sécurisée permettant à son titulaire d’échanger avec les professionnels et établissements de santé et des outils permettant d’accéder à des services de télésanté ;
« 6° Tout service numérique, notamment des services développés pour favoriser la prévention et fluidifier les parcours, les services de retour à domicile, les services procurant une aide à l’orientation et à l’évaluation de la qualité des soins, les services visant à informer les usagers sur l’offre de soins et sur les droits auxquels ils peuvent prétendre ainsi que toute application numérique de santé référencés en application du même III ;
« 7° Le cas échéant, les données relatives à l’accueil et l’accompagnement assurés par les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
« III. – Pour être référencés et intégrables dans l’espace numérique de santé, les services et outils numériques mentionnés aux 2° à 7° du II du présent article, qu’ils soient développés par des acteurs publics ou privés, respectent les référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement mentionné à l’article L. 1111-24, les référentiels d’engagement éthique ainsi que les labels et normes imposés dans l’espace numérique de santé mentionnés à l’article L. 1111-13-2. Ces référentiels, labels et normes tiennent compte de la mise en œuvre par les services et outils numériques de mesures en faveur des personnes rencontrant des difficultés dans l’accès à internet et dans l’utilisation des outils informatiques et numériques.
« Les services et outils numériques référencés ne peuvent accéder aux données de l’espace numérique de santé du titulaire qu’avec l’accord exprès de celui-ci, dûment informé des finalités et des modalités de cet accès lors de l’installation de ces services et outils, et qu’à des fins de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour une durée de conservation strictement proportionnée à ces finalités.
« IV. – Le titulaire ou son représentant légal est le seul gestionnaire et utilisateur. Il peut décider que son espace ne contient pas un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article ou n’y donne pas accès.
« À tout moment, il peut décider :
« 1° De proposer un accès temporaire ou permanent à tout ou partie de son espace numérique de santé à un établissement de santé, à un professionnel de santé ou aux membres d’une équipe de soins au sens de l’article L. 1110-12 ou de mettre fin à un tel accès ;
« 2° D’extraire des données de l’espace numérique de santé en application des dispositions relatives au droit d’accès et à la portabilité des données prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
« 3° De clôturer son espace numérique de santé ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article. Le décès du titulaire entraîne la clôture de son espace numérique de santé.
« À compter de la clôture de l’espace numérique de santé, faute de demande expresse de destruction de son contenu par son titulaire ou le représentant légal de celui-ci, ledit contenu est archivé pendant dix ans, période pendant laquelle il reste accessible à son titulaire, son représentant légal, ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans les conditions et limites prévues au V de l’article L. 1110-4.
« La communication de tout ou partie des données de l’espace numérique de santé ne peut être exigée du titulaire de cet espace lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat, à l’exception des contrats relatifs aux services et outils numériques référencés en application du III du présent article.
« Une personne mineure peut s’opposer à la saisie dans son espace numérique de santé, dans un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article ou dans son dossier pharmaceutique de toute donnée relative aux prises en charge réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 1111-5, L. 1111-5-1, L. 2212-7 et L. 6211-3-1 ou relative au remboursement desdites prises en charge et des produits de santé prescrits ou administrés.
« V. – Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Art. L. 1111 -13 -2. – L’État et une ou plusieurs autorités publiques ou personnes publiques désignées par décret assurent la conception, la mise en œuvre, l’administration, l’hébergement et la gouvernance de l’espace numérique de santé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La conception et la mise en œuvre de l’espace numérique de santé tiennent compte des difficultés d’accès à internet et aux outils informatiques et dans l’usage de ces outils rencontrées par certaines catégories de personnes, en proscrivant toute discrimination fondée sur la localisation géographique, les ressources ou le handicap.
« Ce décret précise notamment le cadre applicable à la définition des référentiels d’engagement éthique et aux labels et normes imposés dans l’espace numérique de santé ainsi qu’au référencement des services et outils pouvant être mis à disposition dans l’espace numérique de santé en application des critères mentionnés au III de l’article L. 1111-13-1. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au V de l’article L. 1111-13-1 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2022.
Au troisième alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique, après le mot : « invalides », sont insérés les mots : « ou le biologiste médical » et le mot : «, peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’identification et à l’authentification des usagers du système de santé, y compris des personnes ne disposant pas d’un identifiant national de santé, des personnes physiques ou morales en charge d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social et des personnes exerçant sous leur autorité, en vue de diversifier, notamment de dématérialiser, les moyens techniques de leur identification et de leur authentification et de les adapter aux différentes situations d’usage dans les systèmes d’information de santé et d’assurance maladie et leurs services dématérialisés, afin d’accompagner le développement des usages numériques en santé et la mobilité des professionnels de santé.
Les ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent disposer » sont remplacés par le mot : « disposent » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le dossier médical partagé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informé de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. La personne concernée ou son représentant légal est également informé des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier médical partagé. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 1111-21, les mots : « recueil du consentement » sont remplacés par les mots : « mise en œuvre de l’information des titulaires sur l’ouverture de leur dossier ainsi que sur les modalités d’exercice de leur droit d’opposition à cette ouverture et de leur droit de clôturer à tout moment leur dossier ».
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2021.
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-15, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : «, à l’exception de ceux réalisés dans le cadre de la médecine du travail » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 1111-18 est ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la médecine du travail, le dossier médical partagé est accessible uniquement pour y déposer des documents. »
II. – L’article L. 4624-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « intégré au dossier médical partagé » ;
2° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ce dossier est accessible aux professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-15, L. 1111-16 et L. 1111-17 du code de la santé publique, sauf opposition de l’intéressé. » ;
3° À la dernière phrase, les mots : « du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « du même code ».
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
L’article L. 1111-22 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 1111 -22. – La collecte, l’échange ou le partage des données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge du patient à l’occasion de soins délivrés lors de sa présence sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne peuvent être réalisés au moyen du dossier médical partagé rendu accessible aux professionnels intervenant dans le cadre de ces soins, dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les modalités d’échange de données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge transfrontalière ainsi que les exigences d’identification et d’authentification des professionnels habilités et de consentement du patient. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des États remplissant les conditions prévues par ce décret. »
Chapitre III
Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins
I. – Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « télémédecine » est remplacé par le mot : « télésanté » ;
2° À l’intitulé du titre Ier, le mot : « télémédecine » est remplacé par le mot : « télésanté » ;
3° L’intitulé du chapitre VI du même titre Ier est ainsi rédigé : « Télésanté » ;
4° Au début du même chapitre VI, est insérée une section 1 intitulée : « Télémédecine » et comprenant l’article L. 6316-1 ;
4° bis Après le mot : « rapport, », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6316-1 est ainsi rédigée : « un professionnel médical avec un ou plusieurs professionnels de santé, entre eux ou avec le patient et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient. » ;
5° Le chapitre VI est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Télésoin
« Art. L. 6316 -2. – Le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l’exercice de leurs compétences prévues au présent code.
« Les activités de télésoin sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis porte notamment sur les conditions de réalisation du télésoin permettant de garantir leur qualité et leur sécurité ainsi que sur les catégories de professionnels y participant.
« Les conditions de mise en œuvre des activités de télésoin sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l’article L. 162-14-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « La ou les conventions définissent également, le cas échéant, les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l’article L. 6316-2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l’assurance maladie mettent en relation un auxiliaire médical et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable, en présence du patient, d’un premier soin par un auxiliaire médical de la même profession que celle du professionnel assurant le télésoin ; l’activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n’est pas prise en charge dans le cadre du télésoin ; »
2° La sous-section 3 de la section 3.1 est complétée par un article L. 162-15-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 162 -15 -5. – Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 1° du I de l’article L. 162-14-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 162-16-1 est ainsi modifié :
a) Après le 14°, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les tarifs ou les modes de rémunération ainsi que les modalités de réalisation des activités de télésoin définies en application de l’article L. 6316-2 du même code. Les activités de télésoin prises en charge par l’assurance maladie mettent en relation un pharmacien et un patient et sont effectuées par vidéotransmission. Leur prise en charge est subordonnée à la réalisation préalable par un pharmacien, en présence du patient, d’un premier soin, bilan de médication ou entretien d’accompagnement d’un patient atteint d’une pathologie chronique ; l’activité du professionnel de santé présent, le cas échéant, auprès du patient n’est pas prise en charge dans le cadre du télésoin. » ;
b) Au vingt et unième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « au 13° » est remplacée par les références : « aux 13° à 15° » ;
4° Après l’article L. 162-16-1-2, il est inséré un article L. 162-16-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162 -16 -1 -3. – Les conditions de prise en charge des activités de télésoin prévues au 15° de l’article L. 162-16-1 sont fixées par décret en Conseil d’État. »
(Supprimé)
I. – L’article 34 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie est abrogé.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à la prescription et à la dispensation de soins, produits ou prestations, notamment ceux ayant vocation à être pris en charge par l’assurance maladie, ainsi qu’aux règles régissant les conditions de certification des logiciels d’aide à la prescription et à la dispensation, tout en assurant la sécurité et l’intégrité des données, en vue de généraliser par étapes la prescription électronique.
Les ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
II bis. – Après la remise au Parlement d’un rapport détaillant les enjeux et les modalités d’une évaluation des logiciels destinés à fournir des informations utilisées à des fins diagnostiques et d’aide aux choix thérapeutiques, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’évaluation de ces logiciels.
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent II bis. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
III. – La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’article L. 161-35 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêts de travail sont prescrits, sauf exception, de manière dématérialisée par l’intermédiaire d’un service mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d’assurance maladie. » ;
b) Au II, les mots : « de l’obligation de transmission électronique par les professionnels et centres de santé » sont remplacés par les mots : « des obligations définies au I du présent article » ;
2° À l’article L. 161-35-1, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » et la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° ».
IV. – Le second alinéa du I de l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à des dates fixées, selon les prescripteurs, par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code, et au plus tard le 31 décembre 2021. Ces dernières définissent également les situations dans lesquelles la dématérialisation des arrêts de travail ne peut s’appliquer. Si les conventions n’ont pas fixé un tel calendrier dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale y procède dans un délai de deux mois.
(Supprimé)
TITRE IV
MESURES DIVERSES
Chapitre Ier
Dispositions de simplification
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie est abrogée ;
1° bis Au 3° du I de l’article L. 1441-6, les mots : « Dans les conditions prévues à l’article L. 1434-14, » sont supprimés ;
2° Le III du même article L. 1441-6 est abrogé ;
3° À l’article L. 5125-10, les mots : « du conseil supérieur de la pharmacie et » sont supprimés ;
4° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 6143-7 est supprimée ;
5° L’article L. 6152-1-1 est abrogé ;
6° À la fin de l’article L. 6152-6, la référence : « et de l’article L. 6152-1-1 » est supprimée.
II. – Le III de l’article 2 de la loi n° 2017-220 du 23 février 2017 ratifiant l’ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification de procédures mises en œuvre par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions relatives aux produits de santé est abrogé.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2212-10 est abrogé ;
1° bis À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2214-3, les mots : « statistiques établies à partir des déclarations prévues à l’article L. 2212-10 » sont remplacés par les mots : « données relatives à la pratique de l’interruption volontaire de grossesse en France » ;
2°
Supprimé
3° Le 3° de l’article L. 2422-2 est abrogé ;
4° Au 4° de l’article L. 6323-1-1, la référence : « L. 2212-10 » est remplacée par la référence : « L. 2212-9 ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration de l’accompagnement au cours de la grossesse et notamment sur les modalités de systématisation de l’entretien prénatal prévu au dernier alinéa de l’article L. 2122-1 du code de la santé publique.
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 313-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 313 -1 -1. – I. – Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l’article L. 313-3 les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1, les projets de lieux de vie et d’accueil ainsi que les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code.
« Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l’autorisation après avis d’une commission d’information et de sélection d’appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s’entendent de ceux qu’apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement.
« Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d’extension faisant appel à de tels financements, la procédure prévue au deuxième alinéa du présent I s’applique.
« Les conditions d’application du présent I sont définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Sont exonérés de la procédure d’appel à projet mentionnée au I :
« 1° Les projets d’extension inférieure à un seuil fixé par décret ;
« 2° Les opérations de regroupement d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en application de l’article L. 313-1, si ces opérations entraînent des extensions de capacités inférieures au seuil prévu au 1° du présent II ;
« 3° Les projets de transformation d’établissements ou de services ne comportant pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312-1 ;
« 4° Les projets de transformation d’établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l’établissement ou du service, au sens de l’article L. 312-1, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et sous réserve que, lorsque l’activité relève d’une autorisation conjointe, il n’y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ;
« 5° Les projets de transformation d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du présent code, à la condition de donner lieu à la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
« 6° Les projets de création et d’extension des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III du même article L. 312-1 ;
« 7° Les projets d’extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n’excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieure à un seuil fixé par décret ;
« 8° Les projets de création, de transformation et d’extension des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 ;
« 9° Les projets de création, de transformation et d’extension des établissements et services de l’État mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 315-2 ;
« 10° Les projets de création, de transformation et d’extension des établissements et services non personnalisés des départements et des établissements publics départementaux lorsqu’ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental, mentionnés au dernier alinéa du même article L. 315-2.
« La commission d’information et de sélection mentionnée au I du présent article donne son avis sur les projets mentionnés aux 4°, 5° et 10° du présent II. » ;
1° bis et 1° ter
Supprimés
1° quater
2° L’article L. 313-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « ans », sont insérés les mots : «, prorogeable dans la limite d’une sixième année » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces contrats impliquent un ou plusieurs établissements ou services mentionnés aux 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1, sans qu’ils relèvent du IV ter de l’article L. 313-12 ou de l’article L. 313-12-2, et que lesdits contrats fixent les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services, le cadre budgétaire appliqué est l’état des prévisions de recettes et de dépenses, dont le modèle est fixé par l’arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales prévu à la deuxième phrase de l’article L. 314-7-1, à la demande du gestionnaire et sous réserve de l’accord de l’autorité de tarification compétente. »
I bis. – Après l’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 314 -7 -2. – Lorsque l’état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l’article L. 314-7-1 s’applique à un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313-11, l’élaboration et la présentation de ce document budgétaire peut, sous réserve de l’accord des parties, être réalisée par anticipation au titre de l’exercice budgétaire qui précède l’entrée en vigueur du contrat. Dans ce cas, le gestionnaire élabore le budget des établissements et services concernés, dans le délai mentionné à l’article L. 315-15, à partir des dernières notifications budgétaires effectuées par l’autorité de tarification compétente. Les recettes prévues par le gestionnaire peuvent comprendre une actualisation des moyens qui n’engage pas cette autorité. Les règles budgétaires liées à l’état des prévisions de recettes et de dépenses s’appliquent dès cet exercice. À la clôture de celui-ci, le gestionnaire affecte les résultats comptables conformément aux dispositions du contrat.
« À défaut de conclusion du contrat mentionné à l’article L. 313-11 au plus tard dans les douze mois qui suivent l’acceptation par l’autorité chargée de la tarification de la présentation de l’état des prévisions de recettes et de dépenses, les règles budgétaires prévues au présent article ne sont plus applicables. »
II. – Le livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1321-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « peut n’instaurer qu’un » sont remplacés par les mots : « instaure un simple » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les captages d’eau d’origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 mètres cubes par jour font également l’objet d’un simple périmètre de protection immédiate établi selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Lorsque les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue des points de prélèvement mentionnés au troisième alinéa du présent article ne satisfont pas aux critères de qualité fixés par l’arrêté mentionné au même troisième alinéa, établissant un risque avéré de dégradation de la qualité de l’eau, un périmètre de protection rapprochée et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée, mentionnés au premier alinéa, sont adjoints au périmètre de protection immédiate. » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Après l’article L. 1321-2-1, il est inséré un article L. 1321-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321 -2 -2. – Par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, lorsqu’une modification mineure d’un ou de plusieurs périmètres de protection ou de servitudes afférentes mentionnés à l’article L. 1321-2 du présent code est nécessaire, l’enquête publique est conduite selon une procédure simplifiée, définie par décret en Conseil d’État et adaptée selon le type de modification. Cette procédure simplifiée ne s’applique pas lorsque la modification étend le périmètre de protection immédiate.
« Lorsque la modification n’intéresse qu’une ou certaines des communes incluses dans le ou les périmètres de protection, la mise à disposition du public du dossier de l’enquête publique peut, par dérogation aux dispositions du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, être organisée uniquement sur le territoire de la ou des communes concernées. » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 1332-8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont déterminées par décret les modalités d’application du présent chapitre :
« 1° Relatives aux différents types de piscine, notamment les règles sanitaires, de conception et d’hygiène qui leur sont applicables ainsi que les modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire organisé par le directeur général de l’agence régionale de santé et les conditions dans lesquelles la personne responsable d’une piscine assure la surveillance de la qualité de l’eau, informe le public et tient à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire les informations nécessaires à ce contrôle ;
« 2° Relatives aux baignades artificielles, notamment les règles sanitaires, de conception et d’hygiène auxquelles elles doivent satisfaire. »
II bis. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 212-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « motivant, », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « à condition que l’état de la masse d’eau concernée ne se détériore pas davantage. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai. » ;
2° Après l’article L. 652-3, il est inséré un article L. 652-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 652 -3 -1. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 212-1, à la fin de la première phrase du V, l’année : “2015” est remplacée par l’année : “2021”. »
II ter. – L’article L. 1432-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » et, à la seconde phrase, les mots : «, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – dans le domaine de l’organisation territoriale des soins. Les membres de cette commission ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés au fonctionnement de cette commission ne peuvent être pris en charge par une personne publique. » ;
2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut décider de fusionner, sous réserve de l’avis conforme d’une majorité qualifiée de leurs membres, les trois commissions mentionnées au 2° ou deux de ces commissions, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. »
III. – La première phrase du I de l’article L. 5141-14-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les titulaires d’autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires mentionnée à l’article L. 5141-5 ainsi que les entreprises assurant la fabrication, l’importation et la distribution d’aliments médicamenteux déclarent à l’autorité administrative compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu’ils cèdent ou qui sont cédés pour leur compte sur le territoire national. »
III bis. – Le premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. »
IV. – Le III de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, ne s’applique pas aux projets pour lesquels une procédure d’appel à projets mentionnée au I du même article L. 313-1-1 est engagée à la date de publication de la présente loi.
V. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant des a et b du 1° du II du présent article, ne s’appliquent pas aux captages d’eau pour lesquels un arrêté d’ouverture d’une enquête publique relative à l’instauration d’un périmètre de protection a été publié à la date de publication de la présente loi.
VI. – Au 14° du IV de l’article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les références : « 5° et 6° de l’article L. 142-2 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, », et les références : « 8° et 9° de l’article L. 142-1 » sont remplacées par les références : « aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 ».
VII. – Le I bis entre en vigueur le 1er octobre 2019.
VIII. –
Supprimé
IX. – L’article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2021 » ;
2° Au dernier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
L’article L. 4412-1 du code de la santé publique est abrogé.
Chapitre II
Mesures de sécurisation
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de simplifier les règles applicables aux agences régionales de santé et de rationaliser l’exercice de leurs missions, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :
1° Alléger les procédures, les formalités et les modalités selon lesquelles les agences régionales de santé exercent leurs compétences ;
2° Adapter l’organisation et le fonctionnement des agences régionales de santé, en particulier par des mutualisations de leurs actions, pour les rendre plus efficientes et pour prendre en compte des caractéristiques et contraintes particulières à certains territoires.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de l’exercice coordonné au sein des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de soins primaires, des centres de santé et des maisons de santé mentionnés respectivement aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique en adaptant leurs objets, leurs statuts et leurs régimes fiscaux respectifs ou en créant de nouveaux cadres juridiques pour :
1° Faciliter leur création, l’exercice de leurs missions, leur organisation et leur fonctionnement ;
2° Permettre le versement d’indemnités, de rémunérations ou d’intéressements, collectifs ou individuels, aux personnes physiques et morales qui en sont membres ;
3° Rendre possible le versement par l’assurance maladie à la maison de santé de tout ou partie de la rémunération résultant de l’activité de ses membres ;
4° Prévoir les conditions d’emploi et de rémunération par la structure de professionnels participant à ses missions ainsi que des personnels intervenant auprès de médecins pour les assister dans leur pratique quotidienne.
III. – Au 1er janvier 2020 :
1° Il est créé une agence régionale de santé de La Réunion, exerçant à La Réunion les compétences dévolues aux agences régionales de santé ;
2° Il est créé une agence régionale de santé de Mayotte, exerçant à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.
III bis. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« La Réunion
« Art. L. 1443 -1. – I. – Pour l’application du présent code à La Réunion, la mention de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de La Réunion se substitue à la mention du conseil territorial de santé.
« II. – La conférence régionale de la santé et de l’autonomie de La Réunion exerce, à La Réunion, les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l’article L. 1434-10.
« II bis. – Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l’article L. 1434-9 sont définis par l’agence régionale de santé de La Réunion à l’échelle de la collectivité de manière à couvrir l’intégralité du territoire.
« III. – Le premier alinéa ainsi que les première et troisième phrases du second alinéa du I de l’article L. 1434-10 ne sont pas applicables à La Réunion. Un décret en Conseil d’État détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres. » ;
2° Le chapitre VI du même titre IV devient le chapitre VII et l’article L. 1446-1 devient l’article L. 1447-1 ;
3° Le chapitre VI du même titre IV est ainsi rétabli :
« CHAPITRE VI
« Mayotte
« Art. L. 1446 -1. – I. – Pour l’application des dispositions du présent code à Mayotte, la mention de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie de Mayotte se substitue à la mention du conseil territorial de santé.
« II. – La conférence régionale de la santé et de l’autonomie de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues au conseil territorial de santé prévu à l’article L. 1434-10. Elle peut ne comprendre aucune commission spécialisée.
« III. – Est placée auprès de l’agence régionale de santé de Mayotte une commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte, associant les services de l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale.
« IV. – La commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques de santé mentionnées à l’article L. 1432-1.
« V. – Pour l’application des dispositions du présent code à Mayotte, la mention de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé.
« VI. – Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l’article L. 1434-9 sont définis par l’agence régionale de santé de Mayotte à l’échelle de la collectivité de manière à couvrir l’intégralité du territoire.
« VII. – Le premier alinéa ainsi que les première et troisième phrases du second alinéa du I de l’article L. 1434-10 ne sont pas applicables à Mayotte. Un décret en Conseil d’État détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, les modalités de son fonctionnement et de désignation de ses membres.
« Art. L. 1446 -2. – Pour leur application à Mayotte, les articles suivants sont ainsi adaptés :
« 1° À la première phrase du g du 2° de l’article L. 1431-2, après le mot : “maladie”, sont insérés les mots : “, avec la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;
« 2° La première phrase du 2° du I de l’article L. 1432-3 est complétée par les mots : “ainsi que des membres du conseil d’administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;
« 3° Le 4° de l’article L. 1432-9 est ainsi rédigé :
« “4° Des agents de droit privé régis par les conventions collectives ou les accords collectifs applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.”
« Art. L. 1446 -3. – La stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411-1-1 déclinée à Mayotte inclut un volet relatif à la mise en place progressive de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. » ;
4° Aux deuxième, troisième et dernier alinéas de l’article L. 5511-2-1 ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6416-5, les mots : « de santé de l’océan Indien » sont remplacés par les mots : « régionale de santé de Mayotte » ;
5° L’article L. 5511-5 est abrogé.
III ter. – Le titre IV du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 2° du III de l’article L. 543-1 est abrogé ;
2° L’article L. 545-1 est abrogé ;
3° Les 5° et 6° de l’article L. 545-3 sont abrogés.
III quater. – Les III bis et III ter entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
III quinquies. – Au 1er janvier 2020 :
1° Les agents contractuels de droit public de l’agence de santé de l’océan Indien exerçant, au 31 décembre 2019, leurs fonctions sur l’île de Mayotte sont rattachés à l’agence régionale de santé de Mayotte ; par dérogation au premier alinéa de l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le contrat dont ils sont titulaires est transféré pour la durée du contrat restant à courir ;
2° Les salariés de l’agence de santé de l’océan Indien mentionnés au 4° de l’article L. 1432-9 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les agents titulaires d’un contrat de droit privé ainsi que les volontaires du service civique exerçant, au 31 décembre 2019, leurs fonctions sur l’île de Mayotte sont rattachés à l’agence régionale de santé de Mayotte ; par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, ils conservent, à titre individuel, le bénéfice de toutes les stipulations de leur contrat de travail ;
3° Les agents contractuels de droit public de l’agence de santé de l’océan Indien exerçant, au 31 décembre 2019, leurs fonctions sur l’île de La Réunion sont rattachés à l’agence régionale de santé de La Réunion ; par dérogation au premier alinéa de l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, le contrat dont ils sont titulaires est transféré pour la durée restant à courir ;
4° Les salariés de l’agence de santé de l’océan Indien mentionnés au 4° de l’article L. 1432-9 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les agents titulaires d’un contrat de droit privé ainsi que les volontaires du service civique exerçant, au 31 décembre 2019, leurs fonctions sur l’île de La Réunion sont rattachés à l’agence régionale de santé de La Réunion ; par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, ils conservent, à titre individuel, le bénéfice de toutes les stipulations de leur contrat de travail ;
5° Les conventions et les accords collectifs conclus pour les agents de droit privé au sein de l’agence de santé de l’océan Indien antérieurement à la date du 1er janvier 2020 restent applicables à l’agence régionale de santé de La Réunion et à l’agence régionale de santé de Mayotte sous réserve de la mise en œuvre des dispositions des sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail.
III sexies. – Au 1er janvier 2020, il est mis fin aux mandats en cours au 31 décembre 2019 des membres de la délégation du personnel au comité d’agence, des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des délégués du personnel de l’agence de santé de l’océan Indien.
Jusqu’à l’élection des représentants du personnel au comité d’agence de l’agence régionale de santé de La Réunion et de l’agence régionale de santé de Mayotte et pour la période s’écoulant jusqu’à cette échéance, chaque organisation syndicale remplissant les conditions prévues soit par l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, soit par les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122-9 et L. 2142-1 du code du travail peut désigner un représentant, interlocuteur du directeur général de l’agence. Ces conditions s’apprécient par collège.
Jusqu’à l’élection des représentants du personnel au comité d’agence de l’agence régionale de santé de La Réunion et des représentants du personnel au comité d’agence de l’agence régionale de santé de Mayotte, et au plus tard jusqu’au 16 juin 2020, le directeur général exerce son pouvoir de direction dans les domaines pour lesquels le comité d’agence est compétent, ainsi que ses obligations en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, après concertation avec les représentants des organisations syndicales mentionnés ci-dessus qu’il réunit à cet effet.
Le directeur général de l’agence gère, dans les mêmes conditions, les activités sociales et culturelles ainsi que le patrimoine dévolu au comité d’agence.
Les représentants des organisations syndicales peuvent présenter au directeur général de l’agence les réclamations individuelles et collectives des personnels.
III septies. – Le patrimoine dévolu, en application de l’article L. 1432-11 du code de la santé publique, au comité d’agence de l’océan Indien fonctionnant à la date du 31 décembre 2019 est réparti avant cette date, par le comité d’agence de l’agence de santé de l’océan Indien, entre le comité d’agence de l’agence régionale de santé de La Réunion et le comité d’agence de l’agence régionale de santé de Mayotte.
À la date de désignation des membres du comité d’agence de l’agence régionale de santé de Mayotte et de l’agence régionale de santé de La Réunion et au plus tard le 16 juin 2020, les nouveaux comités d’agence sont substitués au comité d’agence de l’agence de santé de l’océan Indien dans tous leurs droits et obligations.
III octies. – Les articles L. 1432-2, L. 1432-3, L. 1435-8 et L. 1435-10 du code de la santé publique sont applicables à Mayotte et à La Réunion, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour 2020, les budgets initiaux de l’agence régionale de santé de Mayotte et de l’agence régionale de santé de La Réunion, ainsi que leurs budgets annexes initiaux prévus au second alinéa de l’article L. 1432-5 du code de la santé publique, sont arrêtés par décision des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Le directeur général de chacune des deux nouvelles agences régionales de santé peut les exécuter sans approbation de ces documents par leur conseil de surveillance respectif. Dans les six mois suivant la date de création de l’agence régionale de santé de Mayotte et de l’agence régionale de santé de La Réunion, le directeur général prépare et soumet à l’approbation du conseil de surveillance de l’agence un budget rectificatif et un budget annexe rectificatif ;
2° Les comptes financiers des budgets mentionnés à l’article L. 1432-5 du code de la santé publique de l’agence de santé de l’océan Indien pour 2019 sont établis par l’agent comptable en fonction lors de la dissolution de l’agence. Ils sont arrêtés et approuvés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé ;
3° Les crédits de l’agence de santé de l’océan Indien reportés en 2020 en application de l’article L. 1435-10 du code de la santé publique, dans la limite du plafond fixé au même article L. 1435-10, sont ventilés entre l’agence régionale de santé de Mayotte et l’agence régionale de santé de La Réunion, selon une répartition arrêtée par décision des ministres chargés des affaires sociales et de la santé ;
4° L’information prévue audit article L. 1435-10 sur l’exécution relative à l’exercice 2019 des budgets de l’agence de santé de l’océan Indien est transmise en 2020 par l’agence régionale de santé de Mayotte et par l’agence régionale de santé de La Réunion sur les actions relevant de leurs territoires respectifs.
III nonies. – Les biens, droits et obligations de l’agence de santé de l’océan Indien sont transférés à l’agence régionale de santé de Mayotte et à l’agence régionale de santé de La Réunion selon une répartition déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et des comptes publics. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, impôt, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
III decies. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 20-3 et à l’article 20-5-6 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « l’exception de son deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « L. 162-5-2, L. 162-5-3 à l’exception des cinq derniers alinéas, L. 162-5-4 ».
IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier, en tant que de besoin, les codes et les lois pour les mettre en cohérence avec les dispositions de la présente loi et des ordonnances prises pour son application. Ces ordonnances sont prises à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
V. – À compter de la publication de la présente loi, les ordonnances prévues aux I, II et IV sont publiées dans un délai :
1° De douze mois pour celle prévue au I ;
2° De dix-huit mois pour celle prévue au II ;
3°
Supprimé
4° De vingt-quatre mois pour celle prévue au IV.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
(Supprimés)
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie est ainsi rédigé :
« CHAPITRE UNIQUE
« Protocoles de coopération
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 4011 -1. – Par dérogation aux articles L. 1132-1, L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4221-1, L. 4241-1, L. 4241-13, L. 4251-1, L. 4301-1, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4322-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4352-2, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4364-1, L. 4371-1, L. 4391-1, L. 4392-1, L. 4393-8, L. 4394-1 et L. 6316-1, les professionnels de santé travaillant en équipe peuvent s’engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération pour mieux répondre aux besoins des patients. Par des protocoles de coopération, ils opèrent entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de prévention ou réorganisent leurs modes d’intervention auprès du patient.
« Les protocoles de coopération précisent les formations nécessaires à leur mise en œuvre.
« Le patient est informé des conditions de sa prise en charge dans le cadre d’un protocole de coopération.
« Art. L. 4011 -2. – Les protocoles de coopération sont rédigés par les professionnels de santé. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé définit les exigences essentielles de qualité et de sécurité des protocoles de coopération. Les protocoles précisent les dispositions d’organisation spécifiques auxquelles est subordonnée leur mise en œuvre.
« Section 2
« Protocoles nationaux
« Art. L. 4011 -3. – I. – Un comité national des coopérations interprofessionnelles est chargé de la stratégie, de la promotion et du déploiement des coopérations interprofessionnelles. Il propose la liste des protocoles nationaux à élaborer et à déployer sur l’ensemble du territoire, appuie les professionnels de santé dans l’élaboration de ces protocoles et de leur modèle économique et émet un avis sur leur financement par l’assurance maladie. Il assure le suivi annuel et l’évaluation des protocoles autorisés. À cette fin, lui sont transmises annuellement les données pertinentes pour chacun des protocoles mis en œuvre.
« Le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer l’intégration des actes dérogatoires dans les compétences réglementaires des professionnels. Il propose leurs modalités de financement et de rémunération définitives par leur inscription sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
« Le comité est composé, selon des modalités précisées par décret, de représentants de l’Union nationale des caisses de l’assurance maladie, de la Haute Autorité de santé, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ainsi que des agences régionales de santé. Les conseils nationaux professionnels et les ordres des professions concernées sont associés aux travaux de ce comité.
« II. – Le financement peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
« 1° Aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1, en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ;
« 2° Aux 1°, 2°, 5° et 6° de l’article L. 160-8, en tant qu’ils concernent les frais couverts par l’assurance maladie ;
« 3° À l’article L. 162-2, en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
« 4° Aux articles L. 160-13 et L. 160-14, relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
« Les dépenses mises à la charge de l’ensemble des régimes obligatoires de base d’assurance maladie qui résultent du financement des protocoles nationaux sont prises en compte dans l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
« III. – Le protocole national et son modèle économique sont rédigés par une équipe de rédaction, sélectionnée dans le cadre d’un appel national à manifestation d’intérêt, avec l’appui des conseils nationaux professionnels et des ordres des professions concernées. Le protocole national est autorisé sur l’ensemble du territoire national par arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé qui se prononce sur sa compatibilité avec le décret mentionné à l’article L. 4011-2. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge.
« IV. – Les structures d’emploi ou d’exercice des professionnels souhaitant mettre en œuvre un protocole national déclarent, le cas échéant conjointement, à l’agence régionale de santé compétente sa mise en œuvre sous leur responsabilité. L’agence peut suspendre la mise en œuvre de ce protocole dans une ou plusieurs structures pour des motifs liés à la qualité et à la sécurité des prises en charge et en cas de non-respect des dispositions du même protocole.
« V. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
« Section 3
« Protocoles expérimentaux locaux
« Art. L. 4011 -4. – Des professionnels de santé travaillant en équipe peuvent, à leur initiative, élaborer un protocole autre qu’un protocole national et qui propose une organisation innovante. Ce protocole est instruit, autorisé, suivi et évalué dans le cadre de la procédure des expérimentations à dimension régionale mentionnées au III de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale. Le protocole n’est valable que pour l’équipe promotrice, dont les professionnels de santé sont tenus de se faire enregistrer sans frais auprès de l’agence régionale de santé.
« Section 4
« Dispositions applicables au service de santé des armées
« Art. L. 4011 -5. – I. – Le présent chapitre s’applique au service de santé des armées dans les conditions suivantes :
« 1° Le ministre de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre pour l’ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national des protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011-3 ;
« 2° Le ministre de la défense peut également autoriser, par arrêté, la mise en œuvre pour l’ensemble du service de santé des armées et sur tout le territoire national de protocoles de coopération soumis au préalable à l’avis de la Haute Autorité de santé, qui se prononce sur leur compatibilité au décret mentionné à l’article L. 4011-2.
« II. – Sont déterminées par décret les modalités selon lesquelles :
« 1° Les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées peuvent être autorisés à adhérer aux protocoles mentionnés à l’article L. 4011-3 ;
« 2° Est réalisé le suivi des protocoles prévus aux 1° et 2° du I du présent article ;
« 3° Des professionnels de santé du service de santé des armées travaillant en équipe peuvent élaborer un protocole local expérimental prévu à l’article L. 4011-4. » ;
2° Le 5° de l’article L. 6323-1-1 est ainsi rédigé :
« 5° Soumettre et mettre en œuvre des protocoles définis aux articles L. 4011-1 et L. 4011-2 dans les conditions définies aux articles L. 4011-3 et L. 4011-4 ; »
3° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4113-5, la référence : « L. 4011-3 » est remplacée par la référence : « L. 4011-4 » ;
4° L’article L. 4444-1 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, la référence : « L. 4011-4 » est remplacée par la référence : « L. 4011-5 » ;
b) Après les mots : « résultant de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ».
II. – Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-37 est ainsi modifié :
a) Au 9°, la référence : « au avant-dernier alinéa de l’article L. 4011-2 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 4011-3 » ;
b) Après la première occurrence du mot : « au », la fin du 10° est ainsi rédigée : « deuxième alinéa du I du même article L. 4011-3 ; »
2° Le 2° du II de l’article L. 162-31-1 est complété par un k ainsi rédigé :
« k) Les règles de compétences prévues aux articles L. 1132-1, L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4221-1, L. 4241-1, L. 4241-13, L. 4251-1, L. 4301-1, L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4322-1, L. 4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4352-2, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4364-1, L. 4371-1, L. 4391-1, L. 4392-1, L. 4393-8, L. 4394-1 et L. 6316-1 ; »
3° Le premier alinéa du IV du même article L. 162-31-1 est supprimé ;
4° L’article L. 162-1-7-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « I de l’article L. 4011-2-3 » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du I de l’article L. 4011-3 » ;
b) Au 4°, les mots : « recueilli un avis favorable du collège des financeurs en application du III de l’article L. 4011-2-3 » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une proposition par le comité national des coopérations interprofessionnelles telle que mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 4011-3 » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 162-1-7-4, les mots : « d’un avis favorable du collège des financeurs, prévu à l’article L. 4011-2-3 » sont remplacés par les mots : « d’une proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 4011-3 ».
III. – A. – Les structures d’emploi ou d’exercice des professionnels souhaitant mettre en œuvre un protocole autorisé avant l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent y adhérer selon les dispositions applicables antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article jusqu’à la date de publication du décret prévu à l’article L. 4011-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les projets de protocoles déposés avant l’entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du présent A et ayant vocation à être déployés nationalement sont autorisés par arrêté après avis conforme de la Haute Autorité de santé.
Les projets de protocoles déposés avant l’entrée en vigueur du même décret et n’ayant pas vocation à être déployés nationalement sont instruits et autorisés selon la procédure applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article.
B. – Sont déterminées par décret les modalités selon lesquelles :
1° Les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent être autorisés à adhérer aux protocoles autorisés ou déposés avant l’entrée en vigueur du décret mentionné au A du présent III ;
2° Le ministre chargé de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre, pour l’ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national, des protocoles de coopération autorisés ou déposés avant l’entrée en vigueur du même décret.
Au dernier alinéa de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, après le mot : « malades, », sont insérés les mots : « ni aux détenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l’activité d’assistant médical, ».
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « doté », la fin du premier alinéa de l’article L. 3131-7 est ainsi rédigée : « d’un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles. Ce plan lui permet de mobiliser les moyens de réponse adaptés à la nature et à l’ampleur de l’événement et d’assurer aux patients une prise en charge optimale. » ;
2° L’article L. 3131-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « justifie », sont insérés les mots : «, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé » ;
b) Après le mot : « médico-social », la fin de la même première phrase est supprimée ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
3° L’article L. 3131-9 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
4° L’article L. 3131-9-1 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de situation sanitaire exceptionnelle ou pour tout événement de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment les accidents collectifs, les informations…
le reste sans changement
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la crise » sont remplacés par les mots : « l’événement » ;
5° Après l’article L. 3131-10, il est inséré un article L. 3131-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3131 -10 -1. – I. – En cas de situation sanitaire exceptionnelle dont les conséquences dépassent les capacités de prise en charge d’une ou de plusieurs structures de soins de la région, le directeur général de l’agence régionale de santé concernée peut faire appel aux professionnels de santé de la région volontaires pour porter appui à ces structures de soins.
« II. – Lorsque les conséquences de la situation mentionnée au I dépassent les capacités de prise en charge d’une région, le directeur général de l’agence régionale de santé de zone ou le ministre chargé de la santé peuvent solliciter auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé des autres régions des ressources sanitaires complémentaires.
« Ces derniers identifient les professionnels de santé volontaires pour porter appui aux structures de soins de la région concernée.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé concernée par la situation affecte, au sein de la région, les professionnels de santé volontaires en fonction des besoins.
« III. – Les professionnels de santé qui exercent leur activité dans le cadre des I et II bénéficient des dispositions de l’article L. 3133-6.
« IV. – Les I, II et III du présent article ne s’appliquent pas aux professionnels du service de santé des armées. » ;
6° L’article L. 3131-11 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « et les modalités d’élaboration » sont remplacés par les mots : « ainsi que les modalités d’élaboration et de déclenchement » ;
b) Après les mots : « d’élaboration », la fin du b est ainsi rédigée : « des plans détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles par les établissements de santé et par les établissements et services médico-sociaux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles ; »
c) Au c, après la seconde occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « santé de » et, à la fin, les mots : « mentionnés à l’article L. 3131-9 » sont remplacés par les mots : « chargés d’une mission de conseil et de prise en charge spécifique en cas de situation sanitaire exceptionnelle » ;
d) Sont ajoutés des d et e ainsi rédigés :
« d) Les modalités selon lesquelles des professionnels de santé peuvent être appelés à exercer leur activité en application de l’article L. 3131-10-1 ;
« e) Le contenu et les procédures d’élaboration du plan zonal de mobilisation. »
II. – Les articles L. 3134-2-1 et L. 4211-5-1 du code de la santé publique sont abrogés.
II bis. – Au II de l’article L. 3134-1 du code de la santé publique, les mots : «, à l’exclusion des professionnels de santé en activité, » sont supprimés.
III. – L’article L. 3135-4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 3135 -4. – Par dérogation au 4° de l’article L. 4211-1, en cas d’accident nucléaire ou d’acte terroriste constituant une menace sanitaire grave nécessitant leur délivrance ou leur distribution en urgence, les produits de santé issus des stocks de l’État et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peuvent être délivrés ou distribués lorsqu’aucun pharmacien n’est présent, sous la responsabilité du représentant de l’État dans le département, par d’autres professionnels de santé que les pharmaciens et, à défaut, par les personnes mentionnées à l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ou par les personnels des services de l’État ou des collectivités territoriales désignés dans des conditions fixées par décret.
« Par dérogation aux articles L. 4211-1 et L. 5126-1 du présent code, ces produits de santé peuvent être stockés, selon des modalités définies par décret, en dehors des officines et des pharmacies à usage intérieur, afin de permettre leur délivrance ou leur distribution en urgence dans les cas prévus au premier alinéa du présent article. »
IV. – L’article L. 3821-11 du code de la santé publique est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ».
V. – Au 16° de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, les mots : « blanc de l’établissement » sont remplacés par les mots : « détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles, ».
VI. – L’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales fixe la liste des catégories d’établissements et services médico-sociaux devant intégrer dans leur projet d’établissement un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d’événement entraînant une perturbation de l’organisation des soins, notamment de situation sanitaire exceptionnelle. »
I. – Le 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le mot : « contractuels » est supprimé ;
2° Sont ajoutés les mots : «, dont le statut est établi par voie réglementaire ».
II. – L’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Les personnes ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique.
« A. – Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les médecins et les chirurgiens-dentistes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 décembre 2018 et recrutés avant le 3 août 2010, dans des conditions fixées par décret, dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu’au 31 décembre 2020.
« B. – Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée et au huitième alinéa du I de l’article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée, les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 1er octobre 2020.
« La commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin. L’instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l’agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2021.
« La commission régionale mentionnée au deuxième alinéa du présent B peut auditionner tout candidat relevant de la spécialité concernée. Elle formule, après examen du dossier, une proposition à la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente. Cette proposition consiste :
« 1° Soit à délivrer une autorisation d’exercice ;
« 2° Soit à rejeter la demande du candidat ;
« 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique.
« La commission régionale de spécialité transmet le dossier de chaque candidat, accompagné de sa proposition, à la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente.
« La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé.
« Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de sa demande.
« Elle peut auditionner les autres candidats.
« Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale :
« a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ;
« b) Soit rejeter la demande du candidat ;
« c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. À l’issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.
« L’attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent B prend fin :
« – lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d’exercice ;
« – à la date de prise d’effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ;
« – en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ;
« – en cas de rejet de la demande du candidat ;
« – et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021. » ;
2° Sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :
« V. – Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique entre le 1er octobre 2018 et le 31 janvier 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt avant le 1er octobre 2020 d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de la commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, ou à l’article L. 4221-12 du même code, pour les pharmaciens.
« La commission nationale d’autorisation d’exercice émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé sur la demande d’autorisation d’exercice des candidats.
« Cet avis consiste :
« 1° Soit à délivrer une autorisation d’exercice ;
« 2° Soit à rejeter la demande du candidat ;
« 3° Soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences, d’une durée maximale équivalente à celle de la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens et d’une durée maximale d’un an pour les sages-femmes. Ce parcours peut comprendre de la formation pratique et théorique.
« La commission nationale doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l’obtention directe d’une autorisation d’exercice ou au rejet de son dossier.
« Elle peut auditionner les autres candidats.
« Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut alors :
« a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ;
« b) Soit rejeter la demande du candidat ;
« c) Soit prendre une décision d’affectation du candidat dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à la maquette de la formation suivie pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens et d’une durée maximale d’un an pour les sages-femmes. À l’issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier.
« L’attestation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du présent V prend fin :
« – lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d’exercice ;
« – à la date de prise d’effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ;
« – en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ;
« – en cas de rejet de la demande du candidat ;
« – et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2021.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre des IV et V du présent article, notamment :
« 1° Les délais, conditions, composition et modalités de dépôt des dossiers de demande d’autorisation d’exercice ;
« 2° La composition et le fonctionnement des commissions régionales constituées par spécialité chargées de l’instruction préalable des dossiers ;
« 3° Les modalités d’affectation des candidats en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences arrêté par le ministre chargé de la santé ainsi que les modalités de réalisation de ce parcours ;
« 4°
Supprimé
III. – L’autorité administrative se prononce au plus tard le 31 décembre 2021 sur les demandes d’autorisation d’exercice mentionnées aux IV et V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
IV. – L’article L. 4111-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;
– après le mot : « exercice », sont insérés les mots : «, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, » ;
– après le mot : « médecin », sont insérés les mots : «, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, » ;
– après le mot : « chirurgien-dentiste », sont insérés les mots : «, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, » ;
– après la deuxième occurrence du mot : « ou », il est inséré le mot : « de » ;
– à la fin, les mots : « dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : «, discipline ou » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, par » ;
– à la dernière phrase, les mots : « pour chaque discipline ou » sont remplacés par les mots : «, le cas échéant, pour chaque » ;
– à la même dernière phrase, les mots : « conformément aux dispositions du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « en application du deuxième alinéa du I » ;
b bis) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent I titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
d) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les lauréats candidats à la profession de chirurgien-dentiste doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences d’une année, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé maître de stage. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
d bis) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les lauréats candidats à la profession de sage-femme doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation des compétences d’une année, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans un établissement de santé. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé au deuxième alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
– sont ajoutés les mots : « telles que prévues au présent article » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du I bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion, ».
V. – L’article L. 4221-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;
b) Après le mot : « spécialité », sont insérés les mots : « correspondant à la demande d’autorisation, » ;
c) Sont ajoutés les mots : «, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « qui peuvent être organisées » sont remplacés par les mots : « organisées le cas échéant » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « en tenant compte notamment de l’évolution du nombre d’étudiants déterminé en application de l’article L. 633-3 du code de l’éducation » ;
2° bis Au quatrième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
2° ter Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au quatrième alinéa titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les lauréats candidats à la profession de pharmacien doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Sont ajoutés les mots : « telles que prévues par le présent article ».
V bis. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa de l’article L. 4111-1-2, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, par le directeur général du Centre national de gestion » ;
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 4131-4 est supprimé ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4111-4, après la seconde occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, sur délégation, par le directeur général du Centre national de gestion » ;
3° Au début du premier alinéa ainsi qu’aux deuxième et troisième alinéas des articles L. 4131-1-1 et L. 4141-3-1, au début de la première phrase et à la seconde phrase du premier alinéa ainsi qu’au deuxième alinéa des articles L. 4151-5-1 et L. 4221-14-1, au début de la première phrase et à la dernière phrase du premier alinéa ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 4221-14-2 et au début de l’article L. 4221-9, les mots : « l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;
4° Au premier alinéa des articles L. 4111-3 et L. 4221-1-1, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou, par délégation, le directeur général du Centre national de gestion » ;
5° Au 3° de l’article L. 6213-2, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou par délégation, du directeur général du Centre national de gestion ».
V ter. – L’article L. 5221-2-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5221 -2 -1. – Par dérogation à l’article L. 5221-2, n’est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221-2 :
« 1° L’étranger qui entre en France afin d’y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur une liste fixée par décret ;
« 2° Le praticien étranger titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d’affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, ainsi que, à titre transitoire, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens mentionnés à l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, sur présentation de la décision du ministre chargé de la santé d’affectation dans un établissement de santé prévue au même article 83. »
VI. – A. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
B. – Les dispositions du 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2021.
C. – Les dispositions du I de l’article L. 4111-2 et de l’article L. 4221-12 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des IV et V du présent article, demeurent applicables pour les lauréats des épreuves de vérification des connaissances antérieures à 2020 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.
I. – La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L’article L. 4131-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4131 -5. – Par dérogation à l’article L. 4111-1 et jusqu’au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ainsi que le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4111-1 ou titulaire d’un diplôme de médecine, d’odontologie ou de maïeutique, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d’une commission territoriale d’autorisation d’exercice, constituée, par profession et, le cas échéant, par spécialité.
« Une commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée :
« 1° Pour la Guyane et la Martinique ;
« 2° Pour la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis, par collectivité, profession et le cas échéant, par spécialité, établi sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment :
« a) Les modalités d’établissement de l’arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ;
« b) La composition et le fonctionnement des commissions territoriales constituées par profession et, le cas échéant, par spécialité ;
« c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer ;
« d) Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. » ;
2° Après l’article L. 4221-14-2, il est inséré un article L. 4221-14-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221 -14 -3. – Par dérogation à l’article L. 4221-1 et jusqu’au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ainsi que le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser un pharmacien ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° du même article L. 4221-1 ou titulaire d’un diplôme de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d’une commission territoriale d’autorisation d’exercice.
« Une commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée :
« 1° Pour la Guyane et la Martinique ;
« 2° Pour la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis, par collectivité, établi sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment :
« a) Les modalités d’établissement de l’arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ;
« b) La composition et le fonctionnement des commissions territoriales ;
« c) Les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer ;
« d) Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »
II. – L’article L. 4131-5 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi. Jusqu’à cette date, les dispositions du même article L. 4131-5 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables.
Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le d du 2° de l’article L. 4311-3 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « Lituanie », sont insérés les mots : «, de la Croatie » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « soviétique, », sont insérés les mots : « de la Croatie ou » ;
2° Le 2° de l’article L. 4362-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ni la formation, ni » sont remplacés par le mot : « pas » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette condition d’un an d’exercice professionnel n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée ; » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 4362-7 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou la formation conduisant à » sont remplacés par le mot : « de » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette condition d’un an d’exercice professionnel n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée. »
TITRE V
RATIFICATIONS ET MODIFICATIONS D’ORDONNANCES
I. – L’ordonnance n° 2017-84 du 26 janvier 2017 relative à la Haute Autorité de santé est ratifiée.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 15° de l’article L. 161-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité de santé peut participer à des activités de coopération internationale se rapportant à ses missions. Dans ce cadre, elle peut notamment fournir des prestations de conseil et d’expertise par le biais de conventions et percevoir des recettes. » ;
2° L’article L. 161-42 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Quatre membres désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une personnalité justifiant d’une expérience dans les secteurs médico-social et social ; »
c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Parmi les sept membres mentionnés aux 2° à 5° sont désignés au moins trois femmes et trois hommes. Les quatre membres désignés au titre du 2° sont deux hommes et deux femmes. » ;
d) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » et la référence : « 2° » est supprimée.
III. – L’ordonnance n° 2017-1179 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est ratifiée.
IV. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 1528-1 est complété par les mots : « sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre » ;
2° Le chapitre VIII du titre II du livre V de la première partie est complété par un article L. 1528-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1528 -2. – Pour l’application de l’article L. 1172-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : “d’une affection de longue durée” sont remplacés par les mots : “de maladies chroniques” et le dernier alinéa est supprimé. » ;
2° bis Le 2° du I de l’article L. 1541-2 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« “I. – Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social, a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.” » ;
b) Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Au dernier alinéa du V, les mots : “aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 1111-5” ; »
2° ter L’article L. 1541-3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 1111-2 et L. 1111-8 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 1111-2 est applicable » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa » ;
– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 1111-8 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l’hébergement de données de santé à caractère personnel. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° À l’article L. 1111-2 :
« a) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : “des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 1111-5” ;
« b) Le sixième alinéa n’est pas applicable ; »
– le c du 4° est ainsi rédigé :
« c) Au cinquième alinéa, les mots : “aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1” sont remplacés par les mots : “à l’article L. 1111-5” et les quatrième et septième alinéas ne sont pas applicables ; »
– le 5° est ainsi rédigé :
« 5° À l’article L. 1111-8 :
« a) Au premier alinéa du I, les mots : “prévues au présent article” sont remplacés par les mots : “prévues par la réglementation applicable localement” ;
« b) Les II, III, IV et VI ne sont pas applicables ; »
2° quater Au second alinéa de l’article L. 1542-5, le mot : « à » est supprimé ;
3° L’article L. 2445-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2445 -1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dispositions suivantes du titre Ier du livre II de la présente partie :
« 1° Le chapitre Ier ;
« 2° L’article L. 2212-1, le premier alinéa des articles L. 2212-2 et L. 2212-3, les articles L. 2212-5 à L. 2212-7 et les trois premiers alinéas de l’article L. 2212-8, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
« 3° L’article L. 2212-4 ;
« 4° Le chapitre III, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 précitée. » ;
4° L’article L. 2445-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2445 -3. – Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
« 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2212-6, les mots : “dans les conditions fixées au second alinéa de l’article L. 2212-2” sont supprimés ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2212-8, les mots : “selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2” sont supprimés. » ;
5° L’article L. 2445-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2445 -5. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l’article L. 2213-2, les références : “L. 2212-8 à L. 2212-10” sont remplacées par la référence : “L. 2212-8”. » ;
6° Au début du II de l’article L. 2446-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – L’article L. 2222-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. » ;
6° bis L’article L. 3844-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : «, à l’exclusion de l’article L. 3211-2-3 » sont supprimés ;
– au second alinéa, après la référence : « L. 3211-11-1 », est insérée la référence : « L. 3211-2-3 » ;
b) Après le 4° du II, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis À l’article L. 3211-2-3, les mots : “, selon des modalités prévues par convention” sont supprimés ; »
6° ter Le b du 5° du II de l’article L. 3844-2 est ainsi rédigé :
« b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ; »
7° Au début du premier alinéa de l’article L. 6431-9, sont ajoutés les mots : « Les articles L. 6113-3 et L. 6113-4, pour les missions mentionnées aux 2 à 4 de l’article L. 6431-4, et ».
Après le mot : « personnes », la fin du 2° du III de l’article L. 1121-16-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, l’autorisation de l’autorité compétente, selon les modalités prévues aux articles L. 1123-7 et L. 1123-12, lorsqu’ils ne sont pas utilisés dans des conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de la pertinence de leur prise en charge financière. La décision de prise en charge est prise par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
I. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 312-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un objectif d’amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 évaluent et font procéder à l’évaluation de la qualité des prestations qu’ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont habilités par la Haute Autorité de santé, qui définit le cahier des charges auquel ils sont soumis. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation ainsi qu’à la Haute Autorité de santé. Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations. » ;
b) Les troisième, quatrième et sixième alinéas sont supprimés ;
c) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, » sont supprimés ;
d) À la fin du septième alinéa, le mot : « externe » est supprimé ;
d bis) Après la première occurrence du mot : « au », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « premier alinéa du présent article peuvent l’exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve du cahier des charges mentionné au même premier alinéa et de leur habilitation par la Haute Autorité de santé. » ;
d ter) Les deuxième et dernière phrases du même avant-dernier alinéa sont supprimées ;
e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « les procédures » sont remplacés par les mots : « la procédure » ;
– le mot : « références » est remplacé par le mot : « référentiels » ;
– après le mot : « professionnelles », la fin est ainsi rédigée : « au regard desquelles la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée. » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 313-1, le mot : « externe » est supprimé et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;
3° Au VI de l’article L. 543-1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. À compter du 1er janvier 2020, la Haute Autorité de santé peut habiliter les organismes chargés de l’évaluation, sur la base d’un cahier des charges qu’elle a défini.
Les organismes habilités avant le 1er janvier 2020 renouvellent leur habilitation auprès de la Haute Autorité de santé avant le 1er janvier 2021 sur la base du cahier des charges défini par elle.
I. – L’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé est ratifiée.
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A Le premier alinéa de l’article L. 4121-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. » ;
1° L’article L. 4125-8 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4125 -8. – Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre d’un conseil ou assesseur d’une chambre disciplinaire s’il a atteint l’âge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature. » ;
1° bis AA L’article L. 4132-1 est ainsi modifié :
aa)
a) Le b du 2° est abrogé ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Trois binômes par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants :
« a) Auvergne-Rhône-Alpes ;
« b) Antilles-Guyane ; »
1° bis A L’article L. 4142-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
b) Au 6°, les mots : « Normandie et » sont supprimés ;
c) Au 8°, les mots : « les régions » sont remplacés par les mots : « la région » et les mots : «, et Centre-Val de Loire » sont supprimés ;
d) Au 9°, les mots : « Bretagne et » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et Centre-Val de Loire » ;
e) Après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Un binôme représentant les chirurgiens-dentistes exerçant dans les régions Bretagne et Normandie ; »
1° bis B Le premier alinéa de l’article L. 4221-19 est complété par les mots : « et lorsqu’ils existent, entre associés et intervenants concourant au financement de l’officine ou du laboratoire de biologie médicale » ;
1° bis L’article L. 4222-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4222 -2. – Les demandes d’inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l’ordre compétent. Elles sont accompagnées d’un dossier dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État.
« En cas de cessation ou de modification de l’activité professionnelle ou de changement d’adresse de l’établissement, une déclaration, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, est adressée dans les quinze jours au conseil de l’ordre compétent qui procède, s’il y a lieu, à une modification de l’inscription ou à une radiation, suivie, le cas échéant, d’une nouvelle inscription au tableau, au vu des documents transmis.
« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 4231-1, le pharmacien qui interrompt son activité pour une durée inférieure à un an et qui n’exerce aucune autre activité durant cette interruption est omis du tableau par le conseil de l’ordre compétent. La période de l’omission peut être renouvelée, sans toutefois excéder une durée totale de deux ans. Les conditions dans lesquelles un conseil procède à l’omission sont définies par décret. » ;
1° ter L’article L. 4232-10 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Réunion », la fin du 4° est supprimée ;
b) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant à Mayotte. » ;
c) Après les mots : « élisent un », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « délégué local et son suppléant qui assure la représentation de la section E sur le territoire. » ;
1° quater L’article L. 4232-11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, au début, les mots : « Un binôme est composé » sont remplacés par les mots : « Deux binômes sont composés » et, à la fin, les mots : « exerçant en officine » sont remplacés par les mots : « relevant en métropole des sections A et D » ;
b) Après le mot : « composé », la fin du 2° est ainsi rédigée : « de pharmaciens relevant en métropole des sections B, C, G ou H. » ;
c) Le 3° est abrogé ;
d) Au sixième alinéa, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cents » ;
e) Le septième alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 4233-9 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4233 -9. – Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre d’un conseil s’il a atteint l’âge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature. » ;
2° bis Le premier alinéa de l’article L. 4321-14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. » ;
2° ter À l’article L. 4321-18-4, après la référence : « 30 », sont insérés les mots : « par collège » ;
3° À l’article L. 4321-19, après la référence : « L. 4125-3-1, », sont insérées les références : « L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7 et L. 4125-8, » ;
4° La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 4122-3 est ainsi rédigée : « Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre disciplinaire nationale s’il a atteint l’âge de soixante-dix-sept ans. » ;
5° La dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 4124-7 est ainsi rédigée : « Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une chambre disciplinaire s’il a atteint l’âge de soixante-dix-sept ans. » ;
6° Le deuxième alinéa des articles L. 4234-3 et L. 4234-4 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une chambre de discipline s’il a atteint l’âge de soixante-dix-sept ans. » ;
7° Le quatrième alinéa de l’article L. 4234-8 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre de discipline du conseil national s’il a atteint l’âge de soixante-dix-sept ans. » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 4322-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. » ;
9° Après le mot : « par », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4322-8 est ainsi rédigée : « un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État pour une durée de six ans renouvelable. » ;
10° Le dernier alinéa de l’article L. 5125-16 est ainsi modifié :
a)
Supprimé
b) Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « à remplacer le pharmacien décédé » ;
c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai peut être prorogé, pour une période ne pouvant excéder un an, par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de situation exceptionnelle. À l’issue de ce délai, le directeur général de l’agence régionale de santé peut faire application de l’article L. 5125-22. »
II bis. – Après le troisième alinéa de l’article L. 145-7-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président ou de président suppléant de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pédicures-podologues sont incompatibles avec celles prévues au même article L. 4122-1-1 dudit code. »
III. – Les 1° et 1° bis A à 3° du II entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l’ordre pour lesquels les déclarations de candidature sont ouvertes à compter du 1er novembre 2019.
Le 1° bis AA du même II entre en vigueur lors du renouvellement du Conseil national de l’ordre des médecins prévu en 2022. Le mandat du binôme élu pour le ressort territorial du conseil interrégional Antilles-Guyane lors du renouvellement du Conseil national de l’ordre des médecins prévu en 2019 prend fin à la même date.
III bis. – A. – L’ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé est ratifiée.
A bis. – L’article L. 1453-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à toute personne », sont insérés les mots : « assurant des prestations de santé, » ;
2° Après le mot : « commercialisant », sont insérés les mots : « des produits faisant l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou » ;
3° À la fin, les mots : «, ou qui assure des prestations de santé » sont supprimés.
A ter A. – L’article L. 1453-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 1453-5 », la fin du 3° est ainsi rédigée : « sous réserve qu’ils soient conformes aux obligations fixées à l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale pour les spécialités et dans les conditions mentionnées par le même article L. 138-9 ; »
2° Au 4°, après le mot : « avantage », sont insérés les mots : « et sur une période déterminée ».
A ter. – L’article L. 1453-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 3°, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots : « des conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 4021-3 et » ;
2° Le 4° est complété par les mots : «, à l’exception des étudiants en formation initiale mentionnés au 2° du même article L. 1453-4 et des associations d’étudiants mentionnées au 3° dudit article L. 1453-4 ».
A quater. – À l’article L. 1453-11 du code de la santé publique, après le mot : « dérogation », sont insérés les mots : « et pendant une période déterminée ».
B. – L’article L. 1454-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « présent chapitre » est remplacée par la référence : « chapitre III du présent titre » ;
2° Après le mot : « prévus », la fin du 1° est ainsi rédigée : « aux sections 1 à 3 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation et qui peuvent recevoir des commissions rogatoires dans les conditions prévues à l’article L. 511-4 du même code ; ».
III ter. – Le chapitre unique du titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 4021-6 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Elle exerce le contrôle de ce dispositif. À cette fin, elle peut se faire communiquer toute pièce nécessaire à ce contrôle. Ce contrôle est mis en œuvre sans préjudice du contrôle prévu à la seconde phrase de l’article L. 4021-5. » ;
2° Après le 3° de l’article L. 4021-7, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis L’Agence nationale du développement professionnel continu établit et met en œuvre le plan de contrôle du dispositif ; ».
IV. – Le titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa des articles L. 145-6 et L. 145-7-1 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire de première instance s’il a atteint l’âge de soixante-dix-sept ans. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 145-6-2 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant s’il a atteint l’âge de soixante-dix-sept ans. » ;
3° Le dernier alinéa des articles L. 145-7 et L. 145-7-4 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’un conseil national s’il a atteint l’âge de soixante-dix-sept ans. » ;
4° Le deuxième alinéa des articles L. 146-6 et L. 146-7 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des assurances sociales d’une chambre disciplinaire s’il a atteint l’âge de soixante-dix-sept ans. »
IV bis. – A. – L’ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine est ratifiée.
B. – L’ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 précitée est ainsi modifiée :
1°
Supprimé
2° Le IV de l’article 8 est ainsi rédigé :
« IV. – À l’exclusion des dispositions relatives aux demandes de modifications substantielles et à la vigilance dans les recherches, les recherches régulièrement autorisées ou déclarées à la date d’entrée en vigueur prévue au I se poursuivent conformément à la législation et à la réglementation qui leur étaient initialement applicables. Pour ces recherches, les demandes de modifications substantielles et les obligations en matière de vigilance et de mesures urgentes de sécurité sont soumises aux dispositions résultant de la présente ordonnance. »
V. – Sont ratifiées :
1° et 2°
Supprimés
3° L’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
4°
Supprimé
5° L’ordonnance n° 2016-967 du 15 juillet 2016 relative à la coordination du système d’agences sanitaires nationales, à la sécurité sanitaire et aux accidents médicaux ;
6° L’ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 relative à l’aptitude médicale à la navigation des gens de mer et à la lutte contre l’alcoolisme en mer ;
7° L’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur ;
8°
Supprimé
9° L’ordonnance n° 2016-1812 du 22 décembre 2016 relative à la lutte contre le tabagisme et à son adaptation et son extension à certaines collectivités d’outre-mer ;
10° L’ordonnance n° 2017-9 du 5 janvier 2017 relative à la sécurité sanitaire ;
11° L’ordonnance n° 2017-10 du 5 janvier 2017 relative à la mise à jour de la liste des établissements figurant à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
12° L’ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l’hébergement de données de santé à caractère personnel ;
13° L’ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire ;
14° L’ordonnance n° 2017-29 du 12 janvier 2017 relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique ;
15° L’ordonnance n° 2017-44 du 19 janvier 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international de 2005 ;
16° L’ordonnance n° 2017-45 du 19 janvier 2017 relative aux conditions d’accès aux données couvertes par le secret médical ou le secret industriel et commercial pour le compte de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et à la mutualisation de certaines fonctions d’agences sanitaires nationales ;
17° L’ordonnance n° 2017-46 du 19 janvier 2017 relative à la prise en charge de la rémunération des personnels des établissements de santé mis à disposition des inspections générales interministérielles et abrogeant les dispositions relatives aux conseillers généraux des établissements de santé ;
18° L’ordonnance n° 2017-47 du 19 janvier 2017 précisant la procédure de fusion des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique ;
19°
Supprimé
20° L’ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017 portant harmonisation des dispositions législatives relatives aux vigilances sanitaires ;
21° L’ordonnance n° 2017-496 du 6 avril 2017 portant extension des dispositions de l’article 45 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
22° L’ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes ;
23° L’ordonnance n° 2017-1092 du 8 juin 2017 relative aux composantes de la rémunération du pharmacien d’officine ;
24° L’ordonnance n° 2017-1177 du 19 juillet 2017 portant extension et adaptation des compléments de l’allocation aux adultes handicapés à Mayotte ;
25° L’ordonnance n° 2017-1178 du 19 juillet 2017 relative à l’adaptation du code de la santé publique à Mayotte ;
26° L’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l’adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie ;
27° L’ordonnance n° 2018-4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la modernisation des régimes d’autorisation des activités de soins et d’équipements matériels lourds ;
28° L’ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé ;
29° L’ordonnance n° 2018-21 du 17 janvier 2018 de mise en cohérence des textes au regard des dispositions de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
30° L’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle ;
31° L’ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes ;
32° L’ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 portant adaptation et simplification de la législation relative à l’Établissement français du sang et aux activités liées à la transfusion sanguine ;
33° L’ordonnance n° 2017-30 du 12 janvier 2017 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1413-1, L. 1418-1, L. 1431-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique.
Le I de l’article L. 1453-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Les personnes qui, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, présentent un ou plusieurs produits de santé, de manière à influencer le public ; »
2° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Les personnes morales assurant ou participant à la formation initiale ou continue ou au développement professionnel continu des professionnels de santé mentionnés au 1°. »
I. – L’article L. 4123-13 du code de la santé publique est complété par les mots : «, sous la présidence conjointe de leurs présidents respectifs ».
II. – À la fin de l’article L. 4123-14 du code de la santé publique, les mots : « du président du conseil départemental de l’ordre des médecins » sont remplacés par les mots : « conjointe de leurs présidents respectifs ».
Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de créer aux Antilles une faculté de médecine de plein exercice, ouverte sur l’international et susceptible de faire rayonner la médecine française sur l’arc caribéen.

Nous allons maintenant examiner l’amendement déposé par le Gouvernement.

Sur l’article 1er, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?…
Le vote est réservé.

L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 47
Après la référence :
I bis
insérer les mots :
de l’article L. 632-2 du code de l’éducation
La parole est à Mme la ministre.

Sur les articles 2 bis à 26, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement du Gouvernement.
Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé.
La parole est à Mme la ministre.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je serai très rapide : je vous remercie à la fois de la qualité de nos échanges pendant les débats et de la qualité du texte final, que je mettrai une énergie folle à déployer sur le territoire, pour vos territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions des commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement (texte de la commission n° 591, rapport n° 590) et du projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (texte de la commission n° 593, rapport n° 592).
Il a été décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le rapporteur.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, au terme de plusieurs semaines d’échanges nourris avec nos collègues députés, je suis heureux de vous présenter un texte commun sur le projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, issu des travaux de la commission mixte paritaire qui s’est tenue le 25 juin dernier.
Je rappelle que le texte initial visait trois objectifs principaux : doter le monde de la biodiversité d’un opérateur public unique ; renforcer les attributions des agents dotés de prérogatives de police environnementale ; réformer l’organisation des activités de chasse en cohérence avec la création du nouvel établissement public.
En première lecture, nous avions abordé ce projet de loi avec l’approche pragmatique et attentive aux besoins des territoires qui est la marque de notre assemblée, et l’avions significativement enrichi. Lors de la commission mixte paritaire, nous nous sommes montrés particulièrement soucieux de préserver l’équilibre délicat que le Sénat avait ainsi construit. Le texte de compromis qui en résulte conserve l’essentiel de nos apports, et nous pouvons nous en féliciter.
Je souhaite à cet égard remercier nos collègues Anne Chain-Larché, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques, et Jean-Noël Cardoux, président du groupe d’études « Chasse et pêche », de leur engagement à mes côtés et de leur contribution au texte que nous examinons aujourd’hui.
Sur notre initiative, des améliorations importantes ont été apportées à la gouvernance du nouvel établissement public succédant à l’Agence française pour la biodiversité, l’AFB, et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, l’ONCFS, afin de garantir une représentation plus équilibrée des différentes parties prenantes.
En particulier, nous avons introduit une représentation des organisations professionnelles agricoles et forestières, fixé un quantum minimal pour la représentation des acteurs de la chasse et de la pêche et posé le principe d’une présence minoritaire de l’État en nombre de représentants, équilibrée par la création d’un commissaire du Gouvernement doté d’un droit de veto.
Nous avons en outre précisé que le financement de l’Office français de la biodiversité, l’OFB, ne saurait conduire à une dégradation des ressources des agences de l’eau. C’est un ajout très important au regard des inquiétudes que nous avons tous sur l’avenir de la politique de l’eau. À ce sujet, nous ferons preuve d’une vigilance toute particulière, vous le savez, madame la secrétaire d’État, sur la traduction budgétaire de la création de l’OFB à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2020.
En matière de police de l’environnement, notre travail s’est inscrit pleinement en continuité de l’approche retenue par l’Assemblée nationale, en apportant des précisions aux attributions des inspecteurs de l’environnement. Nous avons eu le même souci de renforcer les pouvoirs des inspecteurs et de ne pas disperser les compétences de police.
Une autre priorité du Sénat a été de consacrer et d’amplifier la contribution du monde de la chasse à la protection de la biodiversité.
Nous avons ainsi précisé le système de financement d’actions en faveur de la biodiversité par les fédérations des chasseurs et inscrit dans la loi l’engagement pris par l’État de soutenir ces actions à hauteur de 10 euros par permis de chasser. Le dispositif équilibré auquel nous sommes parvenus permettra de conforter les nombreuses actions menées au quotidien par les fédérations de chasseurs pour une gestion durable de la biodiversité.
Néanmoins, il nous appartiendra de rester très vigilants sur l’utilisation de ces fonds et sur une solidarité qui devra s’exprimer entre les fédérations départementales. Madame la secrétaire d’État, j’ai eu l’occasion de vous le dire, nous comptons aussi sur votre vigilance en ce domaine.
Le Sénat a également adopté plusieurs dispositions pour renforcer la lutte contre les dégâts de grand gibier, qui constituent un véritable fléau dans de nombreux territoires, en particulier pour les agriculteurs et les propriétaires forestiers. Je pense notamment à l’encadrement des pratiques de nourrissage et du transport des sangliers vivants, ainsi qu’au renforcement des pouvoirs du préfet à l’égard des plans de chasse en cas d’augmentation importante des dégâts. Nous avons en outre permis aux fédérations régionales des chasseurs d’être gestionnaires de réserves naturelles.
Sur ce sujet, je tiens toutefois à préciser que, à titre personnel, je ne suis pas favorable à la mise en place d’une participation à l’hectare, tel que cela a été décidé. Il m’aurait paru plus judicieux de porter le permis national à 250 euros par exemple, ce qui représentait une large économie par rapport à son coût précédent, voisin de 400 euros. Je pense, je suis même persuadé, que cela aurait posé moins de problèmes financiers et d’organisation pour indemniser les dégâts de grand gibier.
Parallèlement, c’est également au Sénat qu’ont été adoptées deux mesures importantes en matière d’encadrement des activités cynégétiques, prévoyant une harmonisation réglementaire des règles de sécurité et créant un régime de rétention ou de suspension du permis de chasser en cas de comportement particulièrement dangereux. Cela témoigne d’une approche très exigeante et responsable de la chasse, en vue d’assurer la sécurité de tous et de permettre une coexistence encadrée et sereine des différentes activités dans nos territoires.
Enfin, nous avons adopté plusieurs dispositions concrètes en faveur d’une meilleure protection du patrimoine naturel. Je pense notamment à des ajouts précisant les critères de reconnaissance des zones humides, élargissant le périmètre des aires marines protégées et introduisant dans la loi une définition de la géodiversité.
L’ensemble de ces évolutions ont été apportées en tenant pleinement compte du travail effectué par l’Assemblée nationale. Les dispositions que nous avons adoptées s’ajoutent à celles qui ont été retenues par nos collègues députés, de façon cohérente et constructive, avec le même souci de proposer une réforme durable en matière de biodiversité.
Sur le fondement de ces travaux, nous avons œuvré activement avec Mme Barbara Pompili, rapporteure de l’Assemblée nationale, pour trouver un accord. Je tiens à saluer le travail que nous avons accompli ensemble en commission mixte paritaire, ainsi que l’implication de notre président de commission, Hervé Maurey, qui est retenu aujourd’hui par une réunion de l’Union interparlementaire.
Un point particulier a suscité des débats nourris jusqu’au dernier moment : l’introduction en première lecture au Sénat, sur l’initiative de notre collègue Jean-Noël Cardoux, d’un délit d’entrave aux activités de chasse, sujet d’actualité s’il en est.
Je rappelle que, sur cette question, la volonté du Sénat était d’affirmer clairement l’impérieuse nécessité d’assurer le respect par tous des activités de chasse et de pêche dûment autorisées. Un certain nombre d’exactions insupportables envers les chasseurs et les pêcheurs, via des menaces et des dégradations de leur équipement, sont régulièrement constatées. Cela participe plus globalement d’une remise en cause violente de certaines activités légales par une minorité radicale. L’objectif de l’introduction d’un délit d’entrave était de sanctionner spécifiquement ces comportements, avec des peines proportionnées à la gravité des faits.
Bien que nous estimions cette disposition parfaitement fondée, l’Assemblée nationale n’a pas jugé, et je le regrette, son maintien souhaitable, pour des raisons que je qualifierai d’affichage. Nous avons consenti à son retrait, après que vous vous êtes engagée, madame la secrétaire d’État, conjointement avec le ministre chargé des relations avec le Parlement, à examiner avec attention la proposition de loi déposée par notre collège Jean-Noël Cardoux, traitant la question du délit d’entrave de façon plus transversale.
Sous réserve de la décision de la conférence des présidents qui se réunira demain, ce texte devrait être inscrit à l’ordre du jour du Sénat en octobre. Nous serons particulièrement attentifs à ce que l’engagement pris par le Gouvernement se concrétise par une inscription rapide du texte à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
Au-delà de cette question, nous avons élaboré – vous l’aurez compris, mes chers collègues – un texte de compromis, conservant les nombreux ajouts du Sénat que j’ai mentionnés à l’instant, aussi bien sur les questions de gouvernance de l’Office français de la biodiversité que de police, de financement ou d’organisation de la chasse. Tout compromis suppose des concessions, a fortiori lorsque les textes des deux assemblées différaient significativement sur certains points, mais je pense que nous pouvons collectivement être fiers de l’importante contribution du Sénat au texte que nous avons à examiner aujourd’hui et que je vous invite à adopter.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, monsieur le vice-président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais dire mon plaisir et ma satisfaction d’être de nouveau devant le Parlement pour le vote solennel de ce projet de loi, six mois après le début de son examen par l’Assemblée nationale et trois mois après les débats au Sénat.
Je veux remercier les sénateurs et les députés qui, comme l’a dit M. le rapporteur, se sont investis sur ce texte, ont été ouverts au dialogue et ont permis d’aboutir à une commission mixte paritaire conclusive en traitant les différents sujets portés par ce projet de loi, dans le cadre d’un travail extrêmement constructif.
Vous avez évoqué, monsieur le rapporteur, une question importante qui fut débattue lors de cette rencontre entre députés et sénateurs : le délit d’entrave. Le texte qui vous est proposé aujourd’hui, issu de cette CMP conclusive, ne comprend pas ce point. Nous avons rappelé l’engagement du Gouvernement sur ce sujet qui concerne la chasse, et au-delà diverses activités légales, et qui a fait l’objet – vous l’avez rappelé – d’une proposition de loi, portée par le sénateur Cardoux. Vous avez annoncé la possibilité d’une inscription rapide de ce texte à l’ordre du jour du Sénat ; le Gouvernement s’est engagé à faciliter son examen rapide à l’Assemblée nationale pour que ce sujet puisse être traité de façon transversale.
Si le présent projet de loi n’inclut pas le délit d’entrave, il comprend de nombreux points majeurs que je veux reprendre à la suite des propos de M. le rapporteur.
Il s’agit, d’abord, de la création de l’Office français pour la biodiversité.
L’opportunité de ce nouvel établissement faisait largement consensus. Nous avons eu des échanges nourris sur sa gouvernance et ses missions, ainsi que sur la juste représentation des outre-mer au regard de leur richesse en matière de biodiversité – nous le savons tous désormais, 80 % de la biodiversité française se situe dans nos territoires ultramarins. Nous avons, je le crois, trouvé un point d’équilibre.
Cet établissement réunira 2 700 agents aux compétences complémentaires sur l’eau et la biodiversité, marine et terrestre, rassemblés dans un établissement unique pour une action plus forte, mieux coordonnée, sur tous les territoires.
Il sera au service du ministère. Nous allons retravailler ses liens avec les services déconcentrés et les autres opérateurs pour la mise en œuvre de ses politiques en matière d’eau et de biodiversité.
L’office sera particulièrement mobilisé pour la mise en place de notre ambition commune, telle qu’elle est issue du plan Biodiversité et des assises de l’eau.
Le texte tend à renforcer la police de l’environnement. Après des débats nourris, nous avons accru les pouvoirs des inspecteurs de l’environnement, qui pourront, sous contrôle du procureur de la République, conduire leurs enquêtes de la constatation de l’infraction au renvoi du prévenu devant le tribunal, sans avoir à se dessaisir au profit d’un officier de police judiciaire généraliste.
Les inspecteurs bénéficieront d’un cadre de collaboration amélioré avec les autres services de police. Les peines sont renforcées pour les délits d’atteinte aux espèces et habitats protégés et pour le délit d’exercice illégal aggravé de la chasse.
Le projet de loi comprend également des mesures pour une chasse plus durable.
Je veux d’abord évoquer la question de la sécurité à la chasse. C’est une priorité du Gouvernement : même si le dernier bilan montre, et c’est heureux, une tendance à la baisse des accidents constatés, nous sommes confrontés à une hausse des incidents.
La loi prévoit ainsi – le Sénat et l’Assemblée nationale ont adopté ces mesures en commission mixte paritaire – des obligations minimales de sécurité homogènes au niveau national, un dispositif de rétention et de suspension du permis de chasser en cas de manquement grave à une règle de sécurité et une obligation de formation pour les accompagnateurs de jeunes chasseurs.
Nous avons aussi progressé sur la question de la maîtrise des dégâts de gibier, en suivant les recommandations de la mission du député Alain Perea et du sénateur Jean-Noël Cardoux : interdiction du nourrissage des sangliers et restriction des lâchers dans les enclos, ce qui permettra également de lutter contre l’engrillagement notamment observé en Sologne.
La loi incite financièrement les chasseurs à mieux réguler le grand gibier, en faisant davantage sur les territoires de chasse où les dégâts sont les plus importants.
Elle met également en place une gestion adaptative de certaines espèces pour adapter régulièrement les prélèvements de celles-ci en fonction de l’état de conservation de leurs populations. Pour ces espèces, la déclaration des prélèvements par chaque chasseur sera obligatoire auprès des fédérations de chasseurs et de l’OFB.
La loi instaure une éco-contribution afin que les fédérations de chasseurs financent chaque année, à hauteur de 5 euros par chasseur, des actions concrètes en faveur de la biodiversité, comme la plantation de haies, la restauration de milieux forestiers et de milieux humides, l’entretien d’habitats favorables à la biodiversité. Des crédits publics cofinanceront ces actions à hauteur de 10 euros pour 5 euros de contribution par chasseur.
Vous l’avez également cité, monsieur le rapporteur, la loi tend également à améliorer la définition des zones humides. Il s’agit d’un point très important abordé dans un rapport parlementaire de Frédérique Tuffnell et votre collègue Jérôme Bignon. Il y avait une ambiguïté sur cette définition, que nous avons levée, pour continuer à protéger ces zones humides comme nous nous y sommes engagés.
Après relecture attentive du texte issu de la CMP, nous avons noté quatre erreurs ou oublis de coordination. Le Gouvernement a donc déposé quatre amendements pour les corriger, lesquels seront examinés à l’issue de cette discussion générale, et qui ont été adoptés par l’Assemblée nationale mardi dernier.
Pour finir, je veux dire que le Gouvernement est pleinement mobilisé pour une mise en œuvre rapide de la loi. L’OFB sera créé au 1er janvier 2020, nous publierons rapidement les textes d’application. Trois rapports sont prévus, dont un sur le financement de la politique de l’eau et de la biodiversité, et un autre sur les questions de ressources humaines. Je m’attarderai quelques instants sur ces deux points avant de conclure.
Sur le premier point, je souhaite vous assurer que la totalité du besoin de financement nécessaire pour faire face à la baisse du permis de chasse sera assurée par des voies budgétaires, ce qui permettra de ne pas effectuer de prélèvements sur les agences de l’eau. Cette inquiétude avait été exprimée à de nombreuses reprises pendant les débats : je suis donc maintenant en mesure de vous affirmer que les agences de l’eau ne connaîtront aucune perte de recettes associée à la création du nouvel établissement et à sa budgétisation.
Comme dans n’importe quel rapprochement d’établissements, des questions légitimes sont posées par les personnels et leurs syndicats, que j’ai d’ailleurs reçus la semaine dernière. Nous avons avancé sur la possibilité d’effectuer une requalification en cinq ans des agents de catégorie C, en catégorie B, avec 300 agents par an pendant les trois premières années. Il s’agit d’une question importante pour l’établissement et nous travaillons sur les autres sujets de ressources humaines, afin de pouvoir créer cet établissement dans les meilleures conditions possible en respectant les personnels.
Nous savons tous que le déclin de la biodiversité est très préoccupant. Nous avons lu les rapports, le Président de la République a reçu les scientifiques de l’IPBES, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, la grande association scientifique qui pilote ces questions sur le plan international.
Ce projet de loi est un texte d’action qui nous permettra d’agir, sans opposer biodiversité et ruralité, et d’être pleinement opérationnels.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, comme vous le savez, nous sommes parvenus le 25 juin dernier à un accord sur le projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, et je m’en félicite.
Je m’en félicite, car rien n’était acquis au vu des différends notoires exprimés dans les nombreux amendements déposés à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Finalement, les mesures les plus clivantes ont été dans leur grande majorité supprimées ou aménagées par la commission mixte paritaire. Et bien qu’ayant défendu certaines d’entre elles, je ne vais pas m’opposer au texte que nous avons à voter.
Je tiens à souligner la véritable volonté de compromis des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que du Gouvernement, mais aussi l’excellent travail effectué en amont par le groupe d’études « Chasse et pêche ».
Ce projet de loi corrige une anomalie qui n’avait pu être réglée lors de l’adoption de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, portée par Ségolène Royal, car le projet d’intégration de l’ONCFS dans l’Agence française de biodiversité était alors combattu par l’ensemble du monde de la chasse, dont je faisais partie.
Aujourd’hui, tout est différent. L’accord passé entre le Président de la République et le président de la Fédération nationale des chasseurs, prévoyant notamment la fixation du prix du permis national à 200 euros et la contribution des chasseurs, couplée à celle de l’État, au nouveau fonds pour la protection de la biodiversité, a permis à cette fusion d’être désormais acceptée par la majorité des parties prenantes. Cette opération s’inscrit en effet dans la continuité de la stratégie nationale pour la biodiversité.
Mon collègue Jean-Michel Houllegatte l’affirmait ici, lors de la discussion générale de la première lecture du texte, « nous sommes convaincus qu’il existe entre le monde de la chasse et la protection de la nature une convergence des objectifs et une complémentarité justifiant la fusion de ces deux établissements », d’autant que le monde de la chasse affirme avec force depuis longtemps, même s’il n’est pas toujours écouté, le rôle qu’il joue dans notre biodiversité, afin d’en garantir la pérennité et la richesse.
Mes chers collègues, le texte issu de la commission mixte paritaire et soumis aujourd’hui à notre vote est, selon moi, acceptable, même s’il est le fruit d’un compromis. La voix du Sénat a été entendue, et nous pouvons collectivement nous en féliciter.
Tout au long de l’examen du texte, je me plais à le souligner, les sénateurs du groupe socialiste n’ont cessé de défendre une vision équilibrée du futur établissement. Attentifs à ce que ce dernier soit le plus fédérateur possible, nous nous sommes attachés à préserver ses missions essentielles de protection de l’environnement, mais surtout à prendre en compte les attentes des différentes parties prenantes. C’est pourquoi nous avons défendu un certain nombre d’amendements en ce sens.
Nous avons notamment milité pour que le monde agricole et forestier figure expressément au sein du conseil d’administration de l’Office.
De même, l’inscription dans le texte de la contribution de 10 euros de l’État, en contrepartie de celle de 5 euros des chasseurs, dans le cadre de la création du futur fonds pour la protection de la biodiversité, a également été soutenue et portée par le groupe socialiste. Ma conviction profonde est que la gestion de ce fonds, confiée à la Fédération nationale des chasseurs, permettra à celle-ci de mener à bien la lourde tâche de protection et de reconquête de la biodiversité, tout en sachant prendre en compte, je l’espère, les attentes et les souhaits des fédérations départementales des chasseurs.
Enfin, le groupe socialiste a fait adopter l’affectation à titre gratuit à l’OFB de biens mobiliers dont, à l’occasion d’une décision de justice, la propriété avait été transférée à l’État, ainsi que des mesures permettant de renforcer la lutte contre les dégâts causés par le grand gibier.
Lors de l’examen du texte, j’ai été particulièrement attentif à ce dernier point. En effet, le département dont je suis élu, la Dordogne, est directement touché par ces dégâts, le plus souvent occasionnés par des sangliers. Je me réjouis d’ailleurs du travail mené en commun avec le sénateur Jean-Noël Cardoux pour faire adopter la fixation, par le préfet, de quota d’animaux à prélever annuellement ainsi que le renforcement des pouvoirs de ce dernier en matière de plans de chasse.
Je me félicite aussi de l’adoption de l’amendement que certains collègues et moi-même avons défendu visant à accorder aux fédérations départementales des chasseurs les compétences consistant à assurer la validation du permis de chasser, à délivrer des autorisations de chasse accompagnée et à concourir à l’organisation des examens du permis de chasse.
Toutes ces mesures serviront, j’en suis convaincu, à rendre plus fort et efficient le nouvel Office.
Toutefois, il me paraît nécessaire, mes chers collègues, d’appeler votre attention sur un certain nombre de points.
Tout d’abord, vous y avez fait allusion, madame la secrétaire d’État, il nous faudra veiller à ce que l’engagement du Gouvernement dans le fonds de protection soit intégré au budget général ; l’argent ne peut provenir des agences de l’eau, dont les fonds de roulement ne permettent pas un tel financement. C’est pourquoi la majorité des travées du Sénat ont tenu à inscrire dans la loi la sanctuarisation des ressources des agences de l’eau.
Vous le savez, je suis un défenseur de la chasse populaire. Dans mon département, la Dordogne, j’ai été sollicité par de nombreux chasseurs qui n’étaient pas convaincus par la baisse du prix du permis de chasse national couplée à la disparition du permis bi-départemental. Ces chasseurs doivent aujourd’hui s’acquitter du permis national pour chasser dans le département voisin, et cela représente une hausse tarifaire discriminante pour les chasseurs les plus modestes. Cette question doit être étudiée le plus rapidement possible par la Fédération nationale des chasseurs, comme elle s’y est engagée ; j’attends une réponse très rapide de sa part.
Il nous faudra également rester attentifs, mes chers collègues, au respect de toutes les parties prenantes au sein du conseil d’administration de l’Office. Le droit de veto accordé au Gouvernement en contrepartie d’une participation minoritaire ne doit pas mener à des abus qui seraient préjudiciables au bon fonctionnement de l’OFB.
Concernant l’indemnisation des dégâts de grand gibier, je regrette que l’extension du dispositif de participation des territoires de chasse aux territoires « susceptibles d’être chassés », introduite par le Sénat, ait été supprimée, au motif qu’elle relevait d’une loi de finances. Ce dispositif ayant vocation à devenir la principale source de financement des fédérations départementales des chasseurs, en remplacement du timbre national grand gibier, il sera nécessaire d’être attentif à son intégration dans la loi de finances.
Enfin, des questions demeurent sur le financement de l’établissement. Une baisse du prix du permis de chasse représentant 21 millions d’euros, une participation de l’État au fonds national à hauteur de 10 millions d’euros et une compensation du transfert de certaines missions représentant 9 millions d’euros : cela porte à près de 40 millions d’euros le financement non assuré de l’OFB à compter du 1er janvier 2020.
Madame la secrétaire d’État, ce sujet sera évidemment évoqué lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, et nous serons, une fois encore, très attentifs à ce que l’État tienne ses engagements.
Je conclus, mes chers collègues, en saluant de nouveau la qualité du travail parlementaire lors de l’examen de ce projet de loi ; bien que celui-ci ne soit pas parfait et qu’il reste des zones à éclaircir, notamment en matière de financement, le groupe socialiste votera majoritairement pour l’adoption de ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires e t du groupe Union Centriste. – M. Jean-Noël Cardoux et Mme Anne Chain-Larché applaudissent également.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, voilà maintenant trois ans, à cette même tribune, je regrettais que la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages n’intègre pas l’Office national de la chasse et de la faune sauvage à la nouvelle Agence française pour la biodiversité. Je ne peux donc que me réjouir du succès de cette commission mixte paritaire, et je salue le travail des rapporteurs et des présidents de commission. Ce succès grave ainsi dans la loi cette fusion nécessaire, et le groupe du RDSE votera très majoritairement en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire.
Ce projet de loi permet en effet de doter notre pays d’un outil plus puissant pour tenter de faire face à cet enjeu majeur, la préservation de notre patrimoine naturel, et pour participer à la définition d’une stratégie efficace visant à stopper la perte de la biodiversité, une menace pour l’avenir même de nos sociétés. Il convient maintenant que ce nouvel office s’investisse résolument dans la définition de cette stratégie, avec comme priorité la préservation des écosystèmes. Cela nécessite de trouver enfin les leviers permettant d’en finir avec les pollutions chimiques et le gaspillage insensé de terres agricoles et naturelles.
L’enjeu de l’artificialisation des terres, qui fragilise notre futur et notre autonomie alimentaire, sera d’ailleurs inclus dans une proposition de résolution que mes collègues Françoise Laborde et Joël Labbé défendront en octobre prochain, dans le cadre d’une niche du groupe du RDSE. Nous aurons donc l’occasion d’y revenir, mais ce débat est déjà l’occasion d’exprimer l’attente, que je crois assez partagée sur les travées du Sénat, d’une loi efficace contre l’artificialisation des sols.
Cet exemple me semble en effet assez symptomatique du fait que chasseurs et écologistes ont plus d’intérêts communs qu’ils ne l’affichent. J’avoue d’ailleurs avoir été quelque peu déçu de la teneur du débat que nous avons eu au Sénat, au cours duquel beaucoup d’amendements adoptés par la majorité sénatoriale ont servi à envoyer des messages de soutien à certains chasseurs, dont je doute d’ailleurs qu’ils soient représentatifs du monde de la chasse d’aujourd’hui.
Cela dit, la plupart de ces amendements ont été supprimés par la commission mixte paritaire, et c’est heureux. Était-il nécessaire de reprendre l’exemple de la chasse à la glu, qui compte tant de défenseurs au Sénat ? Je ne réussirai pas à tous vous convaincre – certains membres du groupe du RDSE ne voteront d’ailleurs pas le texte en raison de la disparition de la mention de cette chasse traditionnelle –, mais il paraît inimaginable que nous puissions tolérer demain des chasses non sélectives. L’Espagne a déjà été condamnée par l’Union européenne sur ce fondement et des recours européens ont aussi été déposés par des associations françaises.
Plus généralement, certaines pratiques, largement rejetées par la population, jouent contre l’image de la chasse ; elles réduisent les vocations alors que nous avons besoin de chasseurs pour réguler certaines populations de gibier, en particulier de sangliers.
Je ne désespère pas, chers collègues, que nous ayons un jour un débat serein et sans tabou sur cette question de l’image de la chasse, laquelle se considère trop comme une citadelle assiégée, se battant pied à pied sur les listes d’espèces chassables ou les dates de chasse, alors que l’enjeu est d’abord la synergie entre chasseurs et écologistes. En effet, notre objectif doit être la gestion dynamique de notre patrimoine naturel, afin que, demain, les populations d’espèces chassables augmentent, ce qui serait une bonne nouvelle pour les chasseurs comme pour les écologistes.
Vous le voyez donc, l’offre de dialogue, au moins de ma part, est toujours là. Deux sujets seront d’ailleurs l’occasion de l’approfondir.
D’abord, la contribution de 10 euros par chasseur cotisant, que l’État s’apprête à créer au bénéfice de l’action « biodiversité » de la Fédération nationale de chasse, fait aujourd’hui, vous le savez, grincer bien des dents chez les associations de protection de l’environnement. Il appartiendra donc aux chasseurs de faire mentir les procès d’intention sur l’utilisation de ce que d’aucuns dénomment « le chèque fusion ».
Ensuite, la gestion adaptative des espèces constituera un autre test. Le principe est intéressant, et, effectivement, cette approche par espèce donne satisfaction dans d’autres pays. Néanmoins, sur ce point aussi, c’est bien l’application qui en sera faite concrètement qui montrera l’existence, ou non, de convergences entre chasseurs et protecteurs de la nature. Soit il s’agit de limiter la pression de chasse sur des espèces fragiles, à la population en déclin, comme la tourterelle des bois, le courlis cendré ou la barge à queue noire, au moyen de mesures de protection des milieux, y compris dans le cadre de coopérations avec d’autres pays pour les espèces migratrices – la convention de Ramsar peut nous servir à cet égard, cher Jérôme Bignon –, soit il s’agit seulement d’augmenter la liste des espèces chassables, le lobby de la chasse n’ayant alors comme objectif que l’augmentation du nombre de cibles disponibles.
La tourterelle des bois sera sans nul doute un test en la matière. En effet, qui dit gestion adaptative dit suivi scientifique. Le CEGA, le Comité d’experts sur la gestion adaptative, a préconisé un moratoire sur la chasse de cette espèce, avec un quota de 18 300 volatiles à abattre au maximum pendant la saison de chasse 2019-2020. Or le Gouvernement propose un total de 30 000 tourterelles, presque le double de l’avis des scientifiques.
Je souhaiterais donc que vous vous exprimiez sur ce point, madame la secrétaire d’État, tant il paraît impossible d’avoir un dialogue apaisé entre tous les acteurs si les avis scientifiques ne sont pas suivis d’effets ; et ce n’est pas une consultation citoyenne sur la chasse à la glu, qui n’a pas eu de conséquences, qui y changera quelque chose – les écolos et les chasseurs partagent d’ailleurs la même opinion sur cette consultation… Je vous remercie donc des précisions que vous voudrez bien apporter sur les raisons conduisant à ce quota de 30 000 individus, qui ne semble pas scientifiquement justifié.
Je profite de cette intervention pour souligner que, sans moyens, les politiques de reconquête de la biodiversité ne peuvent être couronnées de succès. Ainsi, les ponctions régulières sur les recettes des agences de l’eau ne sont plus acceptables, tant le budget de ces organismes est nécessaire aux politiques de restauration des milieux humides. Nous avons tenté d’y remédier – le rapporteur a insisté sur ce point –, car il s’agit d’une préoccupation essentielle.
Enfin, le fait de se doter d’une véritable police unifiée de l’environnement est une avancée majeure, que nous défendions ; là aussi, c’est l’importance des moyens humains dévolus qui permettra de remplir cette mission importante ; nous y serons vigilants.
Comme je le disais au début de mon propos, le groupe du RDSE votera très majoritairement pour les conclusions de la commission mixte paritaire. Le rapporteur l’a dit, beaucoup d’efforts ont été fournis par les uns et les autres pour aboutir à ce texte conclusif.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, chers collègues, les membres de la commission mixte paritaire sont parvenus à un accord sur une version commune du projet de loi créant l’Office français de la biodiversité ; c’est une heureuse nouvelle.
Idée ancienne, longtemps controversée, cette fusion de deux grands établissements publics – l’Agence française pour la biodiversité et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage – qui concourent, chacun avec sa culture et ses moyens, à la préservation de l’environnement permettra, en mutualisant les ressources et les compétences, de renforcer l’efficacité des actions menées sur tout le territoire français, métropolitain et ultramarin. Deux mille sept cents agents – ce n’est pas rien – constitueront à partir du 1er janvier prochain ce nouvel établissement public ; tous nos vœux les accompagnent.
Cette fusion répond à de nombreux objectifs. Parmi ceux-ci, j’en note trois : replacer les enjeux des politiques environnementales à un échelon territorial – cela doit intéresser les sénateurs –, faire converger l’action des politiques de l’eau et de la biodiversité – quand on voit les problèmes que connaît notre pays dans le domaine de l’eau, il n’est pas inintéressant de s’en préoccuper – et renforcer les pouvoirs de police de l’environnement.
Cela permet d’achever le travail de fusion des opérateurs de la biodiversité commencé par la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité ; ce texte réalisait, vous vous en souvenez, la fusion de l’Onema, de l’Agence des aires marines protégées, que j’ai présidée, de l’ATEN et des établissements publics des parcs nationaux. Notre excellent rapporteur l’a indiqué, de nombreuses propositions du Sénat ont été maintenues dans l’accord final, qui représente une solution consacrant la préservation de la biodiversité tout en assurant l’avenir d’une chasse durable. C’est donc aussi une bonne chose pour les chasseurs.
Je me félicite du maintien de plusieurs dispositions que j’avais proposées en faveur d’une meilleure protection du patrimoine naturel. Je pense notamment aux ajouts précisant les critères de reconnaissance des zones humides et élargissant le périmètre des aires marines protégées ; cela témoigne indéniablement de la reconnaissance de l’importance des zones humides dans la préservation de la biodiversité.
Je me réjouis également du renforcement des pouvoirs de la police environnementale. Les diverses mesures relatives à ces pouvoirs devraient améliorer les conditions de travail des agents, concrètement, sur le terrain et dans leur vie de tous les jours.
Dans le contexte actuel de réchauffement climatique, enrayer l’effondrement de la biodiversité est plus que jamais capital ; ces deux notions vont évidemment de pair, et l’ajout de la mention du changement climatique à l’article 1er est essentiel.
Le changement climatique contribue directement aux considérables pertes de biodiversité, mais il constitue également un facteur d’aggravation de certaines causes indirectes. Par ailleurs, lorsque les impacts climatiques frappent, ils le font plus durement là où la nature est déjà dans un état précaire, on a pu le constater récemment.
L’actuelle crise d’extinction est beaucoup plus rapide que les précédentes et elle est quasi exclusivement liée aux activités humaines. Selon la note scientifique n° 12 publiée par l’Opecst en janvier 2019 – encore un travail conjoint de nos deux chambres, qui va dans le même sens que le texte de cette commission mixte paritaire –, la France se situe parmi les dix pays abritant le plus grand nombre d’espèces mondialement menacées.
La protection de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique doivent donc être deux combats menés de front par la France et par l’ensemble de la communauté internationale.
Comme pour le climat, les solutions doivent être mises en œuvre de manière urgente et impliquent des transformations profondes de notre modèle économique ; on en parlera prochainement lors de l’examen d’un texte. La préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique présentent le plus souvent des synergies, qu’il faut davantage développer.
Le groupe Les Indépendants se félicite de la création de l’OFB, qui sera un opérateur clé pour poursuivre, compléter et enrichir notre combat national de restauration et de protection de la biodiversité de façon efficace, dès le 1er janvier 2020.
En tant que membre du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité, où je représente le Sénat, je suis avec beaucoup d’intérêt la territorialisation de cette agence, au travers de la mise en place progressive des agences régionales de la biodiversité.
Plus récemment, sur un autre aspect, j’ai eu divers contacts avec M. Pierre Dubreuil, désigné préfigurateur du nouvel établissement. Je peux témoigner du travail remarquable de concertation qu’il accomplit avec les équipes en place, mais aussi avec les acteurs de terrain dans les comités d’orientation de l’Agence française pour la biodiversité. Nous devrons veiller à ce que l’OFB ait bien les moyens humains et financiers d’agir efficacement et concrètement. Nous avons en effet le talent formidable de construire des outils magnifiques, mais parfois, par une bizarrerie propre à notre pays, Bercy empêche les établissements ainsi créés pour le bien commun d’avancer au rythme souhaité. Nous devrons donc continuer à mener ce combat, comme chaque année, au moment de l’examen du budget. Il y a actuellement des tensions sur le futur budget de l’établissement public fusionné.
Le travail en bonne intelligence avec toutes les parties intéressées – agriculteurs, acteurs économiques, chasseurs, organismes privés et publics, ONG, scientifiques – devra se poursuivre, car il sera primordial pour le bon fonctionnement de ce nouvel office et pour le succès de ses missions.
Le groupe Les Indépendants soutient donc le texte issu de la commission mixte paritaire.
M. le rapporteur et M. Franck Menonville applaudissent.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, que cela a été difficile, tant dans l’hémicycle qu’en commission mixte paritaire ! Je tiens à le souligner, le Sénat a une fois encore fait preuve de son indépendance et de sa volonté de défendre les territoires ruraux. Je remercie le rapporteur, Jean-Claude Luche, la rapporteure pour avis, Anne Chain-Larché, ainsi que tous mes collègues du groupe d’études « Chasse et pêche », qui ont, comme d’habitude, fait preuve d’une solidarité totale.
Je tiens également à le souligner, l’économie générale de l’accord conclu entre le Président de la République et la Fédération nationale des chasseurs a été respectée. Je citerai, en vrac, le permis à 200 euros, la gestion adaptative, l’éco-contribution, la police de l’environnement ; tous ces dossiers, que la FNC avait portés, ont été préservés et maintenus dans le texte. En outre, c’est important, le statut des associations de chasse agréées a été préservé. Tout cela est positif.
Cela a été souligné à plusieurs reprises, le Sénat a apporté sa pierre à l’édifice, sur la gouvernance, sur la sécurité – je pense aux deux amendements du Gouvernement. Nous en avions discuté, madame la secrétaire d’État, et je tiens à souligner votre capacité de dialogue et votre ouverture, dont je vous remercie. Nous avons aussi introduit des mesures pour limiter les dégâts de grand gibier et les engrillagements. Tout cela va dans le bon sens.
Néanmoins, nous avons un sentiment d’inachevé sur certains dossiers. Je ne reviendrai pas plus longuement sur ce fameux délit d’entrave, qui a créé beaucoup de crispations et qui a suscité beaucoup de discussions. Cela dit, nous avons pris note de votre engagement, madame la secrétaire d’État, et de celui de la présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale d’envisager favorablement la proposition de loi que j’ai déposée il y a déjà quelque temps et qui sera très probablement débattue au Sénat au mois d’octobre.
Sur d’autres sujets, je le répète, nous avons un sentiment d’inachevé, voire de frustration.
Je pense tout d’abord aux agents contractuels des fédérations de chasseurs, qui voient leurs pouvoirs régresser quelque peu. Ils sont pourtant à la disposition du monde de la chasse et ils peuvent tout à fait être complémentaires des inspecteurs de l’environnement. Il y a là une réflexion à conduire avec vos services pour essayer de faire évoluer leur statut.
Je pense également à la contribution à l’hectare. Jean-Claude Luche l’a souligné, beaucoup de départements sont un peu réservés à cet égard. Nous n’avons pas pu maintenir la généralisation de cette contribution pour tous les territoires non chassés en raison d’un problème : un non-adhérent à la fédération des chasseurs ne peut pas cotiser à la fédération. Nous avons donc émis l’idée, en commission mixte paritaire, de discuter d’une solution dans le cadre de la loi de finances pour mettre en œuvre cette contribution généralisée à l’hectare.
Surtout, et M. Dantec et moi allons nous heurter de front, …
Sourires.

… la plus grande frustration que nous avons pu avoir procède du refus, par la rapporteure de l’Assemblée nationale, de la sanctuarisation des chasses traditionnelles et de la prise en compte de la notion de chasse durable pour la mise en œuvre de la gestion adaptative. Ce faisant, la tendance écologiste a révélé les limites que montrera, on peut le craindre, l’Office français de la biodiversité.
Monsieur Dantec, je crois que nous finirons l’un et l’autre notre mandat de sénateur sans jamais tomber d’accord.

M. Jean-Noël Cardoux. Nous sommes cependant d’accord sur une chose : face au combat extrêmement difficile que nous allons devoir mener dans les mois et les années à venir pour la défense de l’environnement, chasseurs, pêcheurs et écologistes doivent se poser non pas en adversaires
M. Ronan Dantec applaudit.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe socialiste et républicain.

Reste que les moyens pour y parvenir ne sont pas du tout ceux que vous préconisez. Nous pourrions en parler longtemps, en évoquant la tourterelle, les quotas ou encore le comité d’experts… Vos propos sont mal perçus par les gens modestes…

M. Jean-Noël Cardoux. … de la base, du monde rural, par les gens qui veulent continuer de vivre dans le milieu qu’ils préfèrent.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, j’ai souvenir d’avoir, voilà près de vingt ans, fait voter par l’Assemblée nationale une loi relative à la chasse. Cette loi avait suscité tellement de passions et d’excès, même s’il s’est finalement avéré, à l’usage, que ce texte permettait de rétablir les équilibres et d’engendrer une chasse apaisée et durable, que je redoutais un peu que le présent projet de loi, intervenant presque deux décennies plus tard, suscite les mêmes passions et les mêmes excès. Or je m’aperçois que ce texte, qui aboutit aujourd’hui à son terme, a été examiné dans un climat apaisé, qu’il a donné lieu à des négociations, à des discussions, même si chacun sur ces travées a fait valoir les droits des territoires qu’il défendait et de la ruralité, mais avec beaucoup de responsabilité.
Je veux saluer le travail de tous les parlementaires, des membres du groupe d’études « Chasse et pêche » et des rapporteurs, mais aussi le vôtre, madame la secrétaire d’État, et celui de Sébastien Lecornu. Vous avez su conduire avec succès les concertations et les négociations qui ont abouti à ce texte d’équilibre, qui donnera satisfaction, je l’espère, tant aux environnementalistes qu’aux chasseurs.
Ce projet de loi est issu d’un document adopté à 98 % par les chasseurs, il y a deux ans, et qui a ensuite été négocié avec le Gouvernement. Il procède aussi de la volonté du chef de l’État et de Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs, qui, avec beaucoup de témérité et de courage, mais aussi en acceptant des concessions, a permis que ce texte soit élaboré et adopté en incluant des éléments non seulement pour la chasse, mais aussi pour la biodiversité.
Ce texte ne comporte pas seulement le permis à 200 euros. Cela dit, si ce dispositif est l’occasion d’élargir le nombre de chasseurs et d’engendrer plus de mobilité pour la chasse, il représente aussi une redoutable responsabilité pour le monde de la chasse, qui doit assumer les dégâts de gibier – un vrai problème pour les maires ruraux –, au travers de la taxe à l’hectare, évoquée à l’instant. On le sait, les dégâts de gibier se concentrent sur peu de départements et, au sein de ces départements, sur peu de communes. C’est aux fédérations des chasseurs de l’assumer pleinement, et je crois qu’elles le font aujourd’hui avec beaucoup de responsabilité.
Je suis fier que l’éco-contribution de 5 euros par permis de chasse, complétée par une contribution de l’État de 10 euros, soit répartie à l’échelle nationale pour financer non pas des territoires ou des fédérations, mais des projets. Ainsi, là où il y aura de bons projets pour la biodiversité, la Fédération nationale saura, j’en suis convaincu, étudier ces projets et les assumer pleinement.
Je sais que cela a été un sujet de débat entre nous, mais la raison l’a emporté. Ce qui compte, c’est le financement de projets de biodiversité et non une répartition en fonction du nombre de chasseurs. Sans cela, les grosses fédérations – je n’en citerai pas –, qui comptent jusqu’à 30 000 chasseurs, auraient beaucoup d’argent et peut-être peu de projets, et, inversement, les petites fédérations, ayant peu d’argent parce qu’elles comptent peu de chasseurs, ne pourraient pas financer leurs projets.
Je suis de ceux qui croient que l’argent de l’eau doit aller à l’eau et que l’argent de la chasse doit aller à la chasse. Cependant, pour mettre en œuvre la réforme, nous avions besoin, pour cette première année, de financements croisés. Pour les années à venir, ce sera à l’État, dans le cadre de ses fonctions régaliennes, d’assumer l’expertise en matière de biodiversité. Nous devons œuvrer en ce sens, afin d’obtenir non plus des financements croisés, mais des financements dédiés.
Un autre sujet est celui de la gestion adaptative. Qui aurait pu croire, voilà deux ans, que nous aboutirions à un consensus en la matière ? Aujourd’hui, il existe un effet de cliquet, qui fait qu’une espèce est classée non chassable ou chassable à vie. Pourtant, certaines sont en expansion. Je pense notamment aux cormorans ou aux goélands. Nous évoquerons tout à l’heure le problème de la tourterelle des bois. J’ai apporté des éléments de réponse sur ce sujet à mon ami Ronan Dantec.
La disparition de cet effet de cliquet permettra une gestion intelligente des espèces, grâce à l’expertise de l’Office, dans un esprit de responsabilité et une volonté de sauvegarde des espèces.
J’évoquerai enfin la police rurale. Je crois que nous serons, demain, le seul pays en Europe à avoir une vraie police rurale, ce qui répond à la demande des maires ruraux et des agriculteurs. Plutôt que de s’arc-bouter sur le mot d’ordre « Touche pas à mon office » ou de tenter de récupérer certaines prérogatives, mieux valait mettre en place cette police rurale, qui sera en mesure d’agir sur tout le territoire, dans le cadre d’une plus grande proximité et d’une meilleure efficacité. C’est l’une des grandes avancées de ce texte.
À l’instant, M. le président du groupe d’études « Chasse et pêche » évoquait le problème des agents de développement des fédérations. J’ai une part de responsabilité à cet égard. Toutefois, je m’en suis entretenu avec vous, madame la secrétaire d’État, nous pourrons examiner, dans le cadre d’une évolution future, la manière de redonner aux agents de développement le pouvoir de verbaliser partout sur le territoire.
Ce texte n’est pas seulement relatif à la chasse, il porte aussi sur la ruralité et la biodiversité. Il permettra, ce qui est notre responsabilité à tous, une chasse apaisée, reconnue comme telle, et de respecter nos exigences environnementales. Telles sont les raisons pour lesquelles nous le voterons.
M. Arnaud de Belenet applaudit.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, chers collègues, nous examinons les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité. Cette CMP s’est finalement avérée conclusive, ce que nous n’espérions plus, tant le texte de l’Assemblée nationale avait été dénaturé par le Sénat.
À contre-courant des attentes de nos concitoyens, certains auraient bien voulu transformer ce texte important pour la biodiversité en texte pour la chasse et pour les chasseurs.
Néanmoins, c’est avec soulagement que nous accueillons finalement ce compromis, proche du texte de l’Assemblée nationale. Le projet de loi, qui vise à renforcer les moyens de l’action publique pour défendre la biodiversité, n’a pas été, au bout du compte, trop dévoyé. C’est un soulagement, car certaines dispositions votées au Sénat étaient de nature à aggraver l’effondrement en cours de la biodiversité. Je pense notamment à l’autorisation de techniques d’un autre temps, comme la chasse à la glu, ou à l’extension de la chasse aux oiseaux migrateurs, proposées alors même que la France a perdu près du tiers de ses oiseaux depuis le début du siècle.
Je peux rassurer mes amis chasseurs : ils seront toujours autorisés à chasser une vingtaine d’espèces d’oiseaux menacés et pourront même chasser deux nouvelles espèces.
C’est également un immense soulagement de voir disparaître l’odieux délit d’entrave à la chasse, qui remettait en cause l’accès pour tous à la nature et ravivait des clivages inutiles entre les différents usagers. Les trop nombreux accidents de chasse ayant coûté la vie à des promeneurs nous rappellent qu’une réflexion devra être menée, pour garantir à chacun un accès, en toute sécurité, à l’espace naturel, qui constitue notre patrimoine commun.
Ces scories retirées, nous pouvons nous féliciter du renforcement des prérogatives des inspecteurs de l’environnement, des nouvelles dispositions permettant de mieux protéger la biodiversité ultramarine ou de celles permettant de lutter contre la biopiraterie.
Nous saluons la création d’un établissement unique doté de moyens mutualisés, bien qu’insuffisants, pour agir au service de la reconquête de la biodiversité, souhaitée par toutes les associations de protection de l’environnement depuis le Grenelle.
Toutefois, sur certains points, notre inquiétude demeure.
Premièrement, l’affectation de 15 millions d’euros d’argent public à un fonds géré par la Fédération nationale des chasseurs, et dont l’utilisation est renvoyée à une éventuelle convention postérieure, dans le cadre d’un procédé peu transparent, alors même que le nouvel office manque de moyens financiers, que l’on ponctionne encore le budget des agences de l’eau pour le financer, que la suppression des postes d’inspecteurs de l’environnement se poursuit et que l’on déplore des trous dans la raquette en termes de maillage territorial.
Nous espérons que le prochain budget actera le début des subsides promis à l’époque par Nicolas Hulot, à savoir 600 millions d’euros supplémentaires pour le plan Biodiversité. Vous n’avez pas jugé opportun, madame la secrétaire d’État, de les inscrire dans le dernier projet de loi de finances, préférant créer ce nouvel office avec un déficit structurel de près de 40 millions d’euros. Nous vous demandons de rassurer la représentation nationale sur ce point. Vous venez de le confirmer, il n’y aura pas de nouveaux prélèvements sur les agences de l’eau, ce dont je me félicite. La sanctuarisation du budget de l’OFB est indispensable. Ponctionner les agences, c’est limiter les investissements en matière d’eau potable et d’assainissement, donc agir moins en faveur de la biodiversité. Ce serait un comble, au moment où l’on demande aux intercommunalités de prendre la compétence eau et assainissement et où les besoins d’investissements sont croissants, alors même que les Assises de l’eau mettent en lumière d’importants besoins liés aux conséquences des changements climatiques sur l’état et la répartition des masses d’eau !
Comme je l’évoquais en première lecture, le Gouvernement est devenu spécialiste en « plomberie administrative » : on réorganise, tout en espérant améliorer l’action publique à moyens constants, voire pire, avec moins de moyens. On doit vous reconnaître un certain talent dans la gestion de la pénurie. Néanmoins, quelle que soit l’efficacité opérationnelle du nouvel office, il ne pourra pas grand-chose sans moyens, et notamment sans moyens humains.
Les syndicats de personnel dénoncent un plan social : la suppression de 127 postes, soit 5 % des effectifs. Triste incohérence ! Allez-vous stopper l’hémorragie humaine que connaît votre ministère ? Ce serait une nécessité pour déployer correctement l’Office dans les territoires. Le débat parlementaire n’aura malheureusement pas permis de lever cette inquiétude, pourtant soulevée dès la première lecture par la rapporteure à l’Assemblée nationale. Dans de nombreux départements, les effectifs planchers de l’office ne sont pas atteints. La présence des agents sur le terrain est pourtant la raison d’être d’une telle administration, qui ne pourra pas préserver la biodiversité depuis des bureaux parisiens.
Il faudra des agents sur le terrain, notamment pour déployer le plan Loup, qui est censé soutenir et accompagner le pastoralisme, améliorer les connaissances et expérimenter de nouvelles méthodes, indemniser les éleveurs et réguler les populations de loups ; un plan qui, pour l’instant, n’est pas entièrement financé. Assurer une inévitable cohabitation nécessite, sur le long terme, des moyens financiers et humains.
Dernier motif d’inquiétude : le compromis trouvé en CMP, qui voit l’État renoncer à sa majorité au sein du conseil d’administration de l’Office. Au regard des missions de police qui lui sont confiées, une telle décision est loin d’être anodine. Nous en sommes réduits à gager la responsabilité de tous les acteurs, ce qui n’est pas complètement rassurant.
Si nous regrettons également que des propositions intéressantes visant à améliorer la gestion des dégâts de gibier sur les ressources forestières aient fait les frais des âpres négociations qui se sont déroulées en CMP, nous savons parfois avoir le sens du compromis. Nous voterons donc en faveur de cette dernière mouture.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, comme nombre de nos collègues, nous nous félicitons de cette commission mixte paritaire conclusive sur ce texte qui suscite tant d’enjeux, mais aussi, nous le savons, tant de polémiques.
Ayant présenté un certain nombre d’amendements en faveur d’une meilleure gouvernance, partagée entre tous les usagers et les professionnels des espaces naturels – j’entends par là les chasseurs, mais aussi les forestiers et les agriculteurs –, je regrette, pour l’efficacité et l’équilibre de l’OFB, que certaines dispositions aient finalement été retirées de ce texte. En effet, tenir à l’écart de l’Office français de la biodiversité et de la gestion des plans de chasse les propriétaires agricoles ou forestiers, acteurs, selon moi, légitimes des territoires ruraux, ne me semble pas une posture souhaitable et durable.
Quel est l’intérêt d’ignorer des problématiques de multiusages bien réels, qui ne feront que s’exacerber ? Je pense notamment à l’amendement qui visait à prévoir la compatibilité entre les plans de chasse et les plans d’aménagement des forêts publiques, au regard des dégâts croissants de gibier sur des massifs forestiers affaiblis – on le voit aujourd’hui – par des déficits croissants et de plus en plus vulnérables aux attaques parasitaires. Quel est l’intérêt de refuser une gestion durable et partagée, responsabilisant l’ensemble des acteurs des territoires ?
Ainsi, en matière de gouvernance, le seuil minimum de 10 % des membres du conseil d’administration représentant les organisations professionnelles agricoles et forestières a été supprimé. Il demeure toutefois possible de déléguer des compétences du conseil d’administration à des commissions spécialisées. Nous comptons donc sur la sagesse des décisionnaires de l’OFB, qui les conduira, je l’espère, à s’emparer de ces options d’équilibre qui figurent encore dans le texte, pour une gouvernance plus légitime et, donc, plus durable au service de la biodiversité.
Il en est ainsi de la levée de l’obligation de constituer une réserve dans une ACCA pour le grand gibier ; de l’avis de la Commission régionale de la forêt et du bois pour fixer le nombre du grand gibier soumis au plan de chasse ; des pouvoirs renforcés du préfet pour lutter contre les dégâts du grand gibier ; et, enfin, de la péréquation entre la Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales de chasseurs qui comptent un faible nombre d’adhérents.
La commission mixte paritaire a également maintenu l’ajout introduit par notre collègue Daniel Dubois dans un souci d’efficacité visant à raccourcir le délai pour l’adoption par le maire de mesures de police administrative en matière de réglementation des déchets.
En revanche, cela a été dit, la CMP a supprimé l’article relatif au délit d’entrave, à la suite de l’engagement du Gouvernement de faire examiner la proposition de loi de notre collègue Jean-Noël Cardoux par le Parlement, ce que nous attendons tous dans les plus brefs délais, vu les tensions sociétales qui se manifestent aujourd’hui pour la chasse, comme pour d’autres activités pourtant régulièrement autorisées.
La commission mixte paritaire a également supprimé l’extension de la contribution à l’hectare aux territoires « susceptibles d’être chassés », ce qui risque, malheureusement, de créer des comportements d’aubaine.
Elle a rétabli la rédaction de l’Assemblée nationale sur l’encadrement du droit d’opposition à l’intégration d’un terrain dans une ACCA, une association communale de chasse agréée, en contradiction, je l’avais dit, avec une décision du Conseil d’État d’octobre 2018, fondée sur la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En matière de financement, elle a tout de même confirmé le souhait du Sénat, en sanctuarisant les ressources des agences de l’eau, vous l’avez dit, madame la secrétaire d’État. Elle a précisé le schéma de financement des actions en faveur de la biodiversité, en retenant le principe d’une contribution des fédérations départementales à un fonds géré par la Fédération nationale et dont l’utilisation sera déterminée par convention.
Enfin, elle a maintenu l’engagement de l’État à soutenir les efforts des fédérations à hauteur de 10 euros par permis de chasser validé dans l’année, en visant explicitement la réalisation des actions de protection ou de reconquête de la biodiversité.
Le texte final apporte donc un certain nombre d’avancées, sans écarter pour autant l’épée de Damoclès qui pèse désormais dangereusement sur la biodiversité en forêt, à savoir l’augmentation massive de dégâts de gibier dans un contexte, je l’ai dit, de vulnérabilité sans précédent des forêts, alors que le Gouvernement, dans le cadre du programme national de la forêt et du bois, incite à exploiter plus. De telles attentes, madame la secrétaire d’État, ne sont pas compatibles avec le renouvellement des forêts et mettent en danger la pérennité de nos massifs.

Nous comptons donc sur la lucidité des responsables de l’OFB pour trouver, dans les territoires, des équilibres respectueux des rôles et des réalités.
Le groupe Union Centriste apportera, dans sa grande majorité, son soutien aux conclusions de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’adoption du projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité par la commission mixte paritaire du 25 juin dernier est une très bonne nouvelle. La création de ce nouvel office permettra de renforcer et de rendre plus effective la lutte pour la sauvegarde, sur notre territoire, de la biodiversité, qui est aujourd’hui menacée. On ne peut donc que se féliciter de l’accord trouvé par les représentants des deux chambres, tant le sujet est important et l’attente de nos concitoyens, forte.
La fondation de l’OFB permettra une répartition plus homogène des équipes sur le terrain. Les représentants des chasseurs et pêcheurs entreront dans la gouvernance de l’établissement. Ils pourront ainsi s’impliquer mieux dans la réponse aux problématiques liées à la protection de la biodiversité. Les moyens de police de l’environnement pourront être mutualisés pour une meilleure efficacité.
La gestion adaptative des espèces, processus permettant de redéfinir cycliquement la gestion d’une espèce selon l’état de sa population, assurera une meilleure gestion de la biodiversité. À ce sujet, la commission a su trouver une position équilibrée quant aux obligations de transmission de données incombant aux chasseurs.
Le délit d’entrave à la chasse, qui avait été voté au Sénat, a finalement été retiré du texte. Son adoption aurait permis de sanctionner les individus empêchant ou gênant les chasseurs. Néanmoins, le Gouvernement s’est engagé à ce que la proposition de loi de notre collègue Cardoux, qui vise à sanctionner plus largement l’entrave aux activités légales, soit examinée devant les deux chambres. L’idée d’apporter une réponse pénale adéquate à cet inquiétant phénomène n’est donc pas abandonnée et fera l’objet d’une discussion au Parlement dans le cadre d’un véhicule législatif dédié.
Autre point positif : la discussion de ce texte a été l’occasion d’alerter sur la question de l’engrillagement. La pose sauvage de clôtures porte atteinte aux écosystèmes des milieux naturels. En Sologne, on compterait déjà 3 600 kilomètres de clôtures. Il est nécessaire que les élus se saisissent de cette question, qui peut être réglée au niveau des collectivités lors de l’élaboration des documents d’urbanisme.
En outre, si elle a abandonné l’extension des missions des fédérations départementales des chasseurs à la répression du braconnage, la commission a en revanche renforcé les pouvoirs du préfet dans le cadre de la lutte contre les dégâts de grand gibier.
Sur le plan financier, les recettes destinées aux actions en faveur de la protection et de la restauration de la biodiversité sont définies avec une plus grande précision : il s’agit d’une éco-contribution de 5 euros par permis de chasser et de 10 euros par l’État pour chaque permis de chasser.
La commission mixte paritaire a également maintenu avec raison la sanctuarisation des ressources des agences de l’eau votée au Sénat. Malgré les engagements pris, la question des ressources de l’établissement demeure posée. Je veux croire toutefois que le Gouvernement fournira à l’Office les moyens de mener correctement les missions qui lui ont été confiées. Vous venez d’ailleurs de nous le confirmer, madame la secrétaire d’État.
Les défis qui attentent l’OFB sont importants. En mai dernier, un rapport rédigé par un comité d’experts de l’ONU s’alarmait de la disparition de la biodiversité, menacée par des facteurs multiples, dont la déforestation, une utilisation trop intensive des ressources naturelles, la pollution ou encore les espèces exotiques invasives. Il est temps que toutes les parties prenantes travaillent ensemble pour enrayer ce phénomène d’extinction de la biodiversité, qui menace notre patrimoine commun, mais aussi nos économies et notre alimentation.
Le groupe Union Centriste votera en majorité pour ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, aboutir à un accord en CMP pour le projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement n’était pas gagné d’avance, tant s’en faut.
Je tiens à remercier mes collègues Jean-Claude Luche et Jean-Noël Cardoux pour le travail qu’ils ont accompli. Le texte que nous examinons contient en effet de nombreuses dispositions introduites par le Sénat, ce dont je me félicite.
Tout d’abord, la CMP a conservé nos principales propositions en matière de gouvernance de l’Office français de la biodiversité. Cet établissement issu de la fusion de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage était très attendu. Le Sénat avait été particulièrement attentif à la place des chasseurs au sein de ce nouvel établissement.
Les chasseurs sont des acteurs incontournables en matière de développement et de protection de la biodiversité. Il nous avait donc semblé normal qu’ils bénéficient d’une représentation minimale au sein du conseil d’administration. Le texte prévoit ainsi d’octroyer 10 % des sièges aux représentants des chasseurs et des pêcheurs.
L’État, quant à lui, ne disposera pas de la majorité au sein du nouvel établissement, mais uniquement d’un droit de veto. Il devra savoir convaincre ses partenaires et rechercher le consensus. Ce système fonctionnait parfaitement à l’ONCFS, et je ne doute pas qu’il en sera de même au sein du nouvel établissement.
Autre disposition à laquelle nous tenions : l’inscription dans la loi de l’engagement pris par l’État de contribuer à hauteur de 10 euros par permis de chasser aux actions réalisées par les fédérations de chasseurs en faveur de la biodiversité. Cet engagement de l’État permettra ainsi d’amplifier les projets que mènent déjà les chasseurs.
Par ailleurs, un dispositif de péréquation entre la Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales dotées d’un faible nombre d’adhérents sera également mis en œuvre. Cela devrait rassurer les fédérations départementales qui s’étaient inquiétées de l’impact d’un permis de chasser à 200 euros et des conséquences d’une taxe à l’hectare rendue obligatoire.
Autre sujet d’importance : la sécurité à la chasse. Chaque accident est un accident de trop. Le Sénat avait voté des dispositions permettant d’harmoniser les pratiques. Elles sont maintenues dans le texte, ce dont nous nous félicitons.
La CMP a également sanctuarisé les ACCA, ce qui est une bonne chose, car celles-ci contribuent au développement du gibier et de la biodiversité, en favorisant le regroupement de terrains morcelés de petite taille. Leur rôle n’est plus à démontrer. Elles sont la garantie d’une chasse populaire qu’il faut absolument maintenir.
Mais aboutir à un accord de la CMP suppose des concessions de part et d’autre. C’est savoir renoncer à des dispositifs auxquels nous tenions tout particulièrement. Le Sénat a pris ses responsabilités.
C’est le cas pour ce qui concerne la dénomination du nouvel établissement, issu de la fusion entre l’ONCFS et l’AFB, puisque le mot « chasse » disparaît. Souhaitons que ce ne soit pas de mauvais augure pour le monde cynégétique.
Tel est également le cas du délit d’entrave à la chasse. C’est une question extrêmement importante pour les chasseurs et qui nous concerne tous. Notre collègue Jean-Noël Cardoux a déposé une proposition de loi permettant de réprimer l’ensemble des entraves à l’exercice des libertés. Le Gouvernement a estimé que ce texte constituait un véhicule plus adapté pour aborder la question du délit d’entrave à la chasse. Je souhaite que le Sénat s’en saisisse dès la rentrée et qu’il soit examiné par les députés dans des délais rapides, conformément à l’engagement pris par le Gouvernement.
S’agissant des moyens tant humains que financiers du nouvel établissement, qui ne seraient pas au rendez-vous, nous resterons attentifs, l’État nous ayant souvent échaudés en la matière.
Vous avez pris, madame la secrétaire d’État, des engagements devant la Haute Assemblée. Nous vous avons entendue. Nous comptons sur vous pour trouver des solutions de financement pérennes pour l’OFB, tout en permettant aux agences de l’eau de réaliser leurs investissements en matière d’eau potable et d’assainissement. Sur ces points, nous serons particulièrement attentifs aux décisions qui seront prises lors du prochain budget. En attendant, nous voterons les conclusions de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la création de ce grand établissement public qu’est l’Office français de la biodiversité témoigne d’une volonté collective de préserver la biodiversité. C’est une dynamique qu’on ne peut que saluer.
Je le rappelle, le pilotage de la politique publique de protection de la biodiversité a déjà été réformé à l’occasion de la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Une nouvelle réforme de sa gouvernance est aujourd’hui engagée.
Ce texte fusionne deux établissements publics : l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et l’Agence française pour la biodiversité, issue elle-même d’une fusion de quatre établissements réalisée voilà moins de deux ans. Nous avons exprimé nos craintes s’agissant de la création d’un établissement tentaculaire, dans la mesure où nous avons avancé à l’aveugle, n’ayant même pas eu un retour d’expérience à la suite de la création de l’AFB. En effet, pour des raisons évidentes de calendrier, aucune audition n’a pu avoir lieu. Madame la secrétaire d’État, nous devons nous attacher à mettre en œuvre nos politiques publiques, notamment dans le domaine environnemental, sur le long terme, dans le cadre d’une stabilité ministérielle, en vue d’une plus grande efficacité.
La commission mixte paritaire a été conclusive, ce qui constitue déjà un premier pas. Pour autant, le texte issu de ses travaux ne permet pas encore de lever toutes les interrogations. De nombreuses questions se posent encore aujourd’hui, notamment sur la politique qui sera menée en matière de ressources humaines. Les agents seront-ils multitâches ? Quelle sera la division du travail ?
Certaines dispositions, qui figurent à l’article 4 et aux articles suivants, apportent des réponses à ces questions. Toutefois, d’un point de vue concret et opérationnel, nous avons peu d’informations pour appréhender l’avenir de l’Office à long terme.
Rappelons cependant les faits marquants de cette CMP : les chasseurs sont assurés d’être représentés à hauteur de 10 % au sein du conseil d’administration, conformément à la volonté du Sénat ; le texte sanctuarise l’engagement du Gouvernement à dépenser 10 euros par permis de chasse pour des actions contribuant à la protection de la biodiversité, comme le souhaitait le Sénat ; enfin, le délit d’entrave à la chasse a été retiré, puisque vous vous êtes engagée, madame la secrétaire d’État, à accueillir favorablement la proposition de loi de notre collègue Jean-Noël Cardoux instituant un délit d’entrave généralisé.
Je vous remercie de cet engagement auquel le monde rural est sensible. La violation du droit de propriété par des activistes vegans, sur des terrains de chasse, mais aussi sur des exploitations agricoles, est de plus en plus fréquente. Cette situation inacceptable est réellement préoccupante. Il faut donc agir pour préserver les activités légales et condamner fermement celles qui ne le sont pas.
Ce texte sera une réussite et le pari sera gagné s’il permet de mettre tous les acteurs autour de la table pour défendre la biodiversité : les associations environnementales, les chasseurs, les agriculteurs.
L’année 2020 sera une année importante pour la biodiversité, puisque le Congrès mondial de la nature se tiendra à Marseille. Par ailleurs, une conférence internationale sur la biodiversité interviendra la même année en Chine.
Au-delà de ces rendez-vous œcuméniques internationaux indispensables, l’engagement des acteurs locaux pour la reconquête de la biodiversité doit être soutenu.
Le groupe Les Républicains votera donc en faveur de ce texte, tout en invitant le Gouvernement à s’appuyer sur les acteurs locaux de terrain, notamment les élus, qui sont à la manœuvre pour opérer une reconquête nécessaire de la biodiversité, en métropole, mais aussi dans les outre-mer, là où la biodiversité est si riche.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Je remercie chacun des orateurs des remarques positives qu’il a pu faire. J’ai noté le soutien de Claude Bérit-Débat pour le groupe socialiste, de Ronan Dantec pour le groupe du RDSE, de Jérôme Bignon pour le groupe Les Indépendants, de Jean-Noël Cardoux, d’Anne Chain-Larché et de Guillaume Chevrollier pour le groupe Les Républicains, de François Patriat pour le groupe La République En Marche, de Guillaume Gontard pour le groupe CRCE, ainsi que de la majorité du groupe Union Centriste, exprimé par Anne-Catherine Loisier et Jean-Paul Prince.
Recueillir le soutien sur l’ensemble des travées montre qu’il s’agit d’un beau travail parlementaire sur un texte qui n’oppose pas chasse et biodiversité. Je rappelle qu’il a été adopté à l’Assemblée nationale avec 42 voix pour et 10 abstentions. Je me réjouis qu’un vote similaire, voire à l’unanimité puisse intervenir au Sénat.
Je veux revenir sur deux ou trois points soulevés au cours de la discussion générale.
La vigilance sera nécessaire concernant les permis bi-départementaux. Nous avons eu cette discussion avec la Fédération nationale des chasseurs, qui s’est engagée à évoquer ce sujet avec les fédérations départementales.
S’agissant de la lutte contre l’artificialisation des sols, le texte n’épuise évidemment pas la discussion sur ce sujet important. Au cours de l’avant-dernier Conseil de défense écologique, il a été identifié comme nécessitant une feuille de route opérationnelle. Il fait partie des points du plan Biodiversité. C’est un sujet interministériel, qui concerne le ministère de la transition écologique et solidaire, le ministère de l’agriculture ainsi que celui de la cohésion des territoires et du logement.
Pour ce qui concerne la gestion adaptative, le sénateur Dantec m’a interrogée au sujet des tourterelles. Nous passerons de 90 000 tourterelles chassables l’année dernière à 30 000 cette année. On peut encore progresser en la matière, mais une division par trois me semble aller dans le bon sens.
Par ailleurs, je confirme qu’il y aura bien un financement budgétaire. Le fonds dédié à l’éco-contribution, plus précisément la participation de l’État à l’éco-contribution, sera bien géré par l’OFB.
Concernant les effectifs, je vous redis l’attention toute particulière que je porte au personnel, afin de trouver la bonne organisation, pour parvenir à quelques gains de productivité sur les fonctions support, au moment du rapprochement, en particulier au plan national, et maintenir les agents au plus près du terrain. Pour les agents de développement, vous avez raison, nous devons trouver la bonne articulation – nous continuerons à la chercher.
De même, nous n’avons pas épuisé la totalité des sujets forêt et ACCA, mais nous continuerons à y travailler.
C’est donc un beau texte, équilibré, qui porte réforme de la chasse ; un texte qui permettra d’avancer sur les sujets liés à la biodiversité, et je vous remercie du compromis qui a été trouvé.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

La discussion générale commune est close.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale les textes élaborés par les commissions mixtes paritaires, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble de chacun des textes.
Je donne d’abord lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire pour le projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement :
I. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A Le I de l’article L. 110-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l’ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. » ;
1° L’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé : « Office français de la biodiversité » ;
2° Les articles L. 131-8 à L. 131-13 sont remplacés par des articles L. 131-8 à L. 131-11, L. 131-11-1, L. 131-11-2, L. 131-12 et L. 131-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 131 -8. – Il est créé un établissement public de l’État dénommé : “Office français de la biodiversité”.
« Art. L. 131 -9. – I. – L’Office français de la biodiversité contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu’à la gestion équilibrée et durable de l’eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. Il assure les missions suivantes :
« 1° Contribution à l’exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche ainsi que des missions de police sanitaire en lien avec la faune sauvage ;
« 1° bis
Supprimé
« 2° Développement de la connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, sur les services écosystémiques, sur les liens entre les changements climatiques et la biodiversité ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. L’office pilote ou coordonne les systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques et les milieux marins ;
« 3° Expertise et assistance en matière d’évaluation de l’état de la faune sauvage et de gestion adaptative des espèces mentionnée à l’article L. 425-15-1 ;
« 3° bis
Supprimé
« 4° Appui à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’eau et de la biodiversité, notamment à l’échelon territorial :
« a) Soutien à l’État pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l’article L. 110-3 et suivi de sa mise en œuvre ;
« b) Contribution à la lutte contre la biopiraterie et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;
« c) Appui à la mise en œuvre du principe mentionné au 2° du II de l’article L. 110-1 et suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;
« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales ainsi qu’aux actions de coopération ;
« e) Appui à l’État et à ses établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;
« f) Appui, en lien avec les comités de bassin, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;
« g) Appui aux acteurs socio-économiques et aux associations de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;
« g bis)
Supprimé
« h) Soutien financier, à travers l’attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et à travers la garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques ;
« 5° Gestion, restauration et appui à la gestion d’espaces naturels, notamment de zones littorales comprenant des récifs coralliens et des écosystèmes associés ;
« 6° Communication, sensibilisation du public, accompagnement de la mobilisation et formation :
« a) Accompagnement de la mobilisation citoyenne, de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de biodiversité, notamment sur le lien entre l’homme et la nature ;
« b) Formation, notamment en matière de police, et appui aux actions de formation initiale et continue, en particulier dans le cadre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’enseignement agricole ;
« c) Contribution à la structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;
« 7° et 8°
Supprimés
« Il est chargé pour le compte de l’État de l’organisation de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser.
« II. – L’intervention de l’Office français de la biodiversité porte sur l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.
« Il peut aussi mener, dans le cadre de conventions, des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie ou dans ses provinces, à la demande de ces collectivités.
« III. – L’office et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d’intérêt commun. Les régions ou les collectivités exerçant les compétences des régions et l’office peuvent mettre en place conjointement, dans le cadre d’une convention signée entre les parties, des agences régionales de la biodiversité auxquelles peuvent notamment s’associer les départements et les collectivités territoriales exerçant les compétences des départements. Ces agences exercent leurs missions dans le champ des missions de l’office, à l’exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser.
« Art. L. 131 -10. – L’Office français de la biodiversité est administré par un conseil d’administration qui comprend :
« 1° Un premier collège constitué par des représentants de l’État, des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’office et des personnalités qualifiées ;
« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d’organisations professionnelles agricoles et forestières, d’associations agréées de protection de l’environnement, de gestionnaires d’espaces naturels, des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;
« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des comités de bassin ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 4° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l’office ;
« 5° Un cinquième collège composé de deux députés dont un élu dans une circonscription ultramarine et de deux sénateurs dont un élu dans une circonscription ultramarine.
« Tout parlementaire membre du conseil d’administration de l’Office français de la biodiversité, désigné en raison de son mandat électif, peut être suppléé par un autre parlementaire issu de la même assemblée délibérante.
« Les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture désignent un commissaire du Gouvernement, qui appartient au premier collège. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour du conseil d’administration, provoquer la convocation d’un conseil d’administration extraordinaire ou s’opposer à une décision du conseil d’administration et solliciter une nouvelle délibération.
« Les représentants de la Fédération nationale des chasseurs, des fédérations départementales des chasseurs et de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique représentent 10 % des membres du conseil d’administration. Ce nombre de représentants fait l’objet d’une troncature à l’unité.
« Le conseil d’administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins.
« Il est composé de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées du premier collège.
« Le président du conseil d’administration est élu au sein du conseil d’administration par ses membres.
« Art. L. 131 -11. – Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l’Office français de la biodiversité.
« Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées et leur déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 131 -11 -1. – L’Office français de la biodiversité est doté d’un conseil scientifique, placé auprès du conseil d’administration.
« Ce conseil scientifique comprend une part significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.
« Art. L. 131 -11 -2. – Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l’Office français de la biodiversité définies à l’article L. 131-9 est placé auprès du conseil d’administration de l’établissement, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le conseil d’administration peut lui déléguer certaines de ses compétences.
« Art. L. 131 -12. – L’Office français de la biodiversité est dirigé par un directeur général, nommé par décret.
« Art. L. 131 -13. – Les ressources de l’Office français de la biodiversité sont constituées par :
« 1° Des subventions et contributions de l’État et de ses établissements publics ainsi que, le cas échéant, des gestionnaires d’aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 2° Les recettes des taxes affectées ;
« 3° Toute subvention publique ou privée ;
« 4° Les dons et legs ;
« 5° Le produit des ventes et des prestations qu’il effectue dans le cadre de ses missions ;
« 6° Des redevances pour service rendu ;
« 7° Les produits des contrats et conventions ;
« 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
« 9° Le produit des aliénations ;
« 10° D’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, sous réserve de ne pas dégrader les ressources des agences de l’eau. » ;
3° L’article L. 131-14 est abrogé ;
3° bis
Supprimé
4° À l’article L. 131-16, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».
II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la politique de l’eau et de la biodiversité pour la période 2019-2022.
III. –
Supprimé
Le III de l’article L. 334-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : «, et, le cas échéant, les périmètres de protection de ces réserves, prévus à l’article L. 332-16 » ;
2° Au 3°, les mots : « arrêtés de biotopes » sont remplacés par les mots : « arrêtés de protection des biotopes, des habitats naturels et des sites d’intérêt géologique » ;
3° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :
« 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l’environnement de la Polynésie française, des provinces de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna ;
« 11° Les aires marines ou ayant une partie marine délimitées par la France en application des instruments régionaux ou internationaux suivants :
« a) Au titre des instruments internationaux :
« – la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;
« – la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la 17e conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972 ;
« – la résolution n° 28C/24, adoptée par la 28e conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture le 14 novembre 1995, approuvant la Stratégie de Séville pour les réserves de biosphère et adoptant le cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère ;
« b) Au titre des instruments régionaux :
« – pour la Méditerranée, le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), signé à Barcelone le 10 juin 1995 ;
« – pour l’océan Atlantique du Nord-Est, l’annexe V à la convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime (ensemble un appendice 3 sur les critères de détermination des activités humaines aux fins de ladite annexe), signée à Sintra le 23 juillet 1998 ;
« – pour l’océan Atlantique, région des Caraïbes, le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées dans la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), signé à Kingston le 18 janvier 1990 ;
« – pour l’océan Indien, le protocole relatif aux zones protégées ainsi qu’à la faune et à la flore sauvages dans la région de l’Afrique orientale (ensemble quatre annexes), signé à Nairobi le 21 juin 1985 ;
« – pour l’Antarctique, l’annexe V au protocole au traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement, protection et gestion des zones, signé à Madrid le 4 octobre 1991 ;
« – pour le Pacifique Sud, la convention pour la protection de la nature dans le Pacifique Sud, signée à Apia le 12 juin 1976.
« Un décret en Conseil d’État définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d’autres catégories d’aires marines protégées. »
(Supprimé)
L’article L. 414-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « sauvage », sont insérés les mots : «, de la fonge, des végétations » ;
1° bis Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils assurent la validation et la gestion durable des données qu’ils produisent, collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics. Ils contribuent ainsi à la mise en œuvre du système d’information sur la biodiversité mentionné au 2° de l’article L. 131-9 et donnent accès aux données dans le respect des lois et règlements en vigueur. » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Office français de la biodiversité assure la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise en particulier les missions d’intérêt général qui sont confiées par l’État aux conservatoires botaniques nationaux. »
I A. – Au 3° du I de l’article L. 171-1 du code de l’environnement, les mots : « à titre professionnel » sont supprimés.
I. – Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 172-2, les mots : « dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région ou du département de leur résidence administrative » sont remplacés par les mots : « sur l’étendue du territoire national » ;
1° Le premier alinéa de l’article L. 172-4 est ainsi rédigé :
« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 et les autres fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités au titre des polices spéciales du présent code à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres dispositions législatives, ils exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;
1° bis AA Le début de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 172-5 est ainsi rédigé : « Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, avec l’assentiment…
le reste sans changement
1° bis A Le second alinéa de l’article L. 172-8 est ainsi modifié :
a)
Supprimé
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le fait, sans motif légitime, de ne pas déférer à la convocation à l’audition est constitutif de l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173-4 du présent code. » ;
1° bis L’article L. 172-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 affectés à l’Office français de la biodiversité peuvent recevoir du juge d’instruction des commissions rogatoires. » ;
2° L’article L. 172-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également procéder aux réquisitions prévues aux articles 77-1, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;
3° L’article L. 172-12 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Procéder à la saisie de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés ; »
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La saisie est constatée par procès-verbal établi par leurs soins. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L’article L. 172-13 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Sur autorisation du procureur de la République délivrée par tout moyen, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis dans un lieu de dépôt prévu à cet effet.
« Lorsque leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder :
« 1° À la remise des animaux non domestiques ou non apprivoisés et des végétaux non cultivés, saisis dans un état viable, dans le milieu naturel où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques ;
« 2°
Supprimé
« 3° À la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ;
« 4° Lorsque l’animal ne relève pas des 1° et 3° du présent II, à l’application des dispositions prévues à l’article 99-1 du code de procédure pénale ;
« 5° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l’article 41-5 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 3° et 4° du présent II, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 41-5 du code de procédure pénale.
« III. –
Supprimé
« IV. – Le placement, la remise dans le milieu naturel et la destruction sont constatés par procès-verbal. » ;
4° bis Le second alinéa de l’article L. 172-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l’exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. » ;
5°
Supprimé
I bis. – L’article L. 322-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont également habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173-4 du présent code. » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « ayant la qualité de fonctionnaire ou d’agent public » sont supprimés.
I ter. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article L. 332-20 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 173-4. » ;
b) Au dernier alinéa, les références : « L. 172-7 et L. 172-8, L. 172-12 » sont remplacées par les références : « L. 172-7 à L. 172-9, L. 172-12 à L. 172-14 » ;
2° L’article L. 332-25 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « la réglementation de la réserve naturelle prévue par l’article L. 332-3 », sont insérés les mots : « ou de son périmètre de protection prévu à l’article L. 332-17 » ;
b) Le 4° est abrogé.
I quater. – La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 428-21 est ainsi rédigé :
« Par ailleurs, les agents de développement mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 421-5 constatent par procès-verbaux, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les infractions relatives au schéma départemental de gestion cynégétique, au plan de chasse et au permis de chasser, sur tous les territoires du département dont les propriétaires et détenteurs du droit de chasse sont adhérents d’une fédération, sauf opposition préalablement formée par ces derniers. » ;
2° À l’article L. 428-29, après la référence : « 3° », est insérée la référence : «, 4° ».
I quinquies
II. – Après le 5° bis du I de l’article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172-4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions qu’ils sont habilités à rechercher ; ».
II bis. – Le quatrième alinéa de l’article L. 161-12 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l’exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. »
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la loi prévoit que ces fonctionnaires et agents peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois spéciales mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
2°
Supprimé
3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 41-5, le mot : « ou », est remplacé par les mots : «, à l’Office français de la biodiversité ou à » ;
4° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 99-2, le mot : « ou » est remplacé par les mots : «, à l’Office français de la biodiversité ou à » ;
5° Le premier alinéa de l’article 230-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et les agents des services fiscaux » sont remplacés par les mots : «, les agents des services fiscaux et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et aux inspecteurs de l’environnement mentionnés au même article L. 172-1 » ;
6°
Supprimé
IV. – À l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « ou des services de l’administration des douanes » sont remplacés par les mots : «, des services de l’administration des douanes ou des services de l’Office français de la biodiversité ».
(Supprimé)
L’article L. 944-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « livre », sont insérés les mots : «, du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV du code de l’environnement » ;
2° Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».
Au 3° du II de l’article L. 173-1 du code de l’environnement, les mots : « ou de suspension d’une installation » sont remplacés par les mots : «, de suspension ou de remise des lieux en état d’une installation ou d’un ouvrage ».
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 411-5 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous les spécimens interdits d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non domestiques est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, déterminées par la Commission européenne en application de l’article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro-organismes utiles aux végétaux au sens de l’article L. 258-1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture ; »
b) Le 2° du même I est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous les spécimens interdits d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non cultivées est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, déterminées par la Commission européenne en application de l’article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201-1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture. » ;
c) Au II, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif » ;
2° L’article L. 411-6 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste d’espèces animales ou végétales interdites est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union, déterminées par la Commission européenne en application de l’article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro-organismes utiles aux végétaux au sens de l’article L. 258-1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture. » ;
b) Au premier alinéa du II, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif ».
I. – Après le 10° de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° La prévention de l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets. »
II. – L’article L. 541-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de dix jours » ;
2°
Supprimé
Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 415-3, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 428-4, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
(Supprimé)
Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre III est ainsi modifiée :
a) À l’intitulé, les mots : « et validation » sont remplacés par les mots : «, validation, rétention et suspension administratives » ;
b) Au 8° de l’article L. 423-11, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 423-25-4 ou » ;
c) Au 8° de l’article L. 423-15, la première occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423-25-4 ou » et la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou » ;
d) Le I de l’article L. 423-25 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° À toute personne faisant l’objet d’une mesure administrative de suspension du permis de chasser ou d’interdiction de sa délivrance en application des articles L. 423-25-2 ou L. 423-25-4 du présent code. » ;
e) Après la sous-section 6, est insérée une sous-section 6 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 6 bis
« Rétention et suspension administratives
« Art. L. 423 -25 -1. – En cas de constatation d’un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d’autrui, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 peuvent retenir à titre conservatoire le permis de chasser ou l’autorisation de chasser de l’intéressé. Ces dispositions sont applicables à l’accompagnateur du titulaire de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2.
« En cas d’accident ayant entraîné la mort d’une personne ou involontairement causé une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l’environnement retiennent à titre conservatoire le permis de chasser ou l’autorisation de chasser du chasseur.
« Art. L. 423 -25 -2. – Sur le fondement du procès-verbal constatant l’événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l’article L. 423-25-1, le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis ou de l’autorisation, prononcer la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser du chasseur impliqué pour une durée qui ne peut excéder six mois.
« À défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu au premier alinéa du présent article, le permis de chasser ou l’autorisation de chasser est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 423-25-4 et L. 423-25-5.
« En cas d’accident survenu à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction d’animaux d’espèces non domestiques ayant entraîné la mort d’une personne, la durée de la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser peut être portée à un an.
« Art. L. 423 -25 -3. – Dans le cas où la rétention du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser ne peut être effectuée faute pour le chasseur titulaire d’un tel titre d’être en mesure de le présenter, les articles L. 423-25-1 et L. 423-25-2 s’appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l’autorité qui le requiert son permis de chasser ou son autorisation de chasser dans un délai de vingt-quatre heures. Ces mesures s’appliquent également à l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2.
« Art. L. 423 -25 -4. – Saisi d’un procès-verbal constatant l’événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l’article L. 423-25-1, le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le chasseur impliqué n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser à l’encontre de l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2.
« Art. L. 423 -25 -5. – La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 423-25-4 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, survenu à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction. Le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut également prononcer une telle mesure à l’encontre de l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2.
« Art. L. 423 -25 -6. – Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 ou l’interdiction de leur délivrance ordonnée par le directeur général de l’Office français de la biodiversité en application des articles L. 423-25-2 ou L. 423-25-4 cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de chasser.
« Les mesures administratives prévues par la présente sous-section sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de chasser.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée des mesures administratives s’impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. » ;
2° Le chapitre VIII est ainsi modifié :
a) À l’article L. 428-2, la première occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423-25-4 ou » et la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou » ;
b) À l’article L. 428-3, la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou » ;
c) Après le 1° de l’article L. 428-15, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis En cas de violation manifestement délibérée, à l’occasion d’une action de chasse, d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; ».
(Supprimé)
I. – Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° A Le deuxième alinéa de l’article L. 421-5 est ainsi modifié :
aa)
Supprimé
a) À la deuxième phrase, après le mot : « information », sont insérés les mots : «, de formation » et, après le mot : « territoires », sont insérés les mots : «, du public » ;
b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Elles exercent, pour la gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui leur sont confiées par la section 1 du chapitre II du présent titre et coordonnent l’action de ces associations. » ;
1° Après le cinquième alinéa du même article L. 421-5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Elles conduisent des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation. À cette fin, elles contribuent financièrement au fonds mentionné à l’article L. 421-14, pour un montant fixé par voie réglementaire et qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l’année.
« Dans l’exercice des missions qui leur sont attribuées par le présent code, les fédérations départementales des chasseurs collectent ou produisent des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai.
« Elles collectent les données de prélèvements mentionnées à l’article L. 425-16. » ;
1° bis AA Le sixième alinéa du même article L. 421-5 est ainsi rédigé :
« Elles assurent la validation du permis de chasser ainsi que la délivrance des autorisations de chasser accompagné et apportent leur concours à l’organisation des examens du permis de chasser. » ;
1° bis AB Au premier alinéa de l’article L. 421-6, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du présent livre et du présent titre » ;
1° bis AC
Supprimé
1° bis A Le premier alinéa du IV de l’article L. 421-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette cotisation comprend la part forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs mentionnée à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 421-14. » ;
1° bis À la première phrase de l’article L. 421-11-1, après le mot : « gibier », sont insérés les mots : «, de gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées » ;
1° ter
2° Après le deuxième alinéa du même article L. 421-14, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elle conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation.
« Elle gère un fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations départementales, régionales et nationale des chasseurs dans le cadre d’une convention avec l’Office français de la biodiversité.
« Ce fonds est alimenté par le financement mentionné au sixième alinéa de l’article L. 421-5. L’État ou l’Office français de la biodiversité apportent, selon des modalités définies par convention, un soutien financier à la réalisation des actions mentionnées au même sixième alinéa et au troisième alinéa du présent article pour un montant de 10 € par permis de chasser validé dans l’année.
« Dans l’exercice des missions qui lui sont attribuées par le présent code, la Fédération nationale des chasseurs collecte ou produit des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai. » ;
2° bis AA
2° bis A Le même quatrième alinéa de l’article L. 421-14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine, dans les mêmes conditions, la part forfaitaire de ces cotisations destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs, selon que l’adhérent est demandeur d’un permis de chasser départemental ou national. » ;
2° bis B Les deux premières phrases du cinquième alinéa du même article L. 421-14 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, elle apporte aux fédérations départementales des chasseurs une aide financière dont le montant est fixé en fonction décroissante de leur nombre d’adhérents ; il peut être défini par voie réglementaire un nombre d’adhérents au-delà duquel cette aide n’est pas attribuée. » ;
2° bis C
2° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 422-3, au second alinéa de l’article L. 422-5, à l’article L. 422-8 et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 422-18, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la fédération départementale des chasseurs » ;
2° ter Au premier alinéa de l’article L. 422-5, le mot : « préfectoraux » est remplacé par les mots : « des décisions du président de la fédération départementale des chasseurs » ;
2° quater Au premier alinéa de l’article L. 422-7, les mots : « arrêtée par le préfet » sont remplacés par les mots : « fixée par le président de la fédération départementale des chasseurs » ;
2° quinquies A L’article L. 422-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit d’opposition mentionné au premier alinéa est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association. » ;
2° quinquies B L’article L. 422-23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « en faveur du petit gibier. Par exception, ces réserves peuvent également être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l’état des populations de ces espèces le justifie et qu’il est établi que la constitution de la réserve n’aura pas d’incidence négative, même à long terme, sur le maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique » ;
b)
Supprimé
2° quinquies Après l’article L. 422-25, il est inséré un article L. 422-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422 -25 -1. – En cas d’atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causés par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l’association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telle que la suspension de l’exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du conseil d’administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d’un an, pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu. » ;
2° sexies À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 423-1, les mots : « et de la cotisation nationale instituée à l’article L. 421-14 lorsqu’il s’agit de la chasse du grand gibier » sont supprimés ;
3° L’article L. 423-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » et sont ajoutés les mots : « et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d’accompagnateur » ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le président de la fédération départementale des chasseurs » et, après la dernière occurrence du mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « cette fédération avec le concours de l’Office français de la biodiversité. » ;
4° L’article L. 423-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423 -4. – I. – Il est créé un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l’Office français de la biodiversité et du fichier central des validations et autorisations de chasser géré par la Fédération nationale des chasseurs.
« Le fichier national du permis de chasser est géré conjointement par l’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs.
« Les fédérations départementales des chasseurs transmettent quotidiennement à la Fédération nationale des chasseurs la liste de leurs adhérents titulaires d’une validation ou d’une autorisation de chasser.
« L’autorité judiciaire informe l’Office français de la biodiversité des peines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. L’autorité administrative informe l’Office français de la biodiversité des inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes prévu à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.
« L’Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs mettent à jour leurs fichiers centraux et actualisent quotidiennement le fichier national du permis de chasser pour lequel ils disposent d’un accès permanent.
« II. – Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités de constitution et de mise à jour du fichier national mentionné au I du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité et les agents de développement commissionnés et assermentés des fédérations départementales des chasseurs consultent le fichier dans le cadre de leurs missions de police de la chasse. » ;
4° bis AA Le I de l’article L. 424-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’un terrain qui a été ainsi clos, pour que les dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d’indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I soient applicables, le terrain fait l’objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;
4° bis A L’article L. 424-8 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le 1° est complété par les mots : «, à l’exception des sangliers vivants » ;
– après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Interdits pour les sangliers vivants, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, mentionnés au II de l’article L. 424-3 ; »
b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, au sens de l’article L. 424-3, sont soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sangliers lâchés, sur lesquels ils réalisent un marquage. » ;
4° bis B À l’article L. 424-11, les mots : « grand gibier » sont remplacés par le mot : « cervidés » ;
4° bis CA L’article L. 424-15 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les règles suivantes doivent être observées :
« 1° Le port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand gibier ;
« 2° La pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou à proximité immédiate des voies publiques lors des actions collectives de chasse à tir au grand gibier ;
« 3° Une remise à niveau décennale obligatoire portant sur les règles élémentaires de sécurité pour les chasseurs selon un programme défini par la Fédération nationale des chasseurs.
« Ces règles générales s’imposent aux schémas départementaux de gestion cynégétique mentionnés à l’article L. 425-1. Ces schémas peuvent les compléter.
« Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après consultation de la Fédération nationale des chasseurs, précise ces règles générales de sécurité. Cet arrêté ne peut porter sur le temps de chasse.
« Au sein de chaque fédération départementale des chasseurs, est mise en place une commission départementale de sécurité à la chasse, composée de membres du conseil d’administration de la fédération. » ;
4° bis C L’article L. 425-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d’agrainage dissuasives en fonction des particularités locales. » ;
4° bis D
Supprimé
4° bis L’article L. 425-8 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « la », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « chambre d’agriculture, de l’Office national des forêts, de l’association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale des chasseurs. » ;
a bis) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes sont également consultées avant la mise en œuvre du plan de chasse. » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l’État dans le département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever annuellement dans l’ensemble du département, répartis par sous-ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d’âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d’animaux à prélever, le représentant de l’État dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département.
« Le représentant de l’État dans le département, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, modifie les plans de chasse individuels qui le nécessitent dans l’un des cas suivants :
« 1° Une défaillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse mentionné à l’article L. 425-6 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ;
« 2° Une augmentation importante des dégâts de gibier lorsqu’il est établi qu’elle résulte de prélèvements insuffisants. À cette fin, le président de la fédération départementale transmet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport sur les dégâts de gibier dans son département. » ;
4° ter L’article L. 425-10 est abrogé ;
5° Le chapitre V est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Gestion adaptative des espèces
« Art. L. 425 -15 -1. – La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l’état de conservation de leur population et de leur habitat, en s’appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations.
« La gestion adaptative repose sur un système de retour d’expérience régulier et contribue à l’amélioration constante des connaissances. Les modalités de cette gestion adaptative sont définies en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés.
« Un décret détermine la liste des espèces soumises à gestion adaptative.
« Art. L. 425 -15 -2. – Le ministre chargé de l’environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des espèces mentionnées à l’article L. 425-15-1 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l’Office français de la biodiversité, le nombre maximal de spécimens qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. Cet arrêté s’impose aux décisions prises en application du présent chapitre.
« Art. L. 425 -16. – I. – Tout chasseur est tenu de transmettre au fur et à mesure à la fédération départementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d’espèces soumises à gestion adaptative qu’il a réalisés. Cette obligation ne s’applique pas en cas d’absence de prélèvement.
« II. – Tout chasseur qui n’a pas transmis à la fédération départementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d’une campagne cynégétique, ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de la campagne cynégétique en cours ni lors de la suivante. Tout chasseur qui réitère ce manquement au cours d’une des trois campagnes cynégétiques suivant le précédent manquement ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de cette campagne cynégétique ni lors des trois suivantes.
« Art. L. 425 -17. – Les fédérations départementales des chasseurs transmettent à l’Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu’elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser.
« Art. L. 425 -18. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, y compris la nature des informations enregistrées et la durée de leur conservation. » ;
6° L’article L. 426-5 est ainsi modifié :
a) La troisième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, y compris de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l’article L. 421-14 » sont supprimés ;
– la seconde phrase est supprimée ;
6° bis À l’article L. 429-1, après la référence : « L. 422-26, », est insérée la référence : « du second alinéa de l’article L. 425-5, des articles » ;
7° À la fin du c de l’article L. 429-31, les mots : «, à l’exclusion des personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier » sont supprimés.
I bis. –
Supprimé
II. – L’exercice, par le président de la fédération départementale des chasseurs, des nouvelles missions prévues aux articles L. 421-5, L. 421-11-1, L. 422-3, L. 422-5, L. 422-7 et L. 425-8 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant des 1° A, 1° bis, 2° bis à 2° quater et 4° bis du I du présent article, fait l’objet d’une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l’Office français de la biodiversité.
(Supprimé)
Le troisième alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’environnement est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Des dérogations peuvent être accordées, s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et à la condition de maintenir dans un bon état de conservation les populations migratrices concernées :
« 1° Pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;
« 2° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ;
« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
« 4° Dans l’intérêt de la sécurité aérienne ;
« 5° Pour la protection de la flore et de la faune ;
« 6° Pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions. »
(Supprimé)
Le premier alinéa de l’article L. 332-8 du code de l’environnement est complété par les mots : «, ou à des fédérations régionales des chasseurs ».
L’ensemble des biens, droits et obligations de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sont transférés à l’Office français de la biodiversité.
Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
I. – Les fonctionnaires précédemment affectés, détachés ou mis à disposition au sein des établissements mentionnés à l’article 4 sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de l’Office français de la biodiversité jusqu’au terme de leur détachement ou de leur mise à disposition.
II. – Par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article subsistent entre l’Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.
III. – Par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, les contrats d’apprentissage conclus en application du chapitre unique du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article subsistent entre l’Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.
IV. – Les personnes titulaires d’un contrat de service civique conclu en application des articles L. 120-1 et suivants du code du service national dans les établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article restent soumises à leur contrat jusqu’à son terme. L’agrément délivré en application de l’article L. 120-30 du code du service national est réputé accordé.
V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les dispositions nécessaires pour diversifier et simplifier l’accès à la fonction publique au sein de l’Office français de la biodiversité.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux enjeux liés à la requalification des agents techniques de l’environnement en techniciens de l’environnement et aux voies d’accès à la catégorie statutaire A d’une partie des personnels occupant des fonctions d’encadrement.
L’élection des représentants du personnel au conseil d’administration prévue au 4° de l’article L. 131-10 du code de l’environnement intervient au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article.
La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections organisées en 2018 aux conseils d’administration des établissements mentionnés à l’article 4 de la présente loi auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Jusqu’à l’élection des représentants du personnel au comité technique et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Office français de la biodiversité, qui intervient au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent article :
1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Office français de la biodiversité est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2018 au sein des établissements publics mentionnés à l’article 4 auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité ;
2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics auxquels se substitue l’Office français de la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 110-3 est ainsi rédigé :
« L’établissement mentionné à l’article L. 131-8 apporte son soutien aux régions pour l’élaboration de leur stratégie et le suivi de sa mise en œuvre. » ;
1° bis À l’article L. 131-15, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « office » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 132-1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité, les parcs nationaux » et les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés ;
3° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 134-1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;
4° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 172-1, les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, dans les parcs nationaux et à l’Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « l’Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux » ;
5° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 213-9-1, à la fin de la première phrase et à la seconde phrase du V de l’article L. 213-9-2, à l’article L. 213-9-3, à la première phrase du V de L. 213-10-8, à l’article L. 331-8-1, à la fin du I de l’article L. 334-4, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334-5, au dernier alinéa de l’article L. 334-7, à la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 371-3, aux premier, deuxième et dernier alinéas du VI de l’article L. 412-8 ainsi qu’au II de l’article L. 437-1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;
5° bis À la fin de la dernière phrase du second alinéa du II de l’article L. 334-4, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « office » ;
5° ter À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 371-3, les mots : « délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « agences régionales de la biodiversité » et, à la fin, la référence : « à l’article L. 131-8 » est remplacée par la référence : « au III de l’article L. 131-9 » ;
6° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est abrogée ;
6° bis À l’article L. 420-4, la référence : « L. 421-1, » est supprimée ;
7° Au septième aliéna de l’article L. 422-27, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;
8° À la dernière phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 423-5, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 423-6, à la fin de l’article L. 423-9, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 423-11, à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 423-18, à l’article L. 423-27, au premier alinéa de l’article L. 425-14 et au deuxième alinéa de l’article L. 426-5, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».
II. – Au 4° du I de l’article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « lorsque l’établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l’Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il s’agit d’un établissement public de coopération environnementale ».
III. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À la fin du 3° bis de l’article 1519 C, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;
2° À la fin de l’intitulé de la section X du chapitre III du titre III, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;
3° À la fin de la première phrase de l’article 1635 bis N, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».
IV. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 205-1, les mots : « les agents assermentés de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les inspecteurs de l’environnement affectés à l’établissement mentionné à l’article L. 131-8 du code de l’environnement, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » ;
2° Au 2° du I de l’article L. 205-2, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;
3° Au début du dernier alinéa de l’article L. 221-5, les mots : « les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les agents de l’Office français de la biodiversité ».
IV bis. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l’article 2 bis de la présente loi, les mots : « aux établissements mentionnés aux articles L. 131-8 et L. 421-1 » sont remplacés par les mots : « à l’établissement mentionné à l’article L. 131-8 ».
V. – À l’article 1248 du code civil, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».
VI. – La cinquième ligne de la première colonne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi rédigée : « Direction générale de l’Office français de la biodiversité ».
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 221-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils interviennent dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement. »
II. – Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 171-3, il est inséré un article L. 171-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 171 -3 -1. – I. – Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d’analyses ou d’essais. Ces échantillons sont placés sous scellés.
« Dans le périmètre d’une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu’il peut assister au prélèvement. L’absence du responsable ou de son représentant ne fait pas obstacle au prélèvement.
« II. – Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d’analyses. Un exemplaire est conservé par le fonctionnaire ou l’agent chargé du contrôle aux fins de contre-expertise.
« La personne faisant l’objet du contrôle, ou la personne désignée pour la représenter, est avisée qu’elle peut faire procéder à ses frais à l’analyse de l’exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l’analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l’exemplaire peut être éliminé.
« Dans le cas où aucune contre-expertise n’a été sollicitée, le second échantillon est détruit au terme d’un délai de deux mois à compter de la date du prélèvement. » ;
1° bis L’article L. 171-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 171 -7. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an.
« Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent.
« L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.
« L’autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I :
« 1° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de ces mesures. L’astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. Les deuxième et dernier alinéas du 1° du II de l’article L. 171-8 s’appliquent à l’astreinte ;
« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites.
« II. – S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.
« Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision.
« III. – Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. » ;
2° L’article L. 171-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 171 -8. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement.
« II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :
« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.
« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;
« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
« 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte.
« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.
« L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.
« Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
« L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’État dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant-dernier alinéa du présent II. » ;
3°
III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public défini à l’article L. 322-9 du code de l’environnement, l’autorité désignée à l’article L. 322-10-4 du même code est substituée au représentant de l’État dans le département. »
Au 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, les mots : « temporaire ; la végétation » sont remplacés par les mots : « temporaire, ou dont la végétation ».
Les 3° et 4° du III de l’article 2, les 3° et 4° du I de l’article 3, les I à IV de l’article 5 ainsi que les articles 1er, 4, 6, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Jusqu’au 31 décembre 2019, la mission confiée à l’Office français pour la biodiversité par l’article L. 414-10 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du 2° de l’article 1er bis de la présente loi, est confiée à l’Agence française pour la biodiversité.
Jusqu’au 31 décembre 2019, les missions confiées au directeur général de l’Office français de la biodiversité par les articles L. 423-25-2 à L. 423-25-6 du même code sont confiées au directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Jusqu’au 31 décembre 2019, les données qui doivent être transmises à l’Office français de la biodiversité en application des articles L. 425-16 et L. 425-17 du même code et en application de l’article L. 421-5 dudit code, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l’article 3 de la présente loi, sont transmises à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, l’avis prévu à l’article L. 425-15-2 dudit code est émis par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Jusqu’au 31 décembre 2019, la convention mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 421-14 du même code, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 3 de la présente loi, est conclue avec l’Agence française pour la biodiversité. Le cas échéant, jusqu’au 31 décembre 2019, la convention mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 421-14 dudit code, dans sa rédaction résultant du même 2° du I de l’article 3, est conclue avec l’Agence française pour la biodiversité.
Jusqu’au 31 décembre 2019, la compensation financière prévue au II de l’article 3 de la présente loi est acquittée par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Jusqu’au 31 décembre 2019, le dernier alinéa de l’article L. 172-10 du code de l’environnement et l’article 390-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant du 1° bis et du 6° du III de l’article 2 de la présente loi, sont applicables aux inspecteurs de l’environnement affectés à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Jusqu’au 31 décembre 2019, l’article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du IV de l’article 2 de la présente loi, est applicable à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
(Supprimé)
Le I de l’article L. 640-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ;
2° La référence : « à L. 332-27 » est remplacée par les références : « à L. 332-19-1, L. 332-22 à L. 332-24, L. 332-27 » ;
3° La référence : « L. 334-1 à » est remplacée par les références : « L. 334-2-1 à L. 334-3, » ;
4° La référence : « L. 413-15 » est remplacée par les références : « L. 412-7, L. 412-9 à L. 413-15 » ;
5° La référence : « L. 414-9 à » est supprimée ;
6° La référence : « L. 415-3 » est remplacée par la référence : « L. 415-2-1 » ;
7° Le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;
8° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 332-20, L. 332-25, L. 334-1, L. 334-4, L. 334-5, L. 334-7, L. 412-8, L. 414-10 et L. 415-3 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. »

Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.

Sur les articles 1er, 1er bis A et 1er bis B, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.

L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Après la référence :
insérer les mots :
du I
La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Sur les articles 2 à 9 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.

L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1, au début
Insérer les mots :
Le 1° bis de l’article 1er bis,
La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Le vote est réservé.
L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
et l’article 390-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant du 1° bis et du 6° du III de l’article 2 de la présente loi, sont applicables
par les mots :
, dans sa rédaction résultant du 1° bis du I de l’article 2 de la présente loi, est applicable
La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Sur l’article 11, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’article ?…
Le vote est réservé.

L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
à L. 413-15
par les mots :
à L. 413-8
La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Gérard Poadja, pour explication de vote.

Trois ans après l’entrée en vigueur de la loi Biodiversité, nous allons adopter le projet de loi portant création de l’Office français de la biodiversité.
Contre toute attente, un accord a été trouvé.
Le texte de la CMP permet une représentation plus équilibrée des différentes parties prenantes. Madame la secrétaire d’État, vous avez précisé que le conseil d’administration comprendrait entre 30 et 40 membres. C’est un progrès par rapport au projet initial. J’avais d’ailleurs proposé par amendement que la loi fixe ce nombre à 30.
Autre évolution : l’État ne sera plus majoritaire mais décidera avec tous les acteurs concernés.
Ces avancées vont dans le sens d’une pluralité nécessaire au bon fonctionnement de l’Office.
Concernant les outre-mer, nous partions de loin ! Je rappelle que le texte initial ne comportait aucune référence aux territoires ultramarins. Un non-sens, quand on sait que 80 % de la biodiversité se trouve dans les collectivités d’outre-mer et que la France abrite, avec ces mêmes territoires ultramarins, 10 % des espèces connues au niveau mondial. La Nouvelle-Calédonie à elle seule est considérée comme le deuxième hot spot de la planète en matière de biodiversité, et 75 % des récifs français sont calédoniens.
Eu égard à l’immense richesse de la biodiversité ultramarine, il était inconcevable que ce projet de loi fasse l’impasse sur les outre-mer. Grâce à l’action des parlementaires, nos territoires ont trouvé une place dans ce dispositif : la représentation des Ultramarins et des bassins écosystémiques sera assurée dans le conseil d’administration. Mais, j’y insiste, une fois que la nouvelle structure sera mise en place, elle devra assurer la participation effective des outre-mer.
Je partage l’inquiétude de notre collègue Michel Magras sur l’absence de référence à un comité d’orientation dédié à la biodiversité ultramarine. Il faut à tout prix maintenir un espace de dialogue au cœur de l’OFB. Le futur office ne doit pas être une simple fusion de deux opérateurs. Il doit représenter toutes les parties, être le lieu de débats et porter une ambition nouvelle, à la hauteur de l’immense enjeu qu’est la biodiversité.
Pour conclure, j’indique que je voterai ce projet de loi, une majorité des collègues de mon groupe le votera également.

J’avais en première lecture voté contre le texte tel qu’il était issu du Sénat. Je reconnais bien volontiers que le texte de la commission mixte paritaire revient sur un certain nombre de dispositions que la majorité avait instillées dans le texte et qui me paraissaient extrêmement dommageables. Un seul exemple : l’un de nos collègues a évoqué les atteintes au droit de propriété par les vegans – ce sont ses propos, pas les miens ! J’ai quant à moi un autre point de vue.
Je suis élue d’un département forestier dans lequel les veneurs se déploient tous les week-ends et dans lequel les atteintes au droit de propriété sont constantes, aux dépens des riverains de la forêt. La cohabitation entre les veneurs et les populations devient de plus en plus tendue.
Je ne parle que de la vénerie. Je pourrais vous parler également des autres chasses que je considère comme cruelles et archaïques et qui n’ont plus lieu d’être.
Mes propos ne concernent pas la chasse à tir. Je regrette d’ailleurs que les chasseurs et leurs représentants coalisent l’ensemble des intérêts des différentes chasses, parce que, le plus souvent, ce n’est pas de toutes que l’on parle.
Dans mon département, chaque année, pendant les périodes de chasse, il y a des incidents graves entre les riverains de la forêt et les veneurs, puisque les grands animaux se réfugient dans les jardins, dans les centres-villes à présent, et, à chaque fois, la population prend la défense des grands animaux : les affrontements avec les veneurs sont nombreux.
Si l’on parle d’atteintes au droit de propriété, ayons à l’esprit que c’est contre le droit des habitants, sur leurs terrains, que les atteintes sont nombreuses !
Mes collègues, je crois, voteront le texte tel qu’issu de la CMP. Pour ma part, j’ai entendu les diverses assurances données par le Gouvernement concernant un futur texte législatif spécifique, relatif au délit d’entrave. Je sais quel en sera l’objectif : limiter, non pas les extensions de territoire des veneurs aux dépens des propriétés privées, mais l’action de ceux qui, aujourd’hui, portent la parole des habitants. Pour ces raisons, je m’abstiendrai sur ce texte.

Mon propos n’est pas réellement une explication de vote. Je viens d’écouter Mme Rossignol, et je suis assez surpris de l’entendre proférer un certain nombre de contrevérités.

Dans votre département, l’Oise, certains incidents survenus il y a environ dix-huit mois, à la fin de la saison de chasse à courre, ont été montés en épingle.
Vous dites que les veneurs squattent les forêts : ils sont, dans ces forêts domaniales, adjudicataires et parfaitement en règle ; ils ont le droit de chasser. Depuis ces incidents, la société de vénerie et la fédération nationale des chasseurs ont élaboré une charte opposable à tous les maîtres d’équipage. Si les chiens approchent à environ 1 kilomètre ou 1, 5 kilomètre d’une zone urbanisée, ils sont immédiatement arrêtés. Tout un protocole est prévu dans le cas où, par malheur, un animal se réfugierait dans un jardin. Pour l’épargner, un vétérinaire interviendrait éventuellement, avec une seringue hypodermique. Tout est réglé !
Je déplore ces agitations et désinformations sur la façon dont on chasse à courre – la chasse la plus naturelle qui soit. L’association AVA passe son temps à entraver la chasse dans tous les territoires, provoquant des incidents extrêmement graves. Nous sommes prêts à discuter de façon apaisée de tout cela, mais il n’est pas admissible, dans l’enceinte de la Haute Assemblée, de pratiquer une telle désinformation.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Paul Prince applaudit également.

Personne ne demande plus la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.
Je donne maintenant lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire pour le projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution :
La cinquième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifiée :
1° À la première colonne, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;
2° À la seconde colonne, les mots : « Présidence du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « Direction générale ».

Sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?…
Le vote est réservé.

Personne ne demande la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 165 :
Nombre de votants342Nombre de suffrages exprimés337Pour l’adoption337Le Sénat a adopté définitivement.
Applaudissements au banc de la commission. – MM. Yvon Collin et Jean-Claude Requier applaudissent également.

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2018 n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.

J’ai commis une erreur, monsieur le président : vous m’aviez dit que vous ne souhaitiez pas prendre part au vote ; malheureusement, j’ai glissé dans l’urne un bulletin « pour » qui portait votre nom.

M. le président. Rassurez-vous, je ne demanderai pas de rectification de vote.
Sourires.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-sept heures quarante-cinq.


La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires économiques, pour un rappel au règlement.

Avant d’entamer l’examen du projet de loi, je souhaite faire un rappel au règlement au nom de la commission des affaires économiques et, je le crois, de l’ensemble de nos collègues.
Le texte que nous examinons aujourd’hui engage la politique énergétique de la France pour le demi-siècle à venir. Nous allons évoquer les fermetures de centrales, le poids du nucléaire, les énergies renouvelables, le développement des filières industrielles, les tarifs réglementés, la rénovation des bâtiments, l’équilibre financier d’EDF… Bref, de petits sujets !
Sourires.

Depuis le début de l’examen du texte, nous subissons l’inversion de la hiérarchie des normes. Le Parlement se voit dans l’obligation de ratifier des éléments de la programmation pluriannuelle de l’énergie, déjà écrite : le règlement avant la loi ; c’est un comble !
Il y a eu un mois et demi de préparation à l’Assemblée nationale, car il s’agit d’un texte important. Au cours de cette période, le nombre d’articles est passé de 12 à 55. En revanche, on n’a laissé que quelques jours au Sénat pour auditionner le ministre, examiner les 43 articles additionnels introduits à l’Assemblée nationale et rédiger les amendements de la commission. Nos collègues, toutes travées confondues, n’ont eu que deux jours et demi – samedi, dimanche, donc le week-end, et lundi matin – après le dépôt du texte de la commission pour déposer des amendements.
Nous avons au Sénat des équipes qui ont travaillé nuit et jour, et pendant les week-ends, pour mettre ce texte à la disposition de l’ensemble de nos collègues. Je tiens à leur rendre hommage, tout comme je rends hommage aux deux rapporteurs, qui ont eu vingt-quatre heures pour examiner plus de 400 amendements.
Enfin, comme une apothéose, nous avons un ministre qui a démissionné deux heures avant le début de l’examen du texte ! Madame la secrétaire d’État, je vous remercie d’être là. C’est une forme d’héroïsme de votre part que de reprendre un texte aussi important pour notre pays sans l’avoir examiné et sans avoir été pleinement associée à sa préparation.
Je tiens à signifier notre mécontentement au Gouvernement. Nous sommes très mécontents de la manière dont le Sénat a été traité, de la désinvolture, notamment en ce qui concerne la place du Parlement, avec laquelle des enjeux aussi importants sont abordés et, plus généralement, des conditions dans lesquelles nous travaillons en cette fin de session parlementaire.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Acte vous est donné de ce rappel au règlement, ma chère collègue.
La parole est à M. Roland Courteau, pour un rappel au règlement.

Je déplore à mon tour, au nom du groupe socialiste, les conditions de travail exécrables qui nous sont imposées sur ce texte. Franchement, je n’avais jamais connu une telle situation, et je sais de quoi je parle !
Depuis quelque temps, nous sommes invités à légiférer en urgence et en effervescence. Avec les membres de mon groupe, nous souscrivons totalement aux propos de Mme la présidente de la commission des affaires économiques.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ainsi que Mme la présidente de la commission des affaires économiques l’a souligné, ce projet de loi est important. J’assurerai donc la continuité de l’État et la représentation du ministère de la transition écologique et solidaire pour que les débats puissent se dérouler dans les meilleures conditions possible et que le Sénat ait la possibilité de délibérer sur le texte.
Il y a en effet urgence. Partout, les signaux passent au rouge. Le vivant dans son ensemble s’érode. Comme nous le savons tous, la planète se réchauffe, et, avec elle, les conditions de notre pérennité risquent de s’éteindre également.
L’examen du projet de loi Énergie-climat s’inscrit dans ce contexte particulier. Durant le grand débat, les Français ont réaffirmé leurs exigences et leurs attentes. Le scrutin européen a confirmé la préoccupation, chaque matin plus grande, de nos concitoyens pour l’écologie. Voilà quelques jours encore, un épisode caniculaire exceptionnel nous rappelait que le dérèglement climatique peut bousculer nos économies, notre lien social, nos cultures, notre santé. Aujourd’hui, nous vivons un épisode de sécheresse ; soixante et un départements sont en alerte.
Il faut regarder la réalité en face. L’heure est à l’action. Un seul sujet doit importer : répondre à l’urgence, relever le défi de la transition écologique. En un sens, ce qui se joue, c’est bien l’avenir de la planète.
Mesdames, messieurs les sénateurs, l’écologie politique, celle que nous faisons aujourd’hui, peut changer durablement notre manière d’être. Face à l’urgence climatique, je crois aux actes concrets.
Pour répondre à une telle urgence, le Président de la République a souhaité que l’ambition écologique soit au cœur de l’acte II du quinquennat. Le Premier ministre l’a précisé dans son discours de politique générale au mois de juin : les mois à venir devront être ceux de l’accélération écologique.
Aller encore plus loin, c’est notre ambition. Elle s’inscrit dans le cadre de la mobilisation générale du Gouvernement et du ministère de la transition écologique et solidaire.
Depuis le début du quinquennat, le Gouvernement a mis fin à l’exploration et à l’exploitation des hydrocarbures. Il a mis en place des aides au bénéfice des Français, notamment des plus modestes, pour changer leurs manières de se déplacer, de se chauffer, de se loger. La finalité est de réduire notre dépendance aux fossiles et nos émissions de gaz à effet de serre.
Le Gouvernement a proposé une stratégie énergétique pour les dix années qui viennent, au travers de la programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas-carbone. Vous le savez tous, la programmation pluriannuelle de l’énergie relève d’un décret en vertu de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; le fait qu’il s’agisse d’un texte réglementaire a donc bien à un moment été le souhait du législateur.
La PPE, comme la stratégie nationale bas-carbone, repose sur des économies d’énergies – nous commençons par le principe de sobriété et de réduction de la consommation –, un développement massif des énergies renouvelables et la réduction de la part du nucléaire dans notre mix énergétique.
Nous avons également défendu à l’échelon européen et international le renforcement des normes environnementales favorables au climat et à la biodiversité. Plus récemment, nous avons travaillé avec toutes les parties prenantes dans les Assises de l’eau pour engager en deux phases des actions concrètes pour renouveler les réseaux, protéger les captages et économiser la ressource en eau.
Le projet de loi que vous examinez aujourd’hui amplifie et prolonge cette ambition écologique. Il comporte quatre objectifs principaux, que je souhaite rappeler ici.
Le premier est de permettre la publication et l’adoption de la programmation pluriannuelle de l’énergie, donc la mise en œuvre de notre stratégie énergétique pour les dix années à venir.
Le deuxième objectif est de réduire notre dépendance aux énergies fossiles, rehausser nos objectifs climatiques et adapter notre gouvernance pour les atteindre. Pour ce faire, à l’article 1er, nous fixons l’objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050. En termes de méthode, il s’agit de diviser les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six par rapport à 1990 ; c’est donc plus ambitieux que le texte actuel. Nous diminuerons encore davantage notre consommation énergétique primaire d’énergies fossiles, en passant avec cette loi de moins 30 %, qui est la base législative actuelle, à moins 40 % d’ici à 2030.
Nous avons également souhaité mettre en place une instance d’expertise scientifique indépendante. Le Haut Conseil pour le climat, créé à l’article 2 de la loi, sera chargé d’émettre des avis et recommandations sur l’ensemble des politiques publiques et sur leur conformité avec notre trajectoire climatique ambitieuse. Comme vous le savez, cette instance a commencé ses travaux et nous incite à aller plus loin et à mieux intégrer les enjeux écologiques dans toutes nos politiques publiques.
Le troisième objectif de ce texte est de nous donner les moyens d’assurer la fermeture des centrales à charbon en accompagnant les territoires et les salariés concernés. Le Président de la République en a pris l’engagement. C’est un choix fort pour le climat. Ces quatre centrales émettent près de 10 millions de tonnes de CO2 par an, soit à peu près l’équivalent de 4 millions de véhicules thermiques. L’article 3 du texte donne au Gouvernement l’assise juridique nécessaire pour procéder à la fermeture effective des centrales, en permettant à l’autorité administrative de plafonner leur durée de fonctionnement. Depuis dix mois, nous mettons tout en place pour nous donner les moyens juridiques, humains et territoriaux pour réussir cette mutation industrielle et accompagner les territoires et les salariés concernés. Notre objectif est de signer les projets de territoire sur les quatre territoires touchés avec les élus, les parties prenantes et les acteurs économiques d’ici à la fin de l’année 2019.
Enfin, le quatrième objectif est de régler des problèmes trop longtemps restés en suspens.
En matière d’autorité environnementale, l’insécurité juridique qui demeurait jusqu’alors favorisait les contentieux et fragilisait les petits projets d’énergies renouvelables, notamment solaires. L’article 4 doit permettre de sécuriser le cadre juridique de l’évaluation environnementale, afin de faciliter la concrétisation des projets en revenant au système en vigueur jusqu’alors.
Des dispositions ont été adoptées à l’Assemblée nationale pour accélérer plus encore le développement des énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque. Je m’en réjouis, pour la transition énergétique, pour nos territoires et pour les entreprises qui en bénéficieront.
Sur les tarifs de l’électricité, le Gouvernement a pris des engagements forts devant les Français : geler les hausses en hiver et augmenter le montant du chèque énergie pour atténuer les effets des augmentations. Néanmoins, au sein du Gouvernement, nous ne pouvons pas nous résoudre à être spectateurs d’un mode de calcul invariable. C’est pourquoi le projet de loi doit permettre de stabiliser les prix en relevant le plafond de l’Arenh à 150 térawattheures, ce qui permettra aux consommateurs français de profiter de la stabilité des prix du parc nucléaire.
Nous avons aussi fait procéder à une saisine rectificative du Conseil d’État pour que les éléments de la loi Pacte concernant les tarifs régulés du gaz et de l’électricité puissent être adoptés dans le cadre de ce projet de loi.
Le projet de loi a déjà été et continuera d’être enrichi par les débats parlementaires. Le travail fourni par les parlementaires le montre, les élus partagent le constat de l’urgence que je dressais voilà quelques instants. Ceux-ci ont souhaité l’inscrire au cœur même du texte, qui a été profondément enrichi à l’Assemblée nationale comme en commissions au Sénat ; jusqu’ici, plus de 378 amendements ont été adoptés.
Je sais que les parlementaires aspirent à être pleinement associés à la politique énergétique. C’est légitime, et j’y souscris. Le principe d’une loi de programmation quinquennale pour le climat répond à cette attente. Cette loi vous sera présentée à la prochaine échéance de la PPE, en 2023. Tous les cinq ans, le Parlement aura les moyens de s’assurer de la réussite de la transition énergétique et d’en fixer les prochaines étapes. C’est une évolution significative par rapport à la loi de 2015. En bref, le texte qui vous est présenté aujourd’hui sera l’occasion de renforcer l’implication et le travail du Parlement, afin que celui-ci joue pleinement son rôle dans la transition écologique.
Parmi les mesures supplémentaires que les députés ont souhaité introduire, je pense à la question essentielle de la rénovation des passoires thermiques ; elles sont une aberration écologique et représentent évidemment un coût pour nos concitoyens. C’est pourquoi, pour agir sans pénaliser les propriétaires, le texte a prévu trois phases : incitation, obligation, contrainte. Cette dernière phase sera définie lors de la programmation quinquennale de l’énergie en 2023. La convention citoyenne pour le climat pourra évidemment être associée à ces réflexions et proposer des mesures pour en accélérer le mouvement. Dans la première période, l’incitation, avec Julien Denormandie, nous retravaillerons à la simplification des aides, à l’amélioration des dispositifs d’accompagnement des particuliers, à l’amélioration de l’accompagnement des professionnels, à la gestion des copropriétés, pour en faire en sorte que le système soit le plus fluide, le plus opérationnel et le plus efficace possible.
Les amendements que le Gouvernement défendra au cours des débats visent principalement à préciser des éléments techniques, notamment sur la rénovation, sur les garanties d’origines et, plus largement, sur les tarifs du gaz et de l’électricité. De plus, nous avons souhaité soutenir l’hydrogène décarboné, produit à partir de l’électrolyse de l’eau, suite à de nombreuses demandes, pour profiter pleinement du mix électrique français. Nous souhaitons véritablement garantir l’efficacité de l’autorité environnementale à travers son organisation. C’est un impératif pour pouvoir atteindre nos objectifs en matière d’énergies renouvelables. Enfin, le Gouvernement doit conserver la possibilité de relever le plafond de l’Arenh. Nous en avons pris l’engagement devant les Français.
Avant le débat en séance, le texte qui nous rassemble aujourd’hui a pu bénéficier de l’expertise des sénatrices et des sénateurs en commission. Je comprends que les délais ont été très brefs. Je voudrais saluer l’investissement de tous ceux qui y ont travaillé jusqu’à présent.
Je vous remercie aussi d’avoir été constructifs, car nous avons l’occasion de trouver ensemble des terrains d’entente et de construire une vision et un plan d’action véritablement durables. Je crois pouvoir le dire, le travail a été riche, qu’il s’agisse de compléter la définition de la neutralité carbone, d’intégrer l’aspect social dans le plan stratégique d’EDF ou d’apporter des améliorations sur le contrat expérimental pour les solutions électriques renouvelables innovantes. De nombreuses autres précisions et simplifications soulignent la connaissance fine de nombre d’entre vous sur ces sujets.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je crois qu’il revient naturellement au législateur de fixer les orientations de long terme de la politique énergétique et climatique et au Gouvernement de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les réaliser. Ce texte répond à la nécessité que nous agissions et que chacun prenne ses responsabilités. Déjà enrichi par le débat parlementaire, il constitue une étape décisive dans la transition écologique. Je forme le vœu que les débats qui s’ouvrent aujourd’hui soient constructifs, exigeants et sincères. Je sais que ce sera le cas. Je serai à vos côtés dans ce débat.
Nous ne devons avoir qu’une seule bataille, une seule exigence : relever le défi de la transition écologique. C’est l’engagement du ministère de la transition écologique et solidaire, du Gouvernement et du Président de la République. Je sais pouvoir compter sur vous.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je commencerai en saluant Pascale Bories, rapporteure pour avis de la commission du développement durable sur ce texte, ainsi que Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques.
J’ai déjà employé la formule en commission, mais elle est toujours vraie : malgré l’inflation du nombre de ses articles, la « petite loi énergie » l’est encore, sans conteste, par son manque de vision stratégique à long terme.

Le Gouvernement a dit s’inscrire dans le prolongement de la loi de transition énergétique de 2015, mais cela n’empêchait ni l’ambition ni la volonté d’embrasser tous les grands sujets de la politique énergétique.
Or nombre de ces sujets sont absents du texte. Je pense en particulier aux enjeux de compétitivité de nos entreprises, car l’énergie est un poste important de leur budget, pour les industries intensives en énergie, bien sûr, mais pour toutes les entreprises en général. Je pense aussi à la manière dont nous pourrions mieux gérer nos formidables ressources de biomasse, qu’elles soient agricoles ou forestières, et mieux exploiter le potentiel de capture du carbone par nos sols et nos forêts. Je pense encore aux énergies renouvelables, au biogaz, à l’éolien, au solaire, à l’hydroélectricité, grande ou petite, ou à la géothermie, que le champ très restreint du texte déposé ne nous a permis que d’effleurer, sous peine d’encourir ensuite une censure du Conseil constitutionnel pour avoir introduit des « cavaliers ». En tant que rapporteurs, nous avons été frustrés. Je pense que nos collègues l’ont été également.

C’est seulement par voie d’amendement que le secteur du logement a été ajouté à l’Assemblée nationale !
Le projet de loi porte une seule ambition, ou presque : atteindre la neutralité carbone en 2050. C’est un bon objectif, mais encore faut-il savoir comment on y parvient. En la matière, le texte ne comportait qu’une seule mesure concrète – la fermeture des quatre dernières centrales à charbon d’ici à 2022 –, qui n’y suffira pas. Comme si l’essentiel était renvoyé à la convention citoyenne pour le climat, et si le Gouvernement comptait se défausser sur des citoyens tirés au sort…
En s’inscrivant dans la mécanique de la loi de 2015, ce texte organise aussi le dessaisissement du Parlement : on nous demande d’entériner dans la loi des évolutions décidées à l’avance, dans un projet de décret. En inversant ainsi la hiérarchie des normes, c’est un vrai problème de démocratie que l’on pose. Fort heureusement, grâce aux initiatives combinées de l’Assemblée nationale et de notre commission, c’est la dernière fois que nous vivons une telle situation : pour la prochaine PPE, c’est bien le Parlement qui fixera le cap et les priorités d’action, et ce sont la PPE et la stratégie bas-carbone qui seront chargées de les décliner !
Nous allons encore plus loin, en corrigeant une autre anomalie démocratique : celle qui fait que, aujourd’hui, c’est par simple décret qu’est fixé le volume des CEE, qui représentent pourtant plus de 3 milliards d’euros par an prélevés sur les consommateurs, soit 3 % à 4 % de leurs dépenses d’énergie. En 2023, c’est la loi qui fixera ce volume, sur la base d’une évaluation du gisement faite par l’Ademe.
En matière de nucléaire, la loi a au moins le mérite de reconnaître que la date de 2025 était non seulement irréaliste, mais surtout contre-productive sur le plan du climat, puisqu’il aurait fallu faire appel à des moyens thermiques supplémentaires pour assurer notre approvisionnement. Mais, désormais, c’est la question du nouveau nucléaire qu’on laisse en suspens, alors que le GIEC juge lui-même que le nucléaire fait partie des solutions pour limiter le réchauffement climatique.
Dans le cadre contraint fixé par les articles du texte initial, notre commission a cherché à promouvoir sa vision d’une bonne politique énergétique. Pour donner de la visibilité aux filières dans lesquelles la France a encore une carte industrielle à jouer, nous avons fixé des objectifs ambitieux, mais réalistes : atteindre au moins 27 gigawatts de capacités hydroélectriques installées en 2028 ; augmenter les capacités d’éolien en mer d’au moins un gigawatt par an d’ici à 2024, pour traduire dans la loi l’annonce faite par le Premier ministre dans son discours de politique générale ; cibler 8 % de biogaz en 2028 pour respecter l’objectif des 10 % fixé par la loi en 2030, alors que ce n’est pas le chemin que prend la PPE, ce qui est quand même un comble !
Sur le soutien au biogaz, j’entends bien les considérations budgétaires ; nous y sommes très attentifs, car c’est toujours le consommateur d’énergie qui paie à la fin. Mais j’observe qu’on consacre 7 milliards à 8 milliards d’euros par an pour l’électricité renouvelable, parfois pour des filières qui sont matures ou en passe de l’être, et que, dans le même temps, on hésite à mettre les quelques centaines de millions nécessaires au démarrage d’une filière non intermittente, riche en emplois localisés et porteuse de nombreuses externalités positives. Certes, comme en toute chose, il faut éviter les excès et s’assurer de la disponibilité de la ressource à l’échelle locale.
Pour accompagner nos industries françaises et européennes, ce sont aussi nos dispositifs de soutien qu’il faut revoir. Notre commission a voulu poser un principe : la prise en compte dans tous les mécanismes d’aides publiques du bilan carbone des projets. On veut mesurer notre empreinte carbone dans tous les secteurs. Il n’y a pas de raison que les énergies renouvelables fassent exception. Au contraire ! C’est leur objet même de décarboner notre énergie. Ce sera bon pour le climat et pour nos entreprises. Le droit européen ne s’y oppose pas, pourvu que ce bilan carbone soit analysé de manière transparente et non discriminatoire.
Pour encourager l’essor des énergies renouvelables, la commission a aussi consolidé ou ajouté plusieurs dispositifs, que ce soit pour simplifier encore les augmentations de puissance des installations hydroélectriques concédées, sans remise en concurrence ; faciliter le déploiement de centrales photovoltaïques sur les sites dégradés en zone littorale ; ou concilier le développement du solaire au sol aux abords des routes avec la préservation des surfaces agricoles.
Pour ne pas déstabiliser la filière du biogaz, nous avons aussi reporté de dix-huit mois la réforme des garanties d’origine et prévu un accès privilégié des collectivités à ces garanties pour préserver le lien avec les territoires. Sur ce point, je vous proposerai d’aller encore plus loin en séance.
En matière de rénovation énergétique des logements, la commission a souhaité tourner la page de la mise sous séquestre, qui avait un temps été imaginée à l’Assemblée nationale. Elle a réaffirmé la primauté de l’incitation, de l’information et de l’accompagnement sur la sanction. Non seulement la contrainte touche aussi les propriétaires occupants ou bailleurs aux revenus modestes, mais elle se révèle souvent contre-productive, notamment parce qu’elle sort un grand nombre de logements du marché. Nous avons donc renforcé l’information des locataires et des acheteurs, en ajoutant notamment le montant des dépenses théoriques dans le DPE, tout en rendant les dispositifs plus progressifs, avec un report à 2024 du conditionnement de la révision des loyers en zone tendue à l’atteinte d’une certaine performance énergétique.
La commission a aussi cherché à mieux accompagner les salariés concernés par la fermeture des centrales à charbon, ainsi que les consommateurs dans le cadre de la fin totale ou partielle des tarifs réglementés. Pour les premiers, nous avons réaffirmé le rôle de l’État dans la mise en place des mesures de reclassement et dit qu’il devra être tenu compte, quand ce sera possible, du statut des salariés. Pour les consommateurs, nous avons réintroduit le principe, déjà voté par le Sénat dans la loi Pacte, d’un prix de référence indicatif du gaz, qui sera calculé par la CRE et qui pourra servir de point de repère.
Enfin, sur l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, l’Arenh, la solution proposée par le Gouvernement répond à l’évidence à un enjeu de court terme, celui d’éviter la hausse des tarifs en cas d’atteinte du plafond. Elle n’exonère pas d’une réforme globale d’un système qui est aujourd’hui à bout de souffle. Sur ce point comme sur la réorganisation envisagée d’EDF, nous serons vigilants, je pense, sur toutes les travées, pour qu’un élément fort de notre patrimoine commun ne soit pas remis en cause.
En attendant, et même s’il s’agit d’une solution transitoire, on ne peut pas passer par pertes et profits la juste rémunération du parc historique. Pour concilier cet objectif avec celui, tout aussi légitime, de la stabilité des prix, la commission a lié le relèvement du plafond à la révision du prix et a mentionné explicitement la prise en compte de l’inflation, puisque le prix n’a pas évolué depuis 2012. On nous dit que la Commission européenne n’acceptera jamais la révision du prix. Si tel était le cas, pourquoi le Gouvernement fait-il croire que cette révision pourrait avoir lieu ?

Par ailleurs, si l’on explique à la Commission que ce sera la révision du plafond et du prix sinon rien, nous serons en position de force pour négocier, sachant que la simple prise en compte de l’inflation est une revendication raisonnable et, me semble-t-il, parfaitement audible par Bruxelles.
Au total, mes chers collègues, même si le texte n’a pas l’ambition que nous aurions souhaitée, la commission l’a adopté après l’avoir amendé dans le sens que je viens de vous présenter : de la visibilité et du soutien pour nos filières de l’industrie verte, de l’accompagnement pour les salariés, les entreprises et les consommateurs, de la simplification pour le développement des énergies renouvelables, et un rôle accru du Parlement pour fixer le cap de la politique énergétique !
Je tiens enfin à exprimer ma reconnaissance aux fonctionnaires de la commission qui ont travaillé pour que nous puissions examiner le projet de loi dans les meilleures conditions possible aujourd’hui.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe socialiste et républicain.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui le projet de loi relatif à l’énergie et au climat, pour lequel la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a reçu une délégation au fond de la commission des affaires économiques de neuf articles, notamment l’article 2, sur le Haut Conseil pour le climat, et l’article 4 sur l’autorité environnementale.
C’est une chance que deux commissions permanentes se soient penchées sur le berceau de votre politique énergétique. En effet, avec une seule petite semaine, le Sénat n’a pas disposé, le regrette, du délai suffisant pour examiner en profondeur ce texte, surtout avec quarante-trois articles additionnels. Pour un sujet majeur du quinquennat – vous venez de l’évoquer, madame la secrétaire d’État –, nous pouvons dire qu’il est bien rapidement traité !
Sur le fond à présent, l’urgence climatique nous oblige à prendre des décisions fortes pour demain et, surtout, à agir. Pour autant, elle ne saurait nous conduire à voter dans une hâte excessive un texte dont l’objet premier serait l’obtention d’un satisfecit médiatique. Il est facile d’annoncer de grands objectifs, encore faut-il être capable de transformer ces ambitions en réalité concrète.
À cet égard, je déplore le manque d’une dimension territoriale dans ce texte, s’agissant, en particulier, du volet du soutien financier aux actions des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, alors même que, comme vous le savez, la réalisation de cet objectif relève en grande partie d’actions locales.
Quelle ambition porte, en outre, un projet de loi qui crée, dans son article 2, un Haut Conseil pour le climat, lequel a pourtant été installé en novembre 2018 par le Président de la République et a remis son premier rapport il y a trois semaines ?
Ayant à cœur de nous montrer constructifs, nous avons, en commission, conservé dans cet article 2 de nombreuses propositions issues de l’Assemblée nationale qui nous semblaient indispensables et nous avons adopté plusieurs amendements visant à clarifier davantage les compétences et le fonctionnement de cet organisme.
S’agissant de la réforme de l’autorité environnementale, vous prétendez clarifier la situation à la suite de la décision du Conseil d’État d’annuler l’attribution au préfet de région de la compétence d’autorité environnementale responsable de l’évaluation de la qualité des études d’impacts réalisées. Loin de sécuriser les porteurs de projets, cette réforme risque pourtant de conduire à une multiplication des recours, compte tenu de l’absence d’autonomie de l’instance chargée d’examiner au cas par cas les projets par rapport à celle qui est compétente pour les autoriser.
Notre commission a donc souhaité sécuriser le dispositif retenu au regard du droit européen, en limitant les situations potentielles de conflit d’intérêts.
Enfin, je tiens à insister sur le manque d’anticipation du Gouvernement sur tous les plans.
Il est risqué, et je dirais même dangereux, de vouloir mener de front tous les combats, comme de fermer quatorze réacteurs nucléaires d’ici à 2035, concomitamment aux centrales à charbon. La priorité absolue est d’assurer la production d’une énergie décarbonée.
Il est encore plus risqué de prendre de telles décisions sans prévoir des dispositions spécifiques en faveur des milliers de salariés concernés par ces fermetures. Nous avons donc souhaité, avec mon collègue Daniel Gremillet, renforcer les mesures d’accompagnement de ces salariés.
Madame la secrétaire d’État, je ne crois pas être hors sujet en évoquant la sempiternelle question du mix énergétique. Ce projet de loi et la programmation pluriannuelle de l’énergie, dont le décret se fait attendre, s’appuient sur des hypothèses qui ne semblent pas gravées dans le marbre.
Dès son introduction, la PPE considère qu’« en 2050, la consommation d’électricité décarbonée pourrait atteindre entre 580 et 610 térawattheures ». Ce postulat repose cependant sur des projections d’économies d’énergie ou de développement des véhicules électriques qui relèvent parfois de la pensée magique. Comme ce fut le cas en ce qui concerne la fin de la vente des véhicules thermiques en 2040, inscrite dans la loi Mobilités, ce projet de loi valide des options technologiques qui pourraient nous conduire dans une impasse énergétique à moyen terme.
Nous n’avons pourtant qu’un horizon : décarboner notre production électrique. Je le dis sans enthousiasme, les leviers ne sont pas inépuisables. Les énergies renouvelables et le nucléaire seront le cœur de notre réponse, encore faut-il l’admettre puis s’y préparer. Quid des EPR ? Quid de l’accès aux métaux rares ? Avec quels partenaires l’assurerons-nous ? Ces questions, madame la secrétaire d’État, restent sans réponse.
Je déplore que ce texte, voté si rapidement, nous prive d’un véritable débat de fond sur notre politique énergétique. Je forme le vœu que, à l’avenir, nous puissions débattre au Parlement de cette question si essentielle de manière moins expéditive.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le projet de loi relatif à l’énergie et au climat qui nous est soumis aujourd’hui a d’abord pour fonction de permettre de publier la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie. Comme la PPE ne prévoit pas de baisse significative de la part du nucléaire dans les prochaines années, elle entrait en effet en contradiction avec la loi en vigueur, laquelle imposait la réduction rapide de cette part.
Il s’agit donc d’abord d’une loi de décalage des objectifs, qui vise à repousser la réduction de la part du nucléaire à 50 % en 2035, dix ans plus tard que ce que nous avions voté ici même il y a quelques années.

Cette loi peut donc être vue comme un signe de l’incapacité française à s’engager résolument dans la transition énergétique et comme une traduction de notre difficulté à concevoir la sortie en bon ordre de notre dévotion au dieu atome, dans lequel nous avons investi bien au-delà du raisonnable, comme l’histoire est en train de le démontrer.
En ce sens, je souhaite saluer les apports de la majorité sénatoriale et du rapporteur Daniel Gremillet, qui a intégré dans le texte la nouvelle ambition française dans le domaine des énergies renouvelables et notamment de l’éolien offshore ou du gaz renouvelable.
Il faudrait vérifier dans les archives, mais je ne suis pas loin de considérer qu’il s’agit d’une première historique : la majorité issue du gaullisme et du plan Messmer, moment socle du choix du tout-nucléaire, défend aujourd’hui clairement – j’ai bien entendu Daniel Gremillet – l’ambition des énergies renouvelables. Je me devais de le souligner.
Il s’agit d’une loi sur l’énergie et le climat. Est-il nécessaire de souligner que la question climatique est aujourd’hui un sujet central ? Tout ou presque a été dit sur le sujet. Ce que nous ne disons peut-être pas assez, c’est que l’enjeu de la réduction des émissions de CO2 françaises est une brique essentielle de la mobilisation mondiale.
La France, à travers les paroles fortes de son président – « make our planet great again » –, entend jouer un rôle de leader en Europe et dans le monde, ce qui n’est possible que si elle-même réduit ses propres émissions à la hauteur de ses engagements. Comment voulez-vous réussir à embarquer les autres pays vers le respect de l’accord de Paris si vos émissions augmentent, comme ce fut le cas entre 2015 et 2017 ?
Je souligne ce point, car un des arguments dilatoires les plus entendus, jusque dans cet hémicycle, est que la France ne pesant presque rien dans les émissions mondiales – aux alentours de 1 % –, il serait déraisonnable de s’engager autant sur la baisse de nos émissions. C’est totalement faux ! La France pèse la crédibilité de l’accord de Paris, il faut donc bien réduire nos émissions.
Or nous savons d’où ces dernières proviennent et ce qu’il convient de faire : il faut limiter la mobilité thermique rapidement et rénover les logements anciens et énergivores. Malheureusement, sur ces points, le Sénat n’a guère renforcé le projet de loi. Le débat à l’Assemblée nationale n’avait déjà pas brillé par le volontarisme à propos de la rénovation énergétique des bâtiments anciens et les trous dans la raquette étaient nombreux. Je regrette de devoir dire que la commission des affaires économiques saisie au fond a enlevé le reste du cordage !
Nous ne pouvons pas nous permettre de nous projeter à dix ans en matière de rénovation des bâtiments anciens, la crédibilité de la France sur le climat se joue dans ce que nous ferons, de manière volontariste, dans les trois ou quatre prochaines années.
Si le texte reste en l’état, la France ne tiendra pas ses engagements sur le climat, fragilisant alors tout l’édifice international de la négociation climatique. Notre responsabilité est donc importante.
Après notre rapporteur et la présidente de la commission, je considère qu’un texte aussi important nécessitait un temps de travail beaucoup plus long, en lien avec le prochain projet de loi de finances, car la question financière est au cœur de la problématique de la rénovation des bâtiments.

Je partage donc la frustration exprimée par mes prédécesseurs à cette tribune.
Gardons à l’esprit que, en matière de climat, ce que fait la France ne regarde pas seulement la France : c’est l’édifice international de l’accord de Paris qui se joue ici.
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain et du groupe Union Centriste. – M. Jean-François Husson applaudit également.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la pollution de l’air est la troisième cause de mortalité en France. Parmi ses principaux responsables, le transport routier est également le premier émetteur de gaz à effet de serre en France. Or, aujourd’hui, les poids lourds étrangers se soustraient de plus en plus aux péages autoroutiers en empruntant les routes nationales et départementales. Ce report de trafic cause d’importantes difficultés, notamment dans les départements frontaliers tels que la Moselle.
C’est à partir de ce constat, à la fois national et local, que je souhaite aujourd’hui défendre le retour au système de l’écotaxe sur les poids lourds. En effet, le projet d’écotaxe, qui a été malheureusement abandonné en novembre 2016, constituait un instrument pertinent de politique des transports et une réponse aux enjeux climatiques, écologiques et sanitaires actuels.
Il s’agit d’appliquer deux principes simples : celui de l’utilisateur-payeur, selon lequel les transporteurs routiers s’acquitteraient d’un droit d’usage, comme c’est le cas pour le rail, et celui du pollueur-payeur, qui conduirait le secteur routier à assumer ses nuisances et les émissions de CO2 dont il est responsable, qui restent aujourd’hui à la charge de la collectivité.
Certes, la ministre des transports a annoncé le 9 juillet que le remboursement partiel du gazole dont bénéficie ce secteur sera réduit de 2 centimes par litre. Toutefois, cette mesure est insuffisante. De plus, elle est injuste, puisque, dans les faits, les poids lourds étrangers y échapperont en faisant le plein de carburant au Luxembourg ou en Espagne, ce qui leur permettra de traverser la France sans y acheter une goutte de gazole.
Compte tenu des défis environnementaux que nous devons relever, il nous faut être plus ambitieux et développer des instruments plus stratégiques pour mettre réellement en œuvre la transition énergétique dans nos territoires. Je vous demande donc pourquoi vous refusez d’étudier la possibilité de rétablir une vraie écotaxe sur les poids lourds.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.

Madame la secrétaire d’État, tout d’abord, permettez-moi de vous dire que nous avons dû travailler sur ce texte dans la précipitation, ce qui ne permettra peut-être pas d’y apporter la contribution qu’il aurait méritée. En outre, ce projet de loi aurait pu être plus ambitieux, car les enjeux sont très importants et urgents. Je voudrais remercier nos rapporteurs et nos administrateurs, qui, malgré des conditions difficiles, ont fait un travail remarquable.
Ce texte confirme l’objectif d’une réduction à 50 % de la part du nucléaire dans la production d’électricité et le report de son échéance à 2035 au lieu de 2025. Cette proposition me paraît réaliste, car l’objectif initial était inatteignable.
Il prévoit la fermeture des centrales à énergies fossiles, notamment de celles qui fonctionnent au charbon, en 2022. C’est une mesure positive, car, si la part du charbon dans la production d’électricité n’est que de 1, 8 %, sa part dans les émissions de gaz à effet de serre est de 35 %. Il faudra cependant trouver des solutions alternatives afin de remplacer l’appoint que cette production assurait.
Je salue également le dispositif prévu pour encadrer la reconversion des salariés de ces centrales, qui vont perdre leur emploi – ce sera le cas aussi pour les sous-traitants –, et l’accompagnement des territoires concernés.
Un autre sujet essentiel traité est la politique de rénovation énergétique des bâtiments. Le secteur du bâtiment représente en effet 45 % de l’énergie finale consommée en France et 27 % des émissions de gaz à effet de serre. Rénover le parc permettrait d’endiguer ce problème.
La solution est de mettre en place et de financer un vaste plan de rénovation énergétique des logements. Ces travaux doivent être de grande ampleur et ne pas concerner uniquement le remplacement des fenêtres ou le changement des chaudières. C’est à ce prix que nous pourrons atteindre la neutralité carbone en 2050.
Concernant la question des passoires énergétiques dans les logements mis en location, une réglementation plus ferme envers les bailleurs devrait être édictée, classant comme impropres à la location les logements qui ne respectent pas un standard minimal de performance énergétique. Il serait toutefois important d’y associer des outils de financement incitatifs orientés vers les ménages à revenus modestes.
J’aimerais évoquer rapidement la filière éolienne, puisque la programmation pluriannuelle de l’énergie reprend l’objectif de développement des énergies renouvelables et renforce les trajectoires établies, en prévoyant ainsi, pour l’éolien terrestre, l’installation de 9 à 10 gigawatts par période de cinq ans.
Si les objectifs d’installation d’éoliennes et de capacité solaire – 50 gigawatts à l’horizon de 2028 – doivent compenser la diminution de la production nucléaire, force est toutefois de constater que la gestion des énergies renouvelables devient très complexe lorsque leur taux de pénétration dépasse 30 % du mix énergétique.
Le développement des énergies renouvelables en France doit donc rester pragmatique et modéré, afin d’éviter les surcoûts et d’accompagner l’augmentation de la demande d’électricité tout en diminuant les émissions de CO2.
Je me félicite donc du maintien d’une ambition importante de développement de l’éolien offshore, qui constitue un signal fort en faveur du développement de capacités industrielles nationales dans une filière en cours de structuration au niveau mondial.
Le groupe Union Centriste ne perd pas de vue qu’il est urgent d’agir pour le climat dans l’intérêt de nos concitoyens et des générations futures.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste. – Mme Christine Herzog applaudit également.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, face à l’urgence climatique, il n’y a pas une minute à perdre, mais il ne faut cependant pas confondre vitesse et précipitation : le Sénat est contraint d’examiner le projet de loi Énergie-climat dans un temps très court, trop court.
Cette petite loi de huit articles est devenue, sous la double action de l’Assemblée nationale et du Gouvernement, une petite loi de cinquante-six articles !
Nous regrettons vivement le calendrier imposé sur ce texte, madame la secrétaire d’État, qui ne permet pas l’examen de ses dispositions dans de bonnes conditions. Nous saluons, d’ailleurs, la proposition de redonner au Parlement son pouvoir de définition des objectifs stratégiques de la programmation pluriannuelle de l’énergie, décisif instrument politique – au sens noble du terme – qui nous échappait.
Il nous semble important de souligner que ce texte comporte de bonnes mesures. Les membres du groupe Les Indépendants sont, par exemple, convaincus que le mix français doit être composé d’un bouquet d’énergies dont les sources différentes assureront autant la complémentarité que la fiabilité de l’approvisionnement énergétique.
Parvenir à ce bouquet implique une diversité d’installations de production d’énergie. À ce titre, nos convictions portent sur trois points : nous encourageons toutes les énergies renouvelables, notamment l’énergie hydroélectrique, en laquelle nous croyons, en conciliation avec les utilisateurs des territoires ; nous plaidons pour une plus grande autonomie des territoires et de leurs élus, qui sont les mieux à même de résoudre les difficultés locales ; enfin, nous souhaitons anticiper dès aujourd’hui la mise à niveau, puis le démantèlement des installations. L’évolution rapide des technologies nous oblige à penser les sujets majeurs que sont les friches et la dépollution.
Les enjeux sont technologiques, écologiques, mais aussi sociaux. Les emplois détruits par la fermeture de sites de production sont enfin sérieusement pris en compte. N’oublions toutefois pas les salariés des sous-traitants, souvent victimes des dommages collatéraux de ces décisions.
L’énergie et le climat sont des sujets sensibles dans le débat public comme dans le quotidien de nos concitoyens. Les Français nous ont rappelé avec force que l’écologie du quotidien, sur laquelle le Gouvernement souhaite faire reposer l’axe II du quinquennat, devra être ambitieuse et concrète.
La lutte contre les passoires thermiques doit, par exemple, être intensifiée, parce que nous ne pouvons accepter que près de la moitié des logements privés en location soient notés F ou G. Rappelons-le, en la matière, l’énergie la plus écologique demeure celle qui n’est consommée.
Un certain Président de la République disait il y a plus de quinze ans : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Les jeunes générations nous invitent aujourd’hui à garder les yeux bien ouverts et braqués dans la bonne direction.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour examiner le projet de loi relatif à l’énergie et au climat, dont l’objectif principal est d’accélérer la transition énergétique de notre société.
Il s’agit bien d’une accélération, mes chers collègues, tant, depuis 2017, le Gouvernement œuvre quotidiennement à cet objectif. Dès juillet 2017, il a ainsi présenté le plan Climat, sur la durée du quinquennat, en mobilisant l’ensemble des ministères pour accélérer la transition énergétique et climatique.
Ce plan prévoit la fin de la production d’énergies fossiles sur le sol français à l’horizon de 2040, notamment grâce à la promulgation, dès décembre 2018, de la loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement.
En Drôme et en Ardèche, comme dans d’autres départements, nous mesurons l’importance de cette décision, car nous avons été nombreux, citoyens et élus, à nous mobiliser ensemble contre l’exploration et l’exploitation du gaz de schiste.
Je peux encore citer l’engagement de fermer les quatre dernières centrales à charbon d’ici à 2022, la réduction des émissions de gaz carbonique dans les logements, avec le crédit d’impôt pour la transition énergétique et le prêt à taux zéro ou le développement de solutions de mobilité plus propres, avec le renforcement de la prime à la conversion, le forfait mobilité durable, les dispositions sur les zones à faible émission, les objectifs de renouvellement des flottes, autant de mesures comprises dans le projet de loi Mobilités, dont vous venez, hélas, mes chers collègues, de faire échouer la commission mixte paritaire.
Par ailleurs, le Gouvernement a engagé, dès juin 2017, la révision de la stratégie nationale bas-carbone, visant un objectif de long terme : la neutralité carbone dès 2050.
Il s’est enfin attelé à la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Cet outil de pilotage de la politique énergétique de la France a été créé par la loi de 2015 de transition énergétique pour la croissance verte. L’ensemble des piliers de la politique énergétique et des énergies y sont traités.
Alors, mes chers collègues, vous pardonnerez mon étonnement, quand j’entends que cette « petite loi » serait dépourvue de « vision stratégie à long terme ».
Ce texte est sincère : il dit la vérité aux Français sur la trajectoire que nous adopterons, après une consultation qui a duré plus d’un an, dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Il marque, pour moi, une étape clé dans la mise en œuvre de l’ambition du Gouvernement en matière de politique environnementale.
Il poursuit un double objectif : diversification du mix énergétique, d’une part, et réaffirmation de la priorité à la lutte contre le changement climatique et à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, d’autre part.
Je suis fier, aujourd’hui, de défendre ce projet de loi et ses quatre axes principaux.
Le premier est la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles, avec la hausse de l’objectif de réduction de leur consommation à 40 % d’ici à 2030, contre 30 % aujourd’hui, ce qui passera, notamment, par la fin de la production d’électricité à partir du charbon à compter du 1er janvier 2022, qui est confirmée dans la loi.
Le deuxième axe est la lutte contre les trop nombreuses passoires thermiques, qui concernent majoritairement des foyers aux revenus modestes. De ce point de vue, ce projet de loi a également une dimension sociale.
Le troisième axe est la mise en place de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance et d’évaluation de notre politique en matière de climat, afin de garantir que nos objectifs seront atteints.
Enfin, le quatrième axe est la meilleure maîtrise du prix de l’énergie, avec la possibilité de porter par décret le plafond de l’accès régulé à l’énergie nucléaire historique, l’Arenh à 150 térawattheures au lieu de 100.
Mes chers collègues, l’urgence climatique n’est plus à démontrer. La canicule que nous venons de traverser en a encore été la preuve. Nous devons malheureusement craindre et anticiper d’autres épisodes liés au dérèglement climatique.
En octobre 2018, le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a publié un rapport qui alerte sur les conséquences du réchauffement : montée des océans, impact important sur la biodiversité et les écosystèmes, acidification des océans ou encore risques socio-économiques majeurs, notamment pour les populations d’Afrique subsaharienne, d’Asie du Sud-Est, d’Amérique centrale et du Sud. Ces témoignages, désormais quotidiens, sont le reflet d’une urgence que nous devons considérer. Le rapport est clair : nous ne pouvons contenir ce réchauffement à 1, 5 degré que par des transformations radicales, en diminuant urgemment les émissions.
Les catastrophes et les désastres climatiques se multiplient. À titre d’exemple, le 5 février dernier, mon collègue, Dominique Théophile, sénateur de Guadeloupe, remettait au Premier ministre un rapport sur les sargasses dans la Caraïbe. Nous le savons, la prolifération de ces algues est liée à la fois à l’élévation des températures, à l’augmentation des taux de CO2 et aux résultats des activités anthropiques. Leurs vagues successives d’arrivées, de plus en plus massives depuis 2011, représentent un véritable désastre écologique, sanitaire et économique pour les pays de la Grande Caraïbe.
Je peux également illustrer mon propos par la tempête qui a dévasté le nord de la Drôme il y a un mois. Des grêlons d’une grosseur hors norme, conjugués à un vent de type tornade, ont tout anéanti en quelques minutes : plus de cultures, des villes et un village entier dévastés, tous les toits endommagés et l’école communale de Chatillon-Saint-Jean hors d’usage pour longtemps. Il ne s’agit que de deux exemples parmi des centaines !
Ce texte est donc un texte de responsabilité, qui nous est commune, mes chers collègues. Nous devons tous être mobilisés, et nous devons tous participer à l’effort, quelle que soit notre place sur ces travées.
Comme parlementaires, nous devons prendre notre part de l’effort : dorénavant, les futures lois de finances devront obligatoirement prendre en compte leur impact carbone et les parlementaires fixeront tous les cinq ans nos objectifs et la marche à suivre pour répondre à l’urgence. Nos collègues députés ont enrichi considérablement ce texte, qui est passé de douze à cinquante-six articles, puis à cinquante-huit à l’issue des travaux de commission.
Je me dois, monsieur le rapporteur, de vous dire que ce texte ne renvoie donc pas uniquement à des décisions qui seront prises ultérieurement par décret. Les discussions ont été et seront encore nombreuses, et j’espère que le Sénat saura y apposer sa patte. Je vous fais confiance, mes chers collègues.
Mme Noëlle Rauscent applaudit.

Madame la secrétaire d’État, si je devais résumer en quelques mots notre sentiment sur ce projet de loi, je dirais que nous en partageons l’ambition, mais que, comme souvent avec le gouvernement auquel vous appartenez, nous cherchons les moyens mis sur la table pour atteindre l’objectif.
La Cour des comptes européenne estime que, pour amorcer la transition écologique en France, il faudrait investir 145 milliards d’euros par an sur dix ans, dont les deux tiers dans le transport et le logement.
À ce sujet, j’ai une question : où sont les filières industrielles nécessaires pour atteindre le mix énergétique visé et développer les énergies renouvelables, notamment l’éolien en mer, la méthanisation ou encore l’hydrogène décarboné ?
L’urgence climatique est pourtant là ! La COP21 de Paris s’était fixé pour objectif, en 2015, de maintenir le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Si nous ne changeons pas radicalement nos manières de consommer, de produire, de nous déplacer, notre politique énergétique et industrielle, en clair notre mode de développement, alors nous allons droit dans le mur.
À cette allure, voici ce que nous allons laisser comme Terre en 2050 à nos enfants, et personne ne pourra dire que nous ne savions pas : des îles englouties par la montée des eaux, des ouragans et des cyclones plus intenses, de plus en plus d’épisodes de chaleur, comme celui que nous avons connu à la fin du mois de juin, des hivers de plus en plus rudes, un million d’espèces disparues, des feux de forêt qui se multiplieront.
Ce scénario n’est pas le prochain film catastrophe hollywoodien, mais la réalité en train de se préparer sous nos yeux, avec pour conséquences l’explosion de la pauvreté, avec 100 millions de pauvres en plus à l’horizon de 2030, et le déplacement de 250 millions de réfugiés climatiques à l’horizon de 2050.
Bref, nous sommes en train de tuer notre planète et les espèces qu’elle porte, la nôtre incluse.
Si nous ne prenons pas des décisions radicales aujourd’hui, le pouvoir politique sera devant un défi insurmontable dans dix ans : comment survivre sur une planète qui a subi des dommages irréversibles, avec près de 10 milliards d’habitants ? C’est donc une politique globale et radicale qu’il nous faut mener. Ni les slogans, ni les effets d’annonce, ni la politique des petits pas ne peuvent nous sauver !
Par ailleurs, la présentation de votre projet de loi est rattrapée cruellement par l’actualité : il est facile d’afficher l’objectif de la neutralité carbone en 2050 à l’article 1er, mais, pendant ce temps, l’Assemblée nationale est en train de le ratifier le CETA, et l’Union européenne a signé un accord de libre-échange avec le Mercosur. Les risques sanitaires, sociaux et environnementaux sont immenses : ces accords de libre-échange vont à contre-courant de l’histoire !
Alors qu’il faudrait imposer le principe de coopération entre les peuples, vous érigez le principe de compétition en dogme. Alors qu’il est urgent et vital de relocaliser notre agriculture et notre production industrielle, vous préparez treize nouveaux traités de libre-échange, qui multiplieront le transport de marchandises au-dessus de nos océans. Un jour, pourtant, ces traités deviendront caducs, car ils seront reconnus comme crimes d’écocide, au même titre que les pollutions au plastique, au fioul et la déforestation à outrance pour le seul profit.
Madame la secrétaire d’État, tout peut-il être marché ? S’il s’était agi d’un sujet du baccalauréat de philosophie, nous n’aurions pas, je pense, rendu la même copie… Vous faites le pari que oui, car le capitalisme peut trouver une niche dans le développement des énergies renouvelables et réaliser des profits sur la transition verte. Cela coïncidant avec la prise de conscience de plus en plus prégnante des urgences climatiques dans l’opinion populaire, c’est tout un modèle de « croissance verte » qui est colporté par le Gouvernement et sa fidèle majorité.
Mais, pour cela, il vous faut casser toutes les barrières, en commençant par mettre fin aux tarifs réglementés du gaz, puis en abattant progressivement les tarifs réglementés de l’électricité. Car, pour vous, une seule règle compte : la main invisible du marché ; et tant pis si cette main droite plonge des centaines de milliers de foyers supplémentaires dans la précarité énergétique !

M. Fabien Gay. C’est ce même dogme qui vous pousse à poursuivre la vente de l’énergie nucléaire au concurrent privé d’EDF, avec le déplafonnement de l’Arenh.
M. Roland Courteau opine.

Pas un mot non plus sur la future concession de près de 150 barrages hydroélectriques au privé, alors qu’ils sont un élément essentiel pour stocker nos énergies renouvelables.
Votre but ultime n’est pas dans la loi, mais votre plan est maintenant connu : après avoir vendu Engie aux appétits financiers, vous préparez le démantèlement d’EDF. Le mécanisme est simple et connu : nationaliser les pertes, c’est-à-dire un nucléaire aujourd’hui déficitaire, et privatiser la distribution et les énergies renouvelables.

Vous voulez casser une entreprise publique intégrée pour livrer toute la filière au privé !
Mais, vous le savez, il faudra en passer par une loi pour finir de déréglementer tout le marché de l’énergie. Or, là encore, l’actualité vous rattrape, car les Françaises et les Français en ont marre de voir leur patrimoine bradé au privé, comme en témoignent les plus de 500 000 soutiens déjà exprimés au projet de loi référendaire pour Aéroports de Paris.
Nous mènerons donc une bataille acharnée pour éviter le démantèlement et la privatisation d’EDF. Car, nous, nous n’avons pas honte de le dire : si nous voulons réussir ce défi d’avenir, il nous faut un grand service public de l’énergie, qui réponde à la nécessité du XXIe siècle, sauver la planète et l’humain.
Pour conclure, je recommande à votre méditation cette phrase du chef sioux Sitting Bull : « Quand ils auront coupé le dernier arbre, pollué le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson, alors ils s’apercevront que l’argent ne se mange pas. » Voilà où nous en sommes aujourd’hui !
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain et du groupe Union Centriste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, parce que les sirènes de l’urgence climatique se font de plus en plus stridentes, parce que le dernier rapport du GIEC est plus alarmant encore, il fallait prolonger et amplifier la loi de 2015 pour la transition énergétique. De fait, au-delà de 2 degrés de réchauffement, nous entrerions dans le domaine de l’irréversible.
Ce projet de loi m’inspire une première question : pourra-t-on dire que, avec lui, la politique de la France sera bien dans les clous du dernier rapport du GIEC ? En d’autres termes, sur les questions majeures, le texte est-il à la hauteur des enjeux écologiques, économiques et sociaux ? Répond-il à la situation d’urgence ? Même s’il est vrai qu’il comprend un certain nombre de mesures intéressantes, compte tenu des enjeux et de l’urgence, ne manquerait-il pas d’envergure ?
Pour en juger, je prendrai deux exemples, qui nous invitent à porter le regard sur l’essentiel.
D’abord, madame la secrétaire d’État, vous fixez des objectifs de réduction de nos consommations d’énergies fossiles à l’horizon de 2030 et de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Bien ! Mais, compte tenu du rapport du GIEC et du cri d’alarme de celui-ci, serons-nous, avec ces objectifs, sur la bonne trajectoire ? Ce texte sera-t-il compatible avec les scénarios d’un réchauffement de 1, 5 degré ou avec ceux d’un réchauffement de 2 degrés, voire plus ? Étant entendu que chaque demi-degré compte. Bref, les chiffres fixés ont-ils un fondement scientifique ou sont-ils en deçà ?
Surtout, il faudra dire comment nous atteindrons ces objectifs, par quels moyens et par quels financements. Or, à cet égard, nous ne voyons rien de précis. C’est pourtant sur cela que repose la crédibilité de l’annonce.
Ensuite, il y a la rénovation thermique des 8 millions de logements passoires, un sujet tout aussi fondamental, essentiel pour le climat, l’environnement et la qualité de l’air ; essentiel aussi pour la lutte contre la précarité énergétique et en matière de pouvoir d’achat des ménages ; essentiel enfin pour alléger la facture énergétique de la France, l’emploi et l’activité dans le secteur du bâtiment.
En vérité, l’enjeu est écologique, climatique et social. Le projet de loi prévoit-il un plan d’envergure et rapide pour la rénovation thermique ? Si oui, il ne m’a pas sauté aux yeux…
Je ne dis pas qu’il ne comporte aucune mesure – ce ne serait ni objectif ni juste. Des dispositions sont prévues, mais qui ne répondent pas forcément aux enjeux immédiats et à l’urgence. Elles vont toutes dans le bon sens, mais le problème de ce texte est que l’obligation des travaux de rénovation est repoussée en 2028, voire, pour certains immeubles, en 2033 – échéances trop lointaines, assorties de surcroît de trop nombreuses exceptions.
Bref, l’urgence climatique est remise à plus tard, donc à très tard, peut-être même à trop tard. C’est pourquoi le groupe socialiste a présenté un amendement visant à autoriser le Gouvernement à lever un emprunt à moyen et long terme pour assurer, sans attendre, le financement des investissements dans la rénovation thermique, en aidant notamment ceux qui en ont le plus besoin. Évidemment, nous nous sommes heurtés à l’article 40 de la Constitution…
Madame la secrétaire d’État, la balle est donc maintenant dans votre camp, pour une autre solution.
Pour mémoire, je rappelle volontiers les engagements du candidat Macron pour la création d’un fonds public pour la rénovation et pour la rénovation thermique de la moitié des logements passoires en 2022. Remarquez que c’était plus volontariste que l’objectif de 2028 fixé par le projet de loi… La cohérence entre les engagements et les actes ne saute pas aux yeux !
J’y insiste, il faut une vraie politique, volontariste, dans le domaine de la rénovation, faute de quoi la France se verra accusée, comme ce fut le cas récemment, de donner volontiers des leçons, mais pas assez d’exemples.
Face à des enjeux majeurs, nous attendions mieux. Même si le projet de loi a vu le nombre de ses articles augmenter à l’Assemblée nationale et a été modifié, parfois amélioré, par le Sénat en commission, les motifs de mécontentement ne manquent pas, tels le déplafonnement de l’Arenh et la suppression des tarifs réglementés. Sans parler du projet Hercule d’EDF, autre sujet qui fâche.
Reste que, bien évidemment, nous partageons la volonté affichée de rééquilibrer le bouquet énergétique de la France, en ramenant la part du nucléaire dans notre mix à 50 % à l’horizon de 2025 – échéance plus réaliste, je le reconnais volontiers, que celle que j’avais défendue à cette tribune en 2015.
Le problème, c’est que, par rapport aux enjeux majeurs, écologiques, économiques et sociaux, nous attendions plus. Il serait dommage que ce texte soit celui des occasions manquées.
Dans la discussion des articles, nous reviendrons sur la fermeture des centrales à charbon, sujet environnemental autant que social, et donc sur Cordemais, dont le sort était lié, selon le ministre de Rugy, au démarrage de l’EPR de Flamanville – je le glisse en passant.
À la suite de M. le rapporteur, je souligne qu’il faut rétablir la primauté du législatif sur le réglementaire.
Par ailleurs, je vous dirai tout le mal que je pense de l’Arenh et tout le bien que je pense de l’éolien flottant en Méditerranée, où nous espérons des projets industriels.
Ce qui se joue désormais au niveau planétaire, c’est la survie de l’humanité. L’objectif de maintenir l’élévation de la température sous les 2 degrés, au plus près de 1, 5 degré, ne relève pas de la pure convenance, sachons-le : au-delà, nous entrerions dans l’irréversible, comme le disait un ancien ministre. Je ne saurais mieux dire. Il ne s’agit pas d’en rajouter dans le registre anxiogène, mais de nous mobiliser tous et de parler vrai, sans laisser les problèmes sous le tapis.
Enfin, gardons-nous tous d’oublier que transition énergétique et justice sociale doivent être liées, car, sans adhésion de tous les citoyens, il n’y aura pas de transition réussie !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous pouvons nous réjouir que le nouveau monde ait fini par soumettre à l’examen du Parlement un texte qui était bien parti pour ne jamais franchir les grilles du Palais du Luxembourg.
C’est peu dire que le Parlement aura été négligé sur les sujets environnementaux depuis la récente conversion écologique du Gouvernement. Comment en effet peut-on croire un instant au respect du débat parlementaire, quand on voit le temps qui nous est laissé pour traiter de sujets aussi importants que ceux dont nous sommes saisis ? Comment peut-on imaginer que le Gouvernement respecte le travail des assemblées, quand on nous propose, avec ce texte, d’avaliser une programmation pluriannuelle de l’énergie déjà rédigée depuis longtemps ? Sur ce sujet comme sur celui du Haut Conseil pour le climat, institué par décret voilà deux mois, il faudra nous expliquer, madame la secrétaire d’État, votre conception de la hiérarchie des normes !
Le texte débattu cette semaine mérite son qualificatif de « petite loi » : huit articles au départ, se bornant pour la plupart à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances ou à transposer des directives européennes.
La révision des objectifs énergétiques devenait certes nécessaire, mais nous aurions pu gagner un peu de temps si les gouvernements successifs avaient davantage écouté le Sénat, qui, dès 2015, a souligné l’impossibilité objective d’une réduction de la part du nucléaire à 50 % dans notre mix en 2025.
Je tiens à saluer le travail réalisé à l’Assemblée nationale et tout particulièrement celui accompli au Sénat, sous l’autorité de Sophie Primas, par le rapporteur, Daniel Gremillet, et la rapporteure pour avis, Pascale Bories, qui ont considérablement enrichi le texte. Sans les apports du Parlement, un projet de loi censé porter sur l’énergie et le climat n’aurait comporté aucune disposition sur la rénovation des bâtiments, ni même sur les énergies renouvelables !
En effet, c’est à la faveur du débat à l’Assemblée nationale qu’ont été introduites les mesures relatives à l’hydrogène, au photovoltaïque et à l’éolien en mer. Sans les travaux du Parlement, nous en serions restés à une programmation pluriannuelle de l’énergie adoptée sous forme de décret, échappant donc totalement à l’examen de la représentation nationale.
Certaines mesures sont à saluer : la réforme de l’Arenh, le renforcement des contrôles sur les certificats d’économies d’énergie et l’introduction, par la commission du Sénat, d’objectifs plus réalistes, qui permettront notamment à nos collectivités territoriales, en première ligne pour la transition écologique, de s’appuyer sur des points d’étape pragmatiques.
Tout cela, néanmoins, ne fait pas une grande loi sur l’énergie, répondant aux défis climatiques qui sont devant nous. Où est, en effet, la « vision grand-angle » du Gouvernement sur le sujet ? Où est le dispositif courageux qui permettra de dépasser la vision punitive de l’écologie pour concilier intelligemment croissance économique, attractivité des territoires et respect de l’environnement ?
Madame la secrétaire d’État, nos territoires, nos chefs d’entreprise, nos concitoyens et les élus ont besoin d’un cap clair et stable à moyen et long terme. Ils ont besoin d’être davantage impliqués dans le défi environnemental. Cela passe par une large concertation, ainsi que par la mobilisation du secteur bancaire et financier. Nos concitoyens nous le demandent aujourd’hui, et la jeunesse – mais pas seulement elle – se mobilise régulièrement, y compris pour des projets promus dans les territoires avec un financement solidaire et participatif, qui nous obligent à regarder l’avenir différemment.
Le grand projet de loi Énergie-climat que nous aurions aimé voter, c’est celui qui aurait proposé une fiscalité verte positive et concilié accompagnement des ménages, progressivité de la charge et transparence dans l’utilisation des recettes.
Vous choisissez de réduire la part de l’énergie nucléaire, alors que celle-ci participe aujourd’hui au bon classement de la France parmi les pays émetteurs de gaz carbonique. Et, paradoxe préoccupant, vous n’investissez que très peu dans les énergies propres ou renouvelables, en oubliant que, sans cet effort de diversification de notre mix, nous continuerons de traîner comme un boulet le solde négatif de notre facture énergétique – 40 milliards d’euros de déficit annuel, soit les deux tiers de notre déficit commercial.
Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, ce projet de loi est décevant au regard des enjeux et des ambitions proclamées par la communication gouvernementale. Décevant par les mesures proposées, qui manquent significativement de cohérence d’ensemble, il l’est aussi par la méthode employée, qui consiste, je le répète, à faire ratifier par le Parlement des choix fixés par décret. Il déçoit, enfin, au regard des attentes d’une partie croissante de nos concitoyens, dont beaucoup souhaiteraient agir et être accompagnés, plutôt que taxés ou montrés du doigt.
Madame la secrétaire d’État, votre prédécesseur lors de l’entrée en vigueur de l’accord de Paris déclarait : « L’essentiel n’est pas ce qui brille, mais ce qui dure. » Tout est dit, et chacun en mesure aujourd’hui la portée !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, Ronan Dantec ayant déjà pris la parole au nom du groupe du RDSE, je m’attarderai sur les mesures relatives aux passoires thermiques, qui ont fait l’objet de vifs débats aussi bien à l’Assemblée nationale qu’en commission du Sénat, la semaine dernière.
Et pour cause : loin d’être anodin, le secteur du bâtiment représente 20 % des émissions de gaz à effet de serre en France et dépasse largement les seuils fixés par la stratégie nationale bas-carbone, qui appelle à une rénovation thermique radicale du parc existant. Aussi, sans faire de mauvais jeu de mots, considérer qu’on peut atteindre la neutralité carbone en 2050 sans agir sur le logement, c’est aller droit dans le mur.
Alors qu’un huitième des logements vendus chaque année seraient des passoires énergétiques, il y a urgence : urgence climatique, mais aussi urgence sociale. La précarité énergétique coûte cher à notre pays, et nous devons faire baisser la facture.
Cet habitat énergivore recouvre plusieurs réalités : des propriétaires, occupants ou bailleurs, qui ne peuvent pas se permettre de rénover leur bien ou méconnaissent les aides auxquelles ils ont droit ; parfois aussi, des marchands de sommeil qui font fortune sur l’exploitation de la vulnérabilité des occupants. La problématique n’est pas simplement urbaine : elle existe tout aussi bien dans nos territoires ruraux.
Il ne s’agit pas de stigmatiser ou de montrer du doigt, mais de proposer un panel de solutions adaptées à chaque situation.
S’agissant des propriétaires modestes, le Gouvernement souhaite la transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique en une prime unique, versée au commencement des travaux dès 2020. De notre point de vue, un meilleur accompagnement est également indispensable, car le manque d’informations lisibles sur les aides est source de nombreux renoncements.
Nous proposerons donc l’ajout dans l’audit énergétique des conditions d’attribution des aides publiques et des conséquences des travaux sur la facture, la mise en place d’un parcours de rénovation énergétique parmi les missions de l’ANAH et la création dans les EPCI d’un référent chargé d’accompagner les propriétaires dans la rénovation énergétique de leur logement.
En travaillant sur ce projet de loi, nous avons retrouvé deux engagements forts dans le programme du candidat Macron : l’interdiction de la location des passoires énergétiques en 2025 et la rénovation de 1 million d’entre elles d’ici à 2022.
Afin d’inciter plus fermement les propriétaires qui en ont les moyens à engager des travaux, nous proposerons de définir dans la loi un seuil maximal de consommation énergétique finale des logements pouvant être considérés comme décents et de fixer un palier intermédiaire de rénovation de 1 million de logements mal isolés d’ici à 2022, conformément à l’engagement du Président de la République. Nous proposerons aussi d’instaurer sans attendre une sanction, avec l’interdiction de la location des logements classés G dès 2022 et des logements classés F dès 2028, toujours en nous inspirant des engagements du candidat Macron.
Convaincu que seules des mesures fortes permettront d’atteindre l’objectif ambitieux que la France s’est fixé, le groupe du RDSE déterminera son vote final en fonction des débats.
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste. – Mme la présidente de la commission des affaires économiques applaudit également.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à saluer le travail remarquable de nos rapporteurs et de nos administrateurs, dans le contexte particulier que la présidente de notre commission a souligné.
Le projet de loi soumis à notre examen, censé faciliter l’accès à une énergie décarbonée et abordable pour tous, se concentre sur l’offre énergétique, les tarifs et la lutte contre la fraude. Il ne s’attache pas aux sujets majeurs, tels que la maîtrise de la demande dans les secteurs les plus émetteurs et fait peu de place à l’évaluation et à l’exemplarité de l’État.
En complément des observations présentées par mon collègue Jean-Pierre Moga, j’insisterai sur trois points.
D’abord, la lutte contre le changement climatique et l’objectif de neutralité carbone. Comment atteindre zéro émission nette de carbone d’ici à 2050 en nous privant du levier des puits de carbone ? Selon des chercheurs suisses, 900 millions d’hectares de canopée en plus des 2, 8 milliards d’hectares actuels pourraient absorber 205 des 300 gigatonnes de carbone rejetées dans l’atmosphère depuis la fin du XIXe siècle.
En ce sens, je proposerai un amendement visant à étendre le champ obligation des certificats d’économies d’énergie à la captation de carbone. En créant un volet spécifique au sein du dispositif des CEE, nous soutiendrions les investissements dans les pratiques vertueuses et les services environnementaux devenus essentiels. Je pense à tout ce qui valorise les espaces naturels et les matériaux biosourcés, préservant et développant ainsi des capacités de stockage du CO2 dans le sol et les végétaux, ainsi que des capacités de substitution par l’usage de matériaux biosourcés.
Ensuite, il faut agir sur un autre levier : la petite hydroélectricité. Pouvons-nous véritablement nous permettre de nous priver de ce potentiel, même de petite taille ? Comment expliquerons-nous aux générations futures que, alors que notre planète étouffait, nous n’avons pas jugé nécessaire d’optimiser le potentiel d’énergies renouvelables décarbonées des petites unités d’hydroélectricité ?

Sortons du dogmatisme : les expériences des dernières années démontrent que, en matière d’énergie et de stratégie bas-carbone, il n’y a pas une solution miracle, venue des ENR électriques, mais plutôt un mix de technologies qui se complètent.
Enfin, sur ce sujet de l’offre énergétique, je souhaite réaffirmer la spécificité de notre pays, qui, du fait de son mix électrique essentiellement nucléaire, donc décarboné, doit rechercher d’abord une meilleure efficacité énergétique et des changements dans les usages, plutôt qu’une coûteuse conversion des moyens de production existants.
Il serait opportun, madame la secrétaire d’État, de contrôler et d’évaluer la rentabilité des projets ENR, auxquels les soutiens publics devraient avoisiner 200 milliards d’euros à l’horizon de 2045. Ces soutiens massifs pèsent de plus en plus sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens et ne sont pas tenables à long terme. La CSPE explose, et 70 % de ses recettes vont désormais au soutien aux ENR plutôt qu’à la mobilité propre et à la rénovation thermique. La Cour des comptes comme la CRE appellent à un renforcement du pilotage budgétaire de ces charges et à un meilleur contrôle des appels d’offres, avec une possibilité de révision des mécanismes, notamment du fait des progrès technologiques. Le coût de la maintenance des ENR a diminué de plus 35 % ces dernières années, sans que les engagements relatifs aux prix d’achat puissent être ajustés.
Madame la secrétaire d’État, envisagez-vous une réflexion sur l’ensemble de la chaîne de valeur des industries ENR, au travers d’un bilan environnemental complet intégrant le transport et les matériaux, mais aussi les emplois créés ? De fait, il faut bien constater qu’il n’y a pas de développement industriel autour des ENR en France.
Dans le contexte actuel d’urgence climatique, peut-on se satisfaire de stratégies qui ne permettent aucune réduction des émissions de gaz à effet de serre avant 2028 et ne mobilisent les financements que pour le remplacement des capacités de production actuelles, pourtant largement décarbonées, par de coûteuses ENR bas-carbone ? Il est temps de reconsidérer ces choix de soutien public : 200 milliards d’euros pour les ENR d’ici à 2045, contre 25 milliards d’euros à l’horizon de 2023 pour la mobilité propre ou la rénovation thermique, principaux vecteurs de réduction des émissions de carbone.
Le groupe Union Centriste sera attentif à apporter des améliorations en ce sens au cours des débats qui vont suivre.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe Les Indépendants – République et Territoires.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, notre nouveau regard sur l’énergie devra être un levier majeur de la réduction des gaz à effet de serre. En effet, c’est parce que l’énergie fossile a été utilisée massivement jusqu’à présent que nous faisons aujourd’hui face au péril écologique que nous connaissons sur la planète.
Il appartient au Parlement de fixer les objectifs. Nous souhaitons une politique française ambitieuse en matière de réduction des gaz à effet de serre. Elle nécessitera d’accentuer le développement des énergies renouvelables et décarbonées.
Cela ne doit pas nous faire oublier que la France bénéficie d’un atout considérable dans la production d’électricité décarbonée : le nucléaire, qui reste un moyen fiable et non émetteur de CO2 de produire de l’électricité. La fermeture de près d’un quart des réacteurs français a été annoncée, mais elle doit être assortie d’alternatives crédibles ; nous y serons attentifs. La France doit rester en pointe sur cette technologie, en attendant que ces alternatives crédibles existent véritablement.
Les énergies renouvelables doivent être encouragées et des synergies doivent naître entre la production d’énergie et l’agriculture. Il est nécessaire de consolider un cadre stable et pérenne pour la filière biogaz afin de sécuriser les porteurs de projet.
La production locale de méthane dispose de plusieurs avantages : elle permet une gestion des effluents agricoles, et le biogaz assure un complément de revenus aux agriculteurs et consolide la résilience de notre agriculture.
L’agriculture fait déjà beaucoup pour l’environnement. Elle peut faire beaucoup aussi en matière d’énergie.
Plus généralement, le couple biocarburants et agriculture est porteur de nombreuses promesses, notamment en matière de biokérosène – songeons à l’importance du transport aérien !
La lutte contre le changement climatique passera par nos territoires, mais aussi par le monde de l’entreprise. C’est notamment le cas pour les dispositions de lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie. Elles réaffirment notre engagement dans le processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Par ailleurs, nous sommes convaincus tant du bien-fondé de ce dispositif que de l’intérêt de la production d’hydrogène décarboné à partir d’énergies renouvelables. Néanmoins, nous serons particulièrement attentifs au cadre qui sera proposé pour le développement de cette solution d’avenir.
Les enjeux de climat et d’énergie sont considérables. Ces combats doivent être menés aussi à l’échelle européenne et de façon coordonnée.
Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants contribuera à défendre ce texte, enrichi par le travail de nos rapporteurs, de nos commissions et par le débat qui s’ouvre devant la Haute Assemblée.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste. – MM. Bernard Buis et Yvon Collin applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, permettez-moi de féliciter à mon tour les rapporteurs ainsi que l’équipe des administrateurs : ils ont beaucoup de mérite d’avoir préparé l’examen de ce texte dans les conditions qui leur ont été imposées et que Mme la présidente de la commission a rappelées à juste titre.
En présentant son rapport en commission des affaires économiques, Daniel Gremillet a évoqué la pauvreté de ce projet de loi. Je partage ce constat, l’intention du texte étant essentiellement de faire entériner par le législateur les choix de la PPE. C’est donner bien peu d’importance au Parlement sur un sujet qui suscite une si grande préoccupation.
Je note pour ma part deux grands absents dans les sujets qu’un texte portant sur l’énergie et le climat aurait dû aborder : l’industrie et le transport.
L’industrie nucléaire n’est abordée que sous un angle négatif, malgré sa qualité première en lien direct avec les objectifs du projet de loi : réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique. Tout au plus avez-vous consenti à reporter de dix ans la diminution à 50 % de la part du nucléaire dans le mix énergétique. Nous n’avions pourtant cessé de répéter lors de la discussion du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, sans avoir été entendus, que l’objectif de 2025 était inatteignable. La preuve en est aujourd’hui ! À quoi cela sert-il de fixer des objectifs dont on sait pertinemment qu’ils sont irréalistes ?
Pour ma part, je ne suis ni pro ni anti-nucléaire, mais je salue l’excellence de la filière française, dont nous aurons forcément besoin pour atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050.
Hormis le nucléaire, il y a l’industrie que l’on qualifie de lourde, celle que l’on peine à garder en France et qui a des besoins énergétiques importants. Le rapport de notre collègue Valérie Létard, présenté au nom de la mission d’information sur les enjeux de la filière sidérurgique dans la France du XXIe siècle, a bien montré l’importance du coût de l’énergie pour l’industrie, notamment pour les entreprises électro-intensives. Or certaines d’entre elles verront leur contrat de fourniture historique arriver à terme en 2020, ce qui rend urgente la négociation d’un nouveau tarif, car, pour le maintien et la compétitivité de ces entreprises, des contrats de longue durée sont nécessaires. Notre collègue Jean-Pierre Vial, très investi sur ce sujet qu’il connaît bien en Savoie, a déposé un amendement en ce sens, mais il ne pourra faire l’objet d’une discussion ayant été déclaré irrecevable, bien qu’il s’agisse uniquement d’énergie…
Quelle est donc la réponse du Gouvernement sur ce point très important pour les entreprises industrielles fortes consommatrices d’énergie ?
Le deuxième sujet que je souhaite évoquer est celui des transports, essentiellement le transport des marchandises, qui a une importance majeure pour notre économie. Ce sujet est absent du projet de loi, sous prétexte, je crois, d’en appeler à la LOM, sauf que la LOM ne l’aborde pas !
Le constat est connu depuis longtemps : 80 % des marchandises transportées le sont par la route, d’où l’engorgement des grands axes et les émissions de CO2 que l’on connaît et qui ont des conséquences directes sur le climat et la santé. Or notre territoire métropolitain a la chance de disposer d’un bon réseau ferré, d’un bon réseau fluvial, les deux étant très largement sous-utilisés.
Je prends souvent l’exemple de l’axe Marseille-Lyon. Sur le Rhône, où la navigation est gérée par la CNR, qui par ailleurs assure la production d’hydroélectricité, le transport fluvial n’utilise qu’un tiers des capacités, alors qu’une barge poussée peut transporter en conteneurs l’équivalent de 200 à 300 camions, avec d’ailleurs un coût de transport trois fois moins important que par la route.
À Fos-Marseille, je crois me souvenir que c’est une quinzaine de trains qui quittent le port chaque jour, alors qu’au départ de Hambourg 150 trains irriguent chaque jour tout le nord de l’Europe jusqu’à nos portes, pour livrer les marchandises objets d’import-export.
Le précédent ministre de la transition écologique – je veux parler de M. Hulot §– s’en était ému dans cette enceinte. L’actuelle ministre des transports s’en est elle aussi émue. Pour autant, force est de constater que rien ne bouge.
Madame la secrétaire d’État, allez-vous à votre tour vous en émouvoir et, surtout, agir en faveur du climat ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, ce projet de loi, qui devait marquer une étape majeure dans notre transition énergétique et écologique, n’est ni à la hauteur des enjeux ni pourvu d’une vision globale à long terme. Nous n’y percevons pas les actions concrètes à mener face à l’urgence climatique qui s’impose à nous ni les moyens mis en œuvre pour y parvenir. Il s’agit là d’une loi d’affichage, avec des mesures insuffisantes !
En préambule je tiens à rappeler, à toutes fins utiles, que quasiment toute l’électricité de notre pays est décarbonée. Or de grands enjeux semblent avoir été balayés à la même vitesse que celle à laquelle nous avons dû examiner le texte, ce que je déplore à mon tour. Je pense notamment à l’absence totale des transports dans ce texte, alors qu’ils représentent 39 % des émissions de gaz à effet de serre.
Insuffisantes, les dispositions relatives à la rénovation énergétique des passoires thermiques sont repoussées graduellement à une date bien trop éloignée, après 2022, alors qu’on parle d’urgence et que cette année-là, année d’élection majeure, vous ne serez peut-être plus en mesure d’appliquer votre promesse de campagne.
Je déplore aussi la quasi-absence de la production hydroélectrique, qui ne fait l’objet d’aucune mesure contraignante à court terme, alors qu’elle est incontournable dans la transition énergétique, et, enfin, l’incapacité à trancher le débat sur le nucléaire.
Cela me conduit à une première réflexion. La diminution de la part du nucléaire introduit deux nouveautés majeures.
La première est le passage d’une production d’électricité en masse, concentrée, à une production plus diffuse, répartie sur le territoire et accompagnée de la montée des énergies renouvelables, qui sont bien moins puissantes, ce qui entraîne des problèmes d’acceptabilité par nos concitoyens. Je rappelle pour exemple les résistances rencontrées avec les projets éoliens.
La deuxième nouveauté est la disparition des grosses « machines tournantes » que sont les alternateurs des centrales thermiques. Bien qu’ils soient condamnés à terme, ils sont essentiels au maintien du réseau et des fréquences. Parmi les énergies renouvelables, seule l’hydroélectricité est susceptible de fournir cette qualité. C’est là toute sa pertinence, notamment pour la petite hydroélectricité.
Nos concitoyens doivent être éclairés afin de saisir les enjeux de ces changements et de faire des choix.

Cela me conduit à une autre réflexion sur le sujet.
Vos objectifs pour le report des fermetures de réacteurs nucléaires, dépourvus de chiffrage crédible et assortis d’un calendrier artificiel et propre à être modifié à l’envi, posent problème. L’impact social est négligé. Le Gouvernement est en deçà des responsabilités qui s’imposent à lui. Ces décisions sont les siennes et doivent être assumées, qu’il s’agisse du nucléaire ou des centrales à charbon, les plans de réemploi doivent être au cœur de ses préoccupations. Le volet social doit être pleinement inclus dans l’urgence climatique.
Sur la question de la fermeture des centrales à charbon, permettez-moi de vous interroger de nouveau sur l’avenir : comment maintenir le réseau dans l’ouest du pays, alors que l’EPR de Flamanville est retardé ?
S’agissant de notre entreprise historique EDF, nous avons des interrogations. Sa situation est durablement fragilisée. En effet, l’essor des énergies renouvelables et les progrès en matière d’économies d’énergie peuvent entraîner à terme une chute des prix sur le marché européen, car, vous le savez, nous sommes dans le foisonnement, avec des échanges perpétuels avec nos pays voisins.
Par ailleurs, le coût de production des réacteurs nucléaires d’un parc vieillissant augmente du fait d’un taux d’utilisation en baisse, de la multiplication des arrêts, du grand carénage qui se met en place et des problèmes de sécheresse dus au réchauffement climatique. À cela s’ajoutent les obligations de l’Arenh.
L’intérêt stratégique doit être au centre de la résolution de cette équation. Nous y serons vigilants.
Le groupe socialiste et républicain attend de ces débats des avancées sur les dispositions que nous jugeons insuffisantes : la rénovation thermique et l’incitation à la mobilité verte, afin de diminuer drastiquement notre empreinte carbone. Nous devons opter pour des comportements plus sobres et plus vertueux.
Afin d’assurer une continuité du service public et des politiques en faveur de l’intérêt général qui lient urgence écologique et responsabilité sociale, nous défendrons des propositions très concrètes pour lutter contre la précarité énergétique qui touche un trop grand nombre de nos concitoyens.
Enfin, la lutte contre le réchauffement climatique est liée aux écosystèmes. Nous nous étonnons que nos amendements sur la préservation de la biodiversité aient été déclarés irrecevables. C’est se méprendre sur les enjeux climatiques énergétiques qui nous attendent. La nature est une alliée que nous ne devons pas négliger.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, force est de constater que le texte qui nous est soumis réalise une prouesse assez extraordinaire : fixer à un horizon lointain une série d’objectifs déclaratifs tous plus ambitieux les uns que les autres sans les assortir des moyens nécessaires à leur réalisation. Pis, il se contente de ces objectifs à long terme, sans dire concrètement comment mettre en œuvre, demain matin, des dispositifs pour une véritable transition énergétique dans les territoires.
À ce titre, le projet de loi est décevant. Il manque singulièrement d’envergure et, surtout, de traduction effective de proclamations politiques pourtant largement déployées à l’article 1er à grand renfort de dates, d’estimations diverses et de calculs qui m’impressionnent : neutralité carbone pour 2050, facteur 6 pour les émissions de gaz à effets de serre, réduction de la consommation des énergies fossiles à 40 %, production d’énergie hydraulique à 27 gigawatts en 2028 ou encore 40 % d’hydrogène bas-carbone dans la consommation industrielle…
En vérité, je me demande sincèrement si tout cela est bien sérieux…

M. Stéphane Piednoir. … et s’il ne s’agit pas simplement de servir la cause d’une diminution significative de la production nucléaire dans notre pays, mesure idéologique prise durant le précédent quinquennat pour tenter de satisfaire une partie de la majorité d’alors, aujourd’hui encore aux responsabilités…
Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.

Sur l’article 1er en particulier, je tiens cependant à saluer le travail de notre rapporteur, Daniel Gremillet, qui a clarifié certains de ces objectifs.
En inscrivant l’urgence écologique et climatique dans ce texte, chacun comprend qu’il faut aller vite pour réduire nos émissions de CO2. Alors pourquoi renoncer à la production nucléaire, la plus vertueuse dans ce domaine ? Réduire à 50 % la part de notre production d’électricité d’origine nucléaire ne restera qu’une annonce idéologique sans un plan d’action concret de diversification de notre mix énergétique.

Dans ce contexte, pourquoi ne pas privilégier davantage l’hydrogène, par exemple ?
Chacun sait qu’on ne progresse pas parce qu’on a peur mais parce qu’on croit au progrès. Pour paraphraser le cheikh Yamani, « l’âge de pierre ne s’est pas arrêté faute de pierres » !
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.

Je veux poursuivre mon propos en évoquant la rénovation énergétique des logements, sujet ô combien important, puisque le bâtiment représente environ 45 % de la consommation d’énergie dans notre pays.
Si les objectifs affichés depuis plusieurs années semblent volontaristes, autour de 500 000 logements rénovés par an, on est loin d’une mise en œuvre effective et unifiée sur le terrain. J’en veux pour preuve le caractère très flou des missions du service public de la performance énergétique de l’habitat. Pourtant, tous ceux qui ont une expérience dans ce domaine peuvent témoigner de la nécessité de clarifier le jeu des nombreux acteurs, de faciliter l’accès à un conseil neutre, indépendant et efficace pour les particuliers, déboussolés par la multitude des messages auxquels ils sont régulièrement confrontés. Une stratégie globale est à arrêter, avec sans doute les régions comme chefs d’orchestre et – pourquoi pas ?– les intercommunalités comme relais dans les territoires.
Vous le savez, madame la secrétaire d’État, la rénovation thermique d’un logement peut être onéreuse – elle coûte 30 000 euros en moyenne, et parfois bien plus. Cela mérite de concentrer nos efforts sur cet axe.
Sur le sujet de ce qu’on appelle les passoires énergétiques – on en dénombre environ 7 millions dans notre pays –, nous devons faire preuve d’imagination, non pas pour sanctionner et taxer toujours plus, mais au contraire pour encourager et valoriser les propriétaires bailleurs qui effectuent les travaux. Je proposerai un amendement en ce sens.
Enfin, nous savons que ce texte prévoit une future loi quinquennale, et je m’en félicite. Elle permettra, je l’espère, d’avoir un débat parlementaire sérieux et approfondi pour déterminer les objectifs à rechercher en matière énergétique et, surtout, pour fixer les priorités d’action pour le consommateur lambda, qui conçoit que des changements de comportement et des efforts de rénovation vont être nécessaires, mais qui aspire à une déclinaison pragmatique expurgée de toute empreinte idéologique.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Je souhaite remercier le rapporteur de la commission des affaires économiques, la rapporteure pour avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, ainsi que tous les orateurs.
Sachez que le message est passé : j’ai bien entendu que les délais d’examen ont été trop courts. J’espère néanmoins que les débats nous permettront d’approfondir les sujets et d’adopter les mesures dont nous avons tous besoin.
S’agit-il d’une grande ou d’une petite loi et quelle est sa place dans l’ambition que nous portons pour la transition écologique ?
La transition écologique, la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité sont des actions de système. Même si je sais que je m’adresse au législateur, je répondrai que la loi ne peut pas tout – nous le savons tous. La loi porte une vision, fixe les orientations et donne des moyens juridiques pour agir. Ce texte intervient après d’autres lois qui ont posé des normes et organisé des actions.
Vous l’avez dit, la loi sans les moyens n’est rien. C’est la raison pour laquelle une partie de la réponse se trouvera dans le projet de loi de finances et dans notre capacité à investir.
De plus, tout ne se décide pas au niveau national, tout ne dépend pas de l’État.
Mme Emmanuelle Wargon, secrétaire d ’ État. Les collectivités territoriales sont aussi des acteurs importants. Vous l’avez dit, la mobilisation territoriale est absolument essentielle.
Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.
Je travaille avec les collectivités territoriales depuis que j’ai reçu le portefeuille de secrétaire d’État au ministère de la transition écologique et solidaire. Nous travaillons pour le déploiement de la transition écologique et solidaire au quotidien au plus près des territoires. Les collectivités territoriales auront à apporter une partie de la réponse aux questions qui nous sont posées : la rénovation des bâtiments, les transports, le développement des énergies renouvelables.
Vous avez parlé de l’industrie. Vous avez raison : les filières industrielles sont un enjeu majeur. Elles ne sont pas traitées dans ce texte, parce qu’elles le seront dans le pacte productif 2025 pour le plein emploi porté par Bruno Le Maire. Dans ce cadre, le groupe de travail sur l’énergie a pour objectif de développer notre autonomie, de trouver des solutions françaises et de préserver la compétitivité de l’énergie pour nos entreprises, en particulier pour les industries électro-intensives. La question est traitée dans tous les comités stratégiques de filière, parce que c’est là que ces sujets se traitent.
Par ailleurs, les financements ne sont pas tous publics. J’ai évoqué les financements budgétaires de l’État, mais nous devons aussi mobiliser les banques et les grands financeurs privés. C’est l’objectif que poursuit le Gouvernement au travers de la création, annoncée au Conseil de défense écologique, du plan France transition écologique qui devrait nous permettre de mobiliser des financeurs privés.
Enfin, il faut mobiliser les citoyens. Je suis d’accord avec ceux qui disent que la transition écologique doit aussi être sociale et solidaire. Nous devons porter attention aux plus modestes, à ceux qui sont touchés de plein fouet par le changement climatique, aux ménages dont le budget ne permet pas de faire face à l’augmentation des factures. C’est important, car notre modèle social est en cause. Le Gouvernement a déjà pris de nombreuses mesures, notamment le chèque énergie, dont le dispositif a été fortement étendu, le nombre de ménages éligibles étant passé d’environ 3 millions à 5, 8 millions cette année.
Ce projet de loi est donc important, c’est un maillon d’un système qui va nous permettre d’aller plus vite, plus fort et d’atteindre les objectifs que nous nous fixons en matière de transition écologique.
Ces objectifs sont-ils compatibles avec l’accord de Paris ? La réponse est oui ! Ils sont compatibles avec la neutralité carbone en 2050, neutralité qui nous permettra d’atteindre un autre objectif de l’accord de Paris, avec une trajectoire à 2 degrés, voire à 1, 5 degré.
Le Parlement est-il suffisamment associé ? La PPE est fixée par décret depuis la loi de 2015. C’est le législateur qui l’a décidé. Nous avons toutefois progressé, puisque le projet de loi prévoit une loi quinquennale fixant les grandes lignes de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Un équilibre entre les pouvoirs législatif et exécutif a ainsi été trouvé, ce dont je me réjouis.
Il est exact que nous avons installé le Haut Conseil pour le climat en parallèle de la démarche législative. Il est néanmoins important de le doter d’un fondement législatif, qui lui conférera une importance à la hauteur des enjeux et permettra de sécuriser son rôle consultatif.
Des hypothèses sous-jacentes à la programmation pluriannuelle de l’énergie ont été avancées. Je tiens à dire que c’est une programmation ambitieuse, qui s’appuie d’abord sur une volonté de réduction de la consommation et de sobriété indispensable. La bonne énergie est d’abord celle que l’on ne consomme pas, celle que l’on réduit. La programmation porte également un mix énergétique ambitieux et un volet compensation. Ce dernier est important, car bien qu’il soit résiduel et national, il s’agit de la séquestration du carbone.
J’aimerais maintenant répondre sur quelques points plus particuliers.
La rénovation thermique des bâtiments est évidemment une priorité, mais, là encore, la loi ne peut pas tout. La loi de 2015 a confié aux régions un rôle de chef de file qu’elles n’ont pas pleinement exercé. En outre, le système de distribution des aides n’est pas complètement opérationnel et nécessite une amélioration. Tout cela ne relève pas principalement du niveau législatif. Nous allons mener ce chantier avec Julien Denormandie afin de contractualiser avec les collectivités territoriales et d’améliorer la performance du système et son pilotage.
Nous devons aussi améliorer le label RGE, ce qui relève du niveau réglementaire, et la lutte contre la fraude, qui ne relève ni du niveau réglementaire ni du niveau législatif. Au-delà des dispositions déjà prévues dans le texte pour lutter contre la fraude aux CEE, ce dernier enjeu est d’abord opérationnel.
Nous allons fusionner le crédit d’impôt pour la transition énergétique et les aides de l’ANAH dans le projet de loi de finances, mais nous devons engager parallèlement un chantier de transformations de l’action de l’État et des collectivités territoriales délégataires afin de rendre le dispositif plus opérationnel et plus efficace.
Nous allons travailler sur le droit des copropriétés, non pas dans ce texte, mais dans une ordonnance d’application de la loi ÉLAN. Nous devons permettre aux propriétaires d’un bien en copropriété de disposer d’un système simplifié et de dispositions favorisant la rénovation en copropriété.
Nous allons également élargir les aides aux propriétaires bailleurs et recentrer les aides sur les ménages les plus modestes, qu’ils soient propriétaires ou locataires, pour tenir compte de la nécessité de toucher d’abord les passoires thermiques.
J’en viens au biogaz et à l’éolien offshore. Plusieurs orateurs ont appelé l’attention du Gouvernement sur la nécessité de nous doter d’une trajectoire suffisamment ambitieuse en ces matières. Je partage cette préoccupation. La PPE a été mise en consultation, les derniers réglages sont en cours, mais je crois qu’il sera possible de ne pas réduire les prix du biogaz trop vite afin de permettre le développement de la filière.
La modification du plafond de l’Arenh est nécessaire pour limiter les hausses que les consommateurs subissent. En effet, les concurrents d’EDF souhaitent souscrire des volumes plus importants d’électricité de base. Nous recherchons le bon équilibre. Cela supposera probablement aussi une discussion sur le tarif, mais nous ne souhaitons pas lier juridiquement les deux sujets dans le texte…
… pour garder un peu de marge de manœuvre et pour rester conforme au droit communautaire.
Concernant les centrales à charbon, l’accompagnement est en place. Nous avons pris l’engagement de fermer ces centrales d’ici à 2022. Cet engagement sera tenu en respectant la sécurité d’approvisionnement. Les scenarii réalisés par RTE permettent d’envisager une fermeture définitive d’ici à 2022 pour trois sites sur quatre. En fonction de la réalisation des hypothèses, les capacités de production du site de Cordemais pourront être appelées ponctuellement. Nous y travaillons avec EDF. Par ailleurs, les projets de territoire sont en cours d’élaboration. Nous apportons une attention toute particulière aux salariés et aux sous-traitants concernés par ces fermetures.
Il en va de même pour les fermetures de centrales ou de tranches nucléaires. La fermeture des deux tranches de Fessenheim aura lieu en 2020 conformément aux engagements pris. Un projet de territoire a été signé à Fessenheim le 1er février, et un travail sur la réindustrialisation du site et sur les perspectives nouvelles que nous pouvons proposer aux salariés et aux sous-traitants concernés a été engagé.
Pour le reste, les fermetures s’échelonneront dans la deuxième partie de la PPE. À l’occasion de la présentation de cette dernière, nous avons désigné les sites indicatifs et précisé que nous ne fermerions pas totalement des sites, mais seulement des tranches, ce qui facilitera l’accompagnement.
Vous avez également évoqué l’autorité environnementale. Nous souhaitons simplement revenir au système qui existait avant 2017 et trouver la base juridique permettant de définir le rôle du préfet de manière équilibrée, de sorte que l’autorité environnementale puisse rendre des avis et que les projets puissent être mis en œuvre. Nous ne démantelons donc pas du tout l’autorité environnementale.
J’en viens aux transports. Le sujet a été traité dans la LOM et longuement discuté au Sénat. En ce qui concerne la contribution du transport routier, des réflexions sont en cours. Nous souhaitons ne pas faire peser de charges supplémentaires sur les entreprises de poids lourds françaises qui payent déjà des taxes en France. Nous devons également veiller à respecter le droit communautaire. L’annulation récente d’un dispositif adopté en Allemagne par la Cour de justice de l’Union européenne nécessite une analyse approfondie.
Comme cela a été dit, les certificats d’économies d’énergie constituent un mécanisme important, qui, au même titre que la loi, les règlements, les crédits budgétaires, les crédits des collectivités locales, les financements privés ou l’industrie, concourent à atteindre nos objectifs en matière de transition écologique et énergétique. Nous voulons donner plus de visibilité aux obligés, mais la fixation des volumes dans la loi nous paraît trop rigide.
Enfin, l’hydroélectricité est la première source d’énergie renouvelable en France. Elle est à ce titre extrêmement importante. Nous examinons les possibilités de développement des concessions hydroélectriques dans le respect de notre marge de manœuvre communautaire, mais nous n’excluons pas la mise en place d’un système en régie.
Nous sommes prêts à avancer sur la petite hydroélectricité, mais pas au prix de la continuité des rivières et de la continuité territoriale et pas au prix du maintien de la biodiversité. Il nous faut donc trouver les compromis, au cas par cas, notamment sur des ouvrages existants, afin de développer cette petite hydroélectricité sans revenir sur la continuité des rivières dont nous avons besoin et qui fait par ailleurs partie des engagements pris et souhaités par tous en matière de biodiversité.
J’en terminerai en revenant sur l’exemplarité de l’État : je vous rejoins, je pense que c’est un sujet très important sur lequel nous devrons travailler.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Chapitre Ier
Objectifs de la politique énergétique

L’amendement n° 254, présenté par M. Gay, Mmes Cukierman, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 100-4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 100-… ainsi rédigé :
« Art. L. 100-…. – Afin de respecter les objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-4, la France mène une expertise indépendante sur les conséquences environnementales et climatiques de la ratification de tout nouvel accord de libre-échange.
« Un tel accord ne peut être ratifié s’il est contraire aux engagements internationaux de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre, des autres objectifs environnementaux fixés au niveau national et des objectifs de développement durable. »
La parole est à M. Fabien Gay.

Nous demandons une expertise indépendante avant la signature de tout nouveau traité de libre-échange. Comme je l’ai indiqué précédemment, il y en a treize sur la table : le Tafta, le CETA, le Mercosur, le Jefta, l’AELE, sans oublier le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Ces traités soulèvent des questions qui ne se posaient pas il y a quelque temps. Pourquoi demandons-nous une expertise indépendante ?
D’abord, parce que ces traités de libre-échange sont négociés dans la plus grande opacité. Nous ne disposons ni des mandats de négociation ni même des textes finaux. Par exemple, nous ne disposons pas du texte final du Mercosur, dont les négociations ont débuté il y a vingt ans et qui vient d’être signé.
Ensuite, comme nous le disons souvent, ces traités font courir des risques sanitaires, sociaux ou environnementaux. Je prendrai deux exemples relatifs au CETA.
Premièrement, nous l’avions dit il y a quelques mois lors du débat sur le CETA organisé à la demande de notre groupe, l’entreprise AquaBounty élève des saumons en utilisant des OGM. Demain, quand nous aurons ratifié le CETA – alors que ce traité est déjà en application depuis deux ans en toute illégalité –, nous aurons du saumon OGM dans nos assiettes, parce que la traçabilité sera impossible.
Deuxièmement, alors que nous demandons la traçabilité bête par bête à nos éleveurs de la filière bovine, et nous avons raison de le faire, la traçabilité des bœufs canadiens est impossible. Or le Canada ne dispose d’aucune filière n’ayant recours ni aux OGM ni aux farines animales. On nous dit qu’une filière sans OGM mettra trois ans à se mettre en place…
Tout cela mérite selon nous une expertise indépendante afin de déterminer si les traités de libre-échange contreviennent à nos normes sociales et environnementales. Si c’est le cas, nous ne les signerons pas.
Cet amendement est tout à fait d’actualité, il est de bon sens, et je pense que, collectivement, nous pouvons le voter.

Les dispositions que prévoit cet amendement, qui est effectivement d’actualité, sont problématiques à plus d’un titre.
En premier lieu, son dispositif serait très contraignant, non seulement pour le Président de la République, mais aussi pour le Parlement, qui disposent tous deux du pouvoir de ratifier les traités dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.
En second lieu, l’étude préalable à la ratification d’un accord, quand bien même elle présenterait des gages d’indépendance, sera toujours sujette à caution. Pour s’en convaincre, il suffit de se souvenir de l’étude élaborée à la demande du Gouvernement sur l’accord de libre-échange avec le Canada, le CETA. Dans ce contexte, le dispositif proposé pourrait ne pas suffire à introduire davantage de rationalité dans les choix de politique internationale.
Enfin et surtout, il n’est pas besoin d’empêcher la ratification d’un accord contraire aux engagements internationaux et européens de la France en matière d’énergie et de climat. En effet, ces engagements sont pleinement applicables, et la France ne saurait les dénoncer pour leur préférer des engagements de sens contraire.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement.
Le Gouvernement est bien sûr très attentif à ce que les accords de libre-échange soient pleinement compatibles avec nos objectifs climatiques et environnementaux. C’est la raison pour laquelle nous avons déjà décidé de mener des évaluations sur chacun des grands accords.
Les impacts environnementaux et sanitaires du CETA avaient fait l’objet d’une évaluation par une commission d’experts indépendants. Nous nous attacherons aussi à évaluer pleinement les effets de l’accord avec le Mercosur, qui, lui, n’est pas encore entré en vigueur et n’entrera en vigueur qu’après une décision à l’unanimité du Conseil européen. Ce n’est pas la peine d’inscrire le principe de cette expertise indépendante dans la loi, puisqu’elle est déjà mise en œuvre.
De plus, la formulation retenue dans le dispositif de l’amendement est très générale et a relativement peu de portée pratique, car il est quasiment impossible de déterminer si un accord en particulier est responsable de notre capacité ou de notre incapacité à atteindre nos objectifs.
Enfin, tous les accords internationaux ne font pas l’objet d’une ratification au niveau national, certains relevant en effet de la compétence exclusive de la Commission européenne.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est, comme la commission, défavorable à l’amendement.

D’abord, mettons-nous d’accord sur les termes : s’il existe bien différents traités de libre-échange, nous parlons pour notre part de traités de libre-échange de seconde génération, c’est-à-dire de traités qui modifieront profondément nos normes et nos lois, en raison notamment de la mise en place de tribunaux arbitraux privés qui seront au-dessus des lois que nous votons. Par exemple, une multinationale qui déciderait d’attaquer un État comme la France, parce qu’elle estimerait qu’une norme sociale ou environnementale ne lui permettrait pas de faire du business dans notre pays, pourra le faire devant un tribunal arbitral et pourra obtenir sa condamnation. Je rappelle que les tribunaux arbitraux ont déjà été saisis plus de 800 fois dans la dernière période, ce qui prouve que cela arrivera fatalement ! C’est pourquoi ce traité de libre-échange de seconde génération doit être ratifié, soit par les parlements nationaux, soit par référendum.
Ensuite, je vous entends bien, madame la secrétaire d’État, quand vous nous expliquez que des études ont été menées. Simplement, nous ne les avons pas ! Rien n’est transparent, je le répète, ni les mandats de négociation, ni les textes finaux, ni les études d’impact que vous évoquez. Si vous les avez, rendez les publics ! Organisez de grands débats sur les chaînes audiovisuelles publiques, afin de mettre à la disposition du peuple français toutes les informations – je dis bien « toutes » – dont il a besoin pour se décider !
Pour l’instant, l’opacité règne. Avec cet amendement, nous ne demandons pas que les accords de libre-échange ne soient pas ratifiés, mais que les expertises indépendantes soient rendues publiques : c’est tout ce que nous demandons et c’est le minimum vital, surtout en ce moment ! C’est pourquoi nous allons demander un scrutin public sur l’amendement n° 254.

Nous sommes sensibles à cette problématique et considérons que la question posée par les auteurs de l’amendement est pertinente et légitime. C’est la raison pour laquelle nous le soutiendrons.

Je mets aux voix l’amendement n° 254.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe CRCE.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 166 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de Mme Hélène Conway-Mouret.