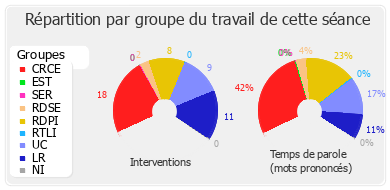Séance en hémicycle du 31 janvier 2008 à 15h00
Sommaire
- Candidatures à une commission mixte paritaire (voir le dossier)
- Rétention de sûreté (voir le dossier)
- Nomination de membres d'une commission mixte paritaire (voir le dossier)
- Retrait de l'ordre du jour d'une question orale
- Transmission d'un projet de loi
- Textes soumis au sénat en application de l'article 88-4 de la constitution
- Dépôt d'un rapport
- Ordre du jour (voir le dossier)
La séance
La séance, suspendue à onze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures.

La séance est reprise.

J'informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (nos 158, 174).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 16 rectifié au sein de l'article 1er, dont je rappelle les termes.
I. - Après l'article 706-53-12 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« De la rétention de sûreté
« Art. 706-53-13. - Lorsque la juridiction a expressément prévu dans sa décision le réexamen de la situation de la personne qu'elle a condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à quinze ans, pour l'un des crimes suivants commis sur un mineur :
« 1° Meurtre ou assassinat ;
« 2° Torture ou actes de barbarie ;
« 3° Viol ;
« 4° Enlèvement ou séquestration,
« cette personne peut, à compter du jour où la privation de liberté prend fin, faire l'objet d'une rétention de sûreté lorsqu'elle présente, en raison d'un trouble grave de la personnalité, une particulière dangerosité caractérisée par la probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une de ces infractions.
« Cette mesure consiste dans le placement de la personne intéressée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale et sociale destinée à permettre la fin de la rétention.
« Le présent article est également applicable aux personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé ou d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal.
« Art. 706-53-14. - La situation des personnes mentionnées à l'article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, afin d'évaluer leur dangerosité.
« À cette fin, cette commission rassemble tous les éléments d'information utiles et fait procéder à une expertise médicale, réalisée par deux experts, ainsi qu'aux enquêtes nécessaires.
« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté dans le cas où :
« 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 ;
« 2° Et si cette rétention constitue ainsi l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.
« Art. 706-53-15. - La décision de rétention de sûreté est prise par la commission régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette commission est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.
« Cette commission est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.
« La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l'article 706-53-14.
« Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné.
« Elle peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.
« La commission nationale statue par une décision motivée qui n'est pas susceptible de recours, à l'exception d'un pourvoi devant la Cour de cassation.
« Art. 706-53-16. - La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.
« La rétention de sûreté peut être renouvelée selon les modalités prévues par l'article 706-53-15 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14 sont toujours remplies.
« Art. 706-53-17. - Supprimé.
« Art. 706-53-18. - La personne qui fait l'objet d'une rétention de sûreté peut demander à la commission régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d'office à la rétention si cette commission n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.
« La décision de cette commission peut faire l'objet du recours prévu à l'article 706-53-15.
« Art. 706-53-19. - La commission régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office qu'il soit mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14 ne sont plus remplies.
« Art. 706-53-20. - Si la rétention de sûreté n'est pas prolongée ou s'il y est mis fin en application des articles 706-53-18 ou 706-53-19 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article 706-53-13, la commission régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire, soumettre celle-ci pendant une durée d'un an aux obligations résultant du placement sous surveillance électronique mobile conformément aux articles 763-12 et 763-13 ainsi qu'à des obligations similaires à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnées à l'article 723-30, et notamment à une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique.
« À l'issue de ce délai, la commission régionale peut prolonger tout ou partie de ces obligations, pour une même durée, par une décision prise après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. Cette décision peut faire l'objet du recours prévu à l'article 706-53-15. Ces obligations peuvent à nouveau être prolongées pour une même durée et selon les mêmes modalités.
« Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par le risque particulièrement élevé de commission des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, le président de la commission régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la commission régionale statuant conformément à l'article 706-53-15, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la rétention.
« Art. 706-53-21. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne qui bénéficie d'une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l'objet d'une révocation.
« Lorsque la rétention de sûreté est ordonnée à l'égard d'une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin.
« Art. 706-53-22. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judicaire de sûreté, en matière notamment de visites, de correspondances, d'exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l'ordre public.
« La liste des cours d'appel dans lesquelles siègent les commissions régionales prévues au premier alinéa de l'article 706-53-15 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux. »
I bis. - L'article 362 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine conformément à l'article 706-53-14. »
II. - L'article 717-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Deux ans avant la date prévue pour la libération d'un condamné susceptible de relever des dispositions de l'article 706-53-13, celui-ci est convoqué par le juge de l'application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application des deuxième et troisième alinéas du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.
« Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de dispenser des soins aux détenus les informations utiles à la mise en oeuvre des mesures de protection des personnes. »
III. - L'article 723-37 du même code devient l'article 723-39 et, après l'article 723-36 du même code, il est rétabli un article 723-37 et inséré un article 723-38 ainsi rédigés :
« Art. 723-37. - Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne faisant l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 706-53-13, la commission régionale mentionnée à l'article 706-53-15 peut, selon les modalités prévues par cet article, décider d'en prolonger les effets, au-delà de la limite prévue à l'article 723-29, pour une durée d'un an.
« La commission régionale de la rétention de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.
« Cette prolongation ne peut être ordonnée, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :
« 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judicaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 ;
« 2° Et si cette prolongation constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions.
« Cette prolongation peut être renouvelée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.
« Les articles 723-30, 723-33 et 723-34 sont applicables à la personne faisant l'objet de cette prolongation.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-20 sont applicables en cas de méconnaissance par la personne de ses obligations.
« Art. 723-38. - Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile a été prononcé dans le cadre d'une surveillance judiciaire à l'encontre d'une personne faisant l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 706-53-13, il peut être renouvelé tant que la mesure de surveillance judiciaire est prolongée. »
IV. - L'article 763-8 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 763-8. - Lorsqu'un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne faisant l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 706-53-13, la commission régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15, décider d'en prolonger les effets, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l'article 131-36-1 du code pénal, pour une durée d'un an.
« Les dispositions des deuxième à cinquième et septième alinéas de l'article 723-37 du présent code sont applicables, ainsi que celles de l'article 723-38. »

L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
traitement dans
rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article :
l'un des établissements pénitentiaires spécialisés dont la liste est précisée par décret.
La parole est à M. le rapporteur.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le projet de loi prévoit que deux ans avant la date de la libération le juge de l'application des peines peut décider au vu du dossier médical et psychologique du condamné de lui proposer de recevoir un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.
Outre que cette initiative intervient bien tardivement - mais l'amendement n° 14 de la commission a déjà répondu à cette objection -, la nature de l'établissement spécialisé dont il est question demeure indécise.
En effet, aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru doivent actuellement exécuter leur peine dans des « établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté ».
Or, la définition précise de ces établissements n'a jamais été apportée et il semble que l'administration pénitentiaire considère peu ou prou tous les établissements pénitentiaires comme étant à même de dispenser un suivi médical et psychologique adapté. De nombreuses visites dans les prisons laissent pourtant penser que tel n'est pas le cas.
Aussi, nous proposons, par cet amendement, d'encourager l'administration à définir une liste précise d'établissements spécifiques et ainsi d'inciter sur le fond à une véritable spécialisation de certaines structures.
Lors d'un débat récent avec un psychiatre, celui-ci m'a dit que l'une des solutions serait peut-être, après que l'évaluation a pu repérer la dangerosité d'un certain nombre de personnes condamnées - cette première évaluation dans l'année qui suit leur incarcération -, de faire en sorte que les personnes considérées comme étant particulièrement dangereuses fassent l'objet d'un regroupement afin de pouvoir être suivies dans un établissement adapté. Il ajoutait - il n'engageait que lui - que si nous prenions ce type d'initiative, la rétention de sûreté deviendrait inutile parce que le traitement permettrait de faire disparaître la dangerosité à la fin de la peine.
Je comprends tout à fait l'objectif de cet amendement, qui permet de savoir où sont les structures et d'inciter à en créer d'autres.
Cependant, dans les faits, les établissements se sont spécialisés.
Dans certains établissements, le personnel est volontaire. Si je prends le cas de Melun, cela s'est fait avec des dispositifs expérimentaux mais aussi avec la volonté du secteur sanitaire local de développer des structures pluridisciplinaires ou de créer les fameuses commissions pluridisciplinaires qui, aujourd'hui, ne sont qu'expérimentales.
Si l'on est obligé d'attendre un arrêté ou un décret, cela rigidifie la situation en freinant les bonnes volontés. Si l'on veut placer des détenus adaptés à ces structures, cela empêche de le faire rapidement parce qu'il faudra attendre que le décret ou l'arrêté reconnaisse l'établissement concerné comme étant spécialisé. Il est vrai qu'il faudra un jour arriver à spécialiser les établissements.
Cela permettrait aussi - cette mesure figurera également dans la loi pénitentiaire - d'avoir des statistiques sur la récidive, de savoir pourquoi certains établissements ont de meilleurs résultats en matière de réinsertion, sans remettre en cause les personnels, mais simplement en étudiant les structures qu'ils mettent en place à titre expérimental, car toutes les innovations ou expérimentations ne remontent pas forcément jusqu'à la Chancellerie.
Pour ma part, je comprends tout à fait l'intérêt d'établir par arrêté ou par décret une liste de tous les établissements spécialisés, sauf que cela peut freiner les bonnes volontés et accroître les délais. À Melun, par exemple, cela s'est fait de manière expérimentale, sur la bonne volonté et très rapidement. Si l'on avait été obligé de passer par un décret, il aurait fallu attendre l'avis du ministère de la santé et cela aurait ralenti la spécialisation.
En résumé, il s'agit d'un amendement incitatif, qui permet de voir l'évolution et donc d'évaluer. Comme, dans les faits, nous ne sommes pas encore totalement au point, cela permet également d'encourager les dispositifs expérimentaux et les bonnes volontés.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Je comprends les objections de Mme le garde des sceaux. Toutefois, le problème que nous posons est réel. Il m'est arrivé de lire que tel établissement - je pense à Mauzac et à Casabianda - était un établissement adapté. Je me suis rendu aussi bien à Casabianda qu'à Mauzac. J'ai pu voir, en effet, l'intérêt du régime qui était appliqué aux détenus, un régime très souple, une assez grande liberté dans l'enceinte pénitentiaire, liberté très respectueuse de la dignité des personnes. Mais en dehors de cela, ce ne sont pas des établissements spécialisés pour un traitement psychologique ou psychiatrique adapté. Les horaires des psychiatres y étaient « homéopathiques », c'est le moins que l'on puisse dire.
En revanche, je comprends que vous ayez besoin d'un peu de temps pour organiser les choses.
Mme le garde des sceaux s'exclame.

Madame le garde des sceaux, je préfère retenir de votre intervention le fait que vous considérez que cela pose un vrai problème, que cela permettrait d'aller vers une spécialisation des établissements et puisque nous allons nous revoir très prochainement avec le projet de loi pénitentiaire, je prends la responsabilité de retirer cet amendement.

L'amendement n° 16 rectifié est retiré.
Je vous donne néanmoins la parole, monsieur Collombat.

J'aurais pu reprendre cet amendement, monsieur le président.
Je suis très étonné de l'argumentation de Mme le garde des sceaux. En effet, l'un des nombreux problèmes que pose ce texte, c'est que l'on n'a aucune structure pour évaluer sérieusement la dangerosité criminologique, et encore moins pour la traiter. M. le rapporteur attire notre attention sur le fait qu'il faudrait peut-être se donner les moyens intellectuels et matériels d'appliquer les textes que l'on vote.
On me dit qu'il faut attendre que le décret... Je croyais que nous étions pressés, qu'il y allait avoir de nombreuses victimes si on n'agissait pas tout de suite. Si la situation est urgente, on peut prendre les décrets et donner un minimum de moyens. L'argumentation du Gouvernement est vraiment très étonnante.

Je me reconnais dans les propos de mon collègue Pierre-Yves Collombat. J'ajouterai simplement que l'on n'ouvre pas un établissement spécialisé tous les mois, malheureusement d'ailleurs compte tenu de la situation de notre réseau en France.
Par conséquent, l'argument des délais ne me semble pas très convaincant. Compte tenu du nombre d'ouvertures d'établissement, on doit avoir le temps de fixer par arrêté la liste de ces établissements spécialisés, sans que cela porte préjudice aux malades qui attendent une prise en charge.

Madame le garde des sceaux, je n'ai pas compris vos propos de la même façon, même si le résultat est le même. J'ai cru comprendre que ce n'était pas la peine d'établir cette liste car, dans la pratique, les établissements se spécialisent, que le fait d'attendre une reconnaissance administrative ne faisait qu'accroître la bureaucratie...

...et que cela décourageait les bonnes volontés.
Ce n'est pas, me semble-t-il, une bonne façon d'aborder le problème. En effet, ce que nous observons actuellement, c'est qu'il n'y a pas les moyens correspondants à une prise en charge suivie pour les personnes concernées. Il est donc nécessaire de créer des endroits où ce suivi individualisé et cette prise en charge pourront réellement être faits et de concentrer le maximum de moyens correspondants.
Sans approuver pour autant le reste, je considère que l'idée de prévoir des établissements spécialisés, c'est le minimum pour contrebalancer le fait que nous n'en avons pas aujourd'hui.
Monsieur Collombat, vous avez parlé de l'évaluation de la dangerosité. Aux termes de la loi de 2005, la commission pluridisciplinaire évalue la dangerosité sur la foi d'expertises.
Ce que propose M. le rapporteur, c'est d'établir par décret la liste des établissements spécialisés en matière de soins avec une prise en charge sanitaire continue.
Il y a donc deux choses : d'une part, l'évaluation de la dangerosité, qui ne pose pas de problème en soi parce qu'elle existe déjà, et, d'autre part, le programme de soins auquel je suis très favorable.
Madame Borvo Cohen-Seat, je n'ai pas dit qu'il s'agissait de bureaucratie et que donc je m'y opposais. Mais si l'on établit une liste par décret, on fige les établissements. Si on doit affecter demain un détenu considéré comme dangereux et pour lequel il faut une prise en charge spécifique, je crains que l'affectation ne soit retardée au motif qu'il n'y a pas de place dans l'établissement qui est inscrit dans le décret. Je crains également qu'un autre établissement, qui pourrait être aussi adapté, ne le prenne pas en charge car il existe un établissement spécialisé.
Pour autant, je suis favorable à l'objectif visé par cet amendement, parce que cela permet d'identifier clairement les établissements. J'ai parlé tout à l'heure de Melun qui n'est jamais cité, alors que 80% à 90 % des détenus sont des délinquants sexuels lourdement condamnés, récidivistes.
Attendre une modification du décret pour ajouter un établissement sur la liste présente un caractère bureaucratique car les personnels, notamment en ce qui concerne la psychiatrie et la psychologie, pourront décider de ne pas se rendre dans cet établissement au motif qu'ils préféreront travailler dans un établissement reconnu comme étant spécialisé.
Nous donnons la possibilité aux établissements pénitentiaires de signer des conventions et de développer des partenariats avec le secteur psychiatrique local. À cet égard, Melun travaille, grâce à la bonne volonté des uns et des autres, en coordination avec le secteur sanitaire et psychiatrique local, et ce n'est pas M. le président Hyest qui me contredira.
Fixer la liste des établissements spécialisés par décret pourra entraîner un retard dans l'affectation des personnels et, donc, dans le travail.
Sur le fond, je le répète, je suis totalement favorable à l'objectif visé par cet amendement, car les établissements seront identifiés. De plus, le travail des magistrats sera facilité pour ce qui concerne l'affectation de certains détenus.
Mais, en l'occurrence, on parle de la rétention de sûreté. Dans l'amendement, il s'agit de deux types d'établissements distincts : d'un côté, les établissements pénitentiaires et, de l'autre, les établissements de rétention, qui sont des hôpitaux.

Cette discussion était intéressante, mes chers collègues, mais je vous rappelle que l'amendement n° 16 rectifié a été retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Ces deux amendements sont présentés par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.
L'amendement n° 44 est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa du II de cet article :
« Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ne peuvent transmettre aux personnels de santé chargés de dispenser les soins aux détenus que les informations strictement nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de protection des personnes. »
L'amendement n° 46 est ainsi libellé :
Au début du dernier alinéa du II de cet article, ajouter les mots :
Après avoir dûment recueilli le consentement du détenu,
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery pour présenter ces deux amendements.

Monsieur le président, je souhaiterais présenter en même temps l'amendement n° 42, car tous les trois concernent le secret médical.

J'appelle donc en discussion l'amendement n° 42, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, et ainsi libellé :
Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 226-13 du code pénal est applicable aux informations mentionnées à l'alinéa précédent. »
Veuillez poursuivre, madame Boumediene-Thiery.

Le dernier alinéa du paragraphe II de cet article porte atteinte au secret médical et est contraire à l'article 72 du code de déontologie. Celui-ci fait obligation au médecin de « veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment ».
Ce texte s'applique au personnel administratif et à la secrétaire médicale, lesquels sont donc soumis au secret médical. Il concerne également les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire qui ont connaissance du dossier médical du condamné. Ils sont donc tenus de respecter le secret médical dans l'exercice de leurs fonctions, notamment en vertu de l'article 226-13 selon lequel « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Le projet de loi ne prévoit pas de déroger à cette disposition.
Afin de limiter les informations susceptibles de circuler entre les agents du service public pénitentiaire et le personnel des établissements pénitentiaires spécialisés, il convient de les circonscrire aux seules informations strictement nécessaires à la mise en oeuvre des mesures de protection des personnes condamnées.
Par la même occasion, cet amendement vise à remplacer l'adjectif « utiles » par l'adjectif « nécessaires » qui est juridiquement plus approprié.
Par ailleurs, le principe du respect du secret médical n'est pas absolu : le malade a le pouvoir de délier le praticien du secret médical.
Le consentement du malade à la levée du secret supprime le caractère confidentiel de l'information. En réalité, les informations visées par cet article vont plus loin que celles qui sont relatives à la santé du détenu. Il y a donc là une violation du principe du respect de la vie privée, ce qui constitue une ingérence que seul le consentement du condamné peut justifier.
En se fondant sur cette dérogation, l'amendement n° 46 prévoit que la transmission des informations relatives au condamné sera soumise à son consentement.
Quant à l'amendement n° 42, il tend à limiter le champ des informations relatives au condamné susceptibles d'être transmises, conformément à l'article 226-13 du code pénal.
L'obligation du secret médical a un caractère général et absolu, ce qui interdit toute révélation à un tiers, même s'il s'agit d'un professionnel, lui aussi assujetti au secret.
Il convient, en effet, de rappeler le principe selon lequel la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est susceptible de poursuites pénales.
Or le dernier alinéa du II ne prévoit aucune articulation entre les dispositions du code pénal et le contenu des informations qui peuvent être transmises. La référence aux « informations utiles » recouvre une variété importante d'informations, qui peuvent être de nature médicale, mais également de nature personnelle.
Cette restriction au droit de transmettre les informations relatives au détenu vise au respect du droit à la vie privée de chacun, garanti par l'article 9 du code civil.

La commission estime que l'amendement n° 44 restreindrait de manière excessive l'obligation fixée par le projet de loi aux agents et collaborateurs du service public pénitentiaire de transmettre aux personnels de santé les informations utiles à la protection des personnes.
Cette disposition, qui consacre une pratique très courante au sein des établissements pénitentiaires, est d'ailleurs le pendant de la mesure prévue à l'article 8 du projet de loi, qui fixe aux personnels de santé une obligation de signaler au directeur de l'établissement un risque pour la sécurité des personnes.
Il nous semble utile de permettre une transmission plus grande des informations relatives à la sécurité des personnes au sein des prisons.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 46. Il nous semble ni nécessaire ni même souhaitable de recueillir l'accord de l'intéressé. La nature des informations concernées touche non pas au secret médical, mais seulement au risque que peut présenter le comportement d'un détenu. Je serais même tenté de dire que ce risque concerne aussi bien un codétenu que le détenu lui-même.
En effet, il est difficile de demander à un détenu que l'on pense suicidaire son autorisation pour transmettre cette information à l'administration pénitentiaire. Or, s'il a des tendances suicidaires, la première précaution à prendre est de faire en sorte qu'il ne se retrouve pas seul en cellule.
S'agissant de l'amendement n° 42, la commission partage sur le fond les propos de Mme Boumediene-Thiery, mais la précision demandée nous semble inutile.
En effet, l'article 226-13 du code pénal, qui prévoit une sanction en cas de révélation d'une information à caractère secret, s'applique de fait aux informations mentionnées à l'alinéa précédent sans qu'il soit nécessaire de s'y référer expressément. Au lieu de renforcer la portée de cet article, cette référence expresse aurait plutôt pour conséquence de l'affaiblir.
Dans ces conditions, la commission vous demande, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces trois amendements.
S'agissant de l'amendement n° 44, je vous indique, madame la sénatrice, que nous avons transmis ce projet de loi au Conseil national de l'ordre des médecins, qui a estimé que la formulation retenue n'entachait pas la notion du secret médical. L'expression « informations utiles », très différente de la formule « informations strictement nécessaires », permet notamment d'éviter que la responsabilité du personnel pénitentiaire ne soit mise en cause pour non-assistance à personne en danger.
Dès lors que le personnel pénitentiaire détient des informations sur des détenus très fragiles, soit au cours des entretiens qu'il peut avoir avec eux, soit lors des activités que ceux-ci pratiquent au sein de l'établissement, il importe qu'il puisse les communiquer à l'autorité médicale. Il s'agit donc bien d'informations utiles.
Concernant l'amendement n° 42, je rejoins les propos de M. le rapporteur. L'administration pénitentiaire est soumise au secret professionnel. Si elle détient des informations de nature médicale, elle sera également, d'un point de vue juridique, soumise au secret professionnel. Comme l'a indiqué M. le rapporteur, la précision que vous proposez, madame la sénatrice, ne ferait qu'affaiblir la portée même de l'article 226-13.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 70, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le III de cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

En application des articles 723-37 et 723-38 du code de procédure pénale, la commission régionale de la rétention de sûreté, ou plus exactement la juridiction régionale de la rétention de sûreté - cette nouvelle dénomination ayant été adoptée hier - pourra prolonger une décision de placement sous surveillance judiciaire ou sous surveillance électronique mobile, et ce indéfiniment.
Jusqu'à présent, ces obligations ne pouvaient excéder la durée correspondant aux réductions de peine.
Sur le plan des faits, la commission des lois n'a pas manqué de souligner les difficultés, pour une personne, de demeurer, dans la durée, sous surveillance électronique. Du point de vue du droit, elle n'a pas manqué de pointer les contradictions et les risques d'inconstitutionnalité, notamment au regard du principe de non-rétroactivité des lois.
Cependant, tenant malgré tout à valider ce projet de loi, elle a tenté de contourner la difficulté en proposant de modifier les dispositions de ce paragraphe III. Toutefois, - et c'est inévitable - on demeure dans la confusion.
Je rappelle que si, dans sa décision en date du 8 décembre 2005, le Conseil constitutionnel a indiqué que la surveillance judiciaire pouvait être rétroactive, c'est parce qu'elle est « limitée à la durée des réductions de peine dont bénéficie le condamné, qu'elle constitue ainsi une modalité d'exécution de la peine qui a été prononcée par la juridiction de jugement ». On sort pourtant ici de ce cadre, puisque la commission régionale pourra prolonger ce qui est donc une modalité d'exécution de cette peine, après le jugement.
La commission des lois propose donc de reconnaître la spécificité des décisions prises après la peine, en supprimant la notion de « prolongation » et en définissant le dispositif comme une « surveillance de sûreté ».
Ainsi, même dans le cas où la juridiction qui est à l'origine de la condamnation aura prévu, en fin de peine, la possibilité d'appliquer la mesure de sûreté envisagée, l'appréciation fondant la décision de la commission régionale ne se fera pas sur la base d'un fait commis au moment de cette décision. Retenir cette disposition reviendrait à accepter que la juridiction d'origine, en l'occurrence la cour d'assises, délègue une partie de son pouvoir à une commission, même si cette dernière est désormais dénommée « juridiction ».
J'ajoute qu'il est pour le moins bien difficile, pour une cour d'assises, d'apprécier au moment du jugement la dangerosité et la nécessité de soins au moins quinze années plus tard. Qu'est-ce qui prévaudra ? Le principe de précaution ou le risque d'erreur de l'estimation ?
En tout état de cause, la mission de la justice, et donc son intervention, s'arrête quand prend fin la peine, en ayant apporté une réponse à l'infraction commise. En l'occurrence, aucune infraction n'est exigée et la peine est achevée.
En conséquence, la juridiction régionale, même composée de trois magistrats de l'ordre judiciaire, ne saurait être considérée comme une juridiction à proprement parler : elle relève du domaine administratif. Or une instance administrative ne saurait remettre en cause une décision juridictionnelle.
Par ailleurs, les manquements à l'obligation de la surveillance judiciaire pourront être sanctionnés par la rétention de sûreté. Seront donc concernées les personnes actuellement détenues. Voilà une autre manière de faire revenir la rétroactivité de cette loi par la petite porte !
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, mes chers collègues, de supprimer le paragraphe III.

L'amendement n° 17, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 723-37 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
faisant l'objet de l'une des condamnations
par les mots :
condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions
La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement n° 18, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Après le mot :
décider
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 723-37 du code de procédure pénale :
de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la limite prévue à l'article 723-29, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée d'un an.
II. - Rédiger comme suit le début du troisième alinéa du même texte :
Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné, ...
III. - Dans le cinquième alinéa (2°) du même texte, remplacer le mot :
prolongation
par le mot :
mesure
IV. Rédiger comme suit le début du sixième alinéa du même texte :
La surveillance de sûreté peut être prolongée selon ...
V. Supprimer le septième alinéa du même texte.
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement est plus important.
Lorsqu'une personne entrant dans le champ d'application de la rétention de sûreté a été soumise à une surveillance judiciaire, le projet de loi autorise la commission régionale à prolonger les obligations de la surveillance judiciaire pour une durée d'un an renouvelable.
La prolongation des obligations de la surveillance judiciaire ne paraît pas conforme à la nature juridique de ce dispositif que le législateur avait en effet considéré en 2005 comme une modalité d'exécution de la peine, puisque sa durée est limitée à celle qui correspond aux réductions de peine obtenues.
Sans nier l'intérêt de garder une personne dangereuse sous certaines obligations au terme de la surveillance judiciaire, il est donc préférable que ce dispositif de contrôle présente un caractère spécifique qui ne se confond pas avec la surveillance judiciaire. Sans doute lui emprunte-t-il ses obligations, mais il relève d'un autre régime juridique au regard tant de l'autorité qui le décide, en l'occurrence la juridiction régionale et non le juge de l'application des peines, que de sa durée, renouvelable dès lors que les conditions prévues par l'article 723-37 sont réunies.
Ce dispositif relève en fait de la même catégorie que celui qui est susceptible de s'appliquer après la levée d'une rétention de sûreté. Il est donc logique de lui appliquer la même dénomination, « surveillance de sûreté ».

L'amendement n° 19, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du dernier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 723-37 du code de procédure pénale, supprimer les mots :
en cas de méconnaissance par la personne de ses obligations
La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement n° 20, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 723-38 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
faisant l'objet de l'une des condamnations
par les mots :
condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions
La parole est à M. le rapporteur.
Pour les raisons avancées par la commission, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 70, qui vise à supprimer la surveillance judiciaire prolongée, devenue surveillance de sûreté, laquelle va bien au-delà de la peine.
En revanche, le Gouvernement est favorable aux amendements n° 17, 18, 19 et 20.

Je suis d'accord, il vaut mieux appeler les choses par leur nom. La dénomination proposée par notre rapporteur est plus claire. Cela dit, une fois désignée par sa nouvelle appellation, cette mesure n'en est pas plus conforme à notre ordre juridique que par le passé !
En fait, de quoi s'agit-il ? Encore une fois, il s'agit non pas d'une peine, mais d'une mesure de police visant à priver de liberté quelqu'un qui n'est pas atteint de troubles mentaux, qui a toute sa responsabilité, et cela non pour ce qu'il a commis ou ce qu'il s'apprête à commettre, mais pour ce qu'il est !
Par conséquent, le problème de la rétention de sûreté reste entier et nous n'avons pas avancé d'un pas en changeant les étiquettes, même si la dernière est un peu plus précise.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 71, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le IV de cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Cet amendement étant dans le même ordre d'idées, il appellerait les mêmes observations et les mêmes critiques.
Cela étant dit, madame le garde des sceaux, j'aimerais connaître le nombre de médecins coordonnateurs. Ils sont très peu nombreux ; il est donc urgent d'en doubler, voire d'en tripler, le nombre.

L'amendement n° 21, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le mot :
décider
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 763-8 du code de procédure pénale :
de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l'article 131-36-1 du code pénal, en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée d'un an.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 71.

L'Assemblée nationale a introduit une disposition permettant, pour les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire pour une infraction entrant dans le champ d'application de la rétention de sûreté, de prolonger les effets de ce suivi socio-judiciaire pour un an renouvelable.
Ces dispositions soulèvent les mêmes difficultés que celles qui ont été relevées à propos de la prolongation de la surveillance judiciaire. En effet, le suivi socio-judiciaire est une peine complémentaire dont la durée est fixée par la juridiction de jugement.
S'il peut être souhaitable de maintenir les obligations au-delà de la durée du suivi socio-judiciaire, ce dispositif de contrôle relève non plus du suivi socio-judiciaire, mais du régime spécifique de « surveillance de sûreté » que proposent d'instaurer les amendements précédents.
J'en viens à l'amendement n° 71. Je remarque que l'argumentation développée dans son objet est un peu moins convaincante depuis hier, c'est-à-dire depuis que nous avons transformé la nature de la commission en juridiction. Désormais, c'est bien une juridiction qui va décider de prolonger la durée du suivi socio-judiciaire.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'exclame.

Permettez-moi de faire observer aussi que la surveillance de sûreté ou, si vous préférez, le suivi socio-judiciaire prolongé, ce qui est en fait la même chose, préserve la liberté de la personne et permet éventuellement d'éviter la rétention de sûreté. Cela peut donc être favorable à la personne et lui permettre, si elle respecte les obligations qui lui sont imposées, de ne pas retourner en détention.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 21 et, pour les raisons que vient d'indiquer M. le rapporteur, défavorable à l'amendement n° 71.
Madame Mathon-Poinat, pour répondre à votre question sur les médecins coordonnateurs, comme je l'avais dit dans mon discours liminaire, ils sont aujourd'hui 203, alors qu'ils étaient moins de 150 voilà quelques mois. L'objectif sur lequel nous nous sommes engagés est qu'ils soient 500 avant la fin de l'année.
Quant au montant de la vacation, il est passé, depuis l'arrêté signé le 24 janvier dernier, de 470 euros à 700 euros. L'été dernier, lors de l'examen du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, nous nous étions engagés à revaloriser cette indemnité.

En fait, je souhaite faire une remarque à M. le rapporteur.
Certes, il s'agit d'une juridiction, mais il n'empêche que les décisions qu'elle va prendre sont des mesures de police. Comme le dit le procureur général Jean-Olivier Viou, c'est la confusion des genres ! Par conséquent, nous ne sortons pas de la contradiction générale.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 1 er est adopté.

L'amendement n° 36, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 763-14 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° - La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et garantit le caractère pluridisciplinaire de cette commission » ;
2° - Après ladite phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il précise notamment les différentes professions susceptibles de figurer dans cette commission, ainsi que les modalités de nomination de ses membres. »
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Cet amendement concerne le caractère pluridisciplinaire de la commission.
Le nouvel article 706-53-14 prévoit que la situation des personnes qui peuvent, en application de l'article 706-53-13, faire l'objet d'un placement en rétention de sûreté doit être examinée au moins un an avant la date prévue pour leur libération afin d'évaluer leur dangerosité.
C'est la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, visée à l'article 763-10-1 du code de procédure pénale, qui est chargée de cette évaluation.
Eu égard au profil des personnes concernées, l'évaluation de la dangerosité criminologique du condamné nécessite un renforcement du caractère pluridisciplinaire de cette commission. C'est pourquoi il convient de modifier la composition de cette dernière, afin d'y intégrer des spécialistes de la criminologie.
Le décret en Conseil d'État qui en fixe les attributions doit donc assurer une pluridisciplinarité plus poussée, une expérience et une spécialisation plus importantes de ses membres que ce qui est actuellement prévu.
Afin de mieux appréhender toutes les difficultés d'évaluation de la dangerosité criminologique du condamné devraient figurer parmi les membres de la commission pluridisciplinaire un magistrat honoraire expérimenté dans le domaine du droit pénal et relevant d'une autre juridiction que celle qui est compétente pour statuer sur la mesure de rétention de sûreté, un expert psychologue ayant suivi une formation et titulaire d'un diplôme en criminologie ou en psycho-criminologie et des intervenants n'exerçant pas des fonctions expertales, par exemple des éducateurs ou des comportementalistes.
Par ailleurs, les membres de ces commissions devraient être nommés par décision conjointe du ministère de la justice et du ministère de la santé, après établissement d'une liste à l'échelon national des différentes catégories professionnelles représentées au sein des équipes.
Ce n'est qu'à ce prix que l'évaluation de la dangerosité sera objective et complète, évaluation qui va bien au-delà d'une double expertise psychiatrique.
Si le médecin psychiatre dispose d'une compétence et d'outils d'évaluation pour appréhender la dangerosité psychiatrique d'un détenu, il est moins sûr de la dangerosité criminologique ou sociale. De plus, confier cette mission au médecin psychiatre, comme le fait le projet de loi, procède d'une confusion dangereuse entre maladie mentale et délinquance. Or tous les fous ne sont pas criminels et tous les criminels ne présentent pas forcément des pathologies mentales !
Tous les pays étrangers ayant adopté un dispositif de défense sociale équivalent à la rétention de sûreté ont élaboré un système beaucoup plus soucieux d'une meilleure évaluation de la dangerosité sociale, mettant la pluridisciplinarité au centre de leur démarche.
Madame le garde des sceaux, puisque vous citez volontiers les systèmes étrangers, assurez à cette commission une pluridisciplinarité équivalente à celle du Pieter Baan Centrum aux Pays-Bas.

Je peine à suivre l'argumentation de Mme Alima Boumediene-Thiery, qui se préoccupe du caractère pluridisciplinaire de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Cela pourrait être une attention tout à fait intéressante.

Mais, très honnêtement, ce n'est qu'une commission administrative. Les membres qui la composent sont le préfet de région, le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, un expert psychiatre, un avocat, un représentant d'une association nationale d'aide aux victimes... De plus, son rôle est assez formel.
Ce n'est pas au sein de cette commission qu'il faut rechercher les spécialisations nécessaires, dont vous avez tout à fait raison de noter le caractère indispensable. Mais nous avons déjà réglé ce problème par le biais de l'évaluation de six semaines qui sera réalisée par des psychiatres, des médecins, des psychologues, des criminologues, des travailleurs sociaux. Toutes les disciplines seront représentées et donneront à cette évaluation sa véritable valeur.
Par conséquent, notre différend ne concerne pas le fond. Il s'agit seulement de savoir ce sur quoi doit porter le caractère pluridisciplinaire. Selon nous, il doit s'appliquer plus à l'évaluation elle-même qu'à la commission. Certes, mieux vaut que celle-ci soit la plus compétente possible, mais la décision de ses membres sera largement conditionnée par l'évaluation qui aura été faite. Ce ne sont pas eux qui rencontreront les détenus pendant six semaines !
Pour ces raisons, je souhaite le retrait de cet amendement n° 36 ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
Pour les raisons qui viennent d'être invoquées par M. le rapporteur, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Oui, monsieur le président, car cette commission est importante.
En effet, son travail va permettre de compléter l'évaluation qui sera faite. Si celle-ci nécessite une équipe pluridisciplinaire, la commission elle-même doit comporter en son sein toutes les compétences réunies.
L'amendement n'est pas adopté.
I. - Le I de l'article 1er est immédiatement applicable aux personnes faisant l'objet d'une condamnation prononcée après la publication de la présente loi, y compris pour des faits commis avant cette publication.
II. - Le même I est également immédiatement applicable aux personnes condamnées avant la publication de la présente loi et exécutant une peine privative de liberté à la date du 1er septembre 2008, lorsque ces personnes ont fait l'objet soit de plusieurs condamnations pour les crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, dont la dernière à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à quinze ans, soit d'une condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de ces crimes commis sur des victimes différentes.
III. - Le III de l'article 1er est applicable à compter du 1er septembre 2008 aux personnes faisant l'objet d'une mesure de surveillance judiciaire.
L'article 2 est applicable aux personnes exécutant une peine privative de liberté à la date de publication de la présente loi.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 77, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Ces derniers jours, l'article 12 du projet de loi a fait couler beaucoup d'encre, et peut-être cela va-t-il continuer !
Madame le garde des sceaux, le projet de loi initial ne prévoyait pas la rétroactivité s'agissant de la rétention de sûreté, et ce, je le suppose, pour des raisons juridiques.
La seule rétroactivité envisagée concernait la surveillance judiciaire et les mesures relatives aux réductions de peine.
Les députés, sur l'initiative de la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui avaient beaucoup réfléchi à la question - peut-être avez-vous participé à cette réflexion, mes chers collègues -, se sont empressés d'adopter un amendement rendant applicables les dispositions relatives à la rétention de sûreté aux condamnations qui seront prononcées après l'entrée en vigueur de la loi, même si les faits ont été commis antérieurement à sa promulgation.
Sur l'initiative du Gouvernement, les députés ont également adopté un amendement rendant d'application quasi immédiate les dispositions relatives à la rétention de sûreté pour les personnes qui ont fait l'objet de plusieurs condamnations pour des crimes mentionnés à l'article 1er. Cela montre bien que l'intention du Gouvernement était, dès le départ, de rendre la rétention de sûreté rétroactive. Mais peut-être ne savait-il pas comment s'y prendre...
Quels que soient les arguments utilisés - et vous les avez tous avancés -, cette rétention de sûreté n'est comparable ni à une mesure de sûreté ni à l'hospitalisation d'office.
M. le rapporteur de la commission des lois a bien essayé de gommer les contours anticonstitutionnels de l'article 12, convaincu, selon ses propres termes, de la « nécessité de respecter les principes fondamentaux de notre droit et, en particulier, la règle de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ». Il a donc déposé un amendement visant à subordonner la libération conditionnelle, pour les criminels condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, à un avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Par ailleurs, il propose que les personnes ayant fait l'objet de plusieurs condamnations pour les crimes mentionnés à l'article 1er puissent être soumises, à l'issue de l'exécution de leur peine d'emprisonnement, dans le cadre de la surveillance judiciaire, puis, le cas échéant, de la surveillance de sûreté, à deux obligations nouvelles et spécifiques : l'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique et l'obligation de déplacement surveillé sous le contrôle d'un agent de l'administration pénitentiaire. Ces deux mesures, il est vrai, sont d'application difficile ; néanmoins, elles respectent le droit.
Les deux amendements déposés par M. le rapporteur lui ont valu de passer pour le « sauveur » de la loi, du moins au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Même s'ils ne changent pas, à nos yeux, le fond du projet de loi, ils vous ont suffisamment hérissé, chers collègues de la majorité, pour que vous déposiez un sous-amendement, adopté de justesse hier matin en commission des lois, tendant à revenir à la rétroactivité totale de la loi.
Dans la foulée, madame le garde des sceaux, vous avez déposé un sous-amendement destiné à entériner définitivement cette rétroactivité.
Ainsi, vous passez outre le respect d'un droit aussi fondamental que celui de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère pour faire passer le message suivant à l'opinion : « Le Gouvernement a enfin fait adopter une loi permettant d'enfermer immédiatement et à vie les ? prédateurs sexuels ? - ce sont vos propres termes -, pour vous protéger contre toute récidive ! »
Franchement, je me demande, mes chers collègues, comment vous concevez votre devoir de législateur ! Vous vous contentez de répéter à l'envi que le principe de non-rétroactivité ne s'appliquerait pas en l'occurrence puisque la rétention de sûreté serait non pas une peine, mais une mesure de sûreté, ce qui ne suffit pas à lui en donner les caractéristiques !
On ne peut pas se résoudre au sacrifice des principes constitutionnellement garantis pour une loi certes d'affichage, mais lourde de conséquences, puisqu'elle ouvre la porte à d'autres violations des principes constitutionnels, alors que le problème posé est celui de l'efficacité des mesures que nous avons prises très récemment, et qui ne sont pas, pour la plupart, appliquées. En effet, soit elles sont trop récentes, soit, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, elles n'ont pas bénéficié des moyens nécessaires. Pour qu'elles soient réellement efficaces, il faudrait les améliorer, mais surtout prendre le problème à l'endroit, c'est-à-dire revoir notre curieuse conception de la détention, qui, finalement, constitue une exception négative au sein de l'Europe, dont nous aimons à vanter les mérites et l'unité de culture, voire de religion.
Nous aurions donc pu nous interroger longuement sur les raisons de l'incapacité de notre pays, comme d'autres, à trouver des moyens plus efficaces pour prendre en charge les détenus. Mais non, vous préférez violer un principe fondamental, celui de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. C'est tout à fait regrettable.

L'amendement n° 41, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Supprimer les I, II et le premier alinéa du III de cet article.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Cet amendement a pour objet la suppression d'une partie de l'article 12, qui est, selon moi, l'un des articles les plus importants et les plus dangereux de ce projet de loi.
Il vise en effet à inscrire le principe de la rétroactivité de la loi dans le temps, dans le mépris le plus total de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
La mesure concernée est non pas une mesure, mais une peine. Tant que le système que vous nous proposez, madame le garde des sceaux, ne remplira pas les conditions qui en feront une modalité d'exécution de la peine, la rétroactivité de la loi pénale sera anticonstitutionnelle.
Dans sa décision relative au placement sous surveillance électronique mobile, le Conseil constitutionnel avait considéré, je vous le rappelle, que cette mesure n'était pas contraire au principe de non-rétroactivité de la loi pénale garanti par l'article 8 de la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen, en se fondant sur trois critères.
Tout d'abord, le but de la mesure est de prévenir une récidive. Elle repose non pas sur la culpabilité du condamné, mais sur sa dangerosité.
Ensuite, la mesure est limitée à la durée des réductions de peine dont a bénéficié le condamné, ce qui en fait une modalité d'exécution de la peine initiale.
Enfin, la mesure est ordonnée par la juridiction de l'application des peines.
Ainsi, ces critères cumulatifs, si nous les appliquons à la mesure de rétention de sûreté que vous nous proposez, nous permettent de conclure que cette dernière est anticonstitutionnelle.
Elle s'ajoute en effet au quantum de la peine prononcée par la juridiction de jugement. Elle est donc non pas une modalité d'exécution de la peine, mais bien une peine supplémentaire.
Je citerai, pour conclure, le rapport intitulé « Réponses à la dangerosité » de M. Jean-Paul Garraud, député de l'UMP, à propos de la mise en place de centres fermés de protection sociale, soit l'équivalent des centres que vous souhaitez créer : « Le placement en centre fermé de protection sociale présente plusieurs caractéristiques qui sont de nature à le faire entrer dans la catégorie des ? sanctions ayant le caractère d'une punition ? au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ce qui aurait pour effet de soumettre la loi nouvelle à l'exigence de non-rétroactivité des peines et des sanctions résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. » Ce n'est pas moi, mais c'est un député de votre majorité qui le dit mot pour mot !
Or, dans le projet de loi, il s'agit bien d'une privation totale de liberté qui s'ajoute à la peine initiale. Cela signifie qu'une rétroactivité s'applique, ce qui est contraire à nos principes.

L'amendement n° 29, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le I et le II de cet article :
I. Le dernier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 706-53-14. »
II. Après l'article 723-30 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les personnes qui ont fait l'objet soit de plusieurs condamnations pour les crimes mentionnés à l'article 706-53-13, dont la dernière à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à 15 ans, soit d'une condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de ces crimes commis sur des victimes différentes, peuvent être soumises à l'obligation d'assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique prévu par l'article 132-26-2 du code pénal et à l'obligation de déplacement surveillé sous le contrôle d'un agent de l'administration pénitentiaire.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement représente une tentative de conciliation entre deux impératifs qui pouvaient sembler opposés : d'une part, faire en sorte que la rétention de sûreté puisse s'appliquer le plus rapidement possible et, d'autre part, éviter tout risque au regard du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.
D'ores et déjà, le projet de loi prévoit des modalités de nature à permettre une application immédiate de la rétention de sûreté, et non à une échéance de quinze ans ou de douze ans si on prend en compte les réductions de peine. Ces modalités ne me semblent pas discutables constitutionnellement.
Cela passe par le biais de la surveillance judiciaire. Il est prévu qu'un manquement aux obligations de la surveillance judiciaire permettrait, si ce manquement révèle une dangerosité particulière, de faire « basculer » la personne de la surveillance judiciaire à la rétention de sûreté.
Par cet amendement, la commission des lois souhaite ajouter deux autres cas qui entraîneraient l'application aussi immédiate que possible de la rétention de sûreté.
Il s'agit tout d'abord du problème des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité. Celles-ci ne représentent pas simplement quelques individus dans les prisons de la République, puisqu'on compte aujourd'hui entre 500 et 600 personnes dans ce cas. Elles sont censées être les plus dangereuses.
La commission vous propose donc, mes chers collègues, de prévoir qu'avant toute libération conditionnelle, une fois leur période de sûreté accomplie, il leur faudra obtenir l'avis conforme de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Autrement dit, il s'agit de placer la personne dans la case « rétention de sûreté », ce qui n'entraîne pas de difficultés particulières.
L'application immédiate du dispositif posait problème pour les personnes condamnées de quinze ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité. Cet amendement vise donc à « muscler » la surveillance judiciaire, que nous avons rebaptisée « surveillance de sûreté », en prévoyant qu'elle pourrait inclure l'assignation à résidence et la sortie sous surveillance pénitentiaire. Ces mesures sont similaires à celles qui sont prévues pour les personnes qui seront placées dans les centres socio-médico-judiciaires.
Ainsi, il nous semblait avoir à peu près répondu aux deux impératifs que j'ai évoqués tout à l'heure : protéger la société et éviter le risque d'inconstitutionnalité pour rétroactivité.

Le sous-amendement n° 78 rectifié ter, présenté par MM. Portelli, Gélard, Garrec, Courtois, Saugey, Béteille, J. Gautier et Buffet, Mme Troendle et M. Othily, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de l'amendement n° 29 :
II. Les personnes exécutant, à la date du 1er septembre 2008, une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans à la suite, soit de plusieurs condamnations, dont la dernière à une telle peine, pour les crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, soit d'une condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de ces crimes commis sur des victimes différentes, peuvent être soumises à une assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile, selon la procédure prévue par l'article 723-37 de ce code.
À titre exceptionnel, si le placement sous surveillance électronique apparaît insuffisant pour prévenir la récidive, ils peuvent être soumis à un placement en rétention de sûreté.
La mise en oeuvre de cette procédure doit être précédée d'une décision de la chambre de l'instruction avertissant la personne condamnée qu'elle pourra faire l'objet d'un réexamen de sa situation dans les conditions ci-après indiquées.
Le procureur général saisit, après avis du juge de l'application des peines du lieu de détention de la personne condamnée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la cour d'assises ayant prononcé la condamnation.
La chambre de l'instruction statue en chambre du conseil après avoir fait comparaître la personne condamnée assistée par un avocat choisi ou commis d'office.
Si elle constate qu'il résulte de la ou des condamnations prononcées une particulière dangerosité de l'intéressé en raison d'un trouble grave de sa personnalité susceptible de justifier à l'issue de sa peine un placement en rétention de sûreté, elle avertit la personne condamnée qu'elle pourra faire l'objet d'un examen de dangerosité pouvant entraîner son placement en rétention de sûreté.
La rétention de sûreté est ensuite décidée suivant la procédure indiquée aux articles 706-53-14 et 706-53-15 du même code nonobstant, le cas échéant, les délais prévus par ces dispositions.
La parole est à M. Hugues Portelli.

Pour comprendre ce sous-amendement, il est nécessaire de rappeler la façon dont le débat s'est déroulé au sein de la commission des lois et de notre propre groupe parlementaire.
Nous voilà face à un texte adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement, et sur la constitutionnalité duquel nous avons quelques doutes.
Tout d'abord, c'est clair et net, nous sommes d'accord avec la finalité de cette disposition. Toutefois, nous ne voulons pas courir le risque d'inconstitutionnalité, non pas parce que nous avons une dévotion particulière pour le Conseil constitutionnel, mais parce que nous sommes respectueux de la Constitution.

Même à l'époque où le Conseil constitutionnel ne s'était pas arrogé les pouvoirs dont il dispose depuis 1971, nous étions respectueux de la Constitution.

Je rappelle que, de tous les principes constitutionnels qui nous régissent, le plus important est le devoir qu'a l'État de protéger ses ressortissants, notamment les plus faibles.

Dans cet État de droit, les citoyens ont des droits qui sont, notamment, la liberté, la sûreté - vous connaissez aussi bien que moi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Nous avons accepté l'amendement n° 29 proposé par le rapporteur afin de disposer d'un peu de temps pour réfléchir aux améliorations à apporter au texte issu de l'Assemblée nationale.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s'esclaffe.

À nos yeux, l'amendement du rapporteur s'apparente au suivi socio-judiciaire, mais ne correspond pas véritablement à la mesure de sûreté que nous appelons de nos voeux s'agissant de ces criminels particulièrement dangereux.
Même s'ils représentent un nombre extrêmement restreint, l'État de droit, je le répète, a le devoir de protéger l'ensemble de la société contre ces individus et ne doit pas s'abstraire de tous les moyens dont il dispose.
Lors des débats qui ont précédé la présente discussion, nous avons défini clairement la mesure de rétention comme étant une mesure de sûreté.
Mme Nicole Borvo s'exclame.

Pour nous, c'est clair et, de notre point de vue et de celui de la majorité de cette assemblée, toutes les dispositions qui ont été votées par le Sénat à l'article 1er vont dans ce sens.
Dès lors que la notion est bien clarifiée et qu'elle se situe dans le champ de la mesure de sûreté, la question de la rétroactivité éventuelle de cette mesure peut être posée constitutionnellement.
Tel est l'objet de ce sous-amendement, qui prévoit une série de dispositions visant à aménager la mise en oeuvre de cette mesure de sûreté dès septembre 2008, donc y compris pour ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation.
Elles précisent que c'est une juridiction et non une commission qui prend la décision, qu'elle s'appuie sur l'évaluation d'une commission d'experts, qu'elle respecte toutes les règles de la défense du condamné, donc de sa représentation, notamment la règle du débat contradictoire, et qu'elle avertit la personne condamnée que celle-ci pourra faire l'objet d'un réexamen de sa situation.
Pourquoi inscrire cet avertissement dans la loi ? Pour une raison très simple : au moment où la procédure est lancée, celui qui est encore détenu a le temps d'accepter les mesures qu'il a refusées jusqu'alors. S'il les accepte, c'est-à-dire s'il consent à faire l'objet d'un suivi médical, psychiatrique, mais aussi éducatif, selon l'ajout voté hier, on entrerait dans le cadre de ce que l'on souhaite et la question de lui appliquer la mesure de sûreté ne se pose plus.
Si, au contraire, malgré cet avertissement, la personne en question refuse le traitement qui lui est proposé, elle donne une preuve supplémentaire de sa dangerosité, et la mesure de sûreté doit alors s'appliquer de plein droit.

M. Hugues Portelli. Tel est le sens de notre sous-amendement, et j'espère que nous serons nombreux à le soutenir !
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Le sous-amendement n° 92, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 29 par deux alinéas ainsi rédigés :
... - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. Le I et le I bis de l'article 1er sont applicables aux personnes faisant l'objet d'une condamnation prononcée après la publication de la présente loi pour des faits commis avant cette publication.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Par souci de cohérence, il est nécessaire de maintenir l'application des dispositions nouvelles pour les condamnations qui seront prononcées après la promulgation de la loi.
L'amendement n° 29 de la commission « écrase », si je puis dire, le I de l'article 12.
Or la disposition est indispensable, puisqu'elle permet l'application de la loi nouvelle aux condamnations futures, même si les faits sanctionnés sont antérieurs à la loi.
Je le répète, il s'agit là non pas de rétroactivité, mais d'une entrée en vigueur immédiate du dispositif de sûreté.
Il faudra impérativement que les personnes qui seront condamnées sous l'empire de la loi nouvelle soient averties du fait que, à la fin de leur peine, leur dangerosité pourra être évaluée, si leur personnalité le justifie. À défaut, ni le dispositif transitoire ni le dispositif définitif ne s'appliqueraient à ceux qui n'auraient pas été avertis au moment de la condamnation en cour d'assises. Malgré leur particulière dangerosité, ces condamnés pourraient ainsi échapper à la rétention de sûreté, alors même que leur dangerosité serait encore avérée lors de la fin de leur peine.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

L'amendement n° 89, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le premier alinéa du III de cet article :
La surveillance de sûreté instaurée par le III de l'article 1er est immédiatement applicable après la publication de la présente loi. Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par le risque particulièrement élevé de commission des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, la personne peut être placée jusqu'au 1er septembre 2008, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 706-53-20, dans un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.
II. - Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :
IV. - L'évaluation prévue par le I ter de l'article 1er est également applicable aux personnes condamnées avant la publication de la présente loi à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n° 77 et 41 ainsi que sur les sous-amendements n° 78 rectifié et 92.

Cet amendement comporte deux dispositions à caractère transitoire, dont la seconde est d'ailleurs plus importante que la première.
En premier lieu, cet amendement adapte la mesure qui prévoit que les dispositions relatives à la prolongation des obligations de la surveillance judiciaire sont applicables à compter du 1er septembre 2008.
Le choix de cette date est lié au délai de mise en place du centre socio-médico-judiciaire de sûreté, structure dont l'ouverture est prévue le 1er septembre 2008 au sein de l'Établissement public de santé national de Fresnes.
Cependant, on ne peut exclure que, dans l'intervalle qui sépare l'entrée en vigueur de la loi et le 1er septembre 2008, la surveillance judiciaire imposée à certaines personnes entrant dans le champ d'application du texte arrive à son terme, la durée correspondant aux réductions de peine étant écoulée.
Il ne serait plus possible alors de placer ces personnes sous surveillance de sûreté, puisque cette procédure constitue une prolongation des obligations de la surveillance judiciaire, mais ne saurait en revanche être imposée à une personne qui ne serait plus sous ce dispositif de contrôle.
Afin d'éviter que des personnes, pourtant très dangereuses, puissent échapper à tout dispositif de contrôle dans les mois à venir, il nous semble souhaitable de permettre l'application immédiate de la surveillance de sûreté.
En cas de manquement grave à ces obligations, la personne pourrait être placée jusqu'au 1er septembre 2008 dans un établissement visé par l'article L. 6141-5 du code de la santé publique, c'est-à-dire un établissement public de santé spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées. Il pourrait s'agir de l'établissement public de Fresnes ou d'une unité d'hospitalisation sécurisée interrégionale, UHSI.
En second lieu, point sur lequel la commission est plus vigilante car il lui paraît plus important, cet amendement permet, à titre transitoire, d'imposer une observation, dans un centre chargé de l'observation des détenus, aux personnes qui sont condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées par l'article 706-53-13 du code de procédure pénale.
Autrement dit, nous avons voté hier une disposition prévoyant la nécessité de procéder à une évaluation dans l'année qui suit l'incarcération, disposition judicieuse pour ceux qui seront incarcérés demain. Mais il serait dommage que les personnes déjà incarcérées, qui ont été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes visés par le présent projet de loi, échappent à cette évaluation, à laquelle, je le rappelle, chacun a intérêt, la société tout autant que le condamné.
C'est la raison pour laquelle la commission propose d'adapter cette obligation d'évaluation pour les personnes déjà condamnées.
J'en viens à l'avis de la commission sur les différents amendements et sous-amendements.
En ce qui concerne l'amendement n° 77, qui tend à la suppression totale de l'article 12, la commission émet un avis défavorable. Même ceux qui n'adhèrent pas à l'ensemble de cet article estiment cependant que certaines de ses dispositions méritent d'être retenues.
L'amendement n° 41 est contraire à la position de la commission car il vise à supprimer des paragraphes pour lesquels elle propose une nouvelle rédaction. Aussi, la commission émet un avis défavorable.
Le sous-amendement n° 78 rectifié ter, qui propose une nouvelle rédaction du II de l'amendement n° 29, présente deux mérites incontestables.
En premier lieu, il tient partiellement compte de l'amendement de la commission, puisqu'il prévoit que la personne peut être soumise à une assignation à domicile. En outre, s'il ne retient pas le principe de la mesure de déplacement surveillé figurant dans l'amendement de la commission, il lui substitue le régime du placement sous surveillance électronique mobile, ce qui peut parfaitement se concevoir. Il maintient néanmoins la faculté d'appliquer la rétention de sûreté immédiatement après la peine de réclusion pour les personnes actuellement détenues pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi.
En second lieu, ce sous-amendement s'efforce de maintenir un lien de causalité entre la décision de condamnation et la rétention de sûreté afin de respecter, notamment, les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, la rétention de sûreté ne serait applicable que si la chambre de l'instruction avertit la personne condamnée que sa situation pourra faire l'objet d'un réexamen en vue d'une telle rétention.
Le sous-amendement ne règle pas le problème de la rétroactivité, si ce n'est en considérant que, s'agissant d'une mesure de sûreté, cette question ne se pose pas.
Les auteurs du sous-amendement ayant fait valoir l'impérieuse nécessité de protéger les victimes potentielles des criminels les plus dangereux, une majorité des membres de la commission se sont ralliés à ce point de vue.
En conséquence, la commission émet un avis favorable.
Le sous-amendement n° 92 n'ayant pas été examiné par la commission, je me permettrai de donner mon point de vue personnel.
À la différence du sous-amendement n 78 rectifié qui concerne les personnes condamnées à la date d'entrée en vigueur de la loi, le sous-amendement n° 92 s'applique aux personnes qui ont commis les faits avant l'entrée en vigueur de la loi, mais n'ont pas encore été condamnées.
Si l'hypothèse visée par ces deux sous-amendements est différente, il s'agit bien, dans les deux cas, d'une dérogation à l'application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, puisque ce principe interdit l'application d'une disposition plus sévère aux personnes condamnées pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de cette loi.
Cependant, le sous-amendement n° 92 ne prévoit pas d'appliquer aux personnes ayant commis des faits avant l'entrée en vigueur de la loi le dispositif qui est retenu par le sous-amendement n° 78 rectifié . En effet, pour cette catégorie de personnes, contrairement à celles qui ont déjà été condamnées, la juridiction de jugement pourra prévoir le réexamen de leur situation en vue d'une rétention de sûreté.
Le sous-amendement n° 92 n'envisage pas davantage, et c'est peut-être la petite critique que je me permettrai de lui faire, de limiter l'application immédiate de la rétroactivité aux criminels récidivistes les plus dangereux, à la différence du sous-amendement n° 78 rectifié . La restriction du champ d'application de la rétention de sûreté prévue par ce dernier contrebalance, d'une certaine manière, le caractère immédiat de l'application de la rétention de sûreté. Cette restriction n'est pas retenue par le sous-amendement n° 92. Dès lors qu'ils répondront aux critères de droit commun - les critères prévus par l'article 706-53-13 du code de procédure pénale -, les criminels concernés pourront se voir appliquer la rétention de sûreté, même si les faits ont été commis avant l'entrée en vigueur de la loi. Il y a là, de mon humble point de vue, un risque accru d'inconstitutionnalité.
S'agissant de l'amendement n° 77, j'ai eu l'occasion de m'expliquer longuement sur ce qui justifie l'application immédiate de la rétention de sûreté aux personnes qui seront incarcérées dès l'entrée en vigueur du présent texte.
En opportunité, à dangerosité égale, il est impératif que les détenus soient traités de la même façon. Constitutionnellement, s'agissant d'une mesure de sûreté, la question de la rétroactivité ne se pose pas puisqu'il ne s'agit pas d'une peine.
Au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'assises n'a évidemment pas pu se prononcer sur l'éventualité d'une rétention de sûreté en fin de peine avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Il est donc important de prévoir cette disposition.
Le sous-amendement n° 78 rectifié permettra, s'il est adopté, d'avertir explicitement le condamné avant la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation de la dangerosité. Le Gouvernement est favorable à cette amélioration du dispositif transitoire, adopté par l'Assemblée nationale, qui paraît plus conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 77, ainsi que sur l'amendement n° 41.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 29, sous réserve de l'adoption des sous-amendements n° 78 rectifié ter et 92.
Le Gouvernement est tout à fait favorable au premier volet de cet amendement, qui vise à subordonner le bénéfice d'une libération conditionnelle pour les condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité à l'avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, au terme d'un examen approfondi et aussi complet que possible. L'utilité de cette mesure de précaution est incontestable.
En revanche, le Gouvernement ne peut qu'être défavorable au second volet de cet amendement. Pour les raisons que je viens de rappeler, il souhaite en effet que la rétention de sûreté puisse s'appliquer dès son entrée en vigueur aux criminels les plus dangereux, ceux qui auront été lourdement condamnés pour plusieurs crimes graves.
Toutefois, le sous-amendement n° 78 rectifié ter de MM. Portelli et Gélard reprend l'idée d'une assignation à résidence et d'une surveillance électronique à distance du respect de l'obligation prévue à l'amendement n° 29, tout en permettant, lorsque cette surveillance est insuffisante, une possibilité de rétention de sûreté.
Enfin, concernant l'amendement n° 89, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, tout en demandant une rectification formelle consistant à remplacer le « IV » par un « V ».

On peut parfaitement considérer que la rétention de sûreté est une nécessité pour un certain nombre de criminels particulièrement dangereux. Pour l'avenir, il n'y a pas de problème : la rétention, qu'on en approuve ou pas le principe, qu'on la considère comme une peine ou comme une mesure de sûreté, aura en effet été fixée préalablement. La question, en revanche, se pose pour ceux qui sont aujourd'hui en détention et qui vont sortir.
Pour ma part, je pencherais plutôt en faveur de la théorie de mon ami Pierre Fauchon qui considère que la rétention de sûreté est une mesure de sûreté.

Monsieur Collombat, cessez donc vos interruptions permanentes et insupportables ! Respectez un peu les autres ! Quand vous parlez, nous vous écoutons !

M. Pierre-Yves Collombat. Nous en reparlerons quand vous nous respecterez autant que nous vous respectons ! Voyez ce qu'il s'est passé hier en commission !
Exclamations sur les travées de l'UMP.

Il ne s'agit pas d'une leçon de morale, monsieur Collombat !
D'ailleurs, je ne regarde plus M. Collombat, car il n'est pas intéressant. Il interrompt les orateurs plus qu'il ne les écoute. Je préfère regarder Jean-Pierre Raffarin, qui me paraît être un auditeur bien plus attentif.
Sourires.
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Et le Gouvernement !
Nouveaux sourires.

Nous devons bien mesurer la portée des premier et deuxième alinéas de l'article 12, qui ne figuraient pas dans le projet de loi initial. Autrement dit, nous devons réfléchir à la nature de la mesure qui serait applicable aux personnes déjà condamnées ou, madame le garde des sceaux, à celles qui seraient auteurs de faits commis avant la publication de la loi.
La rétroactivité s'applique non pas à la condamnation, mais aux faits incriminés. Dans un premier temps, la commission des lois a considéré qu'il planait un doute sur la nature de la mesure qui pouvait être applicable aux faits commis avant la publication de la loi. Partant, elle s'est efforcée, pour éviter tout risque d'inconstitutionnalité, de définir des mesures de sûreté, telle l'assignation à domicile ou l'obligation de déplacement surveillé sous le contrôle d'un agent de l'administration pénitentiaire.
Un débat digne et approfondi s'est ensuivi. Certains ont estimé que la rétention de sûreté était une peine, à laquelle devait s'appliquer le principe de non-rétroactivité. D'autres, au contraire, ont considéré qu'il s'agissait là d'une mesure de sûreté, par conséquent applicable non seulement pour l'avenir, mais encore aux personnes déjà condamnées ou qui seraient auteurs de faits commis antérieurement à la publication de la loi.
Dans tous les cas, il est bien entendu que, afin de respecter la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute mesure privative de liberté doit procéder d'une décision judiciaire.
Je reconnais qu'il n'est pas aisé de prévoir, lors du prononcé de la peine initiale, si, dans quinze, vingt, trente ou quarante ans, le condamné demeurera dangereux ou non.
M. Robert Badinter lève les bras au ciel.

Je suis frappé que personne, sauf vous, sans doute, madame le garde des sceaux, n'ait jamais clairement souligné que les établissements pour soins n'étaient pas des prisons. Je vous rappelle que dans leur rapport d'information consacré aux délinquants dangereux atteints de troubles psychiatriques, nos collègues Philippe Goujon et Charles Gautier concluaient à la nécessité absolue des établissements spécialisés pour ces personnes, non seulement à leur sortie de prison, mais encore dès lors que l'évaluation de leur dangerosité faisait apparaître que seuls ces établissements permettaient à ces personnes de recevoir des soins, d'évoluer favorablement et de prendre conscience de leurs actes ou de bénéficier d'autres dispositifs qui, bien que en vigueur dans d'autres pays, demeurent inutilisés chez nous.
Il ne faut pas attendre le dernier jour de leur détention pour soigner ces personnes ; elles doivent l'être dès le départ !
J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'établissements socio-médico-judiciaires. Ce sont des établissements judiciaires parce les personnes qui y séjournent sont, bien légitimement, soumises à une surveillance.
Compte tenu du risque calculé de rétroactivité, nous prenons l'extrême précaution de réserver l'application immédiate de la mesure de rétention de sûreté aux cas les plus graves.
M. Pierre Fauchon opine.

Madame Borvo Cohen-Seat, nous ne visons dans le cas présent que les cas les plus graves parmi les cas graves, c'est-à-dire les cas extrêmes.
Je suis attaché au principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Pour autant, dès lors qu'on estime, après une évaluation rigoureuse et en s'entourant de multiples précautions, qu'une personne, compte tenu de son passé, des motifs de sa condamnation, de son comportement et de son état psychologique et psychiatrique, risque de récidiver, il convient d'adopter toute mesure utile pour y obvier, comme on le ferait pour un malade mental, qu'on peut hospitaliser d'office à sa sortie de prison.
Cela étant posé, on peut parfaitement estimer qu'il s'agit d'une mesure de sûreté qui peut être appliquée immédiatement.
Après avoir longuement réfléchi à la question, en tenant compte des travaux réalisés sur cette question et de ce qui se pratique dans d'autres pays, je suis parvenu à la conclusion que la rétention de sûreté ne violait probablement aucun principe constitutionnel. Malgré tout, si tel ne devait pas être le cas, il resterait toujours la solution de l'assignation à domicile. Il est important de le souligner.
Néanmoins, madame le garde des sceaux, j'aurais souhaité que le sous-amendement du Gouvernement prévoie les mêmes garde-fous que ceux qui sont contenus dans le sous-amendement présenté par M. Portelli. Pourquoi ? Parce que s'il subsiste un doute quant à la rétroactivité, seuls les faits sont concernés, et non les condamnations.
Je comprends que vous vouliez appliquer le dispositif général aux personnes qui ont commis les faits avant l'entrée en vigueur de la loi mais n'ont pas encore fait l'objet d'une condamnation. Toutefois, ce faisant, vous affaiblissez quelque peu la portée du dispositif que nous avons voulu mettre en place, en donnant un avis favorable au sous-amendement de M. Portelli.
C'est la seule petite réserve que j'exprimerai, même si, je le répète, votre position, à laquelle je me range, est cohérente. Pourquoi ce qui vaudrait pour les personnes déjà condamnées ne vaudrait pas pour celles qui, bien qu'elles aient commis des actes illégaux, n'ont pas encore fait l'objet d'une condamnation ?
Dans votre logique, votre sous-amendement est cohérent avec le sous-amendement présenté par M. Portelli. Mais j'aurais préféré qu'il eût le même champ d'application.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote sur l'amendement n° 77.

Toutes vos contorsions pour nous convaincre que cette mesure n'est pas rétroactive nous confortent dans l'idée que la voie que vous nous proposez de suivre n'est pas la bonne.
Sans doute êtes-vous lassés, mes chers collègues de la majorité, de nous entendre défendre nos idées sur la question de la détention.
Exclamations sur les travées de l'UMP.

Votre lassitude transparaît !
Par conséquent, considérons que ce problème a déjà été évoqué. Cela étant, rien ne vous empêche d'y réfléchir plus avant et de vous demander pourquoi la détention ne permet pas de soigner les détenus malades et pourquoi cette question ne fait pas l'objet d'un traitement prioritaire.
Considérons une personne qui a purgé une peine de quinze à vingt ans de prison pour un crime très grave. Au terme de sa détention, il apparaît que cette personne, en dépit de sa prise en charge thérapeutique, n'est absolument pas guérie et qu'elle ne maîtrise pas ses pulsions, sexuelles ou autres. De surcroît, elle ne veut ni aide, ni soins, ni traitement et refuse de se soumettre à un suivi socio-judiciaire. Bien qu'un tel refus l'expose à passer sa vie en rétention, cette personne s'en « moque ». Bien entendu, elle a fait l'objet d'une évaluation psychiatrique censée mesurer sa dangerosité et ses risques de récidive, puisque c'est ce que prévoit votre projet de loi.
Excusez-moi - que les psychiatres m'excusent aussi, car leur tâche n'est pas facile -, mais si cette personne n'est pas victime d'une altération mentale grave, je ne sais pas qui en souffre !
Cette dissociation entre troubles mentaux et troubles de la personnalité, alors que les uns sont des schizophrènes et les autres des psychotiques, est due au fait que la psychiatrie n'est pas capable - on peut le comprendre - de prendre en charge un certain nombre de troubles mentaux que l'on pourrait qualifier de troubles de la personnalité, parce qu'ils s'ajoutent aux troubles du comportement. Je considère pour ma part que, quoi qu'il en soit, cet individu présente certainement une altération grave de son cerveau.
Il existe l'hospitalisation d'office, car la société veut se prémunir, se protéger. Il faut avoir le courage de prendre ses responsabilités et ne pas demander à un détenu qui termine une peine de prison d'en refaire une autre !
Vous dites, en outre, que ces individus seront placés dans un hôpital, qui ne sera pas tout à fait une prison. Or l'hospitalisation d'office est soumise à des règles spécifiques et à des garanties, et est sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Ayez donc le courage de prévoir, par une mesure administrative, l'hospitalisation dans un hôpital psychiatrique comprenant éventuellement, si vous le souhaitez, une unité spéciale. Mais il est inadmissible que l'on ne se serve pas de ce qui existe - pour des raisons profondes assez complexes que j'aimerais connaître et que je crois pouvoir deviner - et que l'on viole le principe de non-rétroactivité de la loi pénale en maintenant en détention une personne qui a déjà purgée sa peine de vingt ans de prison !

M. Pierre-Yves Collombat. Je vais essayer de ne pas énerver M. le président de la commission des lois...
Sourires

Vous ne m'énervez jamais quand vous parlez ; je suis juste un peu agacé lorsque vous m'interrompez !

Pardonnez-moi !
Mes chers collègues, deux cas de figure se présentent à nous.
Lorsqu'une condamnation à perpétuité a été prononcée, les mesures prises, quelles qu'elles soient, peuvent parfaitement s'appliquer. La rétention de sûreté est une modalité d'application de la peine.
Tout se complique à partir du moment où nous parlons de peine à durée déterminée, à la différence des Anglo-Saxons, qui prononcent des peines à durée indéterminée, et des Néerlandais, qui, eux, ne font pas la différence entre les malades mentaux et les personnes atteintes de troubles de la personnalité, qui ne les jugent pas mais qui les soignent.
Depuis hier soir, on essaie de nous faire croire que la privation de liberté ad vitam aeternam, quand la personne ne relève pas de l'hospitalisation d'office, non pas pour ce qu'elle a fait mais pour ce qu'elle risque de faire, est compatible avec notre ordre républicain. Et pour envelopper le tout, on maquille juridiquement l'affaire en créant des juridictions qui peuvent rendre des mesures de police, de sûreté.
Jusque là, c'est déjà un peu fort ! Mais on va encore plus loin en nous faisant discuter en urgence de décisions qui ne seront applicables que dans quinze ou seize ans ! C'est tout de même un peu curieux ; cela ressemble à de la gesticulation !
Il fallait évidemment penser à pouvoir appliquer directement la mesure, d'où les mécanismes qui ont été inventés. Ils sont plus ou moins compliqués ; sur le plan pratique, ils sont plus ou moins privatifs de liberté. Mais le problème théorique reste le même, sauf que, en plus, on nous propose une application des dispositions à titre rétroactif.
Donc, quelles que soient les modifications qui nous sont soumises, elles tombent sous le coup de la même critique. C'est pourquoi la seule chose à faire, c'est de supprimer cet article 12.
Cela dit, si nous n'avons le choix qu'entre le pire et le moins pire, je préfère l'amendement de M. le rapporteur, Jean-René Lecerf, qui au moins ne va pas jusqu'à prévoir une privation totale de liberté.
Quant à l'invention d'un délit annexe pour justifier l'utilisation de la rétention de sûreté alors que les peines sont accomplies, franchement, je sais que nous avons affaire à d'excellents juristes, mais ce sont vraiment de grands acrobates !

M. Pierre Fauchon. S'il est permis à un « acrobate » d'intervenir dans ce débat en toute modestie
Sourires

Le problème qui se pose est celui de la rétroactivité. On n'est pas sûr de s'en tirer, monsieur le président de la commission, en affirmant, comme je le crois absolument, qu'il s'agit d'une mesure de sûreté et pas du tout d'une peine, parce que la gravité de l'atteinte à la liberté est la racine de l'exigence de non-rétroactivité, même si la mesure prise n'est pas une sanction pénale. Donc attention, la situation est dangereuse !
Pour moi, en réalité, ce problème n'en est pas vraiment un, puisque nous sommes en présence d'un concept nouveau, la rétention, et que, à chaque fois que l'on découvre un concept autonome fondé sur la dangerosité, on a tendance non pas à imaginer et à créer les données relatives à cette notion nouvelle, mais à se rattacher à des concepts antérieurs déjà connus et à transposer nos acquis dans ce nouveau domaine. C'est la raison pour laquelle on se réfère obstinément au concept de peine pour aborder la rétention.
J'en suis convaincu, l'essentiel de ce texte - c'est ce qui le justifie et c'est pourquoi j'en suis peut-être, au fond, son meilleur supporter -, consiste à dire que la notion de rétention est une notion autonome, qui s'apparente d'une certaine façon à la détention provisoire - je l'ai déjà évoqué et Mme le garde des sceaux a d'ailleurs repris les mêmes termes -, dont l'une des causes est d'éviter la répétition des faits, je le rappelle au passage, mais qui s'apparente surtout à une hospitalisation d'office.
Quand on voit les choses sous cet angle - et c'est tout simple, semble-t-il -, on se dit que la rétroactivité doit s'apprécier à partir du fait qui cause et qui justifie la rétention, c'est-à-dire non pas la condamnation intervenue quinze ans auparavant, qui est une condition, mais le diagnostic des experts qui se réunissent au sein d'une commission pluridisciplinaire, postérieurement au vote de la loi bien entendu.
Les membres de la commission compétente tiennent compte de tous les éléments dont ils disposent pour donner un avis sur un individu qui répond naturellement à la condition originelle d'avoir déjà été condamné, sinon il faudrait examiner tout le monde. S'ils considèrent, hic et nunc, que la personne concernée présente un risque de dangerosité, ils rendent une décision en conséquence, laquelle ne pose pas de problème du point de vue de l'exigence de non-rétroactivité, puisque sa cause est bien postérieure à la loi.
Voilà le fond de ma pensée. Je trouve aussi que l'on se complique exagérément la vie, avouons-le, en ayant cru obligatoire, à mon avis à tort, d'introduire dans l'article 1er l'exigence de la prévision initiale selon laquelle les personnes condamnées à des peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure à quinze ans devaient être réexaminées à l'issue de leur détention.
En conséquence, on a ajouté ce malheureux alinéa 2, qui prévoit que la rétention de sûreté ne peut être prononcée que si la cour d'assises, statuant quinze ans auparavant, a expressément prévu que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation et de son éventuelle dangerosité.
Entre nous soit dit, vous voyez le côté farfelu de la prévision qui se situe quinze ans avant l'échéance et qui n'est assortie d'aucune sanction ! J'ai déjà eu l'occasion de dire que ce dispositif était très mal bâti. Mais il paraît qu'on y trouve, à la demande du Conseil d'État, une sécurité juridique par rapport à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...
J'ai déjà expliqué hier que je croyais que ce n'était pas exact, et je me suis penché sur le texte de la Convention. Là encore, on en fait, me semble-t-il, une lecture tout simplement insuffisante.
Que dit la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? Vous voudrez bien m'excuser d'être un peu long, mais cette question délicate autorise quand même une explication un peu plus précise. Elle dispose : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent... ».
C'est à cause de cette exigence de la Convention européenne que l'on va nous obliger à avoir quinze ans auparavant non pas une condamnation, mais une prévision ! C'est en tout cas ce que dit en toutes lettres l'avis du Conseil d'État. À mon avis, celui-ci n'a pas lu complètement les différentes hypothèses prévues.
La deuxième éventualité est celle où l'individu « a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières... ».
La troisième hypothèse est la détention provisoire, sur laquelle on aurait peut-être pu s'arrêter dans la mesure où l'une de ses raisons d'être est d'éviter la répétition des faits. Cette disposition suffisait, et l'on n'avait pas besoin de condamnation antérieure.
L'éducation surveillée, ensuite, ne nous concerne pas.
Le paragraphe suivant est beaucoup plus large, et c'est dans cette largeur que se situe notre hypothèse de rétention. Est visée « la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, ...
Sourires

Je disais donc qu'il s'agit « de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ».
Concernant les aliénés, notre langage et nos concepts doivent évoluer en tenant compte des avancées de la science. Nous nous trouvons dans l'hypothèse d'une personne qui est aliénée au sens profond du terme, puisqu'elle ne se domine pas et qu'elle est dangereuse.

La dangerosité est une variante de l'aliénation.
Je me suis référé tout à l'heure au dictionnaire culturel Le Robert, qui est une référence. Il commence par citer La Bruyère - vous savez que j'aime les citations -, qui dit en parlant de quelqu'un : « Il se déconcerte, il s'étourdit, c'est une courte aliénation. » Le petit crime, soit dit en passant, c'est une courte aliénation. Et le texte de définir ensuite l'aliénation comme « un dérèglement permanent ou passager des facultés intellectuelles, un désordre mental qui met le sujet dans l'impossibilité de mener une vie sociale normale ».
Puisque nous nous trouvons dans une variété d'aliénation, il n'est nul besoin d'avoir cette condamnation initiale. Cet alinéa 2 est de trop ; si on le supprimait, on serait beaucoup plus à l'aise et cela permettrait de faire l'économie de ce débat.
Tous ces amendements sont passablement le résultat de contorsions et dépassent les limites du raisonnable. Je n'en dirai pas plus, parce que j'ai beaucoup d'amitié et de considération pour ceux qui les ont rédigés.
Au demeurant, je ne veux pas mêler ma voix à celle des opposants au principe de la rétention. Moi, je suis foncièrement pour ; je la crois tout à fait nécessaire et urgente, et c'est la raison pour laquelle je ne participerai pas au vote.

Je serai d'une concision exemplaire et constante, car, comme l'écrivait Paul Éluard à propos d'un texte comme celui-là : « Le tout est de tout dire, et je manque de mots, et je manque de temps, et je manque d'audace... » Je n'ai pas le temps, les mots peut-être, l'audace sûrement, mais la voix fait défaut. C'est ainsi.
Je formulerai mes observations amendement par amendement, pour être le plus clair possible.
L'amendement de suppression est lié à la question de la non-rétroactivité de la loi pénale. Monsieur Portelli, j'ai été surpris d'apprendre cette nouveauté extraordinaire : la sécurité se trouverait dorénavant dans notre ordre constitutionnel alors qu'elle est simplement, je le rappelle, un objectif de valeur constitutionnelle. Je vous renvoie à la grande décision rendue en la matière et au rapport Vedel.
La liberté vient en tête de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la devise républicaine. Il ne faut jamais l'oublier, même si ce principe doit se concilier avec les autres objectifs.
Dans la défense de la liberté, la non-rétroactivité de la loi pénale - question bien posée par M. Fauchon -, je l'ai rappelé, est un fondement essentiel.
Il me suffirait de rappeler ce qui est advenu lorsque l'on a méconnu ce principe, en des circonstances heureusement radicalement différentes, mais pour la honte perpétuelle de ceux qui l'ont violé !
Peu importe qu'il s'agisse d'une mesure de sûreté ou d'une peine. L'aspect majeur, et je rejoins M. Fauchon sur ce point, c'est l'importance de l'atteinte à la liberté individuelle. Que l'on utilise le terme de rétention, qui existe déjà, de détention ou d'enfermement, lorsqu'une personne est, pour quelque motif que ce soit, retenue dans un lieu clos gardé par l'administration pénitentiaire, d'où elle ne sort qu'escortée, elle n'a plus de liberté individuelle. L'atteinte à la liberté individuelle est alors majeure et le principe de non-rétroactivité trouve sa place.
Voilà ce que je voulais dire. Vous aurez à en tenir compte. Reste à évoquer les différentes conséquences qu'il faut en tirer. Pour ma part, je suis convaincu que quelques-uns des excellents esprits de la commission des lois - je n'ai pas voulu utiliser le comparatif - partagent ce point de vue. Sinon, pourquoi M. Lecerf aurait-il déposé les amendements qu'il a déposés, et qui ont été votés par la commission ?
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.

La parole est à M. Christian Cointat, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 78 rectifié ter.

Nous sommes confrontés à deux questions.
Tout d'abord, peut-on laisser sortir de prison un criminel dont on sait pertinemment qu'il va récidiver ?

La réponse est négative.
Ensuite, pour atteindre l'objectif visé, peut-on ne pas respecter les garanties constitutionnelles et les textes des conventions internationales auxquelles la France est partie ? La réponse est également négative. Nous devons respecter le droit et les engagements internationaux, quel que soit l'objectif que nous voulons atteindre.
Considérons le sous-amendement de M. Portelli en fonction de ces deux questions.
Première question : permet-il de ne pas laisser sortir un criminel qui va récidiver ? La réponse est positive, et je m'en félicite.
Seconde question : respecte-t-il les contraintes du droit, les obligations que nous imposent la Constitution et la Convention européenne des droits à l'homme ? Je ne suis pas juriste mais, à mon sens, la réponse est négative. Et c'est bien là toute la difficulté.
Ce sous-amendement est le fruit d'une réflexion approfondie. Il prévoit l'intervention de la chambre d'instruction, du procureur général, du juge de l'application des peines, ce qui place la décision de rétention dans le cadre judiciaire, et c'est important. Toutefois, et je rejoins M. Fauchon sur ce point, il s'écarte du principe, fondamental à mes yeux, énoncé dans l'article 1er.
Comme je l'ai indiqué hier soir, je voterai ce projet de loi parce qu'on a maintenu l'article 1er dans son « entièreté », selon un terme cher à nos amis belges. L'objet de cet article est de lier le jugement et la mesure de rétention. Or, avec ce sous-amendement, brusquement, ce lien disparaît.
En effet, dans quinze ans - douze ans peut-être, avec les remises de peine - le problème ne se posera plus, puisque le texte aura trouvé son champ d'application. En revanche, que faire pendant la période transitoire ? On ne peut bien évidemment pas dire à nos concitoyens que, pendant douze ans, la loi ne pourra pas s'appliquer ; ce serait inacceptable !
Pour remédier à cette situation, M. le rapporteur, à qui je tiens à rendre hommage publiquement, avait trouvé une solution qui me paraissait répondre aux deux questions que j'ai posées tout à l'heure, donc à l'attente de nos concitoyens.
Le sous-amendement de M. Portelli va plus loin. Mais ne va-t-il pas trop loin ? Ne risque-t-il pas de nous mettre en difficulté devant le Conseil constitutionnel ou pire, s'il passe ce filtre, dans quelques années, devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Murmures sur les travées de l'UMP.

Je suis désolé, mes chers collègues, mais si dans quatre ans, dans une période sensible, nous sommes condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme, nous ne serons pas très à l'aise !

Certes ! Les dispositions proposées par M. le rapporteur, et adoptées par la commission des lois, répondaient véritablement à l'enjeu en permettant de régler 99 % des cas.
Faut-il aller plus loin ? Si le Sénat le souhaite, je m'inclinerai. Je tiens toutefois à souligner que les décisions de rétention sont, par définition, liées à la peine. Allez dire à quelqu'un qui est resté enfermé quinze ans, qui est placé dans un centre de rétention, qui voit sa durée de rétention prolongée année après année, qui risque de rester enfermé jusqu'à la fin de ses jours : « mon cher monsieur, vous ne faites pas l'objet d'une peine, vous êtes soumis à une mesure de rétention ». Je ne suis pas persuadé qu'il fera bien la différence ! Ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourra pas sortir. Et c'est pour cela que, même si nous franchissons le cap du Conseil constitutionnel, nous risquons d'être condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme.
Ce sous-amendement va dans le sens de l'objectif que nous recherchons mais, selon moi, il soulève des difficultés juridiques que je ne suis pas à même de trancher. Si je souscris à l'objectif, je conteste la méthode. Je préférais la solution qu'avait préconisée M. le rapporteur. Aussi, dans un souci de cohérence, je ne prendrai pas part au vote sur ce sous-amendement.
Mais rassurez-vous, madame le ministre, je voterai l'ensemble du projet de loi. En ce moment décisif, ma voix ne vous manquera pas, car votre texte répond au principe cher à Clemenceau - M. Fauchon sera sans doute ravi de cette citation - selon lequel le Gouvernement a le devoir de faire en sorte que les bons citoyens soient tranquilles et que les mauvais ne le soient pas !

Je salue l'esprit inventif des auteurs de ce sous-amendement. Le dispositif qui nous est proposé est assurément l'une des plus remarquables usines à gaz juridiques de ces dernières années !
Permettez-moi, mes chers collègues, de vous dire quel est, selon moi, le sens de la démarche de M. Portelli.
Ce sous-amendement se fonde sur la méconnaissance de l'obligation de surveillance de sûreté.
Le juge de l'application des peines saisit, ou avise, le procureur général, lequel se tourne vers la chambre d'instruction, laquelle se réfère, tenez-vous bien, à une décision rendue sous l'empire d'une loi antérieure qui ne prévoyait ni la rétention de sûreté ni l'avertissement. Et c'est dans cette décision que, à partir d'un avertissement de rétention, la chambre d'instruction trouve le motif de déclencher la procédure !
Mais au titre de quelles compétences une chambre d'instruction peut-elle interpréter une décision devenue définitive ? D'autant que cette décision ne soulevait pas de difficulté d'exécution : le condamné est bien en prison.
Ainsi, afin de pouvoir mettre en oeuvre le dispositif que l'on a inventé, on va chercher rétroactivement une décision rendue sous l'empire d'une loi qui ignorait ledit dispositif. Et on trouve dans cette décision antérieure le motif de mettre en oeuvre la loi nouvelle ! Je vous laisse juge de ce que cela signifie.
Un tel procédé, qui n'est que le moyen détourné de faire accepter la rétention immédiatement applicable, ne saurait en aucun cas être utilisable. On ne peut pas jouer ainsi avec des concepts aussi fondamentaux. Je crois volontiers qu'il faut céder aux exigences de la sécurité mais, de grâce, pas au détriment de principes aussi essentiels !
Chercher, après coup, dans une décision rendue sous le régime d'une loi antérieure, un moyen de mettre en oeuvre une disposition que cette loi ne prévoyait pas ! Je m'arrête là ! On ne peut que voter contre ce sous-amendement.

Je ne suis pas juriste, vous le savez, et je n'ai pas la prétention de l'être.
J'ai écouté avec attention les juristes qui se sont prononcés et les fioritures juridiques qui nous ont été présentées.
M. Cointat a indiqué, à raison, que voter ce texte nous exposerait à des risques : une censure du Conseil constitutionnel d'une part, une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme, d'autre part.
Pour ma part, je serai simple et pragmatique. Je considère que le risque encouru par la société, par les familles des victimes et futures victimes est bien plus grand qu'une éventuelle condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme !
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

C'est la raison pour laquelle, sans aucune arrière-pensée et en pleine conscience, je voterai ce sous-amendement.
Le sous-amendement est adopté.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 12 est adopté.

Monsieur le président, pour une meilleure organisation des travaux tant du Sénat que du Gouvernement, je demande l'examen par priorité des articles 5 à 8, constituant le titre II du projet de loi.

Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission ?

La priorité est de droit.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Dans le premier alinéa de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, les mots : « d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « d'un classement sans suite motivé par les dispositions de l'article 122-1 du code pénal, d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ». -
Adopté.
Le livre VII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3711-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins prévue par les articles 131-36-4 et 132-45-1 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé : » ;
a bis) Dans le 4°, les mots : « est arrivé à son terme, » sont remplacés par les mots : «, le sursis avec mise à l'épreuve ou la surveillance judiciaire est arrivé à son terme, ou le condamné qui a bénéficié d'une libération conditionnelle, » ;
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° De coopérer à la réalisation d'évaluations périodiques du dispositif de l'injonction de soins ainsi qu'à des actions de formation et d'étude. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins ayant suivi une formation appropriée et qui ont exercé pendant au moins deux ans la fonction de médecin coordonnateur à la date de publication de la loi no du relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental peuvent être inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 3711-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans que leur soient opposables les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les praticiens chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations médicales qu'ils détiennent sur le condamné au médecin coordonnateur afin qu'il les transmette au médecin traitant. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 est ainsi rédigé :
« Le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 3711-4-1 est ainsi rédigé :
« Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, en plus du médecin traitant, un psychologue titulaire des diplômes précisés par arrêté du ministre chargé de la santé. »

L'amendement n° 27, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Dans le second alinéa du a du 1° de cet article, après le mot :
psychiatres
insérer les mots :
ou de médecins ayant suivi une formation appropriée,
II. - Supprimer les huitième et neuvième alinéas (c du 1°) de cet article.
L'amendement n° 28, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer les deux derniers alinéas (4°) de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.

Le droit en vigueur prévoit que les médecins coordonnateurs peuvent être choisis parmi les psychiatres ou parmi des médecins ayant suivi une formation appropriée.
Le ministre de la santé a souhaité réserver cette possibilité aux seuls psychiatres, jugeant que ces derniers étaient mieux à même de garantir la qualité du suivi de l'injonction de soins.
On compterait aujourd'hui 150 médecins coordonnateurs, parmi lesquels 9 médecins non-psychiatres. L'Assemblée nationale a jugé opportun de permettre à ceux-ci d'être maintenus dans leur fonction dès lors qu'ils justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans - condition que, dans les faits, ils remplissent tous.
Il est cependant difficile de comprendre pourquoi l'on devrait se priver de la faculté de faire appel à des non-psychiatres dès lors qu'ils ont reçu une formation appropriée, qu'en pratique certains médecins coordonnateurs ont été recrutés avec ce profil et qu'enfin ils n'ont pas démérité, puisque le Gouvernement a accepté l'amendement de l'Assemblée nationale prévoyant leur maintien en fonction.
Le vivier des médecins psychiatres n'est pas tel que l'on puisse se passer d'autres sources de recrutement, dès lors que les garanties de formation sont exigées.
L'amendement n° 27 a donc pour objet d'en rester, en la matière, au droit en vigueur.
J'en viens à l'amendement n° 28.
Le projet de loi, tout en maintenant la faculté pour les psychologues de participer à la prise en charge des personnes soumises à une injonction de soins, interdit qu'ils puissent se substituer au médecin traitant.
La faculté de recourir à un psychologue à la place du médecin traitant constituait l'une des propositions de la mission d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale consacrée au traitement de la récidive des infractions pénales ; elle avait été reprise par la loi du 12 décembre 2005.
Toutefois, le décret d'application auquel renvoyait la loi n'a jamais été pris : la direction générale de la santé a mis en avant la difficulté de déterminer les formations qualifiant un psychologue pour la prise en charge d'un auteur d'infractions sexuelles.
On peut de nouveau regretter, compte tenu de la pénurie de psychiatres, que soit supprimée la faculté donnée aux psychologues, de manière encadrée, d'intervenir seuls comme médecins traitants. Il convient de se demander si tous les efforts ont été faits par le ministère de la santé pour déterminer les qualifications requises permettant à un psychologue de prendre en charge un auteur d'infraction sexuelle. On doit d'ailleurs constater qu'au Canada, par exemple, les personnes chargées de mettre en oeuvre les programmes destinés aux délinquants sexuels se recrutent principalement parmi les psychologues.
Enfin, le champ d'application du suivi socio-judiciaire ayant été largement étendu, l'injonction de soins peut, par exemple, s'appliquer aux auteurs de violences au sein du couple, qui peuvent tout à fait être suivis par des psychologues.
Aussi l'amendement n° 28 vise-t-il également à en rester, sur ce point, au droit en vigueur.
Monsieur le rapporteur, je mesure, bien sûr, la portée de vos amendements et de votre argumentation : vous souhaitez que tous les médecins puissent exercer la fonction de médecin coordonnateur. Néanmoins, je suis obligée d'exprimer mon désaccord et de vous demander de bien vouloir retirer ces amendements.
En effet, en l'état actuel du droit, les médecins non-psychiatres qui ont suivi une formation spécifique - dont le contenu doit être défini par arrêté ministériel - peuvent être médecins coordonnateurs.
Cette souplesse avait été voulue, à l'origine, pour faciliter la mise en oeuvre du dispositif créé voilà dix ans. Aujourd'hui, elle n'est plus adaptée à la gravité des infractions commises par les personnes relevant d'une injonction de soins ; je crois, à cet égard, que tout le débat parlementaire a bien montré à quelle population nous nous adressions.
Les connaissances requises pour accompagner les personnes condamnées ne se limitent plus à la clinique des auteurs d'infractions sexuelles, car il faut désormais pouvoir suivre indifféremment des catégories de personnes présentant des troubles très hétérogènes qui nécessitent une compétence très large.
Compte tenu de ces difficultés et de l'extension du champ de responsabilité des médecins coordonnateurs, il est indispensable de cibler ces pratiques sur des médecins dont la spécialité est la plus appropriée.
Vous savez, par ailleurs, que le médecin coordonnateur doit transmettre au juge de l'application des peines ou au travailleur social les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins. À cette fin, il doit être capable de suivre l'évolution fine du patient condamné, qu'il convoque périodiquement, ainsi que son adhésion aux soins et l'impact de ceux-ci. Dresser un tel bilan requiert des connaissances tout à fait spécifiques.
De surcroît, les médecins coordonnateurs sont impliqués dans le choix du médecin traitant, à l'égard de qui ils jouent également un rôle de conseil : leur magistère doit donc être reconnu par ce dernier, dont ils sont les confrères. Tous ces éléments, ajoutés à la participation aux centres de ressources, plaident en faveur d'une professionnalisation accrue de la fonction de médecin coordonnateur qui s'accorderait mal avec une formation limitée, aussi intéressante soit-elle.
Le projet de loi tend à renforcer les missions des médecins coordonnateurs, qui devront coopérer à la réalisation d'évaluations périodiques du dispositif de l'injonction de soins ainsi qu'à des formations et à des études. Cela justifie de réserver cette fonction aux seuls psychiatres.
Pour autant, je n'entends pas priver du dispositif les médecins ayant acquis au cours des dernières années une expérience précieuse. C'est pourquoi j'ai accepté que l'Assemblée nationale les autorise à y prendre part.
Pour toutes ces raisons, monsieur le rapporteur, je suis défavorable à l'amendement n° 27.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 28, le même souci de rigueur, appliqué cette fois-ci à la prise en charge thérapeutique des personnes condamnées, implique d'exiger au minimum un suivi médical de ces personnes ; celui-ci est même indispensable, notamment, en cas de prescription de médicaments. C'est pourquoi le projet de loi entend garantir à tous les patients suivis dans le cadre de l'injonction de soins une prise en charge médicale.
Pour autant, bien entendu, je ne désire pas écarter non plus les psychologues du dispositif. En effet, leur intervention peut s'avérer éminemment souhaitable. Elle doit cependant se concevoir dans le cadre d'un suivi pluridisciplinaire, après établissement d'un diagnostic médical et fixation d'un protocole thérapeutique et de prise en charge établis par un médecin. Comme actuellement, il appartiendra au médecin coordonnateur de recommander la prise en charge par un psychologue en fonction de la personnalité de la personne condamnée.
Compte tenu de ces éléments, monsieur le rapporteur, j'émets un avis défavorable sur ces deux amendements, que je vous demande de bien vouloir retirer.

Sur le fond, on ne peut qu'être d'accord avec les propos que vient de tenir Mme la ministre de la santé. Mais - et le mais est considérable - le problème demeure de la réalité de la profession de psychiatre, notamment de psychiatre opérant dans le secteur public, plus particulièrement dans le secteur hospitalier.
Je passe beaucoup de temps dans les établissements pénitentiaires. C'est ainsi qu'à Caen, par exemple - je l'évoquais encore hier -, le responsable du service médico-psychologique régional m'a indiqué qu'il fallait plus de un an pour qu'un rendez-vous demandé par un détenu auprès d'un psychiatre puisse être honoré.
Je précise, en outre, que notre intention est non pas d'obliger à nommer des médecins agréés ou des psychologues - permettez-moi de réunir les deux amendements, puisque le problème est de même nature -, mais simplement de poser le principe selon lequel, s'il n'y a pas de psychiatre, mieux vaut avoir un médecin agréé et formé que personne ; de même, s'il n'y a pas de médecin coordonnateur, il vaut mieux avoir un psychologue que rien, d'autant plus que, le suivi socio-judiciaire ayant été largement étendu, le psychologue est certainement à même de répondre à un certain nombre de problèmes qui se posent en ce qui concerne les auteurs de violences sexuelles.
N'étant pas moi-même médecin, mais étant plutôt juriste, j'ai été très intéressé hier par l'intervention de M. About, qui, en sa qualité de président de la commission des affaires sociales, a manifesté son appui total à nos deux amendements.
Il y a deux jours, au cours d'un débat auquel je participais sur la chaîne Public Sénat, un psychiatre de haute renommée - il sera facile de retrouver qui ! - s'interrogeait : il ne comprenait vraiment pas pourquoi, dans ce pays, on tient absolument à un mieux qui est finalement l'ennemi du bien.
Pour l'ensemble de ces raisons, et tout en reconnaissant que, sur le fond, Mme la ministre aurait raison si le vivier des psychiatres était suffisamment important, je préfère maintenir les deux amendements. Je souhaite que la mesure proposée s'applique au moins pendant la période nécessaire pour que les efforts réalisés par le Gouvernement, que je salue, portent leurs fruits et que davantage de psychiatres se préoccupent de missions en secteur public. Le temps doit leur être donné de se former. Or la formation d'un psychiatre ne se fait pas en quelques mois, ni même en quelques années !
On constate sur le terrain que le frein essentiel au recrutement de médecins psychiatres coordonnateurs n'est pas, en réalité, la démographie des psychiatres : c'est l'attrait financier de la fonction de médecin coordonnateur.
Pour résoudre cette question, j'ai augmenté de 65 % la rémunération des médecins coordonnateurs en la portant de 426 euros à 700 euros. J'entends ainsi régler le problème d'une fonction finalement trop peu attractive au regard des responsabilités assumées, sans pour autant désigner des personnes non compétentes.
Véritablement, monsieur le rapporteur, je vous en supplie : attirons vers ces fonctions qui, j'y insiste, sont extrêmement difficiles à exercer, des praticiens compétents en les rémunérant convenablement au lieu d'y appeler des médecins qui n'auront pas les compétences requises !

Je ne suis pas du tout médecin, et je suis un tout petit peu juriste. Quand les médecins, surtout quand ils s'occupent du cerveau, ...
Ils s'occupent même de beaucoup plus que du cerveau !

Oui, les psychiatres s'occupent de tout. Mais, généralement, tout cela trouve son origine dans le cerveau !
Madame la ministre, je comprends très bien votre position. Cependant, vous avez beau affirmer que les médecins sont en nombre, l'expérience montre que nous manquons de médecins, et partout.
J'ai, bien entendu, voté en son temps la loi par laquelle les services médicaux des prisons sont devenus du ressort de l'administration de la santé. Elle a marqué un progrès considérable, et l'on peut affirmer aujourd'hui que globalement, pour les soins somatiques, la situation est satisfaisante, même si des difficultés subsistent parfois du fait que certains établissements pénitentiaires sont très éloignés des centres hospitaliers qui sont en mesure de fournir des équipes.
Pour la psychiatrie, veuillez m'excuser, il n'en va pas de même ! À partir du moment où les psychiatres sont en nombre insuffisant, que fait-on ? On ne fait rien !
Peut-être nous sommes-nous mal compris, madame la ministre, peut-être est-il possible d'améliorer la rédaction de nos amendements : nous proposons une mesure qui, dans notre esprit, est temporaire. Faut-il, s'il n'y a pas de psychiatre, qu'il n'y ait pas de coordonnateur ?
Il est fait référence à un médecin coordinateur qui sera psychiatre ou médecin agréé !

Ce ne sera plus possible, dorénavant ! Quant aux psychologues, leur intervention est régie par la loi du 12 décembre 2005.

La discussion va sans doute se poursuivre. Néanmoins, pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées, et en me référant également aux arguments du président de la commission des affaires sociales, par précaution, j'incite mes collègues à soutenir la position de la commission des lois.

N'étant ni juriste ni psychologue, je vois cela de l'extérieur. Il s'agit, selon moi, d'un problème de bon sens.
Il est indéniable, tout d'abord, que les chiffres de la démographie psychiatrique sont mauvais : les psychiatres en formation sont en nombre insuffisant et, même si des cohortes d'étudiants s'inscrivaient aujourd'hui, comme cela serait nécessaire, ce n'est que dans dix ans qu'ils seraient opérationnels.
Par ailleurs, nous savons que les psychiatres sont mal répartis sur le territoire : ils sont soit dans la région parisienne, soit sur la Côte d'azur, le reste de la France devenant progressivement une espèce de désert psychiatrique.

Il convient de répondre à cette pénurie. Si, dans quelques années, des psychiatres en nombre suffisant arrivent sur le marché et sont prêts à assumer les fonctions de médecin coordonnateur, alors, nous pourrons revoir le dispositif, mais, aujourd'hui, il faut faire face.
M. le rapporteur et moi-même avons visité une prison très sensible, celle de Clairvaux. J'ai été frappé de ce que l'on m'y a dit : une seule journée de vacation de psychiatres - soit environ sept heures de travail - est prévue par semaine, pour 160 détenus. Telle est la réalité des soins psychiatriques dans une centrale !
Il faut résoudre ce problème. Or, Mme la ministre n'y apporte pas de réponse.
Que des psychologues extérieurs au milieu carcéral y interviennent n'est pas forcément mauvais, le fait d'avoir une expérience large de la société ne pouvant être que bénéfique.
Enfin, dans beaucoup d'autres pays européens, le système pénitentiaire a recours à des psychiatres vacataires qui ont reçu une formation appropriée pour travailler dans le secteur psychiatrique des hôpitaux.
Pour l'ensemble de ces raisons, je voterai ces amendements.

Je ne comprends plus grand-chose ! Depuis le début de ce débat, il nous est dit que, la fin justifiant les moyens, nous devons accepter que soient détenus des gens ad vitam aeternam, même si cela nous met en délicatesse avec le droit - nous nous en préoccuperons plus tard - et même si nous ne disposons pas vraiment des moyens d'évaluer les conséquences d'une telle politique. Or, soudain, il nous est dit l'inverse - le droit, c'est le droit ! -, ce alors que nul n'ignore la crise gravissime que traverse le secteur psychiatrique en milieu carcéral, non plus que le nombre insuffisant de personnels psychiatriques soignants.
Comment peut-il dire une chose pareille ?

Cette situation n'est pas spécifique à la France. M. le rapporteur et moi-même avons constaté, au Canada, que le même problème se posait. Quels remèdes les Canadiens ont-ils trouvés ? Ils ont mis en place un réseau de soutien, composé, bien sûr, de psychiatres, mais aussi de psychologues qui, progressivement, se sont formés à tout ce qui concerne la criminologie.
La proposition de la commission est de bon sens et permettra peut-être de passer d'une conception stratosphérique de l'application de la loi à la réalité. Franchement, madame la ministre, j'avoue ne pas comprendre vos réticences à l'accepter.
Je veux - pardonnez-moi l'expression ! - « tordre le cou à un certain nombre de canards » !
La France n'est pas un désert psychiatrique : avec 14 000 psychiatres, elle compte l'un des taux les plus élevés du monde. Il faut revenir à la raison ! Les psychiatres sont suffisamment nombreux dans notre pays pour exercer les fonctions de médecin coordonnateur.
En fait, je le répète, le problème tient, non pas au nombre de médecins, mais à l'attractivité de la fonction de médecin coordonnateur, insuffisamment rémunérée, compte tenu de la complexité de la tâche et du sentiment d'insécurité dans lequel elle s'accomplit.
J'ai veillé à y remédier. J'ai donc tenu à créer des centres de ressources et à leur accorder des crédits : ainsi, le médecin coordonnateur ne se sentira plus isolé et travaillera dans une équipe pluridisciplinaire, au sein de laquelle des psychologues auront leur place, mais sous le contrôle d'un médecin psychiatre, cette tâche étant extrêmement difficile.
Vous me demandez pourquoi je tiens à ce que ce soit des psychiatres qui exercent cette fonction. C'est parce qu'elle est très ardue et que, en tant que ministre de la santé, je suis garante de la santé publique.
Il n'y a pas de crise psychiatrique quantitative en milieu carcéral ; il y a une crise qualitative, que j'entends résoudre par des mesures tendant à renforcer l'attractivité financière de cette profession et de son exercice.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 6 est adopté.
La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « et aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ». -
Adopté.
L'article L. 6141-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès lors qu'il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, les personnels soignants intervenant au sein de ces établissements et ayant connaissance de ce risque sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l'établissement en lui transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la mise en oeuvre de mesures de protection.
« Les mêmes obligations sont applicables aux personnels soignants intervenant au sein des établissements pénitentiaires. »

L'amendement n° 76, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

L'article 8 tend à modifier l'article L. 6141-5 du code de la santé publique en posant deux exigences a priori contradictoires : en cas de risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein d'un centre de rétention de sûreté et des établissements pénitentiaires, les personnels soignants auront l'obligation de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l'établissement ; toutefois, ces personnels devront le faire dans le respect des dispositions relatives au secret médical.
Se pose donc ici une question cruciale : comment transmettre des informations sur un patient et respecter le secret médical, auquel sont, d'ailleurs, tenus les personnels soignants, et sans lequel le lien de confiance entre un médecin et son patient ne peut s'établir ?
La logique de l'ordre public l'emporte donc sur la logique de soins. Les personnels soignants seront soumis à une obligation de transmission et devront agir contre l'intérêt de leurs patients, pour des raisons de sauvegarde de l'ordre public ou, plus simplement, pour des nécessités de bon fonctionnement du service public pénitentiaire.
Cette disposition, si elle était adoptée, placerait les personnes détenues ou retenues en centre de rétention en dehors du champ d'application des articles L. 1110-4 et R. 41-27-4 du code de la santé publique, qui visent à garantir le secret des informations médicales vis-à-vis des personnes étrangères à l'équipe soignante.
Nous nous demandons pourquoi les règles de déontologie auxquelles les médecins et les personnels soignants sont astreints ne s'appliqueraient pas dans les établissements pénitentiaires et dans les centres de rétention de sûreté.
Les conditions de détention, trop souvent qualifiées de traitements inhumains et dégradants par le Comité européen pour la prévention de la torture et les différents commissaires européens aux droits de l'homme, ne suffisent-elles pas pour faire de nos prisons des zones de non-droit ? Faut-il que, de surcroît, les prisonniers ne puissent bénéficier de ce droit élémentaire qu'est le respect du secret médical, qui devrait être indissociable de l'acte de soigner ?
Pourtant, aussi bien les règles pénitentiaires européennes que les normes édictées par le Comité européen pour la prévention de la torture...

...exigent le respect des règles ordinaires du secret professionnel.
Manifestement, ces règles dérangent le Gouvernement. Cela rappelle tristement la loi sur la prévention de la délinquance, qui a remis en cause, elle aussi, un secret professionnel, celui auquel sont soumis les travailleurs sociaux, en créant la notion de « secret partagé ».
Le médecin sera obligé de transmettre au directeur d'établissement des informations sur son patient, mais dans le respect des dispositions relatives au secret médical. Il y a là une contradiction si ce n'est incompréhensible, du moins inexplicable.

De quoi s'agit-il ? L'article 8 vise simplement à autoriser les médecins à signaler à l'administration pénitentiaire les risques éventuels liés à l'évolution de l'état de santé d'un détenu.
Nombre de faits divers particulièrement dramatiques ont appelé l'attention sur cette absolue nécessité de communication : il est donc temps de reconnaître que, parfois, une conception par trop stricte, de la part des médecins de l'administration pénitentiaire, non pas du secret médical - je ne vais pas jusque là - mais simplement de la communication d'informations opérationnelles, a eu des effets tragiques et a pu conduire à la mort de certains détenus.
L'avis de la commission est donc totalement défavorable.
Il me paraît important de préciser, à l'intention des médecins, qui, parfois, se sont inquiétés, que l'obligation pour les personnels soignants de signaler un risque pour la sécurité des personnes ne fixe qu'un devoir d'alerte sur un risque dont ces personnels auraient connaissance, sans - cela va de soi - impliquer une obligation de détecter un tel risque : la responsabilité du médecin, si celui-ci n'a pas su ou n'a pas pu déceler ce risque, ne saurait donc être engagée.
L'explication de M. le rapporteur est excellente.
L'article 8 est simple : « Dès lors qu'il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes » au sein des établissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté, « les personnels soignants intervenant au sein de ces établissements et ayant connaissance de ce risque sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l'établissement en lui transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la mise en oeuvre de mesures de protection. »
M. le rapporteur a, en outre, précisé que les mêmes obligations sont applicables au personnel soignant intervenant au sein des établissements pénitentiaires.
Rappelez-vous, madame la sénatrice, l'affaire Evrard ! Comment ne pas être frappé de voir à quel point la chaîne de l'information a été gravement perturbée ? Des drames épouvantables auraient sans doute pu être évités.
Il est indispensable de réfléchir à la meilleure manière de concilier le respect du secret médical avec le secours à personnes en danger et la nécessaire information des personnels intervenant en milieu carcéral sur la dangerosité des personnes détenues.
Il est question ici non pas de remettre en cause le secret médical - il reste préservé - mais d'inviter les praticiens à opérer un transfert d'informations opérationnelles à destination de l'administration chargée des lieux de détention ou de rétention, ce dans le seul souci de garantir la sécurité des personnels et des personnes privées de liberté.
Imaginez, madame la sénatrice, que vous êtes médecin, que vous suivez un malade, et que vous vous rendez compte que son état de santé met en danger la vie de ses codétenus, ainsi que celle des personnels : pourriez-vous ne pas transmettre cette information capitale ?
J'insiste : cette information capitale pour la vie des gens, vous ne la transmettriez pas ? Ce serait une attitude totalement insoutenable !
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 8 est adopté.

Nous en revenons au chapitre II.
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux réductions de peines
I. - Après la première phrase du troisième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu'elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines, sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 721-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois, dès lors qu'elle refuse les soins qui lui ont été proposés. »

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 54 est présenté par MM. Badinter, Collombat, Frimat, C. Gautier, Mermaz, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 72 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 54.

Il s'agit d'un amendement de suppression de l'article 2 relatif aux réductions de peine, sujet sur lequel le Parlement a déjà légiféré à plusieurs reprises ces dernières années, à l'occasion de l'examen de la loi Perben II en 2004, prévoyant certaines mesures de sûreté, et de la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.
À chaque fois que l'opportunité s'est présentée, le travail législatif a abouti à diminuer les réductions de peine ou à aggraver, en quelque sorte, leurs conditions d'accès.
Il nous est ici proposé, dans le I de cet article, de « réduire » la réduction de peine elle-même en cas de refus de suivre le traitement proposé par le juge de l'application des peines, le JAP. Au vu de la situation actuelle, où le juge peut retirer la réduction de peine à hauteur de trois mois maximum par an, l'application pour les cas visés à ce paragraphe aboutira à la suppression complète de ladite réduction.
Il s'agit de revenir sur une réforme, positive, qui avait supprimé toute distinction en matière de réduction de peine en fonction de la gravité de celle-ci. Tout le monde était ainsi mis sur le même plan, ce qui avait été très bien perçu et très bien vécu dans les prisons, comme pourront vous le confirmer l'ensemble des personnels pénitentiaires.
Le II du même article vise un cas similaire quoique un peu différent, c'est-à-dire les réductions de peine supplémentaires qui étaient octroyées aux condamnés manifestant des efforts sérieux de réadaptation par le travail ou les études. Autrement dit, ils étaient encouragés à suivre une telle voie. Là encore, on va diminuer ces réductions de peine supplémentaires jusqu'au point où elles seront finalement supprimées.
Certes, je comprends une partie de la philosophie qui sous-tend le dispositif. Il s'agit de contraindre le condamné à accepter tel ou tel traitement qui lui est proposé, car son refus peut signifier, ce qui est effectivement choquant, qu'il n'a aucune envie de s'amender ni d'aller vers la guérison.
Or, ce n'est exact qu'en apparence. Au fond de moi, je me dis que nul ne peut contraindre quelqu'un à se soigner. Après tout, le refus est un choix fondamental, un choix personnel ; sans doute est-ce un mauvais choix, sur lequel nous-mêmes portons un regard négatif, mais c'est le choix du détenu.
Le danger qui se profile derrière est réel. Nombre de psychopathes et de criminels endurcis ne manquent malheureusement pas de subtilité et vont très bien comprendre le fonctionnement de cette mécanique. Pour éviter les suppressions de réduction de peine, pour être bien considérés, il leur suffira de faire semblant, en acceptant de suivre le traitement recommandé par le juge de l'application des peines, mais seulement en apparence. Ils n'iront pas dans le sens de la guérison parce qu'ils resteront à la surface des choses. Ils ne participeront pas au traitement de tout leur coeur et de toute leur âme. En réalité, il y aura une apparence de traitement, un non-soin et, donc, une non-guérison.
Par ailleurs, tous les personnels pénitentiaires vous le diront, les réductions de peine sont un élément extrêmement important dans la vie des condamnés et leur diminution, que le projet de loi tend à introduire, aura certainement pour conséquence de tendre les relations dans les prisons, voire d'y accroître la violence.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l'article 2.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 72.

Aujourd'hui, l'article 2 modifie les articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale, qui régissent le régime des réductions de peines. Je rappelle que ceux-ci ont déjà été modifiés, le premier par la loi de décembre 2005 et le second, tout dernièrement, par celle d'août 2007, dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle est d'application trop récente pour que l'on puisse juger de ses effets et sans compter qu'elle avait, elle aussi, été adoptée dans l'urgence.
Nous avions, pour notre part, contesté ces lois, alors que vous renforcez une nouvelle fois la logique d'enfermement. C'est ainsi que l'article 2 étend les exceptions au principe figurant à l'article 721 du code de procédure pénale et selon lequel « chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation ».
Il procède, ce faisant, à des assimilations pour le moins peu pertinentes : le refus de se soumettre à des soins serait traité de la même manière qu'une « mauvaise conduite » ou une récidive. À cet égard, je rappelle les réserves émises en 2005 par notre collègue, François Zocchetto.
De plus, la limitation des réductions de peines toucherait ici des personnes non récidivistes, mais considérées en quelques sorte comme des « récidivistes potentiels ».
En juillet dernier, lors de l'examen du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, nous avions rappelé l'unanimité des médecins pour dire que le principe du consentement aux soins est nécessaire si l'on veut que ceux-ci aient une chance de réussir et que ce consentement ne doit pas être contraint.
Nous avions également souligné, comme le fait d'ailleurs la commission des lois, l'exigence d'effectivité de ces soins ; c'est, évidemment, un minimum. Or, il est fortement à craindre que le problème ne reste posé, toujours en raison de l'insuffisance des moyens.
Surtout, les réductions de peines font partie des outils qui, à l'instar de la libération conditionnelle, doivent être favorisés, car ils ont une influence positive sur la réinsertion des détenus.
C'est aussi l'avis de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui considère que « Les nouvelles limites envisagées dans le présent texte sont autant d'obstacles aux possibilités de réinsertion durable et réelle du condamné dans la société ». Elles les jugent donc toutes « contreproductives ».
C'est au bénéfice de ces explications que nous vous proposons la suppression de cet article 2.

L'amendement n° 38, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
L'amendement n° 88, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'article 721 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, en raison de sa particulière dangerosité, le condamné est susceptible de faire l'objet d'une rétention de sûreté dans les conditions mentionnées à l'article 706-3-14, la juridiction régionale de la rétention de sûreté visée à l'article 706-53-15 peut décider du retrait de la réduction de peine dont a bénéficié le condamné aux fins de son placement en rétention de sûreté ».
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « en cas », sont insérés les mots : « de décision de placement en rétention de sûreté, ».
... - Dans le quatrième alinéa de l'article 721-1 du même code, après les mots : « de l'application des peines », sont insérés les mots : « ou de la juridiction régionale de la rétention de sûreté, ».
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Nous reprenons ici la même logique que celle qui sous-tendait l'amendement que nous avons défendu à propos de la substitution de la rétention de sûreté à la période correspondant aux crédits de peine dont le condamné a bénéficié.
En fait, au premier abord, l'article 2 corrobore en partie le dispositif que nous proposons, en ce que son I prévoit le retrait des crédits de peine du condamné visé à l'article 706-53-12. Cela va donc dans le sens de notre démarche, mais c'est pour nous insuffisant.
En effet, le retrait des crédits de peine doit être prononcé par la commission régionale de la rétention de sûreté, afin de garantir l'unicité de la décision. Si le juge de l'application des peines décide du retrait des crédits de peine en raison du refus de suivre le traitement proposé, ce sera pour ce motif et non en fonction de la dangerosité du condamné. Il nous paraît donc plus utile de confier le soin du retrait des crédits de peine à la commission régionale, dans le cadre de la décision de placement en rétention de sûreté.
Les deux systèmes ne nous semblent pas incompatibles. Il ne faudrait pas, en effet, créer une confusion entre la procédure de rétention de sûreté, encadrée par la commission régionale de la rétention de sûreté, et cette nouvelle procédure de retrait, confiée au juge de l'application des peines, en raison du refus de soins.
La commission régionale pourra, par ailleurs, s'appuyer sur la décision du JAP pour confirmer le retrait des crédits de peine un an avant la libération prévue du condamné, afin d'étayer sa décision de placement en rétention de sûreté.
Par ailleurs, le II de cet article a pour effet d'amoindrir les jours de crédits de peine, qui pourront être en quelque sorte convertis en une mesure de rétention de sûreté. En effet, la rétention de sûreté étant égale à celle du crédit de peine, l'article réduit en conséquence sa durée théorique. Il faudrait peut-être, au contraire, favoriser les crédits de réductions de peine supplémentaires, car, pour le type de condamnés visés, ils permettront dans tous les cas d'être convertis en un placement en rétention de sureté. Cela vaudrait mieux puisque, après tout, la prise en charge médicale et sociale serait meilleure que dans le cas d'un simple emprisonnement.

La commission a émis un avis défavorable sur les amendements identiques n° 54 et 72 de suppression de l'article 2.
La réduction de peine doit être considérée non pas nécessairement comme un droit, mais comme une reconnaissance des efforts faits par le détenu pour sa réinsertion. À nos yeux, le refus de suivre un traitement et d'accéder aux soins est effectivement une attitude contre laquelle il convient de lutter. Si l'on ne peut pas forcer une personne à se soigner, on peut au moins l'y inciter vivement, et l'une des techniques possibles est justement la diminution des réductions de peine.
De même, pour ceux qui choisiraient délibérément d'aller jusqu'au bout de la peine et de refuser à la fois tout traitement et tout aménagement, la rétention de sûreté pourra être une manière de les inciter à accepter les soins.
En ce qui concerne les amendements n° 38 et 88, l'argumentation de Mme Boumediene-Thiery est quelque peu différente, puisqu'elle reprend la logique de l'un de ses amendements présentés précédemment, dans lequel elle prévoyait que la rétention de sûreté pouvait être appliquée dans le cadre de la durée correspondant aux réductions de peine obtenues.
Dans cette perspective, il pouvait s'avérer utile de ne pas limiter de telles réductions. Mais cette logique n'étant pas celle du projet de loi, la commission y est également défavorable.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 54 et 72. Le principe même de la réduction de peine, c'est d'être la conséquence d'une bonne conduite ou d'un gage de réinsertion ; ce n'est pas un droit automatique. Or elle a souvent été dévoyée.
S'agissant du type de délinquants visés, il est extrêmement important que la réduction de peine prenne tout son sens. Par conséquent, mieux vaut la prévoir en contrepartie de soins ou d'une autre mesure de réinsertion.
Pour les même raisons, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 38.
Par ailleurs, le Gouvernement émet le même avis défavorable sur l'amendement n° 88 que sur l'amendement n° 49 rectifié bis, qui a été examiné hier.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 2 est adopté.

CHAPITRE III
Dispositions applicables en cas d'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental
Après l'article 706-118 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXVIII ainsi rédigé :
« TITRE XXVIII
« DE LA PROCÉDURE ET DES DÉCISIONS D'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL
« CHAPITRE I ER
« Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction
« Art. 706-119. - Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu'il est susceptible d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en raison d'un trouble mental, il en informe les parties lorsqu'il les avise ainsi que le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier, en application du premier alinéa de l'article 175.
« Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre de l'instruction afin que celle-ci statue sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal conformément aux articles 706-122 à 706-127 du présent code.
« Art. 706-120. - Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, après avoir constaté qu'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il ordonne, soit d'office soit si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général près la cour d'appel aux fins de saisine de la chambre de l'instruction.
« À défaut de cette transmission, il rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.
« Art. 706-121. - L'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
« L'ordonnance de transmission de pièces rendue en application de l'article 706-120 ne met pas fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction, par ordonnance distincte, d'ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire. S'il n'a pas été mis fin à la détention provisoire, la chambre de l'instruction doit statuer dans un délai de six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière correctionnelle à compter de la date de l'ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne mise en examen est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
« Art. 706-122. - Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120, son président ordonne, soit d'office soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière si son état le permet. Si celle-ci n'est pas assistée d'un avocat, le bâtonnier en désigne un d'office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celle-ci ne peut comparaître.
« Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos prévus par l'article 306.
« Le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, conformément à l'article 442.
« Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction, conformément à l'article 168.
« Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux articles 436 à 457, les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ou déterminer si le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal est applicable.
« Le procureur général, l'avocat de la personne mise en examen et l'avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins et aux experts, conformément à l'article 442-1.
« La personne mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
« Une fois l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses réquisitions.
« La personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations.
« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers.
« Art. 706-123. - Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
« Art. 706-124. - Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.
« Art. 706-125. - Dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
« 1° Elle déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;
« 2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
« 3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu'il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l'article 489-2 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;
« 4° Elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
« Art. 706-126. - L'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
« Il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
« Art. 706-127. - Les articles 211 à 218 sont applicables aux décisions prévues aux articles 706-123 à 706-125.
« Art. 706-128. - Les articles 706-122 à 706-127 sont applicables devant la chambre de l'instruction en cas d'appel d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas d'appel d'une ordonnance de renvoi lorsque cet appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal.
« CHAPITRE II
« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises
« Section 1
« Dispositions applicables devant la cour d'assises
« Art. 706-129. - Lorsqu'en application des articles 349-1 et 361-1, la cour d'assises a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, elle déclare l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental.
« Art. 706-130. - Lorsque la cour d'assises rentre dans la salle d'audience en application de l'article 366, le président prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
« Cet arrêt met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
« Art. 706-131. - En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'article 489-2 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.
« Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
« Art. 706-132. - Le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La cour d'assises statuant en appel est alors désignée conformément aux articles 380-14 et 380-15.
« L'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action civile. L'appel est alors porté devant la chambre des appels correctionnels, conformément à l'article 380-5.
« Section 2
« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel
« Art. 706-133. - S'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
« 1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;
« 2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
« 3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l'article 489-2 du code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;
« 4° Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
« Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
« Art. 706-134. - Les dispositions de l'article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
« Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité.
« CHAPITRE III
« Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
« Art. 706- 135 A. - Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1 du même code, dont le deuxième alinéa est applicable. L'article L. 3213-8 du même code est également applicable.
« Art. 706-135. - Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement :
« 1° Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
« 2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
« 3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
« 4° Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
« 5° Suspension du permis de conduire ;
« 6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.
« Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu'après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet.
« Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l'objet sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.
« Art. 706-136. - La personne qui fait l'objet d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-135 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de six mois.
« Art. 706-137. - Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-135 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation d'office dont cette personne aura pu faire l'objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.
« La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.
« Art. 706-138. - La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues par l'article 706-135 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
« Art. 706-139. - Un décret précise les modalités d'application du présent titre. »

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous abordons, avec l'article 3, le volet du projet de loi relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Cette irresponsabilité pénale est aujourd'hui régie par le principe posé à l'article 122-1 du code pénal, qui opère une distinction entre l'abolition et l'altération du discernement, afin de déterminer si la personne est pénalement irresponsable ou, au contraire, responsable.
La personne poursuivie fait l'objet d'une expertise psychiatrique au moment de l'instruction, une telle expertise étant de toute façon obligatoire lorsqu'elle a commis un crime.
Mais, de façon surprenante, l'irresponsabilité mentale est de moins en moins retenue par les juges d'instruction : ainsi, le nombre d'ordonnances de non-lieu rendues pour ce motif est passé de 444 en 1987 à 233 en 2003, soit une diminution de moitié environ.
Ces chiffres viennent confirmer le constat que faisait déjà la commission d'enquête parlementaire sur les prisons en 2000, qui indiquait ainsi : « les psychiatres, s'appuyant sur le deuxième alinéa de l'article 122-1 du nouveau code pénal, ont interprété la loi dans un sens univoque. À leur sens, peu de troubles psychiques ou neuropsychiques abolissent le discernement de la personne ou entravent le contrôle de ses actes. En conséquence, le nombre d'accusés jugés ? irresponsables au moment des faits ? est passé de 17 % au début des années quatre-vingt à 0, 17 % pour l'année 1997 ».
Dans ces conditions, il n'est pas étonnant de retrouver ces personnes souffrant de troubles mentaux dans nos prisons : 30 % environ des détenus seraient concernés. L'augmentation du nombre de ceux qui nécessitent l'application de l'article D. 398 du code de procédure pénale permettant aux établissements pénitentiaires de procéder à des hospitalisations d'office dans les hôpitaux psychiatriques est un signe de cette évolution.
Ce n'est donc pas tant l'application de cet article 122-1 du nouveau code pénal qui pose problème, mais c'est bien la médiatisation des faits divers se rapportant à des cas d'irresponsabilité pénale et l'instrumentalisation de la souffrance des victimes. D'ailleurs, ce sont bien deux faits divers qui sont à l'origine de ce projet de loi, dont l'un concerne un jeune homme ayant tué deux infirmières de l'hôpital psychiatrique de Pau et ayant bénéficié d'un non-lieu pour raison psychiatrique.
Nous entendions le Président de la République déclarer, le 20 août 2007, que « le premier des droits de l'homme à défendre, c'est celui des victimes ». Pourtant, la loi n'est pas muette s'agissant des droits des victimes dans les cas d'irresponsabilité pénale. Depuis 1995, l'ordonnance de non-lieu motivée par un trouble mental est notifiée oralement dans le cabinet du juge d'instruction et la contre-expertise sollicitée par la partie civile est de droit.
La loi du 9 mars 2004 a introduit l'obligation faite au juge, en cas d'application de l'article 122-1, de préciser dans son ordonnance de non-lieu s'il existait des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. Pourquoi, par conséquent, vouloir réformer dans l'urgence cette procédure ?
Cette loi est donc clairement une loi d'affichage et non, évidemment, une loi destinée à améliorer le traitement des personnes irresponsables pénalement et à soutenir le secteur de la psychiatrie dans les hôpitaux et dans les établissements pénitentiaires.
Ce que le Gouvernement ne comprend pas, c'est qu'en donnant davantage de moyens à la prévention et au suivi des personnes malades mentales, que ce soit en prison ou en hôpital psychiatrique, on favorise la lutte contre les actes violents et la récidive et, de fait, on agit bien plus efficacement pour la réinsertion de ces personnes dans la société. Faire en sorte qu'il y ait moins de victimes, n'est-ce pas le meilleur moyen d'agir en leur faveur ?

Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 55 est présenté par MM. Badinter, Collombat, Frimat, C. Gautier, Mermaz, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 73 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 55.

Je souhaite présenter quelques remarques sur la nouvelle procédure instaurée à l'article 3.
Je ferai deux types d'observations, les unes concernant la procédure applicable, les autres l'introduction de « mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».
En premier lieu, la participation du malade mental, atteint au point de ne pas être responsable de ses actes, à une forme de procès public qui aboutit à la déclaration d'irresponsabilité porte de sérieuses atteintes aux règles de procédure.
Elle entraîne, tout d'abord, une confusion entre la juridiction d'instruction et la juridiction de jugement, cette dernière devant se prononcer sur la réalité et l'imputabilité des actes. J'ai déjà développé ce point en défendant la motion d'irrecevabilité déposée par mon groupe. Il s'agit d'un problème lourd sur lequel le Conseil constitutionnel devra se prononcer.
Apparaît, ensuite, une confusion entre l'audience de jugement et l'instruction, alors même que, durant l'instruction, l'individu demeure présumé innocent.
En second lieu, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dite Convention européenne des droits de l'homme, dispose que « tout accusé a droit notamment à [...] se défendre lui-même ». Or, dans la procédure envisagée, il existe un cas dans lequel l'accusé ne serait pas convoqué par le président de la chambre d'instruction, peut-être à juste titre s'il n'est pas en état de comparaître, mais aussi dans d'autres situations. En tout état de cause, cet accusé doit être représenté par son avocat, ce qui constitue une remise en cause de son droit à se défendre lui-même.
Un autre point est plus préoccupant. Cette nouvelle procédure, dont l'organisation est compliquée, ne représentera pas nécessairement un grand progrès pour les victimes et leurs familles. En effet, la confrontation physique avec un auteur de crime malade ne constituera pas une explication ou une réparation, mais sera plutôt un drame ajouté au drame, une confrontation de souffrances.
Dans un cas, si la personne présumée coupable est dans un état normal, ce qui peut arriver au cours des cycles de maladie mentale, la famille, les ayants droit ou la victime en tireront la conclusion négative que la déclaration d'irresponsabilité n'est qu'un artifice de procédure, que la personne dispose en réalité de toutes ses capacités, qu'elle est donc vraiment coupable et qu'elle échappe au véritable jugement en faisant semblant d'être malade.
Dans un autre cas, si le coupable présumé est dans un état tel que sa maladie mentale apparaît clairement, il n'y aura pas de dialogue possible. On verra probablement se jouer une mauvaise scène de théâtre, douloureuse pour chaque partie, et les familles n'en tireront pas un grand réconfort.
Une autre variante possible consisterait à prévoir la représentation du coupable présumé par son avocat, comme cela se fait, dans un certain nombre de cas, en cour d'assises. Ainsi, le président de la cour d'assises de Paris nous a dit avoir organisé, à plusieurs reprises, des réunions entre des familles de victimes et les avocats des deux parties concernées, ce qui a permis de faire le tour de l'affaire, sans rien cacher, et de dégager la vérité sur la situation. J'ai cru comprendre que ceux qui avaient participé à ces réunions en étaient sortis plus réconfortés que si le coupable présumé avait été présent.
C'est la raison pour laquelle nous souhaitons la suppression de l'article 3.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 73.

L'amendement n° 22, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-119 du code de procédure pénale, remplacer les mots :
il en informe les parties lorsqu'il les avise ainsi que le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier
par les mots :
il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise
La parole est à M. le rapporteur.

L'amendement n° 23, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
il ordonne,
rédiger comme suit la fin du premier alinéa et le début du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-120 du code de procédure pénale :
si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Il peut aussi ordonner d'office cette transmission.
« Dans les autres cas, il rend ordonnance...
La parole est à M. le rapporteur.

Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle, qui vise à distinguer clairement l'hypothèse dans laquelle le juge d'instruction a une compétence liée pour renvoyer un dossier à la chambre de l'instruction en vue d'une déclaration d'irresponsabilité pénale - c'est-à-dire lorsque le procureur de la République ou une partie le demande - des autres cas dans lesquels ce juge conserve sa liberté d'appréciation.
Je souhaite cependant modifier légèrement cet amendement en supprimant les trois derniers mots du dernier alinéa, « il rend ordonnance », qui n'ont pas à y figurer.

Je suis donc saisi d'un amendement n° 23 rectifié, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Après les mots :
il ordonne,
rédiger comme suit la fin du premier alinéa et le début du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-120 du code de procédure pénale :
si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Il peut aussi ordonner d'office cette transmission.
« Dans les autres cas, ...
L'amendement n° 24, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-122 du code de procédure pénale, après les mots :
qui lui sont reprochés
remplacer le mot :
ou
par le mot :
et
La parole est à M. le rapporteur.

Je présenterai en même temps les amendements n° 24, 25 et 26.
L'amendement n° 24 est un amendement de clarification rédactionnelle.
L'amendement n° 25 est un amendement d'harmonisation rédactionnelle par rapport à l'article 131-36-2 du code pénal.
L'amendement n° 26 vise à préciser l'une des interdictions à laquelle peut être soumise une personne reconnue irresponsable pénalement, celle d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Il s'agit d'indiquer, sur le modèle de l'interdiction prévue par un autre article du code pénal, l'article 131-36-2, relatif au suivi socio-judiciaire, que l'interdiction peut aussi viser toute activité au contact de mineurs.

L'amendement n° 57, présenté par MM. Badinter, Collombat, Frimat, C. Gautier, Mermaz, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le 3° du texte proposé par cet article pour l'article 706-125 du code de procédure pénale, remplacer le mot :
correctionnel
par le mot :
civil
La parole est à M. Robert Badinter.

Cet amendement tend à améliorer la procédure instaurée ainsi que la condition des victimes.
Une fois intervenue la décision de la chambre d'instruction de prononcer l'irresponsabilité pénale se pose la question de la réparation des dommages causés aux victimes, que la loi permet et que la pratique doit favoriser. Or, dans le texte qui nous est soumis, il est prévu de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel pour arbitrer les dommages-intérêts. Cette procédure est singulière, dans la mesure où les juridictions pénales ne peuvent plus être saisies de l'infraction.
Autant la logique commande, dans la foulée du débat, lorsqu'une juridiction pénale s'est prononcée sur les faits, que cette juridiction, connaissant ceux-ci, statue sur les dommages-intérêts, autant cette logique disparaît en matière de dommages-intérêts civils, dès lors qu'il n'y a plus de compétence de la juridiction pénale. Il faut alors se rendre devant le tribunal civil, et plus exactement devant la chambre civile spécialisée dans les problèmes de responsabilité civile.
Puisqu'il faut aller devant une juridiction, il convient de choisir la plus compétente en la matière, c'est-à-dire au premier chef la juridiction civile, et non le tribunal correctionnel, qui n'aura pas connu de l'affaire. J'ajoute que la juridiction civile se montre à la fois plus cohérente et souvent plus généreuse envers les victimes.

L'amendement n° 25, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article 706-135 du code de procédure pénale, remplacer le mot :
sociale
par le mot :
bénévole
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 26, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour l'article 706-135 du code de procédure pénale, après les mots :
a été commise
insérer les mots :
ou impliquant un contact habituel avec les mineurs,
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 74, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 706-138 du code de procédure pénale.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Cet amendement n'a pour objet que de signaler l'incohérence consistant à prévoir des sanctions pénales à l'encontre d'une personne déclarée irresponsable pénalement.
Les mesures de sûreté susceptibles d'être prononcées à l'encontre de cette personne sont déjà suffisamment source de confusion et d'ambiguïté ; elles ne sont pas véritablement la conséquence d'un procès pénal et ne correspondent pas non plus à des mesures qui pourraient être prescrites à tout malade dans le respect de ses droits.
Prévoir, comme vous le faites, d'inscrire la personne malade mentale dans une procédure judiciaire, avec un jugement en audience publique et la possibilité de prononcer des mesures de sûreté assorties de sanctions pénales en cas de non-respect de ces mesures, ne fait que renforcer l'assimilation de ce malade à un criminel responsable.
C'est, d'ailleurs, sur cette assimilation entre maladie mentale et délinquance que s'appuie ce projet de loi. Or le traitement de la maladie mentale ne peut et ne doit pas se confondre avec la prévention de la délinquance. Ce traitement relève de la santé publique et non de l'ordre public. Confondre les deux aboutit à une incohérence, comme celle consistant à sanctionner pénalement une personne déclarée irresponsable pénale en cas de non-respect d'une mesure de sûreté.
C'est pourquoi nous demandons la suppression du texte proposé par cet article pour l'article 706-138 du code de procédure pénale.

L'avis de la commission est défavorable sur les amendements de suppression n° 55 et 73. Lors des auditions que nous avons menées, tant les associations de victimes que les associations de familles de patients en psychiatrie se sont montrées assez favorables aux nouvelles dispositions prévues dans le projet de loi.
L'amendement n° 57 a largement retenu l'attention de la commission des lois. La possibilité de donner au tribunal correctionnel la compétence de statuer sur les intérêts civils répond d'abord au souci de simplifier la procédure pour les victimes. Cependant, le caractère inédit de cette disposition doit être relativisé, puisque cette juridiction peut actuellement, même en cas de relaxe, statuer sur les dommages-intérêts concernant les infractions non intentionnelles.
On ne voit pas, enfin, pourquoi serait interdit au tribunal correctionnel ce qui est autorisé à la cour d'assises qui, lorsqu'elle acquitte un accusé déclaré irresponsable en raison d'un trouble mental, statue, en application de l'article 371 du code de procédure pénale, sans l'assistance du jury, sur les demandes de dommages-intérêts formées par la partie civile.
Plusieurs des membres de la commission ont cependant estimé qu'il incombait à une juridiction civile de se prononcer sur les intérêts civils et ont donc approuvé l'amendement que vient de défendre M. Badinter.
C'est la raison pour laquelle la commission souhaite connaître sur ce point l'avis du Gouvernement.
En ce qui concerne l'amendement n° 74, Mme Borvo Cohen-Seat a raison de dire que la disposition qu'il vise à supprimer présente un caractère paradoxal. En effet, par mesure de sûreté, on va éventuellement condamner à 30 000 euros d'amende et à deux ans d'emprisonnement des personnes qui ont été déclarées pénalement irresponsables pour cause de trouble mental.
Cependant, une lecture plus approfondie du texte fait apparaître que le paradoxe n'est qu'apparent : le projet de loi lui-même prévoit que les sanctions ne sont possibles que sous réserve du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal. Elles ne seraient donc pas applicables si la personne manque aux obligations qui lui sont fixées alors que son discernement est aboli.
L'hypothèse visée est celle où la personne ayant retrouvé toute sa raison après une crise passagère, les sanctions pourraient éventuellement lui être appliquées.
L'avis de la commission est donc défavorable.
Je commencerai par l'amendement n° 55, qui vise à supprimer l'article 3 prévoyant une procédure nouvelle d'irresponsabilité pénale.
Avec cet article, nous avons voulu clarifier, pour les personnes concernées, notamment les victimes, le sens d'une décision de non-lieu. Pendant longtemps, les parties civiles recevaient par courrier ou notification une décision de non-lieu sans explication. Pour certaines victimes, et même pour l'auteur lui-même, d'ailleurs, un non-lieu, c'est un non-lieu à poursuivre. Dès lors, il peut s'ensuivre une confusion.
M. Badinter manifeste son désaccord.
Monsieur Badinter, pensez à ceux qui ne sont pas aussi fins juristes que vous ! Certains imaginent que le non-lieu à poursuivre revient à dire que les faits n'ont pas existé. C'est aussi la vocation de la justice et du droit d'expliquer, à l'intention des personnes concernées, auteurs et parties civiles, que le non-lieu à poursuivre est une décision d'irresponsabilité pénale pour trouble mental.
Le Gouvernement est donc défavorable aux amendements identiques n° 55 et 73.
Il est favorable aux amendements n° 22, 23 et 24, qui améliorent la rédaction du texte.
L'amendement n° 57 tend à supprimer une disposition critiquée par M. Badinter, pourtant très importante pour les victimes en ce qu'elle simplifie considérablement leurs démarches.
En vertu de l'article 498-2 du code civil, la personne reconnue pénalement irresponsable doit réparer civilement les conséquences de son acte.
Si la partie civile en fait la demande, la chambre de l'instruction renverra l'affaire devant le tribunal correctionnel, éventuellement formé d'un juge unique, pour qu'il statue sur son dédommagement. Tel est déjà le cas aujourd'hui.
Monsieur Badinter, vous voulez substituer à cette compétence donnée au tribunal correctionnel celle d'une juridiction civile. Vous le savez parfaitement, il est traditionnel qu'une juridiction pénale se prononce sur les demandes de dommages et intérêts, même en l'absence de condamnation pénale.
Bien sûr que si ! D'ailleurs, la cour d'assises statuant en formation réduite à trois magistrats professionnels peut accorder des dommages et intérêts, même en cas d'acquittement.

Mon amendement concerne le cas où il n'y a pas de juridiction pénale compétente. La chambre de l'instruction ne peut donc pas la saisir !
Non, mais la chambre de l'instruction renvoie à une juridiction correctionnelle, comme dans le cadre de la cour d'assises. C'est ce que prévoit l'article 470-1 pour le tribunal correctionnel !
Faut-il vous rappeler, monsieur Badinter, que c'est vous, alors garde des sceaux, qui, à l'origine, avez défendu cette disposition lors du vote de la loi du 8 juillet 1983 consacrée au renforcement de la protection des victimes d'infractions pénales ? Vous vous contredisez donc quelques années après ! Vous admettrez que rien ne justifie que nous abandonnions en 2008 les objectifs légitimes que vous avez défendus en 1983 ?
M. Badinter proteste.
Les objectifs sont exactement les mêmes ! Nous avons eu hier un débat analogue au sujet de l'hospitalisation psychiatrique d'office. Je vous ai transmis les dispositions y afférentes, que vous n'avez pas commentées. Acceptez que d'autres aient parfois raison !

La parole est à M. Robert Badinter, avec l'autorisation de Mme le garde des sceaux.

Madame le garde des sceaux, puisque je n'ai pas l'avantage, n'étant plus garde des sceaux, de pouvoir à volonté prendre la parole, vous trouverez dans votre courrier une consultation en date du 8 janvier qui vous éclairera sur la distinction que vous semblez omettre, pour je ne sais quelle raison, entre ce que l'on appelle la dangerosité psychiatrique, qui relève des juridictions administratives, et la dangerosité criminologique, objet de nos discussions ; ces deux notions ne sont pas identiques.
Mon amendement visait évidemment le cas où la cour d'assises n'est pas saisie, l'irresponsabilité pénale ayant été constatée. La chambre de l'instruction doit saisir la juridiction civile, qui a pleine compétence. Bien entendu, si la juridiction pénale se prononce sur l'irresponsabilité, elle statue sur les intérêts civils. Mais si la décision est prise au niveau de la chambre de l'instruction, aucune juridiction ne sera saisie. C'est une question non pas de principe, mais de commodité.
La chambre de l'instruction renvoie à la juridiction !

Puisque vous avez mentionné ce que j'ai fait en 1983, force m'est de rappeler que je ne m'en suis pas tenu à cela. Dès l'instant où l'on essaie de rappeler des principes juridiques, l'on vous renvoie aux victimes virtuelles, ce qui vous contraint à revenir sur tout ce que l'on a fait pour elles.
Madame le garde des sceaux, le malheur des victimes, je l'ai vu toute ma vie ! Et je l'ai vu non pas dans les journaux ou à la télévision, mais dans mes bureaux, dans les cabinets des juges d'instruction et en cour d'assises ! La douleur et le malheur des victimes, je les connais !
Quand j'exerçais les responsabilités qui sont aujourd'hui les vôtres, j'ai fait progresser, avec les excellents collaborateurs de la Chancellerie, le droit des victimes pour le porter au niveau le plus élevé en Europe, celui de la Suède.
Je terminerai en disant que la seule loi qui porte mon nom dans les revues juridiques, c'est, vous le savez, la loi en faveur des victimes, et pas une autre !
Monsieur. Badinter, nous n'avons jamais remis en cause ce que vous avez pu faire !
Hier, vous avez dit que l'hospitalisation d'office était limitée au quantum de la peine. Non, l'hospitalisation d'office est maintenue tant que les psychiatres considèrent que la dangerosité psychiatrique de l'intéressé subsiste, au-delà de la peine. Acceptez, monsieur le sénateur, que vous puissiez aussi, parfois, vous tromper !
J'en viens à l'amendement n° 74. Le Gouvernement y est défavorable, car il faut tirer toutes les conséquences de l'infraction commise, même si la personne est déclarée irresponsable.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 3 est adopté.
I. - La première phrase de l'article 167-1 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167, le cas échéant en présence de l'expert ou des experts. En matière criminelle, cette présence est obligatoire si l'avocat de la partie civile le demande. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 177 du même code, les mots : « le premier alinéa de l'article 122-1, » sont supprimés.
III. - L'article 199-1 du même code est abrogé.
IV. - L'article 361-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il est fait application des articles 706-129 et suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
V. - Après l'article 470-1 du même code, il est inséré un article 470-2 ainsi rédigé :
« Art. 470-2. - Le tribunal correctionnel ne peut relaxer le prévenu en raison d'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal qu'après avoir constaté que celui-ci avait commis les faits qui lui étaient reprochés.
« Dans le cas où il estime qu'est applicable le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il statue conformément à l'article 706-133 relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
V bis. - Le 4° de l'article 706-53-2 du même code est ainsi rédigé :
« 4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; ».
V ter. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 706-113 du même code, après les mots : « d'acquittement », sont insérés les mots : «, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ».
VI. - L'article 768 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
VII. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 769 du même code, après les mots : « des condamnations », sont insérés les mots : « ou des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».
VIII. - Après le 15° de l'article 775 du même code, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les décisions de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, sauf si ont été prononcées des interdictions prévues par l'article 706-135 du présent code tant que ces interdictions n'ont pas cessé leurs effets. »

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 56 est présenté par MM. Badinter, Collombat, Frimat, C. Gautier, Mermaz, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 75 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 56.

Par coordination avec notre amendement tendant à supprimer l'article 3 relatif à l'irresponsabilité pénale, nous demandons la suppression de l'article 4.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour défendre l'amendement n° 75.

L'article 4 nous pose deux types de problèmes.
D'une part, il procède à des coordinations correspondant à la nouvelle procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Opposés à cette nouvelle procédure, nous demandons la suppression de cet article.
D'autre part, cet article 4 prévoit que la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental pourra être inscrite au casier judiciaire, alors qu'elle ne constitue pas une condamnation de justice Une telle inscription porte en elle-même atteinte à la conception que l'on peut avoir du casier judiciaire.
En outre, l'insertion de données à caractère personnel mentionnées dans la déclaration d'irresponsabilité est un traitement informatisé sans lien avec l'objet du casier judiciaire.
Par conséquent, l'inscription de la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental constitue un détournement de la fonction initiale du casier judiciaire. Celui-ci, qui ne doit contenir que les condamnations pénales ou commerciales, ne saurait servir à ficher les irresponsables pénaux.
Cette volonté de les ficher n'est pas nouvelle. Je vous rappelle que le Sénat avait dû déjà rejeter, en décembre 2005, lors des débats sur la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, un article introduit par les députés tendant à inscrire les irresponsables pénaux dans le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles.
Aujourd'hui, une nouvelle tentative de fichage nous est proposée, et, cette fois, par le biais du casier judiciaire. Nous l'avons bien vu lors de l'examen de l'article 3, la procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est loin d'offrir toutes les garanties du jugement pénal. Or cette déclaration figurera au casier judiciaire. C'est une option que nous ne pouvons retenir.

L'amendement n° 58, présenté par MM. Badinter, Collombat, Frimat, C. Gautier, Mermaz, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer les VI, VII et VIII de cet article.
La parole est à M. Richard Yung.

Finalement abandonné lors de l'adoption de la loi relative à la prévention de la délinquance, le fichage des personnes atteintes de troubles mentaux est réintroduit dans ce texte.
Ces mesures ont notamment pour objet d'accorder aux juridictions la possibilité de prononcer des jugements et arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, et non plus uniquement une ordonnance de non-lieu, un acquittement ou une relaxe.
Pour compléter cette réforme, le projet de loi prévoit que les décisions reconnaissant l'irresponsabilité pénale seront désormais inscrites au casier judiciaire.
Cela pose un certain nombre de problèmes lourds, notamment de principe, en particulier la question de la légitimité et de la proportionnalité de ce traitement au regard des garanties accordées à toute personne au titre de la loi Informatique et libertés.
Le ministère de la justice ne peut en principe collecter que les données à caractère personnel en lien avec des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté déjà prononcées.
Il est difficile, à cet égard, de considérer qu'une déclaration d'irresponsabilité pénale entre dans l'une ou l'autre de ces catégories de données. Sans vouloir la qualifier au regard du droit pénal, l'examen du présent projet de loi invite à penser que cette déclaration de justice ne porte ni sur l'infraction ni sur la condamnation ; elle s'en écarte.
Par ailleurs, la déclaration d'irresponsabilité pénale ne semble pas non plus pouvoir être confondue avec une mesure de sûreté, point dont nous avons déjà débattu et sur lequel je ne reviens pas.
Pour toutes ces raisons, il nous paraît inopportun d'inscrire les déclarations d'irresponsabilité au casier judiciaire.

La commission est défavorable aux amendements identiques n° 56 et 75.
L'inscription au casier judiciaire des déclarations d'irresponsabilité pénale est encadrée. Ces déclarations ne figurent qu'au bulletin n° 1, qui est consultable par les seules autorités judiciaires. Ce n'est que lorsqu'elles sont assorties de mesures de sûreté qu'elles figurent au bulletin n° 2 et peuvent, à ce titre, être communiquées à certaines autorités administratives pour des motifs limitativement énumérés, tels que l'accès à un emploi public ou à certaines professions.
En outre, cette inscription a un précédent, Mme Borvo Cohen-Seat le rappelait, puisque les décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondées sur l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental sont inscrites au FIJAIS, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, en application de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale.
Il apparaît a fortiori assez logique que les déclarations figurent dans le casier judiciaire.
C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à la suppression des VI, VII et VIII de l'article 4, donc à l'amendement n° 58.
Cependant, je partage en partie la lecture de notre collègue Richard Yung sur un point à propos duquel je souhaite interroger Mme le garde des sceaux, car il me paraît soulever une petite difficulté - peut-être sera-t-il possible d'y remédier, si nécessaire, d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire - ; je veux parler de l'encadrement très strict des pouvoirs du juge.
En effet, l'inscription au bulletin n° 1 est automatique et l'inscription au bulletin n° 2 l'est également dès lors que des mesures de sûreté ont été prononcées. Or une partie de la doctrine considère qu'il serait utile, pour garantir le caractère proportionné du traitement des données, que les juges disposent d'un pouvoir de modulation des conditions d'inscription au casier judiciaire, afin, notamment, qu'ils puissent traiter différemment une personne atteinte d'un trouble mental qui aurait commis une simple dégradation de biens par rapport à une personne qui aurait commis un crime tel qu'un homicide.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements de coordination n° 56 et 73.
Il est également défavorable à l'amendement n° 58, car il est important de conserver la mémoire de la déclaration d'irresponsabilité pénale.
En cas de crime ou de délit, les faits doivent pouvoir être mentionnés dans le casier judiciaire même lorsque l'auteur a été déclaré irresponsable et qu'aucune condamnation n'a été prononcée ; c'est déjà le cas.
Les personnes atteintes de trouble mental ayant commis des faits graves peuvent en commettre à nouveau, éventuellement des années plus tard, et il faut pouvoir accéder au casier judiciaire pour avoir connaissance de ces faits, notamment au moment du placement en garde à vue.
S'agissant de l'inscription au bulletin n° 1 ou au bulletin n° 2 du casier judiciaire, je partage votre avis, monsieur le rapporteur.
Cependant, le code pénal prévoit que la dispense d'inscription au bulletin n° 2 peut être demandée lors de l'audience ; on peut rappeler que cette disposition est applicable. Mais il est important de garder la traçabilité non seulement des faits, mais aussi des mesures de sûreté, notamment l'interdiction de détenir une arme ou de fréquenter certains endroits.
Cela vaut aussi pour les concours administratifs, par exemple pour éviter le recrutement comme éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse d'une personne qui aurait commis des actes graves, mais qui aurait été déclarée irresponsable pénalement.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 4 est adopté.
I. - L'intitulé de la section 9 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Détenus et personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté ».
II. - Après l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté
« Art. L. 381-31-1. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. » -
Adopté.
Après le 11° du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Les interdictions prononcées en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ; ». -
Adopté.
À compter du 1er janvier 2009, la référence à l'article 489-2 du code civil mentionnée aux articles 706-125, 706-131 et 706-133 du code de procédure pénale résultant respectivement des articles 3 et 4 de la présente loi est remplacée par la référence à l'article 414-3 du code civil. -
Adopté.
L'article 706-53-7 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les présidents des conseils généraux et les maires peuvent également consulter le fichier, par l'intermédiaire des préfets, pour l'examen des demandes d'emploi ou d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions. »

Madame le garde des sceaux, mes chers collègues, je vais vous lire un extrait de l'intervention de M. Pascal Clément, alors garde des sceaux, inaugurant le 8 juillet 2005 le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles : « [...] pour que la justice soit efficace, elle se doit d'être fidèle à ses valeurs. Elle doit en particulier garantir le respect de la vie privée.
« [...] ce nouveau fichier est conforme à nos principes. Il nous permettra de mieux assurer la sécurité des Français et il nous permettra de garder ces informations confidentielles.
« Ce fichier est, en effet, exclusivement destiné aux professionnels en charge de la prévention et de la répression de la délinquance sexuelle.
« Il concerne donc les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire et les préfets. La liste des autres administrations de l'État autorisées par la loi à consulter le FIJAIS fera l'objet d'un décret complémentaire au terme de travaux interministériels. »
Or l'article 12 bis vise à étendre la liste des personnes habilitées à consulter le fichier aux présidents de conseils généraux et aux maires, autrement dit aux administrations territoriales. Dois-je en conclure que ce qui était présenté par le garde des sceaux en 2005 comme une garantie de respect de nos principes ne l'est plus moins de trois ans plus tard ou que cet article ne respecte pas nos principes ?
Le FIJAIS a été créé par la loi du 9 mars 2004, loi dont les modalités d'application ont été fixées par un décret du 30 mai 2005 pris après avis de la CNIL, peu de temps après la mise en place de celle-ci.
La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a étendu substantiellement son contenu et sa finalité.
La CNIL, relevant que les préfets et certaines administrations de l'État pourraient utiliser le fichier pour contrôler l'exercice des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs, soulignait alors qu'il n'était pas précisé si ce contrôle concernait uniquement les activités soumises à agrément ou si l'extension concernait l'exercice de l'ensemble des professions impliquant un contact avec des mineurs.
Le fichier est ainsi profondément modifié avant qu'un bilan ait pu être tiré de sa première version et sans que la CNIL ait pu se prononcer sur les modifications envisagées.
Or, je ne vois pas dans l'article 12 bis tel qu'il nous est proposé une quelconque prise en compte des inquiétudes de la CNIL.
Je constate en revanche qu'une fois de plus on nous demande d'accroître le nombre de personnes habilitées à consulter un fichier, en tentant de nous faire croire que cela va régler tous les problèmes. Or nous savons tous que cette multiplication permanente des fichiers et des personnes pouvant les consulter n'a absolument rien réglé.
J'ajoute que, pour ceux qui emploient des personnes susceptibles d'avoir des contacts avec les enfants, la formule est à l'évidence inopérante : y compris en matière de service public, du fait des délégations de service public, dans beaucoup de cas, ce ne sont pas les maires qui emploient directement ces personnes.
S'il s'agissait de permettre à tous les employeurs de consulter le fichier, ce serait un autre problème. Là, on adopte une solution bancale qui, à mon avis, ne résoudra pas le problème censé devoir être résolu, mais qui va en revanche multiplier encore le nombre de personnes habilitées à consulter le fichier.
C'est la raison pour laquelle je souhaiterais, madame le garde des sceaux, que vous nous donniez l'avis de la CNIL, si vous l'avez.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 60, présenté par MM. Badinter, Collombat, Frimat, C. Gautier, Mermaz, Peyronnet, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Richard Yung.

Je serai bref, Mme Borvo Cohen-Seat ayant exprimé nombre de nos préoccupations, la principale étant évidemment l'extension considérable du nombre de personnes ayant accès aux fichiers, ne serait-ce que parce que, comme chacun sait, le nombre des maires en France est de l'ordre de 36 000.
Jusqu'à ce jour, c'était l'autorité d'État - sous ses différentes formes, police ou justice - qui pouvait interroger le fichier, ce qui, au fond, constituait une garantie quant à la nature même de ceux qui étaient habilités à le faire ; là, on franchit un pas de plus, puisque l'accès au fichier est étendu aux élus, que, certes, nous respectons tous, mais il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une extension considérable.
On peut d'ailleurs se demander si ne devraient pas être également concernés d'autres catégories d'élus, au-delà des présidents de conseils généraux et des maires, et d'autres cas que celui de personnes travaillant avec les enfants.
Il y a donc là tous les éléments d'une augmentation considérable de l'accès au fichier, qui mérite réflexion et impose que la CNIL soit saisie pour avis. Pour l'heure, en tout cas, nous ne sommes pas favorables à cette proposition.

L'amendement n° 79 rectifié bis, présenté par MM. Portelli, del Picchia et Béteille, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 706-53-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa (3°), les mots : « pour l'examen des demandes d'agrément » sont remplacés par les mots : « pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation » ;
2° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « par la demande d'agrément » sont remplacés par les mots : « par la décision administrative » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les maires sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions. »
La parole est à M. Robert del Picchia.

L'article 12 bis a été ajouté par l'Assemblée nationale afin de permettre que les collectivités territoriales aient accès au FIJIAIS par l'intermédiaire des préfets, pour contrôler les personnes dont l'activité ou le travail implique un contact avec des mineurs, comme c'est le cas pour les administrations de l'État.
Il convient toutefois de revoir la rédaction de cet article afin de mettre en évidence que l'accès au fichier, tant pour les administrations de l'État que pour les collectivités territoriales, est non pas limité aux demandes d'agrément, mais concerne toutes les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation.
C'est en effet principalement pour le recrutement de personnels travaillant dans les écoles ou les collèges, comme divers cas malheureux l'ont démontré au cours des dernières années, que les maires doivent pouvoir consulter le fichier.
Par ailleurs, il convient de mieux respecter les rédactions traditionnellement retenues par le Conseil d'État et la CNIL pour définir les destinataires d'un fichier lorsque ceux-ci reçoivent des données sans pour autant accéder directement, bien sûr, à l'application informatique, ce qui sera le cas des collectivités territoriales, qui devront interroger les préfets pour connaître les données enregistrées dans le FIJAIS.

Sur l'amendement de suppression n° 60, la commission émet un avis défavorable, car elle estime que la possibilité pour les autorités territoriales, les maires notamment, mais peut-être aussi les présidents de conseils généraux et les présidents de conseils régionaux, d'accéder à des fichiers qui leur permettent de vérifier les données relatives aux collaborateurs dont ils s'entourent et à qui ils confieront des fonctions les mettant en contact avec des enfants, par exemple dans les écoles maternelles, les centres aérés ou les centres de loisirs, est utile.
Nombre de faits divers démontrent que des personnes ont pu travailler dans de tels lieux - Michel Fourniret, par exemple - sans que les maires ne sachent quel était leur passé pénal.
En revanche, la commission est favorable à l'amendement n° 79 rectifié bis.
Il lui semblerait toutefois souhaitable que les présidents de conseils généraux et de conseils régionaux soient mentionnés, en plus des maires, au nombre des destinataires des informations ; Mme la ministre voudra peut-être donner son avis sur l'opportunité d'une telle modification.

L'amendement n° 79 rectifié bis vise les maires. Nous considérions, en effet, que si les personnels des écoles entraient naturellement dans ce dispositif, ceux des collèges et des lycées, eux, relevaient de l'éducation nationale, et qu'il n'y avait donc aucune raison de mentionner les présidents de conseils généraux et de conseils régionaux dans ce texte.
Toutefois, des transferts de compétence sont intervenus. J'aurais dû y penser, moi qui ai conseillé de mentionner seulement les maires ; je fais amende honorable !
Sourires

Désormais, les présidents de conseils généraux gèrent les personnels ATOSS, c'est-à-dire administratifs, techniciens, ouvriers et de service, notamment, et il en va de même pour les présidents de conseils régionaux. Nous pourrions même considérer, à la limite, que les présidents de conseils généraux gèrent une autre catégorie de personnel qui est en contact permanent avec les enfants, à savoir les assistantes maternelles.
Il faut donc mentionner dans le texte de cet amendement non seulement les maires, mais aussi les présidents de conseils généraux et les présidents de conseils régionaux. Telle est la rectification que nous proposons.

Je suis donc saisi d'un amendement n° 79 rectifié ter, présenté par MM. Portelli, del Picchia et Béteille, et ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 706-53-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa (3°), les mots : « pour l'examen des demandes d'agrément » sont remplacés par les mots : « pour les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation » ;
2° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « par la demande d'agrément » sont remplacés par les mots : « par la décision administrative » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les maires, les présidents de conseil général et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions. »
Quel est l'avis du Gouvernement ?
En ce qui concerne l'amendement n° 60, le Gouvernement émet un avis défavorable, pour les raisons qui ont été énoncées par M. le rapporteur.
S'agissant de l'amendement n° 79 rectifié ter, le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 61, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 2-19 du code de procédure pénale, après les mots : « d'outrages, », sont insérés les mots : « de diffamations, ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 62, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ou lorsque les victimes sont des fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les élus du suffrage universel ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les conditions d'application de la présente loi font l'objet d'un rapport du Gouvernement au Parlement, remis au plus tard le 1er septembre 2009. -
Adopté.

L'amendement n° 30, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 12 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
La parole est à M. le rapporteur.

Compte tenu du caractère particulièrement novateur de la rétention de sûreté, il paraît essentiel de permettre une évaluation complète des dispositions de la loi, en vue d'éventuels ajustements.
C'est pourquoi cet amendement prévoit que la présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
Cette demande est légitime. Le Gouvernement émet donc un avis tout à fait favorable.

Je voterai, bien sûr, cet article additionnel. Toutefois, nous serions bien avisés de mentionner que l'évaluation aura lieu « avant toute nouvelle législation pénale ».
En effet, il y a fort à parier qu'avant cinq ans nous serons saisis d'un nouveau texte. Nous ferions donc bien de nous garder de cette éventualité et d'être prévoyants dans notre travail législatif, d'autant que j'ai entendu nombre de sénateurs, de toutes tendances, affirmer qu'avant d'adopter une loi nouvelle il fallait évaluer les précédentes.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12 ter.
I. - Les articles 1er à 4, 6, 9 et 11 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - La présente loi est applicable à Mayotte.

L'amendement n° 31, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Après les mots :
en Polynésie française
rédiger comme suit la fin du I de cet article :
et en Nouvelle-Calédonie.
II. Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement tend à supprimer les mentions expresses d'application de la loi à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les TAAF, puisque ces deux collectivités sont soumises depuis le 1er janvier 2008 à un nouveau régime d'application des lois et règlements : à Mayotte, les lois s'appliquent directement en matière pénale ou de santé ; dans les TAAF, les lois pénales s'appliquent de plein droit.
L'amendement est adopté.
L'article 13 est adopté.

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis 2002, les textes sécuritaires n'ont cessé de s'accumuler, dans un sens toujours plus répressif, et alors que se posent à nous deux problèmes, qui d'ailleurs n'en font qu'un : d'une part, les moyens de la justice, qu'ils soient techniques ou humains, sont insuffisants ; d'autre part, notre conception de la détention est archaïque et insatisfaisante.
De façon générale, il est regrettable que nous légiférions une fois encore dans l'urgence, avant même d'avoir évalué les dispositifs précédents, puisque c'est d'évaluation qu'il était question avec l'amendement n° 30.
Cette logique peut malheureusement provoquer toutes les dérives. L'enfermement, après l'exécution de leur peine, et pour une durée indéfinie - de préférence à vie, diront certains ! - de personnes qui, certes, sont particulièrement dangereuses, mais pour lesquelles, après qu'elles ont commis un crime, on ne cherche aucune solution de rechange à la détention, ce n'est ni plus ni moins qu'un substitut à la peine de mort. Nous ne pouvons donc approuver cette mesure.
Ce projet de loi procède d'une philosophie contraire à notre État de droit, puisqu'il s'agit d'enfermer une personne qui aura purgé sa peine, non parce qu'elle aura récidivé, mais parce qu'elle sera susceptible de commettre une nouvelle infraction.
Madame la ministre, au cours de ces débats, vous n'avez cessé de répéter que la rétention de sûreté n'était pas attentatoire aux droits fondamentaux des personnes puisque l'hospitalisation d'office permettait déjà d'enfermer une personne contre son gré en raison du danger qu'elle pourrait constituer pour elle-même ou pour autrui.
Toutefois, vous oubliez que cette mesure est administrative et non judiciaire. En outre, dans ces conditions, pourquoi créer la rétention de sûreté ? Je le répète, nous disposons déjà d'un certain nombre de moyens, dont l'hospitalisation d'office.
Le législateur doit bien considérer ses actes. Pour cela, il peut s'appuyer sur des exemples étrangers intéressants. Vous souhaitez toujours aligner notre droit sur celui des autres pays comparables, notamment des pays européens, avec lesquels nous sommes engagés dans une destinée et une loi communes. Pourtant, quand il s'agit de prendre des mesures qui vont à l'encontre de la philosophie qui anime votre gouvernement, vous cessez de vous inspirer des exemples étrangers. C'est révélateur, mais tout à fait regrettable. Vous préférez créer une justice vengeresse, parce que c'est davantage payant politiquement dans certaines catégories de la population, semble-t-il.
Par ailleurs, le concept de dangerosité n'a pas fait l'objet en France d'un travail de définition sérieux. Nous l'avons vu, ni le Gouvernement ni les parlementaires de la majorité, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ne parvenaient à s'expliquer lorsqu'il fallait distinguer la dangerosité d'un criminel ayant tué une victime mineure de celle d'un criminel ayant tué une victime majeure. La dangerosité est une notion très complexe.
De surcroît, nous ne sommes pas aidés par les déclarations à l'emporte-pièce émises par le Président de la République, alors qu'il était candidat, sur le caractère génético-hormonal du suicide ou des déviances sexuelles.
L'appréciation de la dangerosité est susceptible de varier dans le temps, en fonction des époques et du contexte. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer à quel point le champ d'application du présent projet de loi s'est élargi entre le 8 janvier dernier, date du début de son examen par les députés, et aujourd'hui : alors qu'il visait au départ les criminels ayant commis des infractions graves sur des mineurs de quinze ans et qu'il n'était pas rétroactif, ce texte sera désormais applicable à presque tous les criminels et rétroactif.
Notre inquiétude est donc légitime quant à d'éventuels futurs élargissements du champ d'application de ce texte. Ce ne serait pas la première fois que le Gouvernement étendrait une législation répressive au fur et à mesure des textes, comme on l'a vu en matière de terrorisme ou de fichage.
Madame la ministre, vous avez pris la responsabilité d'établir une comparaison avec le terrorisme et les événements du 11 septembre 2001. Je me permets de vous rappeler que si ces actes ont justifié notre coopération judiciaire avec les États-Unis, ils ne légitiment en rien Guantanamo ! J'y insiste, car il s'agit d'un problème grave. Le législateur doit réfléchir à ces questions ; donc, efforçons-nous de le faire !
Décréter que la prise en charge des criminels dangereux ne peut intervenir qu'après quinze ou vingt ans de prison revient à admettre que la détention est un temps inutile pour certaines catégories de personnes. C'est peut-être le cas, mais il faut alors en tirer toutes les conséquences sur notre conception de la peine et de la détention, ce que nous ne faisons pas, hélas ! Surtout, cette mesure contredit vos politiques tendant à durcir les peines, qui sont toujours motivées par la lutte contre la récidive.
Certes, nous partageons ce souci ; à cet égard, accuser ceux qui ne sont pas d'accord avec vous de ne pas vouloir lutter contre la récidive est facile, mais ne participe pas d'une saine conception du débat. Toutefois, vous vous contredisez, car vous ne prenez pas le problème dans le bon sens.
Je rappellerai simplement que l'une des missions de l'administration pénitentiaire est la réinsertion des condamnés. Comment remplir au mieux cette mission si la personne concernée sait qu'elle risque d'être enfermée, après sa détention, pour une durée sans cesse renouvelée, si elle est inaccessible à la prison, à la sanction, et même aux coups de bâtons ? Dans ces conditions, comment considérer que la détention peut apporter une solution ?
On est en pleine contradiction ! Avec cette logique d'enfermement, si les présupposés sont justes, c'est une véritable relégation sociale qui est ici proposée. Le bagne existait, on en est revenu. Il est donc regrettable qu'on en soit là aujourd'hui !
Le deuxième volet du projet de loi, consacré à l'irresponsabilité pénale, est très lié au précédent : là encore, on multiplie les confusions.
En la matière, les Néerlandais, par exemple, qui font preuve de davantage de pragmatisme, qui ont mené une réflexion plus approfondie sur la détention et qui consacrent des moyens plus importants à leur justice sont plus proches de la réalité, me semble-t-il. Ils traitent les personnes qui ne sont pas irresponsables pénalement, mais dont les capacités de réflexion ou de compréhension sont altérées, comme des personnes qui ont besoin d'être prises en charge médicalement, psychologiquement, y compris, le cas échéant, en étant enfermées. Nous, nous multiplions les confusions et nous aboutissons à un dispositif qui est totalement hybride, mais aussi dangereux, car il peut concerner des gens qui ne méritent pas de subir un tel traitement.
En outre, des principes élémentaires de notre droit sont violés. Remettre en cause des principes constitutionnels qui fondent notre démocratie et des principes fondamentaux reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne semble pas poser de problèmes à certains de nos collègues. C'est dommage !
Pourquoi ne pas abolir la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen et renoncer officiellement à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au nom de la sécurité de la société ?
Je le répète, puisque vous semblez apprécier les comparaisons : pour renoncer aux droits des personnes, les Américains créent des centres de détention en dehors de leur territoire. Nous pourrions faire de même ! Le bagne n'était rien d'autre que cela : nous pourrions y revenir !
Nous ne pouvons nous associer à un tel dispositif. C'est pourquoi le groupe CRC votera résolument contre ce projet de loi.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je commencerai par saluer le travail de M. Lecerf et le courage dont il a fait preuve dans sa tentative, soigneusement avortée, d'apporter à ce texte les garde-fous juridiques nécessaires à sa mise en oeuvre.
L'intention du Gouvernement me paraît simple : ne rien céder et faire peser sur le Conseil constitutionnel la responsabilité de « retoquer » ce texte largement anticonstitutionnel.
De ce point de vue, madame la ministre, l'épisode de la rétroactivité a été symptomatique : vous avez laissé les députés décider de la rétroactivité, puis vous avez largement soutenu cette démarche, tout en précisant que vous n'en étiez pas l'initiatrice.
M. le rapporteur, dans sa sagesse, a tenté de trouver un moyen d'éviter que ne soit violé le principe fondamental de non-rétroactivité d'une loi pénale. Vous ne l'avez pas soutenu. Pis, vous avez émis un avis favorable sur un amendement de substitution déposé par M. Portelli, qui visait à rétablir ce système en l'édulcorant.
À quoi bon prétendre que la rétroactivité ne s'appliquera qu'à titre exceptionnel, puisque nous savons qu'aucun juge ne prendra le risque de ne pas y recourir ? C'est un piège à responsabilité que votre système met en place : de la même manière qu'aucun juge n'ose user de son pouvoir d'individualisation de la peine quand il s'agit de prononcer des peines planchers, aucun juge ne s'amusera à recourir à un autre dispositif que celui de la rétention de sûreté instauré par ce projet de loi à titre rétroactif.
Ce texte est une honte pour notre système pénal. Pour vous, la dangerosité équivaut désormais à la culpabilité. Vous balayez d'un revers de main des principes pourtant fondamentaux dans notre État de droit.
J'entends encore M. Portelli dire que l'État a un devoir de protection sociale à l'égard de tous les citoyens. La défense sociale est fondamentale, je ne le nie pas. Il n'en reste pas moins que, dans ce domaine, l'État a une obligation de résultat, pas de moyens.
En aucun cas cet objectif de défense sociale ne doit remettre en cause les principes constitutionnels qui régissent notre droit pénal. Dans ce domaine, les libertés individuelles ne peuvent faire l'objet de restrictions aussi graves et aussi désinvoltes que celles que votre projet de loi prévoit. Que des moyens soient mis en oeuvre, nul ne le conteste. Mais encore faut-il qu'ils soient respectueux du droit, de la liberté, de la sûreté et de tous nos principes.
Le dispositif de rétention de sûreté est une privation totale de liberté. Ce n'est pas un moyen conforme aux principes d'un État de droit : c'est une peine qui s'ajoute à la peine, une fois celle-ci purgée. En cela, il n'est pas acceptable.
Avec ce projet de loi, vous tentez de nous faire croire que l'enfermement est le moyen le plus efficace pour lutter contre les récidives des condamnés les plus dangereux. Personnellement, je ne le crois pas.
D'abord, il ne s'agit pas d'une mesure de sûreté ; le Conseil constitutionnel, je l'espère, en conviendra. Une mesure de sûreté ne peut être une privation totale de liberté. D'ailleurs, la privation de liberté est la peine la plus importante de notre système judiciaire. Détention ou rétention, c'est la même chose.
Ensuite, la mesure de sûreté ne peut s'exercer au-delà de la peine prononcée par la juridiction de jugement. Elle ne peut en aucun cas se traduire par une relégation du condamné pour une durée indéterminée, comme le prévoit ce projet de loi.
Madame la ministre, je refuse que l'on puisse enfermer une personne sur la simple base de sa dangerosité, en raison de son état et non à cause de ses actes. Ce qui vaut pour les personnes présentant des troubles mentaux ne vaut pas pour les personnes présentant des troubles de la personnalité. Pourtant, vous confondez les deux.
C'est d'ailleurs bien la confusion qui règne dans ce texte, confusion entre les mesures de sûreté, qui s'appliquent à des personnes jugées responsables, même si elles présentent des troubles de la personnalité, et les mesures d'hospitalisation d'office, qui concernent les aliénés et qui, je vous le rappelle, sont de nature administrative. Il n'est pas possible d'étendre ainsi la procédure de l'hospitalisation d'office, qui est autorisée par la Convention européenne des droits de l'homme pour les personnes dangereuses, à celles qui présentent seulement des troubles de la personnalité.
Cette extension déguisée est grave : elle criminalise la psychiatrie et elle psychiatrise la criminalité. Elle met tout le monde dans le même sac, les fous et les criminels. Elle nourrit une haine déplorable à l'égard des personnes dangereuses, qu'elle instrumentalise en monstres qu'il faut neutraliser.
À quoi servent tous les dispositifs que nous avons votés ces dernières années, comme le bracelet électronique, et qui auraient pu servir dans le cadre de ce projet de loi ? Que deviendront-ils si on leur substitue l'enfermement ? Quelle est aujourd'hui leur valeur si un dispositif aussi radical que la rétention de sûreté existe ? Je vais vous le dire : le principe de précaution l'emportera et l'enfermement sera la règle, les mesures de sûreté l'exception.
Ces outils juridiques auraient dû être adaptés, renforcés, mais jamais écrasés par un dispositif aussi inique et radical.
Nos propositions, pourtant nombreuses, n'ont pas reçu d'écho satisfaisant, et je le déplore. Pourtant, elles avaient le mérite de rendre le texte constitutionnel tout en maintenant le dispositif de rétention intact. Mais votre préoccupation n'était pas celle-là, madame la ministre : seul vous importait l'affichage et, de ce point de vue, vous êtes satisfaite.
Pour des raisons juridiques, philosophiques et humaines, les Verts voteront contre ce texte. Nous espérons qu'une décision du Conseil constitutionnel rendra honneur à notre droit positif et à la tradition des Lumières.

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, le débat a été long et aussi complet que possible. Grâce au travail de la commission des lois et du rapporteur - cela a été souligné, à juste titre, à plusieurs reprises -, nous avons pu améliorer le projet de loi sur un certain nombre de points. La discussion qui a eu lieu au Sénat a donc permis une évolution significative du texte par rapport à la version issue des travaux de l'Assemblée nationale.
Je ne citerai que quelques mesures : le caractère pluridisciplinaire de la période d'observation, sa durée, la transformation de la commission régionale de la rétention de sûreté, et de la commission nationale, en une juridiction, le caractère public du débat contradictoire, le parcours individualisé proposé d'emblée par le juge de l'application des peines, etc.
Mais ces améliorations, aussi importantes soient-elles, ne changeront pas notre approche philosophique.
Ce projet de loi a été conçu sans cohérence, sans analyse sérieuse de la législation et de toutes les mesures qui ont été prises depuis quatre ou cinq ans. Je le répète, nous avons besoin d'une évaluation de toutes les dispositions - il y en a plus d'une dizaine - qui traitent de la même question pour savoir où nous en sommes.
Le débat aurait dû avoir lieu après l'examen du projet de loi pénitentiaire, et non avant. Avouez que cette démarche est assez curieuse : on marche sur la tête !
Malheureusement, le présent projet de loi témoigne, pour l'essentiel, d'une approche répressive, fondée sur l'enfermement, alors que celui-ci est déjà très lourd en France - il est même le plus lourd d'Europe - et semble la seule réponse possible aux problèmes de la société. Nous poursuivons là la chimère du risque zéro en imposant une législation de plus en plus répressive et attentatoire aux libertés.
Ce texte comporte également de nombreux ferments d'inconstitutionnalité. Certains ont soutenu que ce n'était pas très grave et que le Parlement n'avait pas à s'en soucier. D'autres ont reconnu que les risques existaient, mais ils les ont acceptés. N'est-il pas curieux de voir un Parlement voter un texte tout en se doutant qu'il comporte de tels risques ? Le Parlement se défausse sur le Conseil constitutionnel pour pouvoir ensuite affirmer qu'il a proposé ce qu'il fallait : c'est le Conseil constitutionnel qui a manqué de courage.
Ce projet de loi tourne le dos à deux grands principes fondamentaux du droit français depuis la Révolution.
D'une part, enfermer quelqu'un en prison, par une décision judiciaire, non pas à cause des faits qu'il a commis, mais parce qu'il est susceptible de commettre un acte de délinquance, bouleverse un principe fondamental de notre État de droit établi depuis la suppression de la lettre de cachet : une personne ne peut être condamnée sur une suspicion de dangerosité, sur une présomption de culpabilité future ou sur une dangerosité virtuelle ; elle ne peut l'être que sur un acte commis et prouvé par la justice. Le Gouvernement affirme qu'il s'agit là d'une mesure de sûreté. C'est faux : c'est une peine ; le débat ne nous a pas convaincus.
D'autre part, ce texte bafoue le principe de non-rétroactivité de la loi pénale la plus dure, consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce n'est pas l'usine à gaz que constitue l'amendement n° 29, modifié par les sous-amendements n° 78 rectifié ter et 92, qui nous a rassurés sur ce point.
Ce projet de loi est une fuite en avant. Il permet d'enfermer à vie des gens qui n'ont pas commis d'infraction.
En plus d'être contestable en lui-même, le débat parlementaire a montré à quel point ce dispositif pouvait conduire à des dérives. Initialement, la rétention de sûreté ne devait s'appliquer qu'aux délinquants sexuels récidivistes sur mineurs. Elle a été progressivement élargie à toute une série de délinquants, que leurs crimes soient commis sur des majeurs ou sur des mineurs. Elle concerne même ceux qui n'ont pas récidivé. L'escalade risque de se poursuivre. Jusqu'où ?
Ce projet de loi contient en germe une grave menace pour les libertés et pour l'évolution de notre système pénal et pénitentiaire. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre.

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, à l'occasion du vote du projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution, j'ai souligné la grande unanimité du groupe du RDSE. Cet enthousiasme aura été de courte durée, puisque, aujourd'hui, les différentes sensibilités qui le composent s'expriment de manière différente : mon collègue Georges Othily a exposé la sienne hier ; celle que je représente est très réservée sur ce texte.
Tout d'abord, je veux rendre hommage à la commission des lois ; tous l'ont fait et je ne veux pas être en reste. Dans ce genre de circonstances, il vaut mieux se répéter que ne rien dire, surtout quand on connaît les efforts accomplis par la commission des lois pour surmonter les inconvénients de la procédure d'urgence. On sait bien qu'en matière pénale ce n'est pas toujours évident.
Je veux également souligner les efforts réalisés pour améliorer le texte ; je ne reviens pas sur les mesures que vient d'évoquer notre collègue M. Yung. Mais, qu'on le veuille ou non, tous ces efforts sont insuffisants pour compenser la volonté d'affichage - il faut bien appeler un chat un chat ! -du Gouvernement dans cette affaire.
Voilà quelques instants, M. del Picchia a évoqué un argument que l'on peut considérer comme recevable. Certes, il ne s'agit pas de se prosterner devant la Convention européenne des droits de l'homme ; nous devons conserver, les uns et les autres, notre liberté d'appréciation. Il n'en demeure pas moins que cette volonté d'affichage conduit généralement le Gouvernement à déposer des projets de loi sans se soucier des conséquences d'une saisine éventuelle du Conseil constitutionnel - nous n'avons pas non plus à nous en soucier, mais cela nous préoccupe quelque peu - et à se dire : « qui vivra verra ! ». Telle fut un peu la situation que nous avons connue cet été, avec la mesure concernant les intérêts d'emprunts. On fait un effort et, ensuite, on avise !
Si un doute pouvait subsister sur l'intérêt du bicamérisme, il serait aujourd'hui dissipé par la qualité des améliorations que la commission des lois a apportées au projet de loi que nous examinons. Elle a procédé à une réécriture de plusieurs dispositions, afin de corriger la mauvaise qualité d'un texte examiné en urgence.
Le principal argument qui doit nous guider est l'anticipation de la décision du Conseil constitutionnel, dont un membre éminent, son président, a dit un jour : « trop de loi tue la loi ».

Compte tenu de l'autorité de celui qui l'a prononcée, on peut peut-être la prendre en compte !
En l'espèce, nous aurions pu voter en faveur de l'amendement 29 de la commission, mais le sous-amendement n° 92 déposé par le Gouvernement a ruiné l'espoir que nous pouvions mettre dans ce texte.
M. Fauchon a quelque peu mis à mal les arguments relatifs à la Convention européenne des droits de l'homme. Effectivement, si l'on approfondit un peu le sujet, il y a beaucoup de choses à dire.
Aux termes du sous-amendement n° 92, certaines dispositions de l'article 1er « sont applicables aux personnes faisant l'objet d'une condamnation prononcée après la publication de la présente loi pour des faits commis avant cette publication ». Or, selon moi, il existe un principe intangible, qui prime sur toute autre considération.
C'est la raison pour laquelle la majorité des membres du groupe du RDSE votera contre le projet de loi, tandis que la minorité votera pour. Quant à la minorité de la minorité, j'ignore ce qu'elle fera)

Je persiste et signe ! Et de nombreux Français doivent penser comme moi.
Madame le ministre, les membres du groupe UMP voteront en faveur de ce projet de loi avec grand plaisir parce qu'il répond à une forte exigence de nos concitoyens, qui ne comprennent pas pourquoi des crimes particulièrement odieux ont été commis, alors qu'ils auraient pu et auraient dû être évités.
Il est donc de notre responsabilité de soutenir le dispositif que vous proposez, car il s'agit, à l'instar de ce qui existe déjà dans d'autres pays, de renforcer la prise en charge des criminels particulièrement dangereux dans des centres socio-médico-judiciaires.
Au nom de l'ensemble de mes collègues du groupe UMP, je souhaite saluer votre ferme détermination, madame le ministre. Comme vous l'avez souligné lors de la discussion générale, la rétention de sûreté constitue une innovation sans équivalent dans notre droit ; elle concerne certains criminels lourdement condamnés, d'une dangerosité intrinsèque rare.
Voilà pourquoi nous soutenons ce projet de loi, qui représente également une sérieuse avancée pour le droit des victimes, puisqu'il va permettre d'améliorer le traitement judiciaire des dossiers des personnes atteintes de troubles mentaux les rendant irresponsables sur le plan pénal.
Enfin, grâce à ce texte, l'efficacité du dispositif d'injonction de soins sera renforcée.
Pour conclure, je souhaite féliciter, au nom du groupe UMP, le président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest, et le rapporteur, Jean-René Lecerf, de leur travail de qualité, même si nous avons eu quelques petites divergences. Mais ce sont les règles du débat et de la démocratie !

Sous l'impulsion de M. le rapporteur, les dispositions adoptées par notre assemblée ont permis de clarifier utilement certains des aspects du dispositif ; en particulier, il a été précisé que la commission chargée de prononcer la rétention de sûreté était bien une juridiction.
Pour toutes ces raisons, les membres du groupe UMP voteront sans réserve en faveur de ce projet de loi, tel qu'il a été enrichi par les travaux de notre assemblée.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la grande majorité des membres du groupe de l'UC-UDF voteront bien volontiers ce texte.
Reprenant l'expression de notre excellent collègue Nicolas Alfonsi, il est certes possible que « trop de loi tue la loi », mais si cette loi aura servi à éviter quelques meurtres, elle sera bienvenue.
Ce texte a été caricaturé ; je n'y reviens pas. J'ai ainsi lu dans un journal que la rétention de sûreté était la prison à vie. Mais l'auteur de cette affirmation ne s'est sans doute pas donné la peine de lire le projet de loi. D'autres ont parlé de bagne. Toutefois, personne ne conteste que certains individus sont dangereux : tout le monde est d'accord sur ce point !

Certes, ma chère collègue, il n'existe nulle part, en ce bas monde, de certitude absolue ! Mais si, sous prétexte que les choses ne sont pas d'une certitude absolue, il ne fallait rien faire, alors on n'interviendrait pratiquement dans aucun domaine. Naturellement, il faut admettre qu'il existe une certaine marge d'erreur. Je crois que le texte comporte des précautions extrêmement sérieuses.
Vous ne pouvez pas nier la dangerosité de certains individus, pas plus que la très grande probabilité de la répétition de crimes. Quelle contre-proposition avez-vous faite au projet de loi ? Aucune ! Vous préconisez simplement de remettre en liberté les personnes visées, et advienne que pourra !

Non, c'est bien ce que vous dites ! Considérer que ces gens-là puissent voir leur libre arbitre affecté porterait atteinte, selon vous, à la philosophie des Lumières.
Une certaine conception de l'homme transparaît au travers du débat que nous venons d'avoir. On a évoqué tout à l'heure l'époque des Lumières. Robert Badinter campe sur ses positions, décrivant l'homme idéal tel qu'il a été imaginé à la veille de la Révolution française, dans les écoles de Voltaire, de Rousseau : l'homme des Lumières, « maître de lui comme de l'univers », et qui a son libre arbitre.

Mais depuis cette époque, de l'eau est passée sous les ponts. Mes chers collègues, vous semblez ignorer totalement les données de la psychologie et de la psychanalyse et croire que tout un chacun est doté du libre arbitre. L'on ne pourrait avoir de jugement que moral. Je reprends les propos de M. Badinter : une faute a été commise, une sanction a été prononcée...

Ma chère collègue, je vous ai écoutée attentivement et j'estime que vous avez dit beaucoup de choses justes. Alors, écoutez-moi un peu et vous constaterez que je ne dis peut-être pas que des bêtises, on ne sait jamais...

Quoi qu'il en soit, nous avons beaucoup appris sur l'être humain. La référence à l'être humain idéal du XVIIIe siècle ne correspond plus à nos connaissances actuelles. Il faudrait peut-être un peu réviser notre position.
Cela étant, on a brandi, tel un épouvantail, la question de la rétroactivité. Mais, je le répète, selon moi, aucun problème ne se pose de ce point de vue parce que la condamnation d'origine, sans doute très ancienne, est la condition, et non la cause, de l'examen de l'état psychiatrique de la personne concernée. On évoque la rétroactivité sans donner d'explication. Il faut expliquer en quoi consiste cette rétroactivité ! La condamnation d'origine, qui sera bien sûr très antérieure, n'est que la condition.
Prenons un exemple simple. Imaginons l'adoption d'une loi prévoyant qu'une personne, qui, ayant atteint l'âge de la majorité, commet ensuite tel ou tel acte répréhensible, encourra telle ou telle punition. Va-t-on faire remonter l'appréciation de la rétroactivité à la date de sa majorité ? La majorité est la condition, mais non la cause de la condamnation. Ici, le fondement de cette dernière, c'est l'examen par une commission de l'état psychologique de la personne poursuivie, puis la décision de la juridiction. Telle est la cause de la mesure technique de sûreté, qui ne constitue pas une mesure morale de punition. La cause sera, par conséquent, forcément postérieure au vote de la loi. Donc, aucun problème de rétroactivité ne se pose.
J'ai déjà indiqué ce que je pensais de l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme. On s'est trompé en ne retenant que la première hypothèse visée par ladite convention. En réalité, il faut plutôt se situer dans l'hypothèse d'une variante de l'aliénation, qui ne suppose pas de condamnation préalable.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous pouvons adopter ce texte avec sérénité.
Madame la ministre, je formule le voeu que nous trouvions le moyen pratique - indépendamment des discussions théoriques intéressantes que nous avons eues - de créer pour ces malheureux, que nous protégeons aussi contre eux-mêmes - on oublie de le dire ! -, des conditions de rétention telles que personne ne puisse soutenir qu'elles peuvent être confondues avec la détention.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 78 :
Le Sénat a adopté.
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite vous remercier de la qualité du débat que nous venons d'avoir. Une fois de plus, votre Haute Assemblée a montré tout l'attachement qu'elle porte aux grands débats de notre pays et à la qualité des lois qu'elle adopte.
Nous avons eu de nombreux échanges, nous n'avons pas toujours été d'accord, mais j'ai pu apprécier, sur l'ensemble des travées de cette assemblée, la qualité des arguments et la volonté d'apporter de vraies réponses sur un sujet qui nous concerne tous.
Je souhaite remercier tout particulièrement M. le rapporteur, Jean-René Lecerf, et M. le président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest. Leurs travaux ont permis d'améliorer ce texte et je suis sûr que ceux de la commission mixte paritaire seront fructueux.
Ce projet de loi améliore la protection de nos concitoyens et il répond également à leurs attentes, puisque 81 % des Français sont favorables à ce texte.
Je salue tout particulièrement votre volonté unanime d'assurer un suivi adapté des délinquants dangereux dès le début de leur peine.
Je salue également la volonté du Sénat de permettre l'application de la rétention de sûreté aux délinquants les plus dangereux qui sortiront de prison dans les années qui viennent. Je sais que les débats que nous aurons au moment de l'examen du projet de loi pénitentiaire seront tout aussi riches.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.
La liste des candidats établie par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-René Lecerf, Patrice Gélard, Hugues Portelli, Pierre Fauchon, Robert Badinter et Mme Josiane Mathon-Poinat.
Suppléants : M. Nicolas Alfonsi, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. Christian Cointat, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, René Garrec et François Zocchetto.

J'informe le Sénat que la question n° 155 de Mme Marie-France Beaufils est retirée de l'ordre du jour de la séance du mardi 25 mars 2008 à la demande de son auteur.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la nationalité des équipages de navires.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 190, distribué et renvoyé à la commission des affaires économiques.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »).
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3766 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments et modifiant le règlement (CE) n° XXX/XXXX [procédure uniforme].
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3767 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (Refonte).
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3768 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3769 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Avant projet de budget rectificatif n° 1 au budget général 2008 - État des dépenses par section - Section III - Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3770-I et distribué.

J'ai reçu de M. Jean-Claude Carle un rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Todeschini, Mme Gisèle Printz, MM. Jean-Pierre Masseret, Jean-Pierre Bel, Serge Lagauche, Mme Christiane Demontès, MM. Simon Sutour, Bertrand Auban, Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Yannick Bodin, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis Carrère, Pierre-Yves Collombat, Roland Courteau, Jean-Pierre Demerliat, Claude Domeizel, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Jean-Pierre Godefroy, Alain Journet, Yves Krattinger, Alain Le Vern, Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, Marc Massion, Jean-Luc Mélenchon, Gérard Miquel, Jean-Marc Pastor, Bernard Piras, Marcel Rainaud, Daniel Raoul, Thierry Repentin, Mme Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, René-Pierre Signé, Michel Teston, Robert Tropeano, Richard Yung, Bernard Frimat, Michel Dreyfus-Schmidt, Claude Haut, Mme Bariza Khiari, MM. Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Tasca, M. Jean-Pierre Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, tendant à abroger l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (n° 106, 2007-2008).
Le rapport sera imprimé sous le n° 191 et distribué.

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 5 février 2008 :
À dix heures :
1. Dix-huit questions orales.
À seize heures et le soir :
2. Discussion de la proposition de loi (n° 136, 2007-2008), modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attraction.
Rapport (n° 162, 2007-2008) de M. Pierre Hérisson, fait au nom de la commission des affaires économiques.
3. Discussion du projet de loi (n° 149, 2007-2008) relatif aux organismes génétiquement modifiés (urgence déclarée).
Rapport (n° 181, 2007-2008) de M. Jean Bizet, fait au nom de la commission des affaires économiques.
Par ailleurs, je rappelle que le Parlement se réunira en Congrès le lundi 4 février, à seize heures, pour se prononcer sur le projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
La séance est levée à dix-neuf heures vingt.