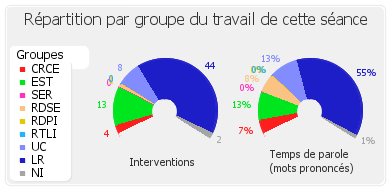Séance en hémicycle du 17 juin 2014 à 21h30
Sommaire
- Convocation du parlement en session extraordinaire
- Exposition aux ondes électromagnétiques (voir le dossier)
- Proposition de loi relative à la sobriété à la transparence à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques (voir le dossier)
- Ordre du jour (voir le dossier)
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.

La séance est reprise.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République en date du 17 juin 2014 portant convocation du Parlement en session extraordinaire à compter du 1er juillet 2014.
Je donne lecture de ce décret :
« Le Président de la République,
« Sur le rapport du Premier ministre,
« Vu les articles 29 et 30 de la Constitution,
« Décrète :
« Article 1er. - Le Parlement est convoqué en session extraordinaire le mardi 1er juillet 2014.
« Article 2. – L’ordre du jour de cette session extraordinaire comprendra :
« 1. Le débat d’orientation des finances publiques ;
« 2. L’examen ou la poursuite de l’examen des projets de loi suivants :
« - Projet de loi de finances rectificative pour 2014 ;
« - Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 ;
« Projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2013 ;
« - Projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
« - Projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire ;
« - Projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes ;
« - Projet de loi portant réforme ferroviaire ;
« - Projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ;
« - Projet de loi tendant à renforcer l’efficacité des sanctions pénales ;
« - Projet de loi relatif à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public ;
« - Projet de loi renforçant la prévention et la répression du terrorisme (sous réserve de son dépôt) ;
« 3. L’examen ou la poursuite de l’examen des propositions de loi suivantes :
« - Proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF ;
« - Proposition de loi facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l’espace public ;
« - Proposition de loi relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (sous réserve de son dépôt) ;
« - Proposition de loi relative à la sécurisation des transactions relatives à la zone d'aménagement concerté du quartier de Gerland (Lyon), n° 2031 ;
« - Proposition de loi relative à la sécurisation des transactions relatives à la zone d'aménagement concerté du quartier de Gerland (Lyon), n° 2032 ;
« 4. L’examen ou la poursuite de l’examen des projets de loi autorisant l’approbation des accords internationaux suivants :
« - Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Géorgie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure ;
« - Projet de loi autorisant la ratification du protocole modifiant l’accord de transport aérien entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis d’Amérique, d’autre part ;
« - Projet de loi autorisant l’approbation de la convention postale universelle ;
« - Projet de loi autorisant l’approbation de l'arrangement concernant les services postaux de paiement ;
« - Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de coopération en matière de sécurité intérieure entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État des Émirats arabes unis ;
« - Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République libanaise relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure, de sécurité civile et d'administration ;
« 5. Une séance de questions par semaine, ainsi qu’une séance supplémentaire à l’Assemblée nationale consacrée aux questions relatives à l’énergie.
« Article 3. - Le Premier ministre est responsable de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
« Fait le 17 juin 2014.
« Par le Président de la République :
« Le Premier ministre,
« Manuel Valls ».
Acte est donné de cette communication.
Mes chers collègues, la conférence des présidents, qui se réunira demain à dix-neuf heures, établira l’ordre du jour de la session extraordinaire. Il sera donné lecture de ses conclusions demain soir, à la reprise de la séance.

Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Joël Labbé. §

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, sobriété, transparence, concertation en matière d’ondes électromagnétiques : voilà un titre qui est clair.
Cette proposition de loi, portée à l’Assemblée nationale par Mme Laurence Abeille, députée écologiste, dont je tiens à saluer la présence dans nos tribunes
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.
Sourires sur les travées de l'UMP.

En dépit des difficultés, un compromis a pu émerger, ce qui a conduit, selon la formule de notre rapporteur Daniel Raoul, à une certaine « sédimentation d’amendements », qui s’est faite en partie au détriment de la qualité rédactionnelle de ce texte.

Notre commission des affaires économiques a veillé à remédier à ces défauts, et le texte est aujourd’hui beaucoup plus clair qu’il ne l’était à l’issue des travaux de l’Assemblée nationale – c'est là aussi le rôle du Sénat.
Malheureusement, certaines dispositions essentielles du texte qui, d’ailleurs, étaient issues non pas directement des réflexions écologistes, mais bien de la démarche de concertation tripartite du Grenelle des ondes, ont été supprimées au passage. Nous vous proposons, au travers d’une dizaine d’amendements, de rétablir quelques-unes de ces dispositions essentielles et nécessaires, que nos concitoyens attendent.
Il nous semble en effet primordial de rétablir le caractère systématique de la concertation locale lors de l’implantation des antennes. Cela aura pour effet de rassurer les citoyens et de les informer correctement de la réalité des émissions des installations. Il s’agit d’une mesure de transparence et certainement du meilleur moyen, pour tous ceux qui soutiennent que les antennes sont sans danger, de le démontrer localement, y compris en informant le conseil d’école lors de l’implantation d’un nouveau réseau.
L’organisation de la concertation redonne un rôle au maire. Certes, celui-ci ne reçoit pas une compétence et un pouvoir de décision au niveau local, mais les élus locaux ne seront plus laissés de côté dans ce type de projet.
Ce qui est caché, ou ce qui est non dit, est toujours source d’anxiété et de fantasmes. Ayons l’aplomb de faire face à nos concitoyens et de leur parler. À ce sujet j’aimerais citer un auteur classique, Publilius Syrus
M. Bruno Sido s'exclame.

Notre commission des affaires économiques a décidé de renoncer à la notion de modération, que les opérateurs rejetaient également, pour lui préférer celle de sobriété. Outre que l’objectif de modération est la conclusion du rapport Tourtelier-Girard-Le Bouler de décembre 2013, ce terme et cet objectif ont fait consensus à la gauche de l’Assemblée nationale, les écologistes ayant transigé par rapport à leur position de départ, qui était l’application du principe de précaution. De plus, la modération implique une démarche qui conduirait à la sobriété, alors que la sobriété est un état n’impliquant pas d’action.
Nous entendons bien la crainte des opérateurs de voir leurs opérations se complexifier, ou certains coûts augmenter. C’est là le souci de tous les opérateurs économiques, et aussi de nos concitoyens.
Nous soutenons l’idée que cette notion de modération permettra de développer des installations plus performantes, moins émissives et moins énergivores, donc plus compétitives et plus rentables pour nos entreprises et pour nos exportations industrielles.
Je voudrais préciser un point concernant les règles applicables à l’étranger en matière de seuils d’exposition aux ondes électromagnétiques. On entend souvent affirmer que, si la France adoptait un texte protecteur des populations, elle serait le seul pays au monde à agir ainsi. De même, on entend souvent dire que les seuils recommandés de 41 à 61 volts par mètre, décidés en 1998, seraient appliqués dans le monde entier, et qu’il n’y aurait donc aucune raison pour que la France les remette en cause.
Or, dans de nombreux pays, les seuils appliqués en matière d’ondes électromagnétiques sont plus restrictifs. L’exemple de la région de Bruxelles est très souvent donné : la valeur limite y est de 3 volts par mètre dans les lieux de vie, ce qui est très loin des 61 volts par mètre... En Italie, les seuils sont également plus stricts, avec une limite de 6 volts par mètre, et je pourrais également citer la Pologne, la Suisse, la Bulgarie, le Luxembourg, la Grèce, la Lituanie, la Slovénie, la Catalogne… ou encore Paris ! Alors arrêtons de nous faire peur en considérant la France comme un pays réfractaire aux nouvelles technologies et qui irait à contre-courant des politiques menées ailleurs.
Quant à ceux qui affirment que l’absence de risques avérés justifie de ne pas légiférer, je me dois de leur rappeler, mes chers collègues, que l’échelle des risques définie par l’ANSES, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, est un dégradé : le « risque avéré » est au sommet ; au-dessous, on trouve les « effets probables », puis, les « effets possibles » ; le « niveau de preuve insuffisant pour conclure à un effet » n’intervient qu’en avant-dernière position, et l’appréciation « probablement pas d’effet chez l’homme » se trouve tout en bas de l’échelle…
N’oublions pas que l’ANSES formule des recommandations concernant l’usage des technologies sans fil, notamment pour les personnes fragiles. Alors n’allons pas croire à une absence totale de risques : l’ANSES reconnaît l’existence d’effets biologiques, et pas uniquement thermiques comme on l’entend souvent.
Enfin, le texte évoque l’électro-hypersensibilité. Si cette pathologie est encore mal connue, nous savons que des personnes en souffrent, et il est du devoir de la puissance publique de considérer leur situation et d’apporter une réponse. De même, il est illusoire de croire que les ondes qui nous traversent en permanence n’auraient strictement aucun effet.
En rétablissant un texte mesuré et équilibré qui, en toute transparence, prenne en compte le développement des nouvelles technologies, mais aussi la préservation de la santé de nos concitoyens, nous donnerons une image du Sénat positive, celle d’une chambre douée d’intelligence collective, protectrice des citoyens et volontariste pour la qualité de notre industrie.
Il serait tout de même dommage que le groupe écologiste ne puisse pas voter le texte qu’il a lui-même proposé !
Vifs applaudissements sur les travées groupe écologiste et du groupe CRC.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord, si vous le permettez, saluer le travail de fond de nos deux rapporteurs, aussi bien celui de Daniel Raoul pour la commission des affaires économiques que celui de Raymond Vall pour la commission du développement durable. Je voudrais aussi souligner qu’il est assez peu courant que deux présidents de commission prennent en charge le rapport d’un texte.
Sourires sur les travées de l'UMP.

Deux hypothèses sont envisageables : soit ils le considèrent comme un horizon indépassable parmi tous les textes que nous avons pu examiner au cours de cette session, soit, au contraire, ils jugent que ce texte doit être dépassé…
De ce point de vue – Joël Labbé en a fait la remarque il y a quelques instants –, la proposition de loi a effectivement considérablement évolué, mais, à moins que nombre de nos amendements ne soient repris, il sera difficile pour notre groupe de le voter, tout simplement parce qu'il comporte encore des contradictions importantes et qu’il pourrait susciter des risques juridiques, eux, bien avérés.
Pour ce qui est des contradictions, le point de départ du texte est le soulagement des personnes hypersensibles aux ondes électromagnétiques. C'est une juste cause, qui doit effectivement mériter toute notre attention. Le problème, c'est que le point d’arrivée du texte risque paradoxalement de se trouver à l’opposé de l’objectif visé.
En effet, si l’on ne veut pas transiger pas sur la couverture du territoire – qui, parmi nous, mes chers collègues, souhaiterait amoindrir la couverture de son territoire et augmenter la fracture numérique ? – tout en rendant aux Français une qualité de service équivalente, il faudra ou bien multiplier les antennes, ou bien augmenter la puissance de réception des portables, autrement dit des terminaux. Or, vous le savez très bien, c'est ce qu’il y a de plus dangereux ! En effet, les antennes relais émettent des radiofréquences qui sont 10 000 à 100 000 fois moins élevées que celles qui sont suscitées par un terminal de portable lors d’une conversation.
Un point d’attention concerne clairement les terminaux. Ce n’est pas pour rien – Daniel Raoul l’a dit il y a quelques instants – que, très tôt, le législateur a voulu qu’un « kit mains libres » soit mis à la disposition de chaque acheteur : c'est précisément pour pallier ce risque.
Ainsi, mes chers collègues, on ne peut prétendre soulager des souffrances qui, selon moi, sont réelles sans base scientifique solide : cela reviendrait à leurrer ceux qui souffrent. M. Le Déaut, qui est vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, disait justement : « L’ensemble des rapports d’expertise internationaux, fondés sur des milliers d’études, conclue qu’il n’y a pas de risque avéré des radiofréquences en dessous des limites réglementaires ».
Voilà la première contradiction. La seconde concerne la Gouvernement. Madame la secrétaire d'État, en l’absence de base scientifique avérée, le Gouvernement doit clairement se positionner pour lever la contradiction qui consiste à entretenir le flou tout en recommandant une feuille de route assez ambitieuse sur le numérique.
Mes chers collègues, nous savons tous que l’avenir de la France dépend très largement de la troisième révolution industrielle. Le numérique représente 25 % de la croissance, 25 % de la productivité, et l’attractivité de nos territoires dépend également de la couverture numérique.
Les deux grandes infrastructures du XXIe siècle, ce sont les réseaux à très haut débit, fixes, mais aussi mobiles. Il doit en effet y avoir une complémentarité entre la fibre et le mobile ; vous en êtes d'ailleurs, monsieur le président de la commission des affaires économiques, l’un des promoteurs. Comme il ne sera pas possible d’installer la fibre dans chaque habitation, il faudra prévoir la complémentarité entre les ondes, c'est-à-dire la mobilité, et la fibre pour couvrir la totalité de notre territoire.
Il faut ajouter une autre frontière, celle du « Web 3.0 », qui utilisera des services et permettra des usages de mobilité, de nomadisme. Le Web 3.0, c’est à la fois le Cloud, le Big data, mais également les objets connectés, une connexion permanente, partout, sans fil à la patte. On voit donc bien que la mobilité et, par conséquent, les ondes et les radiofréquences seront essentielles pour la couverture du territoire et pour relever le défi de la France numérique que nous voulons bâtir. Or ce n’est pas en agitant des peurs que l’on y parviendra !
Si le risque scientifique n’est pas avéré, les risques juridiques, eux, le sont, et ce pour trois raisons.
Le premier risque vient, à mon sens, de ce qu’il n’y a de fondement constitutionnel ni au principe de modération ni au principe de sobriété. La première mouture de la proposition de loi déposée par Mme Abeille et les débats à l’Assemblée nationale témoignent de la volonté de l’auteur de relier son texte au principe de précaution inscrit à l’article 5 de la Charte de l’environnement. Or je ne pense pas que l’on puisse le faire d’un point de vue juridique.
L’exposé des motifs d’un amendement de Mireille Schurch que nous examinerons ultérieurement évoque concrètement le principe ALARA, c'est-à-dire, en anglais, « aussi bas que raisonnablement possible ». Juridiquement, je pense que ce qu’il convient d’invoquer sur ce texte n’est pas le principe de précaution, mais bien plutôt le principe ALARA.
Cependant, ce principe, qui concernait le risque, avéré sur le plan scientifique, que faisaient courir les rayonnements ionisants, ne cadre pas avec l’article 5 de la Charte de l’environnement. En effet, il va bien au-delà du principe de précaution, qui doit rester connecté à l’analyse scientifique et à un danger potentiel. Ainsi, à mon sens, on ne peut pas donner une base juridique à ce texte sur le fondement constitutionnel de l’article 5 de la Charte.
Le deuxième risque juridique concerne le principe de proportionnalité. Je pense en outre que le principe anglo-saxon ALARA s’accommode mal avec le principe de proportionnalité. Pourquoi ? Le principe de proportionnalité, consacré à la fois par le droit européen, le droit constitutionnel et le droit administratif, implique que les mesures de précaution soient proportionnées, c'est-à-dire réalisables, avec un coût acceptable. Le principe ALARA dépasse de très loin cette problématique. Comme vous le savez, une expérimentation menée dans seize quartiers avait montré que, pour réduire l’exposition à 0, 6 volt par mètre, il faudrait multiplier par trois le nombre des antennes. Si la faisabilité technique est présente, il en va donc différemment de l’acceptabilité et de la portée économique.
Le troisième risque juridique, qui est important, vient de ce que ce texte crée une discrimination et une atteinte au principe d’égalité devant la loi. En effet, pourquoi prévoir un régime juridique spécifique pour les seules antennes relais, alors que le rapport Girard-Tourtelier, dont la grande qualité a été soulignée à plusieurs reprises à cette tribune, reconnaît que « l’exposition des personnes aux champs électromagnétiques est composite et ne fait pas une place prépondérante aux antennes relais » ?
Mes chers collègues, pourquoi, de façon rationnelle, avoir laissé de côté les fours à micro-ondes, les radars, les lignes à haute tension, les nombreux appareils qui émettent des ondes ? Il y a bien une discrimination et, par conséquent, une atteinte au principe juridique d’égalité.
En conclusion, l’enfer est souvent pavé de bonnes intentions, …

… lesquelles créent des approximations juridiques, qui conduiront immanquablement à un manque de sécurité juridique du texte.
Ces approximations susciteront un foisonnement de contentieux, qui touchera prioritairement les élus locaux, n’en doutez pas, mes chers collègues ! Si ce texte était voté en l’état, ceux-ci seraient soumis à une double menace : une menace sur le terrain de la légalité, interne et externe – je n’ai pas le temps de développer ce point –, au terme des actions de consultation et de concertation ; une menace sur le terrain de la responsabilité mettant en cause d’éventuelles carences quand la consultation aura été mal organisée, avec de possibles actions en réparation.
Bref, pour conclure d’un trait d’humour, mais qui renvoie tout de même à un problème sérieux, ceux qui ont aimé les tête-à-queue jurisprudentiels en matière d’urbanisme vont adorer le contentieux électromagnétique ! §

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, Bruno Retailleau ayant déjà évoqué de nombreux points, comme la majeure partie des orateurs qui se sont succédé, je serai brève afin que nous nous consacrions à l’examen des amendements.
L’exposition du public aux ondes électromagnétiques n’est pas un sujet anodin. Elle est le point de rencontre et d’achoppement de problématiques diverses et contradictoires. Je dois vous dire que, sur ce texte, ma religion n’est pas faite.
En tant que vice-présidente de la mission commune d’information sur le Mediator, j’ai pu constater que, sur ce type de sujets, nous avions toujours les mêmes réflexes, les mêmes peurs et, malheureusement, toujours les mêmes procédures et toujours le même retard.
L’affaire du Mediator, comme vous le savez, a succédé de dix ans à l’affaire du Vioxx. Si les préconisations d’alors avaient été mises en pratique, les problèmes liés au Mediator auraient probablement été évités. Nous avons donc perdu dix ans, avec un scandale sanitaire majeur. Les rapports parlementaires n’ont jamais été pris en considération, et l’on peut se demander à quoi sert notre travail s’il ne se retrouve pas dans la loi.
Nous traitons mal l’information dont nous disposons sur ce type de problèmes. Il convient aussi de recenser et de prendre en considération les lanceurs d’alertes, que ce soit l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, dont les travaux sont notoirement inconnus, mais également les compagnies d’assurance ou les associations, autant de clignotants, autant d’indices à examiner.
Je rentre d’un séminaire de l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’OCDE, sur les lanceurs d’alerte, qui s’est tenu aujourd'hui, et je dois dire que nous avons besoin d’améliorer les dispositifs, parcellaires, en la matière. Nous ne disposons même pas d’une définition claire du lanceur d’alerte !
Je veux bien admettre que certaines associations soient jugées fantaisistes, que certaines craintes ne soient probablement pas avérées, mais, dans l’absolu, nous avons connu des dossiers dans lesquels ces problèmes se posaient exactement de la même façon. Les questions de sécurité sanitaire et environnementale en sont des exemples patents.
Dans les départements ruraux, l’inquiétude concernant l’exposition aux ondes électromagnétiques est également présente. Plusieurs acteurs de la société civile demandent le respect par les opérateurs de la recommandation de l’Agence européenne pour l’environnement, qui préconise de maintenir un seuil de 0, 6 volt par mètre.
La création de l’association Toxic Ondes, dans le département de l’Orne que j’ai l’honneur de représenter, reflète d'ailleurs cette inquiétude. Sur l’initiative d’une habitante d’Alençon, soucieuse des effets des ondes sur la santé de sa famille, Toxic Ondes a effectué en 2009 des mesures dans un appartement proche d’antennes relais. Elles ont permis de constater une intensité de 3 à 5 volts, un résultat bien au-delà des recommandations. Il s’agit donc d’un vrai sujet, qui intéresse les populations.
Les ondes électromagnétiques sont aussi une source d’inquiétude parce que leur existence est naturellement impalpable. L’association Robin des Toits a beaucoup travaillé, depuis 2006, sur les implantations d’antennes, notamment près des écoles. Elle a finalement obtenu satisfaction, le sujet étant maintenant très réglementé, ce qui prouve tout de même que la société civile et les associations font également avancer les débats. Et heureusement qu’elles étaient présentes, car même le parlementaire le plus initié n’y aurait probablement pas prêté attention.
C’est un enjeu sanitaire ; c’est également un enjeu de compétitivité et d’aménagement numérique. Il faut sortir du débat manichéen entre, d’un côté, les partisans de la modernité, et, de l’autre, les Cassandre qui voudraient freiner la modernité au motif que cela pose des problèmes techniques ou sanitaires.

C'est la raison pour laquelle je vous disais au début de mon intervention que ma religion n’était pas faite. Je ne suis pas certaine que chacun puisse appréhender la réalité des difficultés aujourd’hui. L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques devrait opérer, sur ce type de dossier, des mises à jour, car la technologie évolue et les rapports, aussi bons soient-ils, ne sont parfois plus d’actualité une année plus tard.
Les travaux doivent se dérouler en toute indépendance, et je sais que la question des conflits d’intérêts est toujours en ligne de mire ; M. le rapporteur l’a évoquée. Il n’en demeure pas moins que nous devons légiférer sur les bases scientifiques les plus fiables possible, ce qui constitue toujours une source d’incertitude.
M. Bruno Retailleau a mentionné les objets connectés, dont nous avons parlé récemment dans cet hémicycle à propos de la géolocalisation. J’avais cité à Mme Taubira un article intitulé : « Objets connectés, avez-vous donc une âme ? » Il suffit de répertorier, heure par heure, le nombre d’objets auxquels nous sommes connectés pour constater que nous le sommes de plus en plus. Il y a donc, d’un côté, une demande des consommateurs, qui cherchent un produit sur ce qui est devenu un marché, et, de l’autre, les risques qui y sont afférents. Il est évident qu’il existe, sur le sujet, beaucoup de contradictions.
La concertation doit donc être approfondie entre les différents acteurs, ce que prévoyait le Grenelle des ondes. Notre collègue Chantal Jouanno, qui y avait activement participé, défendra d'ailleurs un certain nombre d’amendements.
En substituant au principe de modération des objectifs de sobriété, la commission a, selon moi, mieux équilibré la question des connaissances scientifiques avec la réalité juridique des concepts, même si on peut évidemment en discuter.
Quant à la procédure de concertation et d’information sur les projets d’installation d’antennes, l’article 1er clarifie le rôle du maire. Au cœur du dispositif d’installation, le maire pourra choisir, s’il le souhaite, une phase de concertation dont il sera l’arbitre tout en n’émettant pas d’avis à proprement parler, cette phase étant le préalable à l’autorisation donnée. La rédaction de la commission me semble, de ce point de vue, tout à fait pertinente.
Le fait de prendre les meilleures mesures possible afin de protéger les populations à risque, dont les enfants, me semble être une évidence. Sur ce sujet potentiellement anxiogène, il faut mesurer notre propre degré d’anxiété, ainsi que nos capacités de légiférer. Un travail d’éducation doit en outre être engagé.
Lorsque je vois, notamment aux États-Unis, des jouets connectés destinés à de très jeunes enfants, comme des iPad pour des enfants de deux ou trois ans, je m’inquiète de l’évolution de cette société de consommation qui nous pousse de plus en plus vers ce type d’objets dont on ne peut aujourd’hui mesurer exactement les effets.
Nous avons déposé un certain nombre d’amendements. Je pense que le groupe UDI-UC, dans sa très grande majorité, s’abstiendra sur ce texte. Encore une fois, à titre personnel, j’attendrai la fin des débats pour me faire une opinion.
M. Bruno Sido manifeste son impatience.

Il s’agit d’un sujet important et, monsieur le président, je pense qu’il faut absolument trouver un moyen, lors de la prochaine législature, d’assurer le suivi de ces dossiers essentiels par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi me paraît à la fois importante et ambitieuse.
Elle est importante, car il s’agit de légiférer sur le quotidien de chacun d’entre nous. Elle est ambitieuse, car elle traduit la volonté de trouver un point d’équilibre entre, d’une part, les avancées des sciences et des techniques que l’on ne peut freiner, et, d’autre part, le principe de précaution. Elle est aussi courageuse, car bien souvent notre point d’équilibre n’est pas exactement le même que celui du voisin, et à vouloir plaire à tout le monde, on risque de ne faire plaisir à personne.
Comme l’avait dit Mme Fleur Pellerin à l’Assemblée nationale, cette proposition de loi vise à mettre en place un dispositif conciliant progrès technologique et modération en matière d’ondes électromagnétiques. Son auteur, notre collègue députée Laurence Abeille, a souligné toute son importance en nous rappelant que nous vivions dans un bain d’ondes.
En effet, les ondes électromagnétiques non ionisantes nous accompagnent jour et nuit, quelle que soit leur fréquence. Je ne vais pas reprendre la liste de tous les objets émetteurs, mais, comme l’a dit le président Vall ou, je crois, Bruno Retailleau, n’oublions pas que certains de ces objets n’entrent pas dans le champ du présent texte : fours à micro-ondes, plaques de cuisson à induction
M. le rapporteur opine

Il ne s’agit que des objets d’aujourd’hui ; ceux de demain seront plus nombreux encore.
L’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, a révélé, dans son fameux rapport de 2013, que, en un trimestre, quelque 51 milliards de messages textes, ou SMS, ont été émis en France. Nous ne pourrons freiner cette avancée technologique. D’ailleurs, le voulons-nous ? Comme l’a pertinemment rappelé Bruno Retailleau, nous nous battons tous pour une meilleure couverture du territoire français. Ce faisant, nous encourageons le développement de cette technologie.
La question qui se pose aujourd’hui est donc de savoir si ce bain d’ondes est dangereux. Il ne s’agit pas d’une question nouvelle : on se la posait déjà au moment de l’invention du télégraphe – vous pouvez vous amuser à relire les commentaires de l’époque, mes chers collègues –, ou lors de la pose d’une antenne au sommet de la tour Eiffel. Avec le recul, cela peut prêter à sourire. Pourtant, je m’en garderai bien : les ondes sont mystérieuses. Invisibles, inodores, impalpables, silencieuses, elles accomplissent des prodiges. Dès lors, pourquoi ne pourraient-elles pas se révéler dangereuses ?
Que dit la science ? Je me référerai à mon tour au rapport de l’ANSES, qui fait quelque peu autorité. Selon cet organisme, « l’exposition aux ondes électromagnétiques n’a aucun effet sanitaire avéré ». Fort bien ! Toutefois, dans le même rapport, on peut lire que les niveaux d’exposition liés à l’utilisation des terminaux mobiles sont bien supérieurs à ceux qui sont liés aux antennes relais et qu’il ne faut pas en abuser.
Pour l’opinion publique, pour ceux qui ne sont pas spécialistes de la question, il s’agit d’une contradiction, qui n’est pas de nature à donner confiance, et ce d’autant plus que l’Académie de médecine n’a pas approuvé ce rapport !
Reste que l’électro-hypersensibilité est un fait. Et si, comme l’a rappelé le président Raoul, aucun véritable lien de causalité n’a pu être établi, il s’agit de souffrances que l’on ne peut ignorer. D’autres études sont en cours, mais, à ce jour, il n’existe aucune preuve de la dangerosité ou de l’innocuité totale des ondes. C’est dans ce contexte difficile qu’il nous faut légiférer.
Au moment d’évoquer le principe de précaution, on oublie souvent de le définir. Or les définitions changent avec les auteurs et les nuances peuvent être de taille : le principe 15 de la déclaration de Rio de 1992 mentionne un « risque de dommages graves ou irréversibles » ; la loi Barnier de 1995 évoque l’« absence de certitudes » – ce qui n’est pas la même chose qu’un dommage grave ou irréversible – et dispose que la réponse doit être proportionnée au risque et se faire – cet élément est nouveau et important – à un coût économiquement acceptable ; enfin, dans sa communication du 2 février 2000, la Commission européenne a exposé la position de l’Union sur le principe de précaution, qui ne peut être invoqué que dans l’hypothèse d’un risque potentiel et qui ne peut en aucun cas justifier une prise de décision arbitraire.
Pour la Commission européenne, le recours au principe de précaution n’est donc justifié que lorsque trois conditions sont remplies : l’identification des effets potentiellement négatifs, l’évaluation des données scientifiques disponibles et l’étendue de l’incertitude scientifique.
Mes chers collègues, comme l’a rappelé Nathalie Goulet, c’est dans ce contexte difficile que nous devons légiférer. Cette proposition de loi constitue malgré tout un bon point d’équilibre entre avancée technologique et principe de précaution, me semble-t-il.
Je ne vais pas énumérer toutes les dispositions de ce texte qui me semblent aller tout à fait dans le bon sens. Je pense notamment aux mesures facilitant la transmission des informations aux propriétaires et aux habitants ou à l’information des consommateurs et des élus locaux. Bien sûr, nous débattrons également de la façon dont s’organisera la concertation, en sus du comité national de dialogue. Permettez-moi, enfin, d’insister sur les dispositions des articles 5 et 7, qui protègent mieux les enfants, ce qui est peut-être la priorité des priorités.
Cette proposition de loi a déjà été enrichie très largement par la commission. Je voudrais féliciter et remercier le président et rapporteur Daniel Raoul et lui dire que, à titre personnel, je suis tout à fait solidaire des propos qu’il a tenus sur l’indépendance de la commission. Je pense d’ailleurs pouvoir m’exprimer ici au nom du groupe socialiste.
Nous allons encore débattre, et je crois que ce texte va continuer à s’enrichir. Dans ces conditions, le groupe socialiste votera cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur de la commission des affaires économiques, monsieur le président de la commission du développement durable, mes chers collègues, j’ai été, comme nombre d’entre vous ici, concernée par le problème de l’exposition aux ondes électromagnétiques : j’ai rencontré certains concitoyens d’une commune de mon canton qui souffrent réellement de la proximité d’un pylône porteur de plusieurs antennes de téléphonie mobile.
Je connais, comme chacun d’entre vous, des personnes dont l’hypersensibilité aux ondes magnétiques constitue – le mot a été utilisé – une véritable souffrance.
Loin de moi, donc, l’idée de récuser d’entrée de jeu cette proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale après un long débat. Je reconnais qu’il y a des difficultés : elles ont été exprimées sur l’ensemble des travées et je veux dire que je les ai écoutées avec la plus grande attention.
Toutefois, si je salue le formidable travail du rapporteur Daniel Raoul, qui s’est attaché à reconstruire le texte en le simplifiant et en ne retenant que les seuls éléments devant concourir à faciliter « sobriété », « transparence » et « concertation en matière d’exposition aux ondes magnétiques », si je veux saluer la raison qui a cherché à rationaliser un débat en le débarrassant de ce qui relève du domaine du sensible, en tout état de cause et en dépit de ce travail de réécriture, je voudrais m’en tenir à l’esprit des conclusions de « mon » président de la commission du développement durable et relever les trois points principaux qui m’empêcheront de voter ce texte.
Il s’agit tout d’abord des conséquences indues d’un texte exclusivement à charge, qui méconnaît de façon partiale les analyses et conclusions de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail : tout prouve, au regard de ces analyses, que « l’exposition aux ondes magnétiques n’est pas de nature à provoquer des risques avérés, dès lors que sont respectées les limites réglementaires ».
Ces limites réglementaires nécessitent que des contrôles soient effectués et vérifiés. J’ai l’expérience, toujours dans mon canton, de mesures opérées par des organismes non habilités, voire des personnalités, certes honorablement connues, qui présentent à dessein des résultats alarmistes !
Dès lors, la mesure que vous avez introduite consistant à faire de l’Agence nationale des fréquences l’organisme assurant la mise à disposition du public des résultats de mesure des valeurs limites des champs électromagnétiques me paraît être, monsieur le président de la commission des affaires économiques, une sage disposition.
Ma deuxième opposition tient à la conséquence qui ne manquera pas de naître du fait de l’instauration d’une information préalable du maire. Cette dernière s’apparentera assurément très vite à une mise en responsabilité contraire au droit actuel.
Je voudrais, là aussi, signaler les déviations déjà existantes. Qui d’entre nous n’a pas observé, dans des temps rapprochés, la mise en cause directe des maires, tenus pour responsables de l’implantation d’une antenne relais, alors que la responsabilité de la décision échoit au préfet, c’est-à-dire au représentant de l’État ?
Il me paraîtrait de bonne administration, madame la secrétaire d'État, plutôt que de vouloir renforcer le rôle du maire, de rappeler le rôle premier des services de l’État, seuls compétents – j’y insiste – pour donner l’autorisation d’implantation de ces antennes relais sur la base du dossier technique réglementairement requis. Je peux vous assurer que ce rappel de la réglementation serait loin d’être inutile.
J’en viens au troisième point du texte auquel je ne puis apporter ma voix. Il s’agit des dispositions concernant les écoles maternelles, qui se verraient interdire l’installation d’un équipement terminal Wi-Fi dans les lieux d’accueil, de repos et d’activités des enfants.
Permettez-moi d’ignorer ici les difficultés auxquelles seraient confrontés les professeurs des écoles pour assumer leur mission d’éveil des enfants de trois ans des classes maternelles. Je ne veux pas méconnaître, en revanche, les réalités du quotidien. Dites-moi, mes chers collègues, combien y a-t-il aujourd’hui de parents qui n’utilisent pas, y compris devant leurs jeunes enfants, l’ensemble des systèmes informatiques et des appareils que nous avons déjà évoqués, dont le fameux micro-ondes ?
Au total, après avoir écouté vos interventions, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, monsieur le rapporteur pour avis, je crois que cette proposition de loi a manqué sa cible. S’il s’agissait de répondre à un enjeu de couverture de territoire, à un enjeu de compétitivité et d’innovation ou à un enjeu sanitaire et social, le texte aurait dû être tout autre.
Ici, les mots choisis le disent de façon claire et nette, la proposition de loi soulève l’inquiétude, alors que, vous l’avez rappelé, madame la secrétaire d’État, il faut restaurer un climat de confiance.
Il faut en effet restaurer un climat de confiance pour faire face au développement du numérique, qui est incontournable et indispensable pour notre économie, partout sur notre territoire, mais peut-être un peu plus encore dans les zones des nouvelles ruralités.
Il faut restaurer un climat de confiance envers le progrès, celui que la curiosité et l’innovation mettront en mouvement, au bénéfice de nos populations.
Un tel climat de confiance aurait permis d’éviter ces menaces et ces insultes proférées par ceux qui ne voient dans une attitude responsable que de prétendues interventions de lobbies de toute sorte. Malheureusement, madame la secrétaire d’État, il n’en est rien. Je le répète : à vouloir mélanger tous les objectifs, le texte n’en a atteint aucun.
Vous ne serez donc pas étonnés que les membres du groupe RDSE n’apportent pas leurs voix à cette proposition de loi. §

M. Pierre Hérisson . Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, je tiens à saluer, tout d’abord, le travail exceptionnel mené par les membres de la commission des affaires économiques et de la commission du développement durable, ainsi que par leur rapporteur et rapporteur pour avis respectif. Une fois de plus, par leur travail, ils nous ont rappelé que ces deux commissions, en d’autres temps, n’en formaient qu’une.
Sourires.

J’aimerais souligner que nous avons hérité d’un texte pour le moins idéologique, anxiogène, et dont la rédaction était trop floue. Néanmoins, il ne s’agit là que du cours normal de la navette parlementaire !
La présente proposition de loi ouvrait la voie à de nombreux contentieux ; la majorité des membres de cette assemblée en conviendra. Or il incombe au législateur que nous sommes, non pas seulement de proposer des lois ou de les adopter, mais d’anticiper et d’éviter les écueils juridiques que peut susciter tout nouveau texte.
Le travail des commissions a permis de revenir à un texte plus équilibré. Aussi, je me réjouis, avec modestie, de l’adoption en commission d’amendements que nous avions déposés. Je tiens à remercier Bruno Retailleau et Bruno Sido d’être intervenus pour ce faire, concrétisant ainsi la réflexion à laquelle bon nombre de sénateurs, en particulier des membres du groupe UMP, avaient participé.
Je sais aussi avec quelle conviction et quelle hauteur de vue il conviendra de défendre les amendements que nous avons déposés en séance publique, car ils sont indispensables au bon équilibre de ce texte.
À l’article 4, nous avons pensé qu’il était préférable de parler, pour les établissements qui proposent un tel service, d’« accès Wi-Fi », en dépit d’un anglicisme, il est vrai, plutôt que d’« accès sans fil à internet ». En effet, je ne suis pas sûr que les nouvelles générations comprennent l’intérêt de franciser des termes désormais tombés dans le vocabulaire courant.
Des difficultés pourraient apparaître au-delà des problèmes quotidiens qu’implique la technologie, au-delà même de ce qu’en pense la population. À l’article 5, par exemple, il semblait plus pertinent, et plus précis, de restreindre la mention d’un « dispositif permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs radioélectriques » aux seules publicités vantant l’utilisation du téléphone en mode écoute.
Certes, il nous faut veiller à ce que chaque loi respecte le principe de précaution, mais cela n’exclut ni la rigueur ni la précision. Or, à cet instant, il n’existe pas d’études démontrant que l’envoi de SMS est dangereux, en tout cas pas pour la santé.
Sourires.

Le retrait du mot « modération », à l’article 1er, paraît une bonne chose. Le recours à ce terme, bien qu’il ait été motivé par des intentions louables, n’est pas approprié dans cette loi. Modérer, c’est réduire à la notion de limitation ; cela revient, à terme, à créer des seuils minimaux. Il s’agit là d’un autre débat, qui devrait se tenir sur la base de critères scientifiques ou médicaux, autant de ressources dont nous ne disposons pas de manière suffisante. C’est d’ailleurs tout à fait regrettable.
Il faut dire que nous souffrons, depuis une vingtaine d’années, d’une difficulté particulière, mal définie, qu’expliquent à la fois l’inquiétude et la peur : dans une société où le principe de précaution est établi, où les recherches de responsabilité sont souvent longues et prennent un tour judiciaire, nous avons du mal, malheureusement, à trouver des experts ou des scientifiques qui acceptent, tout simplement, de dire s’il y a un danger ou non, alors qu’ils en ont les moyens. Je rappelle pourtant qu’il y a quatre milliards de cartes SIM dans le monde, dont 75 millions dans notre pays.
Sur ce point, les élus locaux sont confrontés à une problématique particulière : ce sont parfois les mêmes personnes qui s’inquiètent des risques que font peser ces technologies sur la santé et qui critiquent les élus, car ceux-ci n’ont pas les moyens suffisants pour couvrir les zones blanches ou mal desservies.
La commission des affaires économiques a donc préféré le terme de « sobriété ». Celui-ci n’est peut-être pas non plus tout à fait satisfaisant.

Néanmoins, il est plus général et peut s’appliquer au principe selon lequel tout abus est dangereux.

Ce principe, d’ailleurs, ne concerne pas seulement les ondes magnétiques ; plus globalement, il a trait à l’hygiène de vie. Sur bien des sujets, on le sait, ce sont les excès qui sont dangereux, et non pas la consommation raisonnable.

M. Pierre Hérisson. Il n’en est pas moins vrai qu’un certain nombre de parlementaires, dont je fais partie, je le reconnais bien volontiers, utilisent probablement avec excès leur téléphone portable, et ce depuis plus d’une vingtaine d’années. C’est en tout cas la réputation de certains d’entre nous, monsieur le président de la commission des affaires économiques, et la mienne en particulier !
Sourires.

Même si le vieux dicton nous apprend que « tout homme bien portant est un malade qui s’ignore », je dois dire que, pour l’instant, je suis bien portant ! J’espère néanmoins que je n’aurai pas à subir les affres que mes lectures sur le sujet me décrivent. Cela dit, je n’ai pas trouvé de démonstration de dangerosité véritablement convaincante.
Pour conclure, vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe UMP ne votera pas le présent texte, du moins dans son état actuel. Nous formons néanmoins des vœux pour que l’essentiel des amendements que nous avons déposés soit adopté ce soir, …

M. Pierre Hérisson. … afin que la proposition de loi soit un peu plus équilibrée et raisonnable. Dans ces conditions, il ne serait pas exclu que nous la votions.
Applaudissements sur les travées de l’UMP.
Je tiens à remercier l’ensemble des intervenants de la qualité de leurs propos, lesquels, néanmoins, reflètent les divergences de vues sur ce sujet, qui passionne nos concitoyens. Ils expriment également la difficulté, non pas de trouver un compromis – il ne s’agit pas de cela ici –, mais de définir une ligne et de s’y tenir.
Il me semble important de rappeler l’objectif de ce texte. Son but n’est pas de trancher un débat scientifique portant sur le risque sanitaire lié à l’exposition aux ondes électromagnétiques ; il est de mettre en place les dispositifs qui permettent de tenir ce débat de manière libre et ouverte, afin de faire œuvre de pédagogie auprès de nos concitoyens.
J’insiste sur l’aspect pédagogique de nos travaux et reprends les propos de M. Labbé, selon lesquels « ce qui est caché et non dit est toujours source d’anxiété et de fantasmes ». L’examen de ce texte, tout comme les concertations qui s’ensuivront dans les territoires, seront, je l’espère, l’occasion de rappeler certaines vérités.
Je veux vous en donner, mesdames, messieurs les sénateurs, quelques exemples.
J’indiquais, il y a un instant, que l’usage, sinon excessif, du moins intensif, d’un téléphone portable est acquis à compter d’environ quinze heures par mois. Or sachez, mesdames, messieurs les sénateurs, que le temps moyen de communication d’un usager français est de deux heures et quarante minutes, soit une durée cinq fois inférieure à un usage défini comme intensif.
Par ailleurs, le niveau d’exposition maximal recommandé par l’Organisation mondiale de la santé est de 41 volts par mètre. Or, en France, le niveau moyen d’exposition est de cinq volts par mètre pour 99, 9 % de la population. Ce seuil est donc huit fois inférieur au niveau maximal d’exposition fixé par l’organisation internationale chargée de ce dossier.
Au reste, pour nos concitoyens qui éprouvent des craintes trop fortes sur ce sujet, il est possible de demander une mesure d’exposition. Le Gouvernement a déployé des outils d’utilisation faciles pour ce faire : la carte des antennes, par exemple, ou d’autres documents à télécharger, donne accès à des commandes de mesure. Les citoyens ne sont donc pas du tout impuissants face à l’installation d’une antenne dans leur quartier.
Enfin, autre vérité qu’il est bon de rappeler, le débit d’absorption spécifique, le DAS, varie beaucoup d’un appareil à l’autre, d’où l’importance, en tant que consommateur avisé, de regarder le niveau de DAS au moment de l’achat d’un appareil. Ce niveau se mesure en watt par kilogramme. Le niveau maximal autorisé en France est de deux kilowatts par kilogramme.
Or les progrès technologiques font que ce niveau tend à baisser et, de ce fait, on obtient des taux assez bas sur les nouveaux appareils. Ainsi, de manière générale, il est inférieur à un watt par kilogramme, donc bien en dessous, là encore, du niveau maximal, et sur la plupart des nouveaux appareils, il se situe plutôt autour de 0, 5 watt par kilogramme. Vous voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, l’utilité de notre débat : il permet de rappeler certaines vérités.
Il faut savoir, du reste, que le déploiement de plus en plus rapide du réseau 4G permet de diminuer les seuils d’exposition, tout comme le recours à la fibre optique. Et qui sait de quoi les technologies seront faites à l’avenir ? Le Li-Fi, c'est-à-dire la transmission d’internet par la lumière, se développe. L’avenir se fera peut-être sans ondes électromagnétiques !
Tout cela pour dire, mesdames, messieurs les sénateurs, qu’il faut dépassionner le débat, le rationaliser, pour rassurer nos concitoyens, lesquels, de manière un peu paradoxale, sont aussi de très grands usagers des outils numériques et demandent, les élus locaux que vous êtes le savent, une couverture du territoire et des débits toujours meilleurs.
Eh bien, cette proposition de loi permet aussi de résoudre ce paradoxe, notamment parce qu’elle érige le débat public en objectif.
Sans vouloir prolonger à l’excès cette intervention, car il nous faut encore examiner les amendements, je souhaite revenir sur certains propos des orateurs qui se sont exprimés au cours de cette discussion générale.
Selon Mme Schurch, l’argument de l’aménagement du territoire ne serait pas fondé. En vérité, je pense qu’il l’est. Et soyez assurée, madame la sénatrice, que je ne suis, disant cela, à la botte d’aucun lobby industriel. Il se trouve simplement que je suis chargée du déploiement du plan « France très haut débit ». À ce titre, j’entends les sollicitations non seulement des élus, mais également de l’ensemble de nos concitoyens, qui réclament un accès internet à haut débit chez eux.
Si nous mettons trop d’obstacles au déploiement, …
… il y a un grand risque de fracture numérique.
Nous aurions une très forte couverture dans les centres urbains très denses et une absence de desserte dans d’autres zones, ce qui exclurait de l’accès au numérique un nombre croissant de nos concitoyens.
La concertation doit, me semble-t-il, rester la plus souple possible et être laissée à l’appréciation des maires, non seulement parce que ces derniers n’aiment pas qu’on leur impose de nouvelles compétences obligatoires, mais aussi parce qu’ils sont les mieux placés pour connaître les attentes de leurs concitoyens. Conférer aux élus locaux un rôle nouveau dans cette procédure de concertation, c’est les respecter. Cela s’inscrit dans la perspective d’un débat démocratique. À cet égard, notre position rejoint le souci de la commission des affaires économiques.
Oui, monsieur Retailleau, le numérique, c’est l’avenir ! Et ce texte n’empêche en aucun cas le progrès technologique. Au contraire, il permet d’apporter des précisions juridiques, donc de diminuer les risques de contentieux. Car les risques s’éloignent au fur et à mesure que les acteurs sont impliqués et que les citoyens se sentent concernés. Le fait de les consulter en amont et de les écouter permet de désamorcer les conflits potentiels. Dès lors que le texte est solide juridiquement, les risques de contentieux se trouvent réduits.
Madame Goulet, vous indiquez que votre « religion n’est pas faite ». Cela tombe bien : sur un sujet où la science est parfois encore incertaine, il s’agit d’objectiver, de rationaliser, et non d’exprimer un acte de foi ! §
Vous avez raison de vous soucier des lanceurs d’alerte. Il se trouve que le Parlement s’est déjà saisi de la question, sur l’initiative de Mme Blandin, du groupe écologiste. En l’occurrence, ce thème n’est pas directement lié à l’objet de la proposition de loi. Mais sachez que le Gouvernement partage cette préoccupation.
Vous avez évoqué à juste titre les objets connectés, qui se déploient effectivement de plus en plus. Mais, à mes yeux, vous en avez parlé d’une manière un peu anxiogène. Dans mes fonctions, j’observe tous les jours le déploiement d’objets connectés permettant d’améliorer nettement le quotidien des gens, notamment en matière de santé, de prévenir par exemple des maladies chroniques mieux que ne le faisait jusqu’à présent la médecine traditionnelle. Les objets connectés offrent donc un formidable potentiel d’amélioration des conditions de vie, individuelles ou collectives.
La proposition de loi ne traite pas des objets connectés : elle concerne les sources d’émissions liées aux communications électroniques, à la téléphonie mobile, non des émissions à partir des objets connectés, ce volet du texte ayant été retiré. Je pense donc que le débat sur les objets connectés n’a pas lieu d’être dans la présente discussion.
Je suis d'accord avec M. Dilain : l’équilibre consiste non pas à essayer de satisfaire tout le monde, mais à trouver une juste articulation entre des enjeux qui peuvent paraître contradictoires si on ne sait pas les concilier : d’une part, le progrès et l’innovation ; d’autre part, le respect des attentes et des inquiétudes de nos concitoyens. J’estime que le texte répond à cet objectif.
Madame Escoffier, le rapport de l’ANSES précise effectivement qu’il faut respecter les limites réglementaires, conformément au cadre législatif actuel. Vous regrettez que certaines mesures soient prises par des organismes non habilités. C’est une réalité : tout le monde peut réaliser des mesures ; d’où l’importance d’encadrer plus encore les procédures. C’est l’objectif visé dans la proposition de loi.
En revanche, je ne peux pas vous suivre lorsque vous dites, pour le déplorer, que le préfet, donc le représentant de l’État, n’est pas impliqué. Il l’est : le texte affirme expressément son rôle, parallèle à celui du maire, dans la procédure de concertation.
Je rappelle d’ailleurs qu’il s’agit de répondre à des préoccupations non pas sanitaires, mais bien citoyennes. L’enjeu n’est pas seulement de mesurer les effets biologiques des ondes. À titre de comparaison, lorsque vous allez à la plage, le soleil a un effet biologique sur votre peau, mais il n’a pas d’effet sanitaire si vous respectez un minimum de règles quant au temps d’exposition et si vous vous protégez en mettant de la crème solaire. Je reconnais que cette analogie peut paraître simpliste, mais c’est un peu la même chose s’agissant des ondes électromagnétiques.
Enfin, je suis d’accord avec M. Hérisson lorsqu’il relève cette contradiction : certains de nos concitoyens qui n’acceptent pas l’installation d’une antenne près de chez eux sont parfois les premiers à regretter l’insuffisance de la couverture ou la faiblesse du débit internet dans les lieux qu’ils fréquentent, y compris, donc, chez eux.
Voilà pourquoi il est utile de confier une responsabilité au maire, qui, connaissant ses concitoyens, peut réussir à désamorcer des inquiétudes et à identifier les préoccupations prioritaires.
Tels sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les éléments dont je souhaitais vous faire part avant l’examen des amendements.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
TITRE IER
SOBRIÉTÉ DE L’EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES, INFORMATION ET CONCERTATION LORS DE L’IMPLANTATION D’INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES

Sur l’intitulé du titre Ier, je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 16 rectifié, présenté par MM. Sido et Retailleau, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet intitulé :
Information et concertation lors de l'implantation d'installations radioélectriques
La parole est à M. Bruno Sido.

Cette intervention me permettra de m’exprimer sur l’ensemble de la proposition de loi, notamment sur l’article 1er, qui est le plus important.
Les propos de Mme la secrétaire d’État m’ont paru mesurés, balancés, et je les approuve en grande partie.
Je partage également le point de vue de notre collègue Anne-Marie Escoffier.

Mais oui ! C’est comme pour le nuage de Tchernobyl, qui s’était arrêté à la frontière…

Il s’agit en effet d’un texte idéologique, d’un texte à charge.
Tout prouve aujourd'hui qu’il n’y a aucun risque avéré si les expositions sont inférieures au niveau réglementaire.
Je salue également la commission des affaires économiques, en particulier son rapporteur, M. Daniel Raoul. Il est vrai que c’est un ancien membre éminent de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. En tant que président de cette instance, j’en reconnais bien là la marque : un travail sérieux et de qualité !
Certains principes ont été brandis, parfois à tort et à travers, notamment lorsqu’ils n’avaient juridiquement rien à voir avec le sujet. Ainsi, le principe de précaution, qui fait partie de notre bloc de constitutionnalité, concerne seulement l’environnement ; il ne s’applique dans aucun autre domaine. Je crois qu’il est utile de le rappeler.
Des collègues ont également agité des peurs ; c’est une tactique qui peut toujours servir ! Sauf que les peurs en question ne produisent des effets que dans les zones bien loties en termes de couverture !
Pour ma part, je pense, et je ne suis pas le seul dans cet hémicycle, aux territoires ruraux qui attendent encore une couverture convenable, honnête, une couverture de qualité et, demain, une couverture de quatrième génération. Les populations concernées ne tremblent pas en permanence à cause des ondes électromagnétiques, qui ne viennent d’ailleurs pas seulement, il s’en faut de beaucoup, de la téléphonie mobile, de la Wi-Fi ou du Bluetooth ; la télévision, le four à micro-ondes, etc., en émettent également ! Et les gens n’en ont pas peur !

Ils attendent, avant tout, une couverture correcte !
Or je considère que ce texte va constituer une entrave au déploiement des installations et à la bonne couverture du territoire français, en particulier dans les zones rurales. Il faut donc le corriger. D’ailleurs, cela a commencé à être fait, et dans la bonne direction – j’y reviendrai en présentant d’autres amendements –, grâce au travail de M. le rapporteur.
L’amendement n° 16 rectifié vise à changer l’intitulé du titre Ier de la proposition de loi, afin de le faire mieux correspondre au texte réécrit par la commission, ce dont je remercie une nouvelle fois M. le rapporteur.

L'amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Hérisson et Lenoir, Mme Masson-Maret et M. Sido, est ainsi libellé :
Remplacer le mot :
sobriété
par le mot :
maîtrise
La parole est à M. Bruno Retailleau.

Trois arguments justifient selon nous la substitution du mot « maîtrise » au mot « sobriété ».
D’abord, le terme de « maîtrise » est celui que l’ANSES a choisi dans son avis de 2013, dont certaines des recommandations sont placées sous la rubrique : « En matière de maîtrise des niveaux d’exposition ».
Ensuite, si nous savons bien ce que signifie « maîtrise », la « sobriété » ne correspond à aucun concept juridique.
Enfin, au mois de mai 2013, le Premier ministre d’alors avait chargé M. Tourtelier, ancien député, et M. Girard, conseiller d’État, de faire le point sur le sujet. Leurs conclusions sont claires : « Il ne nous semble pas pertinent de faire figurer dans la loi un principe de sobriété en tant que tel, par rapport auquel les exégètes et les juristes se perdraient en conjectures et en contentieux sans que l’exposition en soit diminuée ou que le débat public local y gagne. »
Nous vous proposons donc d’en tirer les conséquences. À défaut, je m’interrogerais sur l’utilité de commander des rapports. Pourquoi solliciter un ancien député et un conseiller d’État si le Gouvernement n’a pas l’intention de tenir compte de leurs conclusions ? Sauf erreur de ma part, nous n’avons pas – pour l’instant – changé de Président de la République !
J’ajouterai, madame la secrétaire d’État, vous ayant entendue, que cet amendement va aussi dans le sens de la cohérence par rapport au sens que vous donnez à ce texte. Vous avez en effet affirmé voilà quelques instants que l’enjeu central de cette proposition de loi, c’était la citoyenneté et la pédagogie, et non la souffrance, se traduisant éventuellement par des malaises, des personnes hypersensibles aux ondes. Je vous prends au mot : en remplaçant le mot « sobriété » par celui de « maîtrise », vous obtiendrez le même résultat en matière de pédagogie et de citoyenneté tout en défaisant le nid à contentieux que vous êtes en train de créer avec la rédaction actuelle.
Autant on sait ce que la sobriété signifie lorsqu’on parle de consommation d’alcool ou de tabac, autant on ignore les conséquences juridiques que l’emploi de ce terme pourrait avoir dans le domaine qui nous occupe aujourd'hui.

L'amendement n° 25, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Remplacer le mot :
sobriété
par le mot :
modération
La parole est à M. Joël Labbé.

Notre collègue Bruno Retailleau vient d’évoquer un avis de l’ANSES, mais aussi le rapport de MM. Tourtelier, Girard et Le Bouler qu’avait commandé le Gouvernement. Or ceux-ci ont passé plus d’une demi-heure à nous expliquer que le terme de « modération » était le plus pertinent. N’est-ce pas, monsieur le président de la commission des affaires économiques ?
« Modération de l’exposition aux champs électromagnétiques », cela dit bien ce que cela veut dire, alors que « sobriété de l’exposition » me paraît poser problème, ne serait-ce qu’au regard de la langue française. La sobriété, c’est plutôt un état de fait – on est sobre ou on ne l’est pas –, alors que la modération, le fait de se modérer, donc de rechercher la sobriété, est une démarche active, tendant à réduire une consommation ou, en l’occurrence, des émissions d’ondes.

Je note d’abord que, dans l’amendement n° 16 rectifié, est complètement gommé l’objectif de sobriété, ou de maîtrise, ou de modération. Or c’est bien cet objectif qui est au cœur du texte. Eu égard à cet « oubli » d’un élément fondamental, l’avis de la commission ne peut qu’être défavorable.
Quant aux amendements n° 3 rectifié et 25, qui ont en commun le rejet du mot « sobriété », l’un tendant à y substituer le mot « maîtrise », l’autre, le mot « modération », je dois dire qu’ils me laissent tous deux perplexe… J’y suis également défavorable, mais j’inviterai Joël Labbé à faire preuve de cohérence. Il a en effet déposé, à l’article 4, un amendement n° 34 rectifié, où il introduit lui-même l’objectif de sobriété et sur lequel la commission émettra d’ailleurs un avis favorable. Alors, soyez cohérent, mon cher collègue, et acceptez le mot « sobriété » dans l’intitulé du titre Ier !
Sur l’amendement n° 16 rectifié, il me semble effectivement paradoxal de vouloir supprimer de l’intitulé du titre Ier l’objectif même de la proposition de loi.
Il est important de rappeler que le principe de sobriété est un objectif et c’est sur la mise en œuvre, ou non, de ce principe que la jurisprudence devrait se fonder à l’occasion d’un contentieux. Or, en l’occurrence, le choix d’une terminologie plutôt que d’une autre n’aura pas d’incidence sur le dispositif de mise en œuvre de la concertation ni sur la décision prise par l’Agence nationale des fréquences.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Sur l’amendement n° 3 rectifié, je souligne que l’utilisation du mot « maîtrise » fait spontanément jaillir la question : qui maîtrise ? L’emploi de ce terme implique tout de même que l’exploitant d’une installation radioélectrique puisse contrôler l’ensemble des paramètres de l’exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce n’est pas réaliste et ce n’est pas le choix opéré dans ce texte.
Le Gouvernement est donc également défavorable à cet amendement.
Concernant l’amendement n° 25, il faut, me semble-t-il, comme je l’ai expliqué dans mes propos liminaires, revenir à l’esprit du texte. Celui-ci met l’accent sur la mise en œuvre de la procédure de concertation, des obligations d’information à l’égard du public, de la possibilité pour les habitants d’être consultés, avec une spécificité qui est celle du régime du traitement des points atypiques. Telle est l’architecture d’ensemble de la proposition de loi.
Monsieur Labbé, il me semble que, dès lors que « votre amendement n° 34 rectifié, auquel M. le rapporteur a fait allusion et qui sera examiné ultérieurement, tend à remplacer le mot « maîtriser » par l’expression « assurer la sobriété », vous devez, en toute logique et par cohérence, accepter l’emploi de ce terme comme objectif dans le titre Ier.
Le Gouvernement est donc défavorable à votre amendement n° 25.
L'amendement n'est pas adopté.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l'amendement n° 3 rectifié.

Tout le monde évoque les termes en question comme si chacun d’entre eux présentait des risques. Il serait peut-être bon d’en revenir au dictionnaire.

Du coup, on s’apercevrait que faire preuve de « modération », c’est s’efforcer à la pondération, c’est tempérer. Voilà pourquoi notre choix initial s’était porté sur ce mot.
M. le rapporteur propose que le consensus se fasse sur le mot « sobriété ». La sobriété, c’est l’absence de superflu. Alors, c’est un peu comme dans l’agriculture « raisonnée » : on arrête de mettre trop de pesticides au-delà du seuil fixé par la loi. §On sera peut-être obligé d’en arriver là…
Quant à la maîtrise, monsieur Retailleau, je remarque que ce terme est utilisé dans l’expression « maîtrise des émissions en matière de composés organiques volatils des produits de peinture automobile ». Voilà la définition exacte qui en est donnée : « C’est un outil pour les secteurs industriels permettant des schémas de maîtrise, donnant des éléments aux acteurs de nature à leur permettre d’appréhender correctement la réglementation. C’est une alternative aux valeurs limites. »
Là, on n’est plus dans l’agriculture raisonnée, on est dans la transgression de la loi ! Donc, pour nous, la maîtrise, c’est hors de question ! §

C’est extraordinaire ! On va bientôt faire du droit à l’aide de dictionnaires !
Je l’ai dit, ma chère collègue, c’est le terme qui est utilisé par l’ANSES. Pensez-vous que cette agence, dans ses rapports, ses recommandations, ses avis, joue avec la santé des Français ?

Par ailleurs, le conseiller d’État Jean-François Girard et le député Philippe Tourtelier avaient indiqué que le principe de sobriété était un nid à contentieux. Cela, ils ne l’ont sans doute pas trouvé dans le dictionnaire, mais ils ont travaillé et, au terme de leur réflexion, ils sont arrivés à cette conclusion.
C’est donc avec un peu de bon sens que nous proposons le terme de « maîtrise » plutôt que celui de « sobriété ».
L'amendement n'est pas adopté.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote sur l'amendement n° 25.

J’aimerais obtenir une précision.
Si j’ai bien compris ce que vous nous avez dit, madame la secrétaire d’État, le mot « modération » n’est pas acceptable en l’état parce que, dans l’amendement n° 34 rectifié à l’article 4, il est question de « sobriété ».

Cela ne me semble pas être un très bon argument. La notion de modération me paraît meilleure que celle de sobriété dans la mesure où elle se rapproche de l’objectif et ne pose pas de difficulté. Refuser un amendement au motif qu’un autre sera accepté trois articles plus loin ne constitue pas un argument valable. Moi, en tout cas, j’ai assez envie de voter cet amendement n° 25.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.
I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après le 12° bis du II de l’article L. 32-1, il est inséré un 12° ter ainsi rédigé :
« 12° ter À la sobriété de l’exposition du public aux champs électromagnétiques ; »
2° L’article L. 34-9-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 34 -9 -1. – I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l’article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.
« Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant à des exigences de qualité.
« Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l’Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à disposition du public.
« Lorsqu’une mesure est réalisée dans des immeubles d’habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Ces résultats mentionnent le nom de l’organisme ayant réalisé la mesure. Tout occupant d’un logement peut avoir accès, auprès de l’Agence nationale des fréquences, à l’ensemble des mesures réalisées dans le logement.
« II. –
Supprimé
« III. – A. – Toute personne qui exploite, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à autorisation ou avis de l’Agence nationale des fréquences transmet au maire ou au président de l’intercommunalité, à sa demande, un dossier établissant l’état des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement.
« B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à autorisation ou avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.
« Toute modification substantielle d’une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d’autorisation auprès de l’Agence nationale des fréquences fait également l’objet d’un dossier d’information remis au maire au moins deux mois avant le début des travaux.
« Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement.
« C. – Le dossier d’information mentionné au premier alinéa du B du présent III comprend une estimation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. Des mesures peuvent être effectuées, à la demande écrite du maire ou du président de l’intercommunalité, aux fins de vérifier la cohérence de l’exposition effectivement générée avec les prévisions de l’estimation réalisée dans les six mois suivant la mise en service de l’installation.
« C bis (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre d’une procédure d’information et de concertation du public, à l’initiative et sous l’autorité du maire ou du président de l’intercommunalité, préalablement à l’autorisation d’exploitation d’une installation radioélectrique par l’Agence nationale des fréquences, à laquelle le bilan de la concertation est adressé. Ce décret détermine également les conditions de saisine d’une instance de concertation départementale chargée d’une mission de médiation relative à toute installation radioélectrique.
« D. – Il est créé au sein de l’Agence nationale des fréquences un comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité participe à l’information des parties prenantes sur les questions d’exposition du public aux champs électromagnétiques L’agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l’ensemble des mesures de champs électromagnétiques ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champ dans les points atypiques.
« La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par un décret en Conseil d’État.
« E. – Les points atypiques sont définis comme les points de mesure, situés dans les lieux de vie fermés, où les expositions du public aux champs électromagnétiques sont les plus fortes à l’échelle nationale et peuvent être réduites, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus. Les paramètres caractérisant un point atypique sont déterminés par l’Agence nationale des fréquences et font l’objet d’une révision régulière en fonction des données d’exposition disponibles.
« Un recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque année par l’Agence nationale des fréquences. L’agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Elle veille à ce que les titulaires des autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques impliqués prennent, sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause. L’Agence nationale des fréquences établit un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques.
« F. –
Supprimé
« IV. –
Supprimé
3° L’article L. 34-9-2 est abrogé ;
4° La première phrase du cinquième alinéa du I de l’article L. 43 est complétée par les mots : « ainsi que de l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32-1 ».
II
III

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Hérisson et Lenoir, Mme Masson-Maret et M. Sido, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 12° ter À la maîtrise de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, consistant à mesurer, caractériser et contrôler les niveaux d’exposition du public à l’ensemble des appareils, installations et dispositifs radioélectriques, leurs variations dans le temps et dans l’espace ainsi que leur évolution liée au déploiement de nouveaux services et de nouvelles technologies ; »
La parole est à M. Bruno Retailleau.

Avec cet amendement, qui procède de la même inspiration que l’amendement que nous aurions aimé voir retenu dans l’intitulé du titre Ier, je reviens sur l’objectif de sobriété.
Tout à l’heure, le rapporteur et président de la commission des affaires économiques nous expliquait que la sobriété n’était qu’un objectif. Il nous a aussi expliqué qu’il donnerait ultérieurement un avis favorable sur l’amendement n° 34 rectifié, présenté par Joël Labbé, qui tend à introduire le mot « sobriété » dans le texte de l’article 4. Cela signifie que le principe de sobriété ne figurera donc pas dans le texte comme un simple ornement : il sera au cœur de la proposition de loi.
Je maintiens que le principe de sobriété n’a aucune valeur juridique, qu’il est déconnecté du principe de précaution et qu’il est inspiré – comme nous l’exposera Mireille Schurch dans quelques instants en présentant son amendement n° 8 –par le concept anglo-saxon ALARA, qui n’a rien à voir avec nos normes juridiques.
Nous persistons donc dans notre position, en espérant que, cette fois-ci, nous aurons su vous convaincre.

L'amendement n° 26, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
sobriété
par le mot :
modération
La parole est à M. Joël Labbé.

C’est un amendement de cohérence mais, en toute logique, je le retire puisque la modération n’a pas été retenue tout à l’heure.

L'amendement n° 26 est retiré.
L'amendement n° 8, présenté par Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
consistant à ce que le niveau d’exposition de la population aux champs électromagnétiques soit le plus faible possible en conservant un bon niveau de service
La parole est à Mme Mireille Schurch.

Il y a quelques jours, s’est tenu au Sénat un colloque sur l’écriture de la loi. De nombreuses tables rondes s’interrogeaient sur la qualité de la loi, parfois trop vague et trop bavarde. C’est dans ce contexte que je souhaite inscrire la défense de mon amendement.
Le ministre chargé des communications électroniques et l’ARCEP ont pour mission de veiller à « un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population ». Cette disposition est un acquis important, qu’il convient de préserver.
Dans le même ordre d’idées, le choix a été fait d’introduire dans la proposition de loi un autre objectif, complémentaire à la recherche de cette protection, celui de la sobriété de l’exposition du public aux champs électromagnétiques.
Là encore, nous pensons que cela est un réel progrès. Toutefois, nous devons préciser la teneur de cet objectif en le définissant. Sinon, il risque de rester une coquille vide sans portée normative. Or un des reproches faits au législateur est d’être trop bavard et de manquer de clarté, voire d’efficacité ! Nous proposons donc de donner un contenu précis au principe de sobriété, que nous venons de voter.
Sans s’engager dans une définition chiffrée, afin d’éviter un encadrement excessif de l’action publique par des valeurs que l’évolution technique rendrait de toute façon rapidement inadaptées, il conviendrait néanmoins de reprendre la définition « aussi bas que raisonnablement possible », soit la définition même du principe ALARA, utilisé par exemple par l’Autorité de sureté nucléaire et base de la radioprotection.
Ce principe, connu et reconnu au niveau international, se décline en trois temps : la justification, l’optimisation et la limitation des doses d’exposition individuelle.
Nous vous invitons à donner une portée à l’objectif de sobriété défini dans cette proposition de loi en votant cet amendement, l’idée étant de permettre une moindre intensité des antennes relais tout en préservant la qualité du réseau.
J’ajouterai que les émissions d’antennes relais, nous les subissons vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ce qui n’est pas le cas avec d’autres appareils.

Monsieur Retailleau, si vous lisez bien le texte, vous constaterez que le mot « principe » n’est employé nulle part, ce qui désarme quelque peu votre argumentation.

Nous avons sciemment fixé un objectif, et non un principe, sur le modèle des 21 objectifs qui existent déjà dans le code des postes et communications électroniques. Il n’y a donc aucun problème juridique.
Monsieur Labbé, je vous remercie d’avoir retiré votre amendement n° 26, faisant ainsi preuve de la cohérence à laquelle je vous avais précédemment appelé.
Madame Schurch, j’ai un problème avec votre amendement ! §

Certes !
Il vise à définir la sobriété comme un principe ALARA.
Selon l’amendement, l’objectif de sobriété consiste à faire en sorte que « le niveau d’exposition de la population aux champs électromagnétiques soit le plus faible possible en conservant un bon niveau de service ». Mais comment faire quand on sait que le bon niveau de service varie selon les appareils radioélectriques ?
Ne sachant pas comment on peut appliquer le principe ALARA, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.
Sur l’amendement n° 4 rectifié bis, l’avis du Gouvernement est le même que celui de la commission.
Je remercie M. Labbé d’avoir su faire preuve de « modération » – pardonnez-moi ce jeu de mots ! §– en retirant son amendement.
L’amendement n° 8 introduit le principe ALARA, soit as low as reasonably achievable, autrement dit « aussi bas que c’est raisonnablement envisageable –, dont je rappelle qu’il est appliqué à l’industrie nucléaire. Si on l’utilisait en l’espèce, cela pourrait, me semble-t-il, ouvrir la porte à une multiplication des contentieux et créer un climat d’incertitude qui risquerait de freiner terriblement l’investissement.
En effet, l’application de ce principe reviendrait à inverser totalement la charge de la preuve. Il faudrait, par conséquent, complètement redimensionner le réseau. On entrerait alors dans un cercle vicieux : à certains endroits, le nombre d’antennes devrait être multiplié et, à d’autres, diminué. Il ne serait pas réaliste d’ouvrir une telle période d’incertitude.

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote sur l'amendement n° 4 rectifié bis.

Nous sommes là au cœur du texte, et je remercie Mme Schurch d’avoir pointé, avec le principe ALARA, une véritable question juridique.
Madame la secrétaire d’État, vous avez évoqué la légistique, c'est-à-dire la science qui consiste à bien faire la loi. Le Conseil constitutionnel, encore récemment par la voix de son président, et le Conseil d’État nous rappellent souvent, à nous législateurs, que la loi doit d’abord être normative. Elle ne peut pas toujours bavarder ; elle doit poser des normes.
Si, comme Daniel Raoul ne cesse de me le répéter, la sobriété est proclamée comme un objectif et non comme un principe, cela revient à la vider de son sens et, une fois de plus, on fait bavarder la loi ! C'est une supercherie de faire croire aux personnes qui souffrent d’hypersensibilité que l’on réglera leurs problèmes. Madame la secrétaire d’État, vous l’avez d’ailleurs dit de façon tout à fait honnête, 99, 9 % des Français sont exposés à un niveau de fréquence huit fois moindre que la norme fixée par l’OMS.
Je veux aussi m’adresser au groupe écologiste. Pourquoi définir un objectif de sobriété s’il n’est pas relié au principe ALARA, qui est le seul moyen, comme l’a dit Mme Schurch, de lui donner du sens ? Ce n’est pas une bonne façon de faire la loi : on bavarde, on jette des mots apaisants qui n’auront, pour les personnes hypersensibles, strictement aucune portée autre que théorique et poétique !
L'amendement n'est pas adopté.

La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote sur l'amendement n° 8.

Madame la secrétaire d’État, la définition de la sobriété que je vous propose est très équilibrée. Sans définition, on reste dans le vague, et c’est sans doute ce que vous souhaitez.
Mon amendement indique très clairement qu’il faut aller vers un niveau d’exposition « le plus faible possible » tout en conservant un bon niveau de service. Nous n’avons pas indiqué un chiffre précis, car il serait impossible à déterminer.
Je le redis, ma proposition est extrêmement équilibrée ; elle permet de préciser ce qu’est la sobriété. Sinon, nous ne faisons que chanter !
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Hérisson et Lenoir, Mme Masson-Maret et M. Sido, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
à des exigences de qualité
par les mots :
aux exigences de qualité fixées par décret
La parole est à M. Bruno Retailleau.

Il ne s’agit pas d’un amendement rédactionnel ; chaque terme a un sens. Il vise à revenir à la rédaction actuelle de l’alinéa 6 de l’article 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques.
La jurisprudence du Conseil d’État sur les compétences des maires en matière d’urbanisme par rapport au pouvoir régalien de l’État, par l’intermédiaire de l’ANFR, insiste sur la nécessité, dans les domaines techniques, de se référer à un organisme indépendant.
Cet amendement permet de répondre aux conditions posées par la jurisprudence.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 47, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 10 (première phrase) et 11
Remplacer le mot :
autorisation
par le mot :
accord
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement rédactionnel permet de mettre le texte de la proposition de loi en conformité avec les dispositions existantes du code des postes et des communications électroniques.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 17 rectifié, présenté par MM. Sido et Retailleau, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Après les mots :
d'information
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, dans un délai fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement.
La parole est à M. Bruno Sido.

Les délais des dispositifs d’information et de concertation avec la mairie doivent, dans le respect de l'intérêt général – c'est très important –, être aussi maîtrisés et encadrés que possible, sauf à risquer de voir la durée d'installation moyenne d’antennes relais s'allonger encore.
Je rappelle que quelque 600 jours séparent ordinairement l’expression du besoin de l’installation. Bel exemple de la France immobile ! Je pense qu’il est tout de même possible d’améliorer la situation !
La création, prévue dans le texte, d'un nouveau délai de deux mois en amont du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, qui augmenterait encore de soixante jours la durée d’attente avant l’installation, n'apparaîtra pas d’une utilité évidente à nos concitoyens.
C'est la raison pour laquelle mon amendement en prévoit la suppression, à charge pour le Gouvernement de fixer, par voie réglementaire, ce qu’il sait très bien faire, un nouveau délai plus bref, plus pertinent, et donc mieux adapté.

J’ai bien compris que M. Sido voulait renvoyer la fixation du délai à un arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement. Je ne suis pas favorable à cet amendement. Je considère que le délai de deux mois suffit amplement.
Monsieur le sénateur, vous le disiez vous-même, avant d’investir, les opérateurs ont besoin de visibilité et de sécurité juridique. Il faut arrêter un délai : celui de deux mois correspond à ceux choisis dans la plupart des chartes conclues entre opérateurs et collectivités locales.
Par ailleurs, ce délai a été repris par les travaux du COPIC sur la base des expérimentations menées dans plus d’une dizaine de villes.
Il s’agit d’inscrire dans la loi un délai qui est déjà largement expérimenté dans la pratique.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 48, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer les mots :
d’autorisation auprès de l’Agence nationale des fréquences fait également l’objet d’un dossier d’information remis au maire
par les mots :
d’accord ou d’avis auprès de l’Agence nationale des fréquences et susceptible d’avoir un impact sur le niveau de champs électromagnétiques émis par celle-ci fait également l’objet d’un dossier d’information remis au maire ou au président de l’intercommunalité
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Il s’agit d’un amendement de précision qui vise à circonscrire l’obligation d’information à destination du maire aux seules modifications des installations radioélectriques qui ont un impact sur le niveau des champs émis par ces installations, telles que les rehaussements d’antenne, la modification de la puissance de celles-ci, de leur orientation ou du faisceau principal d’émission, le changement de technologie, l’ajout d’une bande de fréquences.
En réalité, nombre des modifications techniques réalisées très régulièrement par les opérateurs sur les antennes sont mineures, mais elles nécessitent néanmoins un accord de l’ANFR.
Il serait disproportionné de soumettre de telles modifications à l’obligation systématique de transmission d’informations dès lors que cette transmission a uniquement pour objet d’accroître la transparence en matière d’exposition du public aux ondes.
Ainsi, les maires ne seraient pas noyés sous un flot de dossiers qui n’intéresseraient finalement que très peu leurs concitoyens.

L'amendement n° 42, présenté par MM. Hérisson, Retailleau et Lenoir, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Après le mot :
fréquences
insérer les mots :
et des travaux sur site
La parole est à M. Pierre Hérisson.

Cet amendement vise à préciser que les modifications substantielles qui font l’objet d’un dossier d’information sont celles qui nécessitent, d’une part, une demande d’autorisation de l’ANFR et, d’autre part, des travaux sur site.
L’amendement écarte ainsi les très nombreuses modifications courantes qui sont réalisées à distance, sans travaux sur site, dans la gestion au quotidien d’un réseau de téléphonie mobile.
Cet amendement répond à un objectif de cohérence : il permet que les demandes formulées par nos concitoyens soient satisfaites rapidement.

L’amendement n° 48 vise à restreindre l’obligation d’information aux modifications des installations radioélectriques ayant une incidence sur le niveau de champs électromagnétiques émis. En effet, changer un amplificateur ou une antenne dans le cadre d’une simple opération de maintenance ne paraît pas devoir emporter une telle obligation dès lors que le niveau des émissions reste inchangé.
Je préfère la rédaction proposée par le Gouvernement à celle que nous soumet notre collègue Pierre Hérisson, qui vise à introduire le critère des travaux sur site. En effet, ceux-ci peuvent être de natures très différentes, alors que ce qui nous préoccupe, c’est le changement du niveau des champs qui pourrait résulter d’une intervention sur l’installation.
Je remarque que cet amendement serait satisfait par l’adoption de l’amendement n° 48 du Gouvernement.

La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote sur l'amendement n° 48.

Monsieur le rapporteur, quid du changement de l’azimut d’une antenne, qui, sans modifier le niveau de champs, peut impacter une partie de la population qui n’était pas concernée jusque-là ?
Nous sommes prêts à suivre le Gouvernement, mais nous avons besoin d’être éclairés sur ce point.

Pour un changement d’azimut ou d’inclinaison, il faut un avis de l’ANFR, de manière à s’assurer, notamment, qu’il n’y a pas d’interférences. L’amendement du Gouvernement couvre donc bien ce cas.

Madame le secrétaire d’État, je veux être sûr de bien comprendre : que devient l’obligation d’information en cas de mutualisation parfaite sur un site, à savoir en cas de partage de fréquences ? Entre-t-elle ou non dans le champ de la restriction ?
En outre, que se passe-t-il en cas de passage de la 3G à la 4G pour une même antenne ? Y a-t-il « modification substantielle » ?
Pardonnez-moi si mes propos n’ont pas été clairs. Ce qui importe, c’est la notion de modification substantielle.
Dans les exemples que j’ai cités, comme le changement de l’orientation du faisceau, l’avis de l’AFNR est obligatoire dans tous les cas.
À l’inverse, l’obligation d’information à destination du maire ne s’impose pas en cas de modifications techniques mineures.
La mutualisation, le changement de niveau, le passage de la 3G à la 4G me semblent a priori constituer des modifications substantielles, qui impliquent donc un avis obligatoire de l’ANFR.
L'amendement est adopté.

En conséquence, l'amendement n° 42 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Sido et Retailleau, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Après les mots :
au maire
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
avant le début des travaux, dans un délai déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement.
La parole est à M. Bruno Sido.

Bien que cet amendement concerne un autre domaine que le précédent, j’utiliserai les mêmes arguments pour le défendre.
Il va de soi que les délais des dispositifs d’information et de concertation avec la mairie doivent, dans le respect de l'intérêt général, être aussi maîtrisés et encadrés que possible, sauf à risquer de voir la durée d'installation moyenne d’antennes relais s'allonger encore. On en est déjà à 660 jours, l’amendement que j’ai défendu tout à l'heure ayant été rejeté ! Eh bien, on va encore ajouter 60 jours, soit un total de 720 jours !

Monsieur le rapporteur, vous avez beau protester, mes additions sont justes ! Tous ces délais s’ajoutent et se surajoutent.

Monsieur le rapporteur, vous pourrez vous exprimer tout à l'heure !
En attendant, mes chers collègues, à force de prévoir des délais qui s’ajoutent les uns aux autres, on finit par ne plus pouvoir rien faire, dans ce pays ! C’est cela que je voudrais faire pénétrer dans les consciences des uns et des autres ! La France devient un pays sclérosé, où, de principe de précaution en principe de ceci, principe de cela, on ne peut plus rien faire !
Un nouveau délai de deux mois en cas de modification substantielle d'une installation radioélectrique semble d'une durée excessive.

Je ne dis pas qu’il ne faut pas se concerter pour prévenir les éventuels problèmes : je dis qu’il n’y a pas besoin de soixante jours pour le faire ! Cette durée est excessive et risque, monsieur le rapporteur, de ralentir le déploiement d'équipements dont les territoires ruraux ont particulièrement besoin.
Mes chers collègues, soyez assurés que, ici, je continuerai de défendre bec et ongles les espaces ruraux !

Oh, vous, vous ne savez que défendre les villes, les quartiers, etc. !
Je répète que je défendrai sans relâche les territoires ruraux et c’est dans cet esprit que je demande au Gouvernement de prévoir par voie réglementaire un nouveau délai, en tout état de cause plus bref et donc mieux adapté.

M. Daniel Raoul, rapporteur. Je ne sais pas pourquoi M. Sido s’énerve ainsi… J’ai l’impression que nous ne sommes pas sur la même longueur d’onde !
Sourires.
Nouveaux sourires.

Cher collègue, l’alinéa 11 de l’article 1er prévoit un délai de deux mois pour l’implantation de nouvelles installations. L’alinéa 12 prévoit, quant à lui, un délai de soixante jours en cas de modification d’une installation radioélectrique existante. Ces deux opérations n’ont donc rien à voir l’une avec l’autre et vous ne pouvez donc pas additionner les délais !
Il semble qu’il y ait une incompréhension. Elle doit être levée.
Le délai de deux mois relevant de la procédure de concertation en cas d’installation de nouvelles antennes ne peut s’additionner au délai de deux mois qui court en cas de mise à niveau, de maintenance opérationnelle ou de modifications d’ordre technique apportées à une antenne déjà installée.
Ces deux cas de figure sont bien distincts, et il ne s’agit aucunement de prolonger les délais existants.

Monsieur le rapporteur, madame la secrétaire d’État, je veux vous expliquer, très calmement, …

… que, si cette réglementation est peut-être justifiée dans l’absolu, en milieu rural, les opérateurs s’en servent pour retarder au maximum leurs interventions.
Or, en milieu rural, la population, qui passe peu de temps dans les transports en commun, puisqu’il n’y en a pas, a le temps de regarder les antennes et de réfléchir. Elle se dit qu’il suffirait de décaler un tout petit peu l’antenne pour bénéficier d’une meilleure couverture. Eh oui, on pense en milieu rural ! Cependant, les opérateurs invoquent la réglementation, qui les empêcherait d’agir, leur imposerait de respecter des délais ou d’organiser une concertation, tout cela pour justifier en fait leur inaction. Telle est, hélas ! la réalité quotidienne.
En milieu rural, nous allons fibrer tous les pylônes préexistants pour leur permettre de transmettre la quatrième génération de téléphonie mobile, que nous attendons toujours. Monsieur le président, je suis sûr que vous procédez ainsi dans votre département, tant qu’il existe encore !
Sourires.

J’explique simplement ce qui se passe en milieu rural !
Si, donc, les flux d’information sont plus importants, les expositions aux ondes électromagnétiques, extrêmement dangereuses, bien entendu, comme chacun sait, le seront aussi. Il n’y a qu’à interroger les habitants de la butte Montmartre, qui vivent depuis cent ans en face de la Tour Eiffel, s’ils ont l’impression d’être condamnés à mourir prématurément !

C’est effectivement la bonne question, monsieur Retailleau !
Mon amendement vise à relayer l’aspiration des espaces ruraux au progrès. Nous avons besoin de ces équipements, même si les milieux urbains, qui sont déjà bien servis en la matière, voudront peut-être freiner des quatre fers.

M. Pierre Hérisson. Les propos un peu vifs de Bruno Sido peuvent faire sourire. Toutefois, n’oublions pas que 20 % de la population française, soit plus de 12 millions d’habitants, vit en milieu rural !
Marques d’impatience sur les travées du groupe écologiste.

Madame la secrétaire d’État, permettez-moi de vous interroger : qui sera chargé de définir ce qu’est une modification substantielle ? Où se trouvera la limite entre le substantiel et le non-substantiel ? Il faudra bien qu’une instance se prononce à un moment ou à un autre sur ce point !
Au demeurant, cette question peut aussi bien s’adresser à M. le rapporteur. §
Comme vient de le dire Bruno Sido, les opérateurs se réfugient derrière les règlements et les normes pour traîner les pieds dans les zones qui ne sont pas rentables.

Monsieur Sido, vous avez sûrement raison sur le fond, mais vous n’êtes pas le seul ici à représenter les territoires ruraux.
Dans les territoires, qui, comme l’Orne, comptent de multiples zones blanches – pour être notre voisin, M. le président de séance le sait bien –, nous serions bien contents de n’avoir à attendre que deux mois !

Nous rencontrons de nombreux problèmes : problèmes d’implantation des antennes, problèmes de financement, risques de défaut d’entente entre les opérateurs… Dès lors, je ne crois pas qu’un délai de deux mois crée de réelles difficultés. Celles que connaissent les territoires ruraux pour s’équiper sont essentiellement d’ordre financier.
J’insiste : si nous ne sommes pas tous convaincus par l’argument des délais de concertation, nous n’en sommes pas moins nombreux à défendre les mêmes territoires. Au demeurant, certains des habitants des territoires ruraux réclament eux-mêmes ces délais, car ils ont eux aussi besoin de sécurité !

Je ne souhaite pas allonger les débats sur ce texte très important, mais je voudrais tout de même répondre à M. Sido, qui nous ressort la même antienne à tout propos.
Il n’y a pas ici les défenseurs du monde rural et les autres. Votre vision caricaturale de mon groupe politique, renvoyé aux quartiers et à la ville, me semble complètement dépassée. Regardez autour de vous ! Les choses évoluent : votre téléphone a changé, votre télévision est aujourd'hui en couleur !
De surcroît, nous en avons assez que vous vous posiez comme le seul défenseur du monde rural : vous n’avez pas de monopole en la matière ! §
Dans son intervention générale, ma collègue Mireille Schurch a évoqué l’aménagement du territoire. Elle a dénoncé la mise en concurrence des différents opérateurs, qui, pour des raisons financières, vont là où les habitants habitent effectivement. Il est vrai que permettre à 20 % de la population, répartie sur la majeure partie du territoire, de passer à la 4G n’intéresse pas les lobbies financiers ni les opérateurs téléphoniques !
Sur cette question, nous n’apportons sans doute pas les mêmes réponses.
Monsieur Sido, je ne peux pas vous laisser dire que le monde rural attend la 4G les yeux fermés, tels les soldats qui, en 1914, pensaient que les balles allemandes ne les atteindraient pas. Oui, dans le monde rural aussi, les gens pensent et lisent. Ils sont conscients des dangers, ils s’inquiètent. Des collectifs se mobilisent, réclament de la concertation, réfléchissent collectivement à la place des différents équipements en fonction des besoins et des usages, tout en préservant l’intérêt général et la sécurité de tous.
Je ne voterai pas cet amendement, pas plus que les autres, car vous n’appréhendez pas la situation avec suffisamment de sérieux. Depuis le début, vous n’avez que mépris pour cette proposition de loi.

Pendant des d’années, à grand renfort d’experts, on nous a expliqué que le nuage de Tchernobyl s’était arrêté à nos frontières, bloqué par les Alpes. On sait depuis qu’il a franchi la montagne...
Ayez donc un peu de respect pour ce texte. Vous n’en partagez pas les objectifs, c’est une chose, mais ce ne sont pas que des « farfuleries » ! §

Ma chère collègue, on peut avoir du respect et pour cette proposition de loi et pour les amendements visant à raccourcir les délais. Si vous pensez un seul instant que ce texte, si jamais il est voté, réduira le nombre de cancers...

... ou qu’il y a un lien entre l’exposition aux champs électromagnétiques et les maladies, vous vous trompez ! (Exclamations sur les travées du groupe écologiste .)
Bruno Sido s’est contenté de demander un raccourcissement des délais parce que nous savons que, dans le milieu rural, nous aurons besoin des technologies filaires pour couvrir le territoire.

Il suffit de regarder une carte et de repérer les zones qui font l’objet d’un AMI, un appel à manifestations d’intérêt, c'est-à-dire celles qui, parce qu’elles constituent un marché, poussent les opérateurs à investir sans demander un euro d’argent public. Ce sont les villes.

La complémentarité devra être assurée, dans le monde rural, avec les ondes électromagnétiques. C’est un constat !
Demandez des délais plus brefs n’est pas sacrilège. On doit pouvoir exprimer une telle idée et la proposer par voie d’amendement sans que vous considériez pour autant que l’on franchit les limites du raisonnable. Ce qui est raisonnable, c’est de faire en sorte que le milieu rural, les quartiers, les villes, puissent bénéficier demain de toutes les facilités numériques. C’est fondamental pour l’avenir individuel et collectif. §

Je ne peux que partager les propos que Bruno Retailleau a tenus dans la seconde partie de son intervention. Pour ma part, je propose de recourir à la 4G pour couvrir les zones blanches et développer le haut débit.
Monsieur Hérisson, vous avez sans doute mal lu l’amendement n° 48 du Gouvernement. Il n’est plus question de transformations substantielles. En revanche, l’avis ou l’accord de l’ANFR est requis. Cette rédaction, bien plus précise, devrait donc vous donner satisfaction.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. Sido et Retailleau, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Après les mots :
le contenu
insérer les mots :
, les délais
La parole est à M. Bruno Sido.

Monsieur le président, la première partie de mon intervention vaudra rappel au règlement.
Madame Cukierman, il n’est pas admissible que vous mettiez en cause un de vos collègues qui défend avec acharnement depuis maintenant plus de douze ans dans cet hémicycle la couverture en téléphonie mobile et en haut débit des territoires ruraux.
Certes, il y a douze ans, vous n’étiez pas là pour le constater !

Le développement des territoires ruraux est important à mes yeux, même si ce n’est pas l’œuvre de ma vie.
Madame Goulet, rassurez-vous : je ne prétends pas être le seul à représenter les territoires ruraux. Fort heureusement, nous sommes nombreux à le faire dans cet hémicycle.
Pardonnez-moi si je m’emporte, et je vous présente mes plus plates excuses, mais cela est dû, tout simplement, à la passion qui m’anime. §

J’en viens à l’amendement n° 19 rectifié.
De manière générale, afin de ne pas ralentir le déploiement des équipements radioélectriques nécessaires aux activités de nos concitoyens, le Gouvernement doit aussi veiller à la question des délais, qui doivent être aussi courts et maîtrisés que possible. De toute évidence, le délai de deux mois évoqué à plusieurs étapes de la procédure d'information et de concertation paraît excessif. On peut aller plus vite.

Alors quoi ? On ne peut même plus s’expliquer ici ! Monsieur le président, j’en appelle à votre arbitrage ! Il me reste encore près d’une minute sur mon temps de parole !

Je ne sais pas ce que c’est ! Vous me l’expliquerez tout à l’heure !
Je reprends : ce délai paraît excessif au regard de la nécessité de poursuivre le déploiement des équipements radioélectriques au rythme prévu.
Il appartient au pouvoir réglementaire de trouver le juste équilibre entre le temps de la concertation et le temps de l'action. In medio stat virtus.

Il s’agit d’un amendement de conséquence de deux amendements que nous avons rejetés. Il aurait même dû tomber… Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
Monsieur Sido, vous souhaitez préciser dans le texte que les délais de transmission des informations au maire seront définis par arrêté interministériel. Or cet amendement me paraît déjà satisfait par la rédaction actuelle. En effet, la notion de modalités de transmission inclut les délais.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 14
1° Première phrase
Après le mot :
comprend
insérer les mots :
, à la demande du maire,
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement vise à tirer les conséquences du remplacement du terme « estimation » par celui de « simulation », comme cela sera proposé dans l'amendement n° 28 rectifié, sur lequel nous émettrons un avis favorable.
Il convient en effet que les opérateurs effectuent des simulations du niveau d’exposition aux ondes générées par les antennes qu’ils projettent d’implanter. Du reste, de telles simulations sont déjà réalisées par les exploitants et sont souvent fournies aux élus dans le cadre des chartes locales signées entre opérateurs et collectivités.
Il s’agit donc de préciser que les simulations, et non plus les estimations, sont fournies à la demande du maire, afin d’en assurer le caractère proportionné. J’ajoute que des simulations peuvent toujours être transmises de manière systématique par les opérateurs dans le cadre des dossiers d’information.
Je m’arrête là, car la mesure qu’il convient d’adopter est très liée aux dispositions prévues à l’amendement n° 28 rectifié et il aurait été plus judicieux d’intervertir l’ordre d’examen de ces deux amendements. Dans cette configuration, l’explication ne peut qu’être un peu laborieuse...

L'amendement n° 43, présenté par MM. Hérisson, Retailleau et Lenoir, est ainsi libellé :
Alinéa 14, seconde phrase
Après le mot :
vérifier
insérer les mots :
, sur la base des lignes directrices définies par l’Agence nationale des fréquences,
La parole est à M. Pierre Hérisson.

Cet amendement vise à préciser, dans un objectif de sécurité juridique et d'harmonisation nationale des pratiques, sur quelles bases il pourra être vérifié que les résultats d'estimations sont cohérents avec les résultats de la mesure. Il est ainsi proposé que l'évaluation de la cohérence entre mesures et estimations soit réalisée sur les mêmes bases techniques et avec les mêmes règles, lesquelles seront définies par l'ANFR.

La commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 49. La simulation du champ électromagnétique généré fournie à la demande du maire serait une charge obligatoire pour les opérateurs.
Quant à la suppression de la seconde phrase de l’alinéa 14, elle est justifiée puisque la possibilité pour le maire de faire réaliser des mesures est déjà prévue par un décret du 14 décembre 2013.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 43, qui sera en outre satisfait par l’article 2 de la proposition de loi, lequel évoque les lignes directrices de l’ANFR.

Je souhaite demander à Mme la secrétaire d'État quelques éclaircissements, puisque l’ordre d’examen des amendements est source de confusion.
Nous allons avoir un débat sémantique à propos de l’amendement n° 28 rectifié. Je ne suis pas du tout sûr que l’on gagne à préférer les simulations aux estimations. En effet, en termes de couverture du territoire, Daniel Raoul le sait parfaitement, nous avons une différence d’appréciation avec l’ARCEP. Celle-ci fournit des cartes sur la base de simulations. La propagation des ondes n’a rien d’arithmétique : il faut tenir compte de la topographie et d’un certain nombre d’autres paramètres.
Pour simuler, il faut d’abord modéliser. Cette opération aboutit à des cartes très théoriques.
À l’inverse, une estimation permet d’élaborer une première hypothèse. En outre, dans un délai de six mois, les opérateurs procèdent systématiquement à une mesure pour la confronter à l’estimation, et ce avec l’appui de l’ANFR.
Par conséquent, entre le dispositif de simulation avec modélisation et le dispositif actuel, à savoir une estimation et une mesure permettant de confronter ex post ce qui a été pressenti ex ante, mon choix est fait. Je pense très franchement que l’on perd beaucoup à abandonner le mode opératoire en vigueur.

Monsieur Retailleau, nous aurons ce débat lors de l’examen de l’amendement n° 28 rectifié. Je pense que vous confondez deux choses.
L’estimation est censée prendre en compte l’environnement urbanistique, etc. Pour l’instant, nous en sommes à la demande préalable. Il s’agit d’avoir une idée des conséquences d’une installation radioélectrique. Pour que cela ne crée de charges supplémentaires ni aux opérateurs ni aux communes concernées, il est préférable d’utiliser le logiciel. Je vous accorde qu’il pourra difficilement donner la valeur exacte.
Toutefois, si vous signez, dans votre commune, une charte prévoyant une simulation en amont…

Peu importe. Nous en reparlerons lorsque nous examinerons l’amendement n° 28 rectifié.
Avant le dépôt du dossier à l’ANFR, vous pouvez demander à l’opérateur de réaliser une mesure avant l’activation commerciale, c'est-à-dire de vérifier que le champ est bien celui qui avait été estimé avant les travaux.
Il me semble, monsieur Retailleau, que vous faites référence à la seconde partie de l’amendement du Gouvernement, qui vise à supprimer la seconde phrase de l’alinéa 14 de l’article 1er, rédigée en ces termes : « Des mesures peuvent être effectuées, à la demande écrite du maire ou du président de l’intercommunalité, aux fins de vérifier la cohérence de l’exposition effectivement générée avec les prévisions de l’estimation réalisée dans les six mois suivant la mise en service de l’installation. »
Ce dispositif de mesures après la mise en service de l’installation figure déjà dans un décret de décembre 2013. L’amendement du Gouvernement vise donc, dans un souci de cohérence, à supprimer une phrase redondante par rapport au droit existant.
L'amendement est adopté.

En conséquence, l’amendement n° 43 n’a plus d’objet.
L'amendement n° 28 rectifié, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 14, première phrase
Remplacer le mot :
estimation
par le mot :
simulation
La parole est à M. Joël Labbé.

Les exploitants réalisent aujourd'hui de véritables simulations techniques avant tout projet d'installation afin d'en vérifier la pertinence. Ces estimations peuvent donc être transmises sans surcoût ni accroissement de charges par les opérateurs aux élus.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, auquel j’ai déjà fait indirectement référence en indiquant que l’amendement du Gouvernement n° 49 visait à préciser que les simulations étaient fournies à la demande des maires.
Quoi qu’il en soit, le Gouvernement souscrit à l’idée de transformer les estimations en simulations.

Madame la secrétaire d’État, quelle différence faites-vous entre estimation et simulation ?
La simulation est une estimation modélisée mathématiquement, qui s’appuie sur des outils comme des cartes, afin de démontrer les différents niveaux de champs. Le niveau de la preuve et le détail des informations apportées sont donc plus élevés.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 39, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout rapport de mesures doit faire apparaître de façon claire et lisible par tous, dans des conditions définies par arrêté, à côté des informations fréquence par fréquence, la contribution globale de la téléphonie mobile, toutes gammes de fréquences et tous opérateurs confondus.
La parole est à M. Joël Labbé.

Cet amendement tend à rétablir une disposition supprimée en commission, qui visait à ce que les rapports de mesure fassent apparaître la part de la téléphonie mobile dans l'exposition fréquence par fréquence. Cette disposition peut se révéler avantageuse pour les opérateurs, puisque le public pourrait se rendre compte que la téléphonie n’est pas forcément la principale source d’exposition aux champs électromagnétiques.

Il s’agit, avec cet amendement, d’indiquer que tout rapport de mesures fait apparaître, à côté des informations fréquence par fréquence, la contribution globale de la téléphonie mobile, toutes gammes de fréquences et tous opérateurs confondus.
Cette disposition ne paraît pas utile, et c’est pourquoi la commission l’a supprimée. En effet, non seulement elle ne relève pas du domaine de la loi, mais elle est d’ores et déjà satisfaite par un arrêté de 2003 qui fixe les exigences issues du protocole de mesure in situ.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Je comprends mal l’objet de cet amendement, qui réserve un sort particulier à la téléphonie mobile. L’acceptation de la téléphonie mobile serait-elle moindre que celle de la radio ou de la télévision ?
De surcroît, comme vient de le rappeler M. le rapporteur, l’arrêté de 2003 prévoit déjà plusieurs modes de présentation des résultats de mesures, et la disposition proposée imposerait, sans raison objective, la mise en œuvre d’une méthode de présentation des résultats plus contraignante pour la téléphonie mobile, ce qui se justifie difficilement.
En conséquence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

L'amendement n° 39 est retiré.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 50, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« C bis.- Le maire ou le président de l’intercommunalité mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent article par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.
« C ter.- Lorsqu’il estime qu’une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l’État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l’intercommunalité. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Cet amendement important a pour objet de garantir la sécurité juridique des dispositions qui ont été introduites par les membres de la commission des affaires économiques du Sénat.
En effet, il nous semble que le renvoi au décret des dispositions relatives aux conditions de mise en œuvre de la procédure d’information du public et de concertation, comme des dispositions relatives aux conditions de saisine d’une instance de concertation départementale qui serait chargée d’une mission de médiation présente un risque élevé d’incompétence négative.
C’est rarement le cas mais, en l’occurrence, on ne dit pas assez de choses dans la loi !
Pour pallier ce risque, le présent amendement vise à sécuriser juridiquement le texte et à clarifier le rôle des élus locaux.
D’une part, il définit l’objectif de la procédure de concertation, clarifie le moment où elle intervient et le rôle de celui qui est chargé de l’organiser.
D’autre part, il institue une instance de concertation, placée sous l’égide du préfet, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, et non plus par circulaire, comme c’est le cas en l’état actuel des dispositions adoptées par la commission.
Il me semble donc que cet amendement respecte les préoccupations exprimées par les membres de la commission : en clarifiant le rôle des maires, il contribue aussi à ne pas les placer dans une situation inconfortable en cas de conflit.

L'amendement n° 46, présenté par MM. Hérisson, Retailleau et Lenoir, est ainsi libellé :
Alinéa 15, première phrase
Après le mot :
public
insérer les mots :
qui est engagée
La parole est à M. Pierre Hérisson.

Le présent amendement vise à préciser, dans un objectif de sécurité juridique et afin d'éviter toute remise en cause des décisions du Conseil d'État sur la répartition des pouvoirs entre l'État et les maires, que l'ANFR peut délivrer une autorisation d'exploitation avant l'achèvement d'une procédure d'information et de concertation.
Une disposition prévoyant que la délivrance de l'autorisation d'exploitation est consécutive d'une procédure locale d'information et de concertation créerait un lien entre, d'une part, la gestion nationale de l'exposition et, d'autre part, la réalisation, et donc le contenu, de cette procédure locale.
Elle pourrait laisser supposer que l'ANFR est investie d'un nouveau pouvoir de contrôle sur l'existence et les conditions dans lesquelles la concertation a eu lieu et qu'elle doit tenir compte des modalités de la concertation dans sa décision d'autoriser un projet d'installation radioélectrique, alors même que ce projet serait conforme à la réglementation concernant l'exposition du public aux ondes radio.

L'amendement n° 27, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 15, première phrase
Supprimer les mots :
à l'initiative et
La parole est à M. Joël Labbé.

Cet amendement vise à rendre obligatoire la concertation préalable à l'implantation des antennes relais. Il s'agit de l'une des mesures fortes ressortant du Grenelle des ondes et du rapport du comité de pilotage, ou COPIC.
Dès lors que les maires disposent de l’information, ils se doivent de la communiquer, dans un souci de transparence. De toute façon, s’ils ne le font pas, cela leur sera reproché.

L'amendement n° 44, présenté par MM. Hérisson, Retailleau et Lenoir, est ainsi libellé :
Alinéa 15, première phrase
Après le mot :
radioélectrique
insérer les mots :
projetée ou modifiée
La parole est à M. Pierre Hérisson.

Cet amendement vise à circonscrire la saisine des instances départementales de concertation aux seules installations radioélectriques projetées ou modifiées, et donc à écarter du périmètre d'activité de ces instances les installations existantes qui ne font l'objet d'aucune modification.
Il est en effet essentiel de respecter le droit au maintien des situations légalement acquises.

L'amendement n° 45, présenté par MM. Hérisson, Retailleau et Lenoir, est ainsi libellé :
Alinéa 15, première phrase
Supprimer les mots :
, à laquelle le bilan de la concertation est adressé
La parole est à M. Pierre Hérisson.

Le présent amendement vise à supprimer tout lien entre la future procédure d'information et de concertation au niveau local et les dispositions de gestion de l'exposition au niveau national, dans l'objectif d'éviter toute remise en cause des décisions du Conseil d'État sur la répartition des pouvoirs entre l'État et les maires.

La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 50, qui comprend une procédure obligatoire d’information du maire par les opérateurs, une procédure obligatoire d’information du public par le maire et une procédure de concertation laissée à la libre appréciation du maire.
Si cet amendement est adopté, il fera tomber les amendements n° 46, 27, 44 et 45.
La commission étant favorable à l’amendement du Gouvernement, elle émet par conséquent un avis défavorable sur les quatre autres amendements.
En effet, si la procédure proposée par le Gouvernement dans son amendement n° 50 était acceptée, les quatre autres amendements en discussion commune deviendraient sans objet.
Je précise que le Gouvernement est favorable au principe mis en œuvre dans l’amendement n° 45. En effet, la transmission à l’ANFR du bilan de la concertation locale représente non seulement une charge administrative pour les collectivités locales et pour l’Agence, mais elle introduit aussi une confusion entre les compétences des collectivités et celles de l’Agence en matière d’implantation des antennes, alors même que la jurisprudence a récemment clarifié ces compétences après plusieurs années de contentieux. Si je suis défavorable à l’amendement n° 45, c’est uniquement parce qu’il est satisfait par l’amendement du Gouvernement.

La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote sur l'amendement n° 50.

Il s’agit là d’un point important, qui concerne l’ensemble des contentieux et qui pourrait bouleverser les lignes de répartition des compétences juridictionnelles sur ces questions.
Comme vous l’avez vu, madame la secrétaire d’État, ce dispositif de concertation entraîne un risque d’incompétence négative. Mais je pense que ce risque existe aussi ailleurs : dans le fait que le législateur n’épuise pas sa compétence et ne va pas au bout de la procédure législative.
Vous allez prendre un décret pour déterminer la commission de l’instance départementale qui pourra être saisie par le préfet ou, si je comprends bien, à la demande du maire ou du président de l’intercommunalité… Il aurait d’ailleurs mieux valu écrire, plutôt que « de l’intercommunalité », « de l’établissement public de coopération intercommunale », car le mot « intercommunalité » n’a pas de portée juridique. Mais ce n’est pas là l’essentiel.
Je voudrais donc que vous précisiez ce que vous prévoyez d’écrire dans le décret. En effet, nous, législateurs, préférons ne pas nous abandonner complètement aux décrets ! Dans ce cas particulier, nous voudrions voir comment la composition de cette médiation pourra refléter la situation locale.
En résumé, vous traitez la question de l’incompétence législative et vous allez certainement nous dire ce que contiendra le décret déterminant la composition de la médiation.
Mais je souhaiterais aussi revenir sur la question soulevée par l’amendement n° 45 qu’a présenté Pierre Hérisson et que j’ai cosigné, de même que M. Lenoir. Comment la rédaction de votre amendement parvient-elle à tenir compte des frontières qu’ont établies un certain nombre de décisions de justice, notamment des arrêts du Conseil d’État, afin de distinguer le contentieux vis-à-vis de l’ANFR, c'est-à-dire de l’État, et le contentieux vis-à-vis des pouvoirs du maire, notamment son pouvoir de police spéciale ? Cette question du contentieux vis-à-vis des maires est très importante. Or il ne me semble pas que, à cet égard, l’amendement n° 50 recouvre complètement le dispositif de l’amendement n° 45.

Je veux simplement suggérer à Mme la secrétaire d'État de rectifier son amendement de manière à y substituer les mots « de l’établissement public de coopération intercommunale » aux mots « de l’intercommunalité » : ce n’est pas la peine de tendre des verges pour se faire battre !
Monsieur Retailleau, sur votre première question, qui porte sur la procédure de médiation conduite par l’instance de concertation départementale, je précise que la composition de cette instance est aujourd'hui régie par une circulaire et que, dans un souci de consolidation juridique, je propose qu’elle soit désormais fixée par décret.

Je l’avais compris. La question est de savoir si le décret reprendra la composition prescrite par la circulaire.
Je peux vous renvoyer au texte actuel de la circulaire, mais je ne peux pas énoncer aujourd'hui avec certitude le contenu du futur décret. Cependant, sachez que l’objectif est simplement de rattacher un dispositif déjà existant à un outil réglementaire qui possède une valeur juridique plus contraignante.
À cet instant, n’ayant pas la circulaire sous les yeux, je ne suis pas en mesure de vous le dire.
Pour ce qui est de votre souci légitime de bien distinguer les contentieux potentiels selon qu’ils concernent la procédure de concertation ou la procédure menée par l’ANFR, l’absence de contentieux est en réalité garantie par le fait qu’il n’existe aucun lien entre les deux procédures. La procédure de concertation menée à l’initiative du maire est complètement distincte de l’examen du dossier puis de la décision d’implantation prise par l’ANFR. Cette distinction des procédures induit une distinction des instances.
Cela étant dit, monsieur le président, je rectifie l’amendement n° 50 dans le sens suggéré par M. Retailleau, puis par M. Hérisson.

Je suis donc saisi d’un amendement n° 50 rectifié, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« C bis.- Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent III par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.
« C ter.- Lorsqu’il estime qu’une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l’État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.

En conséquence, les amendements n° 46, 27, 44 et 45 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 30, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 16, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et veille au respect des grands principes de la concertation locale
La parole est à M. Joël Labbé.

Il est nécessaire que le comité de dialogue ne se contente pas d'informer les parties prenantes et qu’il veille également au respect des grands principes de la concertation.

Il me semble, mon cher collègue, que ce comité ne doit avoir qu’une mission d’information des parties prenantes et en aucun cas un rôle d’appel des décisions prises au niveau local.
La commission émet donc un avis défavorable.
L’avis du Gouvernement est également défavorable.
Je tiens simplement à préciser que, si l’on confiait à l’Agence nationale des fréquences la mission de veiller au respect des grands principes de la concertation, y compris de la concertation locale, cela aboutirait à faire de cette agence une instance de supervision de l’action des élus locaux. Je ne suis pas certaine que cela serait facilement accepté, alors même que les élus ne sont pas obligés de lancer la concertation : ils sont libres de le faire ou non.

Il s’agit moins d’une explication de vote que d’une question que je veux adresser à M. Labbé : que sont ces « grands principes de la concertation » ? Je ne les connais pas !

Je pense que Mme la secrétaire d’État n’a pas bien répondu à M. Joël Labbé, car elle lui a dit que l’ANFR ne peut pas constituer une instance de supervision… Or, selon moi, l’amendement de M. Joël Labbé vise non pas l’ANFR, mais l’instance de médiation, ce que vous appelez le « comité de dialogue ». Ce sont deux choses différentes !
Je ne veux pas faire d’exégèse, mais il faut maintenant que celui qui a rédigé l’amendement nous dise s’il a visé l’ANFR ou l’instance de médiation. Il me paraît évident qu’il a visé cette dernière.

Cet amendement vise effectivement l’instance de médiation. Toutefois, par souci d’efficacité et au vu de la réponse de Mme la secrétaire d’État, je le retire.

L'amendement n° 30 est retiré.
L'amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Sido et Retailleau, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par un décret en Conseil d'État. La composition du comité assure la représentation de l'État, des collectivités territoriales, des équipementiers et opérateurs de téléphonie mobile, des organisations interprofessionnelles d'employeurs, des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de défense des consommateurs et des représentants d'utilisateurs.
« Ses membres exercent leur fonction à titre gratuit.
La parole est à M. Bruno Sido.

J’aurais souhaité que Mme la secrétaire d’État réponde à propos de l’instance de médiation, mais passons…
Le présent amendement ne constitue en rien une injonction au Gouvernement. Il vise simplement à garantir, au sein du comité de dialogue, la représentation la plus large des utilisateurs de services mobiles, notamment celle des professionnels et des entreprises, par exemple via les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers et de l'artisanat, les chambres d'agriculture, les organisations syndicales patronales et ouvrières, les associations, etc.

Monsieur Sido, vous n’êtes pas à une contradiction près ! En effet, entre la première phrase et la suite de votre amendement, il y a une contradiction formelle : il est d’abord dit que la « composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par un décret » et, ensuite, il est énoncé ce que doit être précisément la composition de ce comité. Un peu de cohérence !
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Même avis.
Il y a en effet une certaine contradiction à renvoyer à un décret en Conseil d’État la composition du comité national tout en fixant cette composition dans la loi.
Cependant, soyez assuré, monsieur Sido, que le Gouvernement veillera à respecter la représentativité et la diversité des parties prenantes, comme c’est le cas au sein du COPIC, que ce futur comité a pour objet de prolonger.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 51, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« E.- Les points atypiques sont définis comme les lieux où le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l'échelle nationale conformément aux critères déterminés par l’Agence nationale des fréquences et révisés régulièrement en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués.
II. – Alinéa 19, troisième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les bénéficiaires des accords ou avis mentionnés au cinquième alinéa du I de l’article L. 43 impliqués prennent dans un délai de six mois prennent, sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le niveau de champ émis dans les lieux en cause, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
L’objet de cet amendement est de modifier, pour la clarifier, la définition des points atypiques. Il vise également à clarifier la responsabilité des exploitants des installations radioélectriques concernant leur résorption.
Cet amendement tend à laisser une plus grande marge d’appréciation à l’Agence nationale des fréquences, dont l’expertise en ce domaine est largement reconnue, pour qu’elle détermine elle-même les critères – tels que niveaux d’exposition, types de lieux, présence du public, contraintes techniques ou économiques – qui permettront de définir les points atypiques.
En outre, le deuxième alinéa du E est modifié afin de préciser explicitement qu’il appartient aux exploitants des installations radioélectriques de prendre les mesures permettant de résorber les points atypiques dans un délai de six mois après qu’ils ont été informés de l’existence de ceux-ci.
Cet amendement tend également à conforter la mission de l’Agence en matière de recensement et de suivi des points atypiques. Celle-ci pourra saisir les autorités affectataires, en particulier l’ARCEP ou le Conseil supérieur de l’audiovisuel lorsque les exploitants ne prendront pas les mesures nécessaires au traitement des points atypiques.
Enfin, je vous informe que le premier recensement des points atypiques, qui a été effectué par l’ANFR en application de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications dans sa rédaction actuelle, sera publié avant la fin du mois de juin. L’Agence fournit d’ores et déjà les données, en open data, c’est-à-dire en accès libre, concernant l’emplacement des antennes relais et les mesures de champs qui sont effectuées sur le terrain à la demande de nos concitoyens et qui concourent au renforcement de l’information du public.
Toutes ces informations sont disponibles sur le site internet de l’Agence et permettent une compréhension et une réexploitation des données ainsi publiées. Cela contribue à une meilleure transparence du travail de l’ANFR et de ses décisions.

L'amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Sido et Retailleau, est ainsi libellé :
Alinéa 19, troisième phrase
Après les mots :
faisabilité technique
insérer les mots :
et d'un coût économiquement acceptable
La parole est à M. Bruno Sido.

Cet amendement prévoit de subordonner l'obligation, pour les opérateurs, du traitement des points atypiques à la faisabilité technique des mesures à même de réduire le niveau d'exposition, comme au caractère raisonnable du coût financier que cela suppose, au cas par cas.

Il est bien entendu que si nous adoptons l’amendement n° 51, l’amendement n° 21 rectifié deviendra sans objet et qu’il ne sera donc plus question de « coût économiquement acceptable ». Au reste, monsieur Sido, je ne sais pas qui définit l’’acceptabilité économique de ce coût…
En tout état de cause, la commission est favorable à l’amendement n° 51 et défavorable à l’amendement n° 21 rectifié.

Les points atypiques sont, avec l’objectif – et non pas le principe, monsieur le président de la commission des affaires économiques – de sobriété et l’incompétence négative, c'est-à-dire l’intelligibilité de la loi, l’un des éléments du texte qui ne semblent pas parfaitement déterminés, notamment quant à leurs conséquences juridiques et aux mesures qu’ils impliquent.
Madame la secrétaire d’État, vous réécrivez complètement ici le dispositif qu’avait réécrit la commission. Très franchement, je préfère de beaucoup le sens du texte de la commission, qui apporte en outre un certain nombre de précisions.
En effet, l’amendement du Gouvernement se focalise sur un seul critère, à savoir celui de l’exposition, ce qui n’était pas le cas du texte de la commission.
À nos yeux, si un point donné est considéré comme atypique, parce qu’il s’écarte de ce qui est généralement observé, mais que, en cet endroit, la seule façon de garantir la couverture et la qualité de desserte du service, c’est précisément de prévoir un niveau d’exposition sans doute un plus élevé, cela doit pouvoir se faire, d’autant que Mme la secrétaire d’État nous a expliqué tout à l’heure que, pour 99, 9 % des Français, l’exposition aux ondes était huit fois inférieure à la limite maximale.
Rendez-vous compte : nous aurons des points atypiques qui seront de toute façon en dessous des valeurs limites maximales de l’OMS et du fameux décret !
C’est donc ma première critique, qui se traduit par cette interrogation : quand il n’y a pas d’autres moyens que de forcer un peu l’exposition pour obtenir une bonne couverture du territoire et une bonne qualité de service, que fait-on ?
Deuxième critique : le Gouvernement entend supprimer la référence aux lieux de vie fermés ; or cela a toujours été la référence française, établie en fonction des recommandations de l’OMS. Pour la première fois, madame la secrétaire d’État, la France a une position presque orthogonale par rapport à celle de l’OMS, laquelle préconise de prendre les mesures dans des lieux fermés. Avec votre rédaction, la mesure pourra se faire dans tous types de lieux, y compris donc des lieux ouverts. Certes, nous pouvons prendre cette responsabilité, mais, au moins, je veux que nous le fassions en toute connaissance de cause.
J’en viens à ma troisième critique. Ce que je comprends de votre rédaction, c’est que, désormais, pour vérifier qu’un point est vraiment atypique, il n’y a pas de mesure obligatoire. Vous me direz si je me trompe.
Par ailleurs, se pose un problème de sécurité juridique, car vous renvoyez à un seul critère : le dépassement du niveau généralement observé en fonction des paramètres qu’a retenus l’ANFR. Est-ce suffisant pour éviter toute insécurité juridique ? Personnellement, j’en doute.
Quant à l’amendement présenté par Bruno Sido sur la faisabilité technique et économique, monsieur le président de la commission, il tend tout simplement à mettre en œuvre le principe de proportionnalité. §
Si, monsieur le président ! Le principe de proportionnalité est décliné à l’article L. 110-1 du code de l’environnement et par le droit européen, qui précise, par exemple, que les mesures de précaution doivent avoir un « coût économiquement acceptable ». Ce principe représente la limite qui borne le principe de précaution et, à mon sens, l’amendement présenté par Bruno Sido est donc très important. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je l’ai cosigné, en dehors du fait que Bruno Sido est une autorité en la matière. §
Le principe de proportionnalité est dans les textes ; il y a une jurisprudence et même un droit positif qui permettent de mesurer ce qu’est un « coût économiquement acceptable ».
Il me paraît important de répondre, au moins sur la première allégation de M. Retailleau, selon laquelle le critère de l’exposition serait le seul dont doit tenir compte l’Agence pour effectuer son évaluation.
Je vous invite à relire l’amendement du Gouvernement, car notre but est, au contraire, de faire intervenir le plus de critères possible, sachant que ceux-ci sont définis par l’Agence, au plus proche de la réalité des territoires, des circonstances, de la faisabilité technique.
Par ailleurs, lorsque j’ai évoqué les types de lieux de vie, je n’ai pas précisé s’ils devaient être fermés ou ouverts ; il s’agit non pas de restreindre l’applicabilité des critères ou de préjuger l’application d’un critère plutôt que d’un autre, mais, au contraire, de les définir de la manière la plus large possible, notamment avec l’objectif d’effectuer le recensement le plus juste.
Enfin, monsieur Retailleau, je comprends mal votre argument sur la suppression des mesures obligatoires. En effet, lorsque je reprends le texte de la proposition de loi ou du code de l’environnement, il n’est pas fait mention de mesures obligatoires. Je ne vois donc pas en quoi l’amendement modifierait le dispositif dont vous parlez.
L'amendement est adopté.

En conséquence, l'amendement n° 21 rectifié n'a plus d'objet.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Sido et Retailleau, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Rétablir le F. dans la rédaction suivante :
« F. Un décret définit les modalités de mutualisation et de colocalisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire.
La parole est à M. Bruno Sido.

Par cet amendement, je propose, dans l'intérêt de nos concitoyens et pour garantir le plus large choix d'abonnements possible, de favoriser l’ouverture des pylônes appartenant à un opérateur à tous les autres opérateurs : il s'agit donc de mutualiser davantage, ce qui suppose de faciliter la colocalisation, c’est-à-dire l’accès de tous les opérateurs aux toits-terrasses et terrains où d'autres sont déjà présents.
A minima, le principe de l'égalité d’accès de tous les opérateurs aux bâtiments et terrains publics pourrait être consacré par le décret auquel il est fait référence.
Je voudrais faire un peu d’histoire. En 2001-2002, j’avais été l’initiateur, heureux, d’une proposition de loi relative à la couverture téléphonique et à l’itinérance locale. À l’époque, il s’agissait d’une grande avancée, et je dois dire qu’elle avait été très rapidement reprise par l’Assemblée nationale.

Exactement ! Au fond, il s’agissait de mutualiser là où il y avait des zones dites « blanches ». Nous y sommes parvenus, mais les opérateurs ont résisté, surtout sur le partage d’infrastructures. Ils voulaient absolument que la concurrence se fasse sur les réseaux et leur qualité, non sur les tarifs ou les contenus.
Aujourd’hui, grâce à l’arrivée du quatrième opérateur, il est devenu absolument nécessaire, pour entretenir la concurrence et la baisse des prix qui en découle, de mettre en œuvre la colocalisation des antennes là où elle est possible, ce qui empêchera la surexposition aux ondes électromagnétiques. Cet amendement va donc tout à fait dans le sens des intentions des auteurs de la proposition de loi.

L'amendement n° 31, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Rétablir le F dans la rédaction suivante :
« F. - Un décret définit les modalités d'application du principe de modération, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables, et de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire.
La parole est à M. Joël Labbé.

L’amendement n° 31 est retiré.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 10 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno et N. Goulet, M. Jarlier, Mmes Férat, Morin-Desailly et Létard et MM. Guerriau et Capo-Canellas.
L'amendement n° 38 est présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 20
Rétablir le F dans la rédaction suivante :
F. – Un décret définit les modalités d'application de l'objectif de sobriété, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables, et de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié bis.

Cet amendement tend à prévoir que seront définies par décret les modalités d'application du principe de sobriété, dont il a déjà été question tout à l’heure.

C’est dans un souci de cohérence que nous avons retiré remplacé l’amendement n° 31, qui faisait référence au principe de modération, au profit de celui-ci, qui fait référence à l’objectif de sobriété.
Pour le reste, il s’agit de renvoyer au décret les modalités d’application non seulement de cet objectif, mais aussi de celui de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement des nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire.

Pour faire court, je dirai que M. Sido sera satisfait par les amendements identiques n° 10 rectifié bis et 38.

Il faut savoir lire, monsieur Sido !
Je demande donc le retrait de l’amendement n° 22 rectifié ; à défaut, j’y serai défavorable.
Ces trois amendements me semblent satisfaits par le droit actuel. En effet, le décret du 3 mai 2002 impose déjà de limiter les niveaux de champs dans un périmètre de 100 mètres d’un établissement dit sensible, ce qui inclut les crèches, les écoles, mais aussi les établissements de soins.
Concernant le recours à la mutualisation, il faut savoir que les dispositions législatives et réglementaires l’encouragent déjà. En mars 2013, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis qui définit les modalités de mise en œuvre de ces règles. Il précise notamment que la mutualisation ne peut être imposée que dans les zones les moins denses, donc les zones qui vous intéressent tout particulièrement, monsieur Sido, puisqu’il s’agit le plus souvent de zones rurales.
Dès lors, il me semble que le cadre juridique actuel répond déjà à l’objectif visé par ces amendements.

Personnellement, je ne demande qu’à faire plaisir à M. le rapporteur, mais son argument, qui consiste à dire qu’un amendement est satisfait par tel autre, est un peu facile. Il maîtrise bien cette technique, que j’ai d’ailleurs moi-même pratiquée lorsque j’étais rapporteur…
En l’occurrence, monsieur Raoul, mon amendement n’est pas satisfait, car je parle de colocalisation, tandis que les autres amendements évoquent la rationalisation et la mutualisation des installations, ce qui n’est pas exactement la même chose. C’est un peu parallèle, mais ce n’est pas convergent ! Je maintiens donc mon amendement.

Les deux rédactions sont très différentes, parce que les amendements n° 10 rectifié bis et 38 tendent à définir les modalités d’application de l’objectif de sobriété. Or nous nous y sommes opposés ! On ne peut donc pas dire que les deux rédactions sont absolument identiques.

Si, monsieur le rapporteur.
Je voudrais évoquer rapidement la mutualisation, car c’est un point important. Au moment où il s’est agi de définir les conditions d’attribution des licences 4G, nous l’avons fait ici, suivant les conclusions de la commission du dividende du numérique, en encourageant pour la première fois une mutualisation des opérateurs en zone peu dense.
Comme vous l’avez rappelé, madame la secrétaire d’État, l’Autorité de la concurrence a cadré les choses au regard du critère de concurrence, en reprenant les mêmes arguments.
Depuis, comme le marché est en train de s’essouffler, certains opérateurs, par exemple Bouygues et SFR, ont conclu des contrats ; on verra bien comment ils vivent !
Simplement, pour nous, la mutualisation a un double objectif.
Tout d’abord, il s’agit de couvrir les zones rurales où un équipement offre nécessairement un moindre retour sur investissement. Or moins il y aura d’antennes, moins cela coûtera cher ; par conséquent, plus les opérateurs s’entendront, mieux cela vaudra. C’est donc un objectif d’aménagement du territoire.
Ensuite, moins il y aura d’antennes et moins il y aura d’exposition aux champs électromagnétiques.
D’où ma question, madame la secrétaire d’État : puisque M. Montebourg, qui parle souvent et fort, a annoncé que le Gouvernement allait prendre des mesures pour faciliter la mutualisation, pouvez-vous nous dire concrètement lesquelles ?
L'amendement n'est pas adopté.
Les amendements sont adoptés.

Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je vous rappelle que, conformément à la décision de la conférence des présidents, la séance doit être levée à minuit trente.
Nous allons donc interrompre maintenant la discussion de la proposition de loi.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 18 juin 2014 :
À quatorze heures trente :
1. Débat sur les zones économiques exclusives (ZEE) ultramarines.
De dix-huit heures à vingt heures :
2. Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la procédure applicable devant le conseil de prud’hommes dans le cadre d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié (n° 410, 2013-2014) ;
Rapport de M. Gilbert Barbier, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 598, 2013-2014) ;
Texte de la commission (n° 599, 2013-2014).
De vingt-deux heures à minuit :
3. Suite éventuelle de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la procédure applicable devant le conseil de prud’hommes dans le cadre d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié.
4. Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, permettant la création de sociétés d’économie mixte à opération unique (n° 519, 2013-2014) ;
Rapport de M. Jacques Mézard, fait au nom de la commission des lois (n° 614, 2013-2014) ;
Texte de la commission (n° 615, 2013-2014).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 18 juin 2014, à zéro heure trente.