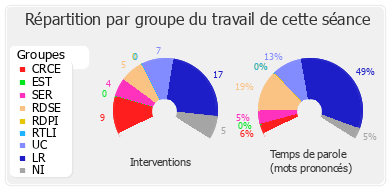Séance en hémicycle du 17 septembre 2009 à 15h00
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à onze heures cinquante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Bernard Frimat.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.
Je rappelle que l’auteur de la question dispose de deux minutes trente, de même que la ou le ministre pour sa réponse. Je demande à chacun des orateurs de bien vouloir respecter ce temps de parole.
Applaudissements sur les travées du RDSE.

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
Le salon international de l’élevage SPACE 2009 s’est ouvert mardi dernier à Rennes dans un climat très tendu : la profession agricole est divisée, quatre ministres sont venus en renfort, le président de la FNSEA a été fortement chahuté. Le ring de présentation des animaux s’est transformé en ring de combat, dont vous avez été « exfiltré », monsieur le ministre, sous protection des gendarmes.
À l’origine de ce climat se trouve la « grève du lait » lancée par certaines organisations. Si l’on peut discuter la méthode, le constat s’impose : le prix du lait ne permet plus de couvrir les charges de production. Comment ne pas être en colère quand, dans le même temps, les prix des produits laitiers affichés dans les grandes surfaces ne diminuent pas, signe que les industriels et les distributeurs s’octroient des marges confortables ?
En réalité, cette grève du lait révèle le désarroi profond de toute la France agricole. Vous l’avez reconnu vous-même, monsieur le ministre : l’agriculture traverse la crise la plus grave qu’elle ait connue depuis trente ans. Effondrement des cours, difficultés à exporter, aléas climatiques : toutes les filières sont touchées en même temps, à l’exception peut-être d’une seule, celle du lait de chèvre !
Pour certaines, le malaise est profond. Je pense notamment à la viticulture ou encore aux productions fruitières et maraîchères, dont la situation a amené le président du groupe du RDSE, M. Yvon Collin, à vous alerter cet été. Pour d’autres, le mal est plus conjoncturel, lié à la crise économique générale ou à la sécheresse.
Quoi qu’il en soit, la situation est grave. Plus que la colère, c’est désormais l’abattement et même l’angoisse qui dominent. Nos agriculteurs ne peuvent plus se contenter d’effets d’annonce !

Au-delà des aides d’urgence, des avances de trésorerie, nécessaires mais insuffisantes, il faut agir sur le long terme par des mesures fortes et structurantes.
Monsieur le ministre, vous venez de lancer la réflexion sur la future loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Cette crise agricole de grande ampleur révèle aussi combien une régulation des marchés est indispensable.

Depuis 1992, l’Europe démantèle minutieusement la politique agricole commune pour livrer son agriculture à la seule loi du marché. Cette démarche libérale dogmatique est suicidaire !

Les campagnes françaises font peut-être encore rêver les gens des villes, mais plus ceux qui les habitent et les valorisent par leur labeur.
Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour garantir aux agriculteurs un revenu « stable et décent », comme le Gouvernement s’y était engagé ? Comment allez-vous leur permettre de vivre de leur travail et leur redonner la fierté de leur métier ?
Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Madame la sénatrice, je partage votre constat sur la situation de l’agriculture française. Je répète ici ce que j’ai déjà eu l’occasion de dire à plusieurs reprises : l’agriculture française vit la crise la plus grave qu’elle ait connue depuis une trentaine d’années.
Je tiens à vous rassurer sur ce qui s’est passé au salon international de l’élevage SPACE 2009 : le ministre n’a pas eu à être « exfiltré » ; il avait dit qu’il viendrait, il est venu ; il avait dit qu’il écouterait, il a écouté, et il a reçu toutes les organisations qui le souhaitaient, la FRSEA, la Fédération des jeunes agriculteurs, l’Association des producteurs de lait indépendants…
« Bravo ! » et applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Monsieur le sénateur, il faut avoir un certain courage pour ouvrir le dialogue quand certains le refusent a priori.
Au-delà de ces péripéties, il nous faut envisager des mesures d’urgence. Certaines ont d’ailleurs déjà été prises sous l’autorité du Premier ministre et du Président de la République.
Ainsi, le Gouvernement a apporté, pour chaque filière, des aides à la trésorerie ciblées, qui répondent aux préoccupations des exploitants.
La filière du lait recevra dans un premier temps 30 millions d'euros, somme qui sera complétée par 30 millions d'euros supplémentaires. Nous souhaitons que cette mesure profite principalement aux jeunes agriculteurs et à ceux qui ont investi récemment.
Par ailleurs, 15 millions d'euros ont été alloués à la filière des fruits et légumes. Nous avons rendez-vous dans quelques jours pour examiner les moyens d’améliorer la compétitivité de ce secteur.
Enfin, je réunirai à la fin du mois d’octobre ou au début du mois de novembre prochain les banquiers, les assureurs et l’ensemble des créanciers des exploitations agricoles françaises. Dans la crise que nous traversons, j’estime que l’effort pour soutenir les agriculteurs de France ne doit pas être supporté uniquement par l’État, mais partagé entre tous.
Toutefois, ces mesures d’urgence ne suffisent pas. Vous l’avez souligné, madame la sénatrice, et je partage entièrement votre avis, nous avons également besoin de mesures structurelles, devant lesquelles, reconnaissons-le, nous avons reculé depuis trop longtemps.
Ces mesures structurelles seront d’abord nationales : à la demande du Président de la République et du Premier ministre, elles feront l’objet d’un projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche.
J’invite tous les membres de la Haute Assemblée à participer activement à la discussion de ce texte, qui sera déposé sur le bureau du Parlement non pas dans deux ans, mais d’ici à la fin de l’année 2009.
Mon propos est long parce que le sujet l’exige !
Des mesures de régulation seront aussi prises à l’échelon européen ; j’aurai l’occasion d’y revenir.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ce n’est que collectivement que nous parviendrons à apporter les bonnes réponses aux difficultés de l’agriculture française. Je compte donc sur vous pour nous aider dans ce travail.
Applaudissements sur les travées de l’UMP, ainsi que sur certaines travées de l ’ Union centriste.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées de l ’ UMP.

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, qui ne s’étonnera pas que nous soyons plusieurs à évoquer la crise du lait. Le sujet est d’une importance telle que cela justifie que nous nous y attardions quelque peu.
Le 29 mai dernier, nous vous avions déjà interpellé, monsieur le ministre, sur les difficultés que connaît ce secteur. Force est de constater que la situation est aujourd’hui particulièrement préoccupante, à l’échelon tant national que communautaire. Nous sommes conscients que le Gouvernement de la France ne pourra à lui seul préparer des jours meilleurs.
Les tensions s’accentuent dans les différents États membres de l’Union européenne : 40 000 éleveurs européens, répartis dans huit pays différents, participeraient à la grève du lait, et les actions tendent à se durcir, notamment en Belgique, dont mon département est très proche.
Bien entendu, les producteurs sont les premières victimes de la baisse des prix de vente du lait, qui ont chuté en moyenne de 65 euros la tonne entre les mois de juillet 2008 et de juillet 2009, le prix moyen étant aujourd’hui inférieur à 280 euros la tonne. Pour certains exploitants, ce prix est inférieur aux coûts de production. Nous pourrions dresser un constat analogue en ce qui concerne la filière des fruits et légumes, qui vient d’être évoquée.
Parallèlement, les consommateurs n’ont pas vu baisser les prix des produits laitiers. Ce déséquilibre met en évidence l’opacité qui continue à prévaloir pour la répartition de la « rente laitière » entre transformateurs, industriels et centrales d’achat.
Permettez-moi de vous rappeler que j’avais déposé une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur le rôle des centrales d’achat dans la fixation des prix à la consommation et les délocalisations d’entreprises. Cette initiative mériterait peut-être d’être prise en considération.
Le récent lancement d’une grève du lait et les actions menées dans d’autres pays de l’Union européenne constituent autant d’appels au secours, auxquels la mise en place d’un fonds de 30 millions d’euros ne permet pas de répondre à long terme.
Dans ce contexte de crise, quels contours et quelle portée souhaitez-vous donner, monsieur le ministre, à la « contractualisation équilibrée et juste entre les producteurs et les industriels » que vous avez appelée de vos vœux pour réguler durablement la production laitière, à l’échelon tant national que communautaire, dans un souci d’équité et de durabilité ?
J’ose espérer que la réponse que vous apporterez à ma question ne fera pas regretter aux agriculteurs la période des quotas !
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste.
Monsieur le sénateur, je me suis déjà exprimé sur les mesures d’urgence qui ont été prises en faveur des exploitations laitières de France.
Comme je l’ai indiqué, une première tranche de 30 millions d'euros a été débloquée, qui sera complétée par une seconde du même montant et par le versement anticipé de 70 % des aides de la politique agricole commune, le 16 octobre prochain au lieu du 1er décembre. Ainsi, les exploitants laitiers connaîtront une amélioration de leur situation de trésorerie dès cette date.
Cependant, chacun sait que la seule solution réside dans la mise en place d’une nouvelle régulation du marché du lait à l’échelle européenne. Un rapport qui fait référence l’a montré. La dérégulation totale des marchés agricoles en Europe, cela ne marche pas !
M. Didier Guillaume s’exclame.
Il nous faut mettre en place une nouvelle régulation européenne des marchés agricoles, …
M. Bruno Le Maire, ministre. Je rappelle que la France a été le premier pays à proposer une telle régulation européenne du marché du lait. Nous avons été suivis par quinze États membres, dont l’Allemagne. Cette initiative débouche sur un succès, puisque la commissaire européenne à l’agriculture et au développement rural, Mme Mariann Fischer Boel, après avoir d’abord refusé notre proposition, a finalement annoncé ce matin qu’elle la jugeait intéressante et qu’il fallait effectivement mettre en place des contrats entre producteurs et industriels pour permettre une stabilisation des prix et des revenus des exploitants laitiers. C’est une première victoire, nous devons continuer dans cette voie.
Très bien ! sur les travées de l’UMP.
Ces contrats doivent être justes et équitables. Il ne s’agit pas de transformer les producteurs de lait en salariés de l’industrie laitière.
Les producteurs de lait doivent mieux s’organiser, …
M. Bruno Le Maire, ministre. … renforcer leurs structures professionnelles, de façon à pouvoir négocier en position de force avec les industriels un volume et un prix qui leur garantissent à terme de vivre dignement de leur activité, laquelle doit leur assurer un revenu décent et stable sur plusieurs années.
Applaudissementssur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.

« Une expertise est menée par une société indépendante. Sur trente-trois personnes, il en ressort que treize ont des “pensées mortifères”. La direction nous a alors juré que ça n’avait rien à voir avec les reconversions. »
C’est le témoignage d’un employé de France Télécom, en Ardèche, sur les différentes reconversions imposées au personnel depuis quelques années sur son site.
« Ils ont recommencé, poursuit-il. En 2008, on nous demande à nouveau de changer de métier […] pour la troisième fois en trois ans. Et impossible de refuser. […] D’autant qu’après la pression est constante. On nous compare avec les autres sites. […] On sait que deux ou trois sites vont fermer dans un avenir proche. Résultat, il règne une concurrence permanente entre nous. »
Ce salarié conclut en ces termes : « On se sent lâchés. On n’est plus rien […], on est devenus des artisans du CAC 40. »
Écoutez encore cette analyse de Christophe Dejours, psychanalyste, membre de la commission Le Breton mise en place par le Gouvernement :
« On ne peut les expliquer – il parle bien sûr des suicides – avec les références habituelles de la psychiatrie. Il y a une bascule dans l’ordre social, dans le fonctionnement de la société, c’est aussi le signe d’une rupture dans la culture et la civilisation : les gens se tuent pour le travail.
« Les gestionnaires qui ne regardent que le résultat ne veulent pas savoir comment vous les obtenez… C’est comme ça que les salariés deviennent fous, parce qu’ils n’y arrivent pas. Les objectifs qu’on leur assigne sont incompatibles avec le temps dont ils disposent.
« On prend les gens, on les casse, on les vire. L’être humain, au fond, est une variable d’ajustement, ce qui compte c’est l’argent, la gestion, les actionnaires, le conseil d’administration. »
Vingt-trois collaborateurs de France Télécom se sont donné la mort en dix-huit mois, et souvenons-nous de la série de suicides qui frappa le personnel du Technocentre de Renault à Guyancourt : on parlait déjà de la pression constante à la rentabilité pesant sur le personnel.
Dans ce contexte, monsieur le Premier ministre, vous arrive-t-il de vous interroger sur la « politique de civilisation », sur le type de société, sur les relations au travail, sur le mode de management que vous avez encouragés avec votre fameux slogan « travailler plus pour gagner plus » ?
Mme Jacqueline Panis s’exclame.

Ne voyez-vous pas les dégâts énormes causés par votre idéologie et vos actes sur la qualité de la vie, du travail, des relations humaines, ainsi que sur nos valeurs ?
Murmures sur les travées de l ’ UMP.

… détricotage du code du travail, soumission à la fameuse refondation sociale voulue par le MEDEF.
Le Président de la République va encore nous parler, dans les arènes mondiales, du « nouveau capitalisme », mais ce dernier ne fait qu’ajouter à l’ancien, celui des cadences infernales et du travail en miettes, la solitude.
Protestations sur les travées de l ’ UMP.

M. David Assouline. Pensez-vous que le monde du travail recevra ses paroles autrement que comme des mots – toujours des maux ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – M. Claude Biwer applaudit également.
Monsieur le sénateur, les témoignages dont vous nous avez donné lecture méritent mieux qu’un tel amalgame.
Notre première pensée va bien entendu à ces salariés qui se sont donné la mort ou ont tenté de le faire sur leur lieu de travail, ainsi qu’à leurs familles, qui traversent actuellement une épreuve difficile.
Les causes de tels gestes sont souvent très complexes, mais il est urgent, aujourd'hui, de sortir d’une situation malsaine dans laquelle les salariés expriment, parfois tragiquement, un rejet des mutations intervenant dans leur environnement professionnel.
Si tous les grands groupes connaissent des évolutions et des mutations qui impliquent une adaptation des personnels, tous ne sont pas confrontés aux mêmes difficultés que celles qu’a connues France Télécom. Nous devons comprendre les causes de cette situation et, surtout, veiller à ce que l’entreprise prenne sans délai les mesures qui s’imposent.
Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Le rôle de l’État est non pas d’empêcher France Télécom de continuer à se développer, mais de garantir que ces évolutions ne s’opèrent pas au détriment de la santé des salariés.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’exclame.
En l’occurrence, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, M. Xavier Darcos, s’est longuement entretenu avec le président du groupe France Télécom au sujet de la série de suicides intervenus dans l’entreprise. Il lui a fait part, notamment, de la volonté de l’État de voir aboutir les discussions et les négociations sur la transposition de l’accord national interprofessionnel sur le stress au travail. Il a demandé que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences offre aux salariés de l’entreprise une meilleure visibilité en matière d’évolutions professionnelles.
De façon très opérationnelle, le directeur général du travail a reçu mission d’assister aux prochains comités nationaux de suivi d’hygiène et de sécurité de l’entreprise et d’en rendre compte régulièrement au ministre.
Vous le voyez, monsieur le sénateur, le Gouvernement est très attentif à la situation. Il a d’ailleurs demandé à son représentant de relayer sa position lors du conseil d’administration extraordinaire qui se tiendra la semaine prochaine.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Ma question s'adresse à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Madame la ministre, vingt-trois salariés de France Télécom ont mis fin à leurs jours.
Murmures sur les travées de l ’ UMP.

Ces décès s’inscrivent dans une ample vague de suicides, notamment chez Renault, PSA, IBM, dont le lien avec le mal-être au travail, causé par la course au profit et à la financiarisation de l’économie, a été bien souvent occulté.
Cet insupportable gâchis humain doit cesser.

Il faut briser le mur du silence. Seule une souffrance extrême au travail peut pousser des hommes et des femmes à commettre ainsi l’irréparable. Il n’est pas acceptable de s’en tenir à la thèse bien commode des « drames personnels ».
M. Lombard, président-directeur général de France Télécom, a dépassé les bornes en évoquant une « mode du suicide ».

Il ne s’agit pas d’un lapsus : c’est bien l’inhumanité du capitalisme qui transparaît dans de tels propos.
Face à ce désastre économique et social, les propositions du Gouvernement ne nous satisfont pas. Ce ne sont pas les numéros verts, les cellules d’écoute et autres observatoires du stress qui feront disparaître la violence au travail. Au contraire, ces dispositifs sont des écrans de fumée qui tentent de masquer la réalité : celle des entreprises transformées en machines à broyer les êtres humains.
Exclamations sur les travées de l ’ UMP.

Cette violence au travail est démultipliée par le choix de la privatisation, par la priorité donnée à la logique financière sur l’intérêt général.

Cette violence, c’est la loi des actionnaires qui écrase les salariés, qui méprise les usagers. Ce qui compte pour M. Lombard, c’est l’augmentation du cours de l’action France Télécom, certainement pas la santé de ses employés.
Il est plus que temps d’en finir avec cette recherche du profit maximal et son cortège de restructurations, de plans sociaux. Il faut dire « stop ! » à ces dirigeants qui s’enrichissent de manière indécente, érigent le harcèlement moral en règle de management et réduisent les syndicalistes au silence.

Pour mettre un terme à cette spirale infernale, une intervention ferme de l’État, premier actionnaire de France Télécom, s’impose de toute urgence. Il faut bien sûr renforcer la réponse sociale, mais avant tout, madame la ministre, stopper la restructuration libérale, mettre un terme à la folie financière qui brise les hommes. Et cela, c’est votre responsabilité !
Un an après le début de la crise financière
Exclamations sur les travées de l ’ UMP

… il n’est que temps de rappeler que l’économie doit servir le développement humain. Il faut remettre de grandes entreprises comme France Télécom ou GDF-Suez au service de la nation, de l’épanouissement de leurs salariés.

M. Guy Fischer. Nous refuserons que La Poste et ses agents suivent cette voie désastreuse que vous entendez leur imposer à leur tour.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.
Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Monsieur Fischer, personne ne doit exploiter ces drames personnels, qui appartiennent aux familles plongées dans la souffrance.
Très bien ! et applaudissementssur les travées de l’UMP.
Devant la récurrence de ce phénomène au cours des dernières semaines, nous avons agi.
Dès que nous avons été informés des événements, Xavier Darcos et moi-même avons demandé une réunion exceptionnelle du conseil d’administration de France Télécom, consacrée principalement à la situation du personnel de l’entreprise.
Lors de la tenue de ce conseil d’administration, mardi après-midi, le représentant de l’État a fait connaître à la direction de France Télécom qu’il était impératif de mettre en place un plan d’urgence afin de répondre à la situation, en prenant plus spécialement en compte deux aspects. Il a ainsi souligné que l’ensemble du personnel de France Télécom était concerné, en particulier les agents des échelons intermédiaires : cela a été clairement mis en évidence. Il a également insisté sur la nécessité de mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences beaucoup plus efficace et individualisée.
En effet, comme l’a relevé tout à l'heure M. Assouline, le personnel de France Télécom, qui a fait des efforts considérables depuis 2002, et même avant, pour tout simplement s’adapter aux évolutions technologiques de ce secteur d’activité, est souvent plongé dans une grande incertitude, portant sur l’évolution individuelle des salariés et celle des postes de travail, ainsi que sur la localisation de ces derniers. C’est une réalité.
Je tiens, à cet instant, à rendre hommage à tous les salariés de France Télécom qui ont accompli cet énorme effort au cours des dernières années, en particulier depuis 2002, date à laquelle, souvenez-vous, le groupe se trouvait dans une situation financière catastrophique. Il aurait alors pu connaître le même sort que British Telecom, par exemple, qui a été obligé de céder une partie de son activité, notamment la téléphonie mobile, pour se retrancher sur la téléphonie fixe. Au lieu de cela, France Télécom est devenu le troisième opérateur de télécommunications en Europe, a réussi à s’implanter dans trente pays et est aujourd’hui un véritable compétiteur sur la scène internationale.
Cela a été possible grâce à la contribution de chacun. La gestion des ressources humaines doit évidemment être centrée sur les femmes et les hommes qui concourent à ce succès. C’est ce que nous avons demandé au conseil d’administration de faire en urgence : il devra en rendre compte au ministre compétent, M. Darcos.
Au nom de l’État actionnaire, j’écrirai dans les prochains jours à tous les présidents des sociétés dans lesquelles l’État détient des participations pour leur demander de prendre le même type de mesures, en particulier de mettre en place une gestion prévisionnelle beaucoup plus fine du personnel.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Ma question s’adresse à M. le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche.
Monsieur le ministre, le 3 juin dernier, un accord a été signé au Centre national interprofessionnel de l’économie laitière, prévoyant notamment que le prix moyen du lait s’établirait en 2009 entre 262 euros et 280 euros pour 1 000 litres.
Ce prix moyen, vous le savez, est considéré comme largement insuffisant par un certain nombre de producteurs de lait et ne couvre pas la totalité des charges, s’agissant notamment des jeunes agriculteurs en phase d’installation et de tous ceux qui ont dû investir lourdement dans leur outil de production.
Les organismes représentatifs de la production laitière doivent élaborer et négocier, d’ici à la fin de l’année, un cadre interprofessionnel définissant les futures relations contractuelles entre producteurs et transformateurs en matière de prix, de volume et de durée, afin de réguler le marché.
Le Gouvernement, quant à lui, a annoncé un plan d’accompagnement, ainsi qu’un gel des quotas pour 2009 et 2010.
Vous avez en outre souhaité, monsieur le ministre, une exonération de la moitié, au moins, de la taxe carbone pour les agriculteurs. Par ailleurs, vous avez demandé aux banques de faire un geste en matière, notamment, d’intérêts d’emprunts et de reports d’annuités. Vous avez adressé une demande analogue à la Mutualité sociale agricole en ce qui concerne les cotisations sociales.
À l’échelon européen, vous avez annoncé la création d’un groupe de travail franco-allemand – ouvert d’ailleurs à tous les États membres – sur une régulation plus souple et plus efficace du marché laitier européen.
Toutefois, ces efforts déployés tant sur le plan national qu’à l’échelon européen ne semblent pas, pour l’heure, répondre aux attentes des producteurs de lait. Des manifestations ont ainsi eu lieu en France, mais également dans d’autres pays, notamment en Belgique, où elles ont pris une forme particulièrement choquante et violente.

L’inquiétude est grande parmi ces producteurs dont le revenu ne cesse de diminuer, tandis que leurs dettes et leurs charges continuent de s’accroître. Une partie d’entre eux travaillent à perte. Le fait de distribuer le lait gratuitement ou de le déverser sur la voie publique est révélateur de la situation dramatique qu’ils connaissent aujourd’hui. La disparition programmée pour 2015 des quotas laitiers leur semble inconcevable.

Comme toutes les autres filières agricoles, celle du lait a besoin de visibilité, de stabilité et de sérénité. Or les compromis actuels apparaissent comme très éloignés des réalités économiques.

M. Benoît Huré. Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous préciser l’état d’avancement des négociations menées à l’échelon européen sur la mise en place d’une nouvelle régulation, accompagnement indispensable de la sortie de crise ? Pourriez-vous également nous assurer une nouvelle fois de votre volonté d’établir une solidarité entre tous les territoires de ce pays ?
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Monsieur Huré, je partage évidemment votre interprétation des mouvements auxquels nous assistons aujourd’hui : ils manifestent le profond désespoir d’une grande partie des exploitants laitiers, en France comme dans le reste de l’Europe.
Comme je l’ai indiqué, tous les moyens nécessaires doivent être mobilisés pour apporter des réponses immédiates. Il convient notamment de prendre des mesures de soutien à la trésorerie et de solliciter la participation des banques, de la MSA et des assurances, que je rencontrerai dans les prochaines semaines.
Par ailleurs, je réunirai dès demain matin les acteurs de l’interprofession laitière pour faire le point avec eux sur la situation. Le dialogue est ouvert à toutes les organisations syndicales qui souhaitent me faire part de leurs analyses.
Tout cela doit nous permettre d’apporter les réponses les plus ciblées et les plus efficaces possible aux problèmes de trésorerie que rencontrent les exploitants laitiers, particulièrement les jeunes et tous ceux qui ont réalisé des investissements, par exemple pour l’achat de robots de traite ou la mise aux normes de leur exploitation, lorsque le cours du lait était plus élevé.
Cependant, ce qui garantira, à long terme, le revenu des exploitants laitiers en France et en Europe, c’est une nouvelle régulation des marchés, laquelle devra comporter deux dimensions.
Sur le plan national, un contrat devra être conclu entre, d’un côté, les producteurs, mieux organisés qu’ils ne le sont actuellement, et, de l’autre, les industriels et les coopératives.
C’est un point essentiel. Ce contrat devra porter sur les volumes et sur les prix : nous pourrons alors dire les yeux dans les yeux à tous les exploitants laitiers de France que leur revenu est garanti pour les années à venir !
À l’échelon européen, il faudra compléter ce dispositif par des moyens de stabilisation des cours. Cela passe, par exemple, par une modification des instruments d’intervention et un accroissement des moyens de stockage. Aujourd’hui, le stockage n’est possible que six mois sur douze, comme si la crise ne frappait que la moitié de l’année ! Mon homologue allemand et moi-même avons donc proposé l’extension de la période de stockage à l’année entière.
Il nous faut aussi réfléchir aux moyens de stabiliser les cours du beurre et de la poudre de lait, produits transformés faisant l’objet de spéculations à l’échelle internationale. J’ai proposé la mise en place d’un marché à terme européen sur les cours du beurre et de la poudre.
M. Bruno Le Maire, ministre. Nous étudierons toutes les solutions possibles pour résoudre, à court terme, les problèmes de trésorerie, et, à plus longue échéance, les questions qui relèvent de l’échelon européen, afin de tenir notre engagement de garantir un revenu stable et décent aux exploitants laitiers de France et d’Europe.
Applaudissementssur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.

S’il est un lieu où l’on sait ce que sont la ruralité et l’agriculture, c’est bien la Haute Assemblée. Le fait que ma question soit la quatrième adressée au ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche montre bien tout l’intérêt que nous portons à ce secteur.
Évoquer l’agriculture nous renvoie à trois questions fondamentales, celles de notre alimentation, de notre mode de vie et de notre santé. Oui, nous devons le réaffirmer ici : les agriculteurs sont utiles à la France ! Il est temps de se souvenir qu’il existe une France rurale, que des hommes et des femmes la font vivre et font vivre notre pays tout entier.
Aujourd’hui, monsieur le ministre, la détresse du monde agricole est extrême. Cela est particulièrement vrai pour les producteurs de lait, mais aucune filière n’est épargnée, tant en plaine qu’en zone de montagne.
Aucune autre profession, mes chers collègues, n’aurait résisté à une baisse de revenus de plus de 20 % en 2008. Et la chute se poursuit en 2009 ! Aujourd’hui, le niveau du revenu agricole est le même qu’en 1994. Or, en quinze ans, 300 000 agriculteurs ont disparu, soit 30 % des effectifs de la profession.
La crise qui touche le monde agricole n’est pas une crise de production : c’est une crise de nature économique, qui est aussi la conséquence de décisions politiques.
Lorsque, en 2002, par pure idéologie, vous avez supprimé les CTE, les contrats territoriaux d’exploitation, …

… vous avez mis à mal la multifonctionnalité et une redistribution plus équitable.
En 2004, vous avez soutenu l’Europe libérale avec les accords de Luxembourg.

La fin des quotas laitiers, entérinée sous présidence française de l’Union européenne, met en difficulté toute la profession.
Les mouvements inspirés par le désespoir auxquels nous assistons en ce moment en témoignent : les éleveurs laitiers se sentent abandonnés ; ils attendent une réponse. La loi de modernisation de l’économie a introduit un nouveau rapport de force favorable à la grande distribution.

Lorsque le kilo de pommes, acheté 48 centimes au producteur, est vendu 2, 40 euros au consommateur, lorsque le kilo de tomates, acheté 30 centimes au producteur, est vendu 2, 80 euros au consommateur, …
Oui ! sur les travées de l ’ UMP.

… on marche sur la tête !
Il est urgent d’en finir avec ces écarts énormes. Le Gouvernement doit réagir. Les agriculteurs veulent vivre de leur travail, sur la base de prix rémunérateurs, et non grâce à des aides.
Vous l’avez dit, monsieur le ministre, la régulation économique doit être au cœur du dispositif. Êtes-vous prêt à revoir le système de formation des prix agricoles afin que les agriculteurs puissent vivre décemment ? Quelles mesures concrètes et fortes comptez-vous prendre pour sauver l’agriculture française et redonner aux producteurs espoir et perspectives ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur Guillaume, il y a un point de fond sur lequel je vous rejoins : nous avons tous une dette de reconnaissance à l’égard du monde agricole.
Comme vous l’avez demandé, nous serons très attentifs à la formation des prix, notamment dans la grande distribution, grâce à l’Observatoire des prix et des marges mis en place par ma collègue Christine Lagarde. Ce dernier fera connaître les résultats de ses travaux sur les fruits et légumes le 8 octobre prochain. S’il devait apparaître que des marges trop importantes ont été pratiquées dans ce secteur, Mme Lagarde et moi-même en tirerions toutes les conséquences.
Quant aux réponses de fond à apporter à l’agriculture française, elles seront l’objet de la future loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, dont j’ai lancé les travaux préparatoires il y a quelques jours. Je vous invite à participer le plus activement possible à son élaboration.
Ce texte doit nous permettre de redonner un nouvel élan à l’agriculture française, en répondant à quelques questions structurelles.
La première de ces questions porte sur l’alimentation. Vous l’avez dit vous-même, monsieur Guillaume, la production agricole française a pour finalité l’alimentation de tous nos concitoyens. La politique agricole commune devrait, elle aussi, avoir pour objectif de nourrir correctement les 500 millions de citoyens européens. J’ai d’ailleurs proposé de rebaptiser la PAC « politique agricole et alimentaire européenne ».
Une deuxième question a trait à la compétitivité de certaines filières. Vous avez évoqué celle des fruits et légumes : il nous faut répondre à la question du coût du travail saisonnier dans ce secteur, qui est de 12 euros de l’heure dans notre pays, contre 6 euros en Allemagne, 7 euros en Espagne et 8 euros en Italie. Nous ne pouvons pas continuer à produire des fruits et légumes dans ces conditions.
Marques d’approbation sur les travées de l’UMP.
La troisième question essentielle porte sur la stabilisation du revenu des agriculteurs français, qui ne peuvent plus continuer à vivre avec des variations de revenu de l’ordre de 20 % à 30 % chaque année. Je propose donc la mise en place de systèmes assurantiels destinés à leur permettre de faire face aux aléas économiques, de plus en plus importants, qu’ils ont à subir.
Enfin, la dernière question structurelle que je vous propose d’examiner ensemble est relative à la perte de foncier agricole. Tous les dix ans, la France, première nation agricole d’Europe, perd l’équivalent d’un département en surface agricole utile. Ce n’est pas acceptable ! Il nous faut prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous invite tous à participer activement à l’élaboration de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche voulue par le Premier ministre et le Président de la République !
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Applaudissements sur les travées de l’UMP.

Ma question s’adresse à M. le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.

Monsieur le ministre, de nombreux parents ont appris avec soulagement qu’une solution avait été trouvée afin de permettre la poursuite de l’accompagnement de leur enfant handicapé à l’école.
Je tiens à vous remercier, ainsi que votre prédécesseur, M. Xavier Darcos, de cette heureuse issue, qui résulte de votre engagement à ce que chaque auxiliaire de vie scolaire en fin de contrat puisse continuer à exercer ses compétences auprès d’un enfant handicapé.

Nous connaissons tous la valeur de ces hommes et de ces femmes qui se dévouent auprès des enfants et qui nous disaient vouloir poursuivre une activité professionnelle ayant du sens pour eux comme pour la collectivité.
Pour autant, si la situation des AVS en fin de contrat au terme de l’année 2009 est aujourd’hui traitée, il nous faut imaginer une solution pérenne pour tous ceux dont la mission au service de l’éducation nationale va s’achever dans les prochains mois.
Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous exposer les détails de la convention-cadre conclue avec les principales associations intervenant au titre du handicap à l’école ?
Pouvez-vous, par ailleurs, nous préciser les propositions du Gouvernement en vue de la création d’un véritable statut de l’accompagnant et d’une professionnalisation de la filière de l’accompagnement scolaire, aujourd’hui bien nécessaire quand on sait que plus de 170 000 enfants handicapés reçoivent une formation en milieu scolaire ordinaire ?
Applaudissements sur les travées de l’UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Madame Debré, 185 000 élèves handicapés ont été accueillis à l’école en cette rentrée 2009, soit 10 000 de plus que l’année dernière, 40 % de plus qu’en 2005 et deux fois plus qu’il y a dix ans.
Cet effort d’accueil sans précédent a d’abord été rendu possible par votre volontarisme, mesdames, messieurs les sénateurs, puisque vous avez voté en 2005 une loi qui a changé la philosophie en la matière, ainsi que par l’action de l’ensemble de nos partenaires, associations de parents d’enfants handicapés et collectivités locales. Il a également été permis grâce aux moyens mis à la disposition des établissements scolaires par l’éducation nationale, de manière progressive mais avec un effort tout particulier pour cette rentrée, puisque nous avons ouvert 200 unités pédagogiques d’intégration supplémentaires. En matière d’encadrement, le Premier ministre avait souhaité pérenniser les 17 000 postes d’AVSI –les auxiliaires de vie scolaire individuels. J’ai annoncé dernièrement que nous en créons 5 000 de plus dans le cadre du plan de relance destiné à lutter contre la crise que nous traversons. Au total, ce sont donc plus de 22 000 AVSI qui accompagneront les enfants handicapés au cours de cette année scolaire, chiffre jamais atteint auparavant.
Dès mon arrivée au ministère, j’ai été sensibilisé à la situation des personnels qui, arrivant au terme de leur contrat, ne pouvaient pas postuler à son renouvellement alors même que leur poste était pérennisé. Cette situation est particulièrement problématique dans le cas des enfants les plus en difficulté, comme les autistes ou les sourds-muets, dont le handicap justifie une continuité dans l’accompagnement.
Nous avons cherché une solution, que nous avons trouvée grâce à vous, mesdames, messieurs les sénateurs, puisque, au mois de juillet dernier, vous avez adopté un amendement qui nous a permis de travailler à la reprise par les associations de parents d’enfants handicapés des contrats de ces personnes. J’ai ainsi pu signer trois conventions en ce sens avec les principales associations avant la rentrée scolaire : l’État prendra à sa charge le salaire brut majoré de 10 %. Les associations sont donc dorénavant en mesure de prendre le relais.
Cela étant, madame Debré, il est vrai qu’il faudra aller plus loin. Mme Morano et moi-même souhaitons travailler avec l’ensemble des parlementaires à la constitution d’une véritable filière. Pour répondre aux besoins, nous disposons de personnels qualifiés avec tous les emplois aidés qui se sont multipliés au fil des années. Réfléchissons ensemble à la création de cette filière, afin que tous les enfants handicapés puissent être accueillis à l’école.
Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Ma question s’adresse à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.
Madame la ministre, le discours prononcé par le Président de la République à Artemare, dans l’Ain, le 10 septembre dernier, est historique à un double titre.
Tout d’abord, en instaurant la taxation des énergies carbonées, M. Sarkozy a fait délibérément entrer notre économie dans la logique d’une fiscalité écologique. À la veille du G20 de Copenhague, cette décision de la France place les autres leaders mondiaux face à leurs responsabilités.
Cela s’accompagne d’une révolution dans les mentalités : pour la première fois dans notre droit fiscal, un gouvernement décide une mesure d’équité pour les contribuables ruraux. Ainsi, eu égard à la quasi-impossibilité, pour eux, d’utiliser les transports en commun, trop rares ou inadaptés, ils bénéficieront d’un avantage fiscal ou d’un « chèque vert » supérieur de plus de 25 % à celui qui sera octroyé à nos concitoyens urbains, si l’on se réfère aux chiffres annoncés par le chef de l’État.
Madame la ministre, moi qui suis, comme la plupart de mes collègues, un ardent défenseur de la ruralité, je ne puis que me féliciter de la prise de conscience, au plus haut niveau de l’État, des inégalités territoriales existant entre ruraux et urbains. Pouvez-vous nous exposer plus en détail ces dispositions ?
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Monsieur le sénateur, l’instauration de la taxe carbone répond à un double objectif.
Nous souhaitons d’abord donner un prix à ce qui n’était jusqu’à présent qu’un coût, à savoir la pollution ou, pour dire les choses de façon plus complexe, notre contribution par l’émission de CO2 au réchauffement climatique.
Nous souhaitons ensuite, au travers de ce prix, adresser un signal, afin que chacun prenne conscience que la consommation d’énergie fossile engendre une pollution.
L’objectif n’est nullement de créer ainsi une ressource supplémentaire pour l’État ! Le produit de la taxe carbone sera restitué aux ménages sous la forme soit d’une réduction d’impôt, pour les contribuables imposables, soit d’un « chèque vert », pour les contribuables non imposables.
Ce dispositif est assorti de deux éléments de pondération.
Il s’agit, en premier lieu, de la composition de la famille, qui joue sur la consommation d’énergie fossile. Ainsi, les foyers recevront 10 euros supplémentaires par enfant à charge.
En second lieu, il est tenu compte de l’existence ou non d’une possibilité de recourir aux transports en commun, ce qui revient souvent à faire une distinction entre urbains et ruraux. Pour cela, nous avons retenu le critère qui nous paraissait le moins imparfait, à savoir la définition des périmètres de transports urbains, les PTU : un bonus sera accordé aux foyers fiscaux domiciliés hors PTU.
Ainsi, une famille comptant deux enfants bénéficiera d’un crédit d’impôt ou d’un « chèque vert » de 112 euros si elle réside dans un PTU, de 132 euros dans le cas contraire. Cette différence résulte de calculs effectués avec l’aide de l’INSEE.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.
Accélération des fusions d’écoles en vue de diminuer le nombre de postes, réduction à la portion congrue de la formation continue des enseignants faute de remplaçants et, surtout, renvoi chez eux d’enfants handicapés faute d’auxiliaires de vie scolaire : telles sont quelques-unes des réalités de votre politique en cette rentrée scolaire, monsieur le ministre.
Cette politique est non pas éducative, mais strictement comptable, fondée sur une simple logique de réduction des moyens. Vous n’avez aucune volonté politique de repenser vraiment l’école !
La preuve en est que l’Inspection générale de l’éducation nationale elle-même, c’est-à-dire votre propre administration, a publié cet été un bilan de la réforme de l’enseignement primaire critique sur deux des mesures phares de celle-ci : la semaine de quatre jours et la prise en charge des élèves en difficulté, la première ayant été conçue, soit dit en passant, pour mieux financer la seconde.
En ce qui concerne la semaine de quatre jours, ce bilan confirme ce que chercheurs et parents d’élèves ont toujours dit : elle ne correspond pas aux rythmes des enfants. Elle induit des journées beaucoup trop longues pour eux et aboutit à réduire le temps effectif d’enseignement à 140 jours dans l’année, alors que la moyenne annuelle en Europe est de 185 jours de classe. La semaine de quatre jours a été faite non pour les enfants, mais pour les adultes !
En ce qui concerne la prise en charge des élèves en difficulté, votre réforme a donné lieu à la juxtaposition de dispositifs dénués de cohérence, ce qui nuit à leur efficacité. L’Inspection générale de l’éducation nationale pointe ainsi la nécessité d’en préciser les finalités et d’en organiser la cohérence. Il y a pire : non seulement des mesures telles que l’aide individualisée ou les stages de remise à niveau ne profitent pas aux élèves qui en ont le plus besoin, mais elles ne sont pas adaptées à la prise en charge des élèves en échec scolaire. Or, avec la sédentarisation des réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté, les RASED, vous laissez sur le bord du chemin les élèves connaissant de lourdes difficultés et en situation d’échec scolaire. Vous vous focalisez uniquement sur les difficultés scolaires passagères, sur le soutien ponctuel, au détriment du traitement de fond de l’échec scolaire, l’objectif étant de faire rapidement du chiffre, les résultats devant être attestés par les nouvelles évaluations.
Aujourd’hui, il est urgent de redéfinir le temps de l’école, ainsi que sa cohérence pédagogique et éducative. C’est votre propre administration qui vous le demande, et les Français aussi, puisque 67 % d’entre eux sont favorables à la semaine de quatre jours et demi, avec classe le mercredi matin.
Êtes-vous donc prêt, monsieur le ministre, à engager la concertation sur ce sujet avec l’ensemble des acteurs concernés ? Cette concertation devra aboutir à une décision ministérielle nationale, et non se réduire à une simple possibilité d’aménagement accordée localement, car cette solution, outre qu’elle est la moins opérante pour les collectivités locales, est surtout synonyme de statu quo.
Êtes-vous prêt, en outre, à recentrer la prise en charge des élèves en grande difficulté autour d’un projet cohérent qui permette, dans tous les établissements, à chaque élève de bénéficier du ou des dispositifs les mieux adaptés à sa situation particulière ? Êtes-vous prêt à y consacrer les moyens propres à assurer la réussite de tous les élèves, notamment en renonçant à la suppression de 16 000 postes cette année ?
Enfin, pourriez-vous nous informer sur la situation actuelle en Guyane, où le rectorat est en grève depuis la rentrée ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le sénateur, je voudrais tout d’abord, deux semaines après la rentrée scolaire, rendre hommage à l’action des 857 000 enseignants et des 175 000 personnels d’encadrement et administratifs de l’éducation nationale qui ont accueilli 12 millions d’élèves sur l’ensemble du territoire, dans 66 000 établissements scolaires. C’est une véritable prouesse, accomplie grâce à leur compétence et à leur savoir-faire.
Vous faites référence à un rapport de l’Inspection générale de l’éducation nationale. Permettez-moi de vous recommander, lorsque vous citez un rapport, de ne pas le faire de manière parcellaire, mais d’aller jusqu’au bout de la citation !
Murmures sur les travées du groupe socialiste. – M. Yves Pozzo di Borgo applaudit.
En effet, ce rapport indique que la réforme du primaire, qui avait été engagée par mon prédécesseur, constitue un véritable progrès pour l’ensemble de l’enseignement scolaire dans ce cycle.
Tout d’abord, les nouveaux programmes ont été recentrés sur les apprentissages fondamentaux, le français et les mathématiques en particulier. Il est important d’édifier un socle commun de compétences dès le plus jeune âge.
Ensuite, un nouveau mode d’évaluation a été mis en place, grâce auquel nous pourrons, dès le primaire, orienter les efforts en direction des élèves en difficulté.
Enfin, une nouvelle organisation du temps scolaire est entrée en vigueur, qui a permis, monsieur le sénateur, de dégager deux heures pour l’aide personnalisée, dispositif qui concerne aujourd'hui un million d’élèves, pris en charge chaque semaine par petits groupes de quatre ou cinq. L’objectif est notamment d’éviter le décrochage scolaire dès le plus jeune âge. Je rappelle que 15 % des élèves arrivant en sixième ont des difficultés de lecture ou d’écriture. Nous allons donc concentrer nos moyens sur ces « décrocheurs » en puissance pour leur offrir, dès le primaire, un accompagnement personnalisé.
Quant à l’organisation du temps de travail, la suppression de l’école le samedi matin, décidée par mon prédécesseur, est plébiscitée par 77 % des Français, selon une enquête de l’IPSOS récemment publiée. Pour le reste, nous avons effectivement laissé à la communauté pédagogique locale, aux conseils d’école, la responsabilité de choisir d’organiser la semaine sur quatre jours ou sur quatre jours et demi. Monsieur le sénateur, j’estime qu’il est du devoir de l’administration centrale, du ministère, de faire confiance à la communauté éducative, …
… aux partenaires, aux maires, aux collectivités territoriales, aux conseils d’école pour déterminer quelle formule convient le mieux aux élèves compte tenu de la situation locale.

Il faut du temps pour l’école, et pas seulement pour aller au supermarché !
M. Luc Chatel, ministre. Telle est, en tout cas, la position que nous avons adoptée.
Applaudissementssur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.

Ma question s'adresse à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Madame la ministre, en octobre 2008, les banques françaises s’étaient engagées à augmenter de 3 % à 4 % leurs encours de crédits sur un an, en contrepartie du plan de soutien gouvernemental. Il est évident qu’elles n’atteindront pas cet objectif : la progression de ces encours atteindra péniblement 2 %.
Aujourd’hui, beaucoup de particuliers et de chefs d’entreprise se plaignent des conditions restrictives d’accès à des financements. C’est pourquoi le rôle d’intermédiaire que joue le médiateur du crédit est absolument indispensable.
Les banques continuent, en effet, de mener des politiques trop frileuses envers les entreprises, surtout les PME. Peinant à obtenir des crédits, ces dernières se trouvent confrontées à de graves difficultés financières.
Pour ma part, je connais, en Seine-Saint-Denis, une jeune entrepreneuse qui, bien que disposant de commandes d’entreprises de renom, est aujourd’hui dans l’impossibilité d’y répondre, faute de moyens financiers lui permettant d’acheter des matières premières ou d’investir. Plutôt que de soutenir cette jeune lauréate du prix « Envie d’agir » en 2005, sa banque, celle qui, paraît-il, « accompagne un monde qui change », la plonge dans une situation dramatique. Dans quelques jours, elle devra mettre la clef sous la porte, faute de soutien, et rejoindre la longue cohorte des chômeurs. Il ne s’agit malheureusement pas d’un cas isolé !
Il est pour le moins honteux que ceux qui ont contribué à plonger notre pays et l’économie mondiale dans la crise se permettent de donner des leçons et ne respectent pas leurs engagements. Quand on a perdu des millions, voire des milliards, il faut faire preuve d’humilité, respecter ceux qui investissent avec courage et font vivre l’économie de notre pays.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Les banques doivent les accompagner et les soutenir avec vigueur plutôt que de les laisser mourir ! J’en viens presque, madame la ministre, à regretter l’époque des banques nationalisées…
Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

M. Christian Demuynck. Dans ce contexte, madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer quelles actions le Gouvernement entend mener pour stimuler l’offre de crédit, afin que ne soit pas ralentie ou compromise la reprise escomptée en 2010 ?
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Monsieur le sénateur, en octobre 2008, en l’espace d’une semaine, le Parlement a approuvé la constitution de deux entités, la SFEF, la société de financement de l’économie française, et la SPPE, la société de prises de participation de l’État. Je n’ai pas demandé alors la nationalisation des banques françaises, parce qu’elles étaient suffisamment solides pour « tenir » grâce à un simple renforcement de leurs capitaux propres, par le biais de prêts participatifs et de titres super-subordonnés. Je crois que nous pouvons nous en réjouir, tous les pays d’Europe n’étant pas nécessairement dans ce cas.
Les engagements pris par les banques en contrepartie étaient de deux ordres.
Dans le domaine économique, tout d’abord, elles s’étaient engagées, comme vous l’avez dit, à soutenir l’activité en augmentant de 3 % à 4 %, selon les établissements, leurs encours de crédits, tant aux ménages qu’aux entreprises. Aujourd’hui, certaines d’entre elles, notamment celle à laquelle vous avez fait référence, sont au-delà de la barre des 3 %, toutes catégories d’emprunteurs confondues.
Cela étant, vous avez raison de souligner que, en ce qui concerne le crédit aux entreprises, il y a du chemin à faire. Heureusement, le Président de la République a décidé la mise en place d’un médiateur.
M. René Ricol a accompli un travail remarquable de traitement au cas par cas de plus de 6 000 dossiers, ce qui a permis de sauver rien de moins que 140 000 emplois.
Par ailleurs, la Cour des comptes est missionnée pour surveiller l’utilisation des fonds qui ont été mis à disposition par le biais de la SFEF et de la SPPE.
Cela ne suffit cependant pas, car nous sommes en période de reprise d’activité. Le Premier ministre a annoncé tout à l’heure une révision à la hausse, pour la première fois depuis plusieurs trimestres, de nos prévisions de croissance pour les années 2009 et 2010, qui s’établissent désormais, respectivement, à moins 2, 25 %, au lieu de moins 3 %, et à plus 0, 75 %, au lieu de plus 0, 5 %. Les signes de la reprise sont donc là, et cela nous conforte dans l’idée que celle-ci est au coin de la rue.
Dans ce contexte, il ne faut surtout pas que les entreprises, en particulier les PME, soient bridées dans leurs efforts, faute notamment de crédits de trésorerie. J’ai donc écrit le 3 septembre dernier à toutes les banques de réseau pour leur demander de me communiquer, avant le 15 du même mois, leur plan d’action, le développement qu’elles envisagent et les modalités selon lesquelles elles sont prêtes à aller à la rencontre de leurs clients et à répondre à leurs besoins. Elles ont toutes répondu, en proposant un certain nombre de méthodes pour cibler les clientèles, avec des taux préférentiels. Leur réponse est plutôt satisfaisante, mais pas tout à fait assez.
Le Premier ministre m’a donc demandé de solliciter à nouveau les banques pour savoir de quelle manière et, surtout, à quel rythme elles entendaient répercuter les baisses des taux directeurs fixés par la Banque centrale européenne auprès des clientèles privées, en particulier des petites et moyennes entreprises, en maintenant bien sûr les mêmes échéances. Je vais m’atteler à cette tâche, de façon à mettre les banques sous pression, mais je demande au passage que l’on ne vilipende pas les personnels de ces établissements, car ils sont nombreux à très bien faire leur travail et à avoir à cœur d’assurer le financement de notre économie. Les banques ne doivent pas être considérées comme des moutons noirs : nous avons besoin d’elles, encourageons-les dans l’effort important qu’elles fournissent actuellement afin que nos entreprises puissent prendre le vent de la croissance qui se lève.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Mes chers collègues, j’ai le plaisir de saluer, dans la tribune d’honneur du Sénat, une délégation de quatre députés du Parlement monocaméral de Hongrie, conduite par M. Lajos Szues.
La délégation, qui comprend aussi le secrétaire général de cette assemblée, est en France pour une visite d’étude auprès de nos deux assemblées, consacrée au travail législatif et aux comptes rendus de ce travail.
Le Sénat français entretient des relations d’amitié étroites avec le Parlement de Hongrie, avec lequel il est récemment intervenu, dans le domaine de la coopération interparlementaire, auprès de pays comme la Roumanie et la Moldavie.
Mes chers collègues, permettez-moi de souhaiter en votre nom à tous à cette délégation parlementaire une cordiale bienvenue, ainsi qu’un excellent et fructueux séjour.
Mmes et MM. les ministres, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.

Je vais maintenant suspendre la séance. Elle reprendra vers seize heures quinze pour l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la convention sur les armes à sous-munitions.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures vingt.
(Texte de la commission)

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la convention sur les armes à sous-munitions (projet n° 575, texte de la commission n° 616, rapport n° 615).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai l’honneur de présenter devant vous cet après-midi, au nom du Gouvernement, le projet de loi visant à autoriser la ratification de la convention sur les armes à sous-munitions.
Je le fais avec d’autant plus de fierté que j’ai signé cette convention au nom de la France le 3 décembre dernier, à Oslo.
Je le fais avec d’autant plus d’émotion qu’il s’agit d’une cause me tenant particulièrement à cœur. Je me suis personnellement beaucoup engagé pour elle, ayant été témoin, au cours de ma vie, des effets dévastateurs, ravageurs et scandaleux de ces armes sur les populations civiles. Grâce à cette convention, il existe désormais un chemin qui nous mènera un jour à leur éradication partout dans le monde. L’espoir est donc là.
Ce texte marque une nouvelle victoire sur l’inhumanité et la barbarie. Nous en avons grand besoin. C’est une victoire du droit international humanitaire et du désarmement. Elle a été obtenue grâce au combat mené avec nous par de nombreuses associations, auxquelles je rends ici hommage. Je pense par exemple, à cet instant, à Handicap international, qui a joué un grand rôle. C’est une victoire remportée contre des armes frappant lâchement et aveuglément, qui continuent d’exploser des semaines, des mois, des années parfois après avoir été dispersées.
Plus d’un million de ces armes sont disséminées dans le monde, selon l’ONU. Chaque jour, dans la trentaine de pays encore affectés par ce fléau, des femmes, des enfants, des vieillards, des hommes qui ont le malheur de vivre sur les théâtres de conflits éteints ou toujours en cours meurent ou sont blessés à jamais par ces armements.
En effet, comme les mines antipersonnel, ces armes ont pour principales victimes des civils – à plus de 98 % –, et d’abord des enfants : 40 % des victimes, soit presque une sur deux, ont moins de dix-huit ans. Quelle injustice pour eux et pour leurs familles !
Nous avons tous en mémoire le regard bouleversant de ces enfants du Cambodge, du Laos, d’Afghanistan ou d’Angola qui continuent de grandir dans l’angoisse et la peur, parfois des décennies après que les armes se sont tues. Nous avons tous en mémoire l’image de ces enfants qui devront vivre mutilés à jamais.
En effet, et bien d’autres pays encore sont touchés !
Victimes hier de la violence et de la terreur des combats, victimes aujourd’hui et demain d’armes toujours présentes, cachées et meurtrières, alors même qu’il n’existe plus d’objectifs militaires avérés : voilà la terrible malédiction de ces populations civiles, à laquelle nous devons mettre fin.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens donc à remercier votre assemblée, et en particulier le président Josselin de Rohan, d’avoir accepté, en concertation avec le Gouvernement, d’inscrire si rapidement ce texte à son ordre du jour, en ce début de session extraordinaire, malgré un programme que je sais très chargé. Je rends également hommage à tous les parlementaires qui se sont engagés dans ce combat, notamment Joëlle Garriaud-Maylam et Jean-Pierre Plancade.
À ce jour, dix-sept États ont ratifié la convention. La France devrait être en mesure de le faire prochainement. Si tout va bien, j’espère pouvoir déposer notre instrument de ratification lors de l’assemblée générale des Nations unies qui s’ouvrira dans quelques jours à New York. Ce serait un très beau symbole !
Mesdames, messieurs les sénateurs, revenons rapidement sur la genèse de cette convention.
Souvenons-nous que les armes à sous-munitions sont des vestiges – si j’ose dire – de la guerre froide, c'est-à-dire d’un autre temps ! Elles étaient destinées à saturer les champs de bataille, notamment contre les regroupements de forces blindées. Représentez-vous leur portée : chaque munition devait couvrir l’équivalent d’un terrain de football, plusieurs dizaines d’explosifs étant placés à l’intérieur d’un même conteneur.
Nous avons changé d’époque. Aujourd’hui, vingt ans après la chute du mur de Berlin, que nous allons célébrer dans quelques semaines, la guerre a, on le sait, changé de nature. Les conflits prennent de nouvelles formes, qui relèvent le plus souvent bien davantage du terrorisme ou de la guérilla que de la guerre, comme nous l’avons encore vu, hélas ! aujourd’hui. Ces guerres asymétriques rendent caduc l’intérêt militaire du type d’armes dont nous parlons.
Ces armes restent pourtant tapies sur le terrain, dans de nombreux pays qui ont été ou sont encore le théâtre d’affrontements. Plus grave encore, elles demeurent dans les arsenaux de plus d’une trentaine de nations, qui détiennent 90 % du stock d’armes à sous-munitions. Parmi ces pays figurent, hélas ! les principales puissances militaires, qui persistent dans leur refus de les détruire.
Voilà plus de trente ans que l’ONU s’est lancée dans la bataille pour l’éradication de ces armes, au nom des principes fondamentaux de l’humanité, pour protéger les populations civiles dans les conflits armés. Dès le 10 octobre 1980 fut signée une première convention, dite CCAC, en vue d’interdire certaines armes classiques, notamment celles qui ont des effets traumatiques excessifs ou qui frappent sans discrimination. Le protocole V de cette convention, entré en vigueur vingt-six ans plus tard, en 2006, visait à éliminer les munitions non explosées, qui constituent l’une des caractéristiques principales des armes à sous-munitions.
C’est à la suite de l’entrée en vigueur de ce protocole, en novembre 2006, qu’un petit nombre de pays, que je veux saluer et nommer – la Norvège, l’Irlande, l’Autriche, le Saint-Siège, rejoints par la Nouvelle-Zélande, le Mexique et le Pérou –, se sont donné pour objectif d’aller plus loin en lançant un mouvement visant à l’interdiction définitive des armes à sous-munitions. Une quarantaine de pays, dont la France, les ont rapidement ralliés, pour aboutir d’abord à une déclaration, en février 2008 à Wellington, puis à une convention, en mai 2008 à Dublin.
Voilà comment ce petit groupe d’États pionniers, porté par l’élan d’une opinion publique mondiale choquée par les souffrances des civils dans les conflits récents, a, en moins de deux ans, réussi le tour de force de faire adopter cette convention par quatre-vingt-dix-huit pays. La France peut être fière d’avoir pris toute sa part dans cette nouvelle percée du droit international.
Mesdames, messieurs les sénateurs, quelle satisfaction que de constater que le droit international humanitaire et le désarmement, lorsqu’ils sont portés par une véritable volonté politique, peuvent avancer vite et loin pour aboutir à un texte dont la force est reconnue par tous les spécialistes.
Ce texte est fort, d’abord, par son ambition : il s’agit de rien de moins que de consacrer l’interdiction de l’emploi, de la mise au point, de la production, de l’acquisition, du stockage, de la conservation et du transfert des armes à sous-munitions définies comme telles.
Ce texte est fort, ensuite, en ce qu’il impose la destruction des stocks existants – armes et sous-munitions elles-mêmes – dans un délai de huit ans, qui ne peut être prolongé que par accord de la totalité de l’assemblée des États parties, et pour seulement huit années supplémentaires. Cela veut dire que, d’ici à seize ans au plus – espérons, évidemment, que ce sera bien plus tôt –, les quatre-vingt-dix-huit signataires auront normalement détruit leurs stocks.
Ce texte est fort, enfin, parce qu’il fixe une obligation de dépollution et de destruction des restes d’explosifs présents sur les territoires soumis à la juridiction des États parties, de nettoyage des territoires contaminés dans un délai de dix ans et d’aide aux victimes par la fourniture d’une assistance médicale et psychologique destinée à favoriser leur réinsertion.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous me permettrez de dire encore une fois la fierté qui est la mienne devant l’attitude exemplaire de notre pays. La France a pris très tôt des mesures de désarmement unilatéral en matière d’armes à sous-munitions.
Nous avons utilisé ces armes ; ce temps est révolu depuis la guerre du Golfe de 1991. Nous avons fabriqué ces armes ; ce temps est révolu depuis 2002 – six ans avant la signature de la convention de Dublin. Entre 1996 et 2002, la France a en outre retiré de ses stocks tous les systèmes d’armes concernés, notamment les bombes dites « Beluga BLG-66 », les obus à grenade OGR, ainsi que les roquettes américaines M-26.
Tout au long des négociations menant à la conférence de Dublin, dont elle a assuré la vice-présidence, la France a contribué à faire le pont entre la Norvège, à la tête des pays précurseurs, et les grands États possesseurs d’armes à sous-munitions. Elle a joué un rôle, unanimement reconnu, de facilitateur entre pays industrialisés et pays en développement, entre gouvernements et organisations non gouvernementales, et, bien sûr, entre les principales nations européennes, ayant montré la voie à certains de nos grands partenaires, aujourd’hui signataires de la convention.
Il nous reste à inscrire dans notre droit pénal l’interdiction concrète de la fabrication et de l’utilisation des armes à sous-munitions, en conformité avec les obligations fixées dans la convention. Cette tâche, le Gouvernement entend l’accomplir au plus vite, avec votre soutien. La rédaction du projet de loi d’application nationale de la convention d’Oslo est actuellement en cours, sous l’égide des services du ministère de la défense, que je tiens à remercier.
Mesdames, messieurs les sénateurs, si l’élan est donné, la tâche reste donc immense. La convention est certes signée par quatre-vingt-dix-huit États, mais une quarantaine de puissances militaires, et non des moindres, manquent à l’appel : les deux anciennes superpuissances de la guerre froide, les principaux pays émergents et, bien entendu, la plupart des pays proliférateurs. L’effort de ratification et d’universalisation de la convention d’Oslo devra donc se poursuivre pendant de longues années.
Parallèlement, les négociations doivent continuer à Genève dans le cadre de la convention de 1980. Nous voulons y obtenir un accord aussi large que possible, compatible avec la convention d’Oslo et englobant cette fois les États-Unis, la Russie, l’Inde et la Chine, notamment.
La France ne saurait accepter un accord qui ne marquerait pas de véritables progrès humanitaires sur le terrain. Elle mettra donc tout en œuvre pour parvenir à de réelles avancées dans ces deux processus complémentaires, qui finiront – il faut y travailler ! – par se rejoindre.
Tels sont, monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les éléments que je tenais à porter à votre connaissance. Votre vote d’aujourd’hui protégera des enfants qui, demain, au Liban, en Irak, en Afghanistan ou au Tchad, pourront jouer sans craindre de voir leur jambe, leur main ou leur vie emportées pour avoir ramassé ce qu’ils auraient pris pour une bouteille colorée ou un jouet. La ratification de cette convention mérite, je le crois, votre soutien unanime.
Applaudissements

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les armes à sous-munitions ont provoqué, dans tous les pays où elles ont été utilisées, des dommages humanitaires considérables, disproportionnés au regard de leur justification militaire.
En raison notamment de leur manque de fiabilité, elles ont laissé dans les zones de conflits des millions de sous-munitions non explosées qui constituent, pour les populations civiles, des années encore après la fin des hostilités, une source permanente d’accidents graves et souvent mortels, avec malheureusement une forte proportion d’enfants parmi les victimes.
En dépit de la mobilisation croissante de l’opinion publique et de nombreux États, les armes à sous-munitions ont fait de nouvelles victimes au cours de ces dernières années, que ce soit en Irak, en 2003, au Liban – plus de 3 millions de sous-munitions en août 2006 ! – ou en Géorgie, en août 2008. L’adoption d’une convention sur les armes à sous-munitions constitue donc une étape extrêmement importante pour le renforcement du droit international humanitaire.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat était particulièrement sensibilisée à ce sujet, puisque, voilà trois ans déjà, elle avait chargé Jean-Pierre Plancade et moi-même de présenter le premier rapport d’information parlementaire, qui reste d’ailleurs le seul à ce jour, consacré aux armes à sous-munitions et au lourd bilan humanitaire de leur utilisation.
Permettez-moi d’ajouter que l’aboutissement de cette convention représente également pour moi une immense satisfaction personnelle, ayant été témoin des conséquences dramatiques de l’emploi de ces armes ignobles et des différentes étapes qui, depuis la conférence initiale d’Oslo, en février 2007, ont conduit à son adoption par près d’une centaine d’États, le 3 décembre 2008, dans cette même capitale.
L’élaboration d’un instrument international spécifique sur les armes à sous-munitions apparaissait indispensable. Depuis plusieurs années, et en dépit des efforts de pays comme la France, les enceintes internationales traditionnelles chargées du désarmement demeuraient paralysées, sur cette question, par de fortes divergences entre États.
Le mérite du processus d’Oslo aura été de dépasser ces blocages et de déboucher, dans des délais particulièrement rapides, sur un texte qui, même s’il n’est, hélas ! toujours pas signé par un certain nombre d’États, constitue déjà une norme de référence et a suscité une dynamique internationale extrêmement positive.
Les organisations humanitaires internationales ont joué, il faut le souligner et leur rendre hommage, un rôle moteur dans le lancement de ce processus et son aboutissement. Je souhaite saluer, en particulier, les efforts de ICBL et de Handicap international, dont certains responsables se trouvent aujourd’hui dans nos tribunes.
Je ne détaillerai pas les différents points de la convention, qui sont explicités dans le rapport que j’ai soumis avant-hier à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Je voudrais simplement souligner quelques-uns de ses aspects les plus significatifs.
Premièrement, les États signataires se sont accordés sur une définition commune des armes à sous-munitions devant être prohibées. Ce n’était pas chose facile, étant donné la grande variété de ce type d’armements. Je crois que cette définition permet de couvrir toutes les armes qui font courir un grave danger aux populations civiles, notamment après les conflits. Les exceptions demeurent extrêmement limitées et obéissent à des caractéristiques précises et très exigeantes.
Deuxièmement, la convention impose une interdiction immédiate, sans restriction ou possibilité de période transitoire, de la production, de la détention, des transferts et de l’emploi de ces armes.
Troisièmement, l’obligation de destruction dans le délai de huit ans prémunit contre les risques qui résulteraient du maintien de stocks importants et garantit que ces armes ne pourront pas alimenter des circuits parallèles.
Enfin, la convention insiste sur la responsabilité à l’égard des victimes et des zones polluées par des sous-munitions non explosées. Elle pose le principe de l’assistance internationale aux pays touchés, dont nous savons qu’ils ont rarement les moyens de faire face aux lourds problèmes économiques et sociaux engendrés par ces armes.
La France a été un acteur très important de la conclusion de la convention d’Oslo. Nous avions dressé dans notre rapport d’information, en décembre 2006, un état des lieux précis de la politique française en matière d’armes à sous-munitions, qu’il s’agisse de la production, de l’acquisition, de l’emploi de ces armes par nos armées ou de leur exportation vers des pays étrangers. Il en ressortait, pour le passé, un constat de très grande retenue de notre pays dans ces différents domaines, comme vous l’avez souligné, monsieur le ministre, et, pour le futur, la perspective d’un rôle plus réduit encore de ces armements dans notre appareil de défense, puisqu’aucun de ce type n’était en production ou en projet.
En ratifiant la convention d’Oslo, la France devra renoncer à deux armements : le lance-roquette multiple, dont notre rapport avait préconisé le retrait et dont le remplacement est prévu par la loi de programmation militaire, et l’obus d’artillerie OGR. Le missile de croisière Apache et l’obus Bonus sont, en revanche, conformes à la convention.
Je crois qu’il faut souligner l’effort important que représente la mise en œuvre de la convention, puisque le coût des opérations de destruction est évalué entre 30 millions et 60 millions d’euros.
Je voudrais, à cet instant, rendre hommage au rôle de la France, de son Président, qui avait pris position sur ce sujet avant même son élection, de son Gouvernement. Je salue plus particulièrement, monsieur le ministre, votre implication personnelle, votre volontarisme et votre détermination sans faille dans l’élaboration de cette convention. Ce fut un plaisir et un honneur d’être à vos côtés lors de la signature de cette convention à Oslo, en décembre dernier.
La France est traditionnellement très attachée au respect du droit international humanitaire. Toutefois, dans cette négociation, sa crédibilité tenait également à son statut de pays militairement significatif, tenu à des responsabilités internationales particulières et engagé sur de nombreux théâtres d’opérations extérieurs. Comme l’a souligné le Gouvernement, notre pays a ainsi pu jouer un rôle utile de liaison entre les préoccupations diverses qui animaient les participants au processus d’Oslo et favoriser un large consensus autour d’un texte équilibré. Il a démontré que l’on pouvait concilier les obligations de défense et les exigences humanitaires.
Comme je l’indiquais en introduction, la convention sur les armes à sous-munitions représentera une avancée majeure pour le droit international humanitaire. Néanmoins, la tâche restant à accomplir est considérable.
Tout d’abord, cela a été souligné, une quarantaine de pays militairement importants n’ont pas signé cette convention. C’est le cas des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de l’Inde, du Pakistan, de la Turquie, de plusieurs pays d’Asie, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Hélas, huit pays de l’Union européenne restent également, pour l’instant, hors de la convention.
Il ne faudra ménager aucun effort pour convaincre ces pays de se rallier au nouvel instrument international. Je sais, monsieur le ministre, que notre diplomatie s’y emploiera. Je pense qu’à travers nos contacts avec nos homologues étrangers, par exemple dans des enceintes telles que l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, nous pouvons également, en tant que parlementaires, agir dans le même sens.
Je suis néanmoins convaincue que, comme la convention d’Ottawa pour les mines antipersonnel, la convention d’Oslo constituera une norme humanitaire de référence, et que nombre d’États non signataires seront de ce fait dissuadés de recourir aux armes à sous-munitions.
Le second grand défi concerne l’assistance aux pays affectés et aux victimes. Du fait de la lenteur et du coût des opérations de dépollution, des menaces continuent de planer sur les populations civiles dans de nombreuses zones où des armes à sous-munitions ont été employées dans le passé. Le traitement et la réinsertion des victimes blessées ou handicapées représentent également une lourde charge. La mobilisation internationale ne peut se limiter à la condamnation des armes utilisées, elle doit aussi s’exercer en faveur de l’assistance et de la coopération.
Enfin, plus largement, les dégâts provoqués par les armes à sous-munitions ne doivent pas faire oublier toutes les autres circonstances dans lesquelles, malheureusement, les populations civiles sont aujourd’hui touchées par les conflits armés, menés par des forces régulières ou de guérilla. Il y a là aussi matière à rechercher, à l’échelon international, de nouveaux instruments de protection des populations civiles.
En conclusion, je voudrais me féliciter de la priorité donnée par notre pays à la ratification rapide de la convention d’Oslo. Déposé au mois de juin, ce projet de loi a pu être adopté par l’Assemblée nationale le 20 juillet, et figure à l’ordre du jour du Sénat dès le début de la session extraordinaire du Parlement. Si, comme je le souhaite ardemment, nous approuvons ce projet de loi aujourd’hui, cela permettra à la France de déposer d’ici à la fin du mois de septembre son instrument de ratification auprès du secrétaire général des Nations unies, à New York, et de contribuer ainsi à l’entrée en vigueur rapide d’une convention internationale qui marquera un très grand progrès pour la protection des populations civiles dans les conflits armés.
Mes chers collègues, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a donné son approbation unanime à la convention sur les armes à sous-munitions. Elle vous demande, par mon intermédiaire, d’adopter ce projet de loi.
Applaudissements

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, je salue le choix du Gouvernement de soumettre au Parlement ce projet de loi de ratification moins de dix mois après la signature de la convention sur les armes à sous-munitions à Oslo, le 3 décembre 2008, qui marque une étape majeure dans la lutte contre la production et l’utilisation des armes conventionnelles et pour la protection des populations civiles.
Le tribut humain des armes à sous-munitions a été jugé, à juste titre, bien trop lourd au regard du droit international ; l’utilisation massive de ce type d’armes au Liban au cours de l’été 2006 a suscité une véritable prise de conscience. Leur emploi dans des zones habitées, conjugué à leur fort effet de dispersion, entraîne un pourcentage très élevé de victimes civiles – femmes et enfants notamment. Il fait subir aux populations civiles un risque humanitaire majeur sur le long terme, en raison du taux de dysfonctionnement important de ces armes, qui restent sur le terrain où elles ont atterri sans avoir explosé et constituent, parfois des années après la fin des conflits, une menace quotidienne intolérable.
Il devenait donc urgent d’élaborer un outil juridique international contraignant. Les textes existants – la convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques du 10 octobre 1980 et son protocole V – se sont révélés insuffisants, car ils ne prévoient aucune interdiction de production ou d’utilisation des armes à sous-munitions. Une telle interdiction globale, visant à l’élimination définitive de ce type d’armes, est dès lors apparue comme une étape indispensable à franchir.
La convention d’Ottawa sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction constitue, de ce point de vue, un modèle d’instrument juridique international contraignant. Je veux d’ailleurs saluer, à cette tribune, le choix de Lionel Jospin, lors de son arrivée aux responsabilités, en 1997, d’inscrire notre pays dans cette dynamique internationale pour le désarmement, que la reprise des essais nucléaires en 1994 et en 1995 avait stoppée. En œuvrant pour la signature de la convention d’Ottawa et en faisant procéder à sa ratification le 8 juillet 1998, le gouvernement de la France avait relancé le processus de désarmement pour ces types d’armes. La convention d’Oslo poursuit cette œuvre.
Je ne reviendrai pas sur les différentes étapes ayant permis l’élaboration de la convention qui fait aujourd’hui l’objet de notre débat ; Mme le rapporteur en a retracé les grandes lignes. Je ne reviendrai pas davantage sur les avancées importantes qu’elle permet et qui ont été développées tant par M. le ministre que par Mme le rapporteur, sinon pour préciser que notre groupe, fidèle à ses engagements en matière de désarmement, y souscrit sans réserve et votera, bien entendu, ce projet de loi de ratification.
Je souhaite maintenant formuler deux regrets, puis évoquer les étapes à venir.
Mon premier regret tient à l’introduction dans la convention du principe d’interopérabilité, qui autorise les États parties à participer à des actions militaires conjointes avec des États qui utiliseraient des bombes à sous-munitions. Si son introduction est compréhensible du point de vue du réalisme politique et diplomatique – nombre de pays, dont les États-Unis, la Chine et la Russie, n’ayant pas signé cette convention –, cette disposition réduit de façon importante la portée juridique et pratique du texte.
Dès lors, monsieur le ministre, quelle lecture la France fera-t-elle de cette disposition ? Pouvez-vous assurer à la représentation nationale que, à défaut de s’interdire de s’engager dans une coopération et dans des opérations militaires avec des États non parties à la convention – en Afghanistan, par exemple, aux côtés des États-Unis –, la France n’acceptera pas de prendre part à des opérations militaires au cours desquelles seraient employées des armes à sous-munitions ? Interrogé sur cette même question lors de l’examen du projet de loi de ratification par l’Assemblée nationale, le secrétaire d’État chargé des affaires européennes, M. Pierre Lellouche, n’a pas apporté les garanties attendues, se bornant à affirmer que la France, dans l’hypothèse d’opérations conjointes avec des pays non signataires de la convention, les encouragerait à ratifier au plus vite celle-ci. Si l’on doit comprendre que la France n’exclut pas de s’engager dans des opérations militaires au cours desquelles seraient employées des armes à sous-munitions, je ne suis pas certaine que cette prise de distance avec l’esprit de la convention sera de nature à inciter les États non signataires à devenir parties à celle-ci. J’espère, monsieur le ministre, que vous saurez lever cette ambiguïté.
Mon second regret est que la convention ne fixe pas de seuil quantitatif pour le stock d’armes à sous-munitions pouvant être conservé ou acquis par les États aux fins légitimes de formation aux techniques de détection, d’enlèvement ou de destruction de ces armes. La convention se borne à indiquer que ce nombre doit être « limité ». À défaut d’un tel seuil, pouvez-vous, monsieur le ministre, donner à la représentation nationale des éléments chiffrés sur le stock que la France entend conserver ou acquérir ? Lors de la conférence de Dublin, notre pays avait annoncé qu’il conserverait 50 000 armes de ce type, au titre de l’article 3, alinéa 6, de la convention. Certaines organisations non gouvernementales jugent ce stock excessif. Que pouvez-vous leur rétorquer ?
Les réserves que je formule, vous l’aurez compris, mes chers collègues, visent non pas à minorer la portée d’un texte qui constitue un pas important vers l’objectif du désarmement, partagé sur toutes les travées de cet hémicycle, mais bien au contraire à garantir le respect de son esprit, pour lui assurer une réelle efficacité.
Pour l’avenir, nous devons mesurer le chemin qui reste à parcourir.
Le premier défi à relever est, bien entendu, celui de l’élargissement du champ des signataires de la convention. Rendre ce texte universel est l’objectif prioritaire. Très tôt, du fait de l’opposition de nombreux États à une interdiction globale de production et d’utilisation des armes à sous-munitions, il est apparu qu’il serait particulièrement difficile à atteindre. Je salue l’engagement personnel de notre rapporteur, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, sur ce point. Je suis certaine qu’elle sera persévérante !
Un groupe d’États a manifesté sa volonté de contourner ces oppositions qui bloquaient les discussions entamées sous l’égide de l’ONU, et a engagé une démarche propre pour l’interdiction des armes à sous-munitions. Cette action, lancée au mois de février 2007 à Oslo, sur l’initiative de la Norvège, s’est progressivement étoffée. Lors de la conférence de Dublin, elle rassemblait 111 États, parmi lesquels la France. Cela a permis d’élaborer le texte aujourd’hui soumis à ratification.
Il s’agit d’une avancée incontestable, car la convention d’Oslo constitue aujourd’hui l’instrument international de référence dans ce domaine. Cependant, sa portée se trouve limitée par le nombre important d’États non signataires. De ce point de vue, on constate une situation de blocage, qui ne doit pas perdurer.
Dans cette perspective, deux voies complémentaires doivent être explorées.
La première est, indiscutablement, celle qui est tracée par l’Union européenne.
Dans le cadre de son programme de développement, la Commission européenne a élaboré une stratégie européenne contre les mines antipersonnel pour la période 2008-2013. Cette stratégie se décline selon différentes priorités : assistance aux pays en voie de développement pour la mise en œuvre de la convention d’Ottawa, opérations de déminage sur le terrain – notamment au Cambodge, en Afghanistan, au Liban –, programme de développement pour répondre aux problèmes économiques et sociaux posés par les mines dans ces pays. L’aide combinée des États membres et de la Commission européenne dans ce domaine fait de l’Union le premier dispensateur au monde d’aide contre les mines antipersonnel.
Cette politique montre combien la coopération européenne en matière de désarmement est possible et utile. On peut dès lors regretter qu’une telle coopération n’existe pas dans le domaine qui nous occupe aujourd’hui, et que ni le Conseil ni la Commission n’aient à ce jour élaboré une stratégie commune. En outre, nombre d’États membres doivent encore ratifier la convention d’Oslo.
La seconde voie est celle de la poursuite des discussions, sous l’égide des Nations unies, au sein de la conférence d’examen de la convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques, dite CCAC.
Il n’y a pas lieu, me semble-t-il, d’opposer la convention de 1980 et la convention d’Oslo. Il convient plutôt de rechercher une complémentarité et un approfondissement de ces instruments.
C’est dans cet esprit que s’est tenue, au mois d’août, au sein de la conférence d’examen de la CCAC, une réunion d’experts d’États parties à la convention d’Oslo et de pays non signataires. À Carthagène se tiendra, au mois de novembre prochain, une conférence de suivi et de révision de la convention d’Ottawa sur les mines antipersonnel. Comment la France entend-elle se saisir de cette occasion pour relancer la dynamique de la convention d’Oslo sur les armes à sous-munitions, dont les problématiques et les enjeux sont analogues ?
Le second défi majeur est celui de la mise en œuvre de la convention par la France.
J’évoquais voilà quelques instants la question du stock des armes à sous-munitions, dont la convention prescrit la destruction dans un délai de huit ans, renouvelable une fois, avec la réserve précédemment évoquée. L’étude d’impact jointe au projet de loi évalue le coût de cette destruction entre 30 millions et 60 millions d’euros et précise que le ministère de la défense financera le démantèlement de ces munitions sur son budget. Au regard du coût annoncé, quelles assurances pouvez-nous nous donner quant au respect du délai imparti ? En outre, il a été souligné que la France ne dispose pas des capacités industrielles nécessaires pour opérer ce démantèlement. Le recours à nos partenaires européens, dans le cadre des actions communes européennes que j’évoquais à l’instant, est-il la solution de rechange privilégiée par le Gouvernement ?
Conformément aux obligations fixées par la convention, il apparaît essentiel, monsieur le ministre, que le Gouvernement s’engage également à présenter rapidement un projet de loi visant à inscrire l’interdiction de la production et de l’utilisation des armes à sous-munitions en droit pénal. La France doit être exemplaire en la matière afin de donner toute sa force à la convention.
Enfin, monsieur le ministre, à quelle hauteur la France entend-elle prendre part à la dépollution des restes d’armes à sous-munitions évoquée à l’article 6 de la convention ? Je pense, par exemple, à la situation du Cambodge, pays que je connais depuis de nombreuses années et dont la population vit quotidiennement des drames liés à la présence de mines antipersonnel et d’armes à sous-munitions, la moitié des victimes, tuées ou mutilées, étant des enfants. Le nombre d’armes à sous-munitions n’ayant pas explosé à l’impact y est évalué entre 2 millions et 6 millions. La France a déjà apporté son concours pour des opérations de dépollution et d’assistance aux populations civiles. Nous en sommes fiers.
Monsieur le ministre, les parlementaires resteront vigilants sur les conditions de mise en œuvre effective de la convention. Les membres de mon groupe voteront ce projet de loi de ratification.
Applaudissements

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, la convention sur l’interdiction des armes à sous-munitions que le Sénat est invité à ratifier aujourd’hui est à la fois très importante, historique et exemplaire à bien des égards.
Monsieur le président de la commission des affaires étrangères, j’apprécie tout particulièrement que, pour souligner l’importance de cette convention, nous débattions solennellement en séance publique de son projet de loi de ratification et qu’il n’ait pas été recouru, comme c’est fréquemment le cas, hélas, au motif de la trop grande complexité technique et juridique de ce type de textes, à la procédure d’adoption simplifiée.
Importante et historique, cette convention l’est car elle marque une avancée décisive sur la voie du désarmement et dans le domaine du droit humanitaire international. Il s’agit du premier texte international interdisant formellement ce type d’armes.
Exemplaire, cette convention l’est aussi car elle illustre le rôle déterminant que peuvent jouer certaines ONG, comme la Croix Rouge et Handicap international, pour sensibiliser les opinions publiques et influencer les gouvernements et les institutions internationales. Alors que, dans cet hémicycle, certains de nos collègues éprouvent parfois des réticences, qui leur semblent légitimes, quant au rôle des ONG, voici un exemple probant de l’utilité de ces dernières.
Dans ce cas d’espèce, la conjonction entre la volonté politique de certains États, dont la France, et le volontarisme tenace des ONG et de la société civile a permis d’aboutir à un texte d’une grande portée.
Du strict point de vue humain, qui devrait d’ailleurs guider toute action politique, économique et sociale, il devenait urgent et nécessaire qu’un nombre significatif d’États montrent l’exemple en s’engageant à interdire la fabrication et l’utilisation de ce type d’armes. Quatre-vingt-dix-huit États l’ont fait à ce jour, mais beaucoup manquent encore à l’appel, et non des moindres : les États-Unis, la Russie, la Chine, mais aussi le Brésil, l’Inde, le Pakistan, Israël, la Turquie et nombre de ces pays qu’il est convenu d’appeler « émergents ». C’est dire tout le chemin qu’il nous reste à parcourir.
Cela étant, il faut bien mesurer que ce texte est l’aboutissement, certes inachevé, d’un long processus. Dès les années 2000, les ONG, les opinions publiques mais aussi les États furent de plus en plus nombreux à prendre conscience que ce type d’armes contrevenaient au droit international humanitaire, lequel se fonde principalement sur la distinction entre les populations civiles et les combattants.
En effet, alors que ces armes avaient été initialement conçues pour détruire des regroupements de blindés ou « saturer » des pistes d’atterrissage, elles furent peu à peu détournées de leur vocation et de plus en plus souvent utilisées contre des zones habitées suspectées d’abriter des combattants. À cet égard, tout le monde a évidemment en mémoire la guerre israélo-libanaise de 2006.
Ajoutons que 30 % environ des munitions n’explosant pas à l’impact, celles-ci deviennent des « résidus explosifs de guerre » qui, plusieurs mois et même plusieurs années après l’arrêt des combats, sont à l’origine d’accidents graves, voire mortels, touchant en premier lieu les enfants.
Les civils sont donc les premières victimes de ces armes. Plus largement, les conflits actuels tendent à frapper plus lourdement les civils que les combattants. Les guerres d’Irak et d’Afghanistan, ainsi que, tout récemment, un rapport de l’ONU sur l’intervention israélienne dans la bande de Gaza, nous montrent que les guerres « propres » et les frappes « chirurgicales » n’existent pas. Ce que l’on appelle les « dommages collatéraux », ce sont les civils qui en font les frais !
Dans les années 2000, les bombes à sous-munitions n’étaient interdites par aucun instrument juridique contraignant, car elles n’entraient pas dans le champ d’application de la convention d’Ottawa de 1997 sur les mines antipersonnel. Elles faisaient l’objet d’un débat récurrent entre les représentants des États et ceux des ONG, pour lesquelles une mine devait être définie en fonction de ses effets, et non pas uniquement de sa conception.
Bien qu’il ait cessé d’utiliser des armes à sous-munitions depuis 1991 et qu’il n’en produise plus depuis 2002, notre pays s’est longtemps accommodé d’un statu quo international sur cette question. Il considérait, en effet, que les armes autres que les mines antipersonnel faisaient l’objet de négociations spécifiques dans le cadre de la convention de Genève sur certaines armes classiques et que cette dernière couvrait le large éventail des munitions non explosées et abandonnées.
Pour sortir de cet imbroglio juridique et diplomatique, et parce que ses membres étaient frappés par le drame de la guerre du Liban et n’acceptaient plus la lenteur des discussions, un petit groupe d’États, aiguillonné par des ONG, décida en 2006 de lancer une initiative parallèle. Baptisé « processus d’Oslo », ce cycle de négociations a abouti au texte que nous examinons aujourd’hui.
Je me félicite donc de ce que le Gouvernement ait changé d’attitude, et choisi de jouer peu à peu un rôle dynamique dans le processus d’Oslo. Je me réjouis, en particulier, qu’il ait montré concrètement l’exemple en annonçant, l’année dernière, le retrait de 90 % de nos stocks de bombes à sous-munitions.
Comme je l’ai indiqué d’emblée, la convention d’Oslo représente une avancée considérable du droit humanitaire international. Elle vise l’interdiction totale de la production, du stockage, du transfert, de la conservation et de l’utilisation de ces armes, mais elle a aussi pour objectif de renforcer la coopération internationale en vue d’aider les victimes civiles, en imposant aux États parties une obligation de nettoyage des zones polluées par les munitions non explosées. Enfin, elle prévoit également une obligation d’assistance aux victimes en matière de santé et de réinsertion sociale.
Toutefois, il faut être réaliste, et apprécier ce texte à sa juste valeur. Il reste en effet beaucoup à faire, puisque seulement 40 % des États producteurs et 20 % des pays utilisateurs ont adhéré à la convention d’Oslo.
Notre diplomatie – les parlementaires du groupe auquel j’appartiens la soutiendront de façon exigeante – devrait désormais œuvrer plus activement à prendre des initiatives fortes pour faire progresser les discussions, afin que l’ensemble de la communauté internationale puisse signer un tel texte.
Comme nous y invite l’ONG Handicap international, nous devrons également être vigilants sur la mise en œuvre des obligations d’assistance aux victimes incluses dans le traité d’Oslo, car l’expérience nous a montré que les engagements internationaux d’assistance précédemment pris en matière de mines antipersonnel étaient, il faut bien le dire, très peu respectés.
Enfin, je souhaite que le Gouvernement nous soumette rapidement un projet de loi visant à transposer dans notre droit pénal les dispositions de cette convention. À cet égard, monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner des précisions sur un éventuel calendrier ? Ce texte devrait, notamment, comprendre l’extension du champ de compétence de la commission pour l’élimination des mines antipersonnel aux armes à sous-munitions, ainsi que le groupe CRC-SPG l’avait demandé dès 2006, au travers d’une proposition de loi.
Pour notre groupe, et plus largement pour les communistes, la lutte pour le désarmement et le respect du droit humanitaire international est un combat de longue date, qui est constitutif de notre identité et de notre idéal d’émancipation humaine.
Le groupe CRC-SPG votera donc avec enthousiasme ce texte, car la convention sur les armes à sous-munitions constitue bien une avancée considérable – historique, n’ayons pas peur du mot !
Applaudissements

« Il est rare que se présente l’occasion de prévenir d’indicibles souffrances humaines. »
C’est ainsi que Jakob Kellenberger, le président du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, s’exprimait en février 2008, en exergue d’une année capitale pour le combat international contre les armes à sous-munitions, qui s’est conclue en décembre dernier par la signature de la convention d’Oslo, dont les conséquences humanitaires seront considérables.
Ce texte marque de manière emblématique une étape importante dans la lutte contre les atteintes à la dignité humaine. Il s’agit de la protection des populations civiles, devenues les principales victimes, pendant et surtout après les conflits.
Par le biais des médias, nous devenons les témoins impuissants et révoltés des dégâts qu’infligent aux populations civiles des moyens militaires dont nous ne pouvons maîtriser tous les effets. N’est-ce pas un paradoxe absurde et insupportable que les terrains où sont disséminées des sous-munitions soient souvent des zones de sécurité pour les militaires, tandis que les populations civiles y courent des dangers mortels ? Qui n’a souhaité la mise en place de nouvelles règles internationales au vu des opérations militaires menées dans la bande de Gaza en janvier dernier ? Il s’agit non pas de prendre une position politique en faveur d’un camp ou d’un autre, mais de protéger les civils, qui sont toujours les victimes les plus nombreuses de ces conflits.
La convention que l’on nous propose de ratifier interdit à ses signataires de fabriquer, de vendre et d’utiliser des armes à sous-munitions, qui ont la particularité de semer la mort et de causer des blessures terribles aux populations non combattantes, et ce pendant des dizaines d’années en raison de leur pérennité. Au Laos, par exemple, quarante ans après la guerre, ces armes font encore des victimes !
La très grande majorité d’entre nous, sinon le Sénat unanime, luttent depuis de nombreuses années contre l’utilisation des mines antipersonnel et des armes à sous-munitions et soutiennent des ONG telles que la Croix Rouge ou Handicap international dans leur combat contre l’une des dimensions les plus horribles, les plus cruelles et les plus injustes de la guerre.
À la fin des années quatre-vingt, ces armes avaient été mises au point afin de rendre plus efficace la lutte contre les unités blindées. Hormis quelques spécialistes, peu d’entre nous avaient imaginé le désastre humanitaire qu’elles provoqueraient. Il faut rappeler que les caractéristiques des armes à sous-munitions les rendent extrêmement dangereuses pour les civils, quel que soit leur mode de dispersion, et cela pour deux raisons essentielles : d’une part, du fait de l’importance de leur rayon d’action, qui couvre jusqu’à plus de 30 000 mètres carrés pour certains modèles ; d’autre part, en raison du risque d’explosion permanent, bien après leur dispersion.
Au cours de la guerre israélo-libanaise de l’été 2006 – je devrais plutôt parler d’invasion israélienne –, ces armes ont été massivement employées par l’armée d’Israël, provoquant des dommages dramatiques parmi les populations civiles. Les hommes, les femmes et surtout les enfants sont, encore aujourd’hui, victimes de sous-munitions non explosées et disséminées sur leurs lieux de vie.
Marqué par ce drame humanitaire, un petit groupe d’États, dont la France, a lancé un vaste débat international en vue de l’interdiction totale de ces matériels. Lors de la conférence diplomatique de Dublin de mai 2008, ce cycle de négociations a permis d’aboutir à un texte qui a recueilli, comme vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, l’approbation de plus de quatre-vingt-dix pays et dont la signature officielle a eu lieu le 4 décembre dernier à Oslo.
À la même époque, notre pays retirait plus de 80 % de ses stocks d’armes à sous-munitions, ce dont nous pouvons nous féliciter.
Néanmoins, même si cette convention représente une avancée décisive dans les domaines du désarmement, de la dépollution, de la neutralisation de ces armes et de la prise en charge des populations civiles victimes de ce fléau, il n’en demeure pas moins que son efficacité risque d’être fort limitée.
En effet, des pays producteurs et utilisateurs d’armes à sous-munitions n’ont pas voulu participer au processus engagé. Comme cela a été dit, il s’agit notamment des États-Unis, de la Russie, d’Israël et de la Serbie, qui, soulignons-le, avaient déjà refusé de ratifier le traité d’Ottawa de 1997 concernant les mines antipersonnel. Aujourd’hui, cela a également été dit, seuls 40 % des États producteurs et 20 % des États utilisateurs ont adhéré à la convention ! Soulignons aussi que des États comme l’Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, la Géorgie ou le Soudan ont refusé d’y adhérer. Or ces pays sont des zones d’affrontements armés actuels ou potentiels !
Dès lors, il serait irréaliste d’affirmer que la convention d’Oslo deviendra rapidement une source du droit international, s’imposant ainsi à tous, y compris aux États non parties à la convention. Il faudra du temps pour qu’elle s’applique à ces derniers comme une coutume internationale ayant acquis force de droit par sa pratique étendue, représentative et uniforme. Il convient donc de rester vigilant, car le combat pour l’éradication de ces armes est loin d’être achevé.
Gardons toujours à l’esprit le principe formulé par la commission militaire internationale de Saint-Pétersbourg il y a déjà cent quarante ans, selon lequel « pour certaines armes, les nécessités de la guerre doivent s’arrêter devant les exigences de l’humanité ».
La France s’honorera en promouvant et en ratifiant cette convention.
Applaudissements

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous occupe cet après-midi est un texte – mes prédécesseurs à la tribune l’ont déjà dit – dont les conséquences sur la scène internationale sont majeures, tout d’abord, pour les populations civiles, victimes de ce type d’armes alors qu’elles connaissent ou ont connu la guerre, ensuite, pour notre pays et son engagement sur la scène internationale en faveur du désarmement et du respect du droit humanitaire.
Avant tout, je voudrais rendre hommage au travail de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Je tiens à remercier notre collègue Joëlle Garriaud-Maylam de son excellent rapport. Elle s’était déjà saisie de ce grave sujet depuis 2006, avec Jean-Pierre Plancade.
À ce titre, permettez-moi de me réjouir du chemin parcouru entre la remise d’un rapport d’information parlementaire et le projet de loi qui nous est soumis aujourd’hui. Je me réjouis également du fait que ce texte puisse être adopté – à l’unanimité, je l’espère –, moins d’un an après la signature du document initial par la France, à Oslo, le 3 décembre 2008.
Les armes à sous-munitions, initialement conçues pour détruire des concentrations de véhicules blindés, peuvent atteindre des cibles sur des surfaces étendues en utilisant moins de munitions que les explosifs classiques. Composées d’une munition dite « mère », ces bombes, qui sont des obus ou des roquettes, dispersent plusieurs munitions destinées à exploser à l’impact. Ce système d’armes a été largement utilisé et le demeure malheureusement encore dans de nombreux conflits dans le monde depuis la guerre du Vietnam.
La caractéristique même de ces armes étant leur large spectre de dissémination et leur utilisation n’étant pas limitée aux seules cibles militaires, elles sont à l’origine de drames humanitaires pendant les conflits. Cependant, c’est surtout leur taux de dysfonctionnement, bien trop élevé, plus élevé que celui des autres types d’armes, qui est en cause.
Les nombreuses sous-munitions demeurant au sol sans avoir explosé provoquent les mêmes dommages que les mines antipersonnel, qui continuent de mutiler les populations des années après la fin des conflits. Les bombes à sous-munitions entraînent des conséquences traumatiques excessives par rapport aux objectifs militaires fixés et sont donc aujourd’hui obsolètes. Il faut avoir le courage de le dire !
Par une multitude de rapports, l’UNICEF, Handicap International ou encore la Croix-Rouge n’ont eu de cesse d’alerter la communauté internationale sur les ravages, à long terme, des « restes explosifs » de ce système d’armes sur les populations et sur leurs territoires.
Comme vous l’avez tous rappelé à la tribune, mes chers collègues, le long processus diplomatique qui a mené à cette interdiction remonte à l’année 1983. Son origine se situe à l’entrée en vigueur de la convention sur certaines armes classiques, ou CCAC.
Si ce texte constitue une avancée majeure en faveur du désarmement, je tiens, au nom du groupe UMP, à rappeler que la ratification par la France de cette convention est aussi une preuve de cohérence et la concrétisation d’une politique engagée dès 1996, date à laquelle notre pays – M. le ministre l’a rappelé – a amorcé le retrait et la destruction des bombes lance-grenades BLG 66 Belouga de ses arsenaux.
Par ailleurs, mes chers collègues, je vous rappelle que, grâce à la loi de programmation militaire 2009-2014 que nous avons votée en juillet dernier et dont le rapporteur était le président de Rohan, les roquettes M-26, qui équipent les lance-roquettes multiples, seront supprimées et remplacées par des lance-roquettes unitaires. Il en va de même pour les obus à grenades de 155 millimètres.
La France parle et signe, mais elle agit, aussi.
En autorisant la ratification de cette convention, notre pays adresse un message aussi fort que symbolique aux autres puissances militaires. Nous démontrons qu’il est possible d’être une puissance militaire, de mener une réelle politique de défense et d’être en amont des négociations en faveur du désarmement international. C’est pourquoi le groupe UMP du Sénat votera ce projet de loi.
Si la France a joué, avec la Norvège, l’Irlande, l’Autriche et la Nouvelle-Zélande, un rôle moteur, il est capital que nous poursuivions – tout le monde l’a dit et vous êtes, monsieur le ministre, le premier engagé dans ce combat – une action diplomatique ferme, en premier lieu auprès de nos partenaires européens – je pense à la Grèce, à la Pologne et à la Roumanie –, mais aussi auprès de pays tels que la Russie, les États-Unis, le Pakistan, la Chine et d’autres qui continuent de produire, de stocker ou d’utiliser ce type d’armement.
Rappelons-nous que, lors de conflits, notamment lors de conflits asymétriques, l’objectif militaire est non plus de gagner militairement, mais de gagner la paix de sortie de guerre. Cela passe par la coopération en matière de déminage et par une assistance aux victimes de guerre, opérations auxquelles notre pays participe déjà depuis de nombreuses années. Il continuera bien sûr d’y participer en ratifiant cette convention, qui est un exemple pour l’ensemble du monde humanisé.
Je souhaite que nous puissions, les uns et les autres, autoriser cette ratification par un vote unanime. Cet accord général montrera, au-delà de cet hémicycle, au pays tout entier et, au-delà encore, au reste du monde qu’il est possible de rester une puissance majeure tout en se battant pour l’humanitaire.
Bravo ! et applaudissements

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la conclusion de la convention d’Oslo sur les armes à sous-munitions marque une étape importante dans la protection des civils durant les conflits armés.
Les conséquences humanitaires de l’utilisation de ces armes, au moment des frappes mais aussi à long terme, sont – M. le ministre l’a rappelé – sans commune mesure avec leur utilité militaire réelle. Les affrontements qui ont eu lieu au Sud-Liban durant l’été 2006 ou, plus récemment encore, en Géorgie, l’ont illustré de manière particulièrement dramatique.
L’application de la convention d’Oslo va permettre, à la fois, de supprimer les armes à sous-munitions des arsenaux des États parties et d’organiser la coopération pour limiter leurs conséquences à long terme sur les populations civiles. Sa mise en œuvre permettra notamment de fournir les soins médicaux et l’assistance nécessaire pour sécuriser les territoires qui ont été exposés. Cette assistance est capitale pour plus d’une trentaine de pays où des restes explosifs sont encore disséminés, particulièrement le Cambodge, le Laos ou encore l’Angola.
Cette convention est donc une avancée majeure, mais c’est aussi une avancée morale. Ce texte est le premier instrument de droit international contraignant les États parties à renoncer à produire et à utiliser ces systèmes d’armes. Il envoie un signal fort aux nombreux pays qui n’y ont pas encore renoncé.
Comme la convention d’Ottawa de 1997 sur l’interdiction des mines antipersonnel, la convention d’Oslo déplace la ligne de démarcation entre l’acceptable et l’inacceptable. Ce glissement du curseur entre ce que l’on tolérait hier et ce que l’on ne tolère plus aujourd’hui est un changement très important. Bien évidemment, le groupe de l’Union centriste votera unanimement en faveur de la ratification de la convention d’Oslo.
Ce vote nous offre l’occasion de saluer l’impulsion du gouvernement norvégien, à l’origine de cette convention, ainsi que le travail de nombreuses organisations non gouvernementales, Médecins Sans Frontières, Handicap International, Amnesty International et de nombreuses autres organisations de la société civile, qui ont fait un remarquable plaidoyer pour alerter les opinions publiques.
Permettez-moi de remercier également Mme le rapporteur de son engagement et de son travail de grande qualité.
J’aimerais enfin, monsieur le ministre, saluer votre implication personnelle sur ce dossier, dès la conférence de Dublin de mai 2008.
Le rôle actif de la France a été largement reconnu par la communauté internationale, et mérite d’être souligné.
Cette action mérite également d’être poursuivie. L’universalité de l’abolition des armes à sous-munitions est loin d’être acquise pour tout le monde, puisque plusieurs des principales puissances militaires de la planète n’ont pas encore renoncé à les produire et à les utiliser.
En encourageant de nouvelles adhésions à la convention d’Oslo ou en participant à l’élaboration d’un nouveau protocole à la convention sur certaines armes classiques, la France peut, la France doit continuer à jouer un rôle dans l’abolition universelle de ces armes.
Applaudissements
Je voudrais remercier tous ceux qui sont intervenus, tous ceux qui ont travaillé sur ce texte, notamment M. le président de la commission des affaires étrangères et Mme le rapporteur.
Madame Tasca, vous m’avez posé des questions, et je vais vous répondre.
Tous les orateurs ont souligné qu’il était intéressant – c’est le moins que l’on puisse dire – de voter ce texte, mais que tout n’était pas fini. Vous avez complètement raison, mesdames, messieurs les sénateurs !
Ce n’est pas fini en Europe, puisque huit pays européens n’ont pas signé la convention. Ce n’est pas fini dans le reste du monde, parce que les plus grandes puissances militaires de la planète n’ont pas encore signé, et se détournent de ce texte.
Comptez sur nous pour tenir nos engagements. Nous essaierons bien entendu de faire signer cette convention par tous les États. Si, grâce à vous et à votre célérité, nous déposons les instruments de ratification dès la semaine prochaine à l’ONU, une étape supplémentaire sera franchie. Nous ferons alors le siège de nos amis et de tous les pays qui n’ont pas encore signé.
En ce qui concerne l’interopérabilité, nous ne pouvons évidemment pas promettre que nous ne nous défendrions pas aux côtés d’autres forces si nous étions attaqués et si nous devions mener bataille. En revanche, nous ferons tout pour ne pas nous engager aux côtés de pays qui accepteraient de se servir d’armes à sous-munitions et dont les pratiques seraient incompatibles avec cette convention. Je pense de toute façon que cette situation ne se présentera pas. Il appartiendra néanmoins aux forces françaises de s’en assurer.
Nous allons tenter de militer, au sens gouvernemental du terme, pour qu’une aussi triste occasion ne se produise pas, mais tous les États européens, notamment le plus neutre d’entre eux, à savoir l’Irlande – pays neutre par excellence –, ont admis qu’il était impossible de le garantir complètement.
Toutes les armes à sous-munitions ont été détruites ou le seront au cours des huit prochaines années. Nous en conserverons néanmoins un certain nombre – 500 – afin de permettre aux démineurs de s’entraîner.
Souvent d’origine étrangère, les démineurs sont des gens très courageux, qui ne font pas un travail commode. C’est bien beau de vouloir dépolluer, mais je rappelle que les démineurs le font parfois au prix de leur vie. C’est vrai notamment au Cambodge, au Laos, au Liban. Je tiens donc à saluer les forces armées, mais également les membres des ONG qui continuent de déminer. Je rends hommage, une fois de plus, à nos amis de Handicap international, ainsi qu’aux organisations britanniques qui ont travaillé avec eux.
Je tiens à noter la qualité de nos rapports avec le ministère de la défense et les forces armées. Nous pensions rencontrer des obstacles, mais tout s’est déroulé très vite.
Pour ce qui concerne la convention d’Ottawa, une réunion est effectivement prévue, à laquelle nous participerons. Nous ferons tout alors pour convaincre nos partenaires.
En ce qui concerne la convention d’Oslo, il y aura transposition en droit français. La loi devrait être présentée au Parlement par le ministre de la défense au premier trimestre 2010 – dès janvier, je l’espère. Les seuils quantitatifs y seront précisés. Ensuite, il nous faudra continuer de convaincre les autres.
En conclusion, permettez-moi de saluer à mon tour le courage des ONG, car, s’il est des spectacles difficiles dans les zones de guerre, le plus insoutenable, c’est de voir encore arriver bien après que les conflits ont cessé des enfants avec une jambe arrachée ou les mains déchiquetées et qu’il faut amputer, ces enfants dont le seul crime aura été, alors qu’ils s’amusaient avec leurs frères et leurs sœurs, de s’être laissés tenter par ce qu’ils pensaient être un jouet.
Croyez-moi, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est une vision qui vous hante à jamais !
Applaudissements

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l’article unique.
Est autorisée la ratification de la convention sur les armes à sous-munitions, signée à Oslo le 3 décembre 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
Le projet de loi est adopté définitivement, à l'unanimité.

M. le président. Mes chers collègues, cette unanimité honore la Haute Assemblée et le Parlement tout entier.
Applaudissements

Nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures trente-cinq, est reprise à dix-sept heures quarante-cinq.
(Texte de la commission)

Nous reprenons la discussion du projet de loi portant engagement national pour l’environnement.
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen de l’article 9.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 84, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après les mots :
ou agricoles,
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du VI du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme :
il peut fixer une valeur plancher au niveau maximal de densité de construction résultant de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.
La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.

Il s’agit d’un amendement de clarification et de simplification rédactionnelles.

L'amendement n° 206, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du VI du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, après le mot :
imposer
insérer les mots :
après accord de l'ensemble des conseils municipaux des communes concernées
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 84 ?
Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 207, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Supprimer les deux derniers alinéas du VI du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 85, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du VI du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme :
Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme...
La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 45, présenté par MM. Repentin, Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-6 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
peut, par secteur, définir
par les mots :
définit, par secteur,
La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, j’arrive un peu en catastrophe, car nous devons également assister aux travaux de commission et examiner les montages proposés par les rapporteurs, notamment s’agissant des architectes des Bâtiments de France, les ABF, afin de nous assurer que tout est bien en ordre. Les initiés comprendront…
Sourires

Le texte proposé pour l’article L. 122-1-6 du code de l’urbanisme permet aux schémas de cohérence territoriale, ou SCOT, de prévoir une réglementation incitative pour énoncer des règles applicables à certains secteurs, notamment en matière de qualité urbaine, architecturale et paysagère – nous avons ajouté cette dimension pour notre collègue Jacques Muller –, en l'absence de plan local d’urbanisme, ou PLU.
L'amendement vise à rendre une telle disposition systématique, afin de mettre en cohérence les principes d'aménagement applicables sur un territoire, quel que soit le statut de la commune en matière de document d'urbanisme, c'est-à-dire que le transfert ait eu lieu ou non.
Cette proposition vise à éviter que les ambitions urbaines ne demeurent nettement en deçà des exigences du Grenelle en matière de réglementation dans certaines communes.

Le texte adopté par la commission de l’économie du Sénat prévoit que le SCOT peut définir de telles normes, sans qu’il s’agisse d’une obligation.
Pour des raisons que nous avons déjà évoquées, il est bon d’en rester à une simple faculté, car cela correspond à la logique de « boîte à outils » du Grenelle : rendre possible ce qui est souhaitable sur chaque territoire, sans imposer une orientation uniforme à des territoires différenciés et en laissant aux élus concernés la possibilité d’apprécier s’il est ou non opportun de prendre une telle décision.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
À l’instar de la commission, le Gouvernement souhaite qu’une telle décision demeure facultative, afin qu’il soit véritablement tenu compte du contexte et des enjeux propres à chaque territoire.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, vous ne serez pas étonnés que je maintienne mon amendement, car il s’inscrit dans la droite ligne de l’idée que nous nous faisons de l’utilité des SCOT. Il serait tout de même très ennuyeux que leurs prescriptions ne se traduisent pas à l’intérieur des PLU !
Peut-être m’objecterez-vous que tout cela est prévu dans les obligations du SCOT, mais encore faut-il les traduire sur le terrain. Je regrette donc qu’une telle obligation ne figure pas dans les PLU.

Monsieur Raoul, il est clair qu’à partir du moment où les élus auront décidé d’inscrire une prescription dans le SCOT, celle-ci s’imposera naturellement aux PLU. Nous laissons simplement aux élus le choix de l’inscrire ou non dans le SCOT.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 46, présenté par MM. Repentin, Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-7 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
Ces objectifs sont ceux du programme local de l'habitat prévu à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation pour les communes concernées.
La parole est à M. Daniel Raoul.

Comme vous vous en doutez, cet amendement procède de la même philosophie que le précédent. Sans espérer vous convaincre, je voudrais au moins vous en présenter les motivations.
Le nouvel article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le programme local de l’habitat, le PLH, est décliné commune par commune et qu'il précise notamment le nombre et le type de logements à réaliser. Ces objectifs ne sauraient être différents d'un document à l'autre.
En revanche, comme la structure et les périmètres d'application des documents sont souvent différents – cela vient de nous être confirmé par M. le rapporteur et par Mme la secrétaire d’État –, nous proposons de faire en sorte que les objectifs quantitatifs de PLH soient ceux qui figurent dans le document de programmation de l'offre de logement.
Il s'agit d'instaurer un nouveau principe de reconnaissance mutuelle des documents d'urbanisme entre eux. C’est ce que les acteurs locaux attendent. En vous y opposant, vous renieriez complètement la philosophie portée par le Grenelle, c'est-à-dire le renforcement de l’intercommunalité en matière d’aménagement du territoire. D’ailleurs, cette philosophie sera sans doute – c’est mon petit doigt qui me le dit
Sourires

Cet amendement revient à inverser la hiérarchie des documents d’urbanisme.
En effet, en l’état actuel du droit, c’est le PLH qui doit être compatible avec le SCOT, et non l’inverse. Bien entendu, les objectifs d’un SCOT en matière de logement ne peuvent pas ignorer les travaux réalisés sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI. Mais le territoire d’un SCOT est beaucoup plus large que celui d’un PLH, car le PLH est élaboré par un EPCI et un SCOT comporte souvent plusieurs EPCI.
Il appartient donc aux élus de déterminer entre eux la politique du logement qu’ils souhaitent mettre en œuvre sur ce grand territoire, afin de la décliner ensuite dans les PLH.
Au demeurant, je voudrais procéder à un bref rappel. Sur ma proposition, la commission de l’économie a intégré dans le projet de loi un amendement tendant à imposer, le cas échéant, une mise en compatibilité du PLH avec le SCOT.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement : tout document élaboré sur le territoire le plus large doit naturellement s’imposer aux documents définis sur des territoires moins larges, faute de quoi la hiérarchie des documents d’urbanisme serait totalement modifiée.
M. le rapporteur a été très précis sur ce point.
Faire du SCOT une simple juxtaposition de programmes locaux de l’habitat reviendrait à renoncer à l’équilibre général, qui est pourtant construit avec les représentants des EPCI. En effet, nous n’ignorons pas les PLH. Les élus locaux, qui sont les créateurs des PLH lorsque de tels programmes existent, participent à l’élaboration du SCOT. Ils peuvent donc s’exprimer sur le sens qu’ils entendent donner à leur propre politique locale de l’habitat dès la définition des grands objectifs et des grandes orientations.
L’idée est véritablement de fixer, sur un bassin de vie, pour un territoire pertinent, des objectifs et des orientations qui nous permettront d’éviter une juxtaposition de programmes locaux de l’habitat sans lien les uns avec les autres.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Malgré les explications qui viennent de nous être apportées par M. le rapporteur et par Mme la secrétaire d’État, je persiste et signe sur cet amendement, car il exprime notre vision globale du rôle de l’intercommunalité.
Vous oubliez les différences de situations sur les territoires. M. le rapporteur et moi-même sommes élus dans des agglomérations. Celle que je représente réunit quatre EPCI, qui constituent le périmètre du SCOT. La démarche relative aux PLH a été abordée bien en amont, et ce n’est donc pas pour nous que le problème se pose. En revanche, il se pose dans les communes n’appartenant pas à un EPCI et dont le périmètre du SCOT ne correspond pas au bassin de vie.
Je ne ferai pas de procès d’intention à certaines municipalités, mais que ne ferait-on pas pour éviter d’appliquer un certain article 55… Vous voyez très bien à quoi je fais allusion !
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 47, présenté par MM. Repentin, Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-8 du code de l'urbanisme par les mots :
, le cas échéant conformément au plan de déplacement urbain adopté en application de l'article 28 de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs et en concertation avec le département
La parole est à M. Daniel Raoul.

Cet amendement s’inscrit dans le droit fil des deux précédents.
Il s’agit de faire en sorte que le principe de compatibilité des documents devienne un principe de reconnaissance mutuelle, le SCOT reprenant à son compte les projets d'équipements prévus par le plan de déplacements urbains, le PDU, qui, à l'instar du PLH, est un document programmatique contenant des données quantitatives et assorti d'un échéancier, alors que le SCOT est un document de planification sur le long terme.
L’objectif est de mettre en cohérence les documents entre eux.

Là encore, les auteurs de cet amendement proposent d’inverser la hiérarchie actuelle entre les SCOT et les PDU.
Aussi, pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées précédemment à propos des PLH, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Par ailleurs, je souhaite apporter une précision en réponse à un argument avancé dans l’objet de l’amendement. Les textes prévoient déjà d’associer le département, qui est responsable de l’organisation des transports interurbains, à l’élaboration d’un SCOT. De même, l’association entre le département et l’organisme chargé du SCOT a été renforcée par la commission de l’économie du Sénat, sur ma proposition. Désormais, le SCOT sera systématiquement associé à l’élaboration de tout PDU le concernant. Je pense donc qu’on peut difficilement faire mieux !
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 272 rectifié, présenté par MM. Vall et Baylet, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-8 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :
« Il fait l'objet d'une étroite concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales responsables de l'organisation des transports collectifs sur leur territoire. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune, les amendements n° 48 et 305.
Afin de laisser notre collègue Daniel Raoul reprendre un peu son souffle
Sourires

Dans le troisième alinéa (a) du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-8 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
minimales ou

Cet amendement vise à supprimer du texte la mention d’obligations minimales de réalisation de places de parking.
Après des décennies de promotion exclusive de l’automobile, après les déclarations d’un Président de la République, Georges Pompidou, affirmant que c’était à la ville de s’adapter à la voiture, et dans un contexte où une majorité de nos concitoyens pensent que la mobilité se traduit nécessairement par la possession d’un véhicule motorisé, excepté à Paris, où il est très difficile de circuler, comment les techniciens et les élus pourraient-il oublier le nombre minimal de places de parking ? On sait pourtant, hélas, que ces dernières contribuent à attirer les voitures et donc à renforcer les flux de circulation.
Nous estimons que ce n’est pas au texte du Grenelle, fondateur d’une politique de l’environnement, de veiller à la pérennisation des places de parking et à consacrer la part excessive que prend la voiture dans nos modes de déplacement.
C’est en revanche le rôle du Grenelle de fixer les obligations maximales, qui doivent être maintenues.
Supprimons donc cette référence au nombre minimal de places de parking qui n’a vraiment pas sa place dans un bon texte !

L'amendement n° 48, présenté par MM. Repentin, Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Au début du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-8 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
Il peut préciser
par les mots :
Le cas échéant conformément aux dispositions particulières prévues par le plan de déplacement urbain, il précise
II. - Dans le troisième alinéa (a) du même texte, supprimer les mots :
minimales ou
III. - Supprimer le dernier alinéa du même texte.
La parole est à M. Daniel Raoul.

Le stationnement est l’une des dimensions mal connues des politiques de transport et de déplacement.
Souvent ignorée, une maîtrise coordonnée de la production des places de stationnement pour les voitures ou les vélos conditionne pourtant la réussite d'une politique de report modal, notamment lors de la création de nouvelles lignes.
Malheureusement, en la matière, les habitudes adoptées au niveau des communes sont difficiles à corriger. C’est pourquoi nous souhaitons que le SCOT énonce des règles plus volontaristes en la matière.
Par exemple, pour rebondir sur ce que disait à l’instant mon collègue, ne pas fixer de normes minimales s’agissant du nombre de places de stationnement permettrait à des opérateurs de ne pas en construire s'ils n'en voient pas l'utilité.
Aujourd'hui, l'obligation de fixer des minima empêche concrètement le développement de quartiers au sein desquels les promoteurs pourraient supprimer purement et simplement les constructions de stationnement, notamment souterraines.
À raison de 15 000 euros hors taxes, prix de revient moyen d'une place, une telle mesure pourrait présenter l'intérêt de diminuer le coût global du logement, comme cela se pratique dans certains quartiers de centre-ville en Allemagne.
En outre, la suppression du dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l’article L. 122-1-8 du code de l’urbanisme est une mise en cohérence qui permet d'envisager trois cas de figure.
Premièrement, quand il existe un PDU établissant des règles en matière de stationnement, les dispositions du PDU sont reconnues dans le SCOT. Deuxièmement, quand le PDU ne précise pas ces règles, le SCOT les établit. Troisièmement, enfin, quand il n'existe pas de PDU, les règles du SCOT devraient s'appliquer.
Cette nouvelle rédaction offre l'intérêt de résoudre le problème posé par le caractère non opposable du PDU en matière de stationnement.

Je m’interroge sur la logique de ces amendements, dont les promoteurs acceptent que les SCOT fixent un nombre de places maximal, mais non un nombre minimal.
Tout le monde en convient, la question du stationnement est centrale pour la régulation de la consommation de l’espace et la réussite des politiques de report modal.
Cela étant, je suis personnellement défavorable, ainsi que la commission, à ce que le SCOT fixe systématiquement des règles en matière de stationnement, qu’il s’agisse de maxima ou de minima.
L’article 9 du projet de loi prévoit que le SCOT fixe des minima et des maxima, mais seulement en l’absence de PLU tendant lieu de PDU. Je vous rappelle que vous avez, comme nous, souhaité que les SCOT ne soient pas des « super PLU ». Or, par vos amendements, vous en arrivez à y introduire des règles qui, à mon avis, sont de la compétence des PLU.
Par ailleurs, il faut bien lire les dispositions du projet de loi relatives à la fixation d’un nombre minimal de places de stationnement.
Le texte prévoit que le SCOT « peut » préciser des obligations minimales en fonction des dessertes par les transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments.
Il n’y a donc aucune obligation à imposer un nombre minimum de création de places de parking ; nous offrons simplement la possibilité de fixer un seuil bas si cela est opportun.
Notre collègue Didier Guillaume l’a rappelé hier, si des personnes veulent, par exemple, prendre les transports en commun pour aller travailler, elles doivent pouvoir trouver des places de stationnement à proximité des gares pour y laisser leur voiture : il n’existe pas partout des transports collectifs desservant les gares. Il faut donc s’adapter en privilégiant naturellement les transports collectifs, mais en permettant aussi aux personnes d’y accéder le plus facilement possible.
M. Braye l’a souligné à juste titre, la disposition visée par l’amendement n° 305 n’est qu’une faculté offerte au SCOT qui, au surplus, doit l’utiliser en fonction de la desserte par les transports publics réguliers.
Lors de la construction d’un tramway, il est naturel de prévoir un minimum des places de stationnement dans un parking relais.
M. Paul Raoult et moi sommes élus du même territoire : sans parking relais, les Quercitains ne pourraient pas utiliser le tramway qui dessert la zone urbaine. Ne pas prévoir un minimum de places de stationnement dans l’aménagement des espaces dédiés aux transports en commun pose donc problème.
En ce qui concerne l’amendement n° 48, M. Braye a développé un argumentaire identique au mien.
Le Gouvernement partage donc l’avis de la commission, et est défavorable à ces deux amendements.

La parole est à M. Jacques Muller, pour explication de vote sur l'amendement n° 305.

J’entends bien les explications de Mme la secrétaire d'État et de M. le rapporteur, qui mettent l’accent sur la simple faculté laissée au SCOT.
Néanmoins, dans le monde où nous vivons, personne n’oublie de construire des places de parking. C’est même le premier réflexe ! En tant qu’élu de terrain, je puis vous assurer que quand on réalise un aménagement, on pense « parking ».
Ce matin, un certain nombre de mes amendements ont été refusés qui ne visaient qu’à indiquer une direction dans la prise en compte d’études et de plans paysagers, afin d’optimiser l’urbanisme, notamment les toits végétalisés. On m’a opposé que de telles dispositions n’avaient pas leur place dans un PLU, dont l’objet est de fixer des règles.
Or maintenant on souhaite inscrire la possibilité de fixer un seuil minimal de places de parking ! Culturellement parlant, une telle précision n’a pas sa place dans ce projet de loi.
Évidemment, nous créons tous des places de parking. Dans cet hémicycle, il n’y a pas un élu qui ne réfléchisse à un nombre minimum de places de stationnement. Mais y inscrire une telle précision discrédite un texte qui va pourtant dans le bon sens, celui de la protection de l’environnement. Pour utiliser une expression familière, « cela fait tache ». Franchement, c’est dommage !

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 48.

Contrairement à ce qu’affirme M. le rapporteur, notre argumentation n’est pas contradictoire.
Si l’on évoque la construction de transports en commun en site propre, ou TCSP, il est clair que des parkings relais doivent être prévus pour favoriser le multimodal.
En revanche, on pourrait très bien imaginer qu’il n’y ait pas de règle sur le minimum de places de stationnement à construire lors d’une opération immobilière, en particulier le long des TCSP, ce qui abaisserait le coût des opérations et contribuerait à la construction d’un plus grand nombre de logements, puisque les personnes pourraient utiliser le tramway pour aller jusqu’au parking relais et en revenir.
Cela se pratique dans d’autres pays : j’ai évoqué les éco-quartiers en Allemagne, mais cela se fait également aux Pays-Bas.
Je connais le système. Pourquoi conserver cette règle de minima, sinon pour rapporter quelques recettes supplémentaires aux communes ? Je rappelle en effet que l’on peut s’affranchir de l’obligation en s’acquittant d’une indemnité…

Chers collègues, nous restons inéluctablement sur notre logique, qui est de donner aux élus une boîte à outils suffisamment complète. Nous prévoyons toutes les possibilités, nous recensons un certain nombre de problématiques et nous donnons aux élus les moyens d’agir.
Cependant, monsieur Muller, nous ne souhaitons rien imposer, ni en termes de minima ni en termes de maxima.
En imposant des minima et des maxima, vous le savez, nous ne répondons pas à la différenciation de territoires qui sont excessivement variés. Si l’on circule plus en voiture dans le nord de la France et que l’on utilise davantage le vélo dans le sud, c’est parce que les conditions climatiques sont plus ou moins favorables, tout simplement ! Alors, de grâce, laissez les élus décider en fonction de leur territoire !
Vous dites faire confiance aux élus, mais vous ne cessez de chercher à leur imposer de nouvelles contraintes.
Encore une fois, nous souhaitons offrir une boîte à outils complète et ouvrir des possibilités. Le texte appelle l’attention des élus sur différents problèmes. À eux, ensuite, de choisir les outils les plus adaptés à leur territoire.

Je ne voterai pas ces deux amendements, et j’ai de bonnes raisons pour cela.
Près de chez moi, un maire à la tête d’une très grande agglomération n’exige plus la création d’un minimum de places de parking pour les constructions nouvelles sur le territoire de sa commune parce qu’il est très bien desservi par les transports en commun.
Ce sont donc les villes voisines qui héritent du problème et qui doivent créer des places de parking pour les personnes qui ne peuvent pas stationner dans sa commune.
Je suis donc très favorable à la possibilité de maintenir des minima.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 306, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-8 du code de l'urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« c) les obligations de compatibilité de la voirie et des transports en commun
La parole est à M. Jacques Muller.

Alors que l’article L. 122-1-8 du code de l’urbanisme concerne les objectifs en matière de transports, alors que l’on évoque dans ce texte l’encadrement des places de parking, la compatibilité de la voirie et des transports en commun n’est pas déclinée dans les précisions suggérées.
Nos pratiques de terrain concernant les plans de déplacements montrent pourtant que des choix vertueux de desserte pour les transports en commun se heurtent souvent à des profils de courbe, à des rayons de ronds-points trop courts, à l’impossibilité d’un décrochement pour un arrêt, etc.
Lorsque l’on n’a pas anticipé, ni la volonté politique ni le budget voté pour la collectivité ne permettront au bus de passer, sauf à envisager des travaux coûteux.
Il est donc utile que le texte de cet article invite à se pencher sur le problème en amont.
En revanche, pour qu’il n’y ait pas de confusion, je précise bien que cet amendement ne vise en rien à exiger que toute la voirie soit compatible avec la desserte par autobus puisque d’autres choix – des axes piétonniers, par exemple -, sont aussi envisageables.

Mon cher collègue, ces dispositions relèvent non pas du SCOT ou du PLU mais tout simplement du bon sens des élus ! Quel élu construirait des routes trop étroites pour les transports en commun ? J’espère que les élus sont suffisamment intelligents pour éviter cet écueil.
Quand on veut créer des voies cyclables, on ne construit pas des autoroutes, et quand on souhaite faire rouler des 40 tonnes, on ne les fait pas passer sur les liaisons douces !
Je suis donc défavorable à cet amendement.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 86, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l’article L. 122-1-12 du code de l’urbanisme :
« Art. L. 122 -1 -12. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
« - les programmes d’équipement de l’État, des collectivités locales et des établissements et services publics ;
« - les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu’ils existent.
« Ils sont compatibles avec :
« - les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;
« - les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
« - les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;
« - les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du même code.
« Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.
La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.

Il s’agit encore d’un amendement de clarification rédactionnelle, monsieur le président.

L’amendement n° 239, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et Muller, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l’article L. 122-1-12 du code de l’urbanisme :
« Art. L. 122 -1 -12. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
« - les programmes d’équipement de l’État, des collectivités locales et des établissements et services publics ;
« - les plans climats énergie territoriaux lorsqu’ils existent.
« Ils sont compatibles avec :
« - les schémas régionaux de cohérence écologique ;
« - les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
« - les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;
« - les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-3 du même code.
« Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est rendu compatible dans un délai de trois ans ».
La parole est à M. Paul Raoult.

L’amendement n° 86 n’est pas purement rédactionnel !
Le vrai problème, aujourd’hui, consiste à rendre compatibles le schéma régional de cohérence écologique, que nous allons créer, les chartes des parcs naturels nationaux ou régionaux quand il en existe, les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau – c’est-à-dire les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, les SAGE, et les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les SDAGE – et l’ensemble des schémas de cohérence territoriale tels qu’ils existent au niveau de la région.
Il faut donc atteindre un degré de clarté suffisant pour que tous ces schémas « s’emboîtent ». La difficulté n’est pas mince car, dans la pratique, chaque niveau voudrait imposer son schéma à l’autre ! Il faut donc faire en sorte que chacun de ces schémas soit établi en cohérence avec les autres.

L’amendement n° 300, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Dans la troisième phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l’article L. 122-1-12 du code de l’urbanisme, après les mots :
mise en valeur des paysages
insérer les mots :
et de la biodiversité
La parole est à M. Jacques Muller.

Cet amendement est identique à un amendement que j’ai déjà présenté précédemment et qui a été rejeté.
La protection de la biodiversité est essentielle ; elle n’a pas à figurer uniquement au « musée » du titre IV du projet de loi. Il serait préférable de l’inscrire de manière tout à fait explicite dans le titre Ier, qui traite de l’urbanisme.
L’argumentation qui nous est opposée m’étonne : on nous refuse l’inscription de la biodiversité dans les différents documents d’urbanisme, au motif qu’elle serait implicitement visée par les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, mais on rejette en même temps un amendement que nous avions cosigné avec nos collègues socialistes et qui tendait à imposer aux SCOT une exigence de compatibilité avec les schémas régionaux de cohérence écologique.
La même argumentation vaut pour les amendements n° 301, 302 et 303, je n’y reviendrai donc pas. Je tenais cependant à souligner cette contradiction majeure dans l’argumentation de M. le rapporteur et de Mme la secrétaire d’État.

L’amendement n° 86, qui a un caractère rédactionnel, recueille un avis favorable de la commission.
En ce qui concerne l’amendement n° 239, le projet de loi a fait le choix d’un rapport de « prise en compte » et non de « compatibilité », en raison des risques importants de contentieux qui découlerait de l’obligation de compatibilité. À mon sens, ce ne serait pas un cadeau à faire aux élus !
Pour éviter que la notion de « prise en compte » n’affaiblisse trop l’articulation entre les schémas de cohérence écologique et les documents d’urbanisme, le projet de loi prévoit néanmoins, avant leur entrée en vigueur, un contrôle préfectoral renforcé sur les questions de préservation et de restauration des continuités.
La préoccupation des auteurs de l’amendement est donc très largement prise en compte et l’avis de la commission est donc défavorable.
Enfin, sur l’amendement n° 300, j’avais expliqué à notre collègue Jacques Muller, en commission, que l’adoption de son amendement aboutirait à imposer aux SCOT d’être compatibles « avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages, de la biodiversité, ». Or cette rédaction n’aurait pas de sens, car il n’existe pas de directives de protection et de mise en valeur de la biodiversité.
La commission a donc émis un avis défavorable sur le fond comme sur la forme.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 86.
Sur l’amendement n° 239, le Gouvernement émet le même avis défavorable que la commission, et pour les mêmes raisons.
Enfin, l’amendement n° 300 ne paraît pas pertinent, car il complète en fait l’appellation d’un document existant et avec lequel le SCOT doit être compatible. Par ailleurs, la protection de la biodiversité est réaffirmée à l’article 6 du projet de loi et dans le contenu du SCOT.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l’amendement n° 86.

L’amendement présenté par notre collègue rapporteur pour avis de la commission des lois est très bien rédigé et, même s’il est incomplet à notre sens, nous le voterons.
L’amendement est adopté à l’unanimité des présents.

En conséquence, les amendements n° 239 et 300 n’ont plus d’objet.
L’amendement n° 49, présenté par MM. Repentin, Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l’article L. 122-1-14 du code de l’urbanisme, après les mots :
décret en Conseil d’État
insérer les mots :
les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors œuvre nette de plus de 2000 mètres carrés
La parole est à M. Daniel Raoul.

Cet amendement tend à abaisser de 5 000 mètres carrés à 2 000 mètres carrés le seuil à partir duquel les opérations d’aménagement doivent respecter les règles de mixité énoncées dans les SCOT.

Il convient de rappeler que les SCOT, dans le droit en vigueur, sont opposables aux documents d’urbanisme de niveau inférieur, notamment les plans locaux d’urbanisme, les PLU, mais pas aux opérations foncières elles-mêmes, hormis les plus importantes. Actuellement, le seuil d’opposabilité directe des SCOT est fixé par l’article R. 122-5 du code de l’urbanisme à 5 000 mètres carrés.
Abaisser le seuil d’opposabilité directe des SCOT, comme le proposent les auteurs de cet amendement, reviendrait à faire des SCOT des documents déterminant très fortement, à mon sens trop fortement, le droit des sols. Or telle n’est pas leur vocation : les SCOT ont pour but d’encadrer et de mettre en cohérence les PLU, mais c’est à ces derniers qu’il revient de déterminer précisément l’usage des sols. J’estime qu’il est nécessaire de renforcer les SCOT mais qu’il faut également veiller à ce qu’ils ne deviennent pas des « super PLU ».
La commission a donc émis un avis défavorable.
Le Gouvernement émet le même avis défavorable que la commission. Il considère en effet qu’il n’est pas souhaitable de faire figurer une telle disposition dans la partie législative du code de l’urbanisme, alors qu’elle devrait conserver son caractère réglementaire.
Par ailleurs, abaisser de 5 000 mètres carrés à 2 000 mètres carrés le seuil à partir duquel les projets doivent être compatibles avec le SCOT affaiblirait le rôle de celui-ci, qui doit rester fondamentalement axé sur la mise en cohérence de l’ensemble des politiques d’aménagement concernant un territoire et ne pas devenir un document définissant le droit des sols.

Les arguments avancés n’ont pas réussi à me convaincre. En effet, ce n’est pas une question de mètres carrés qui fait que cette mesure est de nature législative ou de nature réglementaire. Il en est de même pour la distinction entre « super PLU » et SCOT : ce n’est pas une question de surface !
L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n° 87, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
À la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l’article L. 122-1-14 du code de l’urbanisme, remplacer les mots :
doivent être compatibles
par les mots :
sont compatibles
La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.
Sourires
L’amendement est adopté.

L’amendement n° 88, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l’article L. 122-1-14 du code de l’urbanisme, remplacer les mots :
doivent, si nécessaire, être rendus
par les mots :
sont, le cas échéant, rendus
La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.

M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis. Je ne sais pas si la discussion sera plus nourrie, monsieur le président, mais il s’agit également d’un amendement rédactionnel.
Nouveaux sourires.
L’amendement est adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 264, présenté par M. Emorine, est ainsi libellé :
A. - Rédiger comme suit le I du 2° bis du I de cet article :
I. - Le premier alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.
« Jusqu’au 31 décembre 2012, la disposition du premier alinéa s’applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2016, elle s’applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2017, elle s’applique dans toutes les communes. »
B. - Après le I du 2° bis du même I, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au début du deuxième alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme, les mots : « Dans les communes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où s’applique la disposition du ».
C. - Compléter le 2° bis du même I par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le quatrième alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme est complété les mots : « jusqu’au 31 décembre 2012, ou de plus de 15 000 habitants, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 ».
... - Le dernier alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme est supprimé.
La parole est à M. Jean-Paul Emorine.

M. Jean-Paul Emorine.Je vais essayer de nourrir la discussion, puisque cet amendement n’est pas uniquement rédactionnel !
Sourires

L’amendement n° 264 tend à généraliser les SCOT sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2017.
En effet, le Grenelle de l’environnement décline une vision nationale de l’environnement à travers des directives territoriales d’aménagement et de développement durable au niveau des régions, établies par les préfets en concertation avec les collectivités locales : les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les communautés de communes et, le cas échéant, les communes qui n’appartiendraient pas à une communauté de communes.
Lors de la séance de questions d’actualité, M. le ministre de l’agriculture nous a expliqué que des surfaces agricoles disparaissaient chaque année. À partir du moment où les schémas de cohérence territoriale seront généralisés, ils définiront les différentes zones à urbaniser - les zones boisées, les zones agricoles, les zones industrielles et les zones commerciales - en fonction des objectifs d’aménagement du territoire et faciliteront ainsi peut-être la coexistence de populations différentes dans des communes rurales qui avaient été dominées par l’agriculture mais qui accueillent aujourd’hui de nouvelles catégories d’habitants.
Par la suite, ces schémas de cohérence territoriale pourront évoluer vers des documents d’urbanisme.
Nous constatons que les communes rurales qui ne disposent pas de documents d’urbanisme rencontrent beaucoup de difficultés à gérer l’urbanisation et que des conflits peuvent surgir au sein des conseils municipaux pour la délivrance d’un permis de construire. On en rejette la responsabilité sur la direction départementale de l’équipement, mais la raison profonde de ces conflits tient souvent à l’absence de vision globale de l’urbanisation, même à l’échelle d’une commune rurale.
C’est pourquoi je souhaite que le principe d’urbanisation limitée soit appliqué à toutes les communes et que l’ensemble du territoire puisse être couvert par des SCOT à l’horizon 2017.

L'amendement n° 89, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. - Au début du premier alinéa du 2° bis du I de cet article, remplacer les mots : Au premier alinéa par les mots : Aux premier et quatrième alinéasII. - Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du 2° bis du I de cet article : Ces dispositions entrent en vigueur...
La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.

Compte tenu de l’excellence de l'amendement qui vient d’être présenté par M. Emorine, par ailleurs président de la commission de l’économie, je retire mon amendement.

M. Dominique Braye, rapporteur. Soucieux de respecter le protocole et les usages de notre Haute Assemblée, je ne prendrai pas la parole après notre éminent et bien-aimé président de commission, Jean-Paul Emorine, et me contenterai donc d’émettre un avis très favorable.
M. Daniel Raoul s’exclame.

M. le président. Madame la secrétaire d’État, vous n’êtes pas tenue à la même révérence…
Sourires
L’amendement que vient de nous présenter M. Emorine amplifie la disposition déjà approuvée en commission qui a étendu les effets de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme aux communes situées à moins de quinze kilomètres d’une agglomération de plus de 15 000 habitants.
Cette nouvelle mesure, qui concernerait toutes les communes à partir du 1er janvier 2017, tend à inciter l’ensemble des communes à se doter d’un schéma de cohérence territoriale, quels que soient les caractéristiques du territoire et ses enjeux.
Cette incitation à mettre en œuvre des politiques d’aménagement et d’environnement sur des territoires suffisamment vastes et cohérents est, bien sûr, positive et va tout à fait dans le sens de l’ensemble du Grenelle.
Par ailleurs, le système dérogatoire qui est maintenu permet, encore une fois, suffisamment de souplesse pour que des projets opportuns pour certains territoires puissent être mis en œuvre.
C’est pourquoi nous sommes très favorables à votre amendement, monsieur Emorine.

Peut-être serez-vous étonné, monsieur Emorine, mais nous allons voter cet amendement très pertinent ; il me paraît tout à fait conforme à la volonté d’organiser les bassins de vie, qui est selon moi le mot-clé concernant les périmètres des SCOT.
Je comprends très bien que toute commune devra, à terme, appartenir au périmètre d’un SCOT. Sinon, on ne pourra pas aménager ce territoire en fonction des besoins de ses habitants. Donc, le périmètre lié au bassin de vie me convient très bien et je considère que c’est une avancée dans cet article.

Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je ne suis pas certaine d’avoir tout compris à cet article et à cet amendement, sur lesquels je ne me prononcerai que sous réserve d’explications complémentaires.
J’approuve tout à fait l’idée d’une généralisation progressive des SCOT sur l’ensemble du territoire. On a trop souffert des différences entre territoires, du fait que certains appartenaient à des intercommunalités, contrairement à d’autres, ou qu’ils étaient couverts par des SCOT, tandis que d’autres ne l’étaient pas. À l’évidence, une harmonisation du paysage est souhaitable. Qu’elle se fasse au niveau des bassins de vie est également positif. C’est en tout cas cohérent.
Si j’ai bien compris le troisième alinéa de cet amendement, il s’agit, dans un premier temps, de prévoir que l’on ne pourra pas ouvrir à l’urbanisation une zone qu’il n’avait pas été prévu d’urbaniser avant le 1er juillet 2002 s’il n’existe pas de SCOT.
Toutefois, je ne mesure pas tout à fait ce que vient faire, dans le quatrième alinéa de l'amendement, la référence au « rivage de la mer » et à « une agglomération de plus de 50 000 habitants ». Peut-être allez-vous m’expliquer comment le dispositif fonctionnera, parce que, honnêtement, je ne comprends pas.

M. Claude Biwer. J’ai au moins un point commun avec Évelyne Didier : je n’ai sans doute pas tout compris !
Sourires

La généralisation des SCOT à tout le territoire est, dans son principe, une avancée. C’est un objectif que je partage, surtout lorsque je suis dans mon bureau parisien. Mais, quand je m’en retourne chez moi et que je vois comment cela se passe sur le terrain, je me demande si l’on n’est pas en train de donner le pouvoir à la ville-centre.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Dans mon département, on trouve à la périphérie d’une ville de 20 000 habitants des communes dont la plus importante compte 1 000 habitants. Il n’y aura aucune place pour ces villes-satellites qui n’auront aucune possibilité de se faire entendre au nom de la démocratie puisque les jeux seront faits. Je me demande comment je vais aller expliquer cela sur place.
Évelyne Didier n’est certainement pas dans ma situation mais, moi, il faut m’expliquer deux fois ! Pour l’instant, je ne vois pas comment je peux voter une telle disposition.

J’approuve le souci du président Emorine de programmer la généralisation des SCOT. Je crois que c’est une bonne chose et, par conséquent, je voterai cet amendement.
Je ferai toutefois deux observations.
Premièrement, le vote de cet amendement doit nous obliger à bien distinguer le domaine du SCOT et celui des PLU. Or j’ai constaté tout à l’heure qu’un certain nombre d’amendements tendaient à faire remonter des dispositifs prévus dans les PLU dans le SCOT. Comme, de surcroît, on va créer les PLU intercommunaux, je ne voudrais pas que, pour rénover un quartier ou pour lancer une urbanisation nouvelle, on soit à l’avenir « coincé » entre le PLU local, le PLU intercommunal et le SCOT.
Il faut donc que nous conservions la position que M. le rapporteur a défendue depuis le début : le SCOT est le document général sur l’organisation de l’espace et le PLU est le document concret qui prévoit les droits de chaque propriétaire de parcelle en matière d’urbanisation.
Deuxièmement, l’avant-projet de texte qui va être proposé au Sénat dans quelques mois sur la réorganisation des collectivités territoriales prévoit que l’intercommunalité doit, d’ici à 2014, se développer de manière continue ; par conséquent, aucune commune ne devra rester à l’extérieur d’un système intercommunal.
C’est la raison pour laquelle je me demande s’il est opportun de retenir la notion de SCOT communal à partir de 2017. À mon avis, le SCOT doit être l’élément de base de la programmation intercommunale dans le cadre des EPCI, quelle que soit leur forme, communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de communes ou, demain, métropoles puisque, dans les métropoles dont on nous parle, il y aura évidemment un schéma de cohérence territoriale.
Je suis donc d’accord pour voter ce texte, mais j’insiste sur le fait qu’il ne faut pas mélanger SCOT et PLU et que, dans un avenir assez proche, il n’y aura plus de SCOT communaux, il y aura des SCOT intercommunaux.

La proposition qui nous est faite est effectivement importante – j’espère qu’elle sera acceptée par l’Assemblée nationale –, mais elle pose tout de même des problèmes d’organisation.
D’abord, lorsque l’on veut faire un SCOT, il faut être sûr que l’ensemble des communes adhèrent à ce mouvement, car d’emblée se pose la question de savoir qui va payer. Faire un SCOT, en effet, cela coûte cher - il faut payer un cabinet d’études - et cela prend plusieurs années. Il importe donc de bien connaître d’entrée les moyens dont disposent les communes rurales dans le territoire donné.
À mon avis, on doit prévoir des incitations financières si l’on veut généraliser les SCOT à l’ensemble du territoire. Sinon, cela se traduira par une surcharge financière imposée à un certain nombre de communes.
Sur le principe, nous sommes donc bien d’accord, il faut y aller, mais cela n’ira pas sans poser des problèmes de mise en œuvre. Pour reprendre ce que je disais ce matin, il faudra que le SCOT soit souple et ne tombe pas dans le travers d’un « super PLU ».

Là, on aura du mal, car la nature humaine est ainsi faite que celui qui a le pouvoir a tendance à en abuser. Comme le disait Montesquieu, « il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». Or, dans le droit du sol, les contre-pouvoirs sont rarement nombreux.
En tant que président d’un parc naturel régional regroupant 135 communes, j’ai constaté que plus de la moitié d’entre elles n’avaient ni PLU ni carte communale.

Pour que le SCOT ait véritablement un sens, cela suppose que, sur l’ensemble des communes, il y ait au moins une carte communale. Sinon, que devient le SCOT ?
Voilà pourquoi il faut prévoir des incitations, notamment si l’on autorise les communautés de communes à prendre en charge des PLU intercommunaux.
Je connais cependant un certain nombre de communes qui n’ont pas les moyens aujourd’hui d’élaborer leur PLU ; c’est notamment le cas des communes de 100 ou 150 habitants. Et rien ne changera sur ce plan puisque l’on nous a assuré que la prochaine réforme ne toucherait pas aux 36 000 communes…
Il n’empêche que certaines de ces communes – je ne leur en veux pas, mais c’est la réalité – qui n’ont ni église, ni cimetière, ni école continuent à faire de l’urbanisation linéaire à tout va le long des axes communaux ou départementaux en transférant les charges sur le bourg-centre ! Cela n’est pas possible !
Vous le savez, mes chers collègues, lorsqu’il n’y a ni carte communale ni PLU, la délivrance du permis de construire dépend de certains rapports de force et de l’humeur du maire et du fonctionnaire de la DDE de l’arrondissement !
J’ai suffisamment d’ancienneté pour avoir constaté que, dans certains villages où, pendant dix ou vingt ans, il était impossible de construire, brutalement, parce qu’un fonctionnaire ou un maire avait changé, on construisait à tout va.
La généralisation de la politique des SCOT sur l’ensemble du territoire suppose, je le répète, un soutien financier, plus d’intercommunalité, mais aussi des cartes communales ou des PLU sur l’ensemble du territoire national.

Sur les SCOT, je voudrais d’abord rassurer M. Fourcade : il est certain qu’il nous faut d’ores et déjà adopter une approche intercommunale, et non communale, d’autant que les intercommunalités doivent être définitives à l’horizon 2014.
Je tiens à rassurer parallèlement M. Biwer : le SCOT doit s’établir dans une logique de bassin de vie, mais, dans la réalité, les élus ne le réalisent pas de cette manière.
Pour ma part, j’ai réalisé un SCOT sur une communauté de communes regroupant 8 500 habitants à partir de 16 communes ayant, à peu de chose près, le même rapport de force. La plus importante, chef-lieu de canton, comptait 3 000 habitants et la plus petite, 55 habitants !
Il ne faut pas avoir dans l’esprit que le SCOT ne se réalisera que dans des bassins de vie. Les élus, à mon avis, ne sont pas encore prêts. Ce qui importe, c’est la cohérence que l’on doit donner au SCOT.
Si le préfet peut intervenir pour assurer la cohérence du SCOT, c’est précisément pour que ce dernier ne déstabilise pas d’autres espaces.
Nous pouvons donc être rassurés pour la ruralité. Des espaces peut-être moins pertinents que les bassins de vie peuvent être définis, mais il importe de conserver une approche globale.
Les communes rurales ne doivent pas craindre les SCOT ! M. Raoult vient de l’expliquer, en l’absence de document d’urbanisme, les communes doivent se tourner vers l’intercommunalité, qui leur permet d’adopter cette vision globale dont je parlais. Pour ma part, j’invite les maires de mon département à élaborer non pas une carte communale, mais un PLU, même pour les plus petites communes, car je peux vous assurer que l’application de son règlement renforce la position du maire.

Madame Didier, je vous rappelle que tout cela figure dans les lois que nous avons d’ores et déjà votées. Nous avons notamment exigé des SCOT dans les territoires à enjeu, c'est-à-dire les intercommunalités à partir de 50 000 habitants, mais également toutes les communes du littoral considérées comme telles de par leur nature. Voilà pourquoi, lorsqu’on évoque les SCOT, on mentionne systématiquement la règle du « moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ».
Monsieur Fourcade, vous avez bien fait d’insister une nouvelle fois sur la hiérarchie des documents d’urbanisme, car c’est une question capitale. Notre collègue Paul Raoult invoquait tout à l’heure la nature humaine et la faiblesse des contre-pouvoirs en la matière. C’est précisément pourquoi il est important de bien préciser les choses dans la loi. De cette manière, si des tentations malsaines se manifestent dans le Nord, elles ne pourront pas être suivies d’effet !
Rires

Mes chers collègues, je vous rappelle que le texte initial autorisait la densification. Tout le monde s’accorde à dire qu’il faut densifier l’habitat dans les centres urbains dotés de transports en commun, de gares. Mais le texte prévoyait également que le SCOT puisse fixer des règles concernant le gabarit, la hauteur. Nous avons obtenu le retrait de cette disposition, car nous estimons que les formes urbaines relèvent du PLU. Or nous ne voulons pas que les SCOT deviennent des « super PLU ». Nous devons conserver cette notion fondamentale qu’est la hiérarchie des documents d’urbanisme ; sans quoi, nous observerions des dérives.
Madame la secrétaire d’État, il ne faut pas non plus que l’administration essaye, par petites touches, de revenir sur ce principe dans les lois successives.
Mme la secrétaire d'État approuve.

En l’espèce, on ne doit pas y voir malice, mais la plume est quelquefois rapide lors de la rédaction des projets de loi, et la hiérarchie des normes n’est pas toujours totalement respectée. Le législateur est là pour y remettre bon ordre.
Monsieur Raoult, vous avez évoqué des communes qui n’ont ni carte communale ni intercommunalité. Mais développez donc l’intercommunalité ! Je ne comprends pas comment les maires peuvent avoir des compétences sur le papier sans pouvoir les exercer. Mieux vaut alors se mettre à plusieurs !

(Exclamations amusées.) C’est un domaine dans lequel vous vous êtes visiblement immergée, et avec succès !
Mme la secrétaire d’État sourit.

Madame la secrétaire d’État, je constate avec plaisir que vous êtes beaucoup plus au fait des questions d’urbanisme, qui n’étaient pas votre spécialité, que je n’aurais pu l’imaginer ou même le rêver. §
À la suite de nos interpellations, le Gouvernement nous a promis qu’il participerait au financement des SCOT et des documents d’urbanisme. Nous tenons à ce que cette promesse soit respectée. Nous devons structurer nos territoires ; il faut donc nous en donner les moyens. L’ancien système - un euro par habitant -, qui est valable pour les villes de grande taille, est manifestement très insuffisant pour les petites communes. Il faut trouver un nouveau système tenant compte non seulement de la population, mais également de la superficie du territoire et de l’enjeu.
Madame la secrétaire d’État, je sais que vous ferez tout votre possible parce que vous ne pouvez pas envisager que le Gouvernement ne tienne pas sa promesse.
Sourires

Nous vous faisons confiance et nous jugerons au résultat, même si nous avons déjà une opinion bienveillante à votre égard. Mais je ne vous lâcherai pas !
Exclamations.

M. le président. Selon le règlement, un orateur ne peut intervenir qu’une seule fois pour explication de vote. Mais nous sommes dans une conjoncture particulière, mes chers collègues : Mme Létard, M. Raoult et le président de séance sont des élus du sud du Nord.
Sourires

À quoi sert un SCOT ? Ne retombons pas dans le travers observé lors de la constitution des EPCI. Il ne faut pas développer les SCOT à tout va : ils doivent garder une cohérence géographique.
À mon sens, le SCOT sert à renforcer le lien entre zones urbaines et zones rurales. Créer des SCOT purement urbains ou purement ruraux ne serait pas une avancée. Le véritable enjeu est la périurbanisation, c'est-à-dire la maîtrise de l’urbanisation entre l’espace urbain et l’espace rural. Actuellement, le processus n’est pas maîtrisé. Dans un certain nombre de communes rurales, on constate un afflux de population, avec des demandes de permis de construire en augmentation importante.
Le SCOT doit donc être le lieu de réflexion pour développer une véritable intelligence territoriale entre le rural et l’urbain.

Afin d’assurer l’équité dans les temps de parole, j’autorise également M. Biwer à intervenir une seconde fois.
Vous avez la parole, monsieur Biwer.

M. Claude Biwer. J’ai entendu M. Paul Raoult tout à l’heure évoquer le cas, mais il doit être assez rare, d’une collectivité qui n’avait ni mairie ni cimetière. Chez moi, c’est l’inverse : il y a des communes sans habitant, mais avec des cimetières !
Exclamations.

L’idée de M. Raoult selon laquelle le SCOT doit être à la fois urbain et rural me convient bien : j’aurais aimé que ce principe soit inscrit, ne serait-ce que pour me défaire de cette arrière-pensée, sans doute un peu ridicule, dont je faisais état tout à l’heure.
Je voterai cet amendement, car je ne veux pas faire d’obstruction systématique, mais j’aurais aimé que la loi fixe un cadre qui, sans être complètement figé, afin de laisser une place aux élus, soit tout de même assez rigide. La nature humaine étant ce qu’elle est, les abus seront inévitables, ce qui pourra entraîner des contentieux.
Madame Didier, je voudrais à mon tour vous répondre. L’amendement de M. Emorine part d’un texte existant. Nous sommes bien d’accord, il s'agit de présenter l’articulation qu’il doit y avoir entre l’avant et l’après.
L’aspect important de cet amendement est qu’il prend en compte la réalité des territoires et leurs difficultés d’organisation selon leur degré d’urbanisation, selon qu’ils sont très urbains, urbains, périurbains ou ruraux. Les délais accordés pour mettre en place les SCOT ont été modulés en fonction de ces critères.
Les communautés d’agglomération et les communes du littoral ont déjà engagé la réflexion et disposent des outils d’ingénierie nécessaires, ce qui justifie l’échéance du 31 décembre 2012. Les délais sont différents pour l’échelon intermédiaire et pour les communes les plus rurales, évoquées par MM. Claude Biwer et Paul Raoult.
Monsieur le rapporteur, il est vrai que je suis nouvelle à mon poste
Sourires
Nous réfléchissons à la façon de respecter dans ce cadre les espaces naturels tout en optimisant le développement de l’économie. Le Grenelle nous encourage, par exemple, à développer la voie fluviale : comment organiser nos espaces économiques, comment requalifier les friches industrielles situées en bordure de fleuve pour atteindre cet objectif.
Vous avez raison, monsieur Braye, certains territoires s’en sortent car ils disposent de moyens d’ingénierie. Ce n’est pas le cas des territoires ruraux, qui ont quelquefois du mal à construire leur PLU ou un partenariat intercommunal. La logique d’un PLU intercommunal est de mutualiser les moyens humains au service des communes et de trouver des objectifs conjoints.
L’important est de fournir aux collectivités l’accompagnement financier nécessaire pour élaborer les SCOT. Monsieur le rapporteur, le Gouvernement a effectivement pris l’engagement de travailler sur cette question. Nous réfléchissons à des indicateurs applicables aux territoires ruraux peu peuplés, mais qui sont très étendus et dont les enjeux environnementaux sont importants, afin de les accompagner financièrement, dès 2010, à mettre en œuvre des SCOT.
Il ne faut pas opposer l’urbain et le rural. Un bassin de vie rural n’est pas forcément « sous le joug » d’un bourg-centre important qui lui impose ses vues. Un bassin de vie est un niveau de territoire pertinent pour de personnes qui, ensemble, y vivent, y travaillent et s’y déplacent. Tout le monde doit pouvoir y trouver son compte.
Le SCOT est un outil formidable qui est élaboré par les élus locaux eux-mêmes ; il est la synthèse de tous les points de vue dans l’intérêt général et dans celui de nos concitoyens. L’amendement de M. Jean-Paul Emorine permettra à toutes les communes qui le souhaitent, quelle que soit leur taille, d’en bénéficier.
L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.

L'amendement n° 301, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
de protection
insérer les mots :
de la biodiversité,
Cet amendement a été précédemment défendu par son auteur.
Quel est l’avis de la commission ?

Cet amendement porte sur le nouvel article L. 122-5-1, qui, rappelons-le, vise à renforcer les pouvoirs du préfet en matière de détermination des périmètres des SCOT afin de s’assurer que ces périmètres sont pertinents du point de vue de la conduite des politiques publiques.
À cet égard, je souhaite dissiper les inquiétudes de M. Raoult : si le périmètre proposé par les élus n’est pas pertinent, le préfet ne doit pas l’accepter. Voilà pourquoi il ne saurait y avoir de périmètre de SCOT non pertinent.
Le préfet, en vertu de cette procédure, peut ainsi demander la création d’un SCOT ou la modification du périmètre d’un SCOT déjà existant dès lors qu’il estime que l’absence de SCOT ou la définition non pertinente de son périmètre nuit gravement à la cohérence des politiques publiques.
C’est une procédure novatrice qu’il convient de saluer.
Monsieur Muller, faut-il ajouter le motif de protection de la biodiversité pour rendre cette procédure plus efficace ?
Il me semble que cette précision est inutile et pourrait même se révéler néfaste. D’ailleurs, la lecture précise des textes le montre. En effet, je rappelle que, aux termes du texte proposé pour l’article L. 122-1-5, le SCOT « détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger » et « précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ».
Comme vous pouvez le constater, mon cher collègue, votre préoccupation est déjà prise en compte. La commission ne peut donc émettre qu’un avis défavorable, à moins que vous ne consentiez à retirer votre amendement…
Le Gouvernement se contente donc d’émettre le même avis défavorable que la commission.

L’amendement n° 301 est retiré.
L'amendement n° 43, présenté par MM. Repentin, Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme, après le mot :
forestiers
insérer les mots :
et à la préservation et à la restauration des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l'espace
La parole est à M. Paul Raoult.

Cet amendement se justifie par son texte même. Toutefois, je tiens à préciser que notre ami Thierry Repentin y tient beaucoup.

Cet amendement vise à autoriser le préfet à demander la création d’un SCOT ou l’extension de son périmètre également pour les motifs de lutte contre l’étalement urbain et de rétablissement des continuités écologiques.
Cette préoccupation a déjà été prise en compte. Cependant, la répéter à cet endroit du texte peut ne pas être considéré comme une redondance. La commission a donc émis un avis favorable.
Les continuités écologiques traversent la plupart du temps de nombreux SCOT. Le maintien de ces continuités pose un problème de cohérence entre les SCOT auquel le préfet doit veiller et non un problème de périmètre de ces mêmes schémas de cohérence territoriale.
Toutefois, la possibilité de révision des périmètres ou leur extension peut jouer à titre d’exemple pour mieux organiser et structurer l’urbanisation en périphérie d’un SCOT.
Le Gouvernement s’en remet donc, sur cet amendement, à la sagesse du Sénat, une sagesse favorable, monsieur le président.
Sourires
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 50, présenté par MM. Repentin, Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
l'absence de schéma de cohérence territoriale
insérer les mots :
ou la juxtaposition de deux ou plusieurs schémas de cohérence dont un au moins concerne moins de 30 000 habitants
II. - Dans le même alinéa, après les mots :
cohérence territoriale
insérer les mots :
ou aux établissements publics prévus à l'article L. 122-4
III. - Après le troisième alinéa (2°) du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° soit de procéder à leur fusion conformément à la procédure prévue à l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales.
IV. - En conséquence, compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 122-5-2 du code de l'urbanisme par sept alinéas ainsi rédigés :
« ...° En cas de fusion, crée le nouvel établissement public.
« Dans ce cas, l'ensemble des biens, droits et obligations des syndicats mixtes fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion.
« L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les syndicats mixtes et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« La fusion est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
« L'ensemble des personnels des syndicats mixtes fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public.
La parole est à M. Daniel Raoul.

Cet amendement vise à combler un manque que nous constatons dans le texte : il s’agit d’introduire l’hypothèse de la fusion des syndicats mixtes de SCOT, notamment quand l’un des syndicats fusionnés compte moins de 30 000 habitants.
La procédure respecte les principes des articles L. 5711-2 et L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, que les syndicats mixtes peuvent suivre s’ils décident de fusionner volontairement.
Cette proposition permettrait de faciliter la tâche des syndicats et celle du préfet qui aurait constaté que la juxtaposition de plusieurs petits SCOT serait nuisible à la mise en cohérence des politiques publiques sur une même agglomération ou sur un même bassin de vie.
En commission, il nous a été reproché de créer un dispositif inutile. Après un examen plus approfondi – nous tenons en effet compte des remarques qui nous sont faites –, il semble bien que le projet de loi ne prévoie que la création ou l’agrandissement des périmètres de SCOT existants. Il y a pourtant un certain nombre de territoires, urbains notamment, où des syndicats mixtes de SCOT créés en pétale autour d’une agglomération centrale souhaiteraient fusionner. Or la tâche s’avère particulièrement difficile.
De même, il est désormais avéré que la création de petits SCOT a un effet catastrophique sur l’étalement urbain. Plusieurs études ont montré en effet que les petits SCOT avaient pour effet de repousser au-delà de leurs frontières, c’est-à-dire en troisième et quatrième couronnes des grandes villes, les projets de nouvelle urbanisation, ce qui étend les distances de déplacement et les mouvements pendulaires.
Depuis les lois de 1999 sur l’intercommunalité et de 2000 sur les SCOT, les territoires se sont organisés. Il faut donc en tirer les leçons. C’est pourquoi nous ne comprendrions pas, mes chers collègues, que vous refusiez d’accorder au préfet la possibilité de remédier aux situations compliquées en procédant à des fusions et que vous le contraigniez ainsi à obtenir des dissolutions pour envisager ensuite de nouvelles créations, procédures qui sont toujours beaucoup plus longues et fastidieuses.

Je ne suis pas convaincu de l’utilité de cette procédure, car il me semble que, dans sa rédaction actuelle, le texte proposé pour l’article L. 122-5-1 répond déjà au souci fort justement mis en avant par les auteurs de cet amendement.
En effet, la procédure de l’article L. 122-5-1 concerne non seulement la création de nouveaux SCOT, mais aussi l’extension du périmètre de SCOT déjà existants.

Cette procédure autorise également le préfet à demander à plusieurs SCOT de taille non optimale de réviser leur périmètre, ce qui ouvre la voie à leur fusion. Les SCOT ont donc déjà la possibilité de fusionner.
Pour toutes ces raisons, la commission est contrainte d’émettre un avis défavorable.
La fusion de SCOT est déjà possible en l’état actuel du droit.
S’il était adopté, cet amendement introduirait de nouvelles contraintes procédurales qui risqueraient de limiter les possibilités de fusion.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.

Nous avons déjà eu ce débat en commission, mais, je le répète, la procédure de fusion actuelle nécessite forcément la dissolution des syndicats mixtes. Notre objectif était donc de simplifier le dispositif et non de l’alourdir. En laissant le droit en l’état, c’est au moins un an de perdu !
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 190, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 122-5-2 du code de l'urbanisme, insérer une phrase ainsi rédigée :
À cette fin, le préfet notifie aux collectivités territoriales les raisons qui motivent son arrêté et fournit tout document utile aux collectivités pour qu'elles puissent se prononcer.
La parole est à Mme Évelyne Didier.

Une nouvelle fois, nous demandons que l’on respecte les élus. En effet, nous avons l’impression que la logique sous-jacente des articles que nous venons d’examiner est que les élus ne seraient pas capables de remplir leur rôle et que l’État devrait désormais intervenir pour apporter de la cohérence et de l’intelligence et non plus seulement un conseil ou un support technique. Au fond, c’est un acte de défiance à l’égard des élus.
Ici, le préfet, tel un maître d’école face à de mauvais élèves, peut imposer ou casser – au choix – la mise en place d’un SCOT et contraindre les élus à revoir leur copie.

Il est légitime que le préfet puisse inviter les collectivités territoriales à engager une étude d’opportunité de la réalisation d’un SCOT et à déterminer un périmètre favorable à un aménagement du territoire plus harmonieux, plus cohérent.
Nous estimons cependant qu’il serait au moins normal que le préfet motive sa demande, d’autant que le silence de la collectivité à l’expiration d’un délai de trois mois vaut accord de l’arrêté du préfet, alors même que ladite collectivité n’a souvent pas à sa disposition les moyens de conduire des expertises.
Prévoir que le préfet joint à l’arrêté tout document propre à justifier sa décision est donc pour nous une mesure de bon sens. Nous espérons, mes chers collègues, que cet amendement saura trouver votre agrément.
Cela étant, je reviens un instant sur le fameux amendement n° 264. Je l’ai voté au nom de mon groupe. Cependant, admettez que, si ce dispositif avait été inscrit directement dans le texte et non pas introduit au détour d’un amendement, nous aurions pu avoir une discussion plus approfondie. Heureusement, nous ne décidons pas ultima verba et le débat se poursuivra à l’Assemblée nationale.
Convenez également que ce processus favorisera peut-être la cohérence, mais qu’il se déroule en fin de compte au détriment de la démocratie.
Depuis des siècles, les communes sont des lieux forts de démocratie. Même lorsqu’elles sont petites, elles sont riches de débats et il s’y passe beaucoup de choses. Nous sommes peut-être en train de perdre ce qui faisait l’intérêt de la démocratie en France. Pourtant, jusqu’ici, on ne peut pas dire que les élus aient si mal réussi.

Madame Didier, si les élus prenaient des décisions totalement souhaitables et souhaités et allant dans l’intérêt de leurs administrés, cela se saurait depuis longtemps ! Toutes les cartes d’intercommunalités seraient pertinentes, nous n’aurions pas à déplorer les aberrations que l’on a constatées dans le Nord, les dépenses des collectivités locales seraient inférieures à celles que nous connaissons et les petits villages, qui sont par ailleurs sous-équipés, n’auraient pas tous leur salle des fêtes, pour ne prendre que cet exemple…
De grâce, ne prétendons pas que les élus agissent toujours bien. Je sais que nous sommes au Sénat et que nous sommes tous élus par les grands électeurs, mais un minimum de décence s’impose. Dans leurs discours, les élus disent toujours travailler pour l’intérêt général. Si tel était toujours le cas, ce serait le paradis, mais nous n’y sommes pas encore !

Cette chansonnette permanente est insupportable à entendre pour le rapporteur que je suis.

J’ai les pieds dans la réalité et je ne vis pas la même chose que vous.

Cela étant, l’article L. 122-5-1, en l’état, autorise le préfet à demander la délimitation ou l’extension du périmètre d’un SCOT en indiquant une liste précise de motifs susceptibles d’être invoqués à l’appui de cette demande. Cela prémunit les collectivités contre tout arbitraire de l’autorité administrative, puisqu’elles peuvent, le cas échéant, contester la décision du préfet devant le juge, qui vérifiera nécessairement si cette décision est correctement motivée.
Heureusement que le représentant de l’État est garant de la solidarité. D’ailleurs, notre collègue Daniel Raoul s’inquiétait lui-même du peu de pertinence de certains périmètres.
Je suis bien d’accord avec vous, ces périmètres se définissent souvent plus en fonction de la sympathie qu’éprouvent les élus entre eux que de l’intérêt des administrés !
Je voudrais tout d’abord indiquer à Mme Didier que l’intervention du préfet se limitera bien évidemment à des cas très exceptionnels de manquements graves à un certain nombre d’obligations sur un territoire pertinent. Ces mesures ne seront donc pas prises fréquemment, bien au contraire.
Je voudrais également rappeler que, aux termes de cet article, le préfet « demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale et aux communes non membres d’un tel établissement, susceptibles d’être concernés » de déterminer ce périmètre. Il s’agit non pas d’une injonction, mais bien d’une concertation afin d’essayer de trouver une solution si l’absence de SCOT nuit à la mise en place d’obligations fondamentales pour l’intérêt général.
Le Gouvernement considère que l’article L. 122-5-1 contient déjà implicitement les éléments qui fondent la motivation du préfet de délimiter ou d’étendre le périmètre du SCOT. La motivation de la décision du préfet est également implicite et n’a pas à être mentionnée dans la loi. Quand le préfet en vient à prendre une telle mesure, il la motive par la force des choses auprès des élus locaux concernés.
Je souligne une nouvelle fois que le dispositif prévu par le texte prévoit d’informer et de consulter les élus locaux.

J’apprécie les explications qui ont été données par Mme la secrétaire d’État et je retire l’amendement.
Cependant, je ne peux pas laisser passer les propos de M. Braye. Nous avons tous ici des convictions et nous les défendons.

Pas du tout ! Il s’agit d’une conviction que j’ai toujours défendue. Vous le savez, pour m’avoir déjà entendue sur ce sujet en d’autres occasions !
En tout cas, dans les petites communes, on ne fait peut-être pas tout comme il le faut, mais on fait beaucoup de choses. Ce sont les élus qui portent les colis, distribuent les repas aux anciens, transmettent l’information ! Si vous tuez ce bénévolat extraordinaire, la démocratie régressera !

L'amendement n° 190 est retiré.
L'amendement n° 90, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 122-5-3 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
peut prendre l'initiative de proposer
par les mots :
peut proposer
La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.

Il nous semble utile de remplacer la formule « peut prendre l’initiative de proposer » par « peut proposer ».
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 91, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Au début de la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 122-5-3 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
Le cas échéant,
La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.

Il nous paraît préférable de supprimer l’expression « le cas échéant » pour que le préfet motive son refus dans tous les cas.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 236, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après le 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 122-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale en fait la demande, le président de l'établissement public lui notifie le projet de schéma afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. »
La parole est à M. Paul Raoult.

L'un des apports intéressants du projet de loi est constitué par l'évolution du SCOT, qui intègre la préoccupation de la création de logements et de la mixité sociale, le renforcement des liens entre les transports publics et l’urbanisation, la réduction de la consommation d'espaces. Le SCOT répartira les objectifs en matière de logement, par EPCI ou par commune.
Dans ces conditions, il est plus que jamais nécessaire de permettre la consultation des représentants des organismes de logement social dans le cadre de l'élaboration des SCOT.
Lors de la loi SRU, l'association ou la consultation de toutes les parties prenantes a été prévue, soit directement, soit indirectement, comme professionnels adhérents d'instances consultées, chambre de commerce et d’industrie, chambre de métiers ou d'agriculture.
Or le secteur HLM, n'entrant dans aucune de ces catégories, a été oublié. Alors que les opérateurs du logement social sont très concernés par les politiques foncières et d'urbanisation, et le seront encore plus dans le cadre de la présente loi, ils sont les seuls à ne pas pouvoir s'exprimer.
Cette erreur a été réparée, lors de la loi ENL, pour les PLU mais non pour les SCOT. Nous vous demandons, mes chers collègues, de remédier à cet oubli.

À l’article L. 122-7, il est prévu que le président de l’organisme en charge d’un SCOT puisse consulter toute personne compétente en matière d’habitat, ce qui inclut les représentants des organismes de logement social. Si l’on souhaite aller plus loin et prévoir que cette consultation ait lieu sur la demande des représentants des organismes de logement social, c’est l’article L. 121-4 et non l’article L. 122-7 qu’il faudrait modifier.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable. Elle aurait émis le même avis, je vous le dis franchement, si votre proposition avait porté sur le bon article
Sourires

La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote sur l’amendement n° 236.

Le territoire d’un SCOT peut couvrir une grande diversité d’habitats, avec des secteurs où il y a des logements sociaux et d’autres où il n’y en a pas.
Ceux qui piloteront les SCOT ne seront peut-être pas toujours sensibles aux logements sociaux. Il me paraît donc important que leurs représentants soient pleinement partie prenante de la réflexion. Si leur consultation est nécessaire, mieux vaut l’inscrire dans la loi. Je ne comprends pas votre refus.

Monsieur Raoult, il faut produire des documents pour établir un SCOT, notamment un rapport de présentation, un diagnostic, etc. Il est évident que le SCOT prend en compte toutes les problématiques d’un territoire. Je ne vois pas les élus d’un territoire, chargés d’établir le SCOT, ne pas se soucier d’une dimension essentielle de la vie de leurs administrés. C’est impossible !
De toute façon, toutes les problématiques sont posées à partir d’études. Vous savez bien que le logement est l’un des problèmes majeurs auquel sont actuellement confrontés les élus, sauf peut-être dans de rares territoires en voie de dépeuplement.
Ceux qui établissement les SCOT sont là pour répondre le mieux possible à toutes les problématiques concernant la vie de leurs administrés ; le logement en est un élément essentiel.
Tout en étant d’accord avec vous sur le fond, monsieur Raoult, il ne nous paraît pas utile d’apporter cette précision dans la loi, pour les raisons qui ont été dites par M. Braye.
Vous le savez, l’une des grandes thématiques du SCOT, c’est la politique de l’habitat. Il s’agit d’en définir les grandes orientations.
Des commissions thématiques sont prévues pour mettre en relation les techniciens, l’ingénierie du SCOT, les élus locaux et les acteurs de la politique de l’habitat : bailleurs sociaux, bailleurs privés, établissements publics fonciers, tous ceux qui contribuent à élaborer une politique de l’habitat sur un territoire de référence. Elles ont pour objet d’associer les partenaires extérieurs, tous ceux qui jouent un rôle auprès du SCOT.
Par conséquent, compte tenu des conditions d’élaboration du schéma de cohérence territoriale, dont l’habitat est une thématique centrale, les bailleurs sociaux seront associés, et ce quelle que soit la nature – urbaine ou rurale – du territoire.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 92, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Au 5° du I de cet article, remplacer les mots :
la densification des
par les mots :
l'optimisation de l'usage des sols dans les
La parole est à M. Dominique de Legge, rapporteur pour avis.

Cet amendement, au-delà de sa dimension rédactionnelle, vise à poser un problème de fond.
Nous sommes tous d’accord, nos débats en témoignent, sur l’urgente nécessité de limiter l’étalement urbain. Le consensus qui prévaut sur cette question s’est exprimé à maintes reprises.
On peut s’interroger à l’infini sur la valeur juridique des termes « densification » et « optimisation ». En cas de contentieux, lequel est le plus clair, comment mesure-t-on l’un et l’autre ? Certes, le premier a plutôt une dimension quantitative et le second une dimension qualitative. Au fond, je crois que nous cherchons tous un résultat à la fois quantitatif et qualitatif.
Je voudrais également indiquer que les espaces n’ont pas tous la même valeur et que, par conséquent, la notion même de densification doit être modulée selon une approche très pragmatique des sols.
L’élu rural que je suis ne veut pas, par ce propos, attiser la crainte exprimée par un certain nombre de collègues que le Grenelle II ne signe la mort du milieu rural.
Si la commission des lois a évoqué ce problème, madame la secrétaire d’État, c’est parce qu’elle veut entendre l’interprétation que donne le Gouvernement du terme « densification ».
Pour citer l’exemple de ma commune de 1 500 habitants, j’ai essayé, à la faveur d’un PLU, de boucher des dents creuses dans un hameau. On m’a répondu que ce n’était pas de la densification et qu’il valait mieux construire les logements prévus dans la ville de Vitré, dotée de moyens de transports. Je comprends donc l’inquiétude des élus locaux.
Par cet amendement, madame la secrétaire d’État, nous souhaitons ouvrir le débat. Nous voulons nous assurer qu’il y a un avenir pour le milieu rural et pour l’ensemble de nos territoires, mais surtout que vos services auront une interprétation très pragmatique de cet article.

La commission de l’économie a eu une très longue discussion avec la commission des lois sur cette question, qui suscite l’inquiétude des élus ruraux, et je remercie notre collègue Dominique de Legge d’avoir ouvert le débat sur ce sujet.
Madame la secrétaire d’État, vous devez répondre au souci que notre collègue a relayé, écho de cette ruralité fortement représentée au Sénat et que nous souhaitons conserver. Par cohérence, je précise que la commission de l’économie souhaite naturellement conserver le terme « densification », qui figure de nombreuses fois dans le projet de loi.
Je ne doute pas que, sur l’interprétation du terme « densification », le Gouvernement donnera à M. le rapporteur pour avis les assurances lui permettant de retirer cet amendement.
Monsieur le rapporteur pour avis, de votre point de vue, il importe qu’un critère qualitatif soit retenu dans la lutte contre l’étalement urbain. Cependant, M. le rapporteur l’a souligné, la notion de densification, qui est utilisée dans ce projet de loi, est plus connue, plus précise et donc plus facile à mettre en œuvre que celle d’optimisation de l’usage des sols. Elle nous paraît donc plus opportune.
Certes, la notion de densification peut faire débat, laissant croire que seule compte la densité d’habitat, alors que cela peut ne pas correspondre à la réalité de certains territoires ruraux.
C’est pourquoi le Gouvernement s’engage à donner des instructions pour que les services compétents fassent œuvre de pédagogie et apprécient intelligemment, en fonction du contexte local, l’interprétation à donner à cette notion.
Il existe des outils à destination des services mais aussi des collectivités, par exemple des guides méthodologiques, permettant de mettre en œuvre ces nouvelles mesures et ces nouvelles orientations en tenant compte des spécificités des territoires.
Densifier une dent creuse sur un territoire rural peut avoir tout son sens. Ce n’est pas du mitage, c’est même tout le contraire ! Il s’agit d’optimiser des espaces, des interstices sur des zones qui ont déjà été construites et aménagées.
Il va de soi que les services de l’État seront aux côtés des élus qui construisent un schéma de cohérence territoriale et sont amenés à modifier l’espace. Pour apprécier la façon dont sont densifiés ces espaces, ils prendront bien évidemment en considération le fait que ce territoire n’est pas une ville de 100 000 habitants !
Je le répète, je m’engage, au nom du Gouvernement, à faire en sorte que l’on prenne toute la mesure des attentes des élus locaux et que l’on tienne compte de la réalité du terrain.

Compte tenu de la réponse de Mme la secrétaire d'État, je retire cet amendement, monsieur le président.

L'amendement n° 92 est retiré.
L'amendement n° 240, présenté par MM. Repentin et Raoul, Mme Herviaux, MM. Raoult, Ries, Teston, Guillaume et Muller, Mme Blandin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Au 5° du I de cet article, après les mots :
la préservation
insérer les mots :
ou la remise en bon état
La parole est à M. Paul Raoult.

Nous avons déjà eu ce débat en commission, mais le sujet mérite qu’on y revienne.
Il s'agit d’introduire la notion de remise en bon état des continuités écologiques. Certes, j’ai bien conscience que cette notion peut déranger, mais elle s’inscrit dans le cadre de l’objectif des trames bleue et verte, qui est de préserver. En effet, il arrive que les dégâts subis par la nature soient réparables et que les modifications ne soient pas irréversibles.
Ainsi, on peut retirer les remblais ou les terres d’une zone humide, pour que celle-ci puisse à nouveau reprendre sa fonction d’éponge et de filtre et alimenter correctement la nappe phréatique sous-jacente.
Prévoir dans le texte « la préservation ou la remise en état des continuités écologiques » me paraît un objectif nécessaire pour que les trames bleue et verte fonctionnent correctement. Certes, on ne saurait tout réparer, mais si, dans certains endroits, c’est possible, il serait dommage de ne pas l’indiquer.

Les SCOT doivent fixer des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, mais aussi préciser les modalités de protection des espaces nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état de ces continuités.
Par symétrie et cohérence, si le préfet peut s’opposer à un SCOT au motif qu’il comprend des dispositions insuffisantes en matière de préservation des continuités écologiques, il semble qu’il devrait aussi pouvoir s’y opposer quand le SCOT ne prévoit pas des dispositions suffisantes en ce qui concerne la remise en bon état de ces continuités.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 191, présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mmes Schurch, Terrade et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer le 8° du I de cet article.
La parole est à Mme Évelyne Didier.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des positions que nous avons défendues jusqu’à présent.
Nous nous opposons à la substitution du préfet aux collectivités territoriales pour la mise en compatibilité du SCOT avec des normes d'urbanisme supérieures. Une telle disposition est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Bien entendu, les collectivités doivent se conformer à la loi. Il n’en reste pas moins que, si le préfet peut leur adresser une mise en demeure ou faire en sorte que les décisions soient appliquées, il ne peut se substituer à elles.

L'amendement n° 93, présenté par M. de Legge, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Au début du premier alinéa du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article L. 122-15-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
doit être révisé
par les mots :
est révisé
La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Dans la hiérarchie des normes, les dispositions des lois montagne et littoral s’imposent aux SCOT.
Si un SCOT n’est pas compatible avec ces dispositions, il doit être modifié. C’est le rôle du préfet de veiller au respect de cette hiérarchie. Jusqu’à nouvel ordre, la France est un État décentralisé, mais aussi unitaire. Il est donc essentiel que les réglementations locales respectent les lois nationales. Le préfet doit pouvoir se substituer à l’élu qui voudrait s’y soustraire.
Ce mécanisme est nécessaire à l’application des normes fondamentales du droit de l’urbanisme. Il est dissuasif mais aussi efficace à l’encontre des collectivités qui ne respecteraient pas ces normes. Il existe d’ailleurs déjà pour les plans locaux d’urbanisme. Par ailleurs, il s’applique aux projets d’intérêt général et permet donc de mettre en œuvre des directives territoriales d’aménagement et de développement durable, puisque ces dernières ne peuvent être transcrites que par un projet d’intérêt général.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
L'article 9 est adopté.
Le troisième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de cet article, il vérifie en particulier que le projet d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d'un schéma de cohérence territoriale limitrophe de la commune d'implantation, du fait, notamment, des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu'il génère. –
Adopté.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt-et-une heures quarante-cinq.