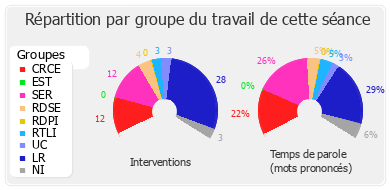Séance en hémicycle du 12 février 2019 à 21h45
Sommaire
- Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice – renforcement de l'organisation des juridictions
- Mise au point au sujet d'un vote (voir le dossier)
- Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice – renforcement de l'organisation des juridictions (voir le dossier)
- Ordre du jour (voir le dossier)
La séance
La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt et une heures quarante, sous la présidence de Mme Valérie Létard.

La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, de programmation 2018–2022 et de réforme pour la justice et du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif au renforcement de l’organisation des juridictions.
Dans la discussion du texte de la commission sur le projet de loi, nous en sommes parvenus à l’article 30.
Sous-section 2
Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire
I. –
Non modifié
II. –
Non modifié
« Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l’étendue du territoire national, à l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction. Ils sont tenus d’être assistés d’un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l’officier de police judiciaire de ce transport. »
II bis. – Après l’article 20-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :
« Art. 20 -2. – Les sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils sont appelés pour occuper un poste comportant cet exercice. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. »
II ter. – À la fin du 1° bis de l’article 21 du code de procédure pénale, la référence : « l’article 20-1 » est remplacée par les références : « les articles 20-1 et 20-2 ».
III. –
Non modifié
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« D’office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire.
« Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la République, procéder à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article 41-1. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d’exercer leur fonction, ce serment n’a pas à être renouvelé en cas de changement d’affectation. »
IV. –
Non modifié
IV bis. –
Non modifié
V et VI. –
Non modifiés
VI bis A. –
Non modifié
1° À la première phrase du premier alinéa des articles 60-1 et 77-1-1, après le mot : « numérique, », sont insérés les mots : « le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 60-1, les mots : « dans les meilleurs délais à cette réquisition » sont remplacés par les mots : « à cette réquisition dans les meilleurs délais et s’il y a lieu selon les normes exigées ».
VI bis. –
Non modifié
VI ter. –
Non modifié
« Art. 365 -1. – Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République, par un agent des douanes dans les conditions déterminées à l’article 390-1 du code de procédure pénale. »
VII. –
Non modifié

L’amendement n° 54, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.

Nous proposons la suppression de cet article, car il marque une fois de plus un recul des prérogatives judiciaires. En effet, l’article 30 prévoit de simplifier la procédure d’habilitation des officiers de police judiciaire, de faciliter leur circulation sur le territoire national, d’étendre les compétences des agents de police judiciaire, de supprimer l’autorisation du procureur de la République pour certaines réquisitions, ainsi que l’obligation de prêter serment.
Non seulement cet article prévoit le recul des compétences des magistrats en matière de maîtrise de l’enquête, mais il s’inscrit dans une perspective d’économies budgétaires en supprimant l’obligation de compétence territoriale de l’officier de police judiciaire. Ainsi, non seulement on supprime une nouvelle fois un lien de proximité, mais, en plus, on renforce la charge de travail des officiers de police judiciaire, qui seront désormais opérationnels sur l’ensemble du territoire national.
Nous regrettons encore une fois que la majorité sénatoriale ait mis de côté son souci affiché de défendre l’institution judiciaire.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Dans le cadre de la simplification de la procédure d’habilitation des officiers de police judiciaire et de la facilitation de leurs déplacements sur le territoire, les assouplissements prévus par le texte sont intéressants, car ils facilitent le travail des enquêteurs.
La commission ayant déjà émis en première lecture un avis favorable sur le projet du Gouvernement sur ce point-là, elle émet ce soir un avis défavorable sur l’amendement de suppression de l’article.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 30 est adopté.
I. – Le II de l’article 63 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire » ;
2°
Supprimé
3° La dernière phrase du même dernier alinéa est supprimée.
I bis. –
Non modifié
II. –
Supprimé
III. –
Non modifié
« Art. 706 -112 -1. – Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S’il est établi que la personne bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, l’officier ou l’agent de police judiciaire avise s’il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles.
« Si la personne n’est pas assistée d’un avocat ou n’a pas fait l’objet d’un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l’existence d’une mesure de protection juridique.
« Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
« Art. 706 -112 -2. – Lorsque les éléments recueillis au cours d’une procédure concernant un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement font apparaître qu’une personne devant être entendue librement en application de l’article 61-1 fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise par tout moyen le curateur ou le tuteur, qui peut désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister la personne lors de son audition. Si le tuteur ou le curateur n’a pu être avisé et si la personne entendue n’a pas été assistée par un avocat, les déclarations de cette personne ne peuvent servir de seul fondement à sa condamnation. »
IV. –
Non modifié

L’amendement n° 84 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Mézard, Collin et Corbisez, Mme Jouve et MM. Labbé, Menonville, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Cet amendement vise à maintenir le droit en vigueur et à conditionner la prolongation d’une garde à vue à la présentation au procureur de la personne concernée, en l’absence d’éléments de nature à prouver qu’il s’agit là d’un formalisme excessif. L’étude d’impact précisait que cette option avait été écartée, car elle était excessive.
Elle s’appuyait sur le rapport de MM. Beaume et Natali, rendu dans le cadre des chantiers de la justice : « les institutions nationales, en particulier les diverses Conférences, restent attachées à la formalisation d’un contrôle du parquet dès 24 heures, en particulier s’agissant de procédures à très fort enjeu répressif. Elles rappellent au surplus, comme celles des juridictions qui n’y sont pas favorables, que ce renouvellement constitue pratiquement la première occasion obligatoire d’un véritable compte rendu au parquet sur le déroulement de l’enquête ».
Au-delà de vingt-quatre heures, la privation de liberté nécessite que l’intéressé puisse valablement présenter ses observations au magistrat sous le contrôle duquel cette mesure est mise en œuvre.
Rappelons que le procureur de la République est garant de la bonne tenue d’une garde à vue et que le parquet doit répondre de ses enquêtes. La suppression de cette obligation risque d’entraîner une prolongation de la garde à vue chaque fois que le service enquêteur le juge utile, sans véritable contrôle par l’autorité judiciaire.
C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à maintenir le droit en vigueur et à conditionner la prolongation d’une garde à vue à la présentation au procureur de la personne concernée, étant rappelé que cela n’induit pas un formalisme excessif ni des contraintes particulières.

La commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’objet de l’amendement vise l’obligation de présentation au procureur pour la prolongation de la garde à vue.
Sur ce point, les auteurs de l’amendement ont satisfaction, puisque nous avons souhaité maintenir dans le texte de la commission cette obligation de présentation.
Le dispositif de l’amendement vise cependant un sujet un peu différent, puisqu’il concerne la possibilité de prolonger la garde à vue au-delà de vingt-quatre heures à fin de présentation au procureur.
Admise par la jurisprudence, cette faculté serait inscrite dans la loi. Il nous semble qu’elle tient compte de la réalité des conditions de fonctionnement des juridictions, et nous l’avions acceptée en première lecture.
L’avis du Gouvernement est également défavorable.
Si nous considérons que la présentation de la personne gardée à vue ne peut être que facultative pour le renouvellement de la mesure, nous jugeons en revanche nécessaire que la personne soit effectivement présente au moment du placement initial.
Le caractère facultatif de la présentation pour une prolongation correspond à une demande formulée par de très nombreux acteurs du monde judiciaire.

Non, le rapporteur m’a convaincue : je le retire, madame la présidente.
L ’ article 31 est adopté.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La victime est informée du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. À l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 15-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d’être assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique. » ;
3° L’article 61-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « victime est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l’audition ou ». –
Adopté.
Section 2
Dispositions propres à l’enquête
Sous-section 1
Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs
I. – L’article 53 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, si la procédure porte sur un crime ou sur une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1, pendant une durée de seize jours » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut, à l’issue du délai de huit jours prévu au deuxième alinéa du présent article, autoriser, par décision écrite et motivée, la prolongation de l’enquête, dans les mêmes conditions, pour une durée maximale de huit jours s’il s’agit d’un délit puni d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement. »
I bis. – L’article 56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut être assistée de son avocat. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ».
II. –
Non modifié
III. –
Supprimé
IV. – Après le III de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d’eau.
« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
« Elle comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
« La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
« Un procès-verbal de fouille est établi et contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une copie est immédiatement remise.
« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée. »
IV bis. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
V. – Après l’article 802-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 802-2 ainsi rédigé :
« Art. 802 -2. – Toute personne ayant fait l’objet d’une perquisition ou d’une visite domiciliaire en application des dispositions du présent code et qui n’a pas été poursuivie devant une juridiction d’instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l’accomplissement de cet acte peut, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le président de la chambre de l’instruction d’une demande tendant à son annulation.
« La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou, à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure. Elle n’a aucun effet suspensif sur les enquête ou instructions en cours.
« Le juge statue, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. Si les nécessités de l’enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au président de la chambre de l’instruction de se prononcer dans un délai de huit jours. Le juge statue par une ordonnance motivée susceptible d’appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la chambre de l’instruction.
« Si la perquisition est intervenue à l’occasion d’une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l’encontre d’autres personnes que celle ayant formé la demande d’annulation, lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, la demande d’annulation est transmise au président de cette juridiction par le président de la chambre de l’instruction.
« Dans le cadre des recours examinés conformément aux troisième et avant-dernier alinéas, le requérant ne peut prétendre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu’il conteste. »
VI. – L’article 63 ter du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la visite concerne le domicile ou le cabinet d’un avocat, il est fait renvoi à l’article 56-1 du code de procédure pénale et le même article 56-1 est applicable. »
VII. – Au troisième alinéa du b du 2 de l’article 64 du code des douanes, au troisième alinéa du b du 2 de l’article 41 du code des douanes de Mayotte, à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, au dernier alinéa du III de l’article L. 16 B et au dernier alinéa du 3 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa ».

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il convient de déplorer l’élargissement des modalités de l’enquête de flagrance prévu par le présent article. Cette évolution sera attentatoire aux libertés en raison des pouvoirs exorbitants de contrainte de la police en matière d’enquête de flagrance.
La prolongation de huit jours supplémentaires de la flagrance, autrefois réservée aux délits punis de cinq ans d’emprisonnement, sera élargie aux délits punis de trois ans d’emprisonnement, soit quasiment tous les délits donnant potentiellement lieu à la flagrance, notamment le vol simple.
Cette disposition, source de difficulté, causera l’affaiblissement des droits des justiciables. Il en sera de même pour ce qui concerne la faculté des enquêteurs de perquisitionner sans assentiment en matière d’enquête préliminaire pour les délits punis de trois ans de prison.
Cela constitue un élargissement dangereux des pouvoirs de contrainte de la police, en absence d’urgence, et cette mesure sera généralisée de surcroît à presque tous les délits !
Dans la même logique, il est dangereux d’élargir les pouvoirs de contrainte des services d’enquête dans le cadre de la flagrance, ceux-ci étant en principe réservés et strictement limités temporellement. On peut citer, par exemple, la possibilité donnée en matière d’enquête préliminaire de procéder à des interpellations domiciliaires, à la demande du parquet, ce qui n’était possible que dans le cadre d’un mandat de recherche.
Un tel projet illustre la volonté gouvernementale de déséquilibre des pouvoirs accordés aux autorités, au détriment des droits des individus et de leur vie privée, ainsi que de celle de leurs proches, alors même qu’ils sont à ce stade de simples suspects. Et cela vaudra y compris en l’absence d’urgence.
L’extension dangereuse de mesures de contrainte de la police en phase d’enquête préliminaire est critiquable, de même que la logique sécuritaire de faire des exceptions un principe, en abaissant les libertés individuelles.
C’est pourquoi je voterai les amendements socialistes sur ce sujet.

L’amendement n° 55, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.

Nous pensons qu’en matière pénale ce texte marque un recul de la place du juge d’instruction et des droits de la défense.
Il octroie aux policiers, sans garde-fou, des pouvoirs d’écoute, de géolocalisation et de perquisition pour une multitude de délits qui n’ont rien à voir avec le grand banditisme ou le terrorisme.
Il fait ainsi entrer encore davantage l’état d’urgence dans l’État de droit.
La justice repose sur le principe de la balance entre l’accusation et la défense. Sans équilibre, vous n’avez plus de justice. C’est la conception même de cette dernière qui est menacée, comme cela a déjà été plusieurs fois indiqué, en particulier lors de l’examen des articles 28 et 29.
L’article 32 étend le pouvoir des enquêteurs par l’intégration dans le droit commun des dispositifs actuellement prévus pour la seule poursuite des délits qui encourent une peine de prison de plus de cinq ans et les infractions de terrorisme ou de criminalité organisée.
Les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l’enquête de flagrance, qui sont justifiés par un crime ou un délit qui vient d’être commis, n’ont aucune raison d’être étendus à un autre cadre juridique.
Alors qu’une réflexion sur la restriction de ce régime dérogatoire de l’enquête de flagrance à une durée strictement limitée à l’urgence serait nécessaire, le projet de loi prévoit au contraire l’extension et la banalisation de ce dispositif par deux moyens.
Il étend, premièrement, la durée de la flagrance à seize jours lorsque la procédure porte sur un crime de droit commun ou sur une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale concernant la criminalité organisée.
Il étend, deuxièmement, la possibilité de prolongation de l’enquête de flagrance à l’ensemble des infractions punies de trois ans d’emprisonnement ou plus, la formulation de la disposition et la confusion de l’étude d’impact ne permettant pas d’exclure tout à fait formellement une application aux crimes de droit commun et aux infractions prévues par les articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, ce qui porterait dans ce cas le délai maximal à vingt-quatre jours.
C’est pourquoi nous souhaitons la suppression de cet article particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales, alors que, en parallèle, une réduction sensible de l’autorité judiciaire est à l’œuvre.

La commission est défavorable à la suppression de l’article 32. Elle souhaite s’en tenir au texte qu’elle a adopté en première lecture, notamment parce que nous avons veillé à mieux encadrer la procédure d’enquête de flagrance et que nous avons renforcé les droits de la défense en matière de perquisition.
J’émets également un avis défavorable sur cet amendement.
En m’appuyant sur votre présentation, madame Assassi, je souhaite toutefois apporter trois précisions.
Premièrement, dans le texte, les moyens d’action du parquet sont renforcés, je ne le nie pas. Je rappelle toutefois, de nouveau, que les membres du parquet sont des magistrats. En tant que tels, ils sont garants des libertés individuelles, ils ne reçoivent aucune instruction individuelle et, bien entendu, ils enquêtent à charge et à décharge.
Deuxièmement, les dispositions de l’article 32 ne me semblent pas porter une atteinte disproportionnée aux libertés publiques et fondamentales. Elles tendent au contraire à renforcer le contrôle judiciaire. Ainsi, la perquisition doit être autorisée par un juge des libertés et de la détention, ou JLD, qui exerce des fonctions spécialisées. En outre, dans ce type de situations, le procureur doit évidemment prendre une décision écrite et motivée, par exemple lorsqu’il prolonge l’enquête de flagrance. Je pourrais encore citer d’autres exemples qui vont dans le sens d’un renforcement des libertés fondamentales.
Enfin, troisièmement, le but du projet de loi n’est absolument pas de limiter les pouvoirs du juge d’instruction, mais au contraire de donner à celui-ci les moyens de se recentrer sur les instructions qui ont une véritable importance et qui nécessitent fondamentalement son intervention, notamment les affaires criminelles.

Madame la ministre, comment gérer la pénurie ? Nous sommes là au cœur de la question.
On veut cantonner le juge d’instruction à quelques matières, mais, dans peu de temps, il disparaîtra. Quant au juge des libertés et de la détention, son existence est encore très éphémère : il est surchargé, et ce n’est pas un juge assisté d’un greffier et disposant d’un cabinet.
Madame la garde des sceaux, vous avez lu, sans doute encore plus attentivement que moi, le rapport sur l’attractivité du parquet qui vous était destiné. Il relève une vraie difficulté. Les procureurs et leurs substituts n’ont pas le temps de répondre à toutes les exigences que vous voulez leur imposer. Nous sommes donc dans du formalisme apparent et il s’agit, en réalité, de renforcer les pouvoirs de la police, sans contrôle judiciaire.
L’encadrement de la flagrance devrait, a priori, selon moi, rester en l’état. Je soutiendrai donc l’amendement présenté par Mme Assassi et je présenterai ensuite, dans le droit fil du travail effectué avec la commission des lois, plusieurs amendements de repli tendant à supprimer certains alinéas de l’article 32.
Ces dispositions posent un vrai problème et renvoient à une évolution dangereuse que l’on observe dans différents domaines depuis quelque temps. Comment pouvons-nous encore sauvegarder notre État de droit ? C’est un vrai sujet pour nous, ici, au Sénat, sur lequel nous devons nous battre, car d’autres textes nous seront soumis prochainement. On peut comprendre la pression qui pèse sur un gouvernement face aux manifestations et au développement de la délinquance, mais on ne devrait jamais agir au mépris de l’État de droit. Lorsque ce dernier est remis en cause, le pire peut arriver. Et, selon certains, nous ne sommes pas très loin du pire…
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 32, présenté par MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jacques Bigot.

En 1999 – ce n’est pas si lointain –, le législateur s’est prononcé pour la première fois sur la question du temps de flagrance, en le limitant à une durée maximale de huit jours.
Afin de prendre en considération la continuité des actes d’enquête, la loi du 9 mars 2004 a prévu la possibilité d’une prolongation de l’enquête de huit jours supplémentaires par le procureur de la République pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement.
Désormais, le présent projet de loi envisage l’allongement à seize jours pour un crime de droit commun ou une infraction prévue par les articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, ces derniers visant les crimes organisés, et à huit jours pour les infractions punies de trois ans d’emprisonnement.
Cette extension de durée renforce donc la complexité, la création de deux régimes relatifs à des délits de flagrance ne simplifiant pas le travail des procureurs et des services d’enquête.
La seule solution nous semble être de fixer une durée limitée de l’enquête de flagrance. C’est la raison pour laquelle nous proposons, à travers l’amendement n° 32, de supprimer les alinéas 1 à 4 de l’article 32. Subsidiairement, l’amendement n° 34 vise à supprimer les seuls alinéas 3 et 4.
Nous aurions ainsi un dispositif plus équilibré, les rapporteurs eux-mêmes s’étant interrogés dans leur rapport sur « la pertinence de l’extension, non négligeable, des durées prolongées de l’enquête de flagrance, dès lors qu’elle semble de moins en moins caractérisée par l’urgence, de moins en moins placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire et susceptible de concerner la quasi-totalité des délits, même mineurs ».
Nous sommes très éloignés de la jurisprudence constitutionnelle sur le contrôle qui doit être exercé par l’autorité judiciaire. Comme il est indiqué dans le rapport, on ne pourra envisager un réel contrôle que lorsque le procureur de la République sera vraiment indépendant et qu’il disposera des moyens adéquats, contrairement à aujourd’hui. Il conviendrait également que le juge des libertés et de la détention dispose de moyens plus importants.

L’amendement n° 33, présenté par MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
sur un crime ou
La parole est à M. Jacques Bigot.

L’amendement n° 34, présenté par MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jacques Bigot.

L’avis de la commission est défavorable sur ces trois amendements.
S’agissant de l’amendement n° 32, l’allongement du délai de l’enquête de flagrance proposé pour les crimes nous avait paru acceptable en première lecture compte tenu de la brièveté du délai de droit commun de huit jours, souvent insuffisant pour mener à bien les enquêtes. Nous vous proposons de confirmer cette position, mes chers collègues.
Les dispositions de l’amendement n° 33 prévoient d’aller encore plus loin que la position adoptée par le Sénat en première lecture concernant la durée de l’enquête de flagrance, qui ne pourrait être prolongée pour les crimes.
Il nous semble que les crimes sont, par nature, des infractions suffisamment graves pour justifier que l’enquête de flagrance puisse durer seize jours. Il ne serait pas cohérent que cette durée soit admise pour certains délits, mais pas pour des crimes.
Enfin, l’amendement n° 34, également relatif à l’enquête de flagrance, appelle le même commentaire que l’amendement n° 32 : nous proposons d’en rester à la position équilibrée que le Sénat avait retenue en première lecture, laquelle nous paraît garantir les droits des uns et des autres.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 35, présenté par MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jacques Bigot.

Madame la ministre, vous avez confié à plusieurs éminentes personnalités le soin de travailler sur les chantiers de la justice. Dans leur rapport sur les chantiers de la procédure pénale, Jacques Beaume et Frank Natali estiment que les perquisitions ne devraient être autorisées dans le cadre d’une enquête préliminaire que pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans, et non de trois ans. Or le texte du Gouvernement comme celui de la commission admettent le seuil de trois ans.
Dans votre rapport, vous jugez que cette disposition semble « poursuivre un mouvement ancien tendant à la marginalisation du juge d’instruction et à l’extension progressive des mesures coercitives dans le cadre des enquêtes. » Allez jusqu’au bout de cette logique, monsieur le rapporteur ! Suivez l’avis des éminents rédacteurs du rapport sur les chantiers de la procédure pénale et donnez un avis favorable à notre amendement, qui tend justement à supprimer l’alinéa 9 de l’article 32 pour que la perquisition sans assentiment ne puisse avoir lieu que pour les délits punis d’une peine de cinq ans ou plus d’emprisonnement.

La commission des lois maintient sa position adoptée en première lecture. Elle a accepté l’abaissement du seuil de cinq ans à trois ans d’emprisonnement pour les perquisitions contraintes, en enquête préliminaire, ce qui répond à une attente des services enquêteurs, mais en l’assortissant de garanties renforcées.
En conséquence, son avis est défavorable.
Il est également défavorable. Je rappelle en outre qu’une autorisation systématique préalable du JLD est requise.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 32 est adopté.

La parole est à Mme Sophie Joissains, pour une mise au point au sujet d’un vote.

Madame la présidente, lors du scrutin n° 48 portant sur l’amendement n° 177 rectifié, à l’article 44 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, M. Hervé Maurey a été déclaré comme votant contre, alors qu’il souhaitait s’abstenir.

Acte vous est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

Dans la suite de la discussion du texte de la commission sur le projet de loi, nous en sommes parvenus à l’examen d’un amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 32.

L’amendement n° 56, présenté par Mmes Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 76 du code de procédure pénale est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, ni sans la présence de son avocat. Au cours de la perquisition, les frais d’avocat ne sont pas pris en charge par l’aide juridictionnelle d’État. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.

Le présent amendement tend à ajouter un article dans le projet de loi permettant la présence de l’avocat lors de la perquisition.
Alors qu’une telle présence est prévue dans le code de procédure pénale pour les visites domiciliaires, un vide juridique subsiste quant à la possibilité pour un avocat d’être présent lors de la perquisition pénale. Nous proposons ainsi de mettre fin à cette absence et aux incertitudes qui en résultent, notamment au regard de la législation européenne.
En effet, la directive 2013/48/UE de 2013 relative aux droits du justiciable énonce : « avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu ».
Au-delà de la mise en conformité avec le droit communautaire, la présence de l’avocat, auxiliaire de justice, est une mesure de bon sens, contribuant à la transparence et au bon déroulement de la perquisition. Elle ne saurait de ce fait être perçue comme une obstruction à la procédure pénale et judiciaire.
Permettant de prévenir toute dérive au cours des perquisitions, la présence de l’avocat nous semble pertinente. Le présent amendement va en ce sens.

Lorsque l’enquête prévoit une perquisition, la commission et le Sénat avaient décidé que l’avocat de la personne perquisitionnée devait être informé, de manière qu’il puisse éventuellement assister à la perquisition, sans en avoir toutefois l’obligation.
Cette position présente un double avantage : elle permet aux enquêteurs de faire leur travail correctement, mais aussi, dans certaines situations, à l’avocat de ne pas venir s’il ne juge pas sa présence utile, en accord avec son client.
Rendre la présence de l’avocat obligatoire ne serait pas forcément efficace. C’est la raison pour laquelle la commission reste sur sa position. Son avis est donc défavorable.
Nous avons déjà eu l’occasion de discuter de ce sujet à plusieurs reprises. Je ferai trois remarques.
Tout d’abord, les directives européennes n’imposent pas, en cas de perquisition, la présence d’un avocat.
Ensuite, et contrairement à vos affirmations, madame la sénatrice, il n’y a pas d’interrogatoire lors d’une perquisition. Celle-ci consiste à prendre des éléments et des pièces présents sur le lieu perquisitionné. Dès lors, la présence d’un avocat n’est pas absolument nécessaire. Si la perquisition devait se transformer en interrogatoire, il faudrait alors évidemment notifier à la personne son droit de faire appel à son avocat.
Troisièmement – sur ce point, mon avis diverge peut-être de celui de la commission des lois –, nous n’avons pas estimé nécessaire d’indiquer dans la loi que la personne pouvait appeler son avocat. Toutefois, quiconque fait l’objet d’une perquisition peut contacter son conseil. Soit la personne considérée est en garde à vue et elle se voit alors notifier ses droits, dont celui d’être assisté par un avocat ; soit elle ne l’est pas, et rien ne lui interdit dans ce cas de faire appel à son avocat. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas jugé nécessaire d’aller au-delà et d’inscrire cette obligation dans la loi.
En conséquence, l’avis du Gouvernement est défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. –
Non modifié
1° L’article 801-1 est ainsi rédigé :
« Art. 801 -1. – I. – Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.
« Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.
« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.
« II. – Ne sont pas applicables au dossier de procédure numérique les dispositions du présent code :
« 1° Procédant à une distinction entre les actes originaux et leurs copies ;
« 2° Prévoyant la certification conforme des copies ;
« 3° Relatives au placement sous scellés, y compris sous scellés fermés, des documents, contenus multimédia ou données dès lors qu’ils sont versés au sein de ce dossier.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. » ;
2° À l’article 66, après le mot : « sur-le-champ », sont insérés les mots : « ou dès que possible » ;
3° L’article 155 est abrogé ;
3° bis Au début du troisième alinéa du I de l’article 230-45, les mots : « Le second alinéa des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du présent code n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent code relatives au placement des enregistrements sous scellés fermés et à l’établissement d’un procès-verbal lorsqu’il est procédé à leur destruction ne sont pas applicables » ;
4° Aux articles 495-22 et 530-6, les mots : « revêtu d’une signature numérique ou électronique » sont remplacés par les mots : « établi sous format numérique » ;
5° Après le mot : « registre », la fin du second alinéa de l’article 706-57 est ainsi rédigée : «, ouvert à cet effet et tenu sous format papier ou numérique. »
II. – Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 130 -9 -1 – À titre expérimental, les constatations relatives aux infractions mentionnées aux chapitres IV, V et VI du titre III du livre II peuvent faire l’objet d’un procès-verbal dématérialisé prenant la forme d’un enregistrement audio, accompagné d’une synthèse écrite.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
III. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au second alinéa de l’article L. 130-9-1 du code de la route, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. –
Adopté.

L’amendement n° 22 rectifié, présenté par M. Antiste, Mme Conconne, MM. P. Joly et Lalande, Mme Artigalas et M. Raynal, est ainsi libellé :
Alinéas 16 à 20
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Maurice Antiste.

Le II de l’article 32 bis vise à légaliser, dans le cadre d’une expérimentation menée jusqu’au 1er janvier 2022, l’enregistrement numérique des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.
Cette disposition, susceptible de porter une atteinte grave aux droits des individus, n’est pas acceptable. En effet, en pratique, les avocats seront alors dans l’impossibilité de contrôler en temps réel la procédure et de faire des observations qui lui seront associées. Le formalisme est une garantie importante du justiciable placé en garde à vue.

Cet amendement est satisfait par le texte de la commission.
Dans le cadre de la notification des droits au gardé à vue, nous avons prévu de façon expérimentale la possibilité d’un procès-verbal dématérialisé pour un certain nombre d’infractions routières.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Vous voulez supprimer l’extension du périmètre de l’expérimentation proposée par la commission des lois du Sénat, monsieur le sénateur. L’Assemblée nationale avait adopté pour sa part un périmètre qui convenait mieux au Gouvernement.
Celui-ci s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement et souhaite dans tous les cas poursuivre les expérimentations sur l’oralisation.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 32 bis est adopté.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d’une affaire. –
Adopté.
Sous-section 2
Dispositions diverses de simplification
I A. –
Non modifié
I. – Après la première phrase du second alinéa de l’article 43 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d’appel, le procureur général transmet la procédure au procureur général près la cour d’appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche. »
II. –
Non modifié
III. –
Non modifié
1° Le dernier alinéa de l’article L. 234-4 est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;
1° bis Au premier alinéa de l’article L. 234-5, les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;
2° L’article L. 234-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;
b) Au troisième alinéa, les deux premières occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;
3° L’article L. 235-2 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, » sont remplacés par les mots : « ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. »

L’amendement n° 28, présenté par MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 12 à 14
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

L’article 33 du projet de loi prévoit plusieurs mesures de simplification de l’enquête.
Concernant les règles relatives aux contrôles d’alcoolémie et d’usage de stupéfiants opérés sur les conducteurs, il envisage de confier aux agents de police judiciaire, les APJ, la possibilité de prendre seuls l’initiative d’un contrôle.
Or, comme vous le savez, mes chers collègues, en l’état du droit, l’initiative en la matière est prise soit à la suite d’une instruction du procureur de la République, soit sur l’initiative d’un officier de police judiciaire, ou OPJ.
Le contrôle peut alors être effectué par des APJ ou des agents de police judiciaire adjoints sur les instructions et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.
La mesure prévue dans cet article est donc loin d’être neutre. Le fait de confier l’initiative de ces contrôles aux APJ, qui justifient d’un niveau de formation procédurale moindre et font l’objet d’un contrôle plus réduit, risque de fragiliser la qualité procédurale des opérations menées.
Nous vous demandons donc, mes chers collègues, d’être cohérents avec les mesures que vous avez adoptées à l’article 30 concernant les réquisitions prises par les agents de police judiciaire.
Il convient, à notre sens, d’en rester au niveau de garanties assuré par le droit en vigueur, en vertu duquel les agents de police judiciaire peuvent déjà être chargés de la réalisation concrète des opérations, mais seul un officier de police judiciaire peut en prendre l’initiative et les contrôler.

Nous avons déjà eu ce débat en première lecture et nous avions alors estimé que les ajustements qui étaient proposés par le texte concernant les prérogatives des agents de police judiciaire étaient de portée limitée et parfaitement acceptables. La commission a souhaité rester sur cette position et émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 33 est adopté.
(Non modifié)
Le titre XXIX du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa des articles 706-150, 706-153 et 706-158, les mots : « autoriser par ordonnance » sont remplacés par les mots : « ordonner par décision » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa des mêmes articles 706-150, 706-153 et 706-158, les deux occurrences des mots : « l’ordonnance » sont remplacées par les mots : « la décision » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 706-158, le mot : « autorise » est remplacé par le mot : « ordonne ». –
Adopté.
Section 3
Dispositions propres à l’instruction
Sous-section 1
Dispositions relatives à l’ouverture de l’information
I. – L’article 706-104 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706 -104. – Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1, lorsqu’il requiert l’ouverture d’une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité nécessite que les investigations en cours ne fassent l’objet d’aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95-1, 706-95-20, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l’objet d’une ordonnance écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.
« Le juge d’instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.
« L’autorisation délivrée par le procureur de la République n’est versée au dossier de la procédure qu’en même temps que les procès-verbaux relatant l’exécution et constatant l’achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d’instruction. »
II. – L’article 86 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le procureur de la République peut demander au doyen des juges d’instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions. La décision du doyen des juges d’instruction constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. » ;
2° Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les investigations réalisées au cours de l’enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l’article 85 ont permis d’établir qu’une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l’objet de poursuites, mais que l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d’instruction de rendre une ordonnance de non-lieu à informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. »
III. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 392-1 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».
III bis. –
Supprimé
(Non modifiés) –
Adopté.
IV à VI. – §
Sous-section 2
Dispositions relatives au déroulement de l’instruction
I. –
Non modifié
II. – La seconde phrase du sixième alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l’ouverture et la reconstitution du scellé fermé n’exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d’instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de l’avocat de la personne ou celui-ci dûment convoqué. »
II bis, II ter A et II ter. –
Supprimés
III. – L’article 142-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté, ou décidant d’une mise en liberté d’office.
« Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l’instruction.
« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire si elle est demandée par la personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction. »
IV. –
Non modifié
IV bis et IV ter. –
Supprimés
V. – L’article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins d’une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, dans les cas et selon les modalités prévus au présent article, à un moyen de communication audiovisuelle. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « prolongation de la détention provisoire », sont insérés les mots : «, y compris l’audience prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 179 » ;
3°
Supprimé
4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est supprimé et les mots : «, celui-ci peut » sont remplacés par les mots : « ou par un interprète, ceux-ci peuvent » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « l’avocat » ;
c) À la fin de la dernière phrase, les mots : « a déjà été remise à l’avocat » sont remplacés par les mots : « lui a déjà été remise » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si ces dispositions s’appliquent au cours d’une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne à présenter elle-même ses observations. »
V bis A. –
Supprimé
V bis. –
Non modifié
VI. – Après l’article 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51 -1. – Par dérogation aux articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, le juge d’instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation procède conformément aux dispositions du présent article.
« Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l’avisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d’un mois. Il peut aussi, par le même avis, interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai, sa réponse à différentes questions écrites. En ce cas, la personne est informée qu’elle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à être entendue par le juge d’instruction.
« Lors de l’envoi de l’avis prévu au deuxième alinéa, la personne est informée de son droit de désigner un avocat. En ce cas, la procédure est mise à la disposition de l’avocat désigné durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. Les avocats peuvent également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dans les conditions mentionnées à l’article 114 du code de procédure pénale.
« À l’issue d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis mentionné au deuxième alinéa du présent article, le juge d’instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne et à son avocat une lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 113-8 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne que, si elle demande à être entendue par le juge d’instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.
« Les III à VIII de l’article 175 du même code ne sont pas applicables. S’il n’a pas reçu les réquisitions du procureur de la République dans un délai de deux mois après la communication du dossier prévu au I du même article 175, le juge d’instruction rend l’ordonnance de règlement. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Après l’article 145-4-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 145-4-2 ainsi rédigé :
« Art. 145 -4 -2. – Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut décider de prescrire à son encontre l’interdiction de correspondre par écrit avec une ou plusieurs personnes qu’il désigne, au regard des nécessités de l’instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions. Il peut pour les mêmes motifs décider de retenir un courrier écrit par la personne détenue ou qui lui est adressé.
« Les décisions mentionnées au premier alinéa sont motivées et notifiées par tout moyen et sans délai à la personne détenue. Celle-ci peut les déférer au président de la chambre de l’instruction, qui statue dans un délai d’un mois par une décision écrite et motivée non susceptible de recours.
« Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. Il en est de même dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire.
« Lorsque la procédure est en instance d’appel, les attributions du procureur de la République sont confiées au procureur général.
« Les autres décisions ou avis conformes émanant de l’autorité judiciaire prévus par les dispositions réglementaires du présent code ou par la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et relatifs aux modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire peuvent, conformément aux dispositions du présent article, faire l’objet d’un recours du détenu ou du ministère public devant le président de la chambre de l’instruction. »
I bis. – L’article 148-5 du code de procédure pénale est abrogé.
II. – Au premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l’article 145-4-2 du code de procédure pénale ».

L’amendement n° 72, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par dix-huit alinéas ainsi rédigés :
I. bis. – L’article 148-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 148 -5. – En toute matière et en tout état de la procédure, toute personne placée en détention provisoire peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret. Les décisions accordant ou refusant ces autorisations peuvent faire l’objet du recours prévu au dernier alinéa de l’article 145-4-2. »
II. – La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :
1° L’article 34 est ainsi rédigé :
« Art. 34. – Les prévenus dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d’un rapprochement familial jusqu’à leur comparution devant la juridiction de jugement, après avis conforme de l’autorité judiciaire susceptible d’être contesté selon les modalités prévus par le dernier alinéa de l’article 145-4-2 du code de procédure pénale. »
2° Le premier alinéa de l’article 40 est ainsi rédigé :
« Les personnes condamnées et, sous réserve des dispositions de l’article 145-4-2 du code de procédure pénale, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. »
III. – À compter du 1er juin 2019, l’article 61-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 61 -1. – Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :
« 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
« 2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
« 3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;
« 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
« 5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;
« 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.
« La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
« Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
« Le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Cet amendement vise à tirer les conséquences de deux décisions adoptées par le Conseil constitutionnel le 8 février 2019 dans le cadre de la procédure des QPC, les questions prioritaires de constitutionnalité. De ce fait, il devrait, me semble-t-il, faire l’objet d’un consensus.
Ces décisions ont déclaré contraires à la Constitution, d’une part, les dispositions de la loi pénitentiaire de 2009 sur le rapprochement familial des prévenus, parce qu’elles ne prévoyaient pas de modalités de recours, et, d’autre part, des dispositions du code de procédure pénale sur l’audition libre, parce qu’elles ne comportaient pas de garanties spécifiques pour les mineurs.
Le Gouvernement vous propose donc, mesdames, messieurs les sénateurs, de modifier les dispositions correspondantes de la loi pénitentiaire et du code de procédure pénale, en instituant, dans le premier cas, un recours et en précisant, dans le second cas, les garanties nécessaires à l’audition libre des mineurs.
Ces modifications ont toute leur place dans l’article 35 bis du présent projet de loi, car cet article tire déjà les conséquences d’une décision QPC de juin 2018, qui avait déclaré contraires à la Constitution des dispositions de la loi pénitentiaire relatives aux décisions d’interdiction de correspondance.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 35 bis est adopté.

Sous-section 3
Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction
I. –
Non modifié
II. – L’article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 175. – I. – Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L’avis est notifié, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.
« II. – Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocats, aux parties.
« III. – Dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, qu’elles souhaitent exercer l’un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article.
« IV. – Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits conformément au III, les parties disposent d’un même délai d’un mois ou de trois mois, selon les distinctions prévues au II, pour :
« 1° Adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les mêmes modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ;
« 2° Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement du neuvième alinéa de l’article 81, des articles 82-1, 82-3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1.
« À l’expiration du délai mentionné au II du présent article, les parties ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
« V. – Si les parties ont adressé des observations en application du 1° du IV, le procureur de la République dispose d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées.
« VI. – Si les parties ont indiqué qu’elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III, elles disposent d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.
« VII. – À l’issue, selon les cas, du délai d’un mois ou de trois mois prévu aux II et IV, ou du délai de dix jours ou d’un mois prévu aux V et VI, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans ces délais.
« VIII. – Le III, le 1° du IV, le VI et, s’agissant des requêtes en nullité, le 2° du IV sont également applicables au témoin assisté. »
II bis et III. –
Supprimés
IV. –
Non modifié
IV bis. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale, la dernière occurrence du mot : « alinéa » est remplacée par les mots : « à septième alinéas ».
IV ter. – Au huitième alinéa de l’article 116 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
IV quater. –
Non modifié
IV quinquies à IV septies et V à VII. –
Supprimés

L’amendement n° 57, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.

L’article 36 du présent projet de loi simplifie et élargit le renvoi par le juge d’instruction à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Je le rappelle, cette procédure a été instaurée en 2004, afin de désengorger les tribunaux correctionnels. Elle ne peut être mise en place que sous certaines conditions, notamment la reconnaissance des faits par la personne poursuivie, ce qui en fait une procédure de plaider-coupable à la française. Elle a été étendue en 2011, mais ne concerne pour l’instant que très peu d’affaires, une centaine par an à l’échelon national.
Comme nous l’avons expliqué en première lecture, l’article 36 étend le recours à une procédure qui est superficielle, qui entraîne un jugement dégradé, dont plus de six ans d’expérience n’ont pas démontré l’utilité et qui est de nature à créer de lourdes difficultés dans les quelques dossiers dans lesquels elle serait utilisée. Il nous semble que l’espérance de gain de temps est très hypothétique et que l’extension prévue n’est justifiée que par une foi aveugle, et quelque peu naïve, dans cette procédure.
De fait, cette mesure s’inscrit pleinement dans la philosophie que déploie ce projet de loi en matière de procédure pénale : aller vite, juger beaucoup et pour pas cher, peu importe le moyen !
Nous proposons par conséquent la suppression de l’article 36, les aménagements apportés par la commission des lois ne changeant rien à notre détermination.

La commission des lois reste également déterminée… Son avis est donc défavorable !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 36 est adopté.

Chapitre III
Dispositions relatives à l’action publique et au jugement
Section 1
Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites
(Supprimé)
Sous-section 1
Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l’amende forfaitaire
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. » ;
2° L’article L. 3421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. »
I bis. –
Supprimé
II. –
Non modifié
II bis et II ter. –
Supprimés
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 495-17 est ainsi rédigé :
« Lorsque la loi le prévoit, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle. Le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, éteint l’action publique dans les conditions prévues à la présente section. » ;
1° bis Après le même article 495-17, il est inséré un article 495-17-1 ainsi rédigé :
« Art. 495 -17 -1. – Pour les délits, prévus par le code pénal, punis d’une peine d’amende, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire, conformément à la présente section, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que les victimes éventuelles ont été intégralement désintéressées.
« Sauf disposition contraire, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 €. » ;
1° ter à 1° quinquies
Supprimés
2° L’article 495-23 est abrogé ;
2° bis
Supprimé
3° L’article 768 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les informations relatives au paiement des amendes forfaitaires ou à l’émission du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées non susceptibles de réclamation pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe. » ;
4° Après le 4° de l’article 768-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les informations relatives au paiement des amendes forfaitaires ou à l’émission du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées non susceptibles de réclamation pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe. » ;
5° L’article 769 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « expiration de la peine », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, la date du paiement de l’amende et la date d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation. » ;
b) Le 6° est complété par les mots : «, soit fait l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle mentionnée au 11° de l’article 768 du présent code » ;
c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l’article 768, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur paiement, si la personne n’a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait de nouveau l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle. » ;
6° Après le 15° de l’article 775, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l’article 768 du présent code. »
6° bis et 7°
Supprimés
IV. –
Non modifié

L’amendement n° 58, présenté par Mmes Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Esther Benbassa.

Le présent article traite de l’application d’une procédure d’amende forfaitaire au délit d’usage illicite de stupéfiants.
Cette mesure a été présentée par le ministre de l’intérieur comme une réponse permettant de simplifier le travail des forces de l’ordre et de la justice et d’automatiser les peines en la matière.
Le principe de l’individualisation de la peine est ici bafoué et la mesure octroie un pouvoir arbitraire aux forces de l’ordre chargées d’appliquer la contravention. Elles pourront de ce fait sanctionner sans limites et au plus grand mépris des droits des personnes suspectées.
En plus d’augmenter les inégalités des citoyens devant la loi, cette mesure est dénuée de toute réflexion sur les questions relatives à la santé publique pour ce qui a trait à la prévention et au traitement de l’addiction.
Le seul effet de l’amende sera d’aggraver par une sanction pécuniaire une situation souvent déjà précaire : nous savons que les comportements de consommation sont diversifiés et divergent entre les milieux paupérisés et mondains.
Ce dispositif, en plus d’accroître le millefeuille législatif en matière de répression de l’usage des stupéfiants, semble inefficace compte tenu de l’impossibilité juridique d’appliquer une amende forfaitaire délictuelle pour les mineurs. Il sera donc dénué de tout effet de dissuasion de la consommation chez les populations les plus jeunes.
Cette mesure, mes chers collègues, est quelque peu rétrograde. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 37. Englobant tous les stupéfiants, il paraîtra répressif pour les uns et laxiste pour les autres.

L’avis de la commission est défavorable. Cet amendement tend à supprimer l’article 37, au motif qu’il aggraverait la répression de l’usage de stupéfiants, qui pourrait être sanctionné par une amende forfaitaire.
La commission des lois estime que l’amende forfaitaire peut apporter une réponse pénale rapide et systématique à cette infraction.
Naturellement, cette procédure n’empêchera pas le magistrat d’imposer aux consommateurs une autre peine, par exemple un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants, si cette sanction lui paraît plus appropriée.
Même avis, madame la présidente. J’insiste sur ce que vient d’indiquer à l’instant M. le rapporteur : cet article donne un outil supplémentaire, mais il n’interdit nullement d’autres types de peines, y compris celles qui peuvent être décidées en matière de soins.

Nous avions exprimé beaucoup de réserves sur la pratique de l’amende forfaitaire.
Madame la ministre, si elle ne constitue qu’un moyen, cela suppose la mise en place d’une véritable stratégie par le procureur de la République et les services de police, incluant notamment la définition des endroits où auraient lieu les interpellations, des méthodes de sensibilisation des parents, afin qu’ils ne soient pas amenés à payer par la suite et des procédures pour éviter que du deal ne se développe afin de payer ces mêmes amendes… Il faudra donc être extrêmement prudent dans la mise en œuvre de ce dispositif.
Je m’abstiendrai sur cet amendement, mais je pense que nous devrons travailler, sous la forme d’une mission d’information ou d’une commission d’enquête, pour voir comment les choses se sont mises en place sur le terrain.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 37 est adopté.

Sous-section 2
Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
(Non modifié)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 6° de l’article 41-1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Demander à l’auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime. » ;
2° L’article 41-1-1 est abrogé ;
3° L’article 41-2 est ainsi modifié :
a)
Supprimé
b) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ; »
b bis) Après la troisième phrase du vingt-septième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce magistrat valide la composition pénale lorsque les conditions prévues aux vingt-quatrième à vingt-sixième alinéas sont remplies et qu’il estime les mesures proposées justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Il refuse de valider la composition pénale s’il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l’espèce, ou que la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application du présent alinéa apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. » ;
c) Le même vingt-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux huit premières phrases du présent alinéa, la proposition de composition n’est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n’excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2° du présent article, à la condition que la valeur de la chose remise n’excède pas ce montant. » ;
d) Le trentième alinéa est ainsi modifié :
– la deuxième phrase est ainsi rédigée : « La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu’il cite l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l’audience. » ;
4° Après l’article 41-3, il est inséré un article 41-3-1 A ainsi rédigé :
« Art. 41 -3 -1 A. – Les dispositions des articles 41-2 et 41-3, en ce qu’elles prévoient une amende de composition et l’indemnisation de la victime, sont applicables à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d’une délégation de pouvoir à cet effet reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.
« Le montant maximal de l’amende de composition pouvant être proposée est alors égal au quintuple de l’amende encourue par les personnes physiques. » ;
5° L’article 495-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut proposer que la peine d’emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. Il peut également proposer le relèvement d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l’article 132-21 du code pénal, ou l’exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire en application des articles 775-1 et 777-1 du présent code. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu’il envisage de formuler. » ;
5° bis À la première phrase de l’article 495-10, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;
6° Après l’article 495-11, il est inséré un article 495-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 495 -11 -1. – Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa de l’article 495-11 ne sont pas remplies, le président peut refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l’article 495-13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. » ;
7° Après le 4° de l’article 768-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les compositions pénales dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République. » ;
8° Après le 5° de l’article 775-1-A, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les compositions pénales mentionnées à l’article 768-1. »
II et III. –
Non modifiés

L’amendement n° 10 rectifié bis n’est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 29, présenté par MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le vingt-deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne est mineure, le président du tribunal désigne une juge des enfants. » ;
La parole est à M. Jacques Bigot.

Cet amendement vise à protéger les mineurs en matière de composition pénale, mais en réalité, il me semble qu’il est satisfait par les pratiques actuelles. En effet, il faut aujourd’hui qu’une enquête préalable soit menée et que les parents soient associés à la procédure. C’est pourquoi je retire cet amendement.
Pour autant, cette intervention me donne l’occasion de dire à Mme la garde des sceaux que nous nous opposerons à sa demande d’habiliter le Gouvernement à modifier l’ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs par ordonnance.
Ce sujet mérite d’importants débats, comme nous venons de le voir au sujet de l’amende forfaitaire ou comme c’est le cas dans cet article sur la composition pénale.
Nous sommes donc particulièrement demandeurs, dans cette enceinte, d’un véritable débat sur la politique à l’égard des mineurs pour qu’elle reste dans l’esprit de l’ordonnance de 1945 qui allie prévention, éducation et sanction, quand celle-ci est nécessaire.
Je regrette que nous ne puissions pas avoir ce débat, qui devrait aussi porter sur les centres éducatifs fermés. Il est vraiment dommage, madame la ministre, que vous nous priviez de cette possibilité.

L’amendement n° 29 est retiré.
L’amendement n° 85 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Mézard, Collin et Corbisez, Mme Jouve et MM. Labbé, Menonville, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le vingt-neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne est mineure, le président du tribunal désigne un juge des enfants. » ;
La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Nous avions déjà présenté un amendement similaire, qui avait été rejeté, mais nous persistons ! Nous souhaitons que le président du tribunal nomme, lorsque la personne est mineure, un juge des enfants. Une telle mesure nous semble indispensable pour la protection des mineurs.

En effet, nous avions déjà débattu de cette proposition et l’avis de la commission reste défavorable.
Pour les compositions pénales applicables aux mineurs et par un système de renvoi d’articles, c’est l’article 4 de l’ordonnance de 1945 qui s’applique, si bien que seul un juge des enfants peut valider les mesures en question. Cet amendement me semble donc satisfait.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 30, présenté par MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

L’amendement n° 30 est retiré.
L’amendement n° 31, présenté par MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
L ’ article 38 est adopté.

Section 2
Dispositions relatives au jugement
Sous-section 1
Dispositions relatives au jugement des délits
I. –
Non modifié
II et III. –
Supprimés
IV. –
Non modifié
V. –
Supprimé
VI, VI bis et VI ter. –
Non modifiés
VI quater A. – À l’avant-dernière phrase du troisième alinéa de l’article 396 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
VI quater B. –
Supprimé
VI quater. –
Non modifié
VII. –
Supprimé
(Non modifié) –
Adopté.
VIII. – §
(Supprimé)
I. – Le deuxième alinéa de l’article 502 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« La déclaration indique si l’appel porte sur la décision sur l’action publique ou sur la décision sur l’action civile ou sur les deux décisions. Si l’appel concerne la décision sur l’action publique, la déclaration indique s’il porte sur l’ensemble de la décision ou s’il est limité aux peines prononcées, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. Si la décision sur l’action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l’appel sur cette décision précise s’il concerne l’ensemble des infractions ou certaines d’entre elles. Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l’appel est considéré comme portant sur l’intégralité de la décision. Le prévenu qui a limité la portée de son appel sur l’action publique aux peines prononcées dans les conditions prévues au présent alinéa peut, selon les modalités prévues au premier alinéa, revenir sur cette limitation dans un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel ; si l’affaire est audiencée en appel avant ce délai d’un mois, il peut revenir sur cette limitation au moment de l’audience. Le prévenu qui n’a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d’appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu’à l’audience de jugement. »
II. –
Non modifié
II bis. –
Non modifié
« Lorsque la limitation de la portée de l’appel sur l’action publique aux peines prononcées n’a pas été faite par l’avocat du prévenu ou par le prévenu en présence de son avocat, le prévenu peut revenir sur cette limitation à l’audience. »
II ter. –
Non modifié
« Art. 509 -1. – Le prévenu doit comparaître devant la chambre des appels correctionnels dans un délai de quatre mois à compter soit de l’appel, si le prévenu est détenu, soit de la date à laquelle le prévenu a été ultérieurement placé en détention provisoire, en application de la décision rendue en premier ressort.
« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le président de la chambre peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de quatre mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes.
« Lorsqu’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-73-1, le délai mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est porté à six mois.
« Si le prévenu n’a pas comparu devant la cour d’appel avant l’expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. »
III. –
Supprimé
IV. –
Non modifié
V. –
Non modifié
Après le mot : « ci-dessus », la fin du dernier alinéa de l’article 388-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : «, du deuxième alinéa de l’article 385-1, de l’article 388-2 et du dernier alinéa de l’article 509. » –
Adopté.
Sous-section 2
Dispositions relatives au jugement des crimes
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A L’article 249 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un des assesseurs peut être un magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;
1° L’article 281 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « un mois et dix jours » ;
1° bis
Supprimé
2° La section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II est complétée par un article 316-1 ainsi rédigé :
« Art. 316 -1. – Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs. » ;
3° L’article 331 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l’accusé. » ;
4°
Supprimé
5° Le deuxième alinéa de l’article 365-1 est ainsi rédigé :
« En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l’article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation consiste également dans l’énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d’assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l’article 362. L’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 706-53-13 est également motivée. La motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction ou des obligations particulières de la peine de probation n’est pas nécessaire. » ;
6°
Supprimé
7° Après l’article 380-2, il est inséré un article 380-2-1 A ainsi rédigé :
« Art. 380 -2 -1 A. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut indiquer qu’il ne conteste pas les réponses données par la cour d’assises sur la culpabilité et qu’il est limité à la décision sur la peine.
« Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
« Lorsque la cour d’assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. » ;
7° bis Après l’article 380-3, il est inséré un article 380-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 380 -3 -1. – L’accusé doit comparaître devant la cour d’assises statuant en appel sur l’action publique dans un délai d’un an à compter soit de l’appel, si l’accusé est détenu, soit de la date à laquelle l’accusé a été ultérieurement placé en détention provisoire en application de la décision rendue en premier ressort.
« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut se tenir avant l’expiration de ce délai, le président de la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. La durée de six mois prévue au présent alinéa est portée à un an en cas de poursuites pour crime contre l’humanité ou pour un crime constituant un acte de terrorisme.
« Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises avant l’expiration des délais prévus au présent article, il est remis immédiatement en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. » ;
8° Après le 3° de l’article 698-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. »
II. –
Non modifié
La cour criminelle, qui siège au même lieu que la cour d’assises, est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d’appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Les personnes contre lesquelles il existe à l’issue de l’information des charges suffisantes d’avoir commis, hors récidive, un crime mentionné au premier alinéa du présent II sont, selon les modalités prévues à l’article 181 du code de procédure pénale, mises en accusation par le juge d’instruction devant la cour criminelle. Le délai d’un an prévu au huitième alinéa du même article 181 est alors réduit à six mois, et il ne peut être procédé qu’à une seule prolongation en application du neuvième alinéa dudit article 181.
Sur proposition du ministère public, l’audiencement de la cour criminelle est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d’appel.
La cour criminelle applique les dispositions du titre Ier du livre II du code de procédure pénale sous les réserves suivantes :
1° Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
2° Les attributions confiées à la cour d’assises sont exercées par la cour criminelle, et celles confiées au président de la cour d’assises sont exercées par le président de la cour criminelle ;
3° La section 2 du chapitre III du même titre Ier, l’article 282, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre II, les deuxième et dernier alinéas de l’article 293 et les articles 295 à 305 du même code ne sont pas applicables ;
4° Pour l’application des articles 359, 360 et 362 dudit code, les décisions sont prises à la majorité ;
5° Les deux derniers alinéas de l’article 347 du même code ne sont pas applicables et la cour criminelle délibère en étant en possession de l’entier dossier de la procédure.
Si la cour criminelle estime, au cours ou à l’issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l’affaire devant la cour d’assises. Si l’accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre l’accusé.
L’appel des décisions de la cour criminelle est examiné par la cour d’assises dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du même code pour l’appel des arrêts rendus par les cours d’assises en premier ressort.
Pour l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, la cour criminelle est assimilée à la cour d’assises.
III. –
Non modifié
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. Cette évaluation est étendue, sur le fondement du principe de bonne administration de la justice, aux modalités d’accès à l’instruction et aux conséquences de celles-ci, tant pour les victimes et les mis en cause qu’en matière de gestion des personnels, d’activité des juges d’instruction des pôles d’instruction seuls compétents sur le ressort de tribunaux de grande instance sans pôle de l’instruction.
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, les personnes déjà mises en accusation devant la cour d’assises peuvent être renvoyées devant la cour criminelle, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d’appel. Les personnes mises en accusation devant la cour criminelle dans un délai de deux ans à compter du début de l’expérimentation et non encore jugées dans un délai de trois ans à compter de cette date sont de plein droit mises en accusation devant la cour d’assises.
IV. –
Non modifié
« Art. 689 -11. – Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle réside habituellement sur le territoire de la République, toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger l’une des infractions suivantes :
« 1° Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;
« 2° Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du même sous-titre Ier, si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée ;
« 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code, si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée.
« La poursuite ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne. À cette fin, le ministère public s’assure de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu’aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n’a demandé sa remise et qu’aucun autre État n’a demandé son extradition. Lorsque, en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »
V. –
Non modifié
« La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu’à la requête du procureur de la République antiterroriste et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l’extradition de la personne. À cette fin, le ministère public s’assure de l’absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu’aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n’a demandé sa remise et qu’aucun autre État n’a demandé son extradition. Lorsque, en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »

Le Gouvernement projette de réserver la cour d’assises en première instance aux crimes dits « les plus graves », à savoir ceux qui sont punis de plus de vingt ans de réclusion criminelle. Il s’agit a priori des meurtres et assassinats, ainsi que des crimes commis dans le cadre d’une récidive. Les crimes punis de vingt ans de réclusion ou moins, comme les viols et les vols criminels, seraient donc renvoyés non plus devant la cour d’assises, mais devant la cour criminelle départementale.
Il résulterait de cette décision une hiérarchisation de la gravité des crimes, certains étant de fait qualifiés de moins graves que d’autres.
Il convient aussi de souligner la régression qui en découlerait pour les viols, qui relèveraient désormais de la catégorie des crimes « moins graves ».
Ainsi, le but réel n’est pas la réduction des délais de jugement, mais la réduction budgétaire !
Pourtant, le dernier rapport de la Commission européenne sur l’efficacité de la justice, publié en 2016, est édifiant : avec 64 euros par habitant et par an consacrés au système judiciaire, la France figure en bas du classement des pays européens. Cette situation aurait dû amener le Gouvernement à augmenter significativement le budget de la justice, afin que la France rattrape son retard en la matière et qu’elle réponde aux exigences du droit européen.
Enfin, de telles infractions seraient jugées sans la garantie et le regard d’un jury populaire, mais les peines encourues seraient les mêmes que celles que l’on attribue habituellement en cour d’assises.
Pourtant, le jury est un échantillon parfaitement représentatif de la population d’un département et le contexte sociologique et historique permet parfois de comprendre les raisons d’un passage à l’acte.
En Martinique, la population est essentiellement créolophone et les mots employés n’ont pas toujours la même signification que celle qui est retenue dans l’Hexagone, même en français. La suppression des jurés au sein de notre territoire ne ferait donc qu’accroître le clivage culturel qui existe déjà entre les justiciables et leurs juges.
C’est pourquoi j’ai déposé un amendement tendant à la non-application de cette disposition à nos territoires.

Je veux aborder une question importante qui est relative à la Cour pénale internationale, pour laquelle cet article présente quelques avancées. Comme Mme la garde des sceaux a bien voulu engager un dialogue attentif sur ce sujet, je souhaite rappeler qu’en 2013 nous avons voté, ici même, sur le rapport de M. Anziani, une proposition de loi que j’avais présentée relative aux crimes relevant de la Cour pénale internationale et au rôle du juge français à leur égard. Ces crimes sont les crimes contre l’humanité, le génocide et les crimes de guerre.
Aujourd’hui, quatre verrous ne permettent pas aux juges français d’exercer les prérogatives qui sont les leurs en vertu de la Convention de Rome et le but de la proposition de loi votée de manière unanime par le Sénat était de lever trois d’entre eux. Nous avions en effet estimé, compte tenu de certaines expériences étrangères, qu’il était préférable de maintenir l’un de ces verrous, à savoir le monopole du parquet.
La question reste donc pendante pour trois de ces verrous.
En ce qui concerne l’inversion du principe de complémentarité entre les juridictions nationales et la Cour pénale internationale, le Gouvernement a présenté lors de nos débats un amendement, fruit du dialogue dont je parlais, pour faire disparaître ce verrou. Je tiens, madame la garde des sceaux, à vous en donner acte. L’exposé des motifs de cet amendement indique que supprimer cette exigence, comme l’a fait le Sénat, peut se justifier.
Un autre verrou est la double incrimination. C’est un problème, parce qu’il faudrait que l’incrimination soit la même en France et dans un certain nombre d’États qui n’ont pas du tout la même culture des droits de l’homme que notre pays. Je note toutefois une avancée, puisque nous allons obtenir, si ce projet de loi est voté en l’état – je pense qu’il le sera –, que pour le génocide la double incrimination tombe. En revanche, elle subsisterait pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, ce que je regrette.
Enfin, il reste la question de la résidence habituelle. Comme le disait Robert Badinter, les personnes qui sont coupables de ce type de crimes résident rarement dans un pavillon de banlieue de notre cher pays… Il serait donc justifié, à mon avis comme à celui de la coalition qui travaille sur ces questions – Robert Badinter en fait partie –, que cette condition de résidence habituelle soit supprimée : dès lors que des personnes sont sur notre territoire et qu’elles sont coupables de génocide, de crime contre l’humanité ou de crime de guerre, il serait juste de les interpeller.
En conclusion, je veux vous dire, madame la garde des sceaux, que vous faites certes un pas, mais il en reste à franchir et ils sont importants.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Fouché, Bouloux et Laufoaulu, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled, Chasseing et A. Marc, Mme Vermeillet, MM. Le Nay, Longeot et Henno et Mme Guidez, est ainsi libellé :
Alinéas 28 à 43
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Alain Fouché.

Cet amendement vise à supprimer l’expérimentation de la chambre criminelle départementale composée uniquement de magistrats et qui jugerait les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion. Cette expérimentation s’étendrait du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2022 dans un nombre de départements compris entre deux et dix.
Ce dispositif n’est pas du tout clair et je n’ai aucun doute sur le fait que l’expérimentation sera définitive !
L’objectif du Gouvernement est d’accélérer les procès d’assises et d’éviter ainsi la correctionnalisation de certains crimes. Un tel objectif peut paraître légitime, mais le moyen pour y parvenir est inadéquat. Depuis 1810 – deux siècles ! –, les crimes sont jugés par des cours d’assises, où siège, à côté des magistrats professionnels, un jury composé de citoyens tirés au sort. Ce sont des représentants du peuple, des ouvriers, des agriculteurs, des chômeurs, des commerçants, des directeurs, des fonctionnaires…
Les cours d’assises sont des juridictions qui fonctionnent : entre 90 % et 95 % des accusés sont condamnés en premier ressort.
Certes, toute institution est perfectible, mais les cours d’assises ne connaissent pas de dysfonctionnements majeurs qui devraient emporter leur disparition.
La question des moyens qui leur sont octroyés se pose en revanche, à l’heure où les citoyens sont en recherche d’expression directe – nous le constatons tous les jours dans la rue ! Il est plus que jamais indispensable de continuer à associer le peuple, par l’intermédiaire des jurés, à l’acte de juger. Le peuple veut être plus proche des institutions !
Les jurés ne sont pas des juristes, ils apprécient le déroulement du procès, l’interrogatoire, les réactions des individus, cela avec une certaine sagesse.
Pour ces raisons, le présent amendement prévoit la suppression de cette disposition incroyable, proposée sans aucune concertation avec les différents acteurs et qui annonce la fin des cours d’assises.
Si le Sénat adopte cette disposition, il devra assumer la suppression des cours d’assises, car tel est bien l’objectif du Gouvernement !

L’amendement n° 23 rectifié, présenté par M. Antiste, Mme Conconne, MM. P. Joly et Lalande et Mme Artigalas, est ainsi libellé :
Alinéa 41
Après la seconde occurrence du mot :
départements
insérer les mots :
, à l’exclusion des collectivités de l’article 73 de la Constitution,
La parole est à M. Maurice Antiste.

Je me suis déjà exprimé sur l’article et mes propos vont rejoindre ceux d’Alain Fouché.
La création de la cour criminelle considérée a pour conséquence de supprimer le jury populaire pour les crimes passibles d’une peine d’emprisonnement de moins de vingt ans.
Cette suppression des jurys populaires, représentatifs de la population locale, est particulièrement malvenue dans les outre-mer, où les justiciables ont plus de mal à se reconnaître dans des juges potentiellement venus d’ailleurs et qui ne possèdent pas forcément la connaissance spontanée des spécificités culturelles du langage oral ou gestuel – ces particularités doivent pourtant être prises en compte dans les procédures criminelles. Elle aura de fait des conséquences non négligeables sur la pertinence et la crédibilité des décisions rendues.
D’ailleurs, je rappelle que le Président de la République, Emmanuel Macron, a lui-même parlé récemment, comme il l’avait déjà fait auparavant, d’un droit à la différenciation !
Aussi, cet amendement vise à maintenir dans les outre-mer la présence de jurés issus du même contexte culturel et social, en excluant l’application du nouveau dispositif dans les collectivités de l’article 73 régies par la Constitution.
Je considère que cet amendement est un amendement de repli par rapport à celui qu’a déposé Alain Fouché.

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements et je voudrais m’en expliquer très rapidement.
En première lecture, nous avons pris connaissance de la proposition du Gouvernement, qui visait alors un tribunal criminel, lequel est devenu depuis lors une cour criminelle.
Nous avions à l’époque fait deux observations.
Tout d’abord, en matière d’agressions sexuelles notamment, les procédures devant les cours d’assises sont extrêmement longues, alors même qu’il est souhaitable que la réponse pénale intervienne relativement rapidement, en particulier dans l’intérêt des victimes. C’est ce qui explique qu’aujourd’hui certaines de ces affaires sont finalement renvoyées, avec l’accord des parties, devant un tribunal correctionnel – c’est ce qu’on appelle la correctionnalisation. Le nombre d’affaires concernées par ce phénomène est assez important. C’est une réalité ! Juger plus vite ces crimes paraît infiniment souhaitable.
Ensuite, nous nous sommes interrogés sur le fait de renvoyer ces affaires devant une juridiction que l’on pourrait qualifier de spécialisée, puisqu’elle jugera de crimes, mais en l’absence de jury populaire.
Pour autant, le projet de loi prévoit uniquement une expérimentation et nous ne pouvons pas sérieusement la refuser à ce stade, même si des interrogations persistent sur les conséquences de la mise en place de cette nouvelle juridiction, ou encore sur les conditions de l’appel des décisions rendues.
Les réponses à ces interrogations ne peuvent pas toutes être apportées aujourd’hui, mais il est certain que ces crimes doivent être jugés plus rapidement. C’est pourquoi la commission des lois s’est prononcée en faveur d’une expérimentation et qu’elle émet un avis défavorable sur ces amendements de suppression.
L’avis du Gouvernement est également défavorable et je ne saurais mieux m’exprimer que M. le rapporteur.
J’ajouterai simplement deux éléments. Tout d’abord, il s’agit d’une expérimentation qui ne s’appliquera que dans les départements ou les collectivités qui seront volontaires. Si vous estimez, monsieur le sénateur Antiste, qu’une difficulté existe de ce point de vue dans les collectivités d’outre-mer, il suffira de ne pas être candidat à cette expérimentation. Ensuite, le jury populaire ne sera pas supprimé, puisque, en toute hypothèse, la cour d’assises, dans son fonctionnement actuel, c’est-à-dire avec un jury populaire, sera compétente en appel.

Je vous remercie, madame la ministre, des précisions que vous avez bien voulu apporter et je ferai tout, avec l’ensemble du barreau martiniquais qui est derrière moi sur ce dossier, pour faire en sorte que la Martinique ne soit pas candidate.
Au-delà, je veux vous inviter, à prendre l’initiative d’une réflexion sur ce que peut être la justice dans un pays du tiers-monde comme le nôtre, où les rapports sociaux sont extrêmement difficiles, notamment en raison du poids de notre passé encore récent.
Vous conviendrez avec moi du fait que la justice est d’abord une affaire culturelle et il y aurait beaucoup à dire de ce point de vue. Je me tiens à votre disposition pour lancer ce débat. En tout cas, j’y participerai volontiers et je suis prêt à vous démontrer, malgré le doute que vous semblez afficher, que rendre la justice est largement une affaire culturelle.

À mon avis, cette expérimentation de 2019 à 2022, sur dix départements volontaires, paraît-il, durera définitivement. Il y aura deux sortes de juridiction : des cours avec cinq magistrats et des cours d’assises avec trois magistrats et douze jurés. Où est l’égalité devant la justice ?
L’objectif du Gouvernement est d’accélérer les procès d’assises, mais les procédures restent identiques. Aujourd’hui, des procédures en correctionnelle peuvent durer pendant des mois, voire des années. J’ai donc des doutes sur le résultat.
Je résume : il s’agit de remplacer les jurés par des professionnels, mais on n’est pas sûr que la procédure soit plus rapide. Ce faisant, on éloigne le peuple de l’acte de juger. De surcroît, madame la ministre, les professionnels ne sont pas toujours les meilleurs. Certes, de nombreux magistrats sont très bons, mais ils ne sont pas meilleurs que les jurés.
Madame la ministre, j’apprécierai que vous m’écoutiez…

Je le répète, on l’a vu, les professionnels, parfois, ne sont pas meilleurs que les jurés. Je pense notamment au procès de l’affaire d’Outreau, qui fut un véritable scandale. En l’espèce, la défaillance ne venait pas des jurés, mais le petit juge a été totalement couvert, puisque, in fine, on l’a nommé à la Cour de cassation.
Cela dit, l’examen de ce texte au Parlement en quelques semaines remet en cause l’essence même du procès pénal.
Pour ma part, je voterai contre cette expérimentation, qui, à mon avis, deviendra définitive. C’est antidémocratique ! Vous êtes en train de casser un système qui fonctionne bien depuis deux siècles. J’ai honte !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 42 est adopté.
(Non modifié)
I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris » et comprenant les articles L. 217-1 à L. 217-4 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme
« Art. L. 217 -6. – Le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu’ils n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire :
« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances contre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier, et relatives :
« a) À la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;
« b) Au versement d’une provision ;
« c) À l’organisation d’une expertise judiciaire en cas de contestation de l’examen médical pratiqué en application de l’article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;
« d) À l’offre d’indemnisation qui leur est faite ;
« 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;
« 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d’un acte de terrorisme. »
I bis. – Au premier alinéa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : «, y compris tout agent public ou tout militaire, ».
II. – Après l’article 706-16 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706-16-1 et 706-16-2 ainsi rédigés :
« Art. 706 -16 -1. – Lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l’action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.
« L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. L’article 5 n’est alors pas applicable.
« Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’État.
« Art. 706 -16 -2. – La juridiction civile compétente en application de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, copie des procès-verbaux constatant l’infraction ou de toute autre pièce de la procédure pénale, même en cours.
« Elle peut également requérir :
« 1° De toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l’infraction ou du requérant ;
« 2° De toute administration ou tout service de l’État, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou entreprise d’assurance susceptible de réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à l’exécution de ses obligations éventuelles.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la demande d’indemnité et leur divulgation est interdite. »
II bis. – Au premier alinéa de l’article L. 126-1 du code des assurances, après la seconde occurrence du mot : « actes », sont insérés les mots : «, y compris tout agent public ou tout militaire, ».
III. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 422-1, il est inséré un article L. 422-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422 -1 -1. – Le fonds de garantie mentionné à l’article L. 422-1 peut requérir de toute administration ou tout service de l’État et des collectivités publiques, de tout organisme de sécurité sociale, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales, de tout employeur ainsi que des établissements financiers ou entreprises d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice la réunion et la communication des renseignements dont ceux-ci disposent ou peuvent disposer relatifs à l’exécution de leurs obligations éventuelles, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.
« Le fonds de garantie informe la victime mentionnée à l’article L. 126-1 avant toute réquisition susceptible de porter sur des renseignements relatifs à sa personne ou à sa situation et sollicite son accord préalable lorsque la réquisition est adressée à son employeur.
« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction du dossier d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds de garantie sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;
2° L’article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour procéder à l’examen médical de la victime mentionnée à l’article L. 126-1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en évaluation des dommages corporels inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire. »
IV. – Au 1° du I, à la première phrase du II et au a du 1° du III de l’article L. 169-4 et au premier alinéa du II de l’article L. 169-10 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 422-2 du code des assurances, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
V. – L’article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux victimes de crimes d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus et réprimés par le 1° de l’article 421-1 et les 1° à 4° de l’article 421-3 du code pénal ainsi qu’à leurs ayants droit en vue de leur constitution de partie civile au soutien de l’action publique. »
VI. – Le présent article, à l’exception du a du 2° du III et du IV, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. À cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l’état au tribunal de grande instance de Paris.
Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa du présent VI pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Le a du 2° du III et le IV entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

L’amendement n° 73, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 36
Remplacer les mots :
est complété
par les mots :
et l’article 5-1 de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna sont complétés
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le sénateur Fouché, je vous rassure, je vous ai bien écouté. J’avais une oreille qui était destinée à M. le président de la commission des lois, mais l’autre était entièrement dédiée à votre écoute.
Rires.
Je comprends évidemment les réactions que l’on peut avoir à l’idée que soient modifiées les conditions…
Je comprends, monsieur le sénateur, mais il ne faut pas penser que les magistrats professionnels ne rendent pas la justice au nom du peuple français. C’est bien évidemment le cas.
D’autre part, je le redis devant vous, les jurys populaires ne sont pas supprimés. Simplement, ils sont réservés aux appels en cour d’assises. Ainsi, nous avons à la fois le maintien de cette spécificité, dont on sait la qualité, et la possibilité d’avoir des jugements plus rapides rendus par des magistrats professionnels. Ces jugements, monsieur le sénateur, traduiront bien la vérité judiciaire, comme l’a dit M. le rapporteur : tous les crimes seront vraiment jugés en tant que crimes et ne seront pas correctionnalisés parce que les victimes le demandent ou parce que cela permet d’obtenir un jugement plus rapide.
Je vous prie de m’excuser, madame la présidente, mais j’ai tenu à répondre à M. le sénateur Fouché.
J’en viens maintenant à l’amendement n° 73, qui vise à étendre à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour les constitutions de partie civile aux fins de soutien de l’action publique en matière de terrorisme.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 42 bis AA est adopté.
I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 228-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé s’il en manifeste la volonté. Si ce dernier n’a pas fait l’objet d’un sauf-conduit délivré par le ministre de l’intérieur en raison de la menace pour la sécurité et l’ordre publics que constituerait un tel déplacement, il est représenté par un avocat. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « dans un délai de deux mois » et les mots : « ou à compter de la notification de chaque renouvellement » sont remplacés par les mots : «, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au sixième alinéa » ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. » ;
– la seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. » ;
2° L’article L. 228-5 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l’audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s’y rendre. Le sauf-conduit n’est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « ou à compter de la notification de chaque renouvellement » sont remplacés par les mots : «, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au troisième alinéa » ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase une rédigée : « Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. » ;
– la seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au troisième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. »
II. –
Non modifié
« Art. L. 773 -10. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les mesures individuelles de contrôle et de surveillance obéissent aux règles définies aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » –
Adopté.
(Non modifié)
Le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 229-1, après le mot : « saisie », sont insérés les mots : « des documents et » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 229-4, après le mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;
3° Le I de l’article L. 229-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « documents ou » ;
b) À la deuxième phrase du second alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « documents et » ;
4° Le II du même article L. 229-5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, à la fin du troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « données saisies » sont remplacés par les mots : « documents et données saisis » ;
b) Au sixième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « documents et » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « les documents, » ;
– au début de la deuxième phrase, sont ajoutés les mots : « Les documents ainsi que » ;
– à la même deuxième phrase, les mots : « la copie » sont remplacés par les mots : « leur copie ou à celle » et les mots : « l’exploitation » sont remplacés par les mots : « leur exploitation ou celle » ;
– à la dernière phrase, les mots : « données copiées » sont remplacés par les mots : « copies des documents ou des données ». –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706-75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente sur l’ensemble du territoire national pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une très grande complexité, en raison notamment du ressort géographique sur lequel elles s’étendent. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 706-77, les mots : « autre que ceux visés à l’article 706-75 » sont supprimés ;
3° Au second alinéa de l’article 706-80, après le mot : « moyen, », sont insérés les mots : « au procureur de la République déjà saisi et » et, à la fin, les mots : « ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 706-76 » sont supprimés ;
4° La section 1 du chapitre II est complétée par des articles 706-80-1 et 706-80-2 ainsi rédigés :
« Art. 706 -80 -1. – Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d’avoir commis l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74, dans le cadre d’une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République chargé de l’enquête ou du juge d’instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
« Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des mêmes articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République chargé de l’enquête ou du juge d’instruction saisi, qui en avise préalablement le parquet, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.
« Art. 706 -80 -2. – Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 ou servant à les commettre, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire en charge des investigations peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits, qui en avise préalablement le parquet, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.
« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. »
II. – La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 67 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « procèdent » est remplacé par les mots : « peuvent procéder » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « selon le cas, » et, à la fin, les mots : « ou au procureur de la République saisi en application des dispositions de l’article 706-76 du code de procédure pénale » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés des articles 67 bis-3 et 67 bis-4 ainsi rédigés :
« Art. 67 bis-3. – Lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner des personnes d’avoir commis un délit douanier dont la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans ou d’y avoir participé comme complices ou intéressées à la fraude au sens de l’article 399, dans le cadre d’une opération de surveillance, et lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à l’interpellation de ces personnes afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
« Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, demander à tout fonctionnaire ou agent public de ne pas procéder au contrôle et à la saisie de ces objets, biens ou produits afin de ne pas compromettre la poursuite des investigations.
« L’autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Le procureur de la République informe sans délai le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris de la délivrance de cette autorisation.
« Art. 67 bis-4. – Dans le cadre d’une opération de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’un délit douanier ou servant à le commettre, lorsque la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à deux ans, et lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, sur l’ensemble du territoire national, avec l’autorisation du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, livrer ou délivrer à la place des prestataires de services postaux et des opérateurs de fret ces objets, biens ou produits, sans être pénalement responsables.
« À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République est écrite et motivée. Cette autorisation est versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. » –
Adopté.
Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 122-3, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale, » ;
2° à 7°
Supprimés
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 41 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit d’actes d’enquête devant être exécutés dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance, il peut demander au procureur de la République territorialement compétent d’y procéder ou d’y faire procéder par un officier de police judiciaire. Il peut toutefois également requérir directement tout officier de police judiciaire sur l’ensemble du territoire national de procéder à ces actes. » ;
1° bis A et 1° bis à 1° sexies
Supprimés
2° Le deuxième alinéa de l’article 702 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également compétents sur toute l’étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal de grande instance et la cour d’assises de Paris selon les modalités déterminées aux articles 628-1 à 628-6 et 698-6. » ;
2° bis
Supprimé
3° L’article 706-17-1 devient l’article 706-17-2 ;
4° L’article 706-17-1 est ainsi rétabli :
« Art. 706 -17 -1. – Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 41, lorsqu’il exerce sa compétence en application de la présente section, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris peut requérir par délégation judiciaire tout procureur de la République de procéder ou faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 dans les lieux où ce dernier est territorialement compétent.
« La délégation judiciaire mentionne les actes d’enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l’enquête pour laquelle elle a été délivrée.
« Elle indique la nature de l’infraction, objet de l’enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris et revêtue de son sceau.
« Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris fixe le délai dans lequel la délégation doit lui être retournée accompagnée des procès-verbaux relatant son exécution. À défaut d’une telle fixation, la délégation judiciaire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.
« Les magistrats commis pour son exécution exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris prévus par la présente section. » ;
4° bis à 4° quater
Supprimés
5° L’article 706-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 34, le ministère public auprès de la cour d’assises statuant en première instance est représenté par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris en personne ou par ses substituts. »
6° à 8°
Supprimés
(Supprimés) –
Adopté.
III et IV. – §
Chapitre V
Dispositions relatives à la cassation
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur en cassation et les autres parties, sauf pour la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577.
« Cet avocat est choisi par le demandeur en cassation ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. La désignation intervient dans un délai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;
3° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;
4° L’article 585-1 est ainsi rédigé :
« Art. 585 -1. – Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur en cassation doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;
5° À la fin de la première phrase de l’article 586, les mots : «, une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de l’acte de pourvoi » ;
6° Au début de l’article 588, les mots : « Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, » sont supprimés ;
7° L’article 590-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et n’a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l’article 584 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « n’ayant pas constitué avocat » sont supprimés ;
8° L’article 858 est abrogé.
II. – Le second alinéa de l’article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Au-delà d’un délai de dix jours après la déclaration de pourvoi, la partie civile pourra transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation. Le mémoire devra être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause. »
III. – L’article 49 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicable le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer est abrogé. –
Adopté.
Chapitre VI
Dispositions relatives à l’entraide internationale
(Non modifié)
I. – L’article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les interdictions prévues aux 1° et 2° de l’article 515-11 du code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, ainsi que celles prévues par une décision de protection européenne reconnue conformément à l’article 696-102 du présent code en application de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne. »
II. – Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article 694-31, les mots : « relève des dispositions du deuxième alinéa de l’article 694-17 du présent code » sont remplacés par les mots : « concerne une procédure mentionnée à l’article 694-29 du présent code et qui n’est pas relative à une infraction pénale » ;
2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 695-26, les mots : « L’article 74-2 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 74-2 et 230-33 sont applicables » ;
3° À la fin de la première phrase de l’article 696-9-1, les mots : « l’article 74-2 est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 74-2 et 230-33 sont applicables » ;
4° La section 5 du chapitre V est complétée par un article 696-47-1 ainsi rédigé :
« Art. 696 -47 -1. – Lorsqu’à la suite d’une demande d’extradition émanant du Gouvernement français la personne a déjà été remise et que, en l’absence de renonciation au principe de spécialité par la personne ou par le Gouvernement étranger, il est demandé l’autorisation d’étendre les poursuites à d’autres infractions commises avant l’arrivée de la personne sur le territoire national, cette demande est accompagnée d’un mandat d’arrêt si un tel mandat avait déjà été délivré et, dans le cas contraire, d’un mandat d’amener. » ;
5° Au a du 4° de l’article 696-73, les mots : « aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 » sont remplacés par les mots : « à l’article 694-32 ».
III. – L’article 227-4-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables à la violation d’une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. »
IV. – Après le premier alinéa de l’article 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avocat assistant, dans les conditions fixées à l’article 695-17-1 du code de procédure pénale, une personne arrêtée dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution. » –
Adopté.
TITRE V
RENFORCER L’EFFICACITÉ ET LE SENS DE LA PEINE
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine
I. – L’article 131-3 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131 -3. – Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
« 1° L’emprisonnement ;
« 2° La probation ;
« 3° Le travail d’intérêt général ;
« 4° L’amende ;
« 5° Le jour-amende ;
« 6° Le stage prévu à l’article 131-5-1 ;
« 7° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 ;
« 8° Le suivi socio-judiciaire prévu à l’article 131-36-1.
« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l’article 131-10. »
1° à 7°
Supprimés
II. –
Supprimé
III. – L’article 131-5-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131 -5 -1. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l’emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.
« Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.
« Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné. »
III bis. – Le début de l’article 131-6 du code pénal est ainsi rédigé : « En matière correctionnelle, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que l’emprisonnement ou que l’amende, une ou plusieurs… (le reste sans changement). »
III ter. – L’article 131-7 du code pénal est abrogé.
IV. – L’article 131-8 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « ou en même temps que » ;
1° bis
Supprimé
2° Les deuxième et dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Lorsque le prévenu est présent à l’audience, la peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.
« Lorsque le prévenu n’est pas présent à l’audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s’il a fait connaître par écrit son accord. »
V. – Le premier alinéa de l’article 131-9 du code pénal est supprimé.
VI. – L’article 131-16 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° La peine de stage prévue à l’article 131-5-1 ; »
2° Les 8°, 9°, 9° bis et 9° ter sont abrogés ;
3°
Supprimé
VI bis. –
Supprimé
VII. –
Non modifié
VII bis, VII ter A, VII ter, VIII et VIII bis. –
Supprimés
IX. – Sont abrogés :
1° Les articles 131-35-1 et 131-35-2, les 4° bis et 8° de l’article 221-8, les 9°, 9° bis et 15° du I de l’article 222-44, les 4° et 5° de l’article 222-45, les 4° bis, 4° ter et 6° de l’article 223-18, le 4° du I de l’article 224-9, le 6° de l’article 225-19, les 7° et 8° du I de l’article 225-20, le 7° de l’article 227-29, l’article 227-32, le 6° du I de l’article 311-14, les 6° et 7° du I de l’article 312-13, le 10° de l’article 321-9, les 5° et 6° du I de l’article 322-15 du code pénal ;
2° Le 3° de l’article 24, le 2° de l’article 32 et de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique.
IX bis. –
Non modifié
IX ter A. –
Supprimé
IX ter. –
Non modifié
IX quater. – Au second alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, les mots : « de citoyenneté mentionné au 8° » sont remplacés par les mots : « mentionné au 7° ».
IX quinquies. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 709-1-1 et au premier alinéa de l’article 709-1-3 du code de procédure pénale, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».
X. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du présent X, le travail d’intérêt général prévu à l’article 131-8 du code pénal peut également être effectué au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi.
Les conditions spécifiques d’habilitation de ces personnes morales de droit privé et d’inscription des travaux qu’elles proposent sur la liste des travaux d’intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont précisées par décret en Conseil d’État.
Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l’expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. –
Adopté.
Après l’article 131-30-2 du code pénal, il est inséré un article 131-30-3 ainsi rédigé :
« Art. 131 -30 -3. – L’interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

L’amendement n° 61, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.

L’article 43 bis, rétabli par la majorité de la commission des lois, résulte d’un amendement de nos collègues du groupe Les Républicains, adopté en première lecture par le Sénat.
Il vise à élargir l’application de l’interdiction du territoire, appelée communément la double peine, à tout étranger reconnu coupable d’un crime ou délit entraînant cinq ans ou plus d’emprisonnement.
Cette interdiction de territoire est actuellement réservée aux crimes et délits les plus graves, à commencer par les actes terroristes.
Ce nouvel article 43 bis entraînera, par exemple, l’application de la double peine à un individu auteur d’un vol de mobylette avec effraction, comme le rappelait Mme la garde des sceaux en première lecture, ici même.
À nos yeux, il s’agit d’une disposition dogmatique, qui créerait une discrimination lourde entre délinquants du fait de leur statut. Pour la majorité sénatoriale, tous les artifices sont bons pour justifier certaines adaptations aux principes de liberté publique. Nous souhaitons donc la suppression de cet article.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, car elle souhaite conserver l’article 43 bis. Je le précise, cet article, que nous avons adopté sur l’initiative de notre collègue Bruno Retailleau, assortit d’une interdiction du territoire la condamnation de « tout étranger coupable de l’un des délits ou crimes punis d’une peine au moins égale – j’y insiste – à cinq ans d’emprisonnement », sauf exception dûment motivée.
Je rappelle que le Sénat a adopté à plusieurs reprises cette mesure.
À l’inverse de M. le rapporteur, j’émets un avis favorable sur cet amendement, qui a pour objet de supprimer un article ayant pour effet, selon nous, d’étendre de manière excessive et disproportionnée la peine d’interdiction du territoire français. Aujourd’hui, vous l’avez rappelé, madame Cukierman, cette mesure est réservée uniquement aux infractions commises en matière terroriste. Le fait de l’étendre à des peines punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement nous paraît exagéré. Cette généralisation est d’autant moins nécessaire que cette peine est déjà encourue, à titre facultatif, pour de nombreux délits, et que la liste en cause a été encore récemment complétée par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 43 bis est adopté.
L’article 132-16-5 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132 -16 -5. – L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40-1 du code de procédure pénale.
« Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. »

L’amendement n° 62, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.

En bonne logique, les dispositions de l’article 43 ter, que la majorité sénatoriale entend rétablir à l’occasion de cette nouvelle lecture, résultent, comme celles de l’article précédent, de l’adoption d’un amendement d’affichage du groupe Les Républicains.
L’objectif est, de toute évidence, de satisfaire un certain électorat, sans prendre en considération jusqu’au bout l’intérêt et les conséquences des mesures que l’on propose.
Comme cela a été expliqué en première lecture, le juge dispose déjà d’une large latitude pour décider de relever ou non la récidive légale. Sa décision a évidemment des conséquences sur l’ampleur de la condamnation éventuelle.
La disposition introduite aura donc comme conséquence de forcer la main au juge, ce qui est contradictoire avec l’objectif affiché, que nous partageons toutes et tous, d’une grande écoute de la magistrature.
Nous proposons par conséquent de supprimer cet article à l’efficacité incertaine et, surtout, comme je le disais d’entrée, que l’on pourrait qualifier de mesure d’affichage. C’est de surcroît une sorte d’injonction sur ce que doit être l’attitude des juges.
Finalement, on propose toujours plus de répression, toujours plus de prison, alors que nous savons tous que la lutte contre la délinquance ne rentre malheureusement pas dans cette équation, car, en l’occurrence, plus ajouté à plus aboutit à moins de réinsertion, moins de lien social.
Nous avons déjà eu longuement ce débat et nous continuerons de l’avoir. Qu’est-ce qui empêche la récidive ? De nombreux textes et discussions tentent de répondre à cette question. On peut augmenter sans cesse le plafond des peines pour encadrer la récidive, mais, malheureusement, les hommes n’obéissent pas mécaniquement aux lois et procédures que nous votons ; il y a une part d’inconscient. Lutter contre la récidive est finalement plus un projet de société. Il ne sert à rien de renforcer l’arsenal, de faire de l’affichage, car on ne répond pas réellement à la préoccupation de nos concitoyennes et de nos concitoyens, qui est de limiter la récidive dans notre pays.
Mme Éliane Assassi applaudit.

Avis défavorable. Pour la commission, l’état de récidive légale doit être relevé immédiatement à l’audience par le juge. Naturellement, ce dernier garde toute liberté de le retenir ou non, voire de le modifier, pour tenir compte des circonstances de fait qui lui sont présentées.
Avis favorable sur cet amendement de suppression. J’avais d’ailleurs indiqué en première lecture que ces dispositions me semblaient à la fois peu utiles et excessives. Je partage pleinement vos arguments, madame la sénatrice.

C’est l’un des points sur lesquels nous ne sommes évidemment pas d’accord avec la majorité de la commission. Une fois de plus, avec cet article 43 ter, qui ne figure pas dans le texte de l’Assemblée nationale, on retrouve une logique, souvent entendue dans cette enceinte : il faut que le magistrat retienne la récidive, et, s’il y renonce, il doit le faire par une décision spécialement motivée. Cela révèle une méfiance à l’égard des magistrats et alimente la réputation de laxisme de la magistrature que d’aucuns voudraient lui donner. Malgré tout, nos prisons sont pleines et nous manquons de places, ce qui prouve bien que ces politiques sont vaines. C’est un affichage auquel nous refusons de nous associer.
Je le répète, nous sommes en désaccord avec la majorité sénatoriale sur ce point, comme sur d’autres en matière pénale, même si un consensus a pu se faire jour sur certains aspects du texte. Nous voterons l’amendement de suppression de l’article 43 ter. Je m’apprêtais de toute façon à émettre un vote négatif sur cet article, mais je préfère encore voter officiellement sa suppression.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 43 ter est adopté.
I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l’article 132-29 est ainsi rédigée : « des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37. » ;
2° L’article 132-35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « sans sursis qui emporte révocation » ;
b) Les mots : « totale ou partielle » sont supprimés ;
3° L’article 132-36 est ainsi rédigé :
« Art. 132 -36. – Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion révoque le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu’il accompagne.
« Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l’emprisonnement ou la réclusion.
« La révocation du sursis est intégrale. » ;
4° L’article 132-37 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ayant ordonné la » sont remplacés par les mots : « sans sursis emportant » ;
b) La seconde occurrence des mots : « du sursis » est supprimée ;
5° L’article 132-38 est ainsi rédigé :
« Art. 132 -38. – En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.
« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;
6° À l’article 132-39, les mots : « totale du sursis n’a pas été prononcée dans les conditions prévues à l’article 132-36 » sont remplacés par les mots : « du sursis n’a pas été encourue » ;
7° Le premier alinéa de l’article 132-42 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
c) À la dernière phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;
8° Au premier alinéa de l’article 132-47, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
9° L’article 132-48 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne, après avis du juge de l’application des peines » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, faire obstacle à la révocation du sursis antérieurement accordé. » ;
10° Au début de l’article 132-49, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu’une fois. » ;
11° L’article 132-50 est ainsi rédigé :
« Art. 132 -50. – Si la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d’abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, la juridiction ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution. »
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 735 est abrogé ;
2° À l’article 735-1, la référence : « 735 » est remplacée par la référence : « 711 ».

L’amendement n° 63, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Une fois de plus, ai-je envie de dire, cet article résulte d’un amendement adopté en première lecture sur l’initiative du groupe Les Républicains et s’inscrit dans la même démarche que les deux précédents. Aussi, nous souhaitons également le supprimer.
Nous sommes dans un vrai débat : que doit être la justice dans notre pays ? La majorité sénatoriale a fait le choix d’afficher une fermeté, une conviction sécuritaire qui, il faut bien le reconnaître, fait peu de cas des libertés fondamentales. Nous ne sommes pas les seuls à le dire : de nombreuses associations, voire le Défenseur des droits, le reconnaissent. Ces mesures votées par la commission remettent en cause l’efficacité du droit, du pouvoir du juge et ne tiennent absolument pas compte du souci, pourtant partagé par tous, d’éviter la surpopulation carcérale. Au-delà de nos positions sur les questions sécuritaires et sur l’enfermement, nous avons tous et toutes à cœur d’avoir dans notre pays des prisons dignes qui permettent réellement de réinsérer l’individu dans la société à l’issue de sa peine.
Le groupe Les Républicains entend revenir à la révocation automatique du sursis en vigueur avant 2014.
Cette disposition avait été supprimée, parce qu’elle avait fait la preuve de son inefficacité et même de sa dangerosité. Elle pouvait en effet conduire à l’incarcération de personnes condamnées à de petites peines.
Nous estimons que le présent article porte atteinte à l’important principe de l’individualisation des peines. La majorité sénatoriale, à nos yeux, brouille une nouvelle fois les pistes en dévoilant ses convictions sécuritaires, loin des opinions affichées par le mouvement en cours au sein de la justice.
On ne peut pas, d’un côté, appeler de ses vœux une prison qui réinsère, et, de l’autre, vouloir toujours punir plus lourdement, donc incarcérer davantage.

Nous avons besoin d’une justice qui travaille à la réinsertion plus que d’un affichage de positions sécuritaires, lesquelles peuvent rassurer dans l’immédiat, mais jamais sur le long terme.

Avis défavorable. Nous sommes sur le même dispositif que précédemment. L’article 43 ter concernait la récidive, tandis que celui-ci porte sur la révocation d’office du sursis. Il faut bien comprendre qu’il appartiendra toujours au magistrat de décider si le sursis doit être révoqué ou levé, en fonction des circonstances de fait. C’est un message fort qui est envoyé. Nous voulons être clairs à l’égard de l’ensemble des prévenus.
Madame Cukierman, la politique pénale ne se limite pas à ces éléments précis. Elle est beaucoup plus complexe et multifactorielle. Néanmoins, en matière d’exécution des peines, nous avons toujours dit que nous souhaitions donner au tribunal un large panel de mesures, justement pour tenir compte des situations particulières des personnes qui comparaissent. On ne peut pas voir la politique pénale uniquement à travers ces deux articles.
Avis favorable. Je considère en effet que les dispositions du présent article sur l’automaticité vont à l’encontre du principe de l’individualisation des peines, même si M. le rapporteur a présenté des mécanismes censés y remédier.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 43 quater est adopté.
I. – L’article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, après les mots : « de probation », sont insérés les mots : « ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » et après les mots : « d’une enquête », sont insérés les mots : «, de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés » ;
2° Au même septième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d’une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire. » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : «, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction, » sont supprimés.
II. – Le septième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « de probation », sont insérés les mots : « ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction » sont remplacés par les mots : « saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen ».
III. – Les deux premiers alinéas de l’article 132-70-1 du code pénal sont ainsi rédigés :
« La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l’égard d’une personne physique lorsqu’il apparaît opportun d’ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d’une peine adaptée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.
« Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine et ordonne, s’il y a lieu, le placement de la personne jusqu’à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire. »
IV. –
Non modifié
Le dossier unique de personnalité centralise les rapports, expertises et évaluations relatifs à la personnalité et à la situation matérielle, familiale et sociale des personnes mentionnées au premier alinéa du présent IV qui ont été réalisés ou collectés :
1° Au cours de l’enquête ;
2° Au cours de l’instruction ;
3° À l’occasion du jugement ;
4° Au cours de l’exécution de la peine ;
5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d’une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;
6° En application des articles 706-136 ou 706-137 du code de procédure pénale ;
7° Durant le déroulement d’une hospitalisation d’office ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique.
Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système sécurisé de télécommunication :
a) À l’autorité judiciaire ;
b) Aux agents des services d’insertion et de probation chargés du suivi de ces personnes, au personnel des greffes des établissements pénitentiaires ainsi qu’aux agents de l’administration centrale en charge des orientations et affectations à compétence nationale.
Les avocats, les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l’autorité judiciaire ou l’administration pénitentiaire d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité ainsi que les personnes habilitées dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81 du code de procédure pénal peuvent également être destinataires, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire et pour l’exercice de leurs missions, des informations contenues dans le dossier unique de personnalité.
En cas de décision de classement sans suite ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.
Les modalités d’application du présent IV sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les modalités de fonctionnement du système sécurisé de télécommunication et les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l’objet ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement.
L’expérimentation du dossier unique de personnalité est prévue pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu à l’avant-dernier alinéa du présent IV. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. –
Adopté.
I A. – Le deuxième alinéa de l’article 132-1 du code pénal est complété par les mots : « et motivée ».
I B. – Le premier alinéa de l’article 132-17 du code pénal est complété par les mots : « et motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ».
I. – L’article 132-19 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132 -19. – Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
« En matière correctionnelle, toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à un an, elle fait l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 au regard de la personnalité du condamné et de sa situation matérielle, familiale et sociale, sauf impossibilité matérielle.
« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément à l’article 464-2 du code de procédure pénale. »
II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l ’ extérieur
« Art. 132 -25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou de la peine de probation dont la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à un an, ou une peine dont la durée de l’emprisonnement restant à exécuter suite à une détention provisoire est inférieure ou égale à un an, la juridiction de jugement ordonne, sauf décision spécialement motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.
« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du prévenu, préalablement informé qu’il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d’office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord.
« Art. 132 -26. – Le condamné placé sous surveillance électronique est astreint à l’interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le tribunal correctionnel ou le juge de l’application des peines en dehors des périodes déterminées par celui-ci. Il est également astreint au port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans ces lieux et pendant ces périodes.
« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l’établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l’application des peines.
« Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour le condamné à l’exercice d’une activité professionnelle, au suivi d’un enseignement, d’un stage, d’une formation ou d’un traitement, à la recherche d’un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d’insertion ou de réinsertion.
« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités ou à faire l’objet d’une prise en charge sanitaire en dehors de l’établissement pénitentiaire.
« Le placement sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l’extérieur emportent également pour le condamné l’obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines.
« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues aux articles 131-4-2 à 131-4-5. »
II bis. – À l’article 132-27 du code pénal, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à » sont remplacés par le mot : « d’ ».
III. – Après l’article 464-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 464-2 ainsi rédigé :
« Art. 464 -2. – I. – Lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel peut :
« 1° Soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, selon des modalités fixées à l’audience ou déterminées par le juge de l’application des peines ;
« 2° Soit ordonner que le condamné est convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément à l’article 474, afin que puisse être prononcée une telle mesure conformément à l’article 723-15 ;
« 3° Soit décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 723-15 à 723-18 ;
« 4° Soit, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre le condamné.
« Dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent I, en application de l’article 132-19 du code pénal, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.
« II. –
Supprimé
« III . – Le 3° du I est également applicable lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.
« IV . – Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, assortir ce mandat de l’exécution provisoire. »
IV. –
Non modifié
V. – L’article 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464-2, en cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, la personne condamnée présente à l’audience peut être convoquée à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours, en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine, et devant le juge de l’application des peines, dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement sous surveillance électronique ou du placement à l’extérieur.
« L’avis de convocation devant le juge de l’application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « une contrainte pénale, à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « une peine de probation ou une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation » ;
3° à 5°
Supprimés
V bis. –
Supprimé
VI et VII. –
Non modifiés
VIII. – La première phrase du premier alinéa de l’article 723-15 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464-2 et qu’il a ordonné la convocation du condamné devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation, » ;
2° Les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et, à la fin, la référence : « à l’article 132-57 du code pénal » est remplacée par la référence : « à l’article 747-1 » ;
3°
Supprimé
IX. –
Supprimé
X. – À la première phrase de l’article 723-15-1 du code de procédure pénale, après le mot : « convocation, », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article 474 ».
XI. – À la première phrase de l’article 723-17 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 723-17-1 du code de procédure pénale, les mots : « mentionnée à l’article 723-15 » sont remplacés par les mots : « à une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an ».
XII. –
Supprimé

L’amendement n° 64, présenté par Mmes Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Esther Benbassa.

Au sein de l’article 45 que nous examinons, l’alinéa 38 vise la suppression de l’automaticité de la procédure d’examen des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure à deux ans, en vue d’un aménagement de peine.
En effet, les articles 474 et 723-15 du code de procédure pénale prévoient l’examen du dossier par le juge de l’application des peines selon la situation des personnes condamnées à des courtes incarcérations en vue de leur proposer une peine alternative à l’emprisonnement.
Rappelons donc que l’individualisation de la peine est le principe en matière d’exécution des sentences et que l’incarcération doit être considérée comme le dernier recours. Ce principe, inscrit à l’article 132-1 du code pénal, est purement occulté par notre gouvernement.
Pourtant, nous le savons, la courte incarcération a des effets délétères sur la personne condamnée. Elle peut également être la cause de suicide chez les personnes les plus vulnérables, à l’instar de ce jeune homme de 25 ans, condamné à une brève peine de prison pour délit de fraude dans les transports en commun, qui s’est donné la mort dans sa cellule de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis quelques jours avant sa sortie, l’année dernière. J’ai justement visité cet établissement voilà quelques semaines.
Adeline Hazan a rappelé à ce sujet que les politiques publiques doivent « avoir le courage d’instaurer un système de régulation carcérale, en s’interrogeant enfin sur le sens des très courtes peines » et en développant des mesures alternatives à l’incarcération.
Nous ne pouvons que regretter le parti pris de l’exécutif et le recul net de tous nos principes fondateurs en matière de pénologie. Nous proposons en conséquence de supprimer l’article 45.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. J’étais sur une lancée d’avis favorables, et je suis désolée que l’amendement de Mme Benbassa fasse l’objet d’un avis défavorable.
Sourires.
À mes yeux, les dispositions prévues par l’article 45, telles que le Gouvernement les avait rédigées, et non pas telles que la commission des lois les a réécrites, sont utiles. Faire passer la durée de détention prévue à l’article 723-15 du code de procédure pénale de deux ans à un an nous permettra de mieux assurer la vérité des peines prononcées et de rendre plus conforme leur exécution par rapport au jugement. Par ailleurs, l’institution du mandat de dépôt à effet différé donnera au tribunal correctionnel la possibilité d’assumer une véritable responsabilité quant aux jugements prononcés, le cas échéant en décidant qu’il n’y a pas d’aménagement ab initio de la peine. Pour ces raisons, je souhaite le maintien de l’article 45.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Antiste, Mme Conconne, MM. P. Joly et Lalande, Mme Artigalas et M. Raynal, est ainsi libellé :
Alinéas 11, trois fois, et 21
Remplacer les mots :
un an
par les mots :
deux ans
La parole est à M. Maurice Antiste.

Les prisons françaises sont surpeuplées, particulièrement dans les outre-mer : on dénombrait 70 710 détenus, dont 5 108 dans les collectivités d’outre-mer au mois de juillet dernier.
Tel est, par exemple, le cas de la maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Ducos, mais également des prisons de Baie Mahaut et Basse-Terre en Guadeloupe, et de Remire-Montjoly en Guyane, qui connaissent un taux d’occupation supérieur à 130 %.
L’une des intentions affichées dans les motifs de ce projet de loi est le désengorgement des prisons. Dans le contexte actuel, le renforcement du recours à des peines alternatives à la détention, à l’aménagement de peine, ainsi qu’à la libération conditionnelle constitue effectivement un enjeu essentiel.
Or il existe une contradiction entre cette intention affichée et les effets des dispositions prévues, notamment, par l’article 45, lequel risque, au contraire, de renforcer la surpopulation carcérale.
Le renforcement de l’aménagement des peines inférieures ou égales à un an de prison que prévoit le projet de loi constitue, certes, une avancée de principe, mais elle ne fait qu’entériner la pratique des tribunaux correctionnels. Il est très rare, en effet, voire exceptionnel, que des peines de prison d’un mois fassent l’objet d’un mandat de dépôt. Les peines d’emprisonnement de six mois à un an, sauf motivation spéciale, font déjà souvent l’objet d’un aménagement.
En revanche, le projet de loi avalise un recul important en rendant impossible l’aménagement des peines de plus d’un an d’emprisonnement, alors qu’une telle mesure est actuellement possible jusqu’à deux ans d’emprisonnement. L’office du juge de l’application des peines sera donc considérablement réduit. Ce magistrat dispose pourtant d’un pouvoir important en vue de faciliter l’insertion ou la réinsertion des condamnés.
C’est pour ces raisons que nous proposons de remplacer, à l’alinéa 11, les mots « un an » par les mots « deux ans ».

Avis défavorable. La commission souhaite rester au seuil d’un an fixé par le texte.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Antiste, Mme Conconne, MM. P. Joly et Lalande, Mme Artigalas et M. Raynal, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 24, 28 et 29
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 33
Remplacer, deux fois, les mots :
un an
par les mots :
deux ans
III. – Alinéa 40
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 41
Supprimer les mots :
Les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » et, à la fin,
La parole est à M. Maurice Antiste.

M. Maurice Antiste. J’offrais au Gouvernement, ainsi qu’au rapporteur, l’occasion de se déculpabiliser d’avoir si souvent, ce soir, prononcé des avis négatifs, mais ils n’ont pas saisi la perche. C’est bien dommage ! Je fais tout de même une nouvelle tentative sur cet article.
Sourires.

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions instituant un mandat de dépôt différé, au profit d’un recours aux peines alternatives à l’incarcération.
Le mandat de dépôt doit en effet demeurer une exception, justifiée par l’absolue nécessité que le condamné aille directement en prison. Or le risque du mandat de dépôt différé est que la décision d’incarcération devienne moins exceptionnelle pour les magistrats du tribunal correctionnel. Cette disposition banalise l’acte d’emprisonnement et restreint de fait, encore une fois, les possibilités d’aménagement de peine.
Le Syndicat de la magistrature l’indique : « Le tribunal n’aura plus à assumer la violence de l’emprisonnement immédiat – l’émotion des proches, l’interpellation à la barre par les policiers –, mais l’incarcération sera inéluctable ».

Nous pensons que le dispositif du mandat de dépôt différé est utile à un meilleur dialogue entre le procureur de la République et l’administration pénitentiaire. C’est une proposition intéressante que nous avons soutenue, d’autant plus que le Sénat en est à l’origine, dans le cadre d’une proposition de loi que nous avions adoptée au mois d’octobre 2017. L’avis de la commission est par conséquent défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 45 est adopté.
(Supprimé)
I. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717-1, la référence : « 721 » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés ;
2° L’article 721 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : «, de l’éventuelle réduction de la peine prévue à l’article 721-1 » ;
3° L’article 721-1 est ainsi rédigé :
« Art. 721 -1. – Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d’incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année.
« Son quantum est fixé en tenant compte :
« 1° Des efforts de formation du condamné ;
« 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;
« 3° De ses recherches d’emploi ;
« 4° De l’indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;
« 5° De sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.
« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :
« a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717-1 et 763-7 ;
« b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;
« c) Pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.
« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d’incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;
4° L’article 721-1-1 est abrogé ;
5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721-2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
6° À l’article 723-29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.
II. – L’article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les juridictions d’application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l’une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »
III. – Le 1° de l’article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé.

L’amendement n° 65, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Cet amendement s’inscrit dans la lignée de ceux que nous avons déposés précédemment pour nous opposer au durcissement du texte proposé en matière pénale par le Gouvernement, puis, par la majorité sénatoriale.
La limitation du mécanisme de réduction de peine ne pourra qu’alourdir la surpopulation pénale.
Bien sûr, nous en convenons, il existe des erreurs judiciaires, ce qui ne nous satisfait pas, mais l’automaticité de la réduction de peine est une règle bien établie et prise en compte par les magistrats. Rendre cette règle floue peut, à notre sens, perturber l’organisation actuelle de l’échelle des peines.
Avis favorable. Je considère en effet que les crédits de réduction de peine sont extrêmement utiles dans la détention des personnes détenues et leur suivi.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 45 bis A est adopté.
À la fin du premier alinéa de l’article 785 du code de procédure pénale, les mots : « d’une année seulement à dater du décès » sont remplacés par les mots : « de vingt ans à compter du décès ». –
Adopté.
L’article 709-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport annuel comprend également une présentation de la politique pénale et d’aménagement des peines du ministère public, une présentation de la jurisprudence du tribunal de grande instance en matière de peines privatives de liberté, ainsi qu’une synthèse des actions et conclusions de la commission de l’exécution et de l’application des peines du tribunal. » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et transmis au Parlement » ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est présenté et fait l’objet d’échanges au sein du conseil de juridiction. Il est également présenté au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, ainsi qu’au sein des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. » –
Adopté.
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-36-1 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En matière criminelle ou correctionnelle, la juridiction de jugement… (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance, prévues aux articles 131-4-2 à 131-4-5, destinées à prévenir la récidive et à assurer sa réinsertion sociale.
« La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour un délit, dix ans pour un délit commis en récidive ou mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s’appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l’application des peines de mettre fin à la mesure à l’issue d’un délai de trente ans, selon les modalités prévues à l’article 712-7 du même code. » ;
c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « juge de l’application des peines » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné » ;
2° Les articles 131-36-2 et 131-36-3 sont abrogés ;
3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 131-36-4 et au second alinéa de l’article 131-36-12, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
4° Les articles 221-9-1, 221-15, 222-65, 224-10, 227-31 et 421-8 sont abrogés ;
5° L’article 222-48-1 est ainsi rédigé :
« Art. 222 -48 -1. – En cas de condamnation pour une infraction définie aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14 et 222-18-3 commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d’assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 763-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 131-36-2 et 131-36-3 » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa de l’article 131-36-1 » ;
b) À la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Le premier alinéa de l’article 763-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « En cas d’inobservation des obligations mentionnées à l’article 131-36-1 du code pénal ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines saisit, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa du même article 131-36-1. » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;
3° Au quatrième alinéa de l’article 763-10, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». –
Adopté.
Chapitre II
Dispositions relatives à la probation
I. – L’article 131-4-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131 -4 -1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou d’un délit de droit commun, puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans au plus, ou d’une durée de dix ans au plus lorsque la personne est en état de récidive légale, le justifient, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement une peine de probation.
« Dès le prononcé de la condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l’article 131-4-3.
« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.
« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
« Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que la peine de probation consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.
« La juridiction fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue.
« Après le prononcé de la peine, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations et interdictions à respecter au titre de la probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations et interdictions particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.
« Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa du présent article.
« La condamnation à la peine de probation est exécutoire par provision. »
1° à 13°
Supprimés
II. – Après l’article 131-4-1 du code pénal, sont insérés des articles 131-4-2 à 131-4-8 ainsi rédigés :
« Art. 131 -4 -2. – La juridiction fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Le délai de probation ne peut excéder la durée de la peine d’emprisonnement encourue.
« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues à l’article 131-4-3 et à celles des obligations particulières prévues à l’article 131-4-4 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.
« Art. 131 -4 -3. – Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
« 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;
« 2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
« 3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
« 4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
« 5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
« 6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.
« Art. 131 -4 -4. – La juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
« 2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;
« 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
« 4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
« 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
« 6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
« 7° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ;
« 8° Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;
« 9° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
« 10° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
« 11° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ;
« 12° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
« 13° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;
« 14° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
« 15° Ne pas détenir ou porter une arme ;
« 16° Accomplir, à ses frais, un des stages prévus à l’article 131-5-1 du présent code ;
« 17° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent 17° ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;
« 18° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
« 19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
« 20° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;
« 21° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ;
« 22° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 ;
« 23° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement.
« Art.131 -4 -5. – Les mesures d’aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.
« Ces mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y a lieu, d’une aide matérielle, sont mises en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.
« Art. 131 -4 -6. – Lorsque la peine de probation accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
« Art. 131 -4 -7. – En cas de non-respect de ses obligations par le condamné, le juge de l’application des peines peut ordonner l’emprisonnement de la personne.
« Art. 131 -4 -8. – La condamnation à la peine de probation est réputée non avenue lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant son emprisonnement. »
II bis. –
Supprimé
III. – La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.
IV. –
Non modifié
V. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° À l’article 20-4, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article 20-5, les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;
3° Au premier alinéa de l’article 20-10, la référence : « 132-43 » est remplacée par la référence : « 131-4-2 ».
VI. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article 230-19, les mots : « d’une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « d’une peine de probation » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 720-1, au sixième alinéa de l’article 720-1-1, à la première phrase de l’article 723-4, au second alinéa de l’article 723-10, au 1° de l’article 723-30 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 731, les références : « 132-44 et 132-45 » sont remplacées par les références : « 131-4-3 et 131-4-4 » ;
3° Le I de l’article 721-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 » ;
b) Au 2°, la référence : « 132-45 » est remplacée par la référence : « 131-4-4 » ;
4° Au premier alinéa de l’article 723-10, les références : « 132-43 à 132-46 » sont remplacées par les références : « 131-4-2 à 131-4-5 ».
VII. – À l’article 132-64 du code pénal, les mots : « de la mise à l’épreuve, tel qu’il résulte des articles 132-43 à 132-46 » sont remplacés par les mots : « de la peine de probation, tel qu’il résulte des articles 131-4-2 à 131-4-5 ».
VIII. – L’article L. 265-1 du code de justice militaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « 132-57 » est remplacée par la référence : « 132-39 » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 ».

L’amendement n° 37, présenté par Mme Lubin, MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 6
Après les mots :
service pénitentiaire d’insertion et de probation
insérer les mots :
ou par la personne morale habilitée
La parole est à M. Jacques Bigot.

Il s’agit d’un amendement de cohérence. Le texte adopté par la commission des lois du Sénat en première et seconde lectures prévoit en effet, à l’article 47, que le suivi de la personne condamnée à une peine de probation est assuré aussi bien par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le SPIP, que par une association habilitée – une personne morale habilitée.
Aussi, la personne morale habilitée sera tout autant que le SPIP amenée à réaliser des évaluations régulières dans le cadre de la peine de probation.
Cet amendement vise à pallier un oubli rédactionnel en ajoutant, aux alinéas 5 et 6, la possibilité d’avoir recours aux personnes morales habilitées.
C’est un avis défavorable, car cette proposition est liée à la création de nouveau de la peine de probation à laquelle je ne suis pas favorable telle que le Sénat l’a conçue.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 46 est adopté.
I A et I B. –
Supprimés
I. – Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« TITRE I ER BIS
« DE LA PEINE DE PROBATION
« Art. 713 -42. – Lorsqu’une condamnation à une peine de probation est prononcée, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues à l’article 712-10.
« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire à l’ensemble des mesures de contrôle prévues à l’article 131-4-3 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues à l’article 131-4-4 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, y compris pendant une période d’incarcération du condamné, prendre le juge de l’application des peines en application des dispositions de l’article 712-8 du présent code.
« Art. 713 -43. – Au cours du délai de probation, le juge de l’application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s’assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l’exécution des mesures de contrôle et d’aide et des obligations imposées à ce condamné.
« Art. 713 -44. – Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu’il en est requis, devant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel il est placé.
« En cas d’inobservation des obligations et mesures de contrôle, les dispositions de l’article 712-17 sont applicables.
« Art. 713 -45. – En cas d’incarcération pour une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou devant une personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s’il s’agit d’une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée est alors saisi de la mesure de probation.
« Art. 713 -46. – Lorsque le tribunal a fait application du cinquième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal et a prononcé une peine de probation avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.
« À l’issue de cette évaluation, le service ou la personne morale habilitée adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle prévues à l’article 131-4-3 du même code, d’assistance prévues à l’article 131-4-5 dudit code et des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 131-4-4 du même code.
« Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 131-4-1 du même code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application du même troisième alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie.
« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.
« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou par la personne morale habilitée ainsi que par le juge de l’application des peines.
« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712-8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles.
« Lorsque le tribunal n’a pas fait application de l’article 131-4-1 du code pénal, le juge de l’application des peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l’exécution de la probation, d’ordonner un suivi renforcé.
« Art. 713 -47. – Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l’article 713-42, lorsque le condamné commet, pendant la durée d’exécution de la peine de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai de probation. Il peut aussi ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du sixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6 du présent code.
« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de l’emprisonnement s’est produit pendant le délai de probation.
« Art. 713 -48. – Lorsque le juge de l’application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut, au total, être supérieur à trois années.
« Art. 713 -49. – Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d’aide et aux obligations particulières imposées en application de l’article 713-42 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l’application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l’application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d’office avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6.
« Art. 713 -50. – Lorsque le condamné à une peine de probation doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 10° et 14° de l’article 131-4-4 du code pénal, le juge de l’application des peines, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l’épreuve.
« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« Art. 713 -51. – La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts.
« Elle ne s’étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
« Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article 713-48 du présent code ou de l’article 131-4-8 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s’applique pas à la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d’avoir effet à l’issue d’un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.
« Art. 713 -52. – Les dispositions relatives aux effets de la peine de probation sont fixées à l’article 131-4-8 du code pénal. »
II. – Le chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est abrogé.
(Supprimés) –
Adopté.
III à V. – §
Chapitre III
Dispositions relatives à l’exécution des peines
(Supprimé)
Au troisième alinéa de l’article 733 du code de procédure pénale, les mots : « doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « ne peut plus bénéficier d’une nouvelle libération conditionnelle et doit subir toute ».

L’amendement n° 66, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 48 bis est adopté.
(Supprimé)
(Non modifié)
La section 5 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée par un article 723-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 723 -6 -1. – Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous-main de justice faisant l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 723-2 et 723-4 sont agréées par l’État.
« Une convention peut être conclue entre l’État et ces structures pour une durée de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions d’accueil et d’accompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure de placement.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

L’amendement n° 38, présenté par Mme Lubin, MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
La parole est à M. Jacques Bigot.

Mme Lubin souhaitait, à juste titre, modifier l’article 49 bis A dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en remplaçant les mots « peut être » par le mot « est ».
Il s’agit de rendre obligatoire le statut destiné à sécuriser les associations qui vont accueillir les sortants de prison et procéder à ces accompagnements, qui sont indispensables.
Si l’Assemblée nationale a eu raison d’adopter cet article, nous pensons qu’il faut renforcer son efficacité en prévoyant la pérennisation du soutien juridique et financier.

La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement, car il s’agit, en la circonstance, de créer une obligation.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 49 bis A est adopté.
La section 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi rétablie :
« Section 8
« Modalités d’exécution des fins de peine d’emprisonnement en l’absence de tout aménagement de peine
« Art. 723 -19. – Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsque aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut demander à exécuter le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. La demande doit être motivée par un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.
« Cette mesure est ordonnée par le juge de l’application des peines sauf en cas d’impossibilité matérielle, d’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive.
« Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République qui fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 131-4-3 et 131-4-4 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. » –
Adopté.
I A. –
Supprimé
I BA et I B à I E. –
Supprimés
I et II. –
Non modifiés
III. – Après l’article 712-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 712 -4 -1. – Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d’application des peines sont prises après avis de la commission de l’application des peines présidée par le juge de l’application des peines et composée du procureur de la République, du chef d’établissement pénitentiaire et du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
« Lorsque la commission donne son avis sur la situation d’un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l’administration pénitentiaire, la présence du chef d’établissement est facultative. »
IV et V. –
Non modifiés
VI. – L’article 723-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir accordé, en application de l’article 712-5, une première permission de sortir à un condamné majeur, afin de préparer sa réinsertion professionnelle ou sociale ou de maintenir ses liens familiaux, le juge de l’application des peines peut déléguer cette prérogative au chef d’établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d’octroi de la permission de sortir par le chef d’établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l’application des peines qui statue conformément au même article 712-5. »
VII. –
Non modifié
VIII. – L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en peine de travail d’intérêt général ou de jour-amende ».
IX. – L’article 747-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 747 -1. – En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d’un sursis, le juge de l’application des peines peut, avant la mise à exécution de l’emprisonnement ou en cours d’exécution de celui-ci, ordonner, d’office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 723-15, la conversion de cette peine en peine de travail d’intérêt général ou en peine de jour-amende lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.
« Lorsque la peine est convertie en travail d’intérêt général, la durée de la peine d’emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en cas de non accomplissement du travail par le condamné. Cette conversion n’est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.
« Lorsque la peine est convertie en peine de jour-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d’emprisonnement prononcé ou du reliquat de cette peine.
« Dès sa saisine, le juge de l’application des peines peut ordonner la suspension de l’exécution de la peine jusqu’à sa décision sur le fond. »
X et XI. –
Supprimés
XII. – L’article 747-2 du code de procédure pénale est abrogé.
(Supprimé) –
Adopté.
XIII. – §
(Supprimé)
Après l’article 707-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 707 -1 -1. – L’Agence de l’exécution des peines est un service à compétence nationale, placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, ayant pour mission de centraliser la gestion des procédures complexes d’exécution des peines.
« L’Agence de l’exécution des peines :
« 1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d’aider les juridictions dans leurs missions d’exécution des peines ;
« 2° Assure la gestion des dossiers d’exécution complexes en matière de peines privatives de liberté ou de peines restrictives de droit résultant de condamnations étrangères de personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant en France ;
« 3° Assure la mise à exécution des peines de confiscation prononcées par les juridictions françaises concernant des biens ou une personne étrangère ;
« 4° Représente le ministère de la justice au sein des instances de la coopération internationale compétentes en matière d’exécution des peines ;
« 5° Élabore chaque année un rapport d’activité rendu public, qui peut comprendre des propositions d’évolution du droit de l’exécution des peines.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » –
Adopté.
Chapitre III bis
Du droit de vote des détenus
I. – À titre expérimental et pour le prochain renouvellement général du Parlement européen, les personnes détenues remplissant les conditions pour être électeur peuvent voter par correspondance sous pli fermé, dans les conditions fixées au présent article.
II. – Les personnes détenues sont informées de ce droit au moins huit semaines avant le scrutin. Elles reçoivent, à une date fixée par décret en Conseil d’État, les bulletins et le matériel de vote ainsi que les circulaires des candidats.
À partir du répertoire électoral unique, prévu à l’article L. 16 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, l’Institut national de la statistique et des études économiques notifie au chef de l’établissement pénitentiaire les communes dans lesquelles les personnes sont inscrites sur la liste électorale ou sur la liste électorale complémentaire.
III. – Le jeudi précédant le scrutin, la personne détenue peut, après passage dans l’isoloir, remettre au chef de l’établissement pénitentiaire un pli contenant son bulletin de vote, par dérogation aux articles L. 54 et « L. 55 du code électoral.
La personne détenue signe une attestation de remise sur laquelle figure le numéro du pli.
Au plus tard le vendredi précédant le scrutin, le chef de l’établissement pénitentiaire transmet ce pli à la commune dans laquelle la personne détenue est inscrite sur la liste électorale ou sur la liste électorale complémentaire. Un avis de réception de son pli lui est transmis sans délai.
IV. – Les conditions de l’enregistrement, de conservation et de transfert du pli sont définies par décret en Conseil d’État.
V. – À la clôture du bureau de vote et par dérogation à l’article L. 62-1 du code électoral, le président du bureau de vote et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.
VI. – Au plus tard six mois après le prochain renouvellement général du Parlement européen, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation. –
Adopté.
Chapitre III ter
Dispositions pénitentiaires
(Non modifié)
I. – L’article 714 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.
« Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d’un quartier spécifique, dans les conditions prévues à l’article 726-2. »
II. – Le second alinéa de l’article 717 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les condamnés peuvent également être affectés en maison d’arrêt au sein d’un quartier spécifique dans les conditions prévues à l’article 726-2. »
III. – L’article 726-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 726 -2. – Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l’autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d’un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée.
« La décision d’affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et ne peut intervenir qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l’objet d’un nouvel examen régulier.
« Cette décision n’affecte pas l’exercice des droits mentionnés à l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité.
« L’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s’effectuer à l’écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » –
Adopté.
(Supprimé)
Chapitre IV
Favoriser la construction d’établissements pénitentiaires
I. – Pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études opérationnelles avant le 31 décembre 2022, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement concernant les projets définis à l’article L. 122-1 du code de l’environnement s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123-19 du même code.
La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 121-1-1 dudit code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public.
Le maître d’ouvrage verse l’indemnité relative à la mission des garants de la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.
Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
II. –
Supprimé
III. – Une opération d’extension ou de construction d’un établissement pénitentiaire entrée en phase d’études opérationnelles avant le 31 décembre 2022 peut être réalisée selon la procédure définie par les II à VI de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.
Par dérogation au même article L. 300-6-1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation est assurée conformément au I du présent article.
IV. – Pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études opérationnelles avant le 31 décembre 2022, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements peuvent céder à l’État à titre gratuit ou à une valeur inférieure à leur valeur vénale des terrains de leur domaine privé destinés à l’extension ou à la construction d’établissements pénitentiaires.
V. – Le premier alinéa de l’article 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Au dernier trimestre de l’année 2019, puis au troisième trimestre de l’année 2022, le Gouvernement… (le reste sans changement). » –
Adopté.
La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l’article 4, les mots : «, les correspondances et tout autre moyen de communication » sont remplacés par les mots : « et les correspondances » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer, dans leur cellule, d’un terminal mobile ni de terminaux autonomes de connexion à Internet. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La correspondance écrite s’entend par voie postale à l’exclusion de la voie électronique. L’accès libre à Internet n’est pas autorisé aux détenus. » –
Adopté.
L’article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les visiteurs font l’objet de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement. »

L’amendement n° 67, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Un certain nombre d’associations et les auteurs de cet amendement estiment que le dispositif prévu à l’article 51 ter en matière de fouille entraîne un fort ralentissement de l’activité de ceux que l’on appelle communément les « visiteurs de prison ». Ces dispositions, qui visent à soumettre les personnes titulaires d’un permis de visite à toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement avant leur entrée en détention, ont été intégrées, en première lecture, à la suite de l’adoption d’un amendement du groupe Les Républicains.
Limiter ainsi la capacité d’action de ces visiteurs – chacun pensera à l’association Genepi – est contraire à la recherche d’un bon climat lors de la détention et d’une future bonne réinsertion.
Beaucoup de femmes et d’hommes reculent, à juste titre, devant ces pratiques peu conformes au respect de la dignité et de leur rôle, utile, pour la société.
Nous proposons au Sénat de s’opposer enfin à ces dispositions.

La commission considère qu’il est parfaitement utile que les mesures de contrôle soient effectuées à l’entrée des maisons d’arrêt ou des centres pénitentiaires. Tel est d’ailleurs l’objet du texte que nous avons voté.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Favorable ! En effet, si je partage l’avis de M. le rapporteur sur l’utilité des mesures de contrôle pour les visiteurs de prison, cela me paraît relever davantage de dispositions réglementaires. De plus, mentionner les personnes visées dans le texte de la commission des lois laisserait entendre que d’autres personnes qui pénètrent dans les prisons ne font pas l’objet de tels contrôles. Or toutes doivent faire l’objet des mêmes contrôles de sécurité.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 51 ter est adopté.
(Non modifié)
L’article 12-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l’emprise foncière affectée au service public pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « du domaine affecté à l’établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « peut la retenir en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire. Il » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé. –
Adopté.
(Non modifié)
L’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir… (le reste sans changement). » ;
2° Le même premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. » ;
3° Après le mot : « fouilles », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. »

L’amendement n° 68, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.

Cet amendement de suppression relève du même esprit que le précédent, défendu par Michelle Gréaume.
La vie en prison se déroule dans des conditions particulièrement détestables. Nous sommes assez nombreux ici à user de notre droit de visite dans les établissements pénitentiaires pour le savoir.
La multiplication des suicides, comme celui de ce jeune fraudeur du métro, il y a quelques jours, à Fleury-Mérogis, l’atteste.
Vouloir encore durcir ces conditions sans élaborer d’alternatives est, selon nous, un non-sens et ne peut qu’amener, à terme, une véritable explosion du système pénitentiaire français.
Nous estimons suffisantes les dispositions législatives et réglementaires qui régissent actuellement les fouilles en prison.
Réduire les tensions, violences, actes illégaux en prison dépendra, en premier lieu, d’une baisse de la surpopulation carcérale et du développement de peines de substitution, ainsi que d’une nouvelle politique de réinsertion, exigeant, bien entendu, des moyens budgétaires accrus. Des mesures telles que celles qui sont proposées par le biais du présent article tendent à gérer la situation dans les prisons françaises et donc, quelque part, à accepter sa détérioration sans viser une amélioration sur le fond.
C’est la raison pour laquelle nous proposons au Sénat de voter en faveur de cet amendement de suppression.

L’article 51 quinquies résulte d’un article additionnel ajouté à l’Assemblée nationale, sur l’initiative de deux de nos collègues, MM. Houbron et Breton. Ces derniers avaient, dans le cadre d’une mission d’information relative au régime des fouilles en détention, fait un certain nombre de propositions sur les conditions dans lesquelles ces fouilles devaient avoir lieu, les fouilles intégrales restant naturellement l’exception.
Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale et la commission des lois du Sénat a décidé de le conserver. J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 68.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 51 quinquies est adopté.

Chapitre V
Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants
(Supprimé)
I. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° A à 1° H
Supprimés
1° L’article 33 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du placement en centre éducatif fermé, le magistrat ou la juridiction peut, durant le temps et selon les modalités qu’il détermine, autoriser l’établissement à organiser un accueil temporaire du mineur dans d’autres lieux afin de préparer la fin du placement ou de prévenir un incident grave.
« La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre, y compris en cas d’accueil dans un autre lieu, peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l’emprisonnement du mineur. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
2° Au premier alinéa de l’article 40, après le mot : « devra », sont insérés les mots : « fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement des parents et » ;
3°
Supprimé
II. –
Non modifié
La mesure éducative d’accueil de jour consiste en une prise en charge pluridisciplinaire, en journée, collective, et dont la continuité est garantie à partir d’un emploi du temps individualisé, adapté aux besoins spécifiques du mineur.
Elle est ordonnée pour une durée de six mois renouvelable deux fois. Cette mesure peut se poursuivre ou être renouvelée après la majorité de l’intéressé, avec son accord, dans les mêmes conditions.
L’exécution de cette mesure est confiée par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les ressorts dans lesquels cette mesure peut être prononcée et exercée à titre expérimental, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont définis par arrêté du ministre de la justice.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.
III. –
Supprimé

L’amendement n° 41, présenté par Mme Lubin, MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Après le premier alinéa de l’article 40, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le suivi de ces modalités peut être confié par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse. »
La parole est à M. Jacques Bigot.

Cet amendement vise à préciser les établissements et services pouvant exercer le suivi des modalités du droit de visite et d’hébergement des parents en citant nommément le secteur public et le secteur associatif, afin d’éviter toute confusion sur les opérateurs pouvant mener cette mission d’accompagnement renforcé.
En inscrivant dans la loi l’existence d’un suivi de ces modalités par un établissement ou un service du secteur public ou associatif, il est créé une nouvelle mesure judiciaire pénale d’accompagnement éducatif spécifique qui fait défaut dans le texte présenté.
En effet, le texte, tel qu’il est proposé aujourd’hui, ne rend pas obligatoire ce soutien renforcé à la parentalité au cours des droits de visite et d’hébergement qui doit pourtant être le corollaire obligatoire de ce nouveau droit, s’agissant des jeunes les plus en conflit avec la loi.
Nous proposons donc d’insérer, après le premier alinéa de l’article 40 de l’ordonnance du 2 février 1945, un alinéa ainsi rédigé : « Le suivi de ces modalités peut être confié par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse. »

Demande de retrait ou avis défavorable sur cet amendement, relatif au droit de visite et d’hébergement des mineurs placés.
Je rappelle que les dispositions de l’article 52 reconnaissent aux parents d’un mineur qui fait l’objet d’une mesure de placement un droit de visite et d’hébergement, selon des modalités fixées par le juge des enfants.
Mes collègues signataires de l’amendement proposent de préciser que le suivi de ces modalités est confié par le magistrat à un service ou à un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse.
Cette précision a paru à la commission superfétatoire dans la mesure où ce suivi sera de fait assuré par la structure dans laquelle le mineur aura été placé – un centre éducatif fermé, par exemple –, qu’elle relève du secteur public ou du secteur habilité.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 52 est adopté.
L’article 1635 bis Q du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1635 bis Q. – I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 20 à 50 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
« II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
« 2° Par l’État ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les procédures introduites par les salariés devant un conseil de prud’hommes ;
« 6° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;
« 7° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
« 8° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ;
« 9° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral ;
« 10° Pour les procédures de conciliation mentionnées à l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles déléguées par le juge, en vertu d’une disposition particulière, au conciliateur de justice.
« IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.
« V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
« VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 2 est présenté par MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 87 rectifié est présenté par Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Mézard, Artano, Collin et Corbisez, Mme Jouve et MM. Labbé, Menonville, Requier, Roux et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 2.

Comme vous le savez, la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 avait instauré une contribution pour l’aide juridique forfaitaire de 35 euros pour tout justiciable introduisant une instance.
Ce droit d’ester en justice, acheté sous la forme d’un timbre fiscal, concernait les justices judiciaire, civile, commerciale, prud’homale, sociale, rurale, voire administrative, à l’exception des situations de surendettement, de la saisine du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants.
Cette contribution avait été créée pour assurer le financement de la réforme de la garde à vue à laquelle avait été conduit le gouvernement de M. François Fillon.
Elle avait été supprimée par la loi de finances pour 2014 sur proposition de Mme Taubira, alors garde des sceaux, au motif qu’elle constituait un véritable frein à l’accès au droit. Pour compenser la perte de recettes, une dotation budgétaire – sans doute insuffisante – avait été créée.
Le présent projet de loi prévoit de rétablir une contribution, cette fois pour financer l’aide juridictionnelle. Son montant s’établirait entre 20 et 50 euros.
Je crois savoir que de nombreux rapports ont été rédigés sur l’aide juridictionnelle. Je me demande même, madame Sophie Joissains, si vous n’aviez pas rédigé, avec M. Jacques Mézard, l’un d’entre eux. §Pour l’avoir lu avec une grande attention, je sais que cette contribution n’est pas, selon vous, une bonne piste. Vous évoquiez dans ce rapport d’autres projets de réforme – utiles – qui sont toujours devant nous.
Mes chers collègues, ne créons pas une sorte de droit à la justice qui s’établirait entre 20 et 50 euros. Cela serait forcément pénalisant pour les justiciables, notamment ceux dont les ressources sont les plus modestes. Nous pensons que nous avions bien fait de retirer ce droit de timbre et nous vous proposons de persévérer dans cette voie !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. De persévérer dans l’erreur !
Sourires.

La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 87 rectifié.

En première lecture, nous étions nombreux à nous opposer à la réintroduction de la contribution pour l’aide juridique. Comme cela avait été dit, cette proposition renforce le dualisme de la protection juridique en exonérant les personnes bénéficiant déjà de l’aide juridictionnelle et en faisant donc porter l’effort de cette nouvelle contribution sur les personnes assumant seules leurs frais de justice.
Nos préoccupations se portent en particulier sur les justiciables qui seraient alors victimes de l’effet de seuil.
À cette occasion, madame la ministre, vous nous aviez indiqué avoir engagé des négociations avec le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et la Bâtonnière de Paris, à la suite de la remise d’un rapport sur la question par l’Inspection générale de la justice, l’IGJ, et l’Inspection générale des finances, l’IGF.
Il existe en outre, cela a été dit, des pistes d’origine parlementaire, avancées dès 2014 dans le rapport de nos collègues Jacques Mézard et Sophie Joissains, qui pourraient être explorées – la hausse des droits d’enregistrement et la taxation des contrats d’assurance protection juridique. Elles semblent d’ailleurs avoir été en partie reprises par les inspections dans leur rapport.
Dans l’attente de solutions plus convenables, nous proposons donc la suppression de l’article 52 bis.

La commission des lois a souhaité réintroduire dans ce texte le financement de l’aide juridictionnelle, dont la dépense augmente chaque année, on le sait. Il ne serait donc pas tout à fait anormal de pouvoir demander une contribution. Celle-ci existait sous la forme d’un droit de timbre. Elle a été supprimée en 2013.
Nous proposons de la réintroduire selon un tarif modulé entre 20 et 50 euros. Ce système serait exonératoire pour un certain nombre de personnes, puisque cette contribution ne serait pas acquittée pour plusieurs contentieux auxquels le présent article ajoute les procédures engagées par les salariés devant le conseil de prud’hommes.
Comme par le passé, les personnes éligibles à l’aide juridictionnelle ne seraient pas non plus redevables de cette contribution, qui est susceptible de rapporter à peu près 50 millions d’euros.
La difficulté de l’aide juridictionnelle est aujourd’hui telle que cette idée ne serait pas complètement inintéressante !
Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur les amendements identiques n° 2 et 87 rectifié.
La commission des lois a souhaité réintroduire une contribution pour l’aide juridique en vue de financer l’aide juridictionnelle et de responsabiliser les justiciables à l’introduction d’une instance au civil en modulant son montant, cela a été rappelé, entre 20 et 50 euros.
Les amendements identiques visent à supprimer cette contribution, revenant en cela au texte de l’Assemblée nationale.
Réintroduire le droit de timbre fait débat, il faut le reconnaître. Le droit de timbre peut en effet être une manière de responsabiliser les justiciables en les sensibilisant au coût de la justice et en évitant des saisines abusives. Dans beaucoup de pays d’Europe, le paiement des frais de justice par le justiciable est une réalité, contrairement à ce qui se fait en France.
L’introduction d’un droit de timbre peut également faire craindre, comme vous l’avez souligné, monsieur le sénateur, de freiner l’accès à la justice.
Le sujet ne me semble pas aujourd’hui complètement mûr. Surtout, il ne doit pas être traité – je l’avais dit – sans une réflexion d’ensemble appréhendant plus globalement la question de l’accès à la justice.
Vous avez eu raison de rappeler, madame la sénatrice, que j’avais demandé à l’Inspection générale des finances et à l’Inspection générale de la justice un rapport sur ces sujets. Il m’a été rendu. Dès le vote de la future loi, je prendrai, comme je m’y suis engagée, contact notamment avec le Conseil national des barreaux pour évoquer avec mes interlocuteurs la manière dont le sujet mérite d’être traité. À ce stade, j’émets, au nom du Gouvernement, un avis favorable sur les amendements identiques n° 2 et 87 rectifié.

Comme vient de le dire Mme la garde des sceaux, cette contribution me paraît totalement contraire à la philosophie qui doit être celle de la justice : ouvrir l’accès à tous.
En effet, M. Mézard et moi-même avions commis un rapport préconisant de taxer la protection juridique des contrats d’assurance, ainsi que les actes réglementés, ce qui permettait d’avoir une base extrêmement large et de limiter les montants pour le justiciable.
Je pense, comme Mme la ministre, que nous pouvons attendre la prochaine réforme de l’aide juridictionnelle pour traiter ce problème.
En tout cas, je voterai évidemment les amendements identiques défendus par mes collègues Jean-Pierre Sueur et Maryse Carrère.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ article 52 bis est adopté.
Après l’article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18 -1. – Toute demande d’aide juridictionnelle est précédée de la consultation d’un avocat. Celui-ci vérifie que l’action envisagée n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.
« Cette consultation n’est pas exigée du défendeur à l’action, de la personne civilement responsable, du témoin assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de l’accusé, du condamné et de la personne faisant l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
« La rétribution due à l’avocat pour cette consultation est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle si le demandeur remplit les conditions pour en bénéficier, à l’exception de celles fixées à l’article 7.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

L’amendement n° 88 rectifié, présenté par Mmes M. Carrère et N. Delattre et MM. Mézard, Artano, Collin, Corbisez, Labbé, Menonville, Requier, Roux et Vall, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Maryse Carrère.

Il est proposé, dans le même esprit que celui qui a présidé au dépôt de l’amendement précédent, de supprimer la disposition visant à introduire une consultation obligatoire d’un avocat avant toute demande d’aide juridictionnelle.
En effet, cette mesure ne paraît ni utile ni souhaitable : d’une part, il est déjà possible pour les justiciables de bénéficier de consultations juridiques gratuites avant de solliciter l’aide juridictionnelle, d’autre part, une ambiguïté demeure sur la rémunération de cette consultation obligatoire : si elle était facturée, cela pourrait induire un coût élevé.

Cet amendement vise à supprimer la consultation obligatoire d’un avocat préalablement à un dépôt de demande d’aide juridictionnelle prévue par la commission.
Le dispositif mis en place a pour objet de rendre effectif le principe de filtre inscrit dans les dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui, dans la réalité, n’a jamais été appliquée.
L’article 52 ter prévoit que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.
Cette consultation serait rétribuée comme un acte d’aide juridictionnelle dès lors que le demandeur de l’aide remplirait les conditions et que le bien-fondé de son action serait établi.
Ce dispositif, s’il fonctionne correctement, devrait largement améliorer le contrôle de l’attribution de l’aide juridictionnelle.
Je vais citer quelques chiffres. Aujourd’hui, le dispositif fonctionne comme un système de guichet : 90 % des demandes formulées en première instance donnent lieu à une admission, alors même que ce taux est de 23 % devant la Cour de cassation, car l’aide juridictionnelle est refusée aux demandeurs si aucun moyen de cassation ne peut être relevé. Cela montre l’efficacité du dispositif !
Ce système de contrôle du bien-fondé et de la recevabilité de la demande a également d’autres vertus. Il permettra d’orienter les demandeurs vers des procédures de conciliation voulues par le texte et d’aboutir à un accord amiable pour une part sans doute importante des affaires traitées. De nombreux rapports consacrés au sujet rendus publics ces dernières années proposent divers dispositifs qui n’ont jamais été mis en œuvre jusqu’à cette date. L’objectif de la commission était de remettre en place un dispositif dont l’efficacité semble en tout cas assez évidente.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui vise à supprimer l’article réintroduit par la commission des lois et à revenir ainsi au texte de l’Assemblée nationale.
Des consultations juridiques gratuites sont évidemment d’ores et déjà délivrées dans le cadre des divers dispositifs d’accès au droit.
Nous cherchons en outre à promouvoir le développement des consultations juridiques au sein des juridictions pour mieux conseiller les justiciables et favoriser le recours notamment aux modes alternatifs de règlement des différends.
Il me semble que rendre obligatoire la consultation préalable d’un avocat et prévoir sa rétribution à l’aide juridictionnelle aurait pour conséquence inévitable un coût extrêmement élevé. Je rappelle qu’on recense chaque année près d’un million d’admissions à l’aide juridictionnelle.
J’estime, là encore, qu’une telle orientation doit être étudiée dans le cadre de la réflexion plus globale à laquelle je me suis engagée, ne serait-ce que pour en maîtriser le coût.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 52 ter est adopté.
L’article 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut recueillir » sont remplacés par le mot : « recueille » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« À cet effet, il consulte les services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales. Ceux-ci sont tenus de lui communiquer, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l’intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l’aide juridictionnelle. » –
Adopté.
Au premier alinéa de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le mot : « étrangères » est remplacé par le mot : « relatives ». –
Adopté.
TITRE VI
RENFORCER L’ORGANISATION DES JURIDICTIONS
Chapitre Ier
Améliorer l’efficacité en première instance
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 121-1, les mots : «, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux de première instance » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 121-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal de première instance » ;
b) Après le mot : « différents », sont insérés les mots : « pôles, chambres, » et après le mot : « services », sont insérés les mots : « et, s’il en existe, chambres détachées » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 121-4, les mots : «, les juges des tribunaux d’instance et de grande instance » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux de première instance » ;
3° bis Au premier alinéa de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
4° À l’article L. 123-1, les mots : « grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont remplacés par les mots : « première instance » ;
4° bis Après le même article L. 123-1, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123 -1 -1. – Les fonctionnaires des greffes des tribunaux de première instance sont affectés soit au siège du tribunal, soit au siège d’une chambre détachée. Par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la République près ce tribunal, prise après avis du directeur des services de greffe, leur affectation peut être modifiée, pour nécessité de service et pour une durée limitée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
5° À la deuxième phrase de l’article L. 123-4, les mots : « d’instance, des tribunaux de grande instance et » sont supprimés ;
5° bis Le chapitre IV du titre II du livre Ier est complété par un article L. 124-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124 -1. – Tout projet de création ou de suppression et tout projet de modification du siège ou du ressort d’un tribunal de première instance ou d’une chambre détachée donnent lieu à une évaluation, au vu des observations présentées par le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ainsi que par le conseil départemental, dont il est rendu compte dans un rapport public.
« La même procédure est applicable aux tribunaux pour enfants ainsi qu’aux juridictions mentionnées à l’article L. 261-1.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères sur la base desquels la création ou la suppression ou la modification du siège ou du ressort d’une juridiction ou d’une chambre détachée doit être justifiée. » ;
5° ter À l’intitulé du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
5° quater À la première phrase de l’article L. 211-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
5° quinquies À l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
5° sexies Aux articles L. 211-3 et L. 211-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
5° septies
Supprimé
6° Après l’article L. 211-4-1, il est inséré un article L. 211-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211 -4 -2. – Le tribunal de première instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;
7° L’article L. 211-5 est abrogé ;
7° bis Aux articles L. 211-6, L. 211-7, L. 211-8 et L. 211-9-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
7° ter À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
8°
Supprimé
8° bis Aux articles L. 211-10, L. 211-11, L. 211-11-1, L. 211-12, L. 211-13 et L. 211-14, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
8° ter à 8° quinquies
Supprimés
9° L’article L. 212-1 est ainsi modifié :
a) Le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En matières disciplinaire ou relative à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales, le tribunal de première instance ne peut statuer à juge unique. » ;
10° L’article L. 212-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une affaire, compte tenu de l’objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de première instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d’office ou à la demande de l’une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
10° bis À l’article L. 212-3 et au premier alinéa des articles L. 212-4 et L. 212-6, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
11° Au début de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 212-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 212 -7. – À titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort de la cour d’appel ou, à défaut, par un greffier chef de greffe exerçant ses fonctions au sein du ressort du tribunal de première instance concerné, par décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour. » ;
11° bis
Supprimé
12° Au début de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II, il est ajouté un article L. 212-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 212 -8. – Le tribunal de première instance peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres détachées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
« Les compétences matérielles minimales de l’ensemble des chambres détachées sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Des compétences supplémentaires peuvent être attribuées à ces chambres, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, sur proposition conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. » ;
12° bis À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;
12° ter Aux articles L. 213-1 et L. 213-2, au premier alinéa et au 1° de l’article L. 213-3 et au premier alinéa de l’article L. 213-4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
13° Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, est insérée une sous-section 3 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 3 bis
« Le juge des tutelles
« Art. L. 213 -4 -1. – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
« Le juge des tutelles connaît :
« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;
« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;
« 4° De la constatation de la présomption d’absence ;
« 5° Des demandes de désignation d’une personne habilitée et des actions relatives à l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. » ;
13° bis Aux premier et second alinéas de l’article L. 213-5, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
14°
Supprimé
14° bis Au premier alinéa de l’article L. 213-7, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
14° ter La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Le juge chargé des contentieux de proximité
« Art. L. 213 -8 -1. – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge chargé des contentieux de proximité.
« Le juge chargé des contentieux de proximité connaît, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 € et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €.
« Il connaît également :
« 1° De la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
« 2° Des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ;
« 3° Des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
« 4° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ;
« 5° Des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
« 6° Des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du même code. » ;
14° quater Au premier alinéa de l’article L. 213-9, à la première phrase de l’article L. 214-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
14° quinquies
Supprimé
15° L’article L. 215-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
b) Après les mots : « siège du tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « de première instance. » ;
15° bis À l’article L. 215-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
16° Le chapitre V du titre Ier du livre II est complété par des articles L. 215-3 à L. 215-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 215 -3. – Le greffe du tribunal de première instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.
« Art. L. 215 -4. – Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.
« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.
« Art. L. 215 -5. – Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal de première instance selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 215 -6. – Le tribunal de première instance connaît :
« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;
« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’héritier et des scellés ;
« 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.
« Art. L. 215 -7. – Le tribunal de première instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l’article L. 511-51 du code de commerce. » ;
16° bis Aux articles L. 216-1 et L. 216-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
16° ter À l’intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre II, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
16° quater Aux articles L. 217-1 et L. 217-2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
16° quinquies
Supprimé
17° Le titre II du livre II est abrogé.
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 39-3, il est inséré un article 39-4 ainsi rédigé :
« Art. 39 -4. – Quand un département compte plusieurs tribunaux de première instance, le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l’application du dernier alinéa de l’article 39-2, et d’assurer la coordination des activités s’y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » ;
2° Au début de l’article 52-1, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il y a un ou plusieurs juges d’instruction dans chaque département.
« Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux de première instance dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n’y a pas de juge d’instruction. Ce décret précise quel est le tribunal de première instance dont le ou les juges d’instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l’article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction. » ;
3° L’article 80 est ainsi modifié :
a) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction est compétent pour requérir l’ouverture d’une information devant le ou les juges d’instruction du tribunal de première instance compétents en application du deuxième alinéa ou des quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 52-1, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.
« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent II bis, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de première instance au sein duquel se trouvent le ou les juges d’instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l’ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d’information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.
« Le procureur de la République près ce tribunal de première instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent II bis jusqu’à leur règlement.
« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises initialement compétents. » ;
b) Le début de la première phrase du III est ainsi rédigé : « Si le procureur de la République près le tribunal de première instance dans lequel il y a un ou plusieurs juges d’instruction ou dans lequel il y a un pôle de l’instruction constate qu’une personne est déférée devant lui en vue de l’ouverture d’une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du II bis et qu’il estime que ne doit être ouverte aucune information ou aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte… (le reste sans changement). » ;
4° Le premier alinéa de l’article 712-2 est ainsi rédigé :
« Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l’application des peines dans les tribunaux de première instance dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d’application des peines par département. »
(Supprimés) –
Adopté.
III à VI. – §

Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 44 est présenté par Mme Joissains, MM. Laugier et Canevet, Mmes Vermeillet et Billon, MM. Henno, Grosdidier et Guerriau, Mme N. Goulet, MM. Laménie, Decool et Le Nay, Mme Guidez, M. Moga, Mmes Goy-Chavent et Deseyne, MM. Dufaut, Delcros, B. Fournier, D. Laurent, Longuet et Kern et Mme A.M. Bertrand.
L’amendement n° 69 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 92 rectifié est présenté par Mme Noël, MM. Pellevat et Vial, Mme Deromedi, M. Cuypers, Mmes Garriaud-Maylam, Bories et Morhet-Richaud et M. Panunzi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Sophie Joissains, pour présenter l’amendement n° 44.

Cet amendement vise la suppression de l’article 53, qui, à mon sens, fragilise grandement la justice de proximité et l’égal accès au droit des justiciables. Ce texte instaure en effet un tribunal unique par département, ce qui va évidemment à l’encontre de la grande disparité de nos départements français.
La création de ces tribunaux ne permet pas d’assurer la proximité du justiciable avec les lieux de justice. En fait, elle l’aggrave en raison du risque de suppression de ces chambres détachées, beaucoup plus faciles à fermer qu’une juridiction à part entière.
La ruralité, confrontée à des problèmes de transport, de fermeture de commerces et d’accès aux écoles, est déjà aujourd’hui en grande difficulté. Le service public de la justice doit à tout prix continuer d’être accessible aux justiciables. Or, nonobstant l’engagement du Gouvernement – je ne remets pas sa sincérité en cause – à ne fermer aucun lieu de justice dans l’immédiat en tout cas, il n’en demeure pas moins qu’en leur ôtant leur statut protecteur, le texte permet de facto de faciliter la fermeture de ces lieux. Je suis évidemment opposée à cet article et à ce tribunal unique.

Nous proposons également la suppression de l’article 53. Dans sa version initiale, le Gouvernement entendait déjà mettre en place la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance, au travers de la création de chambres détachées visant à remplacer les tribunaux d’instance vidés de leur substance ; la commission est allée encore plus loin en réintroduisant les tribunaux de première instance.
Aussi, alors que le Gouvernement n’excluait pas de conserver plusieurs TGI sur un même département, il s’agit ici de consacrer le principe du tribunal unique par département. Il me semble pourtant que, sur de nombreuses travées, nous nous sommes montrés très critiques envers une telle approche.
La seule logique pécuniaire et gestionnaire guide ces mesures, au détriment de la justice de proximité, alors même que la proximité est une aspiration très défendue en ce moment. Nous devons également défendre l’égal accès au droit pour tous les justiciables de notre pays.

La parole est à Mme Sylviane Noël, pour présenter l’amendement n° 92 rectifié.

L’article 53 procède à la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d’instance, créant ainsi le tribunal de première instance.
Les élus locaux et les professionnels de la justice craignent que la mise en œuvre de cette disposition n’aboutisse à terme à la disparition de certaines juridictions. Pour un territoire rural et de montagne, cette situation pourrait porter gravement préjudice à l’accès des justiciables à la justice.
En effet, la délocalisation de certains contentieux et la nécessité pour le justiciable de parcourir parfois plus de cent kilomètres pourraient le décourager de se rendre à son audience. Dans les zones de montagne et les territoires ruraux, la proximité des services publics est un facteur important, car le problème des distances peut vite devenir rédhibitoire en raison des conditions imposées par le climat et le relief.
C’est pourquoi il convient de supprimer l’article 53 et de maintenir l’organisation judiciaire actuelle.

Ces amendements visent à supprimer le rapprochement entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance. Je rappelle que, dès la première lecture de ce texte, la commission des lois a admis le principe de ce rapprochement, qui est notamment issu des propositions du rapport publié par son président en avril 2017.
Au-delà du principe, nous avons tenu à faire figurer à cet article un certain nombre de conditions qui manquaient dans le projet de loi initial.
D’abord, je tiens à faire remarquer à mes collègues auteurs de l’amendement n° 69 que le texte ne contient aucune disposition dont l’effet serait de ne laisser subsister qu’un seul tribunal de grande instance par département. Le principe affiché n’est pas la suppression du tribunal de grande instance.
Nous avons par ailleurs souhaité faire figurer dans la loi des garanties relatives au maillage territorial ; nous voulons être certains que, à terme, il n’y aurait pas de suppression de juridictions. C’est pourquoi nous avons pris plusieurs décisions.
Premièrement, nous avons supprimé la spécialisation d’une chambre au sein d’un tribunal de grande instance. Nous sommes en effet convaincus qu’une telle chambre, sinon dans l’immédiat, du moins dans le futur, pourrait dévitaliser un autre TGI et peut-être, à terme, mener à sa suppression.
Deuxièmement, garantie importante, nous avons décidé la mise en place d’un juge chargé des contentieux de proximité, non statutaire, sur le modèle du juge des tutelles et du juge aux affaires familiales. Il serait chargé d’une partie des contentieux traités dans les chambres détachées.
Troisièmement, nous avons institué une garantie de localisation des emplois pour les fonctionnaires du greffe, soit au siège du tribunal de première instance, soit dans une chambre détachée, et nous avons mis en place un mécanisme d’encadrement de toute modification de la carte judiciaire. Ce mécanisme associe les chefs de cour et les conseils départementaux.
Nous avons également prévu que soit défini, à l’échelon national, par décret en Conseil d’État, un socle minimal de compétences pour les chambres détachées, afin d’éviter tout risque de dévitalisation de ces sites. Ce socle minimal devra comprendre l’actuel contentieux du tribunal d’instance et le contentieux des affaires familiales, ou du moins les affaires consécutives à un divorce.
Les chambres détachées auront donc de vraies compétences, ainsi que les magistrats chargés de les exercer et des greffiers permanents. En outre, les élus seront associés à toute réflexion relative à la carte judiciaire. Voilà les règles que le Sénat et sa commission des lois ont fixées dès la première lecture de ce projet de loi et auxquelles nous voulons nous en tenir.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur les trois amendements de suppression de l’article 53.
Madame la sénatrice Brulin, concernant l’évolution que nous proposons, vous avez évoqué une logique pécuniaire et gestionnaire, qui s’opposerait à la logique de proximité. Je m’inscris totalement en faux par rapport à cette perception des choses.
Comme M. le rapporteur l’a bien précisé, nous ne réduisons en aucune manière ni les implantations des juridictions ni même les compétences qu’elles exercent. Fort au contraire, nous garantissons le maintien de tous les tribunaux d’instance actuels, même s’ils s’appelleront désormais tribunaux de proximité, et nous leur offrons la possibilité d’accroître leurs compétences, lorsque cela apparaîtra nécessaire.
Si nous n’avons pas repris la rédaction exacte que propose la commission des lois, les principes que je viens d’énoncer reçoivent de nombreuses garanties dans notre texte. Je pense notamment à la création d’un juge des contentieux de la protection, qui sera présent dans tous les tribunaux de première instance.
Nous garantissons le lieu, nous garantissons le juge, mais nous garantissons évidemment aussi le personnel. Cette garantie figurera, non pas dans la loi, mais dans les dispositions réglementaires qui accompagneront le présent texte : elles préciseront que les membres du personnel de justice seront affectés dans les lieux précis où ils exerceront leurs activités. Nous considérons en effet que nous ne pouvons pas déplacer ces personnes comme s’il s’agissait de simples pions ; ce n’est pas pensable !
Nous offrons donc toutes ces garanties de maintien de vitalité sur le territoire. Il n’y aura dans les dispositions que nous proposons que des éléments qui permettront de renforcer le rôle des juridictions.
Quant à la spécialisation de certaines chambres dans des contentieux spécifiques, qui a été supprimée par votre commission des lois, je tiens à réaffirmer qu’il ne s’agit pas de créer des chambres spécialisées. Il n’est question que de contentieux très techniques et très peu nombreux en volume, et en aucun cas des contentieux de masse. Lorsque, par exemple, trois tribunaux de grande instance existent dans un même département, un type de contentieux technique sera géré par l’un d’entre eux, un autre par un deuxième, un autre encore par le dernier. Nous aurons ainsi une forme de compétence spécialisée pour des contentieux qui représentent moins de 10 % du volume des affaires jugées par chacun des tribunaux.
Cela correspond à une réalité. Je me trouvais, il y a quelques jours, dans un modeste tribunal de grande instance, dont j’ai rencontré le personnel et les avocats. Ils me disaient eux-mêmes avoir très rarement à traiter du contentieux de la fiscalité indirecte. Ce contentieux pourrait donc être déplacé vers un autre tribunal. En revanche, me demandaient-ils, ne nous enlevez pas tel ou tel contentieux rural, car nous le rencontrons souvent ! Dont acte : la ville voisine n’a peut-être jamais à connaître de telles affaires. Il peut y avoir des équilibres sur des contentieux très techniques, très spécialisés. Cela représentera un progrès tant pour les magistrats que pour les justiciables.
Enfin, madame Noël, c’est avec grand plaisir que je me rendrai au tribunal d’instance de Bonneville pour rassurer son personnel et les magistrats qui y travaillent et continueront d’y travailler !

Sur ce point, la mission conduite par M. le président de la commission des lois était effectivement allée plus loin. Je comprends l’observation faite par les auteurs de ces amendements, puisque le rapport présenté ici en octobre 2017 en conclusion de cette mission concluait plutôt au maintien d’un seul tribunal de première instance par département, sauf exception. On a objectivement fait marche arrière sur ce point.
Le sujet est compliqué. Nous avons tous vu, sur nos territoires, quel que soit notre groupe politique, les réactions suscitées par cette évolution quand nous y étions favorables. Ces réactions peuvent apparaître contradictoires : j’ai interpelé des magistrats, en leur faisant remarquer que, dès lors qu’un tribunal d’instance, éloigné du tribunal de grande instance, sera une chambre détachée, ou chambre de proximité, rattachée à ce TGI, rien n’interdira dans l’organisation que vous pourrez mettre en place qu’un juge aux affaires familiales tienne des audiences dans ce lieu, ou qu’un juge des enfants devant prononcer des mesures d’assistance éducative pour des familles vivant sur ce territoire s’y rende. Les magistrats, me semble-t-il, n’y sont pas tout à fait prêts.
Nous aurions tout intérêt, de même que les élus locaux, sur place, dans les conseils de juridiction auxquels nous sommes invités, à travailler sur cette question d’organisation, afin que la proximité territoriale soit garantie. Cela permettrait d’assurer la continuité avec le travail que nous avons accompli ici et de répondre au mieux aux intérêts du justiciable.
Personnellement, dans la logique de mes déclarations depuis cette mission, je ne voterai évidemment pas ces amendements de suppression : il faut selon moi faire avancer cette réforme.
Les amendements ne sont pas adoptés.

Madame la ministre, mes chers collègues, il est presque minuit. Je vous propose de prolonger nos travaux afin de terminer ce soir l’examen de ce texte, puisqu’il ne reste qu’une dizaine d’amendements à examiner. Cela requiert simplement que chacun d’entre vous fasse preuve de concision.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
L’amendement n° 95 rectifié, présenté par Mme Noël, MM. Pellevat et Panunzi, Mme Deromedi, MM. Vial et Cuypers, Mme Garriaud-Maylam, M. Laménie et Mmes Bories et Morhet-Richaud, est ainsi libellé :
Alinéas 9 à 12
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Sylviane Noël.

Les alinéas 9 à 12 de l’article 53, introduits en première lecture par voie d’amendement, prévoient la fusion des greffes du tribunal judiciaire et des conseils de prud’hommes lorsqu’ils sont tous deux situés dans une même commune.
Ils auraient pour conséquence d’éliminer purement et simplement le poste de greffier attaché au conseil de prud’hommes. Or les représentants des salariés et des employeurs sont particulièrement attachés aux juridictions prud’homales.
Aussi, il convient de supprimer cette disposition récemment introduite dans le projet de loi ; tel est l’objet de cet amendement.

Cet amendement est satisfait, puisque la commission des lois a déjà supprimé les ajouts apportés par l’Assemblée nationale sur ce point. Je vous demande donc, ma chère collègue, de bien vouloir le retirer, faute de quoi la commission sera obligée d’émettre un avis défavorable.
Il est également défavorable, mais pour d’autres motifs…
Sourires.

L’amendement n° 95 rectifié est retiré.
Les amendements n° 77 et 78 ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 25 rectifié, présenté par M. Antiste, Mme Conconne, MM. P. Joly et Lalande et Mme Artigalas, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le présent article n’est pas applicable dans les départements et collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.
La parole est à M. Maurice Antiste.

Cet amendement vise à exclure les départements et collectivités d’outre-mer du champ d’application de l’article 53, lequel organise la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance.
En effet, alors que l’exposé des motifs de ce projet de loi prétend rapprocher la justice des justiciables, cet article conduira au contraire à les en éloigner.
En outre-mer, la réduction croissante du service public de la justice contribuera, plus encore qu’ailleurs, à accroître le clivage culturel entre les institutions judiciaires et la population, au prix d’une incapacité toujours plus grande à assurer une régulation équitable et efficace des rapports sociaux. Le service public de la justice étant dans ces régions déjà suffisamment fragilisé, il semble nécessaire d’éviter de le fragiliser davantage par une réforme qui apparaît mal calibrée et dont l’objectif reste d’économiser des moyens humains supplémentaires pourtant indispensables.
C’est pourquoi nous proposons de compléter cet article par un paragraphe précisant qu’il n’est pas applicable dans les départements et collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

La commission soupçonne un problème de constitutionnalité dans le dispositif de cet amendement, sur lequel elle émet donc un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 53 est adopté.
(Supprimé)
(Non modifié)
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212 -6 -1. – Quand un département compte plusieurs tribunaux de grande instance, le procureur général peut désigner l’un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et assurer la coordination des activités s’y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » –
Adopté.
(Non modifié)
Après le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces assistants peuvent également être nommés auprès du tribunal de première instance et de la cour d’appel de Papeete, dans les mêmes conditions qu’aux deux premiers alinéas du présent article. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précitée est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’article 20 de la présente loi dans les collectivités mentionnées au I du présent article. » –
Adopté.
(Supprimés)
(Non modifié)
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 148-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « de magistrats » sont remplacés par les mots : « d’un magistrat ».
II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 723-3 du code de commerce, après le mot : « un magistrat », il est inséré le mot : « honoraire ».
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1114-1, les mots : « membre du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative » ;
2° Le 2° des articles L. 3223-2 et L. 3241-2 et le 9° du II de l’article L. 3844-2 sont abrogés.
IV. – Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 251-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « un magistrat du siège ou » sont supprimés ;
b) Après le mot : « honoraire », sont insérés les mots : « ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d’appel, » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles. » ;
2° À la fin du 5° de l’article L. 251-6, les mots : «, dont au moins un magistrat du siège et un magistrat du parquet désignés par le premier président de la Cour de cassation » sont supprimés.
V. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3452-3 du code des transports, les mots : « et présidée par un magistrat de l’ordre administratif » sont supprimés.
VI. – Au quatorzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « ou ancien magistrat » sont remplacés par le mot : « honoraire ».
VII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 de l’article 1651 H, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1653 F, les mots : « conseiller d’État » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative » ;
3° L’article 1741 A est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « conseillers d’État » sont remplacés par les mots : « membres du Conseil d’État » ;
b) Au 2°, les mots : « conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, » sont remplacés par les mots : « magistrats de la Cour des comptes ».
VIII. – À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 111-4 du code du patrimoine, les mots : « du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de la juridiction administrative ».
IX. – Au 1° de l’article L. 332-18 du code du sport, les mots : « membres du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « membres de la juridiction administrative ».
X. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 561-39 est ainsi modifié:
a) Le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;
b) Les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;
c) Les mots : « conseiller-maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;
2° L’article L. 612-5 est ainsi modifié :
a) Au 3°, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;
b) Au 4°, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;
c) Au 5°, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;
3° L’article L. 612-9 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » et les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;
b) Au septième alinéa, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;
4° L’article L. 621-2 est ainsi modifié :
a) Au 2° du II, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;
b) Aux 3° du même II, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;
c) Au 4° dudit II, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;
d) Au 1° du IV, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;
e) Au 2° du même IV, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de ».
XI. – La section 1 du chapitre VII du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :
1° L’article L. 327-3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;
b) Au 2°, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;
c) Au 3°, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;
2° L’article L. 327-4 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;
b) Au 2°, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de » ;
c) Au 3°, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de ».
XII. – Le II de l’article L. 228-2 du code de l’aviation civile est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « ou ancien membre du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de la juridiction administrative » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « membre ou ancien membre de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes ».
XIII. – Au premier alinéa du II de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de la juridiction administrative » et les mots : « membre de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « magistrat de la Cour des comptes ou magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes ».
XIV. – Au 1° de l’article 18-1 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil ».
XV. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les mots : « conseiller d’État » sont remplacés par les mots : « membre de la juridiction administrative ».
XVI. – La loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédures aux contribuables en matière fiscale et douanière est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article 1er, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil », les mots : « conseillers d’État » sont remplacés par les mots : « membres du Conseil d’État », les mots : « conseillers maîtres à » sont remplacés par les mots : « magistrats de » et le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « membres » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 20, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil », les mots : « conseillers d’État » sont remplacés par les mots : « membres du Conseil d’État », les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de », les mots : « conseillers maîtres à » sont remplacés par les mots : « magistrats de » et le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « membres ».
XVII. – Au deuxième alinéa de l’article 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, les mots : «, d’un membre du Conseil d’État » sont supprimés.
XVIII. – Le II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables est ainsi modifié :
1° Au b, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil » ;
2° Au c, les mots : « conseiller à » sont remplacés par les mots : « membre de » ;
3° Au d, les mots : « conseiller maître à » sont remplacés par les mots : « magistrat de ».
XIX. – Au 1° du II de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, le mot : « conseiller » est remplacé par les mots : « membre du Conseil ».
XX. – L’article 2 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;
2° Au 2°, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;
3° Au 3°, les mots : « conseillers maîtres à » sont remplacés par les mots : « magistrats de ».
XXI. – Le chapitre II de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 13 est supprimé ;
2° Le troisième alinéa de l’article 14 est supprimé ;
3° L’article 16 est abrogé ;
4° Le cinquième alinéa de l’article 17 est supprimé ;
5° Le dernier alinéa du II de l’article 19 est supprimé ;
6° Le deuxième alinéa de l’article 20 est supprimé. –
Adopté.
Chapitre Ier bis
(Supprimés)
Chapitre Ier ter
Gestion électronique des registres des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle
(Non modifié)
I. –
Non modifié
II. – L’article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : «, du registre des associations et du registre des associations coopératives de droit local tenus par les tribunaux d’instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et peut assurer ou faire assurer l’informatisation de ces registres et de leurs annexes conservés sur support papier » ;
2° Les 2° et 3° sont complétés par les mots : «, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes » ;
3° Le 4° est complété par les mots : « pour ces registres informatisés » ;
4° Après le mot : « copies », la fin du 5° est ainsi rédigée : « des registres du livre foncier, des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local, ainsi que de leurs annexes. » –
Adopté.
Chapitre II
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)

L’amendement n° 26 n’est pas soutenu et l’article 54 demeure supprimé.
Chapitre III
Dispositions diverses
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur, de la suppression du tribunal d’instance et de la création du tribunal de première instance en résultant prévues à l’article 53 de la présente loi et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Aménager et mettre en cohérence, par coordination, les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal de première instance et celles relatives à l’institution, la compétence, l’organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal d’instance ;
3° Tirer les conséquences de la suppression du tribunal d’instance dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. –
Non modifié

Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 70 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 94 rectifié est présenté par Mme Noël, M. Pellevat, Mme Deromedi, MM. Vial et Cuypers, Mme Garriaud-Maylam, M. Laménie, Mmes Bories et Morhet-Richaud et M. Panunzi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 70.

Cet article aura de lourdes conséquences sur l’organisation judiciaire de notre pays. Il habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnances les mesures conséquentes à la suppression des tribunaux d’instance et à l’extension des compétences des tribunaux de grande instance.
Cette véritable refonte de la carte judiciaire qui ne dit pas son nom devrait faire l’objet d’un large débat public et d’un projet de loi distinct de cette réforme éparse. Nous proposons donc, comme au sujet de l’article 53 que nous venons d’examiner, de supprimer cet article : défendre les territoires et leur population exige que l’on garantisse de véritables services publics de proximité, qu’il s’agisse de la justice, de l’éducation, de la poste ou de la santé.

La parole est à Mme Sylviane Noël, pour présenter l’amendement n° 94 rectifié.

L’article 55 a été modifié à la suite de la réécriture complète de l’article 53 par la commission, qui a cherché à revenir à sa conception originelle du regroupement des tribunaux d’instance et de grande instance. Nous avons impérativement besoin des dispositions de l’article 55 pour pouvoir aller au bout, dans le domaine réglementaire, de la mise en œuvre de ce que nous avons voté.
La commission souhaite donc le retrait de ces amendements, faute de quoi son avis sera défavorable.
Les auteurs de ces amendements ont sans doute une mauvaise compréhension du sens de l’article qu’ils désirent supprimer. Il ne s’agit en rien de refaire la carte judiciaire par voie d’ordonnances ; il s’agit simplement de tirer les conséquences légistiques des dispositions qui auront été adoptées auparavant.
Dans les différents codes, on relève de nombreuses occurrences des terminologies amenées à être modifiées : tribunal d’instance, tribunal de grande instance. Si ces appellations sont remplacées, comme je le propose, par « tribunal de proximité » ou « tribunal judiciaire », il faudra opérer toutes ces modifications légistiques.
C’est uniquement à cette fin de coordination légistique que nous vous demandons la présente habilitation, de manière à vous éviter ce travail fastidieux sur de nombreux textes.
L’avis du Gouvernement sur ces amendements est donc défavorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ article 55 est adopté.

TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L’APPLICATION OUTRE-MER
I A. –
Supprimé
I. – L’article 4 s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, à l’exception des II bis et II ter qui s’appliquent aux instances introduites à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
I bis A et I bis B. –
Supprimés
I bis. – Les 1° A et 4° de l’article 9 bis entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2020.
I ter. – Le I de l’article 9 ter entre en vigueur le 1er janvier2021.
II. –
Supprimé
II bis. – L’article L. 212-5-2 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi, entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.
III. – L’article 14 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2021.
IV. –
Non modifié
IV bis. – Les articles 19 bis et 19 quater entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
IV ter. – L’article 19 ter entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.
IV quater. – Les I AB et III bis de l’article 26 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la publication de la présente loi.
V. – L’article 802-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du V de l’article 32 de la présente loi, s’applique aux perquisitions et aux visites domiciliaires intervenues à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
VI. – Les articles 27, 28 et 29, les III et IV de l’article 31, le II de l’article 34, les III à VI de l’article 35, les I, II et IV bis à IV quater de l’article 36, l’article 41 et le I de l’article 42, à l’exception de son 5°, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
VI bis AA. – Le 5° du I de l’article 42 entre en vigueur le 1er mars 2019. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi, au deuxième alinéa de l’article 365-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du 5° du I de l’article 42, les mots : « peine de probation » sont remplacés par les mots : « sursis avec mise à l’épreuve ».
VI bis A. – Les articles 380-3-1 et 509-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant, respectivement, des articles 42 et 41 de la présente loi, sont applicables aux procédures dans lesquelles l’appel a été formé postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
VI bis. – Les 3° à 6° bis du III de l’article 37 et les 7° et 8° du I de l’article 38 entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
VI ter. – L’article 40 et le 2° du III de l’article 57 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
VI quater. – L’article 42 bis C entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Les dispositions du sous-titre II du titre Ier du livre IV du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux faits pouvant être qualifiés de crime contre l’humanité et de crimes ou délits de guerre commis avant l’entrée en vigueur de ces dispositions et qui peuvent être réprimés sous une autre qualification pénale en vigueur au moment où ils ont été commis.
VII. – L’article 43, à l’exception des IV, VII, VII ter, VIII bis et X, les I à III de l’article 44, les articles 45, 46, 47 et 48 ainsi que les VIII, IX et XII de l’article 50 entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.
VII bis A, VII bis et VIII. –
Supprimés
IX. – Les articles 53 et 53 bis AB entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
X. –
Non modifié
B. – Le V de l’article 53 bis A entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2020.

L’amendement n° 76 rectifié bis, présenté par Mmes Meunier et Rossignol, MM. Jacques Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sutour et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rétablir le I A dans la rédaction suivante :
I A. – Le I de l’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2022.
La parole est à M. Jacques Bigot.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 74, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Supprimer la référence :
le II de l’article 34,
La parole est à Mme la garde des sceaux.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 56 est adopté.
I. –
Supprimé
I bis. –
Non modifié
I ter. –
Non modifié
B. – Les articles 373-2, 373-2-6, 373-2-9-1, 373-2-10 et 1397 du code civil sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
C. – L’article 1397 du code civil est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
II. –
Non modifié
« Art. 711 -1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
III. – Le titre Ier du livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : » ;
2° L’article 837 est ainsi rédigé :
« Art. 837. – Pour l’application de l’article 398-1 en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna :
« 1° Le 2° est ainsi rédigé :
« “2° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ;”
« 2° Le 4° est ainsi rédigé :
« “4° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ainsi qu’à la sécurité des navires et de la navigation, à la prévention de la pollution marine et à la sûreté des navires ;”
« 3° Le 6° est ainsi rédigé :
« “6° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore ;”
« 4° Le 7° est ainsi rédigé :
« “7° Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de protection des bois et forêts ;”
« 5° Le 8° est ainsi rédigé :
« “8° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de travaux ou aménagement immobiliers et en matière d’installations classées ;”
« 6° Le 9° est ainsi rédigé :
« “9° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de garde et de circulation des animaux ;”
« 7° Le 12° est ainsi rédigé :
« “12° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière d’habitat insalubre.” »
IV. – Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° Le treizième alinéa de l’article L. 243-1 et le douzième alinéa des articles L. 244-1 et L. 245-1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;
2° Aux treizième, quatorzième et dernier alinéas de l’article L. 243-1 et aux douzième, treizième et dernier alinéas des articles L. 244-1 et L. 245-1, les mots : « et examens médicaux, cliniques et » sont remplacés par les mots : « ou examens médicaux, cliniques ou » ;
3° Le vingt-deuxième alinéa de l’article L. 243-1 et le vingt et unième alinéa des articles L. 244-1 et L. 245-1 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 234 -9. – Les officiers ou les agents de police judiciaire soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;
4° Les articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2 sont ainsi modifiés :
a) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Le I de l’article L. 235-1 est applicable dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 235-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice. »
V. – Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A Le premier alinéa de l’article L. 3823-2 est complété par les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice » ;
1° L’article L. 3826-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 3353-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice. » ;
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « L’article L. 3353-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ;
2° L’article L. 3833-1 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 3842-1 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice ».
V bis. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1, la référence : « loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 895-1 et L. 896-1, la référence : « loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence « loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice ».
VI. – L’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
VII. – Le premier alinéa de l’article 44 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi rédigé :
« Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46, les dispositions de la présente ordonnance, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 16 bis, des articles 25, 26 et 39 à 41, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
VIII. –
Supprimé
IX. – Le livre V du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 531-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531 -1. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna le livre Ier ainsi que les articles L. 211-17, L. 211-18, L. 212-5-1 et L. 212-5-2 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice. » ;
2° Au début du titre IV du livre V, il est ajouté un article L. 541-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541 -1. – Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 211-17, L. 211-18, L. 212-5-1 et L. 212-5-2 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice. » ;
3° L’article L. 551-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 551 -1. – Sont applicables en Polynésie française le livre Ier, les articles L. 211-17 et L. 211-18 ainsi que le 3° de l’article L. 261-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice. » ;
4° L’article L. 561-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 561 -1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie le livre Ier, les articles L. 211-17, L. 211-18 et L. 532-17 ainsi que le 3° de l’article L. 261-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice. »
X. – L’article L. 641-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 111-5, L. 121-4, L. 125-1, L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice. »
XI. – Le II de l’article 112 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° Il est ajouté un D ainsi rédigé :
« D. – Les articles 4-1 à 4-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
XII. – Le premier alinéa du I de l’article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé :
« I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent article, la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : ».
XIII. – Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 740-2 est complété par les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 750-1 est complété par les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice » ;
3° L’article L. 760-3 est complété par les mots : «, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice » ;
4° Après la référence : « L. 214-10 », la fin de l’article L. 770-1 est ainsi rédigée : « L. 221-1 à L. 222-1, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice. »
XIV et XV. –
Supprimés
XVI. –
Non modifié
XVII. –
Non modifié

L’amendement n° 75, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 54
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Aux articles L. 532-2 et L. 552-2, la référence : « et L. 211-12 » est remplacée par les références : «, L. 211-12 et L. 217-6 » ;
II. – Après l’alinéa 60
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 562-2, la référence : « L. 211-12 » est remplacée par les références : « L. 211-12, L. 217-6 » ;
2° Après l’alinéa 75
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les III et IV de l’article 42 bis AA de la présente loi sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Cet amendement vise à permettre l’application outre-mer des dispositions relatives au JIVAT, le juge de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme.

Dans le cadre général de ce projet de loi, nous nous sommes montrés favorables au JIVAT. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Le JIVAT est un juge placé auprès du tribunal de grande instance de Paris ; il a compétence exclusive sur tous les territoires métropolitains pour statuer sur les droits des victimes d’attentats terroristes.
Il me semble qu’imposer sa juridiction aux ressortissants des territoires d’outre-mer cités dans le présent amendement n’est pas justifié : pourquoi dire à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, et à Wallis-et-Futuna qu’ils devront s’adresser à ce juge situé à Paris ? Je voterai donc contre cet amendement.
Je rappelle à M. Bigot que le JIVAT pourra à l’évidence tenir des audiences délocalisées ; nous l’avons précisé à plusieurs reprises.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 57 est adopté.

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, je m’exprime au nom du groupe socialiste et républicain.
Comme je l’ai rappelé à plusieurs reprises, le texte du Sénat est meilleur que celui qui est issu des travaux de l’Assemblée nationale. Toutefois, sur une série de dispositions relatives à la procédure pénale, nous sommes en désaccord avec la majorité sénatoriale.
Dès lors, dans l’équilibre logique des choses, nous ne pouvons pas soutenir entièrement le texte issu des travaux du Sénat ; c’est pourquoi nous nous abstiendrons, comme nous l’avons fait en première lecture.

Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.
Le projet de loi est adopté.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE LA MAGISTRATURE
I. – L’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des articles 3-1, 28, 28-2, 28-3, 37, 38-1, 38-2, 40-2, 41-5, 41-12 et 41-27, nul magistrat ne peut être affecté moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. »
II. – L’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019.
La procédure prévue à l’article 2-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée s’applique à ces magistrats.
L ’ article 1 er A est adopté.
I. – Après l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2 -1. – Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis aux obligations résultant du dernier alinéa de l’article 2 font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents. Les demandes d’affectation de ces magistrats ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chef de juridiction, ni sur des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon.
« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des fonctions de ces mêmes magistrats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents.
« À l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, ces magistrats sont nommés dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du siège pour les magistrats du siège et du parquet pour les magistrats du parquet, dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, ils sont, à l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.
« Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les magistrats soumis aux obligations résultant du dernier alinéa de l’article 2 et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction.
« Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s’ouvrir dans la juridiction où ils ont été nommés en surnombre. »
II. – L’article 2-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019.
Adopté.
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « de premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance, » sont supprimés ;
2° À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article 3-1, les mots : « premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance, » sont supprimés.
Adopté.
Après l’article 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3 -2. – Lorsque la nature particulière d’une affaire le justifie, à la demande du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés, les magistrats du siège qui ont prêté serment depuis moins de trois ans peuvent apporter au magistrat en charge de l’affaire leur concours à la préparation de la décision. »
Adopté.
I. – Après le mot : « apprécie », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 12-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi rédigée : « spécialement les critères pris en compte lors de la nomination de ces magistrats et mentionnés aux articles 28-1 A, 28-1 B, 37-1 A et 38-1-1. »
II. – L’article 12-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux nominations intervenant à compter du 1er décembre 2019.
Adopté.
Après le deuxième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats nommés à des fonctions de premier président d’une cour d’appel, de président d’un tribunal de grande instance, de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel, ainsi que les magistrats nommés à des fonctions de procureur général près une cour d’appel, de procureur de la République près un tribunal de grande instance, de première instance ou un tribunal supérieur d’appel suivent, au plus tard dans les six mois de leur installation, une formation spécifique à l’exercice de leurs fonctions, qui a pour objet le développement des compétences d’encadrement, d’animation et de gestion au sein d’une juridiction. Cette formation est organisée par l’École nationale de la magistrature, dans des conditions et selon un programme fixés par décret. »
Adopté.
La section 1 du chapitre II de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complétée par un article 21-2 ainsi rédigé :
« Art. 21 -2. – Les auditeurs de justice jugés aptes, à la sortie de l’école, à exercer les fonctions judiciaires peuvent être nommés en premier poste magistrats du siège auprès d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein d’une juridiction qui détient des compétences particulières ou au sein d’une juridiction spécialisée.
« La liste des juridictions mentionnées au présent article est fixée par décret en Conseil d’État. »
Adopté.
I. – Le dernier alinéa de l’article 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Après le mot : « durée », il est inséré le mot : « minimale » ;
2° Après les mots : « est de », la fin est ainsi rédigée : « trois années. » ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut être dérogé à cette règle sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. La durée maximale d’exercice de ces mêmes fonctions est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée. »
II. – L’article 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019.
Adopté.
I. – Après l’article 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont insérés des articles 28-1 A et 28-1 B ainsi rédigés :
« Art. 28 -1 A. – Pour arrêter chaque proposition de nomination de président de tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :
« 1° Les qualités juridictionnelles ;
« 2° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« 3° L’aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d’appel ;
« 4° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la juridiction, et à en rendre compte au premier président de la cour d’appel du ressort ;
« 5° L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;
« 6° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« 7° L’aptitude à collaborer avec le procureur de la République près la même juridiction ;
« 8° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« 9° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.
« Art. 28 -1 B. – Pour donner son avis sur les propositions de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, aux fonctions de procureur de la République près un tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :
« 1° Les qualités juridictionnelles ;
« 2° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« 3° L’aptitude à mettre en œuvre les priorités de politique pénale définies par le garde des sceaux, ministre de la justice, sous l’autorité du procureur général près la cour d’appel du ressort ;
« 4° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la juridiction et à en rendre compte au procureur général près la cour d’appel du ressort ;
« 5° L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;
« 6° L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;
« 7° L’aptitude à collaborer avec le président de la même juridiction ;
« 8° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« 9° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »
II. – Les articles 28-1 A et 28-1 B de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent aux nominations intervenant à compter du 1er décembre 2019.
Adopté.
I. – Le dernier alinéa de l’article 28-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
3° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;
b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;
c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;
4° À la dernière phrase, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».
II. – L’article 28-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019.
Adopté.
I. – L’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et celles de juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » sont supprimés ;
2° La première phrase des deuxième et dernier alinéas est ainsi modifiée :
a) Le mot : « enfants, » est remplacé par les mots : « enfants ou » ;
b) Les mots : « ou de juge chargé du service d’un tribunal d’instance » sont supprimés ;
3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de quatre années et » ;
b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;
4° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
5° La deuxième phrase du même dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la dixième année d’exercice de ces fonctions » ;
b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;
c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;
6° À la dernière phrase du même dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».
II. – L’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant des 3° à 6° du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019.
Adopté.
I. – L’article 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots : « Les fonctions » ;
b) Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;
2° L’antépénultième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;
3° Après le même antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ses fonctions » ;
5° Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de cette période. » ;
6° Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».
II. – L’article 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019.
Adopté.
I. – Après l’article 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 37-1 A ainsi rédigé :
« Art. 37 -1 A. – Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :
« 1° Les qualités juridictionnelles ;
« 2° L’expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;
« 3° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« 4° L’aptitude à conduire et mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d’appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;
« 5° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;
« 6° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« 7° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;
« 8° L’aptitude à collaborer avec le procureur général près la même cour d’appel ;
« 9° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« 10° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »
II. – Après l’article 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 38-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 38 -1 -1. – Pour donner son avis sur les propositions de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, aux fonctions de procureur général près une cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :
« 1° Les qualités juridictionnelles ;
« 2° L’expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;
« 3° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;
« 4° L’aptitude à conduire et mettre en œuvre des priorités de politique pénale définies par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort de la cour d’appel, et à coordonner à cet effet l’action des procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de ce ressort ;
« 5° L’aptitude à diriger et gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;
« 6° L’aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
« 7° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;
« 8° L’aptitude à collaborer avec le premier président de la même cour d’appel ;
« 9° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;
« 10° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »
III. – Les article 37-1 A et 38-1-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature s’appliquent aux nominations intervenant à compter du 1er décembre 2019.
Adopté.
I. – L’article 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots : « Les fonctions » ;
b) Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;
2° L’antépénultième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;
3° Après le même antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;
5° Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de cette période. » ;
6° Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».
II. – L’article 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019.
Adopté.
I. – L’article 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;
b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;
2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;
3° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;
b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;
c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;
4° À la seconde phrase du même avant-dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».
II. – L’article 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er décembre 2019.
Adopté.
Au premier alinéa de l’article 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots : « chargé du service d’une chambre détachée d’un tribunal de première instance ».
Adopté.
L’article 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Lorsqu’ils sont affectés dans un tribunal d’instance, » sont supprimés ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « du tribunal de première instance » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont affectés dans une chambre détachée d’un tribunal de première instance, ils ne peuvent assurer plus du tiers des services de ladite chambre. »
Adopté.
L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 2, les mots : « de tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa de l’article 3, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
3° L’article 3-1 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;
b) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
c) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;
d) Aux deuxième et troisième phrases de l’avant-dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 12-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
5° Au premier alinéa de l’article 13, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
6° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « d’un tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;
7° L’article 28-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « d’un tribunal de grande instance, » sont supprimés et la seconde occurrence du mot : « grande » est remplacée par le mot : « première » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;
– à la deuxième phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
8° L’article 28-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les deux occurrences des mots : « de grande instance ou » sont supprimées ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;
d) À la deuxième phrase du même dernier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;
9° À la première phrase de l’article 32, les mots : « d’un tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;
10° L’article 38-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;
d) Au dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
11° Au premier alinéa de l’article 41-10, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
12° Au dernier alinéa de l’article 41-13, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
13° L’article 41-14 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
b) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot « première » ;
14° L’article 41-25 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
15° Aux première et dernière phrases de l’article 41-26, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
16° Au dernier alinéa de l’article 41-28, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
17° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 41-29, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
18° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 72-3, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
19° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 76-1-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».
Adopté.
(Supprimé)
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
La loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Le 3° de l’article 1er est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « grande » est remplacée par le mot : « première » ;
b) Après les mots : « présidents de tribunal », les mots : « de grande instance, » sont supprimés ;
2° Au 3° de l’article 2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
3° Aux 3° et 4° de l’article 4-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 15, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».
Adopté.
I et I bis. –
Non modifiés
II. – Aux premier et troisième alinéas du I et aux première et seconde phrases du premier alinéa du II de l’article 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots : « de première instance ».
Adopté.
(Non modifié)
I. – Sans préjudice des articles 41-10 et 41-25 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées au même article 41-25 peuvent, entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2022, exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminelles.
II. – La sous-section II de la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase de l’article 41-25, après la première occurrence du mot : « appel », sont insérés les mots : « pour exercer les fonctions d’assesseur dans les cours d’assises ou » ;
2° L’article 41-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cour d’assises ne peut comprendre plus d’un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés en application de la présente sous-section. »
Adopté.
(Supprimé)
À compter du 1er janvier 2020, les magistrats exerçant à titre temporaire poursuivent leur mandat, pour exercer les fonctions prévues à l’article 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi organique, au sein du tribunal de première instance ayant succédé au tribunal de grande instance dans lequel ils ont été nommés.
Adopté.
(Supprimé)
Les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7 bis et 8 A et le II de l’article 8 de la présente loi organique entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Adopté.

Les autres dispositions du projet de loi organique ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.

Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi organique dans le texte de la commission.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 55 :
Le Sénat a adopté.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 13 février 2019, à quatorze heures trente et le soir:
Projet de loi organique portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française (procédure accélérée) (texte de la commission n° 294, 2018-2019) et projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française (procédure accélérée) (texte de la commission n° 293, 2018-2019).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 13 février 2019, à minuit quinze.
La liste des candidats désignés par la commission spéciale pour faire partie de l ’ éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises a été publiée conformément à l ’ article 12 du règlement.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 9 du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire sont :
Titulaires : Mme Catherine Fournier, M. Jean-François Husson, Mmes Élisabeth Lamure, Sophie Primas, M. Martial Bourquin, Mme Frédérique Espagnac et M. Georges Patient ;
Suppléants : MM. Serge Babary, Michel Canevet, Philippe Dominati, Jean-Marc Gabouty, Fabien Gay, Mme Christine Lavarde et M. Jean-Louis Tourenne.