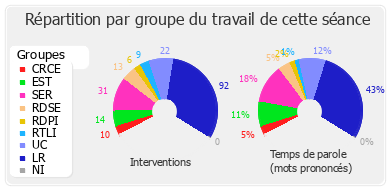Séance en hémicycle du 19 décembre 2023 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Mise au point au sujet d'un vote (voir le dossier)
- Questions orales (voir le dossier)
- Demande de soutien de l'état pour le projet de modernisation de l'abattoir de quillan (voir le dossier)
- Adapter la politique de concurrence sur les produits bois issus des forêts françaises en crise (voir le dossier)
- Mise en œuvre et sécurisation des financements des projets alimentaires territoriaux (voir le dossier)
- Exonération de la taxe sur les salaires pour les groupements d'intérêt public des maisons de l'emploi (voir le dossier)
- Dépenses non éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (voir le dossier)
- Modification de l'ordre du jour (voir le dossier)
- Questions orales suite (voir le dossier)
- Procédures concernant les installations classées protection de l'environnement et insécurité juridique (voir le dossier)
- Application de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages (voir le dossier)
- Éligibilité des dépenses de travaux dans les gîtes communaux au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (voir le dossier)
- Reconnaissance des cancers comme maladies professionnelles chez les sapeurs-pompiers (voir le dossier)
- Recrudescence d'occupations illicites de membres se revendiquant de la communauté des gens du voyage en haute-savoie (voir le dossier)
- Situation difficile des infirmières libérales en milieu rural dans les vallées de la roya et de la bévéra dans le département des alpes-maritimes (voir le dossier)
- Désengagement de l'état du dispositif « territoires zéro chômeur de longue durée » (voir le dossier)
- Loi de finances pour 2024 (voir le dossier)
- Communication relative à une commission mixte paritaire
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Monsieur le président, lors du scrutin n° 102 du 14 décembre 2023 sur l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi organique visant à rétablir la réserve parlementaire en faveur des communes et des associations, je souhaitais voter pour.

Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle figurera dans l’analyse politique du scrutin concerné.

La parole est à M. Sebastien Pla, auteur de la question n° 796, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur l’importance du concours de l’État pour la modernisation de l’abattoir de Quillan, propriété d’un syndicat mixte réunissant les communautés de communes du Limouxin et des Pyrénées audoises au sein du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) de la haute vallée de l’Aude.
Cet outil est le seul qui reste dans le département après la fermeture des abattoirs de Castelnaudary et de Narbonne. Il est indispensable pour la filière d’élevage audoise, car il est implanté en zone de montagne au plus près des exploitations.
Ce site d’abattage collectif, cogéré par les éleveurs et les élus locaux, permet la commercialisation de bêtes élevées localement avec une traçabilité irréprochable, justifiant la création du label de qualité « Viandes des Pyrénées audoises » et favorisant de nombreux partenariats avec les artisans bouchers locaux.
Son positionnement géographique central permet aussi de limiter le transport des animaux vivants à moins d’une heure de distance, afin de garantir des conditions sanitaires et de bien-être animal optimales.
Enfin, il permet aux éleveurs des territoires voisins, tels que ceux de la plaine du Lauragais qui pratiquent l’enrichissement gras, de bénéficier d’une structure de proximité adaptée.
Or l’abattoir de Quillan doit faire face à de nombreux handicaps qui fragilisent sa pérennité économique, comme l’inflation des charges courantes, le coût de normes qui sont inadaptées pour des structures de cette taille, la baisse du tonnage traité et le coût élevé des investissements. Aujourd’hui, cet abattoir indispensable à la filière a besoin d’un nouveau souffle pour poursuivre sa modernisation et se diversifier.
Dans le cadre du plan de relance, l’État a permis de financer des études pour la mise en œuvre d’un modèle de gestion en phase avec les objectifs réglementaires et sanitaires qu’exige un tel site.
Monsieur le ministre, pouvez-vous m’indiquer à quelle hauteur l’État envisage de financer les investissements nécessaires à la modernisation de l’abattoir de Quillan et quand il compte le faire ?
Plus globalement se pose la question de savoir si les petits abattoirs de proximité en zone de montagne ont un avenir ou s’ils sont voués à disparaître, disparition dont je ne préfère pas imaginer les conséquences. Quelle est votre doctrine sur ce sujet ? Prévoyez-vous de le traiter dans le cadre du futur projet de loi d’orientation et d’avenir agricoles ?
Monsieur le sénateur Pla, comme vous le soulignez, les abattoirs jouent un rôle majeur dans les filières animales et dans la chaîne alimentaire, ainsi que pour les territoires.
Ainsi, 181 abattoirs ont bénéficié du plan de relance, à hauteur de 115 millions d’euros, ce qui représente un volume d’aide inédit. Cela a permis de moderniser et d’adapter les outils pour les mettre en conformité avec les exigences du secteur.
Je souscris à ce que vous dites sur les normes – il faut éviter d’en ajouter en permanence –, mais il arrive malheureusement souvent que, tout en faisant valoir ce principe, on en ajoute quand même… Faisons simplement avec les normes existantes !
Le contexte actuel crée une conjoncture difficile pour les filières d’élevage, qui subissent l’inflation et parfois des pertes de volume.
Le ministère de l’agriculture a engagé au mois de juillet dernier, sur mon initiative, une démarche associant l’ensemble des filières professionnelles et les collectivités territoriales pour préserver un maillage sur l’ensemble du territoire. Ce travail est en cours et doit aboutir au premier trimestre 2024. Il permettra de déterminer le maillage à privilégier, le type d’abattoirs dont nous avons besoin et ceux que nous devons accompagner.
En effet, j’ai pu constater que, dans certains cas, quatre, cinq ou six plans d’aide ne suffisent toujours pas à garantir la pérennité d’un abattoir. Certes, ce n’est pas forcément le cas de celui que vous citez, mais cela montre qu’il faut tenir compte du contexte. Je ne peux pas engager l’État à l’aveugle sur tel ou tel abattoir sans avoir analysé l’ensemble du maillage.
Nous devons définir clairement le réseau d’abattoirs dont nous avons besoin sur le territoire, en distinguant les établissements selon leur taille – il nous faut toute la panoplie. Pour cela, nous devons savoir quels animaux sont aujourd’hui traités dans tel ou tel abattoir et dans quels volumes. Nous devons aussi établir des prévisions de production. Nous pourrons ainsi déterminer si l’ensemble peut fonctionner.
Ensuite, l’État interviendra conformément à ce que prévoit le plan de reconquête de la souveraineté de l’élevage, c’est-à-dire grâce à des garanties d’emprunts à hauteur de 50 millions d’euros, pour accompagner les abattoirs dans leur modernisation.
Pour l’instant, nous avons surtout besoin d’un diagnostic et ce sera fait rapidement, puisque les travaux devraient se terminer durant le premier trimestre 2024.

Monsieur le ministre, j’entends ce que vous dites et je m’en réjouis. Vous avez raison de rappeler qu’il faut veiller à ne pas créer trop de normes.
Toutefois, il faut surtout donner des moyens aux territoires qui n’en ont pas, notamment ceux où l’on trouve des structures d’utilité publique comme l’abattoir de Quillan, où il est difficile de recruter du personnel doté d’un certain niveau de compétences.

La parole est à M. Guislain Cambier, auteur de la question n° 906, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Monsieur le ministre, lors du premier conseil de l’Union européenne sous présidence française, le 17 janvier 2022, vous avez fait de la mise en place des clauses miroirs une priorité européenne.
Évoquées à plusieurs reprises par le Président de la République, ces mesures imposeraient aux partenaires commerciaux qui souhaitent exporter leurs produits agricoles vers l’Union européenne de se conformer au préalable à ses normes sanitaires et environnementales.
Aujourd’hui, alors que les agriculteurs français respectent les nombreuses préconisations de la Commission européenne, tout particulièrement la réduction drastique de produits phytosanitaires, ces obligations ne sont pas imposées aux produits importés de l’extérieur de l’Union européenne. C’est ainsi que des pesticides et antibiotiques non autorisés en Europe peuvent l’être à l’étranger et se retrouver dans nos assiettes.
Par exemple, le consommateur français n’est pas informé que les lentilles produites au Canada le sont avec des pesticides formellement interdits en Europe.
Ces produits chimiques ont pour seul objectif d’augmenter les volumes de récolte, quoi qu’il en coûte, donc au détriment de la santé des consommateurs européens. Cette différence de traitement peut être assimilée à de la concurrence déloyale.
Les agriculteurs que j’ai rencontrés dans le département du Nord, en particulier dans l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe, vous ont soutenu dès 2022, alors que vous annonciez que ces clauses miroirs étaient une priorité. Mais, deux ans après cette annonce, rien.
Comme les agriculteurs de mon territoire, je souhaite connaître l’état d’avancement de la mise en œuvre des clauses miroirs, près de deux ans après l’annonce que vous avez faite à leur sujet.
Monsieur le sénateur Cambier, vous ne pouvez pas dire qu’il ne s’est rien passé !
Le Gouvernement a inscrit la question des clauses miroirs à l’agenda européen, alors qu’elle n’y figurait pas, et cela sous l’impulsion de mon prédécesseur, Julien Denormandie, en accord avec le Président de la République dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne.
Oui, il faut introduire des clauses miroirs dans l’ensemble des accords internationaux. Nous avons d’ailleurs refusé certains accords, comme ceux avec l’Australie et le Mercosur. La France, parfois seule – sans doute trop seule… –, a refusé ces accords au motif que des clauses miroirs n’y figuraient pas, en particulier celles qui sont relatives à l’accord de Paris. Voilà un exemple d’action concrète que nous avons menée. L’absence de clauses miroirs dans ces deux accords a justifié notre refus de les entériner. Nous avons donc tenté, vous le voyez bien, de progresser sur ce sujet.
En outre, en matière de réciprocité des normes, nous avons défendu trois types de mesures miroirs : l’interdiction des importations de produits d’origine animale pour lesquels il a été fait usage d’antimicrobiens ; la suppression des tolérances à l’importation de produits contenant des résidus de pesticides interdits ; et la lutte contre la déforestation importée. Ces mesures s’appliquent désormais dans un certain nombre d’accords et des décisions européennes ont été prises dans ce sens.
L’initiative portée par la France a eu pour résultat l’introduction d’une conditionnalité tarifaire dans l’accord avec la Nouvelle-Zélande réservant le bénéfice de l’accès préférentiel aux produits issus de bovins nourris à l’herbe.
Pa ailleurs, la Commission européenne a présenté le 6 décembre 2022 le projet d’acte délégué permettant d’étendre aux importations de viande l’interdiction européenne d’utiliser des antibiotiques.
L’accord trouvé entre le Conseil européen et le Parlement européen le 6 décembre 2022 sur l’instrument de lutte contre la déforestation est un autre exemple de résultat concret que nous avons obtenu.
Enfin, la Commission européenne a également adopté, le 2 février dernier, au titre de la protection des pollinisateurs, la mise à zéro des limites maximales de résidus acceptables dans un certain nombre de produits.
Je ne dis pas que tout est résolu, mais nous essayons de progresser à chaque fois que c’est possible. Dans toutes les discussions que nous avons sur les questions commerciales, nous veillons à intégrer des clauses miroirs, car sans elles, nos agriculteurs subiraient une distorsion de concurrence.
Certes, il ne s’agit pas d’une équivalence absolue et ni l’agriculture brésilienne ni l’agriculture canadienne ne fonctionnent comme l’agriculture française. Toutefois, dès que l’on constate un risque de distorsion de concurrence, il faut travailler à inclure des clauses miroirs et c’est ce que nous faisons.

Monsieur le ministre, nos agriculteurs méritent une égalité de traitement, que leurs produits soient en concurrence avec d’autres qui proviennent de l’extérieur ou de l’intérieur de l’Union européenne.
C’est un enjeu essentiel pour nos villages et nos communes, ainsi que pour notre puissance agricole. L’agriculture ne doit pas être une variable d’ajustement des négociations commerciales.
Je prends acte de votre fermeté et je vous invite à tenir cette position tout au long des négociations à venir.

La parole est à M. Patrick Chaize, auteur de la question n° 922, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Ma question porte sur l’impérieuse nécessité d’agir pour améliorer la balance commerciale française grâce à la filière forêt-bois.
Depuis 2017, nous faisons face à une crise sanitaire frappant une partie des forêts, dont celles les plus productives d’Auvergne-Rhône-Alpes. La conjoncture commerciale, peu dynamique, provoque un retrait de la demande. Un nombre croissant de propriétaires forestiers voient leurs recettes forestières ainsi que leur capital forestier sur pied littéralement amputés.
Tout porte à croire que les effets du changement climatique ne faibliront pas et que le modèle économique de la forêt française doit évoluer pour survivre : nous devons préserver ses emplois, qui représentent près de 375 000 salariés directs, approvisionner son industrie en matériaux de qualité et maintenir une gestion forestière durable.
Si le Gouvernement déploie des dispositifs d’accompagnement importants, ces mesures ne répondent que partiellement aux difficultés du premier maillon de la filière. Il faut prévenir une dévalorisation du matériau bois.
À la différence des bois de chêne pour lesquels il faut lutter contre l’export des grumes, l’enjeu est inversé pour les résineux dans les temps de crise que nous traversons : il s’agit de lutter contre l’importation de bois transformé. Cette dépendance à l’importation désavantage les propriétaires forestiers, en mettant à mal l’avenir du financement du modèle de gestion multifonctionnelle. De surcroît, elle met l’industrie nationale à rude épreuve, accroît le déficit de la balance commerciale et aggrave le mécanisme de déforestation importée.
Dans ce contexte, et en complément du dispositif France 2030, le Gouvernement envisage-t-il d’intervenir sur les politiques d’achat de bois et d’encadrer davantage les marchés ?
Monsieur le sénateur Chaize, je ne suis pas certain que l’on puisse fixer précisément à 2017 le moment où la crise de la forêt française et de la filière bois a commencé… Il me semble que cette crise est bien plus ancienne. Les forestiers vous diraient même que le sujet existe depuis dix, quinze ou vingt ans. Le dépérissement forestier n’est pas nouveau ; en revanche, il s’accélère – vous avez raison de le dire.
Tout d’abord, concernant le dépérissement des forêts, nous devons travailler à mieux accompagner les professionnels pour qu’ils fassent évoluer leurs exploitations de manière à affronter le dérèglement climatique. C’est tout le sens du volet « renouvellement forestier » du plan de relance, qui consacre 250 millions d’euros au financement du reboisement et du renouvellement selon des modalités de gestion durable qui prennent en compte le phénomène de grande migration que subissent les forêts, qu’il s’agisse des résineux ou des feuillus, et qui les fait évoluer de manière importante.
Ensuite, dans un certain nombre de cas, la surface des forêts dépérit à grande vitesse. Cela concerne des centaines de milliers d’hectares de bois, de sorte qu’il faut traiter le problème très rapidement. Sinon, la filière risque de subir une perte nette.
Nous devons donc penser nos outils de transformation non seulement pour l’avenir, mais aussi dans le cadre de la crise qui s’annonce : elle arrive dans nos forêts comme une tempête silencieuse qui se manifestera très rapidement.
Comme je l’ai dit, nous avons prévu une enveloppe de 250 millions d’euros pour financer des plantations et le renouvellement forestier – c’était une première étape en vue de la transformation de nos forêts – et nous ajoutons maintenant 200 millions d’euros.
Jamais des moyens aussi importants n’ont été dégagés et ils seront reconduits en 2024 – c’est inscrit dans le projet de loi de finances qui est en cours d’examen par le Parlement –, ainsi que les années suivantes. Il est important de le préciser, parce que cela donne de la visibilité aux différentes filières qui pourront ainsi s’organiser et lancer la modernisation de leurs outils pour transformer la forêt française.
Enfin, il faut poursuivre la logique mise en œuvre dans le cadre de l’accord de filière « chêne », en développant la contractualisation. J’ai confiance dans cette logique. Pendant des années, on n’a pas rémunéré la matière et elle est partie ailleurs. Désormais, la matière coûte parfois très cher et l’on peine à trouver un équilibre économique global. D’où la nécessité de contractualiser. Tel est le sens de l’accord de filière « chêne », qu’il faut élargir aux résineux et même plus largement à l’ensemble des feuillus.

Monsieur le ministre, la forêt a fourni des recettes à certaines communes, mais elle est désormais source de déficit. Le risque est donc que les communes abandonnent les forêts, alors que celles-ci font partie de notre patrimoine.
À mon sens, nous devons rester vigilants sur la valorisation des bois dépérissants.
M. le ministre approuve.

La parole est à M. Hervé Gillé, auteur de la question n° 973, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Monsieur le ministre, l’examen du budget 2024 aurait pu être l’occasion de sécuriser le financement de la phase opérationnelle des projets alimentaires territoriaux (PAT). Or, à ce jour, cette proposition semble écartée par le Gouvernement.
Le 30 novembre dernier, vous avez lancé un nouvel appel à projets en lien avec la future stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat. En ce sens, vous avez fait parvenir un communiqué aux différents acteurs territoriaux par le biais des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf).
Il y est indiqué qu’une enveloppe budgétaire de 2, 84 millions d’euros serait consacrée aux nouveaux PAT. Qu’en est-il pour accompagner les besoins en ingénierie des projets de niveau 2 existants pour leur mise en œuvre opérationnelle ?
En effet, pour que ces financements aient du sens et que la massification des PAT soit enclenchée, il nous faut consolider les projets territoriaux qui fonctionnent, en leur donnant de la visibilité. Les acteurs territoriaux ont principalement besoin de recruter un animateur dédié, et non de simples prestataires, et de financer des actions pour consolider l’entrée en phase opérationnelle.
En Gironde, plusieurs PAT sont concernés. Prenons l’exemple du pôle territorial du Cœur Entre-deux-Mers, dont les besoins sont évalués à 160 000 euros pour cinq ans, soit au moins le montant de ce qui a été versé pour la labellisation de niveau 1.
Une enveloppe supplémentaire prévoyant des financements pour les PAT existants a été annoncée. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer le montant et la durée de cette enveloppe supplémentaire ? Va-t-elle au-delà du seul financement du réseau national des PAT ? S’agira-t-il d’une enveloppe contractualisée pluriannuelle afin de donner de la visibilité aux acteurs territoriaux ?
Monsieur le sénateur Gillé, vous attirez mon attention sur les PAT.
Tout d’abord, je tiens à rappeler que ce dispositif est issu d’une initiative datant d’avant 2017, qui n’avait pas trouvé son financement avant la mise en œuvre du plan de relance. Depuis lors, le nombre de ces projets a été multiplié de façon exponentielle sur le territoire. Nous le devons à la politique que nous avons menée dans le cadre de France Relance. On peut toujours créer des dispositifs, mais mieux vaut avoir les moyens de les faire fonctionner…
Ensuite, vous m’interrogez à juste titre sur l’avenir des PAT. Nous avons décidé de prolonger la dynamique à la fois pour que de nouveaux projets voient le jour et pour soutenir l’animation des projets existants, en particulier dans le cadre de la labellisation.
Enfin, nous inscrirons cette dynamique dans le cadre de la planification écologique, qui constitue naturellement l’un des leviers de la transformation de notre agriculture. Or les PAT favorisent, à l’échelle d’un territoire, le dialogue avec les agriculteurs en matière d’alimentation. On a besoin de filières courtes et les PAT contribuent à les développer. Nous tenons donc à poursuivre cette dynamique.
Pour cela, nous avons décidé de consacrer 20 millions d’euros dès 2024 aux PAT. Des financements seront réservés à l’animation des projets en phase opérationnelle, en lien avec la labellisation de niveau 2. Des crédits seront affectés au financement du réseau – vous l’avez dit – aux niveaux national et régional pour assurer un accompagnement technique des projets, notamment dans la perspective de déployer des actions concrètes en prenant plus largement en compte l’ensemble des dimensions de l’alimentation, qu’il s’agisse de l’économie, de l’environnement ou de la justice sociale.
Nous poursuivrons également l’accompagnement des PAT émergents dans le cadre de l’édition 2023-2024 de l’appel à projets du programme national pour l’alimentation.
Vous me demandez combien de temps dureront ces mesures. Comme vous le savez, l’annualité budgétaire s’impose à nous, mais dans la mesure où il s’agit de planification, ces mesures sont prévues de manière au moins triennale. D’autres déferont peut-être ce que nous faisons. Quoi qu’il en soit, nous aurons ouvert une perspective pour permettre à tous les territoires de travailler sur ce sujet.

Monsieur le ministre, je suis tout à fait d’accord avec vous pour consolider la planification écologique et pour la transcrire dans un programme pluriannuel.
Je souhaite attirer votre attention sur le PAT du Cœur Entre-deux-Mers, en Gironde, et sur la reconversion de certaines terres en lien avec la crise viticole. Nous pouvons avoir intérêt à accompagner ce mouvement de reconversion des terres. Dans ce cas de figure, on pourrait envisager de prévoir, par exemple via le fonds vert, une enveloppe spécifique pour améliorer les dispositifs. Cela enverrait assurément, dans le cadre de la crise actuelle, un signal politique intéressant.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, auteur de la question n° 987, adressée M. le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Monsieur le ministre, des inquiétudes planent sur la démographie agricole française. Près de 45 % des agriculteurs en activité seront partis à la retraite à l’horizon 2030, comme le rappelle, dans son introduction, le pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture, que vous avez présenté vendredi dernier à Yvetot. Or seulement deux tiers d’entre eux seront remplacés avec certitude par de nouveaux arrivants.
À peine dévoilé, ce pacte, publié quelques semaines avant la présentation du projet de loi d’orientation et d’avenir agricoles, suscite déjà de l’incompréhension, voire, parfois, du mécontentement. Malgré un an et demi de concertations et plusieurs reports du texte, les éléments présentés la semaine dernière restent très insuffisants.
Parmi les trente-cinq mesures présentées dans le pacte, aucune ne fixe un objectif chiffré quant au nombre de nouvelles installations à atteindre chaque année.
L’avant-projet de loi demeure pour sa part très silencieux sur la question du foncier. Si le texte reprend notamment l’idée d’un groupement foncier agricole d’investissement (GFAI), un dispositif prévu dans la proposition de loi de notre collègue Vanina Paoli-Gagin, il ne se montre, pour le reste, pas à la hauteur des enjeux.
Faute de leviers fiscaux plus contraignants, le dispositif, dans son état actuel, ne devrait concerner que quelques dizaines d’agriculteurs par an – tout au plus.
Le projet ne semble pas prendre la mesure du problème de l’accessibilité des terres agricoles : à l’heure actuelle, 40 % des exploitants sont locataires de leur terre, mais cela représente 75 % de la superficie agricole utilisée (SAU) totale. Le déséquilibre entre ces deux données est alarmant.
Il est urgent d’offrir des pistes stables et consolidées d’accessibilité au foncier pour garantir la diversité des modèles composant notre agriculture.
Des mesures fiscales performantes visant à ne pas dissocier le foncier de l’installation, un panel consolidé d’aides à l’installation tendant à faciliter l’accès au foncier ou encore une fiscalité plus avantageuse pour les nouveaux arrivants sont des pistes dont le pacte d’orientation aurait pu s’inspirer.
Ma question est donc la suivante, monsieur le ministre : quelles garanties complémentaires entendez-vous apporter aux nouveaux agriculteurs dans le cadre de leur installation ? Il est en effet fondamental que le Gouvernement se saisisse de tous les dispositifs possibles pour remédier à la double crise qui nous attend, celle du foncier et celle du renouvellement générationnel.
Monsieur le sénateur, je vous trouve un peu dur, pardonnez-moi de le dire, avec le pacte et le projet de loi d’orientation et d’avenir agricoles, dont nous débattrons dans cet hémicycle.
Nous soulevons, au travers de ce projet de loi, la question du foncier et nous le faisons d’une façon qui n’est ni pire ni meilleure que ne l’a fait le Sénat, puisque nous l’abordons à l’aune des groupements fonciers agricoles d’investissement. On ne peut pas saluer une proposition quand elle vient du Sénat et la regretter quand elle est avancée par le Gouvernement ! Selon moi, cela va plutôt dans le bon sens, et nous aurons des débats nourris.
Par ailleurs, je ne partage pas votre point de vue sur le foncier agricole. Qu’une partie des agriculteurs soient locataires, c’est aussi vieux que l’histoire agricole française ! Faut-il être forcément propriétaire de son foncier agricole ? Non !
En revanche, il ne faut pas que le statut de la propriété foncière empêche de jeunes agriculteurs de s’installer, parce que le foncier serait accaparé par des propriétaires souhaitant simplement agrandir leur exploitation. Voilà le véritable sujet !
Le fermage – un formidable outil – est sans doute ce qui a permis à la France d’atteindre son statut de puissance agricole, car il est l’un des plus performants. Il a permis un accès au foncier à des tarifs très faibles par rapport à d’autres pays. Sans aller très loin au nord – je pense à la Belgique ou aux Pays-Bas –, vous verrez que les tarifs du foncier, à la location comme à l’achat, sont incomparablement moins compétitifs que les nôtres.
Il faut donc préserver le fermage. Aussi je n’ai pas voulu ouvrir cette question. Je le répète, cet outil très puissant assure notre compétitivité agricole !
J’ajoute que, dans le pacte et le projet de loi, d’autres questions que le foncier sont ouvertes, qu’il s’agisse de la rémunération, des transitions ou encore du guichet unique.
Enfin, nous mettrons en place à partir du mois de janvier prochain le fonds Entrepreneurs du vivant, qui vise à donner les moyens aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) ou à d’autres établissements publics fonciers de porter plus longtemps du foncier – d’une certaine façon, cela revient à retirer le foncier du marché – pour l’attribuer à des jeunes ou à des moins jeunes d’ailleurs, puisque les profils de ceux qui s’installent en tant qu’agriculteurs sont très variés. Au travers des GFAI, nous donnons aux établissements publics fonciers les moyens de mieux accompagner les jeunes pour leur installation.
C’est sur cette base que nous pourrons avancer, et nous en tenons compte dans le pacte et dans le projet de loi d’orientation à venir.

La parole est à Mme Frédérique Puissat, auteur de la question n° 047, adressée M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Monsieur le ministre, j’attire votre attention sur la situation fiscale du groupement d’intérêt public (GIP) de la maison de l’emploi et de la formation des pays voironnais et sud Grésivaudan dans l’Isère, qui peut concerner bien d’autres cas.
Ce GIP, institué par un arrêté du préfet de région, associe les collectivités territoriales, le service public de l’emploi et des représentants d’entreprises. Sa vocation est de regrouper dans un seul ensemble plusieurs outils et dispositifs pour l’emploi, la formation, l’orientation et l’insertion, ce qui est un gage d’efficacité et d’économies d’échelle.
Le personnel de ce GIP se compose de trente-huit personnes mises à disposition de la maison de l’emploi par les collectivités locales, leur employeur.
Or, pendant plusieurs années, les collectivités ont mis à disposition du GIP des agents en contrat à durée déterminée (CDD), pour lesquels la réglementation ne prévoit pas cette disposition statutaire.
La maison de l’emploi s’est donc mise en conformité avec la réglementation le 1er janvier 2021, en employant directement quinze agents en contrat à durée déterminée.
Le GIP n’étant pas assujetti, du fait de son statut, à la taxe sur la valeur ajoutée, il se doit de régler, depuis cette date, la taxe sur les salaires pour ces agents en CDD. Jusqu’à présent, celle-ci s’élevait à 30 000 euros par an ; en 2024, elle s’élèvera à 53 000 euros.
Monsieur le ministre, bien qu’il n’y ait eu aucun changement effectif au sein de cette maison de l’emploi, une surcharge de 53 000 euros est donc apparue dans le budget !
Cette maison de l’emploi n’ayant pas de but lucratif, serait-il possible de la considérer comme une association, afin qu’elle bénéficie de l’abattement de la taxe sur les salaires prévue par l’article 1679 A du code général des impôts ?
Madame la sénatrice Puissat, la taxe sur les salaires s’applique aux rémunérations individuelles versées aux salariés par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année précédant celle du paiement desdites rémunérations.
Au regard de ce principe général, les groupements d’intérêt public entrent dans ce champ d’application, à l’instar des maisons de l’emploi qui ont choisi cette forme juridique, dès lors que leurs activités échappent à la TVA, qu’elles soient non imposables, qu’elles en soient exonérées ou encore qu’elles n’y soient que partiellement soumises.
Je vous confirme que seules les rémunérations versées par l’employeur à son personnel propre ou à celui qui lui est détaché – c’est le cas qui s’applique dans la situation que vous mentionnez – et pour lequel il a la qualité d’employeur entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires.
En revanche, les rémunérations versées au personnel simplement mis à sa disposition n’ont pas à être soumises à la taxe, dans la mesure où la simple mise à disposition ne confère pas au GIP la qualité d’employeur.
De la même manière, le GIP n’est pas redevable de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations qui seraient financées directement par le budget général de l’État. En effet, ces rémunérations sont exonérées de la taxe de par la loi.
En outre, les GIP ne sont pas éligibles à l’abattement de cotisation annuelle de la taxe sur les salaires, dont bénéficient certains organismes sans but lucratif.
Toute extension du périmètre d’application de cet abattement entraînerait des conséquences financières potentiellement importantes sur le rendement de cette taxe qui, je le rappelle, est intégralement affectée au budget de la sécurité sociale. C’est pourquoi nous n’envisageons pas une telle piste de réforme.
Cela étant, je vous précise que l’État participe directement au financement des maisons de l’emploi. Ainsi, il peut prendre en charge, sous certaines conditions, jusqu’à 70 % de leur budget de fonctionnement : 5 millions d’euros sont ouverts à ce titre dans le projet de loi de finances initiale pour 2024. Peut-être est-ce une piste à suivre, madame la sénatrice, pour le GIP auquel vous faites référence.

Monsieur le ministre, votre intervention est très technique et j’entends vos arguments.
Mais je vous rappelle que ce sont les parlementaires qui, chaque année, lors de l’examen du projet de loi de finances, prennent l’initiative d’augmenter les crédits que l’État consacre au financement des maisons de l’emploi ! Certes, nous nous félicitons de n’avoir pas eu à le faire cette année, car l’État avait prévu ce qu’il fallait.
Dans le cas que j’évoque, les élus ont tout à coup vu apparaître dans leur budget une surcharge de 53 000 euros, ce qui freine nécessairement leur capacité d’action ! Ne serait-il pas possible d’affecter davantage de crédits provenant de l’État sur ce type de structure, pour compenser une telle surcharge ?
Voilà la piste à étudier, monsieur le ministre, et je souhaiterais que vous vous y engagiez, notamment pour soutenir le GIP de la maison de l’emploi et de la formation des pays voironnais et sud Grésivaudan dans l’Isère.

La parole est à Mme Véronique Guillotin, auteure de la question n° 609, adressée M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Monsieur le ministre, ma question porte sur les difficultés rencontrées par les entreprises françaises de fabrication de masques chirurgicaux, dont certaines se sont implantées dans nos territoires durant la crise sanitaire.
Confronté à une pénurie de masques, jusqu’ici largement importés d’Asie, notamment de Chine, l’État a incité les entrepreneurs à investir dans la production de masques dès le début de la crise, et c’est ce qu’ils ont fait.
L’entreprise Family Concept implantée dans le nord du département de Meurthe-et-Moselle, dont le dirigeant est en tribunes, a répondu à cet appel à la souveraineté nationale et a participé à la fabrication de millions de masques 100 % français.
Or la production de cette entreprise est aujourd’hui à l’arrêt et son stock est deux fois supérieur à ses contrats annuels. Sont en cause les appels d’offres, dont certains sont toujours confiés à des revendeurs de masques asiatiques, et d’autres qui privilégient les grandes entreprises françaises, comme c’est le cas pour le stock stratégique de l’État.
Créateurs d’emplois dans des territoires qui connaissent souvent un sous-investissement, comme la Lorraine, nos entrepreneurs déplorent aujourd’hui un manque de soutien de l’État, alors même qu’ils ont répondu à son appel pour une plus grande indépendance quant aux produits stratégiques. Beaucoup de ces entreprises ne survivront pas.
Je rappelle également que la Commission européenne a récemment sanctionné les concurrents indiens de Saint-Gobain, autre belle entreprise de Meurthe-et-Moselle, pour leurs pratiques de dumping fiscal.
On sait que certains gouvernements asiatiques subventionnent les entreprises et que la frontière entre public et privé y est parfois ténue, ce qui fait évidemment baisser les tarifs. Ce sont des pratiques qui vont à l’encontre des règles de la concurrence et qui doivent être prises en compte dans le choix des fournisseurs, en plus des questions sociales et environnementales.
La sécurisation des approvisionnements des marchés publics par nos entreprises de fabrication de masques est donc indispensable, ce qui doit passer par l’établissement de critères tels que la fabrication et la provenance européennes des matières premières ou encore la durée de validité de cinq ans des masques.
Monsieur le ministre, pouvez-vous me dire – et dire à cet entrepreneur – quelles sont les intentions du Gouvernement pour préserver les entreprises françaises de fabrication de masques dans un contexte post-covid ?
Madame la sénatrice, monsieur le chef d’entreprise, que je salue, le marché du masque fait face à un double défi. D’une part, la demande a baissé, et c’est une bonne nouvelle, puisque cela vient du fait que la pandémie est terminée. Ainsi, les stocks accumulés pendant cette crise sont aujourd’hui disponibles. D’autre part, la forte baisse des prix des produits asiatiques augmente la concurrence.
Le Gouvernement s’est saisi de ce défi : je pense à des dispositions introduites dans le cadre de la loi relative à l’industrie verte, de la loi Climat et résilience, issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, puis de la loi de financement de la sécurité sociale.
Ainsi, les acheteurs publics sont dorénavant autorisés à diminuer l’importance du critère lié au prix dans leurs appels d’offres, afin de davantage prendre en compte des critères environnementaux, sociaux et de souveraineté.
Vous le savez, le risque de manque de stocks qui a plané pendant la crise – c’est le moins qu’on puisse dire – a mis en lumière l’importance de la souveraineté industrielle.
Les nouveaux critères fixés par la loi de financement de la sécurité sociale seront applicables dès janvier 2024 et pourront éventuellement être appliqués à des appels d’offres lancés précédemment. Un mécanisme de compensation des surcoûts éventuels supportés par les établissements de santé est également prévu dans cette loi.
Nous mettons en œuvre un certain nombre de dispositions qui, je l’espère, permettront de répondre aux défis que vous avez mentionnés, madame la sénatrice.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Quelques avancées ont été réalisées, mais nous devons rester vigilants, parce que les marchés publics destinés à constituer le stock de masques dont nous avions besoin ont privilégié les grandes entreprises.
Un véritable travail doit être mené pour traiter cette question, car il y va de la réindustrialisation de nos territoires et de la souveraineté nationale.

La parole est à Mme Christine Herzog, auteure de la question n° 125, adressée M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Monsieur le ministre, au 1er janvier 2021, les dépenses d’acquisition, d’aménagement et d’agencement de terrains ont perdu leur éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
Beaucoup d’élus ayant engagé ce type de dépenses, sur lesquelles ils étaient habitués à récupérer la TVA en n+1, n’ont pas vu venir ce changement de règle ; ils s’en sont donc rendu compte après coup !
Aussi, ils n’ont pas pu récupérer la TVA sur les dépenses relatives aux comptes 211 et 212, car elles ont été exclues de celles qui sont éligibles au FCTVA, ce qui a eu des effets parfois désastreux sur leur budget.
Finalement, le Gouvernement est revenu en arrière. Il a autorisé de nouveau, à compter du 1er janvier 2024, l’intégration dans l’assiette du FCTVA des dépenses d’aménagement de terrains effectuées par les collectivités locales. Ainsi, ces dépenses, réalisées à compter du 1er janvier 2024, seront éligibles au FCTVA.
Personne n’a compris la justification de cette interruption pour les années 2021, 2022 et 2023.
Il s’agit maintenant de savoir si les dépenses effectuées pour des travaux d’aménagement de terrains par une commune entre 2021 et 2023 seront éligibles de manière rétroactive au FCTVA.
J’ai donc deux questions à vous poser, monsieur le ministre : pourquoi avoir supprimé la possibilité de récupérer le FCTVA pour la réinstaurer deux ans plus tard ? Le Gouvernement permet-il un rattrapage sur 2021, 2022 et 2023 pour ce type de travaux, qu’ils soient toujours en cours ou entièrement réalisés au 1er janvier 2024 ?
Madame la sénatrice Herzog, je rappelle d’abord que la loi de finances pour 2021 a mis en œuvre la réforme de l’automatisation de la gestion du FCTVA et a amorcé la transmission automatique des dépenses éligibles. Cette baisse des charges administratives fait gagner en efficacité et, sans doute, en fiabilité.
Ce nouveau mode de gestion s’applique aux dépenses mandatées depuis le 1er janvier 2021. La réforme de l’automatisation n’a pas remis en cause le régime de versement du FCTVA. S’agissant des communes, les fonds attribués une année donnée correspondent bien au volume des dépenses éligibles réalisées au titre de la pénultième année. Une série de mesures d’assouplissement permet cependant un versement anticipé.
La réforme a conduit à redéfinir l’assiette des dépenses considérées comme éligibles. Dans le système déclaratif, l’assiette était définie par des critères juridiques. À la suite de cette réforme, l’éligibilité des dépenses se constate en fonction de leur imputation comptable sur un compte éligible.
Or le périmètre des comptes du plan comptable des collectivités ne permet pas de faire coïncider exactement l’assiette automatisée et l’assiette réglementaire. Des ajustements ont donc été opérés après une large concertation avec les associations d’élus engagée en 2016, dont l’objectif était la neutralité financière.
Le Gouvernement a décidé qu’à compter du 1er janvier 2024 les dépenses d’aménagement de terrains seront réintégrées dans l’assiette d’éligibilité. Cette mesure trouve sa traduction dans le projet de loi de finances pour 2024. Elle majore d’ores et déjà de 250 millions d’euros le soutien apporté chaque année par l’État à l’investissement des collectivités territoriales. Cette hausse d’enveloppe s’ajoutera aux dépenses rendues éligibles depuis 2021 dans le cadre de la réforme.
Il s’agit d’une mesure tournée vers l’avenir, qui vise à renforcer le niveau de l’investissement public local futur et à accompagner encore davantage les projets locaux, notamment en faveur de la transition écologique.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Le FCTVA est non pas un cadeau fait par l’État aux collectivités, mais un juste retour sur les investissements qu’elles mettent en œuvre.
Aussi, un petit coup de pouce via une hausse de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour les communes qui ont perdu au change serait bienvenu !

La parole est à Mme Nathalie Delattre, auteure de la question n° 799, adressée à M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Monsieur le ministre, en avril dernier, je vous ai sollicité par courrier sur les difficultés rencontrées par les organismes consulaires pour accompagner les chefs d’entreprise dans leurs déclarations sur le guichet électronique des formalités d’entreprises, dit guichet unique, opéré par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi).
Votre réponse, très sommaire, m’a renvoyée vers les partenaires consulaires, qui ne sont pourtant pas les développeurs de la plateforme de télédéclaration.
Du reste, cette plateforme a connu, dès le début, de graves et nombreux dysfonctionnements, à tel point qu’il a fallu mettre en place des procédures de secours.
Force est de constater qu’après un an d’exploitation ce produit informatique ne fonctionne toujours pas de manière satisfaisante : incidents à répétition, formalités non accessibles sur la plateforme et, depuis quelques semaines, obligation pour les déclarants d’effectuer, en amont de leurs démarches, des mises à jour sur le registre national des entreprises.
En effet, ce dernier, mis en place récemment dans le cadre de l’article 2 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, ne récupère pas les données d’entreprises déclarées précédemment sur les autres registres.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous apporter des garanties sur le bon fonctionnement de ce guichet avec des données d’entreprises fiables ?
Pensez-vous mettre en place de nouvelles procédures de secours, si les problèmes informatiques persistent au 1er janvier 2024 ?
En accord avec votre plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises de 2019, qui devait poursuivre la simplification des démarches d’entreprises, pouvons-nous espérer pour 2024 une amélioration des procédures afin d’inciter les Français à entreprendre davantage ?
Madame la sénatrice Delattre, je reconnais volontiers que nous n’avons pas encore atteint le nirvana, mais le dispositif s’est nettement amélioré ! J’entends vos frustrations. Au reste, en tant qu’ancien rapporteur du projet de loi Pacte à l’Assemblée nationale, je partage votre volonté de disposer d’un guichet efficace.
Il faut tout de même reconnaître qu’après des débuts difficiles pour les entreprises, la situation s’est nettement améliorée. Ainsi, tous les types de formalités sont maintenant disponibles et près de 2 millions de déclarations ont été déposées depuis le début de l’année, qu’il s’agisse d’une création d’entreprise, d’un dépôt de compte, d’une modification de situation ou encore d’une cessation d’activité.
Au 30 novembre 2023, on a compté depuis l’ouverture du guichet un flux moyen de plus de 12 000 formalités par jour, mais nous souhaitons atteindre un niveau de 20 000. Le guichet unique reçoit 100 % des créations d’entreprises et plus de 80 % des autres formalités.
La situation de janvier 2024 est donc bien différente de celle de janvier 2023 : comme l’attestent les chiffres que je viens de vous donner, le guichet est monté en puissance et en qualité pour les formalités de création, de cessation ou de modification d’activité ou pour celles de dépôts des comptes.
L’enjeu est désormais de garantir la continuité et l’amélioration du service – comme vous l’avez indiqué, madame la sénatrice, celui-ci est encore perfectible – pour tous les déclarants, notamment en ce qui concerne les modifications des sociétés, dont 20 % seulement sont aujourd’hui enregistrées sur le guichet unique.
Avec Bruno Le Maire, Olivia Grégoire et l’ensemble des parties prenantes – greffiers, chambres consulaires, organismes compétents, que je remercie, car nous avons besoin de nous appuyer sur leur expertise –, je travaille à la définition d’une procédure de continuité de sorte qu’en cas de nouveau dysfonctionnement du guichet, les usagers puissent effectuer leur démarche.
J’espère que vous aurez l’occasion de me poser une nouvelle question d’ici à quelques mois et que celle-ci sera l’occasion de remercier et de féliciter le Gouvernement du travail accompli.
Sourires.

Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande que l'examen de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, prévu en premier point de l'ordre du jour de cet après-midi, soit inscrit à la fin de l'ordre du jour de cet après-midi, après le début de l'examen du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires.
Acte est donné de cette demande.
En conséquence, nous examinerons ces conclusions à 19 heures.
Modification de l’ordre du jour

Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande que l’examen de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévu en premier point de l’ordre du jour de cet après-midi, soit inscrit à la fin de l’ordre du jour de cet après-midi, après le début de l’examen du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires.
Acte est donné de cette demande.
En conséquence, nous examinerons ces conclusions à 19 heures.

Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande que l’examen de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévu en premier point de l’ordre du jour de cet après-midi, soit inscrit à la fin de l’ordre du jour de cet après-midi, après le début de l’examen du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires.
Acte est donné de cette demande.
En conséquence, nous examinerons ces conclusions à dix-neuf heures.
Questions orales (suite)
suppression de la taxe communale sur les services funéraires

Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur la suppression, par la loi de finances pour 2021, des taxes communales sur les services funéraires – convoyage, inhumation, crémation funéraire.
Le maire de Guérigny, dans la Nièvre, qui m'a alertée à ce sujet, a vu les recettes de sa commune de 2 500 habitants chuter de 4 000 euros.
La Cour des comptes estime que ces taxes étaient prélevées par seulement quatre cents communes jusqu'en 2020, ce nombre restreint s'expliquant par la faible proportion de collectivités disposant d'un funérarium.
Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2021, la suppression de ces taxes a été adoptée par l'Assemblée nationale à deux reprises, avec l'avis favorable du Gouvernement, au motif de leur « incidence fiscale sur les proches des défunts ». Le Sénat, lui, avait voté contre.
Alors que la Cour des comptes recommandait le remplacement de ces taxes, qui constituaient une source de recettes non négligeable pour les petites communes, par une augmentation du prix des concessions funéraires, elles n'ont de fait pas été compensées.
Avec la suppression de la taxe d'habitation, cette nouvelle suppression de recettes contribue à fragiliser encore davantage le budget des communes.
Monsieur le ministre, le Gouvernement compte-t-il compenser cette perte de recettes pour les collectivités territoriales ?

La parole est à Mme Nadia Sollogoub, auteur de la question n° 124, adressée à M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics.

Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur la suppression, par la loi de finances pour 2021, des taxes communales sur les services funéraires – convoyage, inhumation, crémation funéraire.
Le maire de Guérigny, dans la Nièvre, qui m’a alertée à ce sujet, a vu les recettes de sa commune de 2 500 habitants chuter de 4 000 euros.
La Cour des comptes estime que ces taxes étaient prélevées par seulement quatre cents communes jusqu’en 2020, ce nombre restreint s’expliquant par la faible proportion de collectivités disposant d’un funérarium.
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021, la suppression de ces taxes a été adoptée par l’Assemblée nationale à deux reprises, avec l’avis favorable du Gouvernement, au motif de leur « incidence fiscale sur les proches des défunts ». Le Sénat, lui, avait voté contre.
Alors que la Cour des comptes recommandait le remplacement de ces taxes, qui constituaient une source de recettes non négligeable pour les petites communes, par une augmentation du prix des concessions funéraires, elles n’ont de fait pas été compensées.
Avec la suppression de la taxe d’habitation, cette nouvelle suppression de recettes contribue à fragiliser encore davantage le budget des communes.
Monsieur le ministre, le Gouvernement compte-t-il compenser cette perte de recettes pour les collectivités territoriales ?
Cela n'est pas prévu à ce stade, madame la sénatrice !
L'article 121 de la loi de finances pour 2021, issu d'un amendement parlementaire, a abrogé l'article du code général des collectivités territoriales qui autorisait la perception de taxes pour les convois, les inhumations et les crémations.
Cette mesure traduit les préconisations formulées par la Cour des comptes en faveur de la suppression et de la simplification des taxes dont le coût administratif pour l'État ou les collectivités est trop élevé au regard de leur faible rendement.
Dans son référé au Premier ministre daté du 3 décembre 2018, la Cour précisait ainsi que « ces taxes s'ajoutent, en pratique, pour les familles, au prix des concessions dans les cimetières, qui sont des redevances d'occupation du domaine public ».
Avant cette suppression, les comptes de gestion des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre faisaient état, pour l'année 2020, d'un produit de taxes funéraires dont le montant moyen s'établissait à 0, 1 % des recettes réelles de fonctionnement pour l'ensemble des bénéficiaires.
Telle est la raison pour laquelle le législateur n'a pas assorti cette suppression d'une compensation des pertes subies, pas plus que le Gouvernement n'envisage, madame la sénatrice, d'introduire de disposition en ce sens.
En tout état cause, les ressources des communes ont été relevées sous l'effet de la revalorisation des bases de taxe foncière, ainsi que par l'abondement de la dotation générale de fonctionnement des communes de 320 millions d'euros en 2023, et à nouveau de 320 millions d'euros pour 2024.
Cela n’est pas prévu à ce stade, madame la sénatrice !
L’article 121 de la loi de finances pour 2021, issu d’un amendement parlementaire, a abrogé l’article du code général des collectivités territoriales qui autorisait la perception de taxes pour les convois, les inhumations et les crémations.
Cette mesure traduit les préconisations formulées par la Cour des comptes en faveur de la suppression et de la simplification des taxes dont le coût administratif pour l’État ou les collectivités est trop élevé au regard de leur faible rendement.
Dans son référé au Premier ministre daté du 3 décembre 2018, la Cour précisait ainsi que « ces taxes s’ajoutent, en pratique, pour les familles, au prix des concessions dans les cimetières, qui sont des redevances d’occupation du domaine public ».
Avant cette suppression, les comptes de gestion des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre faisaient état, pour l’année 2020, d’un produit de taxes funéraires dont le montant moyen s’établissait à 0, 1 % des recettes réelles de fonctionnement pour l’ensemble des bénéficiaires.
Telle est la raison pour laquelle le législateur n’a pas assorti cette suppression d’une compensation des pertes subies, pas plus que le Gouvernement n’envisage, madame la sénatrice, d’introduire de disposition en ce sens.
En tout état cause, les ressources des communes ont été relevées sous l’effet de la revalorisation des bases de taxe foncière, ainsi que par l’abondement de la dotation générale de fonctionnement des communes de 320 millions d’euros en 2023, et à nouveau de 320 millions d’euros pour 2024.
Cela n’est pas prévu à ce stade, madame la sénatrice !
L’article 121 de la loi de finances pour 2021, issu d’un amendement parlementaire, a abrogé l’article du code général des collectivités territoriales qui autorisait la perception de taxes pour les convois, les inhumations et les crémations.
Cette mesure traduit les préconisations formulées par la Cour des comptes en faveur de la suppression et de la simplification des taxes dont le coût administratif pour l’État ou les collectivités est trop élevé au regard de leur faible rendement.
Dans son référé au Premier ministre daté du 3 décembre 2018, la Cour précisait ainsi que « ces taxes s’ajoutent, en pratique, pour les familles, au prix des concessions dans les cimetières, qui sont des redevances d’occupation du domaine public ».
Avant cette suppression, les comptes de gestion des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre faisaient état, pour l’année 2020, d’un produit de taxes funéraires dont le montant moyen s’établissait à 0, 1 % des recettes réelles de fonctionnement pour l’ensemble des bénéficiaires.
Telle est la raison pour laquelle le législateur n’a pas assorti cette suppression d’une compensation des pertes subies, pas plus que le Gouvernement n’envisage, madame la sénatrice, d’introduire de disposition en ce sens.
En tout état cause, les ressources des communes ont été relevées sous l’effet de la revalorisation des bases de taxe foncière, ainsi que par l’abondement de la dotation générale de fonctionnement des communes de 320 millions d’euros en 2023, et de nouveau de 320 millions d’euros pour 2024.

Je cite les conclusions de la Cour des comptes, monsieur le ministre : « [Ces taxes] pourraient être remplacées par d'autres ressources, par exemple en augmentant le prix des concessions funéraires et cinéraires. Une telle solution présenterait le triple avantage de supprimer un prélèvement obligatoire, d'alléger la tâche des trésoriers communaux et de simplifier la législation. »
La suppression de ces taxes n'a par ailleurs absolument rien changé pour les familles, car comme l'indique la Cour des comptes, le prix des prestations funéraires a augmenté deux fois plus vite que celui de l'ensemble des prix à la consommation.
En revanche, si la moyenne des ressources tirées de ces taxes s'établit effectivement à 0, 1 % des ressources totales des communes, leur suppression emporte une importante perte de recettes pour les quelques communes qui les percevaient.

Je cite les conclusions de la Cour des comptes, monsieur le ministre : « [Ces taxes] pourraient être remplacées par d’autres ressources, par exemple en augmentant le prix des concessions funéraires et cinéraires. Une telle solution présenterait le triple avantage de supprimer un prélèvement obligatoire, d’alléger la tâche des trésoriers communaux et de simplifier la législation. »
La suppression de ces taxes n’a par ailleurs absolument rien changé pour les familles, car comme l’indique la Cour des comptes, le prix des prestations funéraires a augmenté deux fois plus vite que celui de l’ensemble des prix à la consommation.
En revanche, si la moyenne des ressources tirées de ces taxes s’établit effectivement à 0, 1 % des ressources totales des communes, leur suppression emporte une importante perte de recettes pour les quelques communes qui les percevaient.
fonds vert et dotations d’investissement

Ma question porte sur le financement du fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, dit fonds vert. En 2023, le fonds vert a été annoncé à 2 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 500 millions d'euros en crédits de paiement, une partie de cette somme ayant du reste servi à compenser la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Pour 2024, le fonds vert est annoncé à 2, 5 milliards d'euros en autorisations d'engagement et à 1, 1 milliard d'euros en crédits de paiement. Toutefois, les montants du fonds ne figurent plus au tableau des concours financiers de l'État, si bien que la rubrique « Transferts financiers divers » est passée de 13, 7 milliards d'euros en 2023 à 10, 4 milliards d'euros en 2024.
Le rapport sur la situation des finances publiques locales n'évoque pas davantage le fonds vert.
La répartition des crédits au sein des différentes sous-actions du fonds vert n'étant pas détaillée dans les documents budgétaires, non plus que dans le projet annuel de performances pour 2024 de la mission « Écologie », le Parlement n'a pas disposé de ces informations essentielles lors de l'examen du projet de loi de finances.
Publierez-vous en toute transparence la répartition prévisionnelle des crédits de paiement et des autorisations d'engagement du fonds vert, qui aurait dû être précisée dans le projet de loi de finances pour 2024, monsieur le ministre ?
Pourriez-vous notamment préciser si, en 2024, les financements de projets alloués dans le cadre du fonds vert pourront à nouveau être versés à la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), à la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) ou à la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID) ? Pouvez-vous nous communiquer le bilan de ces transferts pour l'année 2023, le montant du verdissement de ces trois dotations étant fixé à 485 millions d'euros pour 2024 ?
De fait, la proximité de ces financements et des crédits alloués dans le cadre du fonds vert est source de confusion pour les parlementaires comme pour les élus locaux.
Est-il prévu que les dotations d'investissement participent en 2024 au financement des politiques du fonds vert ? Si oui, à quelle hauteur ?
Je vous remercie de nous apporter les réponses les plus éclairantes possible, monsieur le ministre. Il importe en effet de fournir aux responsables de nos collectivités et aux membres des commissions d'élus de la DETR une information précise et exhaustive sur les moyens alloués aux dotations d'investissement qui échappent à leurs décisions d'attribution et à tout débat contradictoire.

La parole est à M. Laurent Somon, auteur de la question n° 968, adressée à M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics.

Ma question porte sur le financement du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, dit fonds vert. En 2023, le fonds vert a été annoncé à 2 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 500 millions d’euros en crédits de paiement, une partie de cette somme ayant du reste servi à compenser la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Pour 2024, le fonds vert est annoncé à 2, 5 milliards d’euros en autorisations d’engagement et à 1, 1 milliard d’euros en crédits de paiement. Toutefois, les montants du fonds ne figurent plus au tableau des concours financiers de l’État, si bien que la rubrique « Transferts financiers divers » est passée de 13, 7 milliards d’euros en 2023 à 10, 4 milliards d’euros en 2024.
Le rapport sur la situation des finances publiques locales n’évoque pas davantage le fonds vert.
La répartition des crédits au sein des différentes sous-actions du fonds vert n’étant pas détaillée dans les documents budgétaires, non plus que dans le projet annuel de performances pour 2024 de la mission « Écologie », le Parlement n’a pas disposé de ces informations essentielles lors de l’examen du projet de loi de finances.
Publierez-vous en toute transparence la répartition prévisionnelle des crédits de paiement et des autorisations d’engagement du fonds vert, qui aurait dû être précisée dans le projet de loi de finances pour 2024, monsieur le ministre ?
Pourriez-vous notamment préciser si, en 2024, les financements de projets alloués dans le cadre du fonds vert pourront à nouveau être versés à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), à la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) ou à la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) ? Pouvez-vous nous communiquer le bilan de ces transferts pour l’année 2023, le montant du verdissement de ces trois dotations étant fixé à 485 millions d’euros pour 2024 ?
De fait, la proximité de ces financements et des crédits alloués dans le cadre du fonds vert est source de confusion pour les parlementaires comme pour les élus locaux.
Est-il prévu que les dotations d’investissement participent en 2024 au financement des politiques du fonds vert ? Si oui, à quelle hauteur ?
Je vous remercie de nous apporter les réponses les plus éclairantes possible, monsieur le ministre. Il importe en effet de fournir aux responsables de nos collectivités et aux membres des commissions d’élus de la DETR une information précise et exhaustive sur les moyens alloués aux dotations d’investissement qui échappent à leurs décisions d’attribution et à tout débat contradictoire.

Ma question porte sur le financement du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, dit fonds vert. En 2023, le fonds vert a été annoncé à 2 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 500 millions d’euros en crédits de paiement, une partie de cette somme ayant du reste servi à compenser la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Pour 2024, le fonds vert est annoncé à 2, 5 milliards d’euros en autorisations d’engagement et à 1, 1 milliard d’euros en crédits de paiement. Toutefois, les montants du fonds ne figurent plus au tableau des concours financiers de l’État, si bien que la rubrique « Transferts financiers divers » est passée de 13, 7 milliards d’euros en 2023 à 10, 4 milliards d’euros en 2024.
Le rapport sur la situation des finances publiques locales n’évoque pas davantage le fonds vert.
La répartition des crédits au sein des différentes sous-actions du fonds vert n’étant pas détaillée dans les documents budgétaires, non plus que dans le projet annuel de performances pour 2024 de la mission « Écologie », le Parlement n’a pas disposé de ces informations essentielles lors de l’examen du projet de loi de finances.
Publierez-vous en toute transparence la répartition prévisionnelle des crédits de paiement et des autorisations d’engagement du fonds vert, qui aurait dû être précisée dans le projet de loi de finances pour 2024, monsieur le ministre ?
Pourriez-vous notamment préciser si, en 2024, les financements de projets alloués dans le cadre du fonds vert pourront de nouveau être versés à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), à la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) ou à la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) ? Pouvez-vous nous communiquer le bilan de ces transferts pour l’année 2023, le montant du verdissement de ces trois dotations étant fixé à 485 millions d’euros pour 2024 ?
De fait, la proximité de ces financements et des crédits alloués dans le cadre du fonds vert est source de confusion pour les parlementaires comme pour les élus locaux.
Est-il prévu que les dotations d’investissement participent en 2024 au financement des politiques du fonds vert ? Si oui, à quelle hauteur ?
Je vous remercie de nous apporter les réponses les plus éclairantes possible, monsieur le ministre. Il importe en effet de fournir aux responsables de nos collectivités et aux membres des commissions d’élus de la DETR une information précise et exhaustive sur les moyens alloués aux dotations d’investissement qui échappent à leurs décisions d’attribution et à tout débat contradictoire.
Monsieur le sénateur Somon, je m'efforcerai d'être clair et précis, car tout cela est effectivement complexe.
Le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires a été doté en 2023 de 2 milliards d'euros en autorisations d'engagement et de 500 millions d'euros en crédits de paiement, soit une hypothèse de décaissement de 25 % la première année. Cette hypothèse, qui est à ce stade conservée pour 2024, pourrait naturellement évoluer en fonction de la mise en œuvre et des décaissements effectifs du fonds.
Les crédits de paiement utilisés pour le fonds vert ne proviennent pas – ce point est important – du verdissement de la DETR, de la DSIL ou de la DSID. Du reste, ces crédits ne relèvent pas du même programme budgétaire que les dotations que je viens de citer.
Les montants des dotations d'investissement inscrites dans le programme 119 « Concours financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements », au sein de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », sont maintenus à hauteur de près de 2 milliards d'euros en autorisations d'engagement dans le projet de loi de finances pour 2024.
Afin de soutenir les collectivités territoriales qui investissent dans la transition écologique, le Gouvernement a fait le choix de renforcer le verdissement de ces dotations sur la base de la cotation du budget vert de l'État.
Les projets d'investissement dits verts devront ainsi représenter 20 % de la DETR, 30 % de la DSIL et 25 % de la DSID. Il s'agit d'un objectif complémentaire à ce que nous faisons avec le fonds vert. Ces crédits ne sont pas fléchés vers le fonds vert et demeurent en intégralité portés par les dotations de soutien à l'investissement local au sein de cette mission.
Monsieur le sénateur Somon, je m’efforcerai d’être clair et précis, car tout cela est effectivement complexe.
Le fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires a été doté en 2023 de 2 milliards d’euros en autorisations d’engagement et de 500 millions d’euros en crédits de paiement, soit une hypothèse de décaissement de 25 % la première année. Cette hypothèse, qui est à ce stade conservée pour 2024, pourrait naturellement évoluer en fonction de la mise en œuvre et des décaissements effectifs du fonds.
Les crédits de paiement utilisés pour le fonds vert ne proviennent pas – ce point est important – du verdissement de la DETR, de la DSIL ou de la DSID. Du reste, ces crédits ne relèvent pas du même programme budgétaire que les dotations que je viens de citer.
Les montants des dotations d’investissement inscrites dans le programme 119 « Concours financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements », au sein de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », sont maintenus à hauteur de près de 2 milliards d’euros en autorisations d’engagement dans le projet de loi de finances pour 2024.
Afin de soutenir les collectivités territoriales qui investissent dans la transition écologique, le Gouvernement a fait le choix de renforcer le verdissement de ces dotations sur la base de la cotation du budget vert de l’État.
Les projets d’investissement dits verts devront ainsi représenter 20 % de la DETR, 30 % de la DSIL et 25 % de la DSID. Il s’agit d’un objectif complémentaire à ce que nous faisons avec le fonds vert. Ces crédits ne sont pas fléchés vers le fonds vert et demeurent en intégralité portés par les dotations de soutien à l’investissement local au sein de cette mission.
guichet unique électronique des formalités d’entreprises (ii)

Le compte à rebours est lancé, monsieur le ministre. Dans douze jours, la possibilité pour les entrepreneurs d'effectuer leurs formalités de modification et de cessation d'activité via le portail Infogreffe, ou sous format papier dans certains cas exceptionnels, prendra fin.
Cette procédure de secours, demandée par la présidente du Conseil national de l'ordre des experts-comptables dès les premiers dysfonctionnements du guichet unique et déjà prolongée par deux fois, ne sera bientôt plus disponible. Présenté comme le fer de lance de la simplification administrative lors de l'examen du projet de loi Pacte, ce guichet a connu des débuts tumultueux depuis son lancement le 1er janvier 2023.
Autrefois vantée, cette interface entre les entrepreneurs et l'administration, confiée à l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi), semble encore en quête de stabilité, alimentant les préoccupations légitimes des entrepreneurs, des experts-comptables et des greffiers quant à sa pérennité et à sa performance en 2024.
À l'aube d'une nouvelle année, je forme le vœu que le guichet unique soit plus résilient et plus performant en 2024, monsieur le ministre. Je souhaite que les erreurs de 2023 deviennent des leçons apprises et que les bugs soient corrigés avec célérité. Puisse l'année 2024 être synonyme de stabilité et d'efficacité.
Puissent tous les entrepreneurs de mon département, le Vaucluse, et de toute la France aborder cette nouvelle étape de la transition numérique avec confiance. Puisse l'année 2024 être placée sous le signe de l'efficacité, de l'ergonomie et de la simplification administrative – la vraie, enfin !
Le glas de cette nouvelle année n'a toutefois pas encore sonné que les entrepreneurs, les experts-comptables et les greffiers sont dans l'attente de la décision du Gouvernement.
Il vous reste donc douze jours pour répondre aux inquiétudes des entrepreneurs, ainsi qu'à celles des greffiers, soucieux de maintenir, jusqu'à l'entière mise en œuvre du guichet unique en 2024, l'assistance qu'ils fournissent afin d'en compenser les failles. Je forme le vœu que vous saisissiez l'occasion qui vous est donnée de répondre à leurs inquiétudes, monsieur le ministre, car je puis vous assurer qu'ils vous écoutent.

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, auteur de la question n° 983, adressée à M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Le compte à rebours est lancé, monsieur le ministre. Dans douze jours, la possibilité pour les entrepreneurs d’effectuer leurs formalités de modification et de cessation d’activité via le portail Infogreffe, ou sous format papier dans certains cas exceptionnels, prendra fin.
Cette procédure de secours, demandée par la présidente du Conseil national de l’ordre des experts-comptables dès les premiers dysfonctionnements du guichet unique et déjà prolongée par deux fois, ne sera bientôt plus disponible. Présenté comme le fer de lance de la simplification administrative lors de l’examen du projet de loi Pacte, ce guichet a connu des débuts tumultueux depuis son lancement le 1er janvier 2023.
Autrefois vantée, cette interface entre les entrepreneurs et l’administration, confiée à l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), semble encore en quête de stabilité, alimentant les préoccupations légitimes des entrepreneurs, des experts-comptables et des greffiers quant à sa pérennité et à sa performance en 2024.
À l’aube d’une nouvelle année, je forme le vœu que le guichet unique soit plus résilient et plus performant en 2024, monsieur le ministre. Je souhaite que les erreurs de 2023 deviennent des leçons apprises et que les bugs soient corrigés avec célérité. Puisse l’année 2024 être synonyme de stabilité et d’efficacité.
Puissent tous les entrepreneurs de mon département, le Vaucluse, et de toute la France aborder cette nouvelle étape de la transition numérique avec confiance. Puisse l’année 2024 être placée sous le signe de l’efficacité, de l’ergonomie et de la simplification administrative – la vraie, enfin !
Le glas de cette nouvelle année n’a toutefois pas encore sonné que les entrepreneurs, les experts-comptables et les greffiers sont dans l’attente de la décision du Gouvernement.
Il vous reste donc douze jours pour répondre aux inquiétudes des entrepreneurs, ainsi qu’à celles des greffiers, soucieux de maintenir, jusqu’à l’entière mise en œuvre du guichet unique en 2024, l’assistance qu’ils fournissent afin d’en compenser les failles. Je forme le vœu que vous saisissiez l’occasion qui vous est donnée de répondre à leurs inquiétudes, monsieur le ministre, car je puis vous assurer qu’ils vous écoutent.
Monsieur le sénateur Jean-Baptiste Blanc, votre question me permet de compléter la réponse que j'ai donnée à la sénatrice Nathalie Delattre tout à l'heure.
Comme je le disais, si tout n'est pas encore parfait, la situation s'améliore. Aujourd'hui, le guichet unique enregistre en moyenne 12 000 formalités par jour. Notre objectif est d'atteindre 20 000 formalités par jour et nous avons déjà fortement accéléré depuis le début de l'année, si bien que toutes les créations d'entreprises sont désormais enregistrées sur le guichet unique. Deux millions de déclarations ont été effectuées sur ce guichet.
Nous avons donc toutes les raisons d'être assez confiants dans le fait que tout se passera bien dès le début de l'année 2024.
Vous avez évoqué le rôle des chambres de commerce et d'industrie, monsieur le sénateur. Depuis la loi Pacte, qui a redéfini les rôles de chaque acteur, les réseaux consulaires ont été déchargés du rôle de collecte des dossiers qu'ils exerçaient en tant que centres de formalité des entreprises – ce rôle est désormais exclusivement dévolu au guichet unique – et sont devenus des acteurs majeurs de l'assistance.
Dans le cadre de cette mission d'assistance, l'accès des chambres de commerce et d'industrie au dossier des déclarants peut parfois se révéler utile pour aider ces derniers dans leurs démarches. Des solutions de partage d'écran sont disponibles et sont déjà utilisées par des acteurs comme les Urssaf. J'engage les chambres de commerce et d'industrie à se saisir de ces outils et à les utiliser dans leurs échanges avec les déclarants.
Monsieur le sénateur Jean-Baptiste Blanc, votre question me permet de compléter la réponse que j’ai donnée à la sénatrice Nathalie Delattre tout à l’heure.
Comme je le disais, si tout n’est pas encore parfait, la situation s’améliore. Aujourd’hui, le guichet unique enregistre en moyenne 12 000 formalités par jour. Notre objectif est d’atteindre 20 000 formalités par jour et nous avons déjà fortement accéléré depuis le début de l’année, si bien que toutes les créations d’entreprises sont désormais enregistrées sur le guichet unique. Deux millions de déclarations ont été effectuées sur ce guichet.
Nous avons donc toutes les raisons d’être assez confiants dans le fait que tout se passera bien dès le début de l’année 2024.
Vous avez évoqué le rôle des chambres de commerce et d’industrie, monsieur le sénateur. Depuis la loi Pacte, qui a redéfini les rôles de chaque acteur, les réseaux consulaires ont été déchargés du rôle de collecte des dossiers qu’ils exerçaient en tant que centres de formalité des entreprises – ce rôle est désormais exclusivement dévolu au guichet unique – et sont devenus des acteurs majeurs de l’assistance.
Dans le cadre de cette mission d’assistance, l’accès des chambres de commerce et d’industrie au dossier des déclarants peut parfois se révéler utile pour aider ces derniers dans leurs démarches. Des solutions de partage d’écran sont disponibles et sont déjà utilisées par des acteurs comme les Urssaf. J’engage les chambres de commerce et d’industrie à se saisir de ces outils et à les utiliser dans leurs échanges avec les déclarants.
Monsieur le sénateur Jean-Baptiste Blanc, votre question me permet de compléter la réponse que j’ai précédemment donnée à la sénatrice Nathalie Delattre.
Comme je le disais, si tout n’est pas encore parfait, la situation s’améliore. Aujourd’hui, le guichet unique enregistre en moyenne 12 000 formalités par jour. Notre objectif est d’atteindre 20 000 formalités par jour et nous avons déjà fortement accéléré depuis le début de l’année, si bien que toutes les créations d’entreprises sont désormais enregistrées sur le guichet unique. Deux millions de déclarations ont été effectuées sur ce guichet.
Nous avons donc toutes les raisons d’être assez confiants dans le fait que tout se passera bien dès le début de l’année 2024.
Vous avez évoqué le rôle des chambres de commerce et d’industrie, monsieur le sénateur. Depuis la loi Pacte, qui a redéfini les rôles de chaque acteur, les réseaux consulaires ont été déchargés du rôle de collecte des dossiers qu’ils exerçaient en tant que centres de formalité des entreprises – ce rôle est désormais exclusivement dévolu au guichet unique – et sont devenus des acteurs majeurs de l’assistance.
Dans le cadre de cette mission d’assistance, l’accès des chambres de commerce et d’industrie au dossier des déclarants peut parfois se révéler utile pour aider ces derniers dans leurs démarches. Des solutions de partage d’écran sont disponibles et sont déjà utilisées par des acteurs comme les Urssaf. J’engage les chambres de commerce et d’industrie à se saisir de ces outils et à les utiliser dans leurs échanges avec les déclarants.

Dont acte, monsieur le ministre. Je vous invite toutefois à prendre au sérieux la détresse des greffiers. Ils nous alertent sur des milliers de cas de burn-out au sein de leurs services, tandis que des milliers d'entreprises échouent à se faire inscrire.
J'espère donc vivement que le dialogue qui est engagé avec votre ministère aboutira.

Dont acte, monsieur le ministre. Je vous invite toutefois à prendre au sérieux la détresse des greffiers. Ils nous alertent sur des milliers de cas de burn-out au sein de leurs services, tandis que des milliers d’entreprises échouent à se faire inscrire.
J’espère donc vivement que le dialogue qui est engagé avec votre ministère aboutira.

Dont acte, monsieur le ministre. Je vous invite toutefois à prendre au sérieux la détresse des greffiers. Ils nous alertent sur des milliers de cas de burn-out au sein de leurs services, tandis que des milliers d’entreprises échouent à se faire inscrire.
J’espère donc vivement que le dialogue qui est engagé avec votre ministère aboutira.
avenir du glacier de la girose dans les alpes

Bien que vous soyez originaire du plat pays, monsieur le ministre, je ne vous apprendrai rien en vous disant que les Alpes se réchauffent deux fois plus vite que le reste de l'hémisphère Nord. Les glaciers, véritables biens communs, subissent de plein fouet ce réchauffement exacerbé, avec de nombreuses conséquences sur le cycle de l'eau, le climat et les populations en aval.
Ce constat sans appel a été rappelé en novembre dernier par de nombreux scientifiques à l'occasion du One Planet – Polar Summit, premier sommet international consacré aux pôles et aux glaciers. En parallèle, un appel lancé par plus de cent scientifiques et personnalités pour préserver les glaciers a été largement soutenu par le grand public via une pétition qui a recueilli 30 000 signatures en quelques jours.
Désormais conscient de l'urgence, le Président de la République s'est exprimé ainsi lors du discours de clôture du sommet : « Je souhaite que nous puissions lancer la concertation qui nous permettra d'avoir la totalité de nos glaciers en protection forte ». Il s'agit d'un acte marquant.
Parmi les cent cinquante glaciers concernés par cette annonce, il en est un, le glacier de la Girose, pour lequel l'urgence de la protection se fait davantage sentir. Situé au pied de la Meije, dans les Hautes-Alpes, au sein d'un écosystème extraordinaire, il s'agit en effet du dernier glacier français accessible à tous.
Ce lieu unique fait pourtant l'objet d'un projet d'aménagement hors du temps visant à prolonger un téléphérique afin de permettre la pratique du ski sur ce glacier dont les jours sont comptés.
Ce projet implique de construire un pylône sur le glacier de la Girose et, partant, de détruire son équilibre fragile. Malgré son statut de site inscrit, sa situation dans l'aire d'adhésion du parc national des Écrins et la présence d'une espèce protégée au niveau national sur l'emprise du projet, cet aménagement en totale contradiction avec la protection du glacier suit son cours, à rebours de l'esprit « montagne » pourtant si cher à La Grave.
Pour toutes ces raisons, ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, que la protection forte du glacier de la Girose pourrait être le premier acte de la mise en œuvre de la volonté présidentielle ?

La parole est à M. Guillaume Gontard, auteur de la question n° 952, adressée à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Bien que vous soyez originaire du plat pays, monsieur le ministre, je ne vous apprendrai rien en vous disant que les Alpes se réchauffent deux fois plus vite que le reste de l’hémisphère Nord. Les glaciers, véritables biens communs, subissent de plein fouet ce réchauffement exacerbé, avec de nombreuses conséquences sur le cycle de l’eau, le climat et les populations en aval.
Ce constat sans appel a été rappelé en novembre dernier par de nombreux scientifiques à l’occasion du One Planet – Polar Summit, premier sommet international consacré aux pôles et aux glaciers. En parallèle, un appel lancé par plus de cent scientifiques et personnalités pour préserver les glaciers a été largement soutenu par le grand public via une pétition qui a recueilli 30 000 signatures en quelques jours.
Désormais conscient de l’urgence, le Président de la République s’est exprimé ainsi lors du discours de clôture du sommet : « Je souhaite que nous puissions lancer la concertation qui nous permettra d’avoir la totalité de nos glaciers en protection forte ». Il s’agit d’un acte marquant.
Parmi les cent cinquante glaciers concernés par cette annonce, il en est un, le glacier de la Girose, pour lequel l’urgence de la protection se fait davantage sentir. Situé au pied de la Meije, dans les Hautes-Alpes, au sein d’un écosystème extraordinaire, il s’agit en effet du dernier glacier français accessible à tous.
Ce lieu unique fait pourtant l’objet d’un projet d’aménagement hors du temps visant à prolonger un téléphérique afin de permettre la pratique du ski sur ce glacier dont les jours sont comptés.
Ce projet implique de construire un pylône sur le glacier de la Girose et, partant, de détruire son équilibre fragile. Malgré son statut de site inscrit, sa situation dans l’aire d’adhésion du parc national des Écrins et la présence d’une espèce protégée au niveau national sur l’emprise du projet, cet aménagement en totale contradiction avec la protection du glacier suit son cours, à rebours de l’esprit « montagne » pourtant si cher à La Grave.
Pour toutes ces raisons, ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, que la protection forte du glacier de la Girose pourrait être le premier acte de la mise en œuvre de la volonté présidentielle ?

Bien que vous soyez originaire du plat pays, monsieur le ministre, je ne vous apprendrai rien en vous disant que les Alpes se réchauffent deux fois plus vite que le reste de l’hémisphère Nord. Les glaciers, véritables biens communs, subissent de plein fouet ce réchauffement exacerbé, avec de nombreuses conséquences sur le cycle de l’eau, le climat et les populations en aval.
Ce constat sans appel a été rappelé en novembre dernier par de nombreux scientifiques à l’occasion du One Planet – Polar Summit, premier sommet international consacré aux pôles et aux glaciers. En parallèle, un appel lancé par plus de cent scientifiques et personnalités pour préserver les glaciers a été largement soutenu par le grand public via une pétition qui a recueilli 30 000 signatures en quelques jours.
Désormais conscient de l’urgence, le Président de la République s’est exprimé ainsi lors du discours de clôture du sommet : « Je souhaite que nous puissions lancer la concertation qui nous permettra d’avoir la totalité de nos glaciers en protection forte. » Il s’agit d’un acte marquant.
Parmi les cent cinquante glaciers concernés par cette annonce, il en est un, le glacier de la Girose, pour lequel l’urgence de la protection se fait davantage sentir. Situé au pied de la Meije, dans les Hautes-Alpes, au sein d’un écosystème extraordinaire, il s’agit en effet du dernier glacier français accessible à tous.
Ce lieu unique fait pourtant l’objet d’un projet d’aménagement hors du temps visant à prolonger un téléphérique afin de permettre la pratique du ski sur ce glacier dont les jours sont comptés.
Ce projet implique de construire un pylône sur le glacier de la Girose et, partant, de détruire son équilibre fragile. Malgré son statut de site inscrit, sa situation dans l’aire d’adhésion du parc national des Écrins et la présence d’une espèce protégée au niveau national sur l’emprise du projet, cet aménagement en totale contradiction avec la protection du glacier suit son cours, à rebours de l’esprit « montagne » pourtant si cher à La Grave.
Pour toutes ces raisons, ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, que la protection forte du glacier de la Girose pourrait être le premier acte de la mise en œuvre de la volonté présidentielle ?
Monsieur le sénateur Guillaume Gontard, pour être certes originaire du plat pays, je n'en suis pas moins en total accord avec votre souci de la préservation des glaciers.
Les enjeux du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité et de la modification du cycle de l'eau sont totalement interconnectés. Les glaciers, qui représentent environ 10 % de la surface des terres émergées, en sont un exemple criant. Ils remplissent en effet un rôle majeur dans le fonctionnement des différents cycles structurants, tels que la séquestration du carbone, le cycle de l'eau ou les habitats du vivant essentiels à la vie sur Terre.
Dans le contexte actuel, les glaciers disparaissent plus rapidement que ce qui était prévu dans nos hypothèses. Cela emporte sur les populations et les écosystèmes des conséquences nombreuses et majeures dont l'ampleur, la fréquence, la magnitude et la saisonnalité sont encore trop peu connues. L'urgence est donc à la mobilisation collective et au développement d'une connaissance systémique des glaciers.
En novembre dernier, à l'occasion du One Planet – Polar Summit que vous avez cité, monsieur le sénateur, le Président de la République a souhaité la mise sous protection forte, d'ici à 2030, de l'ensemble des glaciers et des écosystèmes post-glaciaires français. À ce jour, près de 60 % des glaciers métropolitains et des écosystèmes post-glaciaires sont en protection forte, 100 % outre-mer.
Pour atteindre l'objectif ambitieux fixé par le Président de la République, le Gouvernement lancera prochainement un chantier co-piloté par les préfets de région et les présidents de région concernés dans le but d'accompagner les élus dans la co-construction de la protection des glaciers avec l'ensemble des citoyens et des acteurs des territoires. Nous souhaitons en effet que ce travail soit ancré dans les territoires pour que chacun s'approprie les enjeux de ces nouveaux espaces à haute valeur ajoutée de biodiversité.
Ce travail, qui sera prochainement lancé au niveau local pour le glacier de la Girose, sera l'occasion d'interroger le modèle touristique proposé au regard de la protection forte qu'il convient d'instaurer et, le cas échéant, de faire évoluer le projet afin d'en réduire l'impact, voire de lui substituer un projet alternatif durable.
Monsieur le sénateur Guillaume Gontard, pour être certes originaire du plat pays, je n’en suis pas moins en total accord avec votre souci de la préservation des glaciers.
Les enjeux du changement climatique, de l’érosion de la biodiversité et de la modification du cycle de l’eau sont totalement interconnectés. Les glaciers, qui représentent environ 10 % de la surface des terres émergées, en sont un exemple criant. Ils remplissent en effet un rôle majeur dans le fonctionnement des différents cycles structurants, tels que la séquestration du carbone, le cycle de l’eau ou les habitats du vivant essentiels à la vie sur Terre.
Dans le contexte actuel, les glaciers disparaissent plus rapidement que ce qui était prévu dans nos hypothèses. Cela emporte sur les populations et les écosystèmes des conséquences nombreuses et majeures dont l’ampleur, la fréquence, la magnitude et la saisonnalité sont encore trop peu connues. L’urgence est donc à la mobilisation collective et au développement d’une connaissance systémique des glaciers.
En novembre dernier, à l’occasion du One Planet – Polar Summit que vous avez cité, monsieur le sénateur, le Président de la République a souhaité la mise sous protection forte, d’ici à 2030, de l’ensemble des glaciers et des écosystèmes post-glaciaires français. À ce jour, près de 60 % des glaciers métropolitains et des écosystèmes post-glaciaires sont en protection forte, 100 % outre-mer.
Pour atteindre l’objectif ambitieux fixé par le Président de la République, le Gouvernement lancera prochainement un chantier co-piloté par les préfets de région et les présidents de région concernés dans le but d’accompagner les élus dans la co-construction de la protection des glaciers avec l’ensemble des citoyens et des acteurs des territoires. Nous souhaitons en effet que ce travail soit ancré dans les territoires pour que chacun s’approprie les enjeux de ces nouveaux espaces à haute valeur ajoutée de biodiversité.
Ce travail, qui sera prochainement lancé au niveau local pour le glacier de la Girose, sera l’occasion d’interroger le modèle touristique proposé au regard de la protection forte qu’il convient d’instaurer et, le cas échéant, de faire évoluer le projet afin d’en réduire l’impact, voire de lui substituer un projet alternatif durable.
Monsieur le sénateur Guillaume Gontard, pour être certes originaire du plat pays, je n’en suis pas moins en total accord avec votre souci de la préservation des glaciers.
Les enjeux du changement climatique, de l’érosion de la biodiversité et de la modification du cycle de l’eau sont totalement interconnectés. Les glaciers, qui représentent environ 10 % de la surface des terres émergées, en sont un exemple criant. Ils remplissent en effet un rôle majeur dans le fonctionnement des différents cycles structurants, tels que la séquestration du carbone, le cycle de l’eau ou les habitats du vivant essentiels à la vie sur Terre.
Dans le contexte actuel, les glaciers disparaissent plus rapidement que ce qui était prévu dans nos hypothèses. Cela emporte sur les populations et les écosystèmes des conséquences nombreuses et majeures dont l’ampleur, la fréquence, la magnitude et la saisonnalité sont encore trop peu connues. L’urgence est donc à la mobilisation collective et au développement d’une connaissance systémique des glaciers.
En novembre dernier, à l’occasion du One Planet – Polar Summit que vous avez cité, monsieur le sénateur, le Président de la République a souhaité la mise sous protection forte, d’ici à 2030, de l’ensemble des glaciers et des écosystèmes postglaciaires français. À ce jour, près de 60 % des glaciers métropolitains et des écosystèmes postglaciaires sont en protection forte, 100 % outre-mer.
Pour atteindre l’objectif ambitieux fixé par le Président de la République, le Gouvernement lancera prochainement un chantier copiloté par les préfets de région et les présidents de région concernés dans le but d’accompagner les élus dans la coconstruction de la protection des glaciers avec l’ensemble des citoyens et des acteurs des territoires. Nous souhaitons en effet que ce travail soit ancré dans les territoires pour que chacun s’approprie les enjeux de ces nouveaux espaces à haute valeur ajoutée de biodiversité.
Ce travail, qui sera prochainement lancé au niveau local pour le glacier de la Girose, sera l’occasion d’interroger le modèle touristique proposé au regard de la protection forte qu’il convient d’instaurer et, le cas échéant, de faire évoluer le projet afin d’en réduire l’impact, voire de lui substituer un projet alternatif durable.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Si celle-ci va dans le bon sens, je souhaite insister sur le fait qu'il y a urgence, car le projet est prêt. De fait, des pelles mécaniques étaient déjà présentes sur le site cet été.
D'autres solutions existent pourtant et permettraient de favoriser le développement touristique de cette région. Il suffit d'y travailler en lien avec les élus locaux. En tout état de cause, il faut d'abord stopper ce projet dangereux.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Si celle-ci va dans le bon sens, je souhaite insister sur le fait qu’il y a urgence, car le projet est prêt. De fait, des pelles mécaniques étaient déjà présentes sur le site cet été.
D’autres solutions existent pourtant et permettraient de favoriser le développement touristique de cette région. Il suffit d’y travailler en lien avec les élus locaux. En tout état de cause, il faut d’abord stopper ce projet dangereux.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Si celle-ci va dans le bon sens, je souhaite insister sur le fait qu’il y a urgence, car le projet est prêt. De fait, des pelles mécaniques étaient déjà présentes sur le site cet été.
D’autres solutions existent pourtant et permettraient de favoriser le développement touristique de cette région. Il suffit d’y travailler en liaison avec les élus locaux. En tout état de cause, il faut d’abord stopper ce projet dangereux.
procédures concernant les installations classées protection de l’environnement et insécurité juridique

La France est un grand pays agricole. Nous ne pouvons que nous en réjouir, de même que nous nous réjouissons que le ministère de l'agriculture soit désormais aussi celui de la souveraineté alimentaire.
Il faut toutefois vous rendre compte, monsieur le ministre, des difficultés qu'entraînent, pour beaucoup d'éleveurs de notre pays, les procédures administratives particulièrement lourdes et contraignantes qu'emporte le régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Les dossiers sont si complexes que l'on a parfois l'impression qu'il s'agit, non pas d'exploitations agricoles, mais d'installations classées Seveso ! Il en résulte des coûts importants pour les agriculteurs, puisqu'une déclaration d'ICPE coûte entre 3 000 et 8 000 euros et qu'un dossier d'autorisation d'ICPE coûte entre 15 000 et 30 000 euros. De plus, les recours et contentieux sont si nombreux que l'on n'est jamais assuré de l'issue de ces démarches.
Pour assurer notre souveraineté alimentaire, ce que nous souhaitons, il est nécessaire d'accompagner les professionnels dans leurs projets. Quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il de prendre, monsieur le ministre, afin de simplifier la création de nouveaux outils de production, notamment de nouvelles installations classées ?

La parole est à M. Michel Canévet, auteur de la question n° 569, transmise à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

La France est un grand pays agricole. Nous ne pouvons que nous en réjouir, de même que nous nous réjouissons que le ministère de l’agriculture soit désormais aussi celui de la souveraineté alimentaire.
Il faut toutefois vous rendre compte, monsieur le ministre, des difficultés qu’entraînent, pour beaucoup d’éleveurs de notre pays, les procédures administratives particulièrement lourdes et contraignantes qu’emporte le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Les dossiers sont si complexes que l’on a parfois l’impression qu’il s’agit, non pas d’exploitations agricoles, mais d’installations classées Seveso ! Il en résulte des coûts importants pour les agriculteurs, puisqu’une déclaration d’ICPE coûte entre 3 000 et 8 000 euros et qu’un dossier d’autorisation d’ICPE coûte entre 15 000 et 30 000 euros. De plus, les recours et contentieux sont si nombreux que l’on n’est jamais assuré de l’issue de ces démarches.
Pour assurer notre souveraineté alimentaire, ce que nous souhaitons, il est nécessaire d’accompagner les professionnels dans leurs projets. Quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il de prendre, monsieur le ministre, afin de simplifier la création de nouveaux outils de production, notamment de nouvelles installations classées ?
Monsieur le sénateur Michel Canévet, la réglementation des installations classées agricoles, constante depuis dix ans, transpose strictement le droit de l'Union européenne, notamment les directives relatives à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
Cette réglementation permet de distinguer les installations classées pour la protection de l'environnement devant faire l'objet d'une évaluation environnementale des autres installations. Elle prévoit ainsi que le préfet décide, au cas par cas, si la demande d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement, qu'il s'agisse d'une création ou d'une extension, doit ou non faire l'objet d'une évaluation environnementale.
Cet examen au cas par cas se fonde notamment sur la sensibilité environnementale du milieu et sur le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installation, ouvrages et travaux.
Des jugements récents annulant des arrêtés préfectoraux d'autorisation d'extension d'élevage ont éclairé la lecture de cette réglementation et interrogé les pratiques mises en œuvre jusqu'alors pour les installations relevant du régime de l'enregistrement. Ces jugements concernent la zone bretonne, marquée par des enjeux liés aux pollutions par les nitrates et par une concentration importante d'élevages.
Conscients de l'enjeu que représente la sécurisation des procédures et des projets, les services de l'État compétents pour ce qui relève des installations classées pour la protection de l'environnement ont donc engagé des travaux avec le corps préfectoral et la profession agricole afin d'identifier les mises à jour pertinentes à apporter aux pratiques existantes.
Ces travaux visent notamment à renforcer les capacités à justifier les choix effectués lors de l'examen au cas par cas par l'ajustement, sur certains aspects, du contenu des dossiers de demande d'enregistrement transmis par les exploitants à l'appui de leurs demandes.
Monsieur le sénateur Michel Canévet, la réglementation des installations classées agricoles, constante depuis dix ans, transpose strictement le droit de l’Union européenne, notamment les directives relatives à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
Cette réglementation permet de distinguer les installations classées pour la protection de l’environnement devant faire l’objet d’une évaluation environnementale des autres installations. Elle prévoit ainsi que le préfet décide, au cas par cas, si la demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement, qu’il s’agisse d’une création ou d’une extension, doit ou non faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Cet examen au cas par cas se fonde notamment sur la sensibilité environnementale du milieu et sur le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installation, ouvrages et travaux.
Des jugements récents annulant des arrêtés préfectoraux d’autorisation d’extension d’élevage ont éclairé la lecture de cette réglementation et interrogé les pratiques mises en œuvre jusqu’alors pour les installations relevant du régime de l’enregistrement. Ces jugements concernent la zone bretonne, marquée par des enjeux liés aux pollutions par les nitrates et par une concentration importante d’élevages.
Conscients de l’enjeu que représente la sécurisation des procédures et des projets, les services de l’État compétents pour ce qui relève des installations classées pour la protection de l’environnement ont donc engagé des travaux avec le corps préfectoral et la profession agricole afin d’identifier les mises à jour pertinentes à apporter aux pratiques existantes.
Ces travaux visent notamment à renforcer les capacités à justifier les choix effectués lors de l’examen au cas par cas par l’ajustement, sur certains aspects, du contenu des dossiers de demande d’enregistrement transmis par les exploitants à l’appui de leurs demandes.

Monsieur le ministre, je vous remercie de ces éclaircissements. Néanmoins, nous devons veiller à ce que la législation européenne ne durcisse pas encore davantage les règles en vigueur, par exemple en abaissant les seuils au-delà desquels le régime d'autorisation est imposé. Ce serait particulièrement préjudiciable pour les éleveurs.
J'en veux pour preuve l'exemple de la volaille, qui est l'une des viandes les plus répandues dans le monde. Ayons à l'esprit que 50 % de la volaille consommée en France est importé, tout simplement parce que nous n'avons pas le droit de produire plus : ce n'est pas acceptable.
Il est temps d'autoriser de nouvelles installations, suivant le vœu de bien des producteurs de notre pays. Voilà pourquoi il faut assurer l'assouplissement que j'évoquais ; on limitera ainsi les contentieux.

Monsieur le ministre, je vous remercie de ces éclaircissements. Néanmoins, nous devons veiller à ce que la législation européenne ne durcisse pas encore davantage les règles en vigueur, par exemple en abaissant les seuils au-delà desquels le régime d’autorisation est imposé. Ce serait particulièrement préjudiciable pour les éleveurs.
J’en veux pour preuve l’exemple de la volaille, qui est l’une des viandes les plus répandues dans le monde. Ayons à l’esprit que 50 % de la volaille consommée en France est importé, tout simplement parce que nous n’avons pas le droit de produire plus : ce n’est pas acceptable.
Il est temps d’autoriser de nouvelles installations, suivant le vœu de bien des producteurs de notre pays. Voilà pourquoi il faut assurer l’assouplissement que j’évoquais ; on limitera ainsi les contentieux.

Monsieur le ministre, je vous remercie de ces éclaircissements. Néanmoins, nous devons veiller à ce que la législation européenne ne durcisse pas encore davantage les règles en vigueur, par exemple en abaissant les seuils au-delà desquels le régime d’autorisation est imposé. Ce serait particulièrement préjudiciable pour les éleveurs.
J’en veux pour preuve l’exemple de la volaille, qui est l’une des viandes les plus répandues dans le monde. Ayons à l’esprit que 50 % de la volaille consommée en France est importée, tout simplement parce que nous n’avons pas le droit de produire plus : ce n’est pas acceptable.
Il est temps d’autoriser de nouvelles installations, suivant le vœu de bien des producteurs de notre pays. Voilà pourquoi il faut assurer l’assouplissement que j’évoquais ; on limitera ainsi les contentieux.
transfert financier et d’ingénierie aux epci de l’aide à la pierre

La crise du logement que nous traversons touche tous les secteurs sans qu'un acteur compense les difficultés d'un autre.
Alors que le nombre de constructions de logements neufs n'est pas à la hauteur des besoins, l'aide à la pierre est une solution pour soutenir les programmes immobiliers des bailleurs sociaux. Or, dans le souci louable d'assurer une plus grande proximité, l'État a délégué la gestion des dossiers de demande aux acteurs territoriaux.
Les intercommunalités dotées d'un programme local de l'habitat (PLH) peuvent ainsi demander une délégation de compétence. C'est ce qu'ont fait, dans le département de la Seine-Maritime, la communauté urbaine du Havre, la métropole rouennaise, ainsi que les communautés d'agglomération de Dieppe et de Caux-Seine.
Néanmoins, ces délégations ne sont assorties d'aucun transfert de moyens. Le recrutement, l'instruction des dossiers, le coût du suivi et des assurances ne sont pas compensés en conséquence. Pour assumer ces tâches, de véritables moyens humains sont nécessaires, d'autant que les demandes vont croissant.
Monsieur le ministre, face à la crise du logement, le Gouvernement compte-t-il aider les collectivités territoriales dans la gestion des dossiers d'aide à la pierre ?

La parole est à Mme Agnès Canayer, auteur de la question n° 812, adressée à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

La crise du logement que nous traversons touche tous les secteurs sans qu’un acteur compense les difficultés d’un autre.
Alors que le nombre de constructions de logements neufs n’est pas à la hauteur des besoins, l’aide à la pierre est une solution pour soutenir les programmes immobiliers des bailleurs sociaux. Or, dans le souci louable d’assurer une plus grande proximité, l’État a délégué la gestion des dossiers de demande aux acteurs territoriaux.
Les intercommunalités dotées d’un programme local de l’habitat (PLH) peuvent ainsi demander une délégation de compétence. C’est ce qu’ont fait, dans le département de la Seine-Maritime, la communauté urbaine du Havre, la métropole rouennaise, ainsi que les communautés d’agglomération de Dieppe et de Caux-Seine.
Néanmoins, ces délégations ne sont assorties d’aucun transfert de moyens. Le recrutement, l’instruction des dossiers, le coût du suivi et des assurances ne sont pas compensés en conséquence. Pour assumer ces tâches, de véritables moyens humains sont nécessaires, d’autant que les demandes vont croissant.
Monsieur le ministre, face à la crise du logement, le Gouvernement compte-t-il aider les collectivités territoriales dans la gestion des dossiers d’aide à la pierre ?
Madame la sénatrice Agnès Canayer, vous interrogez le Gouvernement sur les délégations des aides à la pierre mises en œuvre dans le département de la Seine-Maritime, notamment dans ses principales intercommunalités, dont la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
Dans le cadre des telles délégations, les acteurs locaux se voient attribuer une dotation destinée au financement du parc locatif social ainsi qu'une dotation de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) pour octroyer les aides nécessaires à la rénovation énergétique et à l'amélioration du parc privé.
Au-delà des dotations du Fonds national des aides à la pierre (Fnap), diverses aides sont associées à l'agrément des opérations de logement social, notamment le taux réduit de TVA et les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties. Dorénavant, pour ce qui concerne les opérations agréées, ces exonérations sont intégralement compensées jusqu'en 2026.
D'autres mesures de soutien au développement du logement social ont été prises par le Gouvernement.
Le taux du livret A a été maintenu à 3 % : cette mesure représente environ 1, 4 milliard d'euros d'économies pour les bailleurs sociaux.
Des enveloppes de prêts à taux bonifiés ont été créées pour les logements sociaux financés via les prêts locatifs aidés d'intégration (PLAI) et les prêts locatifs à usage social (Plus), à hauteur de 8 milliards d'euros.
Nous augmentons de 250 à 400 millions d'euros l'enveloppe des prêts participatifs proposés par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), comme je l'ai annoncé lors du congrès de l'Union sociale pour l'habitat qui s'est tenu à Nantes.
En outre, la réhabilitation énergétique du parc locatif social bénéficiera de 1, 2 milliard d'euros de subventions de l'État sur trois ans, en sus des écoprêts de la CDC.
Les délégataires seront pleinement associés pour mobiliser et engager ces nouveaux moyens financiers au service de la rénovation énergétique du parc social.
Je relève que la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a atteint ses objectifs au cours des trois dernières années, ce qui témoigne d'une bonne dynamique de développement du logement dans ce territoire. Le mouvement a toutefois été porté par un nombre élevé de prêts locatifs sociaux (PLS), l'objectif au titre des Plus et des PLAI n'ayant été atteint qu'à 92 %.
Enfin, le projet de loi relatif au logement, qui est en préparation et devrait être présenté en conseil des ministres au printemps prochain, a vocation à poser la question de la décentralisation de la politique du logement, pour aller au-delà de la délégation.
Madame la sénatrice Agnès Canayer, vous interrogez le Gouvernement sur les délégations des aides à la pierre mises en œuvre dans le département de la Seine-Maritime, notamment dans ses principales intercommunalités, dont la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
Dans le cadre des telles délégations, les acteurs locaux se voient attribuer une dotation destinée au financement du parc locatif social ainsi qu’une dotation de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour octroyer les aides nécessaires à la rénovation énergétique et à l’amélioration du parc privé.
Au-delà des dotations du Fonds national des aides à la pierre (Fnap), diverses aides sont associées à l’agrément des opérations de logement social, notamment le taux réduit de TVA et les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties. Dorénavant, pour ce qui concerne les opérations agréées, ces exonérations sont intégralement compensées jusqu’en 2026.
D’autres mesures de soutien au développement du logement social ont été prises par le Gouvernement.
Le taux du livret A a été maintenu à 3 % : cette mesure représente environ 1, 4 milliard d’euros d’économies pour les bailleurs sociaux.
Des enveloppes de prêts à taux bonifiés ont été créées pour les logements sociaux financés via les prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI) et les prêts locatifs à usage social (Plus), à hauteur de 8 milliards d’euros.
Nous augmentons de 250 à 400 millions d’euros l’enveloppe des prêts participatifs proposés par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), comme je l’ai annoncé lors du congrès de l’Union sociale pour l’habitat qui s’est tenu à Nantes.
En outre, la réhabilitation énergétique du parc locatif social bénéficiera de 1, 2 milliard d’euros de subventions de l’État sur trois ans, en sus des écoprêts de la CDC.
Les délégataires seront pleinement associés pour mobiliser et engager ces nouveaux moyens financiers au service de la rénovation énergétique du parc social.
Je relève que la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a atteint ses objectifs au cours des trois dernières années, ce qui témoigne d’une bonne dynamique de développement du logement dans ce territoire. Le mouvement a toutefois été porté par un nombre élevé de prêts locatifs sociaux (PLS), l’objectif au titre des Plus et des PLAI n’ayant été atteint qu’à 92 %.
Enfin, le projet de loi relatif au logement, qui est en préparation et devrait être présenté en conseil des ministres au printemps prochain, a vocation à poser la question de la décentralisation de la politique du logement, pour aller au-delà de la délégation.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse et de vos propos positifs au sujet de la politique du logement au Havre : c'est le fruit d'un important travail de l'intercommunalité, qui s'efforce de répondre aux besoins des habitants en matière de logement social.
Cela étant, la gestion des dossiers continue de reposer sur les acteurs territoriaux. §Or, vous le savez, les budgets locaux sont contraints, si bien que l'on doit faire face à un effet de ciseaux.
Aujourd'hui, pour la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, la seule gestion des aides à la pierre mobilise six équivalents temps plein (ETP), soit environ 200 000 euros par an. C'est un effort significatif et, sur ce sujet, une réflexion globale sera la bienvenue.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse et de vos propos positifs au sujet de la politique du logement au Havre : c’est le fruit d’un important travail de l’intercommunalité, qui s’efforce de répondre aux besoins des habitants en matière de logement social.
Cela étant, la gestion des dossiers continue de reposer sur les acteurs territoriaux. §Or, vous le savez, les budgets locaux sont contraints, si bien que l’on doit faire face à un effet de ciseaux.
Aujourd’hui, pour la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, la seule gestion des aides à la pierre mobilise six équivalents temps plein (ETP), soit environ 200 000 euros par an. C’est un effort significatif et, sur ce sujet, une réflexion globale sera la bienvenue.
financement des logements sociaux

Monsieur le ministre, j'attire votre attention sur la situation de communes du Gard ayant délivré à des promoteurs des permis de construire pour des programmes comportant un quota de logements sociaux.
Du fait de la conjoncture économique, un certain nombre d'organismes finançant les logements sociaux se sont désengagés, de sorte que des promoteurs ont dû se tourner vers des financements classiques pour réaliser ou terminer leurs programmes.
Ainsi, ces logements ont été acquis principalement par des primo-accédants sous le régime des prêts immobiliers classiques. De ce fait, les candidats aux logements sociaux ont été évincés.
Certains des promoteurs concernés se tournent aujourd'hui vers les communes pour qu'elles leur délivrent des permis de construire modificatifs portant suppression des programmes de logements sociaux imposés initialement par les règles d'urbanisme.
Lesdites communes refusent de délivrer de tels permis de construire modificatifs, qui seraient nécessairement illégaux, mais elles sont parfois menacées de procès par ces promoteurs. Surtout, elles se trouvent en difficulté, car elles subissent un déficit de logements sociaux.
Quelles solutions le Gouvernement entend-il mettre en œuvre pour régler cette situation, qui pénalise au premier chef les communes concernées – ces dernières s'exposent en effet à des pénalités pour non-réalisation du quota de logements sociaux –, ainsi que les promoteurs engagés dans ces opérations, dont l'achèvement ou la vente sont compromis, et enfin les populations, qui attendent ces logements sociaux ?

La parole est à M. Laurent Burgoa, auteur de la question n° 912, adressée à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Monsieur le ministre, j’attire votre attention sur la situation de communes du Gard ayant délivré à des promoteurs des permis de construire pour des programmes comportant un quota de logements sociaux.
Du fait de la conjoncture économique, un certain nombre d’organismes finançant les logements sociaux se sont désengagés, de sorte que des promoteurs ont dû se tourner vers des financements classiques pour réaliser ou terminer leurs programmes.
Ainsi, ces logements ont été acquis principalement par des primo-accédants sous le régime des prêts immobiliers classiques. De ce fait, les candidats aux logements sociaux ont été évincés.
Certains des promoteurs concernés se tournent aujourd’hui vers les communes pour qu’elles leur délivrent des permis de construire modificatifs portant suppression des programmes de logements sociaux imposés initialement par les règles d’urbanisme.
Lesdites communes refusent de délivrer de tels permis de construire modificatifs, qui seraient nécessairement illégaux, mais elles sont parfois menacées de procès par ces promoteurs. Surtout, elles se trouvent en difficulté, car elles subissent un déficit de logements sociaux.
Quelles solutions le Gouvernement entend-il mettre en œuvre pour régler cette situation, qui pénalise au premier chef les communes concernées – ces dernières s’exposent en effet à des pénalités pour non-réalisation du quota de logements sociaux –, ainsi que les promoteurs engagés dans ces opérations, dont l’achèvement ou la vente sont compromis, et enfin les populations, qui attendent ces logements sociaux ?
Monsieur le sénateur Laurent Burgoa, le Gouvernement a pris des mesures fortes pour limiter les situations de désengagement. Il a notamment augmenté la capacité d'investissement des bailleurs sociaux dans le cadre d'un document d'engagement signé en septembre dernier avec l'ensemble du mouvement HLM. Je suis donc un peu surpris d'entendre que des bailleurs se désengagent quand même…
Cet accord prévoit 650 millions d'euros de bonifications d'intérêts pour 8 milliards d'euros de prêts – je l'évoquais précédemment – afin de financer des logements sociaux PLAI et Plus. S'y ajoute la limitation du taux du livret A.
Par ailleurs, nous avons veillé à préserver la capacité des bailleurs sociaux à orienter leurs investissements sur l'offre nouvelle, en accordant 1, 2 milliard d'euros de subventions sur trois ans pour rénover près de 400 000 logements sociaux.
Pour ce qui concerne les opérations confrontées aux désengagements que vous évoquez, le Gouvernement rappelle aux promoteurs la nécessité de respecter les servitudes de mixité sociale inscrites dans la loi et dans les documents d'urbanisme.
De ce point de vue, les communes sont tenues de refuser les permis modificatifs qui emporteraient une atteinte à ces exigences.
Afin de parvenir à une commercialisation compatible avec ces servitudes, en cas de difficulté pour les bailleurs sociaux, les promoteurs sont invités à se tourner vers d'autres opérateurs, notamment ceux engagés dans des plans d'investissement en logements sociaux par achat de programmes en vente en l'état futur d'achèvement (Vefa).
Le Gouvernement tient aussi à le rappeler : les communes déficitaires en logements sociaux au regard de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) voient les pénalités financières associées à leur situation minorées à hauteur des dépenses qu'elles ont engagées en faveur du développement d'un parc social sur leur territoire. Je relève, au passage, que ces pénalités ne sont pas une amende, mais plutôt une contribution.
Il en va ainsi de toutes les subventions et moins-values permettant aux maîtres d'ouvrage d'équilibrer leurs opérations de logements sociaux.
Non seulement ces initiatives allègent la charge financière, mais elles constituent des leviers particulièrement efficaces à la main des communes pour garantir la réalisation effective des opérations en facilitant l'atteinte d'un équilibre économique.
Enfin, grâce au reliquat du Fnap pour 2023, nous finançons des actions supplémentaires pour assurer l'équilibre de certaines opérations de promotion. Il existe encore des moyens au titre de cette année.
Monsieur le sénateur Laurent Burgoa, le Gouvernement a pris des mesures fortes pour limiter les situations de désengagement. Il a notamment augmenté la capacité d’investissement des bailleurs sociaux dans le cadre d’un document d’engagement signé en septembre dernier avec l’ensemble du mouvement HLM. Je suis donc un peu surpris d’entendre que des bailleurs se désengagent quand même…
Cet accord prévoit 650 millions d’euros de bonifications d’intérêts pour 8 milliards d’euros de prêts – je l’évoquais précédemment – afin de financer des logements sociaux PLAI et Plus. S’y ajoute la limitation du taux du livret A.
Par ailleurs, nous avons veillé à préserver la capacité des bailleurs sociaux à orienter leurs investissements sur l’offre nouvelle, en accordant 1, 2 milliard d’euros de subventions sur trois ans pour rénover près de 400 000 logements sociaux.
Pour ce qui concerne les opérations confrontées aux désengagements que vous évoquez, le Gouvernement rappelle aux promoteurs la nécessité de respecter les servitudes de mixité sociale inscrites dans la loi et dans les documents d’urbanisme.
De ce point de vue, les communes sont tenues de refuser les permis modificatifs qui emporteraient une atteinte à ces exigences.
Afin de parvenir à une commercialisation compatible avec ces servitudes, en cas de difficulté pour les bailleurs sociaux, les promoteurs sont invités à se tourner vers d’autres opérateurs, notamment ceux engagés dans des plans d’investissement en logements sociaux par achat de programmes en vente en l’état futur d’achèvement (Vefa).
Le Gouvernement tient aussi à le rappeler : les communes déficitaires en logements sociaux au regard de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) voient les pénalités financières associées à leur situation minorées à hauteur des dépenses qu’elles ont engagées en faveur du développement d’un parc social sur leur territoire. Je relève, au passage, que ces pénalités ne sont pas une amende, mais plutôt une contribution.
Il en va ainsi de toutes les subventions et moins-values permettant aux maîtres d’ouvrage d’équilibrer leurs opérations de logements sociaux.
Non seulement ces initiatives allègent la charge financière, mais elles constituent des leviers particulièrement efficaces à la main des communes pour garantir la réalisation effective des opérations en facilitant l’atteinte d’un équilibre économique.
Enfin, grâce au reliquat du Fnap pour 2023, nous finançons des actions supplémentaires pour assurer l’équilibre de certaines opérations de promotion. Il existe encore des moyens au titre de cette année.

Monsieur le ministre, je prends acte de votre réponse ; mais, à l'instar des élus, le monde du logement attend de votre part une vraie politique en la matière.
Nous attendons tous une loi de programmation dans le domaine du logement. Vous, l'ancien maire de Dunkerque, maîtrisez parfaitement ces problématiques ; mais malheureusement vous n'avez pas la vision que nous attendions de vous.
Vous nous dites ainsi que ces pénalités ne sont pas une amende, mais une contribution. Je pense que vous allez décevoir beaucoup de maires…

Monsieur le ministre, je prends acte de votre réponse ; mais, à l’instar des élus, le monde du logement attend de votre part une vraie politique en la matière.
Nous attendons tous une loi de programmation dans le domaine du logement. Vous, l’ancien maire de Dunkerque, maîtrisez parfaitement ces problématiques ; mais malheureusement vous n’avez pas la vision que nous attendions de vous.
Vous nous dites ainsi que ces pénalités ne sont pas une amende, mais une contribution. Je pense que vous allez décevoir beaucoup de maires…
dangers des munitions immergées

Monsieur le ministre, selon une étude indépendante à paraître, menée en lien avec un laboratoire de recherche océanique, plus de cent zones de munitions conventionnelles et chimiques immergées ont été recensées sur l'ensemble du littoral français : 18 décharges d'explosifs immergées, 59 zones de dépôt et 29 épaves contenant des munitions.
Ces dernières sont issues, pour la plupart, de largages opérés au lendemain des deux conflits mondiaux dans l'océan et dans des lacs. S'y ajoutent des stockages opérés jusqu'au début des années 2000.
L'ensemble des échantillons d'eau et de sédiments prélevés sur sites ont été testés positifs aux explosifs, révélant des taux inédits de TNT et de ses dérivés, de tétryl, de RDX et d'autres substances nocives.
Le 22 octobre 2020, en réponse à une question que je lui avais adressée, le ministère de la transition écologique avait avancé que, faute d'étude scientifique précise, les risques étaient difficiles à évaluer, que les stocks étaient globalement moins dégradés qu'on ne pouvait le craindre et qu'aucune recommandation concrète ou engageante n'avait été prise. En d'autres termes, votre ministère estimait que la prise en charge de cette pollution potentielle n'était pas une priorité.
Preuve est faite aujourd'hui que les munitions immergées représentent une réelle menace écologique, lourde de conséquences humaines, environnementales, économiques et sanitaires. Quelles actions le Gouvernement va-t-il mettre en œuvre, rapidement, pour débarrasser les fonds marins de ces bombes environnementales à retardement ?

La parole est à Mme Annick Billon, auteure de la question n° 982, adressée à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Monsieur le ministre, selon une étude indépendante à paraître, menée en lien avec un laboratoire de recherche océanique, plus de cent zones de munitions conventionnelles et chimiques immergées ont été recensées sur l’ensemble du littoral français : 18 décharges d’explosifs immergées, 59 zones de dépôt et 29 épaves contenant des munitions.
Ces dernières sont issues, pour la plupart, de largages opérés au lendemain des deux conflits mondiaux dans l’océan et dans des lacs. S’y ajoutent des stockages opérés jusqu’au début des années 2000.
L’ensemble des échantillons d’eau et de sédiments prélevés sur sites ont été testés positifs aux explosifs, révélant des taux inédits de TNT et de ses dérivés, de tétryl, de RDX et d’autres substances nocives.
Le 22 octobre 2020, en réponse à une question que je lui avais adressée, le ministère de la transition écologique avait avancé que, faute d’étude scientifique précise, les risques étaient difficiles à évaluer, que les stocks étaient globalement moins dégradés qu’on ne pouvait le craindre et qu’aucune recommandation concrète ou engageante n’avait été prise. En d’autres termes, votre ministère estimait que la prise en charge de cette pollution potentielle n’était pas une priorité.
Preuve est faite aujourd’hui que les munitions immergées représentent une réelle menace écologique, lourde de conséquences humaines, environnementales, économiques et sanitaires. Quelles actions le Gouvernement va-t-il mettre en œuvre, rapidement, pour débarrasser les fonds marins de ces bombes environnementales à retardement ?
Madame la sénatrice Annick Billon, je suis particulièrement sensible à votre question, car le littoral dunkerquois est concerné au premier chef par ces problématiques. On y trouve notamment des munitions de la Première Guerre mondiale.
L'État est parfaitement conscient de l'enjeu lié aux munitions immergées. C'est précisément pourquoi il y consacre des travaux interministériels, échelonnés sur plusieurs années.
Ces travaux visent, d'une part, à nous doter d'une cartographie précise des zones concernées et de la nature des munitions immergées et, d'autre part, à recueillir des informations scientifiques fiables, y compris auprès des autres pays qui sont confrontés aux mêmes problématiques, qu'il s'agisse de l'évolution des munitions dans l'eau de mer ou du comportement de leur contenu en cas de fuite. Je le répète, la France n'est pas le seul État concerné par ce problème.
Parallèlement, une réflexion sur la modélisation du vieillissement de ces objets a été engagée. Le cas échéant, elle sera corrélée aux observations qui pourront être pratiquées in situ. Puis, une fois les potentielles zones à risques identifiées, l'opportunité de mettre en place une surveillance environnementale ponctuelle sera étudiée afin de détecter d'éventuels indices de pollution.
En conséquence, l'État est intéressé par toute étude visant à améliorer la connaissance du comportement des munitions immergées dans le temps. Il pourra ainsi alimenter les travaux interministériels et, in fine, adapter les dispositifs de protection civile et environnementale existants.
Madame la sénatrice Annick Billon, je suis particulièrement sensible à votre question, car le littoral dunkerquois est concerné au premier chef par ces problématiques. On y trouve notamment des munitions de la Première Guerre mondiale.
L’État est parfaitement conscient de l’enjeu lié aux munitions immergées. C’est précisément pourquoi il y consacre des travaux interministériels, échelonnés sur plusieurs années.
Ces travaux visent, d’une part, à nous doter d’une cartographie précise des zones concernées et de la nature des munitions immergées et, d’autre part, à recueillir des informations scientifiques fiables, y compris auprès des autres pays qui sont confrontés aux mêmes problématiques, qu’il s’agisse de l’évolution des munitions dans l’eau de mer ou du comportement de leur contenu en cas de fuite. Je le répète, la France n’est pas le seul État concerné par ce problème.
Parallèlement, une réflexion sur la modélisation du vieillissement de ces objets a été engagée. Le cas échéant, elle sera corrélée aux observations qui pourront être pratiquées in situ. Puis, une fois les potentielles zones à risques identifiées, l’opportunité de mettre en place une surveillance environnementale ponctuelle sera étudiée afin de détecter d’éventuels indices de pollution.
En conséquence, l’État est intéressé par toute étude visant à améliorer la connaissance du comportement des munitions immergées dans le temps. Il pourra ainsi alimenter les travaux interministériels et, in fine, adapter les dispositifs de protection civile et environnementale existants.
Madame la sénatrice Annick Billon, je suis particulièrement sensible à votre question, car le littoral dunkerquois est concerné au premier chef par ces problématiques. On y trouve notamment des munitions de la Première Guerre mondiale.
L’État est parfaitement conscient de l’enjeu lié aux munitions immergées. C’est précisément pourquoi il y consacre des travaux interministériels, échelonnés sur plusieurs années.
Ces travaux visent, d’une part, à nous doter d’une cartographie précise des zones concernées et de la nature des munitions immergées, d’autre part, à recueillir des informations scientifiques fiables, y compris auprès des autres pays qui sont confrontés aux mêmes problématiques, qu’il s’agisse de l’évolution des munitions dans l’eau de mer ou du comportement de leur contenu en cas de fuite. Je le répète, la France n’est pas le seul État concerné par ce problème.
Parallèlement, une réflexion sur la modélisation du vieillissement de ces objets a été engagée. Le cas échéant, elle sera corrélée aux observations qui pourront être pratiquées in situ. Puis, une fois les potentielles zones à risques identifiées, l’opportunité de mettre en place une surveillance environnementale ponctuelle sera étudiée afin de détecter d’éventuels indices de pollution.
En conséquence, l’État est intéressé par toute étude visant à améliorer la connaissance du comportement des munitions immergées dans le temps. Il pourra ainsi alimenter les travaux interministériels et, in fine, adapter les dispositifs de protection civile et environnementale existants.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse.
En tant que sénatrice de la Vendée et à titre personnel, je suis particulièrement engagée sur ces sujets – la question que je mentionnais date de 2020. Je serai donc très attentive aux travaux gouvernementaux que vous annoncez.
Au total, quatre sites ont été identifiés dans le département dont je suis l'élue. Vous envisagez d'établir une cartographie, mais un cabinet indépendant l'a déjà dressée. §Je vous conseille de vous inspirer de ces travaux : vous gagnerez ainsi du temps.
J'y insiste, nous sommes face à une urgence à la fois environnementale et sanitaire. §Ces épaves et ces munitions sont là depuis des années, voire des décennies. Les mesures effectuées par le cabinet indépendant que j'évoquais démontrent leur dangerosité.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse.
En tant que sénatrice de la Vendée et à titre personnel, je suis particulièrement engagée sur ces sujets – la question que je mentionnais date de 2020. Je serai donc très attentive aux travaux gouvernementaux que vous annoncez.
Au total, quatre sites ont été identifiés dans le département dont je suis l’élue. Vous envisagez d’établir une cartographie, mais un cabinet indépendant l’a déjà dressée. §Je vous conseille de vous inspirer de ces travaux : vous gagnerez ainsi du temps.
J’y insiste, nous sommes face à une urgence à la fois environnementale et sanitaire. §Ces épaves et ces munitions sont là depuis des années, voire des décennies. Les mesures effectuées par le cabinet indépendant que j’évoquais démontrent leur dangerosité.
application de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Depuis 2016, année du vote de la loi pour la reconquête de la biodiversité, j'ai l'honneur de présider la fédération des parcs naturels régionaux (PNR) de France.
Les PRN, qui représentent 17 % du territoire français, sont engagés pour la préservation des patrimoines naturels et culturels.
Monsieur le ministre, dans le cadre de cette mission, j'ai constaté que de nombreux projets financés par l'État et l'Europe via le programme Life sont depuis des années totalement bloqués. Comment expliquer cet état de fait, qui va à l'encontre des engagements pris et même des lois votées ?
Ainsi, l'autorisation de défrichement sans compensation pour des projets écologiques prévue par la loi de 2016 n'a, à ce jour, pas reçu de décret d'application. Cette disposition est pourtant essentielle à la mise en œuvre de travaux écologiques.
Les milieux ouverts, tels que les landes, les tourbières, les prairies et les terres arbustives, ont une valeur écologique exceptionnelle. C'est peut-être contre-intuitif, mais le reboisement les condamne à s'appauvrir.
Pour maintenir ces espaces ouverts et sauvegarder la biodiversité inféodée à ces milieux, la dérogation à la compensation liée à la procédure de défrichement, prévue par la loi pour la reconquête de la biodiversité, est indispensable.
Comment expliquer l'absence de décret d'application, sept ans après le vote de la loi ? J'ai la conviction que cette paralysie administrative a pour origine une obstruction politique. À en croire une rumeur, c'est le ministère de l'agriculture qui bloquerait sciemment la publication de ce décret.
Aussi, je m'interroge. De fait, dans de nombreux cas, les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Draaf) refusent d'appliquer la loi pour la reconquête de la biodiversité, faute de décret.
Je vous demande de faire toute la lumière sur cette inertie administrative, qui prive d'efficacité un texte salvateur pour nos écosystèmes.

La parole est à M. Michaël Weber, auteur de la question n° 946, adressée à Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la biodiversité.

Depuis 2016, année du vote de la loi pour la reconquête de la biodiversité, j’ai l’honneur de présider la fédération des parcs naturels régionaux (PNR) de France.
Les PNR, qui représentent 17 % du territoire français, sont engagés pour la préservation des patrimoines naturels et culturels.
Monsieur le ministre, dans le cadre de cette mission, j’ai constaté que de nombreux projets financés par l’État et l’Europe via le programme Life sont depuis des années totalement bloqués. Comment expliquer cet état de fait, qui va à l’encontre des engagements pris et même des lois votées ?
Ainsi, l’autorisation de défrichement sans compensation pour des projets écologiques prévue par la loi de 2016 n’a, à ce jour, pas reçu de décret d’application. Cette disposition est pourtant essentielle à la mise en œuvre de travaux écologiques.
Les milieux ouverts, tels que les landes, les tourbières, les prairies et les terres arbustives, ont une valeur écologique exceptionnelle. C’est peut-être contre-intuitif, mais le reboisement les condamne à s’appauvrir.
Pour maintenir ces espaces ouverts et sauvegarder la biodiversité inféodée à ces milieux, la dérogation à la compensation liée à la procédure de défrichement, prévue par la loi pour la reconquête de la biodiversité, est indispensable.
Comment expliquer l’absence de décret d’application, sept ans après le vote de la loi ? J’ai la conviction que cette paralysie administrative a pour origine une obstruction politique. À en croire une rumeur, c’est le ministère de l’agriculture qui bloquerait sciemment la publication de ce décret.
Aussi, je m’interroge. De fait, dans de nombreux cas, les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf) refusent d’appliquer la loi pour la reconquête de la biodiversité, faute de décret.
Je vous demande de faire toute la lumière sur cette inertie administrative, qui prive d’efficacité un texte salvateur pour nos écosystèmes.

Depuis 2016, année du vote de la loi pour la reconquête de la biodiversité, j’ai l’honneur de présider la Fédération des parcs naturels régionaux (PNR) de France.
Les PNR, qui représentent 17 % du territoire français, sont engagés pour la préservation des patrimoines naturels et culturels.
Monsieur le ministre, dans le cadre de cette mission, j’ai constaté que de nombreux projets financés par l’État et l’Europe via le programme Life sont depuis des années totalement bloqués. Comment expliquer cet état de fait, qui va à l’encontre des engagements pris et même des lois votées ?
Ainsi, l’autorisation de défrichement sans compensation pour des projets écologiques prévue par la loi de 2016 n’a, à ce jour, pas reçu de décret d’application. Cette disposition est pourtant essentielle à la mise en œuvre de travaux écologiques.
Les milieux ouverts, tels que les landes, les tourbières, les prairies et les terres arbustives, ont une valeur écologique exceptionnelle. C’est peut-être contre-intuitif, mais le reboisement les condamne à s’appauvrir.
Pour maintenir ces espaces ouverts et sauvegarder la biodiversité inféodée à ces milieux, la dérogation à la compensation liée à la procédure de défrichement, prévue par la loi pour la reconquête de la biodiversité, est indispensable.
Comment expliquer l’absence de décret d’application, sept ans après le vote de la loi ? J’ai la conviction que cette paralysie administrative a pour origine une obstruction politique. À en croire une rumeur, c’est le ministère de l’agriculture qui bloquerait sciemment la publication de ce décret.
Aussi, je m’interroge. De fait, dans de nombreux cas, les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf) refusent d’appliquer la loi pour la reconquête de la biodiversité, faute de décret.
Je vous demande de faire toute la lumière sur cette inertie administrative, qui prive d’efficacité un texte salvateur pour nos écosystèmes.
Monsieur le sénateur Michaël Weber, la mosaïque paysagère de nos espaces naturels est une composante de la biodiversité. Vous l'avez souligné : en ouvrant des espaces dans des zones qui se boisent naturellement ou ont été boisées il y a longtemps, on offre des services écosystémiques importants. On participe même à la restauration des écosystèmes.
Aussi, la loi pour la reconquête de la biodiversité a prévu des dispositions pour articuler défrichement et protection de la forêt.
Il s'agit en effet de concilier deux approches : alors que nos forêts sont menacées par le changement climatique, la loi prévoyait de faciliter le défrichement. Ce paradoxe apparent a nécessité de longues discussions pour aboutir à un projet de décret équilibré qui sera soumis au Conseil d'État au tout début de l'année 2024. Vous voyez que je fais taire les rumeurs !
Sourires.
Monsieur le sénateur Michaël Weber, la mosaïque paysagère de nos espaces naturels est une composante de la biodiversité. Vous l’avez souligné : en ouvrant des espaces dans des zones qui se boisent naturellement ou ont été boisées il y a longtemps, on offre des services écosystémiques importants. On participe même à la restauration des écosystèmes.
Aussi, la loi pour la reconquête de la biodiversité a prévu des dispositions pour articuler défrichement et protection de la forêt.
Il s’agit en effet de concilier deux approches : alors que nos forêts sont menacées par le changement climatique, la loi prévoyait de faciliter le défrichement. Ce paradoxe apparent a nécessité de longues discussions pour aboutir à un projet de décret équilibré qui sera soumis au Conseil d’État au tout début de l’année 2024. Vous voyez que je fais taire les rumeurs !
Ce décret s'inscrira dans un cadre renouvelé de la gestion forestière. Non seulement les seuils de gestion durable seront modifiés pour la forêt privée, mais les schémas régionaux de gestion sylvicole (SRGS) seront intégralement renouvelés et un plan ambitieux de renouvellement forestier sera mis en œuvre.
Enfin, ce décret viendra renforcer les outils dont les acteurs des territoires disposent d'ores et déjà pour s'engager pleinement dans les projets de restauration des écosystèmes, dont la stratégie nationale pour la biodiversité a fixé l'ambition. À cet égard, les zones humides feront l'objet d'un effort particulier.
Sourires.
Ce décret s’inscrira dans un cadre renouvelé de la gestion forestière. Non seulement les seuils de gestion durable seront modifiés pour la forêt privée, mais les schémas régionaux de gestion sylvicole (SRGS) seront intégralement renouvelés et un plan ambitieux de renouvellement forestier sera mis en œuvre.
Enfin, ce décret viendra renforcer les outils dont les acteurs des territoires disposent d’ores et déjà pour s’engager pleinement dans les projets de restauration des écosystèmes, dont la stratégie nationale pour la biodiversité a fixé l’ambition. À cet égard, les zones humides feront l’objet d’un effort particulier.

Monsieur le ministre, je me réjouis de cette annonce. Nous serons évidemment très attentifs à la rédaction de ce décret, qui, je le répète, est attendu avec impatience.
assurances des communes

Une à une, nos communes voient leur contrat d'assurance résilié ; non seulement leurs cotisations augmentent brutalement, mais les conditions de prise en charge sont modifiées sans négociation, assorties de franchises hors de prix. Leurs appels d'offres ne trouvent plus de réponse et le quasi-monopole de deux compagnies permet aux assurances de proposer des tarifs exorbitants, que les communes ne peuvent plus refuser.
On le constate dans mon département de Seine-Maritime comme ailleurs. Les communes de Maromme, Saint-Étienne-du-Rouvray et Petit-Quevilly sont touchées, à l'instar de Bierville. Cette commune rurale de 300 habitants a vu son contrat résilié ; elle a dû batailler pour obtenir un nouveau contrat, dont les primes sont de 50 % plus élevées que celles du précédent.
Les compagnies d'assurances justifient ces augmentations par des risques de sinistralité trop élevés à la suite des émeutes, ou encore par les différentes catastrophes naturelles liées au changement climatique. L'assurance des collectivités territoriales ne pèse pourtant pas si lourd : elle ne représente que 1 % à 2 % du chiffre d'affaires des compagnies d'assurances.
Face à cette situation, les communes se trouvent totalement démunies. Certaines d'entre elles en sont réduites à s'auto-assurer, alors même que leurs obligations légales assurantielles se sont accrues depuis 2019.
La mission sur l'assurabilité des collectivités territoriales doit remettre son rapport au printemps prochain. Mais, d'ici là, il me semble important d'apporter des solutions de court terme à toutes ces communes en difficulté.
De même, il est nécessaire de protéger nos communes face aux résiliations brutales, d'encadrer les tarifs des cotisations et de veiller à une prise en charge élargie des sinistres couverts au titre des catastrophes naturelles.
Enfin, l'assurabilité des collectivités territoriales doit faire l'objet d'une réflexion à part entière. Je rappelle que nos collectivités concourent au service public, tout en aménageant le territoire au bénéfice de tous.
Monsieur le ministre, une lourde responsabilité pèse sur les épaules de nos élus locaux : nous ne pouvons pas les laisser seuls face à ces difficultés.

La parole est à Mme Céline Brulin, auteure de la question n° 861, adressée à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité.

Une à une, nos communes voient leur contrat d’assurance résilié ; non seulement leurs cotisations augmentent brutalement, mais les conditions de prise en charge sont modifiées sans négociation, assorties de franchises hors de prix. Leurs appels d’offres ne trouvent plus de réponse et le quasi-monopole de deux compagnies permet aux assurances de proposer des tarifs exorbitants, que les communes ne peuvent plus refuser.
On le constate dans mon département de Seine-Maritime comme ailleurs. Les communes de Maromme, Saint-Étienne-du-Rouvray et Petit-Quevilly sont touchées, à l’instar de Bierville. Cette commune rurale de 300 habitants a vu son contrat résilié ; elle a dû batailler pour obtenir un nouveau contrat, dont les primes sont de 50 % plus élevées que celles du précédent.
Les compagnies d’assurances justifient ces augmentations par des risques de sinistralité trop élevés à la suite des émeutes, ou encore par les différentes catastrophes naturelles liées au changement climatique. L’assurance des collectivités territoriales ne pèse pourtant pas si lourd : elle ne représente que 1 % à 2 % du chiffre d’affaires des compagnies d’assurances.
Face à cette situation, les communes se trouvent totalement démunies. Certaines d’entre elles en sont réduites à s’auto-assurer, alors même que leurs obligations légales assurantielles se sont accrues depuis 2019.
La mission sur l’assurabilité des collectivités territoriales doit remettre son rapport au printemps prochain. Mais, d’ici là, il me semble important d’apporter des solutions de court terme à toutes ces communes en difficulté.
De même, il est nécessaire de protéger nos communes face aux résiliations brutales, d’encadrer les tarifs des cotisations et de veiller à une prise en charge élargie des sinistres couverts au titre des catastrophes naturelles.
Enfin, l’assurabilité des collectivités territoriales doit faire l’objet d’une réflexion à part entière. Je rappelle que nos collectivités concourent au service public, tout en aménageant le territoire au bénéfice de tous.
Monsieur le ministre, une lourde responsabilité pèse sur les épaules de nos élus locaux : nous ne pouvons pas les laisser seuls face à ces difficultés.
Madame la sénatrice Céline Brulin, je ne puis que confirmer le constat que vous dressez.
Cette situation résulte notamment de l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des événements climatiques en France métropolitaine et dans les outre-mer ; nous en avons encore eu la preuve récemment, y compris dans ma région. Elle se traduit par une hausse importante et durable des coûts d'indemnisation des pertes matérielles des communes, laquelle pousse certains assureurs à se retirer du marché de l'assurance des collectivités territoriales.
Afin de contribuer à l'instauration d'un climat de confiance entre collectivités territoriales et assureurs, le Gouvernement a annoncé à la fin du mois de septembre dernier la conclusion d'un accord avec les assureurs. Le recours à la médiation de l'assurance, intervenant comme un médiateur conventionnel, doit ainsi être généralisé pour les litiges portant sur les contrats d'assurance des collectivités.
En outre, le Gouvernement vient d'annoncer le lancement d'une mission d'expertise afin de définir et de proposer des solutions concrètes et pérennes pour faciliter l'assurance des collectivités territoriales. Cette mission remettra ses conclusions au deuxième trimestre de 2024.
Par ailleurs, la mission sur l'assurabilité des risques climatiques, lancée en mai dernier par mes collègues Dominique Faure, Bruno Le Maire, Christophe Béchu et Thomas Cazenave, s'inscrit pleinement dans le cadre de la recherche de solutions aux difficultés assurantielles rencontrées par les collectivités.
Elle a pour rôle de dresser un état des lieux des recommandations sur l'évolution du système assurantiel français face aux enjeux posés par le dérèglement climatique, afin de garantir l'assurabilité des particuliers, des entreprises et des collectivités. La mission formulera ses recommandations d'ici décembre 2023.
Madame la sénatrice, soyez assurée que le Gouvernement restera extrêmement vigilant pour faciliter les modalités d'accès à l'assurance des collectivités.
Madame la sénatrice Céline Brulin, je ne puis que confirmer le constat que vous dressez.
Cette situation résulte notamment de l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des événements climatiques en France métropolitaine et dans les outre-mer ; nous en avons encore eu la preuve récemment, y compris dans ma région. Elle se traduit par une hausse importante et durable des coûts d’indemnisation des pertes matérielles des communes, laquelle pousse certains assureurs à se retirer du marché de l’assurance des collectivités territoriales.
Afin de contribuer à l’instauration d’un climat de confiance entre collectivités territoriales et assureurs, le Gouvernement a annoncé à la fin du mois de septembre dernier la conclusion d’un accord avec les assureurs. Le recours à la médiation de l’assurance, intervenant comme un médiateur conventionnel, doit ainsi être généralisé pour les litiges portant sur les contrats d’assurance des collectivités.
En outre, le Gouvernement vient d’annoncer le lancement d’une mission d’expertise afin de définir et de proposer des solutions concrètes et pérennes pour faciliter l’assurance des collectivités territoriales. Cette mission remettra ses conclusions au deuxième trimestre de 2024.
Par ailleurs, la mission sur l’assurabilité des risques climatiques, lancée en mai dernier par mes collègues Dominique Faure, Bruno Le Maire, Christophe Béchu et Thomas Cazenave, s’inscrit pleinement dans le cadre de la recherche de solutions aux difficultés assurantielles rencontrées par les collectivités.
Elle a pour rôle de dresser un état des lieux des recommandations sur l’évolution du système assurantiel français face aux enjeux posés par le dérèglement climatique, afin de garantir l’assurabilité des particuliers, des entreprises et des collectivités. La mission formulera ses recommandations d’ici décembre 2023.
Madame la sénatrice, soyez assurée que le Gouvernement restera extrêmement vigilant pour faciliter les modalités d’accès à l’assurance des collectivités.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Je ne doute pas que ces missions aboutiront à des préconisations intéressantes, mais je vois que les compagnies d'assurance se font entendre dans ce débat et formulent un certain nombre d'exigences : je pense que la puissance publique, l'État notamment, devrait en faire autant, afin que le système soit beaucoup moins injuste qu'aujourd'hui.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Je ne doute pas que ces missions aboutiront à des préconisations intéressantes, mais je vois que les compagnies d’assurance se font entendre dans ce débat et formulent un certain nombre d’exigences : je pense que la puissance publique, l’État notamment, devrait en faire autant, afin que le système soit beaucoup moins injuste qu’aujourd’hui.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Je ne doute pas que ces missions aboutiront à des préconisations intéressantes, mais je vois que les compagnies d’assurances se font entendre dans ce débat et formulent un certain nombre d’exigences : je pense que la puissance publique, l’État notamment, devrait en faire autant, afin que le système soit beaucoup moins injuste qu’aujourd’hui.
éligibilité des dépenses de travaux dans les gîtes communaux au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Monsieur le ministre, je souhaite appeler l'attention du Gouvernement sur l'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des dépenses de travaux réalisés dans les gîtes ruraux communaux.
La loi de finances pour 2021 a instauré l'automatisation du calcul du FCTVA, qui s'opère désormais à partir des imputations comptables des dépenses des collectivités locales. Cela a permis de réduire sensiblement les délais pour bénéficier du dispositif, mais a néanmoins exclu certaines dépenses jusque-là éligibles.
Dans mon département de la Mayenne, la commune de Saint-Pierre-sur-Erve, qui est au demeurant une petite cité de caractère, n'a pas pu disposer du FCTVA pour un projet de travaux dans son gîte : c'est particulièrement regrettable !
Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2024, j'ai déposé un amendement tendant à revenir sur la liste des exceptions fixée par le code général des collectivités territoriales (CGCT), mais il n'a finalement pas été retenu.
La compensation financière qu'offre le FCTVA est essentielle au développement des collectivités locales, notamment dans le cadre de la promotion et de la préservation de leur patrimoine. En effet, les gîtes communaux permettent de faire vivre le tourisme et l'économie des communes rurales ; ils contribuent aussi à la redynamisation des centres-bourgs et des villages, auxquels nous sommes si attachés dans cette haute assemblée.
Le Gouvernement envisage-t-il de revenir par voie réglementaire sur la liste des exceptions fixée par le CGCT, en y ajoutant les dépenses liées aux travaux dans les gîtes communaux ? Si tel n'est pas le cas, je souhaite connaître les dispositifs qu'il compte mobiliser pour soutenir les communes rurales qui, j'y insiste, contribuent à l'économie touristique de nos territoires et renforcent leur attractivité.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier, auteur de la question n° 934, adressée à Mme la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier, auteur de la question n° 934, adressée à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité.

Monsieur le ministre, je souhaite appeler l’attention du Gouvernement sur l’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des dépenses de travaux réalisés dans les gîtes ruraux communaux.
La loi de finances pour 2021 a instauré l’automatisation du calcul du FCTVA, qui s’opère désormais à partir des imputations comptables des dépenses des collectivités locales. Cela a permis de réduire sensiblement les délais pour bénéficier du dispositif, mais a néanmoins exclu certaines dépenses jusque-là éligibles.
Dans mon département de la Mayenne, la commune de Saint-Pierre-sur-Erve, qui est au demeurant une petite cité de caractère, n’a pas pu disposer du FCTVA pour un projet de travaux dans son gîte : c’est particulièrement regrettable !
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, j’ai déposé un amendement tendant à revenir sur la liste des exceptions fixée par le code général des collectivités territoriales (CGCT), mais il n’a finalement pas été retenu.
La compensation financière qu’offre le FCTVA est essentielle au développement des collectivités locales, notamment dans le cadre de la promotion et de la préservation de leur patrimoine. En effet, les gîtes communaux permettent de faire vivre le tourisme et l’économie des communes rurales ; ils contribuent aussi à la redynamisation des centres-bourgs et des villages, auxquels nous sommes si attachés dans cette haute assemblée.
Le Gouvernement envisage-t-il de revenir par voie réglementaire sur la liste des exceptions fixée par le CGCT, en y ajoutant les dépenses liées aux travaux dans les gîtes communaux ? Si tel n’est pas le cas, je souhaite connaître les dispositifs qu’il compte mobiliser pour soutenir les communes rurales qui, j’y insiste, contribuent à l’économie touristique de nos territoires et renforcent leur attractivité.
Monsieur le sénateur Chevrollier, vous l'avez rappelé au début de votre propos : la loi de finances pour 2021 a instauré l'automatisation du calcul du FCTVA, qui s'opère désormais à partir des imputations comptables des dépenses des collectivités. Cela a permis de réduire sensiblement les délais pour bénéficier du dispositif.
En matière de création et d'aménagement des gîtes ruraux, c'est un régime spécifique qui s'applique aux dépenses réalisées avant le 1er janvier 2021 : les communes pouvaient bénéficier d'attributions du FCTVA pour leurs dépenses d'investissement, sous réserve qu'elles ne puissent pas déduire la TVA par voie fiscale et que les gîtes ne soient pas loués plus de six mois par an.
Dorénavant, le FCTVA est automatisé et couvre toute dépense régulièrement enregistrée sur l'un des comptes éligibles, dont la liste est fixée par l'arrêté du 30 décembre 2020, sous réserve qu'elle ne soit pas assujettie à la TVA.
Les dépenses relatives à la construction ou à l'aménagement des gîtes ruraux doivent être enregistrées sur le compte n° 2132 « Immeubles de rapport », lequel n'a pas été retenu dans l'assiette d'éligibilité au FCTVA. Néanmoins, lorsque ces dépenses sont enregistrées sur le compte n° 2313 « Constructions », intégré aux immobilisations en cours, elles peuvent ouvrir au bénéfice du FCTVA, notamment lorsque le bien n'est pas achevé. Cela s'explique par le fait que ce compte n'est pas subdivisé entre bâtiments publics et immeubles de rapport.
Monsieur le sénateur Chevrollier, vous l’avez rappelé au début de votre propos : la loi de finances pour 2021 a instauré l’automatisation du calcul du FCTVA, qui s’opère désormais à partir des imputations comptables des dépenses des collectivités. Cela a permis de réduire sensiblement les délais pour bénéficier du dispositif.
En matière de création et d’aménagement des gîtes ruraux, c’est un régime spécifique qui s’applique aux dépenses réalisées avant le 1er janvier 2021 : les communes pouvaient bénéficier d’attributions du FCTVA pour leurs dépenses d’investissement, sous réserve qu’elles ne puissent pas déduire la TVA par voie fiscale et que les gîtes ne soient pas loués plus de six mois par an.
Dorénavant, le FCTVA est automatisé et couvre toute dépense régulièrement enregistrée sur l’un des comptes éligibles, dont la liste est fixée par l’arrêté du 30 décembre 2020, sous réserve qu’elle ne soit pas assujettie à la TVA.
Les dépenses relatives à la construction ou à l’aménagement des gîtes ruraux doivent être enregistrées sur le compte n° 2132 « Immeubles de rapport », lequel n’a pas été retenu dans l’assiette d’éligibilité au FCTVA. Néanmoins, lorsque ces dépenses sont enregistrées sur le compte n° 2313 « Constructions », intégré aux immobilisations en cours, elles peuvent ouvrir au bénéfice du FCTVA, notamment lorsque le bien n’est pas achevé. Cela s’explique par le fait que ce compte n’est pas subdivisé entre bâtiments publics et immeubles de rapport.

Je vous remercie de ces précisions très techniques, monsieur le ministre. Il est vrai que nos élus ont besoin de soutiens financiers, qui se matérialisent par divers dispositifs. Les élus nécessitent notamment un accompagnement adapté afin de pouvoir utiliser pleinement le FCTVA. Nous prônons la simplification et la stabilité des dispositifs pour améliorer leur maîtrise par nos élus et assurer l'efficacité des politiques publiques.

Je vous remercie de ces précisions très techniques, monsieur le ministre. Il est vrai que nos élus ont besoin de soutiens financiers, qui se matérialisent par divers dispositifs. Les élus nécessitent notamment un accompagnement adapté afin de pouvoir utiliser pleinement le FCTVA. Nous prônons la simplification et la stabilité des dispositifs pour améliorer leur maîtrise par nos élus et assurer l’efficacité des politiques publiques.

Je vous remercie de ces précisions très techniques, monsieur le ministre. Il est vrai que nos élus ont besoin de soutiens financiers, qui se matérialisent par divers dispositifs. Il leur faut notamment un accompagnement adapté afin de pouvoir utiliser pleinement le FCTVA. Nous prônons la simplification et la stabilité des dispositifs pour améliorer leur maîtrise par nos élus et assurer l’efficacité des politiques publiques.
progressivité des tarifs de l’eau

Monsieur le ministre, face aux sécheresses à répétition qui ont frappé mon département de la Loire, la finalisation du schéma directeur d'alimentation en eau potable de Loire Forez agglomération, assurée sous la gouvernance du maire de Montbrison, Christophe Bazile, a permis de mettre en œuvre les travaux les plus urgents dès 2023 afin de sécuriser la distribution de l'eau.
Les agriculteurs ne bénéficiant pas de l'eau du canal du Forez, qui est un très gros pourvoyeur, restent très tributaires du réseau public d'eau potable pour maintenir leur activité ; il en va de même des établissements médico-sociaux.
L'agence de l'eau Loire-Bretagne va conditionner l'attribution des subventions à la collectivité compétente à l'application d'une progressivité des tarifs. L'objectif est louable, puisqu'il s'agit de réduire les consommations d'eau, donc les prélèvements.
De ce fait, la dégressivité du tarif de l'eau pratiquée dans beaucoup de communes de montagne, afin de ne pas pénaliser les agriculteurs, ne peut être maintenue par Loire Forez agglomération au risque de perdre les subventions de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Or ces subventions sont essentielles, voire vitales au financement du budget annexe « Eau potable ».
Cette décision va avoir pour conséquence une augmentation forte et généralisée du prix de l'eau pour l'ensemble des usagers. Le risque serait également de voir se multiplier les recherches en eau et les forages privés.
Face à ce constat, il serait souhaitable qu'un dispositif approprié puisse s'appliquer à ces usagers, certes gros consommateurs en eau, mais dont l'activité pourrait être menacée par ces fortes hausses. J'ajoute que les collectivités pourraient, elles aussi, être pénalisées.

La parole est à M. Hervé Reynaud, auteur de la question n° 928, transmise à Mme la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité.

La parole est à M. Hervé Reynaud, auteur de la question n° 928, transmise à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité.

Monsieur le ministre, face aux sécheresses à répétition qui ont frappé mon département de la Loire, la finalisation du schéma directeur d’alimentation en eau potable de Loire Forez agglomération, assurée sous la gouvernance du maire de Montbrison, Christophe Bazile, a permis de mettre en œuvre les travaux les plus urgents dès 2023 afin de sécuriser la distribution de l’eau.
Les agriculteurs ne bénéficiant pas de l’eau du canal du Forez, qui est un très gros pourvoyeur, restent très tributaires du réseau public d’eau potable pour maintenir leur activité ; il en va de même des établissements médico-sociaux.
L’agence de l’eau Loire-Bretagne va conditionner l’attribution des subventions à la collectivité compétente à l’application d’une progressivité des tarifs. L’objectif est louable, puisqu’il s’agit de réduire les consommations d’eau, donc les prélèvements.
De ce fait, la dégressivité du tarif de l’eau pratiquée dans beaucoup de communes de montagne, afin de ne pas pénaliser les agriculteurs, ne peut être maintenue par Loire Forez agglomération au risque de perdre les subventions de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Or ces subventions sont essentielles, voire vitales au financement du budget annexe « Eau potable ».
Cette décision va avoir pour conséquence une augmentation forte et généralisée du prix de l’eau pour l’ensemble des usagers. Le risque serait également de voir se multiplier les recherches en eau et les forages privés.
Face à ce constat, il serait souhaitable qu’un dispositif approprié puisse s’appliquer à ces usagers, certes gros consommateurs en eau, mais dont l’activité pourrait être menacée par ces fortes hausses. J’ajoute que les collectivités pourraient, elles aussi, être pénalisées.
Monsieur le sénateur Reynaud, le plan Eau annoncé par le Président de la République repose sur un objectif structurant de sobriété : moins 10 % d'eau prélevée d'ici à 2030.
L'atteinte de cet objectif suppose une contribution, voire une mobilisation de l'ensemble des usagers de l'eau, y compris des agriculteurs. L'agence de l'eau Loire-Bretagne a mis en place des accords de résilience, qui ont pour objet de décliner territorialement le plan Eau.
L'agence de l'eau accompagne de façon prioritaire, et à des taux majorés, les collectivités ayant rencontré des difficultés d'approvisionnement en eau en 2022 ou en 2023. En contrepartie, les contrats reposent sur des engagements en matière de transferts de compétences au 1er janvier 2026, de fin des tarifs dégressifs et d'actions de la collectivité pour accompagner les particuliers ou les entreprises du territoire dans leurs efforts pour économiser l'eau.
J'en viens à Loire Forez agglomération. La collectivité exerce la compétence relative à l'eau potable depuis le 1er janvier 2020 et a mis en place une convergence tarifaire sans dégressivité à l'horizon 2026. Ainsi, l'accord de résilience entre l'agence de l'eau et l'agglomération ne fait pas mention d'un engagement supplémentaire en matière de tarification de l'eau. L'application progressive d'un tarif unique de l'eau non dégressif sur le territoire de Loire Forez agglomération est une décision antérieure.
Les difficultés rencontrées lors de la sécheresse de l'étiage 2022 ont entraîné des obligations de citernage et des restrictions d'eau.
L'accord porte sur le remplacement des canalisations fuyardes, les économies d'eau, les travaux de sécurisation et d'interconnexion des réseaux et la protection de captages. Le montant des travaux est établi à 5 438 000 euros, avec un soutien financier de l'agence de l'eau à hauteur de 2 924 000 euros.
Au-delà des investissements nécessaires, la sobriété de la consommation est importante pour préserver la ressource en eau : la fin de la dégressivité tarifaire a justement vocation à y contribuer.
Monsieur le sénateur Reynaud, le plan Eau annoncé par le Président de la République repose sur un objectif structurant de sobriété : moins 10 % d’eau prélevée d’ici à 2030.
L’atteinte de cet objectif suppose une contribution, voire une mobilisation de l’ensemble des usagers de l’eau, y compris des agriculteurs. L’agence de l’eau Loire-Bretagne a mis en place des accords de résilience, qui ont pour objet de décliner territorialement le plan Eau.
L’agence de l’eau accompagne de façon prioritaire, et à des taux majorés, les collectivités ayant rencontré des difficultés d’approvisionnement en eau en 2022 ou en 2023. En contrepartie, les contrats reposent sur des engagements en matière de transferts de compétences au 1er janvier 2026, de fin des tarifs dégressifs et d’actions de la collectivité pour accompagner les particuliers ou les entreprises du territoire dans leurs efforts pour économiser l’eau.
J’en viens à Loire Forez agglomération. La collectivité exerce la compétence relative à l’eau potable depuis le 1er janvier 2020 et a mis en place une convergence tarifaire sans dégressivité à l’horizon 2026. Ainsi, l’accord de résilience entre l’agence de l’eau et l’agglomération ne fait pas mention d’un engagement supplémentaire en matière de tarification de l’eau. L’application progressive d’un tarif unique de l’eau non dégressif sur le territoire de Loire Forez agglomération est une décision antérieure.
Les difficultés rencontrées lors de la sécheresse de l’étiage 2022 ont entraîné des obligations de citernage et des restrictions d’eau.
L’accord porte sur le remplacement des canalisations fuyardes, les économies d’eau, les travaux de sécurisation et d’interconnexion des réseaux et la protection de captages. Le montant des travaux est établi à 5 438 000 euros, avec un soutien financier de l’agence de l’eau à hauteur de 2 924 000 euros.
Au-delà des investissements nécessaires, la sobriété de la consommation est importante pour préserver la ressource en eau : la fin de la dégressivité tarifaire a justement vocation à y contribuer.

Je vous remercie de la précision de votre réponse, monsieur le ministre. Il est vrai que ces sujets appellent souvent la formulation d'injonctions dites contradictoires, venant pénaliser des démarches qui se veulent vertueuses entre les collectivités et les acteurs agricoles en particulier, mais aussi entre les collectivités et des établissements médico-sociaux.

Je vous remercie de la précision de votre réponse, monsieur le ministre. Il est vrai que ces sujets appellent souvent la formulation d’injonctions dites contradictoires, venant pénaliser des démarches qui se veulent vertueuses entre les collectivités et les acteurs agricoles en particulier, mais aussi entre les collectivités et des établissements médico-sociaux.
situation du collège rural de corlay

En mars dernier, lors d'un déplacement dans la Nièvre, Mme la Première ministre, Élisabeth Borne, a affirmé la volonté du Gouvernement de « changer de méthode » sur l'évolution de la carte scolaire en milieu rural et de généraliser les territoires éducatifs ruraux (TER) d'ici trois ans.
La fabrique du territoire scolaire est un exercice complexe d'aménagement qui se révèle vital pour l'avenir des territoires, surtout en milieu rural. Elle doit assurer, par un maillage riche et dense d'établissements, un équitable accès au service public de l'éducation.
À Corlay, commune des Côtes-d'Armor située en zone de revitalisation rurale (ZRR), la décision de fermer le collège public Pier An Dall à la rentrée prochaine, votée hier par le conseil départemental, a suscité une très forte opposition.
En effet, cette décision prise sans concertation ne se justifie ni pour des raisons économiques, car le projet de reconstruction d'un collège dans la commune voisine, située dans un bassin de vie différent, aurait un coût très important pour un établissement qui continuera de fonctionner malgré les sous-effectifs, ni pour des raisons pédagogiques, puisque le collège de Corlay enregistre en moyenne 94 % de réussite au brevet ces quinze dernières années.
Ses résultats sont parmi les meilleurs du département. Soulignons-le, monsieur le ministre : ils sont d'autant plus remarquables que l'indice de position sociale (IPS) du collège se situe largement sous la moyenne départementale.
En outre, les effectifs sont en hausse continue, particulièrement sur la période 2022-2035, avec des prévisions de croissance de 18 %.
Ainsi, ni le calendrier, ni la méthode, ni les raisons invoquées ne justifient cette décision de fermeture. L'État doit encore confirmer ce vote du conseil départemental, le préfet annonçant la publication de son arrêté en mars prochain.
Aussi, je vous demande, monsieur le ministre, de soutenir la mise en place d'un moratoire sur la fermeture du collège public de Corlay et son inscription dans le réseau des TER.

La parole est à M. Ronan Dantec, auteur de la question n° 882, adressée à M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

En mars dernier, lors d’un déplacement dans la Nièvre, Mme la Première ministre, Élisabeth Borne, a affirmé la volonté du Gouvernement de « changer de méthode » sur l’évolution de la carte scolaire en milieu rural et de généraliser les territoires éducatifs ruraux (TER) d’ici trois ans.
La fabrique du territoire scolaire est un exercice complexe d’aménagement qui se révèle vital pour l’avenir des territoires, surtout en milieu rural. Elle doit assurer, par un maillage riche et dense d’établissements, un équitable accès au service public de l’éducation.
À Corlay, commune des Côtes-d’Armor située en zone de revitalisation rurale (ZRR), la décision de fermer le collège public Pier An Dall à la rentrée prochaine, votée hier par le conseil départemental, a suscité une très forte opposition.
En effet, cette décision prise sans concertation ne se justifie ni pour des raisons économiques, car le projet de reconstruction d’un collège dans la commune voisine, située dans un bassin de vie différent, aurait un coût très important pour un établissement qui continuera de fonctionner malgré les sous-effectifs, ni pour des raisons pédagogiques, puisque le collège de Corlay enregistre en moyenne 94 % de réussite au brevet ces quinze dernières années.
Ses résultats sont parmi les meilleurs du département. Soulignons-le, monsieur le ministre : ils sont d’autant plus remarquables que l’indice de position sociale (IPS) du collège se situe largement sous la moyenne départementale.
En outre, les effectifs sont en hausse continue, particulièrement sur la période 2022-2035, avec des prévisions de croissance de 18 %.
Ainsi, ni le calendrier, ni la méthode, ni les raisons invoquées ne justifient cette décision de fermeture. L’État doit encore confirmer ce vote du conseil départemental, le préfet annonçant la publication de son arrêté en mars prochain.
Aussi, je vous demande, monsieur le ministre, de soutenir la mise en place d’un moratoire sur la fermeture du collège public de Corlay et son inscription dans le réseau des TER.

En mars dernier, lors d’un déplacement dans la Nièvre, Mme la Première ministre, Élisabeth Borne, a affirmé la volonté du Gouvernement de « changer de méthode » sur l’évolution de la carte scolaire en milieu rural et de généraliser les territoires éducatifs ruraux (TER) d’ici à trois ans.
La fabrique du territoire scolaire est un exercice complexe d’aménagement qui se révèle vital pour l’avenir des territoires, surtout en milieu rural. Elle doit assurer, par un maillage riche et dense d’établissements, un équitable accès au service public de l’éducation.
À Corlay, commune des Côtes-d’Armor située en zone de revitalisation rurale (ZRR), la décision de fermer le collège public Pier An Dall à la rentrée prochaine, votée hier par le conseil départemental, a suscité une très forte opposition.
En effet, cette décision prise sans concertation ne se justifie ni pour des raisons économiques, car le projet de reconstruction d’un collège dans la commune voisine, située dans un bassin de vie différent, aurait un coût très important pour un établissement qui continuera de fonctionner malgré les sous-effectifs, ni pour des raisons pédagogiques, puisque le collège de Corlay enregistre en moyenne 94 % de réussite au brevet ces quinze dernières années.
Ses résultats sont parmi les meilleurs du département. Soulignons-le, monsieur le ministre : ils sont d’autant plus remarquables que l’indice de position sociale (IPS) du collège se situe largement sous la moyenne départementale.
En outre, les effectifs sont en hausse continue, particulièrement sur la période 2022-2035, avec des prévisions de croissance de 18 %.
Ainsi, ni le calendrier, ni la méthode, ni les raisons invoquées ne justifient cette décision de fermeture. L’État doit encore confirmer ce vote du conseil départemental, le préfet annonçant la publication de son arrêté en mars prochain.
Aussi, je vous demande, monsieur le ministre, de soutenir la mise en place d’un moratoire sur la fermeture du collège public de Corlay et son inscription dans le réseau des TER.
Monsieur le sénateur Dantec, concernant l'enseignement public du second degré, l'article L. 213-1 du code de l'éducation dispose que « le conseil département arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves ».
En vertu du même code, le département a la charge des collèges : il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.
Le conseil départemental des Côtes-d'Armor est donc compétent pour décider de l'éventuelle fermeture du collège Pier An Dall à Corlay, qui scolarise environ soixante-dix élèves depuis plusieurs années, avec un maximum de quatre-vingts élèves en 2020.
Dans les Côtes-d'Armor, pour l'année scolaire 2022-2023, 17, 8 % des collégiens relèvent de la ruralité, soit un taux deux fois plus élevé qu'à l'échelle nationale. Dans les collèges ruraux du département, le nombre moyen d'élèves par division est de 22, 8, soit un taux d'encadrement beaucoup plus favorable que la moyenne des collèges ruraux à l'échelle nationale, établie à 24. Dans l'ensemble des collèges du département, le ratio d'élèves par division est de plus de 25.
Ce taux d'encadrement montre que les services de l'éducation nationale ont bien pris en compte les spécificités du milieu rural des Côtes-d'Armor.
La chambre régionale des comptes a mené une analyse du réseau des collèges et de sa gestion par le conseil départemental. Elle a conclu à la nécessité de fermer un ou deux collèges proches, ceux de Corlay et de Saint-Nicolas-du-Pélem, distants de 8 kilomètres, en raison de prévisions pessimistes concernant des effectifs déjà fragiles – ces derniers seront réduits de 30 % à moyen terme. §
En outre, l'analyse déplore des résultats en retrait, notamment aux épreuves écrites du diplôme national du brevet, un manque d'émulation, des écarts importants de parcours parmi les collégiens par rapport aux données départementales, de même qu'un mauvais état du bâti.
En conséquence, la chambre régionale des comptes propose d'orienter les élèves dans d'autres établissements situés à proximité, qui disposent de capacités d'accueil encore importantes.
Le conseil départemental a choisi de maintenir un des deux collèges, celui de Saint-Nicolas-du-Pélem, qui dispose d'une emprise foncière plus importante, permettant d'envisager une reconstruction en site occupé conformément à l'objectif de zéro artificialisation nette (ZAN). L'établissement qui a vocation à y être reconstruit est donc appelé à devenir le collège du territoire.
Monsieur le sénateur Dantec, concernant l’enseignement public du second degré, l’article L. 213-1 du code de l’éducation dispose que « le conseil département arrête après avis du conseil départemental de l’éducation nationale, en tenant compte de critères d’équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d’accueil, leur secteur de recrutement et le mode d’hébergement des élèves ».
En vertu du même code, le département a la charge des collèges : il en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement.
Le conseil départemental des Côtes-d’Armor est donc compétent pour décider de l’éventuelle fermeture du collège Pier An Dall à Corlay, qui scolarise environ soixante-dix élèves depuis plusieurs années, avec un maximum de quatre-vingts élèves en 2020.
Dans les Côtes-d’Armor, pour l’année scolaire 2022-2023, 17, 8 % des collégiens relèvent de la ruralité, soit un taux deux fois plus élevé qu’à l’échelle nationale. Dans les collèges ruraux du département, le nombre moyen d’élèves par division est de 22, 8, soit un taux d’encadrement beaucoup plus favorable que la moyenne des collèges ruraux à l’échelle nationale, établie à 24. Dans l’ensemble des collèges du département, le ratio d’élèves par division est de plus de 25.
Ce taux d’encadrement montre que les services de l’éducation nationale ont bien pris en compte les spécificités du milieu rural des Côtes-d’Armor.
La chambre régionale des comptes a mené une analyse du réseau des collèges et de sa gestion par le conseil départemental. Elle a conclu à la nécessité de fermer un ou deux collèges proches, ceux de Corlay et de Saint-Nicolas-du-Pélem, distants de 8 kilomètres, en raison de prévisions pessimistes concernant des effectifs déjà fragiles – ces derniers seront réduits de 30 % à moyen terme.
Monsieur le sénateur Dantec, concernant l’enseignement public du second degré, l’article L. 213-1 du code de l’éducation précise : « [Le] conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l’éducation nationale, en tenant compte de critères d’équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d’accueil, leur secteur de recrutement et le mode d’hébergement des élèves. »
En vertu du même code, le département a la charge des collèges : il en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement.
Le conseil départemental des Côtes-d’Armor est donc compétent pour décider de l’éventuelle fermeture du collège Pier An Dall à Corlay, qui scolarise environ soixante-dix élèves depuis plusieurs années, avec un maximum de quatre-vingts élèves en 2020.
Dans les Côtes-d’Armor, pour l’année scolaire 2022-2023, 17, 8 % des collégiens relèvent de la ruralité, soit un taux deux fois plus élevé qu’à l’échelle nationale. Dans les collèges ruraux du département, le nombre moyen d’élèves par division est de 22, 8, soit un taux d’encadrement beaucoup plus favorable que la moyenne des collèges ruraux à l’échelle nationale, établie à 24. Dans l’ensemble des collèges du département, le ratio d’élèves par division est de plus de 25.
Ce taux d’encadrement montre que les services de l’éducation nationale ont bien pris en compte les spécificités du milieu rural des Côtes-d’Armor.
La chambre régionale des comptes a mené une analyse du réseau des collèges et de sa gestion par le conseil départemental. Elle a conclu à la nécessité de fermer un ou deux collèges proches, ceux de Corlay et de Saint-Nicolas-du-Pélem, distants de 8 kilomètres, en raison de prévisions pessimistes concernant des effectifs déjà fragiles – ces derniers seront réduits de 30 % à moyen terme.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, on parle souvent de modernisation de la vie publique et politique. À vingt-sept mois des prochaines élections municipales – vingt-sept mois, déjà ! –, nous devrions travailler certaines pistes afin d'améliorer les choses en la matière pour les communes, échelon préféré des Français, d'autant que le calendrier le permet.
Je pense tout d'abord au panachage, qui s'applique dans les communes de moins de 1 000 habitants : est-il bien utile de maintenir ce système archaïque datant de la IIIᵉ République, qui a parfois des conséquences délétères ? Sa suppression aurait l'avantage de généraliser le scrutin de liste, donc de faire progresser la parité dans les exécutifs municipaux et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Ce n'est là que l'une des pistes de cette modernisation dont on parle tant. On pourrait aussi réfléchir, au cas par cas, à diminuer le nombre de conseillers communaux, notamment dans les communes les plus rurales, là où des difficultés ne manqueront pas de se poser.
C'est un principe de réalité, madame la secrétaire d'État : il est certain que nous ferons face à une crise des vocations lors du renouvellement des communes en 2026. Comment susciter de nouveau des vocations ?
Nous sommes par exemple en train d'inventer des solutions permettant de comptabiliser des trimestres pour la retraite en cas de volontariat – nous avons d'ailleurs tous salué le volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers à l'occasion de la Sainte-Barbe.
Quelles pourraient être les pistes pour inciter nos concitoyens à siéger dans les conseils municipaux ? La revalorisation des indemnités est une bonne idée, mais elle doit être financée par l'État, car les budgets communaux sont aujourd'hui à sec et ne peuvent aller au-delà, faute de quoi les élus seront les premiers à se restreindre.
Oui à la modernisation, mais quand allons-nous sérieusement nous pencher sur le statut de l'élu ? C'est un débat que je souhaiterais que nous ayons dans les mois à venir, madame la secrétaire d'État.
En outre, l’analyse déplore des résultats en retrait, notamment aux épreuves écrites du diplôme national du brevet, un manque d’émulation, des écarts importants de parcours parmi les collégiens par rapport aux données départementales, de même qu’un mauvais état du bâti.
En conséquence, la chambre régionale des comptes propose d’orienter les élèves dans d’autres établissements situés à proximité, qui disposent de capacités d’accueil encore importantes.
Le conseil départemental a choisi de maintenir un des deux collèges, celui de Saint-Nicolas-du-Pélem, qui dispose d’une emprise foncière plus importante, permettant d’envisager une reconstruction en site occupé conformément à l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN). L’établissement qui a vocation à y être reconstruit est donc appelé à devenir le collège du territoire.
élections dans les communes de moins de 1 000 habitants
Monsieur le sénateur Belin, en matière de parité, des progrès importants ont été accomplis ces dernières années au sein des assemblées des collectivités locales.
En effet, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 a introduit deux mesures majeures : d'une part, elle crée un scrutin majoritaire binominal paritaire pour l'élection des conseillers départementaux ; d'autre part, elle abaisse le seuil du scrutin de liste paritaire pour l'élection des conseillers municipaux, permettant d'étendre ce mode de scrutin aux communes comprises entre 1 000 et 3 500 habitants.
Au lendemain des élections municipales de 2020, la proportion des femmes siégeant dans les conseils municipaux est ainsi passée à 42, 4 %, contre 39, 9 % lors du renouvellement général de 2014.
La proportion des maires femmes a elle aussi progressé, passant de 16, 9 % en 2014 à 19, 8 % en 2020. En obligeant au dépôt de listes de candidats paritaires, le scrutin de liste a fortement contribué à la féminisation des conseils municipaux.
Je pense sincèrement que l'attention que vous portez aux communes de moins de 1 000 habitants est pertinente, …

La parole est à M. Bruno Belin, auteur de la question n° 014, adressée à M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, on parle souvent de modernisation de la vie publique et politique. À vingt-sept mois des prochaines élections municipales – vingt-sept mois, déjà ! –, nous devrions travailler certaines pistes afin d’améliorer les choses en la matière pour les communes, échelon préféré des Français, d’autant que le calendrier le permet.
Je pense tout d’abord au panachage, qui s’applique dans les communes de moins de 1 000 habitants : est-il bien utile de maintenir ce système archaïque datant de la IIIe République, qui a parfois des conséquences délétères ? Sa suppression aurait l’avantage de généraliser le scrutin de liste, donc de faire progresser la parité dans les exécutifs municipaux et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Ce n’est là que l’une des pistes de cette modernisation dont on parle tant. On pourrait aussi réfléchir, au cas par cas, à diminuer le nombre de conseillers communaux, notamment dans les communes les plus rurales, là où des difficultés ne manqueront pas de se poser.
C’est un principe de réalité, madame la secrétaire d’État : il est certain que nous ferons face à une crise des vocations lors du renouvellement des communes en 2026. Comment susciter de nouveau des vocations ?
Nous sommes par exemple en train d’inventer des solutions permettant de comptabiliser des trimestres pour la retraite en cas de volontariat – nous avons d’ailleurs tous salué le volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers à l’occasion de la Sainte-Barbe.
Quelles pourraient être les pistes pour inciter nos concitoyens à siéger dans les conseils municipaux ? La revalorisation des indemnités est une bonne idée, mais elle doit être financée par l’État, car les budgets communaux sont aujourd’hui à sec et ne peuvent aller au-delà, faute de quoi les élus seront les premiers à se restreindre.
Oui à la modernisation, mais quand allons-nous sérieusement nous pencher sur le statut de l’élu ? C’est un débat que je souhaiterais que nous ayons dans les mois à venir, madame la secrétaire d’État.
… puisque celles-ci représentent 71 % des communes en France. Toutefois, une extension complète du scrutin de liste à ces communes ne va pas de soi et pose de réelles interrogations d'ordre constitutionnel.
En effet, le mode de scrutin uninominal majoritaire qui s'applique aux communes de moins de 1 000 habitants répond avant tout à un autre objectif, celui de l'expression pluraliste des opinions politiques. Si l'exigence de stricte parité n'a pas été étendue aux communes de moins de 1 000 habitants, c'est pour garantir la liberté de candidatures dans les communes dans lesquelles le nombre de candidats potentiels se trouve réduit.
Sachez que le Gouvernement poursuit avec beaucoup d'engagement sa réflexion sur l'évolution de la parité en matière électorale, en gardant à l'esprit la nécessité de préserver l'équilibre entre cet objectif de parité et le principe de pluralisme politique.
Monsieur le sénateur Belin, en matière de parité, des progrès importants ont été accomplis ces dernières années au sein des assemblées des collectivités locales.
En effet, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 a introduit deux mesures majeures : d’une part, elle crée un scrutin majoritaire binominal paritaire pour l’élection des conseillers départementaux ; d’autre part, elle abaisse le seuil du scrutin de liste paritaire pour l’élection des conseillers municipaux, permettant d’étendre ce mode de scrutin aux communes comprises entre 1 000 et 3 500 habitants.
Au lendemain des élections municipales de 2020, la proportion des femmes siégeant dans les conseils municipaux est ainsi passée à 42, 4 %, contre 39, 9 % lors du renouvellement général de 2014.
La proportion des maires femmes a elle aussi progressé, passant de 16, 9 % en 2014 à 19, 8 % en 2020. En obligeant au dépôt de listes de candidats paritaires, le scrutin de liste a fortement contribué à la féminisation des conseils municipaux.
Je pense sincèrement que l’attention que vous portez aux communes de moins de 1 000 habitants est pertinente, …

D'après l'Insee, 44 000 personnes ont été victimes d'agressions à l'arme blanche entre 2015 et 2017, soit 120 personnes par jour en moyenne. Depuis, plus aucune donnée n'a été transmise, et pour cause : les chiffres d'agressions étaient récoltés par l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), supprimé en 2020 pour être remplacé par un autre observatoire au sein du ministère de l'intérieur.
Aujourd'hui, le Gouvernement prononce toujours les mêmes mots – « rixe », « déséquilibré », « acte isolé » –, comme s'il niait la réalité ; jusqu'au garde des sceaux, qui nous a répété plusieurs fois que « la France n'est pas un coupe-gorge ».
Aussi, comme je le demande depuis 2021, aux côtés notamment de plusieurs criminologues, je souhaite connaître précisément la cartographie, les chiffres et les profils de cette violence, pour en tirer les enseignements.
… puisque celles-ci représentent 71 % des communes en France. Toutefois, une extension complète du scrutin de liste à ces communes ne va pas de soi et pose de réelles interrogations d’ordre constitutionnel.
En effet, le mode de scrutin uninominal majoritaire qui s’applique aux communes de moins de 1 000 habitants répond avant tout à un autre objectif, celui de l’expression pluraliste des opinions politiques. Si l’exigence de stricte parité n’a pas été étendue aux communes de moins de 1 000 habitants, c’est pour garantir la liberté de candidatures dans les communes dans lesquelles le nombre de candidats potentiels se trouve réduit.
Sachez que le Gouvernement poursuit avec beaucoup d’engagement sa réflexion sur l’évolution de la parité en matière électorale, en gardant à l’esprit la nécessité de préserver l’équilibre entre cet objectif de parité et le principe de pluralisme politique.
transparence sur la délinquance et la hausse des attaques au couteau
Madame la sénatrice Boyer, puisque nous sommes toutes deux élues de Marseille, je tiens à avoir une pensée émue pour Alban Gervaise, tué à l'arme blanche devant l'établissement Sévigné, ainsi que pour sa famille et ses enfants. Je me souviens que vous aviez largement évoqué ces faits à l'époque ; je veux aujourd'hui rendre mémoire à la victime.
Je connais votre engagement pour la sécurité des Marseillaises et des Marseillais, madame la sénatrice. J'en ai fait, moi aussi, un combat de chaque instant.
Les attaques commises à l'arme blanche ou par toute autre arme sont un fléau pour notre société et sa cohésion. Au-delà des attaques dues au terrorisme ou liées à des pathologies psychiatriques, le phénomène est réel et ne doit pas être sous-estimé. Les attaques particulièrement barbares commises ces derniers mois, notamment à Annecy, Arras, Crépol ou Paris, nous ont rappelé cette terrible évidence.
Cette violence a aussi rappelé la réactivité et l'engagement de nos forces de l'ordre et de nos services publics – police nationale, police municipale, pompiers, soignants –, que je tiens à remercier pour leur dévouement au quotidien et à qui j'exprime mon soutien le plus sincère.
Même si les réponses à la violence ne sont pas toutes à chercher dans l'action de la police nationale ni même dans celle de l'État, notre détermination est totale. La politique menée par le Gouvernement en matière de sécurité, qui vise à accroître la présence visible, rassurante et dissuasive des forces de l'ordre sur la voie publique, constitue l'une des réponses à ce phénomène. Cette présence sur la voie publique et dans les transports en commun sera d'ailleurs doublée d'ici à 2030.
Lutter contre les violences à l'arme blanche passe aussi par une réponse pénale efficace, effective et sévère. Depuis 2017, nous renforçons, dans des proportions exceptionnelles, les moyens alloués à la justice.
Quant aux chiffres, madame la sénatrice, le phénomène n'est pas simple à quantifier : les statistiques institutionnelles, agrégées et analysées par les services de sécurité intérieure, ne recensent pas, en tant que telles, les attaques à l'arme blanche. En effet, la qualification des infractions, telle qu'elle résulte du code pénal, ne permet pas de distinguer l'usage des armes blanches du recours à d'autres armes.
Madame la sénatrice, je puis vous assurer que nos policiers et nos gendarmes continueront à agir sans relâche sur le terrain pour garantir la sécurité de tous les Français.

La parole est à Mme Valérie Boyer, auteure de la question n° 744, adressée à M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer.

D’après l’Insee, 44 000 personnes ont été victimes d’agressions à l’arme blanche entre 2015 et 2017, soit 120 personnes par jour en moyenne. Depuis, plus aucune donnée n’a été transmise, et pour cause : les chiffres d’agressions étaient récoltés par l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), supprimé en 2020 pour être remplacé par un autre observatoire au sein du ministère de l’intérieur.
Aujourd’hui, le Gouvernement prononce toujours les mêmes mots – « rixe », « déséquilibré », « acte isolé » –, comme s’il niait la réalité ; jusqu’au garde des sceaux, qui nous a répété plusieurs fois que « la France n’est pas un coupe-gorge ».
Aussi, comme je le demande depuis 2021, aux côtés notamment de plusieurs criminologues, je souhaite connaître précisément la cartographie, les chiffres et les profils de cette violence, pour en tirer les enseignements.

Merci de votre réponse, madame la secrétaire d'État, mais ce phénomène était quantifiable par le passé et les chiffres étaient officiels. Pourquoi n'en dispose-t-on plus aujourd'hui ?
Si je vous pose cette question de vive voix, c'est parce que je n'ai obtenu aucune réponse à mes nombreuses questions écrites, alors même qu'il est absolument indispensable que nous ayons ces données.
Notre volonté de lutter contre la délinquance n'est pas à démontrer et les chiffres ne devraient pas être cachés. Aussi, madame la secrétaire d'État, je vous le redemande : pourquoi de telles données, qui étaient disponibles autrefois, ne le sont-elles plus aujourd'hui ?
Je souhaiterais vraiment que vous apportiez des précisions sur ces attaques à l'arme blanche. Les homicides et les tentatives d'homicide explosent en France. Pourquoi ne donnez-vous plus ces informations ? Les cachez-vous ? Pour quelle raison ? Je n'arrive pas à comprendre…
Je veux bien croire en votre engagement, mais aujourd'hui, seule la presse quotidienne régionale relate ces violences. Il ne s'agit pourtant pas de faits divers, mais d'un véritable phénomène de société.
Aujourd'hui, la moindre des choses serait de pouvoir disposer de données précises. Aussi, madame la secrétaire d'État, je vous le demande encore une fois : pourquoi ces données précises ne sont-elles plus collectées et transmises à la représentation nationale ?
Je le rappelle, je suis obligée de vous poser ma question dans cet hémicycle, ce matin, pour obtenir une réponse, dans la mesure où toutes mes questions écrites sont restées lettre morte. Il est anormal que l'on cache ces statistiques aux Français ! §
Madame la sénatrice Boyer, puisque nous sommes toutes deux élues de Marseille, je tiens à avoir une pensée émue pour Alban Gervaise, tué à l’arme blanche devant l’établissement Sévigné, ainsi que pour sa famille et ses enfants. Je me souviens que vous aviez largement évoqué ces faits à l’époque ; je veux aujourd’hui rendre mémoire à la victime.
Je connais votre engagement pour la sécurité des Marseillaises et des Marseillais, madame la sénatrice. J’en ai fait, moi aussi, un combat de chaque instant.
Les attaques commises à l’arme blanche ou par toute autre arme sont un fléau pour notre société et sa cohésion. Au-delà des attaques dues au terrorisme ou liées à des pathologies psychiatriques, le phénomène est réel et ne doit pas être sous-estimé. Les attaques particulièrement barbares commises ces derniers mois, notamment à Annecy, Arras, Crépol ou Paris, nous ont rappelé cette terrible évidence.
Cette violence a aussi rappelé la réactivité et l’engagement de nos forces de l’ordre et de nos services publics – police nationale, police municipale, pompiers, soignants –, que je tiens à remercier pour leur dévouement au quotidien et à qui j’exprime mon soutien le plus sincère.
Même si les réponses à la violence ne sont pas toutes à chercher dans l’action de la police nationale ni même dans celle de l’État, notre détermination est totale. La politique menée par le Gouvernement en matière de sécurité, qui vise à accroître la présence visible, rassurante et dissuasive des forces de l’ordre sur la voie publique, constitue l’une des réponses à ce phénomène. Cette présence sur la voie publique et dans les transports en commun sera d’ailleurs doublée d’ici à 2030.
Lutter contre les violences à l’arme blanche passe aussi par une réponse pénale efficace, effective et sévère. Depuis 2017, nous renforçons, dans des proportions exceptionnelles, les moyens alloués à la justice.
Quant aux chiffres, madame la sénatrice, le phénomène n’est pas simple à quantifier : les statistiques institutionnelles, agrégées et analysées par les services de sécurité intérieure, ne recensent pas, en tant que telles, les attaques à l’arme blanche. En effet, la qualification des infractions, telle qu’elle résulte du code pénal, ne permet pas de distinguer l’usage des armes blanches du recours à d’autres armes.
Madame la sénatrice, je puis vous assurer que nos policiers et nos gendarmes continueront à agir sans relâche sur le terrain pour garantir la sécurité de tous les Français.
Madame la sénatrice Boyer, puisque nous sommes toutes deux élues de Marseille, je tiens à avoir une pensée émue pour Alban Gervaise, tué à l’arme blanche devant l’établissement Sévigné, ainsi que pour sa famille et ses enfants. Je me souviens que vous aviez largement évoqué ces faits à l’époque ; je veux aujourd’hui rendre mémoire à la victime.
Je connais votre engagement pour la sécurité des Marseillaises et des Marseillais. J’en ai fait, moi aussi, un combat de chaque instant.
Les attaques commises à l’arme blanche ou par toute autre arme sont un fléau pour notre société et sa cohésion. Au-delà des attaques dues au terrorisme ou liées à des pathologies psychiatriques, le phénomène est réel et ne doit pas être sous-estimé. Les attaques particulièrement barbares commises ces derniers mois, notamment à Annecy, Arras, Crépol ou Paris, nous ont rappelé cette terrible évidence.
Cette violence a aussi rappelé la réactivité et l’engagement de nos forces de l’ordre et de nos services publics – police nationale, police municipale, pompiers, soignants –, que je tiens à remercier pour leur dévouement au quotidien et à qui j’exprime mon soutien le plus sincère.
Même si les réponses à la violence ne sont pas toutes à chercher dans l’action de la police nationale ni même dans celle de l’État, notre détermination est totale. La politique menée par le Gouvernement en matière de sécurité, qui vise à accroître la présence visible, rassurante et dissuasive des forces de l’ordre sur la voie publique, constitue l’une des réponses à ce phénomène. Cette présence sur la voie publique et dans les transports en commun sera d’ailleurs doublée d’ici à 2030.
Lutter contre les violences à l’arme blanche passe aussi par une réponse pénale efficace, effective et sévère. Depuis 2017, nous renforçons, dans des proportions exceptionnelles, les moyens alloués à la justice.
Quant aux chiffres, madame la sénatrice, le phénomène n’est pas simple à quantifier : les statistiques institutionnelles, agrégées et analysées par les services de sécurité intérieure, ne recensent pas, en tant que telles, les attaques à l’arme blanche. En effet, la qualification des infractions, telle qu’elle résulte du code pénal, ne permet pas de distinguer l’usage des armes blanches du recours à d’autres armes.
Madame la sénatrice, je puis vous assurer que nos policiers et nos gendarmes continueront à agir sans relâche sur le terrain pour garantir la sécurité de tous les Français.

Madame la secrétaire d'État, je souhaite vous interroger sur le décret du 15 septembre 2023, qui précise qu'il revient au maire de communiquer à la population les caractéristiques des risques majeurs, les mesures de prévention ou encore les modalités d'alerte et d'organisation des secours.
Si nous comprenons le principe de l'information préventive, laquelle est nécessaire pour informer la population, encore faut-il, avant de faire paraître un tel décret, s'assurer que les élus disposent des outils leur permettant de l'appliquer.
Je tiens à rappeler que les maires ne disposent même pas, à l'heure actuelle, d'une connaissance actualisée de la population résidant dans leur commune. Dans ces conditions, comment pourraient-ils lui faire parvenir des informations ?
J'interpelle régulièrement votre gouvernement ici, au Sénat, sur la nécessité pour les maires de pouvoir tenir un registre domiciliaire actualisé. Très concrètement, les nouveaux arrivants dans une commune auraient l'obligation de se déclarer en mairie.
Connaître les habitants de sa commune est indispensable pour un maire, d'autant que le nombre de personnes qui déménagent est en hausse constante.
Cette mesure est d'ailleurs en vigueur dans de nombreux États européens – où cela ne pose aucun problème –, notamment en Allemagne, en Italie, en Belgique et en Espagne, pour ne citer que ces pays.
Cette mesure de bon sens serait non seulement nécessaire dans le cadre de cette nouvelle obligation d'information, mais également indispensable aux maires si l'on veut qu'ils puissent exercer leurs missions au quotidien, anticiper les besoins de la population et les investissements à engager.
Madame la secrétaire d'État, vous rappelez constamment la nécessité d'un lien de confiance entre l'État et les élus locaux. Permettez donc aux maires de connaître leur population : ils le demandent pour exercer au mieux leurs missions et pour pouvoir mettre en application les décrets que vous publiez.
Ma question est donc simple : quand allez-vous enfin permettre aux maires de France de disposer d'un outil efficace pour connaître la population qui réside dans leur commune et, ainsi, mieux les informer ?

Merci de votre réponse, madame la secrétaire d’État, mais ce phénomène était quantifiable par le passé et les chiffres étaient officiels. Pourquoi n’en dispose-t-on plus aujourd’hui ?
Si je vous pose cette question de vive voix, c’est parce que je n’ai obtenu aucune réponse à mes nombreuses questions écrites, alors même qu’il est absolument indispensable que nous ayons ces données.
Notre volonté de lutter contre la délinquance n’est pas à démontrer et les chiffres ne devraient pas être cachés. Aussi, madame la secrétaire d’État, je vous le redemande : pourquoi de telles données, qui étaient disponibles autrefois, ne le sont-elles plus aujourd’hui ?
Je souhaiterais vraiment que vous apportiez des précisions sur ces attaques à l’arme blanche. Les homicides et les tentatives d’homicide explosent en France. Pourquoi ne donnez-vous plus ces informations ? Les cachez-vous ? Pour quelle raison ? Je n’arrive pas à comprendre…
Je veux bien croire en votre engagement, mais aujourd’hui, seule la presse quotidienne régionale relate ces violences. Il ne s’agit pourtant pas de faits divers, mais d’un véritable phénomène de société.
Aujourd’hui, la moindre des choses serait de pouvoir disposer de données précises. Aussi, madame la secrétaire d’État, je vous le demande encore une fois : pourquoi ces données précises ne sont-elles plus collectées et transmises à la représentation nationale ?
Je le rappelle, je suis obligée de vous poser ma question dans cet hémicycle, ce matin, pour obtenir une réponse, dans la mesure où toutes mes questions écrites sont restées lettre morte. Il est anormal que l’on cache ces statistiques aux Français !
Madame la sénatrice Schalck, vous interrogez le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, dont je vous prie de bien vouloir excuser l'absence et qui m'a chargé de vous répondre, sur le besoin qu'expriment les maires de connaître l'état actualisé de la population dans leur commune et les outils adaptés pour y répondre.
L'information préventive sur les risques majeurs auxquels peut être exposée la population constitue un enjeu important de la politique de prévention des risques. Cette obligation d'information de la population est aujourd'hui assez souple, puisque le maire est libre de choisir les moyens de communication les plus appropriés pour diffuser ces informations. Cette démarche peut prendre la forme de panneaux d'affichage, de réunions publiques, de sites web municipaux, de messages sur les réseaux sociaux, etc.
Je comprends le souhait que formulent les communes exposées à un risque majeur de pouvoir disposer d'un état des lieux détaillé de leur population, de telle sorte qu'elles puissent communiquer à leurs habitants les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, ainsi que les modalités d'alerte et d'organisation des secours.
Cependant, le Gouvernement n'est pas favorable à l'instauration d'une déclaration domiciliaire qui obligerait tout nouvel habitant d'une commune à déclarer son domicile à la mairie de ladite commune. Cette obligation générale de déclaration domiciliaire se traduirait par la constitution d'un fichier de données à caractère personnel, dont la conformité vis-à-vis des exigences constitutionnelles en matière de protection des libertés individuelles, notamment les principes constitutionnels de liberté d'aller et venir et de respect de la vie privée, devrait être établie.
Comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mars 2014, la création d'un traitement de données à caractère personnel doit être justifiée par un motif d'intérêt général précis et d'une importance suffisante ; elle doit de surcroît aboutir à la conciliation équilibrée du principe d'obligation de résultat et de la nécessaire protection des libertés individuelles.
Enfin, une telle obligation ferait peser une charge très lourde sur les communes, problématique à laquelle le Sénat est, je le sais, particulièrement sensible. Les communes seraient en effet contraintes de s'organiser pour recueillir les déclarations de domicile, délivrer des récépissés et tenir un registre de la population communale.
Il existe aujourd'hui un certain nombre d'outils permettant au maire de disposer des informations nécessaires sur la population de sa commune, dont les opérations de recensement réalisées par l'Insee.
obligation d’information préventive des maires à la population

Madame la secrétaire d’État, je souhaite vous interroger sur le décret du 15 septembre 2023, qui précise qu’il revient au maire de communiquer à la population les caractéristiques des risques majeurs, les mesures de prévention ou encore les modalités d’alerte et d’organisation des secours.
Si nous comprenons le principe de l’information préventive, laquelle est nécessaire pour informer la population, encore faut-il, avant de faire paraître un tel décret, s’assurer que les élus disposent des outils leur permettant de l’appliquer.
Je tiens à rappeler que les maires ne disposent même pas, à l’heure actuelle, d’une connaissance actualisée de la population résidant dans leur commune. Dans ces conditions, comment pourraient-ils lui faire parvenir des informations ?
J’interpelle régulièrement votre gouvernement ici, au Sénat, sur la nécessité pour les maires de pouvoir tenir un registre domiciliaire actualisé. Très concrètement, les nouveaux arrivants dans une commune auraient l’obligation de se déclarer en mairie.
Connaître les habitants de sa commune est indispensable pour un maire, d’autant que le nombre de personnes qui déménagent est en hausse constante.
Cette mesure est d’ailleurs en vigueur dans de nombreux États européens – où cela ne pose aucun problème –, notamment en Allemagne, en Italie, en Belgique et en Espagne, pour ne citer que ces pays.
Cette mesure de bon sens serait non seulement nécessaire dans le cadre de cette nouvelle obligation d’information, mais également indispensable aux maires si l’on veut qu’ils puissent exercer leurs missions au quotidien, anticiper les besoins de la population et les investissements à engager.
Madame la secrétaire d’État, vous rappelez constamment la nécessité d’un lien de confiance entre l’État et les élus locaux. Permettez donc aux maires de connaître leur population : ils le demandent pour exercer au mieux leurs missions et pour pouvoir mettre en application les décrets que vous publiez.
Ma question est donc simple : quand allez-vous enfin permettre aux maires de France de disposer d’un outil efficace pour connaître la population qui réside dans leur commune et, ainsi, mieux les informer ?

Madame la secrétaire d'État, les Parisiens ont pu constater ces derniers mois une augmentation du nombre des campements de sans-abri dans les rues de la capitale.
Ce phénomène s'explique en partie par la fin de la convention entre les hôtels parisiens et l'État en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, une convention qui permettait jusqu'alors la mise à disposition de places d'hébergement d'urgence au profit des sans-abri.
Malheureusement, cette situation conduit à une pénurie d'hébergements d'urgence, à laquelle s'ajoute un manque de rotation des places. Actuellement, 4 358 personnes sont sur liste d'attente, rien qu'à Paris.
Dans la capitale, cette pénurie se cumule à l'engorgement du 115, seul numéro d'urgence pour les personnes à la rue, toutes conditions confondues.
Les sans-abri vivent dans des conditions indignes et inacceptables. Les Parisiens déplorent, quant à eux, les nuisances occasionnées par les campements.
À Paris, pour expulser légalement une personne de sa tente, le secrétariat général de la ville doit lui demander son accord préalable et établir une liste de « motifs aggravants ». Or les critères sont flous et les campements dans les arrondissements parisiens sont traités de manière inéquitable.
Les maires d'arrondissement, qui sont en première ligne pour prendre en charge les sans-abri, se trouvent ainsi dépourvus de moyens.
Madame la secrétaire d'État, le Gouvernement entend-il définir une procédure plus rapide et plus efficace pour lutter contre ce phénomène, en faisant notamment en sorte de mettre les maires d'arrondissement au cœur des procédures de décision ?
Madame la sénatrice Schalck, vous interrogez le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, dont je vous prie de bien vouloir excuser l’absence et qui m’a chargé de vous répondre, sur le besoin qu’expriment les maires de connaître l’état actualisé de la population dans leur commune et les outils adaptés pour y répondre.
L’information préventive sur les risques majeurs auxquels peut être exposée la population constitue un enjeu important de la politique de prévention des risques. Cette obligation d’information de la population est aujourd’hui assez souple, puisque le maire est libre de choisir les moyens de communication les plus appropriés pour diffuser ces informations. Cette démarche peut prendre la forme de panneaux d’affichage, de réunions publiques, de sites web municipaux, de messages sur les réseaux sociaux, etc.
Je comprends le souhait que formulent les communes exposées à un risque majeur de pouvoir disposer d’un état des lieux détaillé de leur population, de telle sorte qu’elles puissent communiquer à leurs habitants les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, ainsi que les modalités d’alerte et d’organisation des secours.
Cependant, le Gouvernement n’est pas favorable à l’instauration d’une déclaration domiciliaire qui obligerait tout nouvel habitant d’une commune à déclarer son domicile à la mairie de ladite commune. Cette obligation générale de déclaration domiciliaire se traduirait par la constitution d’un fichier de données à caractère personnel, dont la conformité vis-à-vis des exigences constitutionnelles en matière de protection des libertés individuelles, notamment les principes constitutionnels de liberté d’aller et venir et de respect de la vie privée, devrait être établie.
Comme l’a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mars 2014, la création d’un traitement de données à caractère personnel doit être justifiée par un motif d’intérêt général précis et d’une importance suffisante ; elle doit de surcroît aboutir à la conciliation équilibrée du principe d’obligation de résultat et de la nécessaire protection des libertés individuelles.
Enfin, une telle obligation ferait peser une charge très lourde sur les communes, problématique à laquelle le Sénat est, je le sais, particulièrement sensible. Les communes seraient en effet contraintes de s’organiser pour recueillir les déclarations de domicile, délivrer des récépissés et tenir un registre de la population communale.
Il existe aujourd’hui un certain nombre d’outils permettant au maire de disposer des informations nécessaires sur la population de sa commune, dont les opérations de recensement réalisées par l’Insee.
Madame la sénatrice Dumas, depuis le début de l'année 2023, les services de la préfecture de police ont recensé 276 implantations à Paris, allant de la tente isolée à des campements plus importants comprenant des abris précaires regroupant des migrants ou des personnes de la communauté rom. Sur ces sites, occupés par 1 167 personnes, on a recensé 602 tentes et 180 abris.
Le dispositif d'hébergement d'urgence mis en place en région parisienne relève de la compétence de la préfecture de Paris, conformément à l'article L.121-7 du code de l'action sociale et des familles. La préfecture de police intervient à la demande de l'autorité judiciaire, afin de prêter le concours de la force publique dans le cadre d'opérations d'évacuation de campements illicites.
Il convient de noter que les services de police restent systématiquement mobilisés et assurent la surveillance quotidienne des lieux évacués pour détecter toute nouvelle implantation.
Nous constatons aujourd'hui des situations dégradées, tant au regard des conditions de vie que des troubles à l'ordre public occasionnés dans le voisinage, ce qui a conduit les services de l'État à organiser des opérations de mise à l'abri. Ainsi, depuis le début de l'année 2023, 5 973 personnes, dont 4 251 hommes isolés et 1 271 personnes en famille, ont été prises en charge par les services de l'État lors de trente-deux opérations de mise à l'abri.
Le 20 juin dernier, le Gouvernement a lancé le deuxième plan Logement d'abord, qui vise à créer et à mettre à disposition des logements adaptés et abordables pour les ménages en grande précarité. Dans ce cadre, 25 000 nouveaux logements en résidence sociale et en foyer de jeunes travailleurs seront agréés. Par ailleurs, 30 000 nouvelles places louées par des associations ou des organismes agréés d'intermédiation locative et 10 000 nouvelles places en pension de famille seront ouvertes.
Le deuxième plan Logement d'abord a également pour but de conforter le maintien dans le logement, de prévenir les ruptures et d'éviter la dégradation des situations.
augmentation des campements de sans-abri à paris

La parole est à Mme Catherine Dumas, auteure de la question n° 880, adressée à M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Merci pour cette réponse chiffrée et détaillée, madame la secrétaire d'État. Je tiens à avoir une pensée particulière pour les habitants de la rue Fructidor et de l'avenue de la Porte-de-Clichy, dans le XVIIe arrondissement de Paris, qui subissent des nuisances depuis de nombreux mois et qui attendent avec impatience une réaction de l'État.
Je vous le redis, madame la secrétaire d'État : appuyez-vous sur les maires d'arrondissement pour lutter contre ce phénomène.

Madame la secrétaire d’État, les Parisiens ont pu constater ces derniers mois une augmentation du nombre des campements de sans-abri dans les rues de la capitale.
Ce phénomène s’explique en partie par la fin de la convention entre les hôtels parisiens et l’État en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, une convention qui permettait jusqu’alors la mise à disposition de places d’hébergement d’urgence au profit des sans-abri.
Malheureusement, cette situation conduit à une pénurie d’hébergements d’urgence, à laquelle s’ajoute un manque de rotation des places. Actuellement, 4 358 personnes sont sur liste d’attente, rien qu’à Paris.
Dans la capitale, cette pénurie se cumule à l’engorgement du 115, seul numéro d’urgence pour les personnes à la rue, toutes conditions confondues.
Les sans-abri vivent dans des conditions indignes et inacceptables. Les Parisiens déplorent, quant à eux, les nuisances occasionnées par les campements.
À Paris, pour expulser légalement une personne de sa tente, le secrétariat général de la ville doit lui demander son accord préalable et établir une liste de « motifs aggravants ». Or les critères sont flous et les campements dans les arrondissements parisiens sont traités de manière inéquitable.
Les maires d’arrondissement, qui sont en première ligne pour prendre en charge les sans-abri, se trouvent ainsi dépourvus de moyens.
Madame la secrétaire d’État, le Gouvernement entend-il définir une procédure plus rapide et plus efficace pour lutter contre ce phénomène, en faisant notamment en sorte de mettre les maires d’arrondissement au cœur des procédures de décision ?
Madame la sénatrice Dumas, depuis le début de l’année 2023, les services de la préfecture de police ont recensé 276 implantations à Paris, allant de la tente isolée à des campements plus importants comprenant des abris précaires regroupant des migrants ou des personnes de la communauté rom. Sur ces sites, occupés par 1 167 personnes, on a recensé 602 tentes et 180 abris.
Le dispositif d’hébergement d’urgence mis en place en région parisienne relève de la compétence de la préfecture de Paris, conformément à l’article L.121-7 du code de l’action sociale et des familles. La préfecture de police intervient à la demande de l’autorité judiciaire, afin de prêter le concours de la force publique dans le cadre d’opérations d’évacuation de campements illicites.
Il convient de noter que les services de police restent systématiquement mobilisés et assurent la surveillance quotidienne des lieux évacués pour détecter toute nouvelle implantation.
Nous constatons aujourd’hui des situations dégradées, tant au regard des conditions de vie que des troubles à l’ordre public occasionnés dans le voisinage, ce qui a conduit les services de l’État à organiser des opérations de mise à l’abri. Ainsi, depuis le début de l’année 2023, 5 973 personnes, dont 4 251 hommes isolés et 1 271 personnes en famille, ont été prises en charge par les services de l’État lors de trente-deux opérations de mise à l’abri.
Le 20 juin dernier, le Gouvernement a lancé le deuxième plan Logement d’abord, qui vise à créer et à mettre à disposition des logements adaptés et abordables pour les ménages en grande précarité. Dans ce cadre, 25 000 nouveaux logements en résidence sociale et en foyer de jeunes travailleurs seront agréés. Par ailleurs, 30 000 nouvelles places louées par des associations ou des organismes agréés d’intermédiation locative et 10 000 nouvelles places en pension de famille seront ouvertes.
Le deuxième plan Logement d’abord a également pour but de conforter le maintien dans le logement, de prévenir les ruptures et d’éviter la dégradation des situations.
Madame la sénatrice Dumas, depuis le début de l’année 2023, les services de la préfecture de police ont recensé 276 implantations à Paris, allant de la tente isolée à des campements plus importants comprenant des abris précaires regroupant des migrants ou des personnes de la communauté rom. Sur ces sites, occupés par 1 167 personnes, on a recensé 602 tentes et 180 abris.
Le dispositif d’hébergement d’urgence mis en place en région parisienne relève de la compétence de la préfecture de Paris, conformément à l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles. La préfecture de police intervient à la demande de l’autorité judiciaire, afin de prêter le concours de la force publique dans le cadre d’opérations d’évacuation de campements illicites.
Il convient de noter que les services de police restent systématiquement mobilisés et assurent la surveillance quotidienne des lieux évacués pour détecter toute nouvelle implantation.
Nous constatons aujourd’hui des situations dégradées, tant au regard des conditions de vie que des troubles à l’ordre public occasionnés dans le voisinage, ce qui a conduit les services de l’État à organiser des opérations de mise à l’abri. Ainsi, depuis le début de l’année 2023, 5 973 personnes, dont 4 251 hommes isolés et 1 271 personnes en famille, ont été prises en charge par les services de l’État lors de trente-deux opérations de mise à l’abri.
Le 20 juin dernier, le Gouvernement a lancé le deuxième plan Logement d’abord, qui vise à créer et à mettre à disposition des logements adaptés et abordables pour les ménages en grande précarité. Dans ce cadre, 25 000 nouveaux logements en résidence sociale et en foyer de jeunes travailleurs seront agréés. Par ailleurs, 30 000 nouvelles places louées par des associations ou des organismes agréés d’intermédiation locative et 10 000 nouvelles places en pension de famille seront ouvertes.
Le deuxième plan Logement d’abord a également pour but de conforter le maintien dans le logement, de prévenir les ruptures et d’éviter la dégradation des situations.

Une équipe de journalistes d'investigation vient de démontrer, dans la série documentaire Vert de Rage, que tous les sapeurs-pompiers français étaient exposés aux retardateurs de flammes, ces substances reconnues comme reprotoxiques et cancérigènes, et ce à des niveaux tels qu'il est indispensable d'étudier le lien entre l'exposition professionnelle à ces substances et les maladies recensées.
Dès 2003, l'alerte avait pourtant été donnée. En effet, un rapport remis au ministre de l'intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, concluait à la nécessité de mettre en place une véritable veille sanitaire des sapeurs-pompiers, en vue d'élaborer une politique de prévention efficace. Mais, vingt ans plus tard, aucune étude épidémiologique, aucun effort de suivi médical coordonné n'a été mis en œuvre.
En juin 2022, le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé a publié une étude précisant qu'il existait suffisamment de preuves chez l'homme pour établir la cancérogénicité de l'exposition professionnelle des pompiers. Cette étude a ainsi établi un lien entre l'exposition professionnelle des pompiers et le mésothéliome ou le cancer de la vessie.
Comme vous le voyez, les études et les alertes ne manquent pas.
Pour autant, aujourd'hui en France, seul un type de cancer, le carcinome du nasopharynx, est reconnu comme étant lié à l'exposition à la fumée des incendies. Aux États-Unis, jusqu'à vingt-huit cancers sont reconnus comme maladie professionnelle. Au Canada, il y en a dix-neuf, en Australie douze.
Comment expliquer une telle différence ? Les pompiers français ne sont-ils pas exposés aux mêmes risques ? Les considère-t-on dans notre pays comme des surhommes ?
Agnès Buzyn, ancienne ministre de la santé, avait annoncé la révision du tableau des maladies professionnelles. Qui plus est, la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) est chroniquement excédentaire – j'imagine que, pour la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), il en est de même.
Alors, madame la secrétaire d'État, quelles mesures comptez-vous adopter pour, enfin, favoriser la reconnaissance des maladies professionnelles, la prévention et le suivi de la santé de nos sapeurs-pompiers professionnels comme volontaires ?

Merci pour cette réponse chiffrée et détaillée, madame la secrétaire d’État. Je tiens à avoir une pensée particulière pour les habitants de la rue Fructidor et de l’avenue de la Porte-de-Clichy, dans le XVIIe arrondissement de Paris, qui subissent des nuisances depuis de nombreux mois et qui attendent avec impatience une réaction de l’État.
Je vous le redis, madame la secrétaire d’État : appuyez-vous sur les maires d’arrondissement pour lutter contre ce phénomène.
Madame la sénatrice Poumirol, dans le cadre de leur mission, les sapeurs-pompiers sont en effet exposés à de nombreux risques. S'agissant de la toxicité des fumées, composées à la fois de gaz et de particules, cette exposition est bien identifiée et prise en compte au travers de plusieurs dispositifs.
Les sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, sont soumis à des conditions d'aptitude physique et médicale particulières et suivis par une médecine d'aptitude lors de leur entrée en fonction et tout au long de leur carrière ou engagement.
Le contrôle de l'aptitude des sapeurs-pompiers est défini par l'arrêté du 6 mai 2000, dont la refonte fait actuellement l'objet d'une réflexion. L'enjeu est que la pratique s'adapte aux évolutions de la médecine, notamment pour tenir compte, au travers de dépistages, des risques de cancer.
En fin de carrière, le décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 ouvre droit à un suivi médical post-professionnel pour les agents de la fonction publique territoriale, incluant les sapeurs-pompiers professionnels, qui en bénéficient après la cessation définitive de leurs fonctions. Ce suivi est pris en charge par les services départementaux d'incendie et de secours (Sdis).
Par ailleurs, les Sdis ont mis en place différentes mesures de prévention collective et individuelle : d'une part, chaque procédure d'intervention peut donner lieu à un soutien en matière de santé ; d'autre part, les sapeurs-pompiers disposent d'équipements de protection individuelle, comme l'appareil respiratoire isolant pour la protection des voies respiratoires.
Au-delà des études menées par le Centre international de recherche sur le cancer, de nombreux travaux de recherche sont effectués à l'échelle nationale, notamment par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'intérieur. Ces travaux devraient permettre d'établir plus précisément le lien éventuel entre les risques professionnels auxquels sont exposés les sapeurs-pompiers et l'apparition des maladies.
reconnaissance des cancers comme maladies professionnelles chez les sapeurs-pompiers

La parole est à Mme Émilienne Poumirol, auteure de la question n° 960, adressée à M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Merci, madame la secrétaire d'État. Je sais bien qu'il existe un suivi des sapeurs-pompiers par la médecine d'aptitude, qui se poursuit même à l'issue de leur carrière. Mais, en l'occurrence, je m'étonne qu'en France il n'y ait jamais eu de reconnaissance des maladies professionnelles des sapeurs-pompiers en raison de leur exposition professionnelle – c'est ce que nous demandons.
Vous avez évoqué les études du Centre international de recherche sur le cancer : celles-ci ont démontré qu'il existe un lien étroit entre les fumées et les maladies des pompiers ; pourquoi ce lien serait-il reconnu aux États-Unis, au Canada ou en Australie, mais pas en France ?
Il n'est plus temps de tergiverser : il faut désormais mettre en place cette reconnaissance pour les plus de 2 000 sapeurs-pompiers qui seraient concernés en France.
J'ai été moi-même confrontée, en tant que présidente de Sdis, mais aussi en tant que médecin, à un certain nombre de cas, dans lesquels il est impossible de faire jouer cette reconnaissance, parce que les pathologies ne sont pas inscrites au tableau des maladies professionnelles.

Une équipe de journalistes d’investigation vient de démontrer, dans la série documentaire Vert de Rage, que tous les sapeurs-pompiers français étaient exposés aux retardateurs de flammes, ces substances reconnues comme reprotoxiques et cancérigènes, et ce à des niveaux tels qu’il est indispensable d’étudier le lien entre l’exposition professionnelle à ces substances et les maladies recensées.
Dès 2003, l’alerte avait pourtant été donnée. En effet, un rapport remis au ministre de l’intérieur de l’époque, Nicolas Sarkozy, concluait à la nécessité de mettre en place une véritable veille sanitaire des sapeurs-pompiers, en vue d’élaborer une politique de prévention efficace. Mais, vingt ans plus tard, aucune étude épidémiologique, aucun effort de suivi médical coordonné n’a été mis en œuvre.
En juin 2022, le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé a publié une étude précisant qu’il existait suffisamment de preuves chez l’homme pour établir la cancérogénicité de l’exposition professionnelle des pompiers. Cette étude a ainsi établi un lien entre l’exposition professionnelle des pompiers et le mésothéliome ou le cancer de la vessie.
Comme vous le voyez, les études et les alertes ne manquent pas.
Pour autant, aujourd’hui en France, seul un type de cancer, le carcinome du nasopharynx, est reconnu comme étant lié à l’exposition à la fumée des incendies. Aux États-Unis, jusqu’à vingt-huit cancers sont reconnus comme maladie professionnelle. Au Canada, il y en a dix-neuf, en Australie douze.
Comment expliquer une telle différence ? Les pompiers français ne sont-ils pas exposés aux mêmes risques ? Les considère-t-on dans notre pays comme des surhommes ?
Agnès Buzyn, ancienne ministre de la santé, avait annoncé la révision du tableau des maladies professionnelles. Qui plus est, la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) est chroniquement excédentaire – j’imagine que, pour la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), il en est de même.
Alors, madame la secrétaire d’État, quelles mesures comptez-vous adopter pour, enfin, favoriser la reconnaissance des maladies professionnelles, la prévention et le suivi de la santé de nos sapeurs-pompiers professionnels comme volontaires ?

Une équipe de journalistes d’investigation vient de démontrer, dans la série documentaire Vert de Rage, que tous les sapeurs-pompiers français étaient exposés aux retardateurs de flammes, ces substances reconnues comme reprotoxiques et cancérigènes, et ce à des niveaux tels qu’il est indispensable d’étudier le lien entre l’exposition professionnelle à ces substances et les maladies recensées.
Dès 2003, l’alerte avait pourtant été donnée. En effet, un rapport remis au ministre de l’intérieur de l’époque, Nicolas Sarkozy, concluait à la nécessité de mettre en place une véritable veille sanitaire des sapeurs-pompiers, en vue d’élaborer une politique de prévention efficace. Mais, vingt ans plus tard, aucune étude épidémiologique, aucun effort de suivi médical coordonné n’a été mis en œuvre.
En juin 2022, le Centre international de recherche sur le cancer de l’Organisation mondiale de la santé a publié une étude précisant qu’il existait suffisamment de preuves chez l’homme pour établir la cancérogénicité de l’exposition professionnelle des pompiers. Cette étude a ainsi établi un lien entre l’exposition professionnelle des pompiers et le mésothéliome ou le cancer de la vessie.
Comme vous le voyez, les études et les alertes ne manquent pas.
Cela étant, aujourd’hui en France, seul un type de cancer, le carcinome du nasopharynx, est reconnu comme étant lié à l’exposition à la fumée des incendies. Aux États-Unis, jusqu’à vingt-huit cancers sont reconnus comme maladie professionnelle. Au Canada, il y en a dix-neuf, en Australie douze.
Comment expliquer une telle différence ? Les pompiers français ne sont-ils pas exposés aux mêmes risques ? Les considère-t-on dans notre pays comme des surhommes ?
Agnès Buzyn, ancienne ministre de la santé, avait annoncé la révision du tableau des maladies professionnelles. Qui plus est, la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) est chroniquement excédentaire – j’imagine que, pour la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), il en est de même.
Alors, madame la secrétaire d’État, quelles mesures comptez-vous adopter pour, enfin, favoriser la reconnaissance des maladies professionnelles, la prévention et le suivi de la santé de nos sapeurs-pompiers professionnels comme volontaires ?
Madame la sénatrice Poumirol, dans le cadre de leur mission, les sapeurs-pompiers sont en effet exposés à de nombreux risques. S’agissant de la toxicité des fumées, composées à la fois de gaz et de particules, cette exposition est bien identifiée et prise en compte au travers de plusieurs dispositifs.
Les sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, sont soumis à des conditions d’aptitude physique et médicale particulières et suivis par une médecine d’aptitude lors de leur entrée en fonction et tout au long de leur carrière ou engagement.
Le contrôle de l’aptitude des sapeurs-pompiers est défini par l’arrêté du 6 mai 2000, dont la refonte fait actuellement l’objet d’une réflexion. L’enjeu est que la pratique s’adapte aux évolutions de la médecine, notamment pour tenir compte, au travers de dépistages, des risques de cancer.
En fin de carrière, le décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 ouvre droit à un suivi médical post-professionnel pour les agents de la fonction publique territoriale, incluant les sapeurs-pompiers professionnels, qui en bénéficient après la cessation définitive de leurs fonctions. Ce suivi est pris en charge par les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis).
Par ailleurs, les Sdis ont mis en place différentes mesures de prévention collective et individuelle : d’une part, chaque procédure d’intervention peut donner lieu à un soutien en matière de santé ; d’autre part, les sapeurs-pompiers disposent d’équipements de protection individuelle, comme l’appareil respiratoire isolant pour la protection des voies respiratoires.
Au-delà des études menées par le Centre international de recherche sur le cancer, de nombreux travaux de recherche sont effectués à l’échelle nationale, notamment par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l’intérieur. Ces travaux devraient permettre d’établir plus précisément le lien éventuel entre les risques professionnels auxquels sont exposés les sapeurs-pompiers et l’apparition des maladies.

La localisation stratégique de la Haute-Savoie au carrefour de la Suisse et de l'Italie attire chaque année de nombreux groupes de la communauté des gens du voyage, dont une part non négligeable s'installe sur des terrains, privés comme publics, en toute illégalité.
Ces implantations entraînent systématiquement leur lot de nuisances et de dégradations à répétition et grèvent lourdement le budget des communes concernées. Les conséquences sont également catastrophiques pour de nombreuses entreprises, dont l'activité est entravée par l'occupation de leurs terrains et l'immobilisation de leur outil de travail.
Si la Haute-Savoie attire autant, c'est aussi parce qu'il semblerait que les membres de ces communautés parviennent facilement à se faire délivrer des patentes helvètes par les autorités genevoises, ce qui leur permet d'exercer leur activité sur le territoire suisse. En outre, il semblerait que ces autorisations leur permettent d'obtenir des plaques d'immatriculation suisses, qui rendent leur verbalisation et leur expulsion beaucoup plus difficiles.
L'étrange facilité avec laquelle les patentes leur sont délivrées crée un véritable appel d'air pour ces communautés, fortement attirées par l'eldorado suisse.
Le canton de Genève n'ayant aucune obligation légale de construire des aires d'accueil ou de grand passage, au contraire des communes de Haute-Savoie, ces communautés repassent chaque soir la frontière pour élire domicile, de façon régulière ou irrégulière, dans mon département.
Nous ne sommes évidemment pas contre le fait que le canton de Genève les autorise à travailler sur son territoire, mais nous appelons nos amis suisses à loger ces communautés en mettant à leur disposition des aires d'accueil, comme en France.
La pression exercée par cet afflux de gens du voyage devenant totalement ingérable en Haute-Savoie, je souhaiterais connaître les actions que le gouvernement français entend engager, en lien avec son homologue suisse, pour mettre un terme à ces pratiques.

Merci, madame la secrétaire d’État. Je sais bien qu’il existe un suivi des sapeurs-pompiers par la médecine d’aptitude, qui se poursuit même à l’issue de leur carrière. Mais, en l’occurrence, je m’étonne qu’en France il n’y ait jamais eu de reconnaissance des maladies professionnelles des sapeurs-pompiers en raison de leur exposition professionnelle – c’est ce que nous demandons.
Vous avez évoqué les études du Centre international de recherche sur le cancer : celles-ci ont démontré qu’il existe un lien étroit entre les fumées et les maladies des pompiers ; pourquoi ce lien serait-il reconnu aux États-Unis, au Canada ou en Australie, mais pas en France ?
Il n’est plus temps de tergiverser : il faut désormais mettre en place cette reconnaissance pour les plus de 2 000 sapeurs-pompiers qui seraient concernés en France.
J’ai été moi-même confrontée, en tant que présidente de Sdis, mais aussi en tant que médecin, à un certain nombre de cas, dans lesquels il est impossible de faire jouer cette reconnaissance, parce que les pathologies ne sont pas inscrites au tableau des maladies professionnelles.
Madame la sénatrice Noël, en 2021, le préfet de la Haute-Savoie a procédé à 45 mises en demeure de quitter les lieux à l'endroit de groupes de gens du voyage installés de manière illicite. Il en a adressé 20 en 2022 et 74 depuis le début de l'année 2023.
Plus du tiers des arrêtés pris cette année concerne un seul et même groupe semi-sédentarisé bien connu des services de police et de gendarmerie. Ce groupe, souvent réparti sur plusieurs sites et constitué au total de près de 250 caravanes, va d'occupations illicites en occupations illicites le long de l'arc lémanique, leur parcours s'accompagnant d'incivilités, d'agressions, de dégradations et d'atteintes à la salubrité publique.
L'augmentation des mises en demeure prises par le préfet part d'une volonté assumée de s'appuyer sur toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour faire cesser les nuisances occasionnées par ce groupe familial.
C'est ainsi que, régulièrement, les forces de l'ordre effectuent des contrôles de véhicules et d'attelages, verbalisent et procèdent à des saisies.
Certains de ces véhicules sont immatriculés en Suisse. Lorsqu'ils sont verbalisés pour une infraction à la police de la route, ils font l'objet d'une identification partagée avec les services de police suisses, qui se joignent parfois aux contrôles réalisés par les forces de l'ordre françaises sur les installations illicites.
Le Gouvernement a pleinement conscience de la nécessité d'approfondir davantage la coopération avec les autorités genevoises. Il souhaite examiner avec elles les conditions de délivrance et de retrait des patentes.
Ce point a d'ailleurs été évoqué le jeudi 14 décembre 2023 lors du comité régional franco-genevois, coprésidé par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le président du Conseil d'État du canton de Genève, et sera inscrit à l'ordre du jour du prochain comité prévu au printemps 2024.
recrudescence d’occupations illicites de membres se revendiquant de la communauté des gens du voyage en haute-savoie

La parole est à Mme Sylviane Noël, auteure de la question n° 884, transmise à M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Madame la secrétaire d'État, je vous remercie de ces éléments de réponse et je me réjouis que cette question soit à l'ordre du jour.
Vous avez rappelé la nature des difficultés que nous rencontrons avec un groupe précis, dont les membres ne doivent plus être considérés comme des gens du voyage, car ils n'en ont plus aucune caractéristique. Nous devons réellement sévir à leur encontre.
Je le rappelle, voilà un an, devant les maires des communes de Haute-Savoie, le ministre Darmanin a pris l'engagement, très fort, de faire évoluer la loi relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dite loi Besson, dont nous constatons chaque jour les limites et les failles.
Nous en avons grandement besoin pour éviter qu'un drame n'ait lieu.

La localisation stratégique de la Haute-Savoie au carrefour de la Suisse et de l’Italie attire chaque année de nombreux groupes de la communauté des gens du voyage, dont une part non négligeable s’installe sur des terrains, privés comme publics, en toute illégalité.
Ces implantations entraînent systématiquement leur lot de nuisances et de dégradations à répétition et grèvent lourdement le budget des communes concernées. Les conséquences sont également catastrophiques pour de nombreuses entreprises, dont l’activité est entravée par l’occupation de leurs terrains et l’immobilisation de leur outil de travail.
Si la Haute-Savoie attire autant, c’est aussi parce qu’il semblerait que les membres de ces communautés parviennent facilement à se faire délivrer des patentes helvètes par les autorités genevoises, ce qui leur permet d’exercer leur activité sur le territoire suisse. En outre, il semblerait que ces autorisations leur permettent d’obtenir des plaques d’immatriculation suisses, qui rendent leur verbalisation et leur expulsion beaucoup plus difficiles.
L’étrange facilité avec laquelle les patentes leur sont délivrées crée un véritable appel d’air pour ces communautés, fortement attirées par l’eldorado suisse.
Le canton de Genève n’ayant aucune obligation légale de construire des aires d’accueil ou de grand passage, au contraire des communes de Haute-Savoie, ces communautés repassent chaque soir la frontière pour élire domicile, de façon régulière ou irrégulière, dans mon département.
Nous ne sommes évidemment pas contre le fait que le canton de Genève les autorise à travailler sur son territoire, mais nous appelons nos amis suisses à loger ces communautés en mettant à leur disposition des aires d’accueil, comme en France.
La pression exercée par cet afflux de gens du voyage devenant totalement ingérable en Haute-Savoie, je souhaiterais connaître les actions que le gouvernement français entend engager, en lien avec son homologue suisse, pour mettre un terme à ces pratiques.
Madame la sénatrice Noël, en 2021, le préfet de la Haute-Savoie a procédé à 45 mises en demeure de quitter les lieux à l’endroit de groupes de gens du voyage installés de manière illicite. Il en a adressé 20 en 2022 et 74 depuis le début de l’année 2023.
Plus du tiers des arrêtés pris cette année concerne un seul et même groupe semi-sédentarisé bien connu des services de police et de gendarmerie. Ce groupe, souvent réparti sur plusieurs sites et constitué au total de près de 250 caravanes, va d’occupations illicites en occupations illicites le long de l’arc lémanique, leur parcours s’accompagnant d’incivilités, d’agressions, de dégradations et d’atteintes à la salubrité publique.
L’augmentation des mises en demeure prises par le préfet part d’une volonté assumée de s’appuyer sur toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour faire cesser les nuisances occasionnées par ce groupe familial.
C’est ainsi que, régulièrement, les forces de l’ordre effectuent des contrôles de véhicules et d’attelages, verbalisent et procèdent à des saisies.
Certains de ces véhicules sont immatriculés en Suisse. Lorsqu’ils sont verbalisés pour une infraction à la police de la route, ils font l’objet d’une identification partagée avec les services de police suisses, qui se joignent parfois aux contrôles réalisés par les forces de l’ordre françaises sur les installations illicites.
Le Gouvernement a pleinement conscience de la nécessité d’approfondir davantage la coopération avec les autorités genevoises. Il souhaite examiner avec elles les conditions de délivrance et de retrait des patentes.
Ce point a d’ailleurs été évoqué le jeudi 14 décembre 2023 lors du comité régional franco-genevois, coprésidé par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le président du Conseil d’État du canton de Genève, et sera inscrit à l’ordre du jour du prochain comité prévu au printemps 2024.

Madame la secrétaire d'État, mille, c'est le nombre de camions qui défilent, chaque jour, dans certains villages de mon département de l'Oise.
Or nombre d'élus et de riverains ne supportent plus les nuisances liées aux passages incessants des poids lourds dans leurs communes et dénoncent cette situation devenue invivable qu'ils comparent au Grand Prix de Monaco ou à tout autre rallye automobile.
Ils se sentent souvent démunis et nombre d'entre eux me saisissent afin de demander le concours de l'État et des collectivités pour la mise en place de davantage de contrôles visant à faire respecter les arrêtés d'interdiction de circulation et les déviations ou encore pour l'installation d'un radar ou de ralentisseurs afin de briser la vitesse excessive des véhicules.
Certes, le conseil départemental de l'Oise publiera, dans les prochains mois, une charte de bonne conduite à destination des transporteurs, mais je doute que cette initiative résolve le problème.
En effet, ce trafic, qui s'explique notamment par la situation géographique centrale du territoire et l'installation de nombreuses plateformes logistiques, mais qui dépasse les limites du raisonnable, a trois principales conséquences.
La première d'entre elles a trait à la santé de nos administrés. Ces nuisances sonores ont un effet sur la qualité de vie dans nos communes et entraînent une augmentation de la pollution de l'air.
La deuxième conséquence concerne la sécurité routière. En effet, la hausse du nombre d'accidents de la route est manifeste. L'accident survenu le 12 décembre dernier, à Verberie, en est la preuve : un conducteur a percuté un poteau électrique, provoquant une coupure de courant, avant de tenter de s'enfuir.
Enfin, la troisième conséquence, et non la moindre, est la détérioration importante de nos infrastructures routières provoquée par le passage des poids lourds, alors que nous connaissons les contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités locales.
Madame la secrétaire d'État, loin d'une image d'Épinal, les habitants de certaines communes de l'Oise entendent non plus les oiseaux chanter, mais uniquement les moteurs vrombir, parce que des entreprises, peu scrupuleuses, veulent économiser le prix du péage. Ces habitants doivent être entendus et leurs élus, davantage accompagnés.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de ces éléments de réponse et je me réjouis que cette question soit à l’ordre du jour.
Vous avez rappelé la nature des difficultés que nous rencontrons avec un groupe précis, dont les membres ne doivent plus être considérés comme des gens du voyage, car ils n’en ont plus aucune caractéristique. Nous devons réellement sévir à leur encontre.
Je le rappelle, voilà un an, devant les maires des communes de Haute-Savoie, le ministre Darmanin a pris l’engagement, très fort, de faire évoluer la loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dite loi Besson, dont nous constatons chaque jour les limites et les failles.
Nous en avons grandement besoin pour éviter qu’un drame n’ait lieu.
Monsieur le sénateur Courtial, le maire chargé de la police de la circulation se trouve souvent en position d'arbitre. Aux termes des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, réglementer la circulation sur les voies de l'agglomération. Il peut notamment interdire l'accès aux poids lourds de voies, de portions de voies ou encore de secteurs de la commune.
Pour autant, le droit français posant comme principe que la liberté est la règle et la restriction de police l'exception, le juge administratif a fixé les conditions de légalité de tels arrêtés : un maire ne peut donc interdire, de manière permanente, la circulation des poids lourds dans l'ensemble de l'agglomération.
En revanche, il est fondé, sur la base de l'article L. 2213–2 du même code, à édicter des mesures restrictives motivées par des circonstances précises, dont il n'existe toutefois pas d'énumération exhaustive.
Dans ce cadre, la gendarmerie a relevé, dans le département de l'Oise, 301 infractions aux restrictions de circulation en 2021 et 349 en 2022, soit une hausse de 16 %, puis 598 infractions en 2023, soit une augmentation de 71 %.
L'activité de coordination des transports, à savoir le contrôle des poids lourds, représentait pour la gendarmerie de l'Oise 1 570 heures de service en 2021, avant d'atteindre 1 820 heures en 2022, soit une hausse de 16 %, et 2 670 heures en 2023, soit une augmentation de 47 %.
La vidéoverbalisation autorise aujourd'hui les policiers municipaux et les gardes champêtres à constater les infractions sans interception, après visionnage des images.
Le ministère de l'intérieur a d'ores et déjà engagé le processus pour opérer les modifications réglementaires nécessaires. Il s'agit, d'une part, d'étendre le périmètre des infractions constatables sans interception, recensées à l'article R. 121-6 du code de la route, aux interdictions et aux restrictions de circulation prévues par la réglementation sur le poids des véhicules ; d'autre part, d'élargir l'accès des policiers municipaux au système d'immatriculation des véhicules, afin que ces derniers puissent obtenir les données relatives à la catégorie des véhicules.
circulation des poids lourds dans les villages de l’oise

Madame la secrétaire d’État, mille, c’est le nombre de camions qui défilent, chaque jour, dans certains villages de mon département de l’Oise.
Or nombre d’élus et de riverains ne supportent plus les nuisances liées aux passages incessants des poids lourds dans leurs communes et dénoncent cette situation devenue invivable qu’ils comparent au Grand Prix de Monaco ou à tout autre rallye automobile.
Ils se sentent souvent démunis et nombre d’entre eux me saisissent afin de demander le concours de l’État et des collectivités pour la mise en place de davantage de contrôles visant à faire respecter les arrêtés d’interdiction de circulation et les déviations ou encore pour l’installation d’un radar ou de ralentisseurs afin de briser la vitesse excessive des véhicules.
Certes, le conseil départemental de l’Oise publiera, dans les prochains mois, une charte de bonne conduite à destination des transporteurs, mais je doute que cette initiative résolve le problème.
En effet, ce trafic, qui s’explique notamment par la situation géographique centrale du territoire et l’installation de nombreuses plateformes logistiques, mais qui dépasse les limites du raisonnable, a trois principales conséquences.
La première d’entre elles a trait à la santé de nos administrés. Ces nuisances sonores ont un effet sur la qualité de vie dans nos communes et entraînent une augmentation de la pollution de l’air.
La deuxième conséquence concerne la sécurité routière. En effet, la hausse du nombre d’accidents de la route est manifeste. L’accident survenu le 12 décembre dernier, à Verberie, en est la preuve : un conducteur a percuté un poteau électrique, provoquant une coupure de courant, avant de tenter de s’enfuir.
Enfin, la troisième conséquence, et non la moindre, est la détérioration importante de nos infrastructures routières provoquée par le passage des poids lourds, alors que nous connaissons les contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités locales.
Madame la secrétaire d’État, loin d’une image d’Épinal, les habitants de certaines communes de l’Oise entendent non plus les oiseaux chanter, mais uniquement les moteurs vrombir, parce que des entreprises, peu scrupuleuses, veulent économiser le prix du péage. Ces habitants doivent être entendus et leurs élus, davantage accompagnés.

Madame la secrétaire d'État, à l'occasion de la réforme des retraites, le Sénat, dans son ensemble, il faut le souligner, a souhaité valoriser l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leurs droits à la retraite, grâce à l'octroi de trois trimestres supplémentaires à partir de dix années d'engagement, puis, au-delà, d'un trimestre supplémentaire tous les cinq ans.
Il s'agit de témoigner de notre reconnaissance envers les sapeurs-pompiers volontaires en raison de leur engagement citoyen au service de la collectivité. En effet, nous en sommes tous très conscients ici, nos sapeurs-pompiers exercent leurs missions dans des situations de grande tension et de risque, auxquelles s'ajoutent les contraintes professionnelles inhérentes à leur activité.
Cette mesure vise également à soutenir le recrutement des effectifs nécessaires à l'accomplissement des nouvelles missions ou activités liées aux événements climatiques ou encore aux carences sanitaires. Sans pompiers bénévoles, la sécurité de nos concitoyens ne pourrait être assurée de manière satisfaisante, alors que chaque année plusieurs millions de Français en bénéficient.
À l'occasion des fêtes de la Sainte-Barbe qui se déroulent en ce moment, les sapeurs-pompiers volontaires se posent des questions, voire s'en inquiètent, sur la non-parution du décret relatif à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance qui leur est allouée.
En outre, selon certaines informations, le projet de décret distinguerait les sapeurs-pompiers volontaires selon qu'ils exercent ou non une activité professionnelle.
Ces hommes et ces femmes s'engagent avec courage et avec dévouement pour la sécurité de nos concitoyens et au service du public. Par conséquent, je souhaite savoir à quelle date le Gouvernement entend publier ce décret.
En outre, je souhaite obtenir de vous l'assurance que tous les sapeurs-pompiers volontaires, sans exception, bénéficieront de ces mesures, quelle que soit leur situation professionnelle, dans le respect de ce que nous avons voté.
Monsieur le sénateur Courtial, le maire chargé de la police de la circulation se trouve souvent en position d’arbitre. Aux termes des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, réglementer la circulation sur les voies de l’agglomération. Il peut notamment interdire l’accès aux poids lourds de voies, de portions de voies ou encore de secteurs de la commune.
Pour autant, le droit français posant comme principe que la liberté est la règle et la restriction de police l’exception, le juge administratif a fixé les conditions de légalité de tels arrêtés : un maire ne peut donc interdire, de manière permanente, la circulation des poids lourds dans l’ensemble de l’agglomération.
En revanche, il est fondé, sur la base de l’article L. 2213–2 du même code, à édicter des mesures restrictives motivées par des circonstances précises, dont il n’existe toutefois pas d’énumération exhaustive.
Dans ce cadre, la gendarmerie a relevé, dans le département de l’Oise, 301 infractions aux restrictions de circulation en 2021 et 349 en 2022, soit une hausse de 16 %, puis 598 infractions en 2023, soit une augmentation de 71 %.
L’activité de coordination des transports, à savoir le contrôle des poids lourds, représentait pour la gendarmerie de l’Oise 1 570 heures de service en 2021, avant d’atteindre 1 820 heures en 2022, soit une hausse de 16 %, et 2 670 heures en 2023, soit une augmentation de 47 %.
La vidéoverbalisation autorise aujourd’hui les policiers municipaux et les gardes champêtres à constater les infractions sans interception, après visionnage des images.
Le ministère de l’intérieur a d’ores et déjà engagé le processus pour opérer les modifications réglementaires nécessaires. Il s’agit, d’une part, d’étendre le périmètre des infractions constatables sans interception, recensées à l’article R. 121-6 du code de la route, aux interdictions et aux restrictions de circulation prévues par la réglementation sur le poids des véhicules ; d’autre part, d’élargir l’accès des policiers municipaux au système d’immatriculation des véhicules, afin que ces derniers puissent obtenir les données relatives à la catégorie des véhicules.
Monsieur le sénateur Courtial, le maire chargé de la police de la circulation se trouve souvent en position d’arbitre. Aux termes des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, réglementer la circulation sur les voies de l’agglomération. Il peut notamment interdire l’accès aux poids lourds de voies, de portions de voies ou encore de secteurs de la commune.
Cela étant, le droit français posant comme principe que la liberté est la règle et la restriction de police l’exception, le juge administratif a fixé les conditions de légalité de tels arrêtés : un maire ne peut donc interdire, de manière permanente, la circulation des poids lourds dans l’ensemble de l’agglomération.
En revanche, il est fondé, sur la base de l’article L. 2213–2 du même code, à édicter des mesures restrictives motivées par des circonstances précises, dont il n’existe toutefois pas d’énumération exhaustive.
Dans ce cadre, la gendarmerie a relevé, dans le département de l’Oise, 301 infractions aux restrictions de circulation en 2021 et 349 en 2022, soit une hausse de 16 %, puis 598 infractions en 2023, soit une augmentation de 71 %.
L’activité de coordination des transports, à savoir le contrôle des poids lourds, représentait pour la gendarmerie de l’Oise 1 570 heures de service en 2021, avant d’atteindre 1 820 heures en 2022, soit une hausse de 16 %, et 2 670 heures en 2023, soit une augmentation de 47 %.
La vidéoverbalisation autorise aujourd’hui les policiers municipaux et les gardes champêtres à constater les infractions sans interception, après visionnage des images.
Le ministère de l’intérieur a d’ores et déjà engagé le processus pour opérer les modifications réglementaires nécessaires. Il s’agit, d’une part, d’étendre le périmètre des infractions constatables sans interception, recensées à l’article R. 121-6 du code de la route, aux interdictions et aux restrictions de circulation prévues par la réglementation sur le poids des véhicules ; d’autre part, d’élargir l’accès des policiers municipaux au système d’immatriculation des véhicules, afin que ces derniers puissent obtenir les données relatives à la catégorie des véhicules.
Monsieur le sénateur Joly, issu de l'adoption d'un amendement transpartisan, l'article 24 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a créé un dispositif permettant aux sapeurs-pompiers volontaires, justifiant d'une durée minimum d'engagement, de valider des trimestres de retraite pour compléter, le cas échéant, leur carrière professionnelle au titre de la reconnaissance de leur engagement au service de nos concitoyens.
Élaboré sur le fondement des travaux parlementaires, le projet de décret en Conseil d'État vise, en application de cet article, à octroyer trois trimestres supplémentaires pour dix ans d'engagement, continus ou non, en tant que sapeur-pompier volontaire, puis d'un trimestre supplémentaire par tranche de cinq ans d'engagement, selon une logique d'attribution identique à celle des trimestres assimilés.
Le projet de décret fixe, tout d'abord, les règles d'affectation des trimestres à la carrière professionnelle, ainsi que les règles de détermination des régimes auxquels incombera la charge de valider ces trimestres.
Il vise également à adapter la mesure aux spécificités liées au régime des marins et à celui des fonctionnaires.
Il a été soumis, très récemment, à l'avis des différentes caisses de retraite. Il est actuellement devant le Conseil d'État, qui devrait rendre son avis demain.
Sa publication devrait donc intervenir d'ici à la fin de cette année et la mesure s'appliquera aux liquidations de pensions qui interviendront dès le lendemain de son entrée en vigueur.
décret relatif à la bonification des trimestres des sapeurs-pompiers volontaires

La parole est à M. Patrice Joly, auteur de la question n° 989, adressée à M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Madame la secrétaire d'État, vous n'avez pas répondu sur la question de l'éventuelle distinction qui serait faite entre les sapeurs-pompiers volontaires en fonction de leur situation d'emploi.
Je vous le demande solennellement : levez les inquiétudes des sapeurs-pompiers, consultez-les ou continuez de le faire, rassurez-les ! Nous avons besoin d'eux !

Madame la secrétaire d’État, à l’occasion de la réforme des retraites, le Sénat, dans son ensemble, il faut le souligner, a souhaité valoriser l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leurs droits à la retraite, grâce à l’octroi de trois trimestres supplémentaires à partir de dix années d’engagement, puis, au-delà, d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans.
Il s’agit de témoigner de notre reconnaissance envers les sapeurs-pompiers volontaires en raison de leur engagement citoyen au service de la collectivité. En effet, nous en sommes tous très conscients ici, nos sapeurs-pompiers exercent leurs missions dans des situations de grande tension et de risque, auxquelles s’ajoutent les contraintes professionnelles inhérentes à leur activité.
Cette mesure vise également à soutenir le recrutement des effectifs nécessaires à l’accomplissement des nouvelles missions ou activités liées aux événements climatiques ou encore aux carences sanitaires. Sans pompiers bénévoles, la sécurité de nos concitoyens ne pourrait être assurée de manière satisfaisante, alors que chaque année plusieurs millions de Français en bénéficient.
À l’occasion des fêtes de la Sainte-Barbe qui se déroulent en ce moment, les sapeurs-pompiers volontaires se posent des questions, voire s’en inquiètent, sur la non-parution du décret relatif à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance qui leur est allouée.
En outre, selon certaines informations, le projet de décret distinguerait les sapeurs-pompiers volontaires selon qu’ils exercent ou non une activité professionnelle.
Ces hommes et ces femmes s’engagent avec courage et avec dévouement pour la sécurité de nos concitoyens et au service du public. Par conséquent, je souhaite savoir à quelle date le Gouvernement entend publier ce décret.
En outre, je souhaite obtenir de vous l’assurance que tous les sapeurs-pompiers volontaires, sans exception, bénéficieront de ces mesures, quelle que soit leur situation professionnelle, dans le respect de ce que nous avons voté.

La parole est M. Jean-Baptiste Lemoyne en remplacement de Mme Dominique Vérien, auteure de la question n° 976, transmise à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée de la citoyenneté, et auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ville.
Monsieur le sénateur Joly, issu de l’adoption d’un amendement transpartisan, l’article 24 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a créé un dispositif permettant aux sapeurs-pompiers volontaires, justifiant d’une durée minimum d’engagement, de valider des trimestres de retraite pour compléter, le cas échéant, leur carrière professionnelle au titre de la reconnaissance de leur engagement au service de nos concitoyens.
Élaboré sur le fondement des travaux parlementaires, le projet de décret en Conseil d’État vise, en application de cet article, à octroyer trois trimestres supplémentaires pour dix ans d’engagement, continus ou non, en tant que sapeur-pompier volontaire, puis d’un trimestre supplémentaire par tranche de cinq ans d’engagement, selon une logique d’attribution identique à celle des trimestres assimilés.
Le projet de décret fixe, tout d’abord, les règles d’affectation des trimestres à la carrière professionnelle, ainsi que les règles de détermination des régimes auxquels incombera la charge de valider ces trimestres.
Il vise également à adapter la mesure aux spécificités liées au régime des marins et à celui des fonctionnaires.
Il a été soumis, très récemment, à l’avis des différentes caisses de retraite. Il est actuellement devant le Conseil d’État, qui devrait rendre son avis demain.
Sa publication devrait donc intervenir d’ici à la fin de cette année et la mesure s’appliquera aux liquidations de pensions qui interviendront dès le lendemain de son entrée en vigueur.

Madame la secrétaire d'État, la question que je pose en lieu et place de Dominique Vérien et qui nous préoccupe tous deux a trait aux critères d'attribution des subventions relatives aux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), notamment celui du seuil de population.
Seules les unités urbaines comptant au moins 10 000 habitants peuvent bénéficier de ce dispositif. Or l'Insee évalue la population des aires urbaines selon des critères d'appréciation qui semblent parfois discutables aux yeux des élus.
Ces subventions sont très importantes pour la vie quotidienne des communes concernées. Ainsi en est-il de la ville de Joigny qui perçoit, à ce titre, 715 000 euros par an, ce qui permet de répondre aux besoins des habitants des quartiers concernés. En outre, le classement QPV a un effet d'entraînement, car il permet de mobiliser des dispositifs auprès d'autres financeurs, comme la région.
Or, selon le dernier recensement, la ville de Joigny est passée sous la barre des 10 000 habitants, non pas tant parce que ses résidents seraient partis, mais parce que certains habitants, notamment ceux du quartier en question, ne se sont pas fait recenser.
Aussi, madame la secrétaire d'État, le critère relatif au seuil de population pourrait-il être appliqué avec souplesse afin d'éviter d'exclure des QPV de la nouvelle carte en cours d'élaboration, notamment celui de la ville de Joigny sur lequel Dominique Vérien et moi-même attirons votre attention ?

Madame la secrétaire d’État, vous n’avez pas répondu sur la question de l’éventuelle distinction qui serait faite entre les sapeurs-pompiers volontaires en fonction de leur situation d’emploi.
Je vous le demande solennellement : levez les inquiétudes des sapeurs-pompiers, consultez-les ou continuez de le faire, rassurez-les ! Nous avons besoin d’eux !
Monsieur le sénateur Lemoyne, votre question a trait à la redéfinition de la géographie des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Vous le savez, les travaux visant à mettre à jour ce zonage, qui n'a pas été modifié depuis 2014, soit voilà dix ans, sont en train de s'achever.
Deux décrets seront ainsi publiés avant le 31 décembre prochain : un décret « méthode » qui tend à définir les modalités particulières de détermination des critères prévus par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014, dite loi Lamy, et un décret « liste » qui vise à recenser les quartiers retenus.
Au cours de l'année 2023, les échanges étroits menés entre les élus et les préfets, que j'ai voulus, ont notamment permis d'identifier plusieurs situations similaires à celle que vous évoquez : le cas d'unités urbaines passant sous le seuil des 10 000 habitants en raison d'une déprise démographique liée au refus des habitants d'être recensés ou au relogement des résidents dans une commune voisine pendant la durée des travaux conduits dans le cadre d'un programme de renouvellement urbain.
Le projet de décret « méthode », dans sa version actuelle, vise à prendre en compte de telles situations. Il est actuellement soumis au Conseil d'État ; aussi dois-je attendre son avis pour vous répondre plus précisément sur le cas de Joigny.
Néanmoins, vous le savez, vous pouvez compter sur ma totale détermination, comme sur celle du Gouvernement, pour que ce nouveau zonage soit défini au plus près de chaque territoire et réponde aux besoins des plus fragiles.
Au travers d'une circulaire, j'avais d'ailleurs encouragé les préfets à travailler de manière très étroite avec les élus locaux, comme avec les habitants, et appelé de tous mes vœux les concertations citoyennes.
En tout cas, je vous adresserai une réponse écrite précise, lorsque nous connaîtrons l'avis du Conseil d'État sur le projet de décret.
critères d’attribution du label « quartier prioritaire de la ville »

La parole est M. Jean-Baptiste Lemoyne en remplacement de Mme Dominique Vérien, auteure de la question n° 976, transmise à Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, chargée de la citoyenneté, et auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ville.

Madame la secrétaire d'État, je vous remercie de ces précisions.
Votre prédécesseur s'était engagé à appliquer le critère de la population avec souplesse, ce que permettra le décret « méthode », d'après ce que je comprends.
Vous évoquiez le travail avec les préfets : au sujet du quartier de Joigny aujourd'hui classé en QPV, tant le préfet de département que celui de région se sont montrés ouverts au maintien de ce classement, ce qui, je l'espère, sera confirmé par les textes à venir.

Madame la secrétaire d’État, la question que je pose en lieu et place de Dominique Vérien et qui nous préoccupe tous deux a trait aux critères d’attribution des subventions relatives aux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), notamment celui du seuil de population.
Seules les unités urbaines comptant au moins 10 000 habitants peuvent bénéficier de ce dispositif. Or l’Insee évalue la population des aires urbaines selon des critères d’appréciation qui semblent parfois discutables aux yeux des élus.
Ces subventions sont très importantes pour la vie quotidienne des communes concernées. Ainsi en est-il de la ville de Joigny qui perçoit, à ce titre, 715 000 euros par an, ce qui permet de répondre aux besoins des habitants des quartiers concernés. En outre, le classement QPV a un effet d’entraînement, car il permet de mobiliser des dispositifs auprès d’autres financeurs, comme la région.
Or, selon le dernier recensement, la ville de Joigny est passée sous la barre des 10 000 habitants, non pas tant parce que ses résidents seraient partis, mais parce que certains habitants, notamment ceux du quartier en question, ne se sont pas fait recenser.
Aussi, madame la secrétaire d’État, le critère relatif au seuil de population pourrait-il être appliqué avec souplesse afin d’éviter d’exclure des QPV de la nouvelle carte en cours d’élaboration, notamment celui de la ville de Joigny sur lequel Dominique Vérien et moi-même attirons votre attention ?
Monsieur le sénateur Lemoyne, votre question a trait à la redéfinition de la géographie des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Vous le savez, les travaux visant à mettre à jour ce zonage, qui n’a pas été modifié depuis 2014, soit voilà dix ans, sont en train de s’achever.
Deux décrets seront ainsi publiés avant le 31 décembre prochain : un décret « méthode » qui tend à définir les modalités particulières de détermination des critères prévus par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014, dite loi Lamy, et un décret « liste » qui vise à recenser les quartiers retenus.
Au cours de l’année 2023, les échanges étroits menés entre les élus et les préfets, que j’ai voulus, ont notamment permis d’identifier plusieurs situations similaires à celle que vous évoquez : le cas d’unités urbaines passant sous le seuil des 10 000 habitants en raison d’une déprise démographique liée au refus des habitants d’être recensés ou au relogement des résidents dans une commune voisine pendant la durée des travaux conduits dans le cadre d’un programme de renouvellement urbain.
Le projet de décret « méthode », dans sa version actuelle, vise à prendre en compte de telles situations. Il est actuellement soumis au Conseil d’État ; aussi dois-je attendre son avis pour vous répondre plus précisément sur le cas de Joigny.
Néanmoins, vous le savez, vous pouvez compter sur ma totale détermination, comme sur celle du Gouvernement, pour que ce nouveau zonage soit défini au plus près de chaque territoire et réponde aux besoins des plus fragiles.
Au travers d’une circulaire, j’avais d’ailleurs encouragé les préfets à travailler de manière très étroite avec les élus locaux, comme avec les habitants, et appelé de tous mes vœux les concertations citoyennes.
En tout cas, je vous adresserai une réponse écrite précise, lorsque nous connaîtrons l’avis du Conseil d’État sur le projet de décret.

Madame la secrétaire d'État, constituées en établissements publics de coopération culturelle (EPCC), les écoles supérieures d'art territoriales délivrent des diplômes nationaux, labellisés par le ministère de la culture et valant grade de licence et de master.
Pour autant, l'État ne les finance, en moyenne, qu'à hauteur de 10 %, avec de grandes variations selon les établissements considérés, l'essentiel de leur financement étant assuré par les collectivités territoriales.
Ainsi, si le financement moyen par étudiant est actuellement de 1 960 euros, il s'élève à moins de 1 000 euros dans certaines écoles qui rencontrent des difficultés de plus en plus criantes.
Or cette dotation n'a pas évolué depuis douze ans, ce qui représente une baisse de 14 % en euros constants, alors que ces écoles font face aux exigences, accrues d'année en année, de l'enseignement supérieur, à l'inflation qui affecte lourdement leur budget, ainsi qu'à la revalorisation nécessaire et indispensable des traitements des agents publics.
Résultat, les EPCC, sous-financés et exclus de tous les derniers dispositifs d'aide, ne parviennent plus à équilibrer leur budget et épuisent peu à peu leur fonds de roulement.
Certes, la ministre de la culture annonçait, en mars dernier, le déploiement d'une aide d'urgence de 2 millions d'euros répartie entre les trente-trois établissements, aide reconduite dans le dernier projet de loi de finances. Toutefois, ces aides ne répondent ni à la gravité de la situation ni à la question structurelle de la responsabilité de l'État.
Alors que le Gouvernement a émis au Sénat, lors de l'examen du dernier projet de loi de finances, un avis défavorable sur un amendement à ce sujet, pourtant défendu par les élus et les professionnels, quelle mesure envisage-t-il pour garantir la pérennité des écoles supérieures d'art territoriales ?

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de ces précisions.
Votre prédécesseur s’était engagé à appliquer le critère de la population avec souplesse, ce que permettra le décret « méthode », d’après ce que je comprends.
Vous évoquiez le travail avec les préfets : au sujet du quartier de Joigny aujourd’hui classé en QPV, tant le préfet de département que celui de région se sont montrés ouverts au maintien de ce classement, ce qui, je l’espère, sera confirmé par les textes à venir.
Monsieur le sénateur Brisson, anciennes régies municipales et désormais EPCC, ces écoles relèvent des collectivités locales et bénéficient, vous le savez, d'un soutien financier du ministère de la culture à hauteur d'environ 11 % de leurs ressources.
Contrairement à ce que vous indiquez, monsieur le sénateur, ce soutien a augmenté, passant de 16, 2 millions d'euros en 2012 à 21 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 30 % en dix ans.
Afin de répondre aux importantes difficultés financières, notamment dues à l'inflation et, dans certains cas, à une baisse des contributions des collectivités locales, la ministre de la culture a décidé le 28 mars dernier de débloquer une aide d'urgence de 2 millions d'euros de crédits supplémentaires.
Pour prendre un exemple que vous connaissez bien, monsieur le sénateur, l'École supérieure d'art et de design des Pyrénées, établie à Pau et à Tarbes, a bénéficié de la quatrième plus grosse enveloppe issue de cette aide, avec une augmentation du soutien de l'État de près de 42 %.
Consciente des difficultés plus structurelles, la ministre de la culture, Rima Abdul-Malak, a décidé de « socler » cette aide dans le budget, de fournir un effort d'investissement supplémentaire de 3 millions d'euros et de commander un rapport, rendu public depuis, dans lequel sont formulées quatre grandes préconisations.
Tout d'abord, il s'agit de « mieux fonctionner », en revoyant la gouvernance des EPCC au cas par cas et en impliquant davantage les régions et les intercommunalités.
Il s'agit ensuite de « mieux connaître pour mieux comprendre », en établissant la cartographie de l'ensemble de l'offre de formation artistique, publique et privée, mais aussi de « mieux financer » en objectivant la dépense publique de l'État, notamment par étudiant.
Il s'agit, enfin, de « mieux valoriser » ces écoles qui gagneraient à être mieux connues, je le concède.
À la suite de ce travail et des rapports de la Cour des comptes et du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres), les services du ministère de la culture travaillent actuellement à l'élaboration d'un plan d'action en faveur de ces écoles, dans une logique de dialogue et de concertation.
situation des écoles supérieures d’art territoriales

La parole est à M. Max Brisson, auteur de la question n° 870, adressée à Mme la ministre de la culture.

Madame la secrétaire d'État, à vous écouter, les états généraux de l'enseignement supérieur artistique devraient rapidement se réunir pour fixer de nouveaux équilibres financiers et garantir ainsi, dans la durée, l'avenir des EPCC.
Il est urgent de repenser le dispositif de financement, qui est source d'inégalités entre les établissements. Aussi, pourquoi ne pas mettre en place – c'est une idée – un forfait fixe par étudiant, en lieu et place du saupoudrage actuellement de mise ?

Madame la secrétaire d’État, constituées en établissements publics de coopération culturelle (EPCC), les écoles supérieures d’art territoriales délivrent des diplômes nationaux, labellisés par le ministère de la culture et valant grade de licence et de master.
Pour autant, l’État ne les finance, en moyenne, qu’à hauteur de 10 %, avec de grandes variations selon les établissements considérés, l’essentiel de leur financement étant assuré par les collectivités territoriales.
Ainsi, si le financement moyen par étudiant est actuellement de 1 960 euros, il s’élève à moins de 1 000 euros dans certaines écoles qui rencontrent des difficultés de plus en plus criantes.
Or cette dotation n’a pas évolué depuis douze ans, ce qui représente une baisse de 14 % en euros constants, alors que ces écoles font face aux exigences, accrues d’année en année, de l’enseignement supérieur, à l’inflation qui affecte lourdement leur budget, ainsi qu’à la revalorisation nécessaire et indispensable des traitements des agents publics.
Résultat, les EPCC, sous-financés et exclus de tous les derniers dispositifs d’aide, ne parviennent plus à équilibrer leur budget et épuisent peu à peu leur fonds de roulement.
Certes, la ministre de la culture annonçait, en mars dernier, le déploiement d’une aide d’urgence de 2 millions d’euros répartie entre les trente-trois établissements, aide reconduite dans le dernier projet de loi de finances. Toutefois, ces aides ne répondent ni à la gravité de la situation ni à la question structurelle de la responsabilité de l’État.
Alors que le Gouvernement a émis au Sénat, lors de l’examen du dernier projet de loi de finances, un avis défavorable sur un amendement à ce sujet, pourtant défendu par les élus et les professionnels, quelle mesure envisage-t-il pour garantir la pérennité des écoles supérieures d’art territoriales ?
Monsieur le sénateur Brisson, anciennes régies municipales et désormais EPCC, ces écoles relèvent des collectivités locales et bénéficient, vous le savez, d’un soutien financier du ministère de la culture à hauteur d’environ 11 % de leurs ressources.
Contrairement à ce que vous indiquez, monsieur le sénateur, ce soutien a augmenté, passant de 16, 2 millions d’euros en 2012 à 21 millions d’euros en 2022, soit une hausse de 30 % en dix ans.
Afin de répondre aux importantes difficultés financières, notamment dues à l’inflation et, dans certains cas, à une baisse des contributions des collectivités locales, la ministre de la culture a décidé le 28 mars dernier de débloquer une aide d’urgence de 2 millions d’euros de crédits supplémentaires.
Pour prendre un exemple que vous connaissez bien, monsieur le sénateur, l’École supérieure d’art et de design des Pyrénées, établie à Pau et à Tarbes, a bénéficié de la quatrième plus grosse enveloppe issue de cette aide, avec une augmentation du soutien de l’État de près de 42 %.
Consciente des difficultés plus structurelles, la ministre de la culture, Rima Abdul-Malak, a décidé de « socler » cette aide dans le budget, de fournir un effort d’investissement supplémentaire de 3 millions d’euros et de commander un rapport, rendu public depuis, dans lequel sont formulées quatre grandes préconisations.
Tout d’abord, il s’agit de « mieux fonctionner », en revoyant la gouvernance des EPCC au cas par cas et en impliquant davantage les régions et les intercommunalités.
Il s’agit ensuite de « mieux connaître pour mieux comprendre », en établissant la cartographie de l’ensemble de l’offre de formation artistique, publique et privée, mais aussi de « mieux financer » en objectivant la dépense publique de l’État, notamment par étudiant.
Il s’agit, enfin, de « mieux valoriser » ces écoles qui gagneraient à être mieux connues, je le concède.
À la suite de ce travail et des rapports de la Cour des comptes et du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres), les services du ministère de la culture travaillent actuellement à l’élaboration d’un plan d’action en faveur de ces écoles, dans une logique de dialogue et de concertation.

Madame la ministre, ma question a trait à la pénurie du traitement Beyfortus et, plus généralement, aux pénuries de médicaments.
Pendant l'hiver 2022-2023, 75 000 passages aux urgences ont été enregistrés pour des cas de bronchiolite. Depuis le 15 septembre 2023, il est possible d'administrer aux bébés un traitement préventif contre cette maladie.
Une commande de 200 000 doses a ainsi été passée, mais une semaine après le lancement d'une campagne de communication du Gouvernement en faveur de la vaccination, plus aucune dose n'était disponible. Cette campagne a donc été efficace, mais ses effets ont été sous-évalués.
Plus généralement, selon le baromètre France Assos Santé, le nombre de patients se déclarant confrontés à une pénurie de médicaments a bondi de 29 % à 37 % en une année.
L'hiver 2022-2023 a été marqué par des pénuries d'amoxicilline et de paracétamol. Cet été, les tensions se sont également accentuées, notamment pour ce qui concerne les médicaments liés à la cardiologie.
Cette situation inquiète légitimement les Français. Elle s'explique notamment par des délocalisations massives opérées par les laboratoires pharmaceutiques, qui ont externalisé les différentes étapes de la fabrication des produits, afin d'obtenir une meilleure rentabilité.
Une autre explication réside dans la concentration, quasi monopolistique, de la production. Ainsi certains médicaments sont-ils fournis par une seule entreprise.
Madame la ministre, quand les doses du traitement préventif Beyfortus seront-elles disponibles afin d'éviter les hospitalisations ? Plus généralement, quelle stratégie est mise en place pour disposer de stocks de médicaments suffisants ?

Madame la secrétaire d’État, à vous écouter, les états généraux de l’enseignement supérieur artistique devraient rapidement se réunir pour fixer de nouveaux équilibres financiers et garantir ainsi, dans la durée, l’avenir des EPCC.
Il est urgent de repenser le dispositif de financement, qui est source d’inégalités entre les établissements. Aussi, pourquoi ne pas mettre en place – c’est une idée – un forfait fixe par étudiant, en lieu et place du saupoudrage actuellement de mise ?
Monsieur le sénateur Cabanel, en juillet 2023, les autorités françaises ont réservé 200 000 doses de Beyfortus dans le cadre de la préparation aux épidémies de l'hiver. La France a été l'un des quatre premiers pays à en avoir commandé et le premier État à déployer de façon aussi large cet outil de prévention.
La campagne d'immunisation des nourrissons contre la bronchiolite a débuté le 15 septembre et a rencontré une forte adhésion de la part des professionnels, mais aussi des parents, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.
Dans un contexte de très forte demande, les discussions entre les autorités françaises et les laboratoires ont permis de sécuriser 50 000 doses additionnelles et de prolonger la campagne d'immunisation en cours.
Plus largement, une nouvelle feuille de route adoptée en 2023 a permis de poser les premiers jalons d'une nouvelle stratégie en matière de prévention et de gestion des pénuries.
Par ailleurs, trois mesures ont été adoptées dans le cadre du dernier PLFSS pour permettre d'améliorer l'accès de nos concitoyens aux médicaments en cas de pénurie.
La première mesure vise à prévenir les ruptures d'approvisionnement à la suite de l'arrêt de la commercialisation de médicaments matures d'intérêt thérapeutique majeur.
La deuxième mesure porte sur la distribution et la délivrance, avec, d'une part, la possibilité de limiter la vente directe entre les laboratoires pharmaceutiques et les officines et, d'autre part, le renforcement des leviers d'épargne en cas de rupture d'approvisionnement.
La troisième mesure permet d'élargir les dispositifs permettant une production alternative pour certaines spécialités pharmaceutiques.
En parallèle de ces évolutions et à la demande du ministre de la santé et de la prévention, Aurélien Rousseau, dont je vous prie de bien vouloir excuser l'absence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a formalisé, en lien avec l'ordre des pharmaciens, l'engagement des acteurs de la chaîne pharmaceutique : une charte destinée à fluidifier la chaîne de distribution des médicaments a ainsi été signée le 22 novembre dernier.
pénuries du traitement beyfortus et de médicaments

La parole est à M. Henri Cabanel, auteur de la question n° 955, adressée à M. le ministre de la santé et de la prévention.

Il est vrai que des efforts ont été fournis, mais nous avons connu une pénurie, si bien qu'on peut considérer qu'ils n'ont pas été suffisants.
Les pharmaciens sont très ennuyés de ne pas pouvoir fournir certains médicaments à leurs patients. Dans mon département, ils mènent une action visant à faire envoyer par leurs patients un courrier au Président de la République. Nous espérons recevoir une réponse favorable !

Madame la ministre, ma question a trait à la pénurie du traitement Beyfortus et, plus généralement, aux pénuries de médicaments.
Pendant l’hiver 2022-2023, 75 000 passages aux urgences ont été enregistrés pour des cas de bronchiolite. Depuis le 15 septembre 2023, il est possible d’administrer aux bébés un traitement préventif contre cette maladie.
Une commande de 200 000 doses a ainsi été passée, mais une semaine après le lancement d’une campagne de communication du Gouvernement en faveur de la vaccination, plus aucune dose n’était disponible. Cette campagne a donc été efficace, mais ses effets ont été sous-évalués.
Plus généralement, selon le baromètre France Assos Santé, le nombre de patients se déclarant confrontés à une pénurie de médicaments a bondi de 29 % à 37 % en une année.
L’hiver 2022-2023 a été marqué par des pénuries d’amoxicilline et de paracétamol. Cet été, les tensions se sont également accentuées, notamment pour ce qui concerne les médicaments liés à la cardiologie.
Cette situation inquiète légitimement les Français. Elle s’explique notamment par des délocalisations massives opérées par les laboratoires pharmaceutiques, qui ont externalisé les différentes étapes de la fabrication des produits, afin d’obtenir une meilleure rentabilité.
Une autre explication réside dans la concentration, quasi monopolistique, de la production. Ainsi certains médicaments sont-ils fournis par une seule entreprise.
Madame la ministre, quand les doses du traitement préventif Beyfortus seront-elles disponibles afin d’éviter les hospitalisations ? Plus généralement, quelle stratégie est mise en place pour disposer de stocks de médicaments suffisants ?
Monsieur le sénateur Cabanel, en juillet 2023, les autorités françaises ont réservé 200 000 doses de Beyfortus dans le cadre de la préparation aux épidémies de l’hiver. La France a été l’un des quatre premiers pays à en avoir commandé et le premier État à déployer de façon aussi large cet outil de prévention.
La campagne d’immunisation des nourrissons contre la bronchiolite a débuté le 15 septembre et a rencontré une forte adhésion de la part des professionnels, mais aussi des parents, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.
Dans un contexte de très forte demande, les discussions entre les autorités françaises et les laboratoires ont permis de sécuriser 50 000 doses additionnelles et de prolonger la campagne d’immunisation en cours.
Plus largement, une nouvelle feuille de route adoptée en 2023 a permis de poser les premiers jalons d’une nouvelle stratégie en matière de prévention et de gestion des pénuries.
Par ailleurs, trois mesures ont été adoptées dans le cadre du dernier PLFSS pour permettre d’améliorer l’accès de nos concitoyens aux médicaments en cas de pénurie.
La première mesure vise à prévenir les ruptures d’approvisionnement à la suite de l’arrêt de la commercialisation de médicaments matures d’intérêt thérapeutique majeur.
La deuxième mesure porte sur la distribution et la délivrance, avec, d’une part, la possibilité de limiter la vente directe entre les laboratoires pharmaceutiques et les officines et, d’autre part, le renforcement des leviers d’épargne en cas de rupture d’approvisionnement.
La troisième mesure permet d’élargir les dispositifs permettant une production alternative pour certaines spécialités pharmaceutiques.
En parallèle de ces évolutions et à la demande du ministre de la santé et de la prévention, Aurélien Rousseau, dont je vous prie de bien vouloir excuser l’absence, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a formalisé, en lien avec l’ordre des pharmaciens, l’engagement des acteurs de la chaîne pharmaceutique : une charte destinée à fluidifier la chaîne de distribution des médicaments a ainsi été signée le 22 novembre dernier.
Monsieur le sénateur Cabanel, en juillet 2023, les autorités françaises ont réservé 200 000 doses de Beyfortus dans le cadre de la préparation aux épidémies de l’hiver. La France a été l’un des quatre premiers pays à en avoir commandé et le premier État à déployer de façon aussi large cet outil de prévention.
La campagne d’immunisation des nourrissons contre la bronchiolite a débuté le 15 septembre et a rencontré une forte adhésion de la part des professionnels, mais aussi des parents, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.
Dans un contexte de très forte demande, les discussions entre les autorités françaises et les laboratoires ont permis de sécuriser 50 000 doses additionnelles et de prolonger la campagne d’immunisation en cours.
Plus largement, une nouvelle feuille de route adoptée en 2023 a permis de poser les premiers jalons d’une nouvelle stratégie en matière de prévention et de gestion des pénuries.
Par ailleurs, trois mesures ont été adoptées dans le cadre du dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour permettre d’améliorer l’accès de nos concitoyens aux médicaments en cas de pénurie.
La première mesure vise à prévenir les ruptures d’approvisionnement à la suite de l’arrêt de la commercialisation de médicaments matures d’intérêt thérapeutique majeur.
La deuxième mesure porte sur la distribution et la délivrance, avec, d’une part, la possibilité de limiter la vente directe entre les laboratoires pharmaceutiques et les officines et, d’autre part, le renforcement des leviers d’épargne en cas de rupture d’approvisionnement.
La troisième mesure permet d’élargir les dispositifs permettant une production alternative pour certaines spécialités pharmaceutiques.
En parallèle de ces évolutions et à la demande du ministre de la santé et de la prévention, Aurélien Rousseau, dont je vous prie de bien vouloir excuser l’absence, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a formalisé, en lien avec l’ordre des pharmaciens, l’engagement des acteurs de la chaîne pharmaceutique : une charte destinée à fluidifier la chaîne de distribution des médicaments a ainsi été signée le 22 novembre dernier.

Madame la ministre, chacun le sait, en matière de désertification médicale, la psychiatrie est l'une des spécialités les plus touchées, ce qui laisse démunis les élus locaux, qui doivent désormais gérer en direct les errements de certains de leurs administrés.
À la lecture du rapport de l'Observatoire régional de la santé de la région Centre-Val de Loire, il apparaît que le Loiret est le moins bien doté, avec un taux 12, 7 psychiatres pour 100 000 habitants, contre 15, 4 u niveau régional.
Parallèlement, la dotation financière du Loiret en psychiatrie est la plus faible de l'ensemble des départements de la région, avec un ratio par habitant de 140 euros, contre 160 euros au niveau régional et même 170 euros au niveau national.
Une telle iniquité entre les territoires entraîne de graves conséquences pour notre département et ses habitants. À titre d'exemple, l'établissement public de santé mentale (EPSM) Georges-Daumézon, le plus important de la région Centre-Val de Loire, qui prend en charge plus de 17 000 patients se voit contraint de fermer des lits faute de personnels et de moyens, malgré les politiques volontaristes mises en place.
Mes questions sont donc les suivantes. Comment peut-on mettre fin à cette inégalité criante entre les territoires, en donnant les moyens indispensables à l'établissement Georges-Daumézon et, plus généralement, au Loiret ? Au-delà du problème de désertification que nous connaissons tous, quelles mesures sont envisagées afin de répondre à cette crise de la psychiatrie affectant bon nombre d'autres politiques publiques, tout particulièrement l'aide sociale à l'enfance ?

Il est vrai que des efforts ont été fournis, mais nous avons connu une pénurie, si bien qu’on peut considérer qu’ils n’ont pas été suffisants.
Les pharmaciens sont très ennuyés de ne pas pouvoir fournir certains médicaments à leurs patients. Dans mon département, ils mènent une action visant à faire envoyer par leurs patients un courrier au Président de la République. Nous espérons recevoir une réponse favorable !
Madame la sénatrice, comme vous le soulignez à juste titre, la psychiatrie rencontre des difficultés en termes de ressources humaines et d'attractivité. C'est vrai partout en France, en particulier dans le Loiret. Je souhaite toutefois rappeler les avancées récentes, notamment l'augmentation, depuis 2018, du nombre de postes d'internes : +10 en 2017 et +13 en 2022, ce qui reste bien sûr largement perfectible.
Je pense également à la reconnaissance de la psychiatrie en tant que spécialité en tension en 2022 dans l'ensemble des établissements, ainsi qu'à l'augmentation du taux d'étudiants hospitaliers de deuxième cycle en service de psychiatrie.
Par ailleurs, des objectifs ambitieux sont désormais inscrits dans le projet régional de santé pour les cinq prochaines années : renforcer et améliorer la formation des professionnels de santé médicaux et non médicaux ; développer l'attractivité du secteur de la psychiatrie et de la santé mentale et fidéliser les professionnels – c'est un enjeu majeur – ; déployer l'usage de la télémédecine.
Pour ce faire, la mise en place d'une deuxième faculté de médecine à Orléans permettra de former davantage de médecins dans votre région, de renforcer l'offre de formation de troisième cycle et d'accroître le nombre d'internes en psychiatrie.
Concernant spécifiquement l'établissement public de santé mentale Georges-Daumézon, je tiens à saluer l'engagement au quotidien des professionnels.
Je rappelle que nous avons fermement soutenu l'établissement avec la mise en place d'une équipe mobile de précarité en psychiatrie et d'une équipe mobile d'intervention et de crise pour enfants et adolescents. Nous avons également renforcé les centres médicaux psychologiques pour enfants et adolescents, ainsi que les dispositifs mobiles d'intervention en addictologie.
Comme vous le voyez, madame la sénatrice, le Gouvernement et l'ARS sont pleinement mobilisés pour ce territoire, qui est aujourd'hui en difficulté.
situation de la psychiatrie dans le loiret

La parole est à Mme Pauline Martin, auteure de la question n° 971, adressée à M. le ministre de la santé et de la prévention.

Madame la ministre, une mobilisation générale est nécessaire. C'est un appel au secours !

Madame la ministre, chacun le sait, en matière de désertification médicale, la psychiatrie est l’une des spécialités les plus touchées, ce qui laisse démunis les élus locaux, qui doivent désormais gérer en direct les errements de certains de leurs administrés.
À la lecture du rapport de l’Observatoire régional de la santé de la région Centre-Val de Loire, il apparaît que le Loiret est le moins bien doté, avec un taux 12, 7 psychiatres pour 100 000 habitants, contre 15, 4 au niveau régional.
Parallèlement, la dotation financière du Loiret en psychiatrie est la plus faible de l’ensemble des départements de la région, avec un ratio par habitant de 140 euros, contre 160 euros au niveau régional et même 170 euros au niveau national.
Une telle iniquité entre les territoires entraîne de graves conséquences pour notre département et ses habitants. À titre d’exemple, l’établissement public de santé mentale (EPSM) Georges-Daumézon, le plus important de la région Centre-Val de Loire, qui prend en charge plus de 17 000 patients se voit contraint de fermer des lits faute de personnels et de moyens, malgré les politiques volontaristes mises en place.
Mes questions sont donc les suivantes. Comment peut-on mettre fin à cette inégalité criante entre les territoires, en donnant les moyens indispensables à l’établissement Georges-Daumézon et, plus généralement, au Loiret ? Au-delà du problème de désertification que nous connaissons tous, quelles mesures sont envisagées afin de répondre à cette crise de la psychiatrie affectant bon nombre d’autres politiques publiques, tout particulièrement l’aide sociale à l’enfance ?
Madame la sénatrice, comme vous le soulignez à juste titre, la psychiatrie rencontre des difficultés en termes de ressources humaines et d’attractivité. C’est vrai partout en France, en particulier dans le Loiret. Je souhaite toutefois rappeler les avancées récentes, notamment l’augmentation, depuis 2018, du nombre de postes d’internes : +10 en 2017 et +13 en 2022, ce qui reste bien sûr largement perfectible.
Je pense également à la reconnaissance de la psychiatrie en tant que spécialité en tension en 2022 dans l’ensemble des établissements, ainsi qu’à l’augmentation du taux d’étudiants hospitaliers de deuxième cycle en service de psychiatrie.
Par ailleurs, des objectifs ambitieux sont désormais inscrits dans le projet régional de santé pour les cinq prochaines années : renforcer et améliorer la formation des professionnels de santé médicaux et non médicaux ; développer l’attractivité du secteur de la psychiatrie et de la santé mentale et fidéliser les professionnels – c’est un enjeu majeur – ; déployer l’usage de la télémédecine.
Pour ce faire, la mise en place d’une deuxième faculté de médecine à Orléans permettra de former davantage de médecins dans votre région, de renforcer l’offre de formation de troisième cycle et d’accroître le nombre d’internes en psychiatrie.
Concernant spécifiquement l’établissement public de santé mentale Georges-Daumézon, je tiens à saluer l’engagement au quotidien des professionnels.
Je rappelle que nous avons fermement soutenu l’établissement avec la mise en place d’une équipe mobile de précarité en psychiatrie et d’une équipe mobile d’intervention et de crise pour enfants et adolescents. Nous avons également renforcé les centres médicaux psychologiques pour enfants et adolescents, ainsi que les dispositifs mobiles d’intervention en addictologie.
Comme vous le voyez, madame la sénatrice, le Gouvernement et l’ARS sont pleinement mobilisés pour ce territoire, qui est aujourd’hui en difficulté.

Ma question s'adresse au ministre de la santé et de la prévention et j'y associe l'ensemble des parlementaires du Cher, ainsi que les maires concernés par le sujet.
Nous avons récemment pris connaissance du projet régional de santé, qui est susceptible d'avoir de lourdes conséquences pour notre département en matière d'accès aux soins et plus précisément aux services obstétriques. Il fait en effet mention de suppressions de maternités dans le département, à Vierzon et à Saint-Amand-Montrond.
Cette décision potentielle n'est pas acceptable ! Supprimer ne serait-ce qu'une maternité, c'est prendre le risque d'engorger les autres et de mettre en péril la sécurité des femmes enceintes et de leurs bébés.
Inutile de vous le rappeler, notre territoire souffre déjà du phénomène de désertification médicale. Or, à l'heure où les initiatives parlementaires portant sur l'amélioration de l'accès aux soins se multiplient, une telle proposition de suppression est tout simplement incompréhensible.
Ainsi, je vous demande tout simplement de garantir le maintien des maternités dans un territoire où le désert médical, comme le Sahara, s'agrandit au fil des années.
Monsieur le sénateur, les maternités françaises et leur personnel sont actuellement confrontés à de très fortes tensions et le Gouvernement y prête une attention toute particulière afin que les femmes enceintes bénéficient d'une prise en charge de qualité tout au long de leur grossesse, et ce jusqu'à l'accouchement, au plus près de leur domicile.
Toutefois, lorsqu'une fermeture ne peut être évitée, du fait, parfois, d'un manque de professionnels de santé, nous nous attachons à sécuriser le parcours des patientes concernées. Des hébergements non médicalisés sont déployés à cet effet à proximité des maternités de référence de ces territoires. Ils accueillent les femmes en amont de leur terme et limitent ainsi les accouchements inopinés susceptibles de survenir en dehors d'une structure hospitalière.
De même, nous soutenons la création des centres périnataux de proximité. Ces structures offrent un panel large de services en matière de périnatalité et évitent de longs déplacements aux femmes enceintes pour le suivi de leur grossesse.
Monsieur le sénateur, à ce jour, quatre maternités sont en activité dans votre département, trois dans les centres hospitaliers de Bourges, Vierzon et Saint-Amand-Montrond et une au sein d'une clinique à Bourges. L'offre médicale pour les femmes enceintes de votre département passe également par la présence d'équipes complètes – gynécologues et anesthésistes – sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Je vous confirme, monsieur le sénateur, qu'à ce jour aucune maternité du Cher n'est remise en cause. Notre objectif demeure bien le maintien de l'offre existante dans le Cher et l'accompagnement des transformations, si elles devenaient nécessaires.
situation des maternités dans le département du cher

La parole est à M. Rémy Pointereau, auteur de la question n° 972, adressée à M. le ministre de la santé et de la prévention.

Vous me rassurez, madame la ministre. Il est vrai que je ne compte plus le nombre d'interventions relatives à cette problématique d'accès aux soins, que je nomme d'ailleurs un accès au droit de vivre !
En l'occurrence, il s'agit de préserver un droit de naître, qui ne doit pas faire l'objet de logiques rentables. Je le sais bien, il existe des problèmes de personnel. Toutefois, il ne faut pas toucher au maillage actuel, qui est fondamental pour le département du Cher. C'est simplement une question d'égalité dans l'accès aux soins et à la santé.

Ma question s’adresse au ministre de la santé et de la prévention et j’y associe l’ensemble des parlementaires du Cher, ainsi que les maires concernés par le sujet.
Nous avons récemment pris connaissance du projet régional de santé, qui est susceptible d’avoir de lourdes conséquences pour notre département en matière d’accès aux soins et plus précisément aux services obstétriques. Il fait en effet mention de suppressions de maternités dans le département, à Vierzon et à Saint-Amand-Montrond.
Cette décision potentielle n’est pas acceptable ! Supprimer ne serait-ce qu’une maternité, c’est prendre le risque d’engorger les autres et de mettre en péril la sécurité des femmes enceintes et de leurs bébés.
Inutile de vous le rappeler, notre territoire souffre déjà du phénomène de désertification médicale. Or, à l’heure où les initiatives parlementaires portant sur l’amélioration de l’accès aux soins se multiplient, une telle proposition de suppression est tout simplement incompréhensible.
Ainsi, je vous demande tout simplement de garantir le maintien des maternités dans un territoire où le désert médical, comme le Sahara, s’agrandit au fil des années.
Monsieur le sénateur, les maternités françaises et leur personnel sont actuellement confrontés à de très fortes tensions et le Gouvernement y prête une attention toute particulière afin que les femmes enceintes bénéficient d’une prise en charge de qualité tout au long de leur grossesse, et ce jusqu’à l’accouchement, au plus près de leur domicile.
Toutefois, lorsqu’une fermeture ne peut être évitée, du fait, parfois, d’un manque de professionnels de santé, nous nous attachons à sécuriser le parcours des patientes concernées. Des hébergements non médicalisés sont déployés à cet effet à proximité des maternités de référence de ces territoires. Ils accueillent les femmes en amont de leur terme et limitent ainsi les accouchements inopinés susceptibles de survenir en dehors d’une structure hospitalière.
De même, nous soutenons la création des centres périnataux de proximité. Ces structures offrent un panel large de services en matière de périnatalité et évitent de longs déplacements aux femmes enceintes pour le suivi de leur grossesse.
Monsieur le sénateur, à ce jour, quatre maternités sont en activité dans votre département, trois dans les centres hospitaliers de Bourges, Vierzon et Saint-Amand-Montrond et une au sein d’une clinique à Bourges. L’offre médicale pour les femmes enceintes de votre département passe également par la présence d’équipes complètes – gynécologues et anesthésistes – sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Je vous confirme, monsieur le sénateur, qu’à ce jour aucune maternité du Cher n’est remise en cause. Notre objectif demeure bien le maintien de l’offre existante dans le Cher et l’accompagnement des transformations, si elles devenaient nécessaires.

Madame la ministre, je reprends une question écrite posée début juin pour attirer l'attention du Gouvernement sur la situation dramatique des associations d'aide alimentaire.
Depuis lors, des mesures ont été prises, comme l'aide de 156 millions d'euros attribuée en septembre à ces associations et la rallonge exceptionnelle prévue dans le cadre de la loi de finances pour 2024.
Néanmoins, en Gironde, le Secours populaire français a vu bondir de 10 % le nombre de personnes reçues au second semestre 2022 et de nouveau de 10 % au cours de l'année 2023. Les besoins augmentent dans chaque antenne du département et l'aide alimentaire reçue par les personnes bénéficiaires leur est indispensable. Par ailleurs, les publics concernés sont de plus en plus nombreux.
En France, les Restos du Cœur ont distribué 47 % de repas en plus. Par ailleurs, les personnes accueillies ont augmenté de 15 % à 20 %.
Dans le même temps, les associations ont constaté une baisse de 25 % en 2023 des dotations européennes de soutien à l'aide alimentaire. Ces dernières ont certes été revues à la hausse pour 2024, mais cela ne suffit pas à compenser l'inflation et la hausse du nombre de demandeurs.
En effet, en 2023, les produits alimentaires ont vu leur prix bondir de 15 %. Les aides reçues par ces associations ne sont toujours pas au niveau des besoins et de l'augmentation du nombre de bénéficiaires.
Une telle conjoncture entraîne des conséquences dramatiques sur la situation budgétaire de ces associations. Les 1 500 bénévoles des antennes girondines du Secours populaire français se sentent démunis face au manque de moyens accordés et s'inquiètent de ne pas pouvoir répondre aux besoins de nouveaux arrivants dans les comités locaux.
Madame la ministre, je demande au Gouvernement d'agir pour que les dispositifs européens et nationaux d'aide alimentaire soient renforcés à la hauteur de la situation actuelle, marquée par l'inflation et l'augmentation du nombre de bénéficiaires.
Un renforcement significatif, hors appels à projets, garantirait aux associations les moyens financiers nécessaires pour leur mission d'aide alimentaire. Les associations seraient en mesure de faire mieux face à une situation d'urgence. Elles demandent également à bénéficier d'aides spécifiques.

Vous me rassurez, madame la ministre. Il est vrai que je ne compte plus le nombre d’interventions relatives à cette problématique d’accès aux soins, que je nomme d’ailleurs un accès au droit de vivre !
En l’occurrence, il s’agit de préserver un droit de naître, qui ne doit pas faire l’objet de logiques rentables. Je le sais bien, il existe des problèmes de personnel. Toutefois, il ne faut pas toucher au maillage actuel, qui est fondamental pour le département du Cher. C’est simplement une question d’égalité dans l’accès aux soins et à la santé.
Madame la sénatrice, vous interrogez Mme la ministre des solidarités et des familles sur le soutien apporté aux associations d'aide alimentaire.
Afin de lutter contre la précarité, le Gouvernement a mis en place le pacte des solidarités, qui vise à garantir l'accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité. Ce programme se distingue par un engagement financier sans précédent et par la mise en œuvre de mesures concrètes pour soutenir les associations d'aide alimentaire et les familles en difficulté.
Pour l'année en cours, le Gouvernement a alloué un budget exceptionnel de 156 millions d'euros à l'aide alimentaire nationale, soit plus du double par rapport à l'année 2021. Cette enveloppe budgétaire sert à soutenir les grandes associations telles que les Restos du Cœur, les banques alimentaires, le Secours populaire français et la Croix-Rouge, dans le cadre du programme « Mieux manger pour tous ! ». J'en profite d'ailleurs pour saluer le travail mené au quotidien par ces associations.
En outre, 66 millions d'euros sont dédiés aux associations locales, ce qui souligne l'importance de l'aide de proximité.
Le programme « Mieux manger pour tous ! » a été conçu pour être étendu et renforcé au cours du quinquennat, avec une projection de 100 millions d'euros par an d'ici à 2027. Une telle initiative montre la volonté du Gouvernement de s'engager sur le long terme pour lutter contre la précarité alimentaire.
Il a également sollicité la participation des grandes entreprises pour des dons en nature, doublant ainsi l'aide apportée. Permettez-moi de vous donner un exemple concret : grâce à cet appel, les Restos du Cœur pourront recevoir une aide équivalente à plus de 2, 5 millions d'euros.
En août, le Gouvernement a réussi à obtenir des fonds européens supplémentaires pour l'aide alimentaire, à hauteur de 80 millions d'euros pour la période 2024-2027.
Pour conclure, le pacte des solidarités reflète la détermination du Gouvernement à soutenir les associations d'aide alimentaire et à garantir une assistance aux populations vulnérables, particulièrement au cours de la crise que nous connaissons, marquée par l'inflation.
effet de ciseaux pour les associations d’aide alimentaire

Madame la ministre, je reprends une question écrite posée début juin pour attirer l’attention du Gouvernement sur la situation dramatique des associations d’aide alimentaire.
Depuis lors, des mesures ont été prises, comme l’aide de 156 millions d’euros attribuée en septembre à ces associations et la rallonge exceptionnelle prévue dans le cadre de la loi de finances pour 2024.
Néanmoins, en Gironde, le Secours populaire français a vu bondir de 10 % le nombre de personnes reçues au second semestre 2022 et de nouveau de 10 % au cours de l’année 2023. Les besoins augmentent dans chaque antenne du département et l’aide alimentaire reçue par les personnes bénéficiaires leur est indispensable. Par ailleurs, les publics concernés sont de plus en plus nombreux.
En France, les Restos du Cœur ont distribué 47 % de repas en plus. Par ailleurs, les personnes accueillies ont augmenté de 15 % à 20 %.
Dans le même temps, les associations ont constaté une baisse de 25 % en 2023 des dotations européennes de soutien à l’aide alimentaire. Ces dernières ont certes été revues à la hausse pour 2024, mais cela ne suffit pas à compenser l’inflation et la hausse du nombre de demandeurs.
En effet, en 2023, les produits alimentaires ont vu leur prix bondir de 15 %. Les aides reçues par ces associations ne sont toujours pas au niveau des besoins et de l’augmentation du nombre de bénéficiaires.
Une telle conjoncture entraîne des conséquences dramatiques sur la situation budgétaire de ces associations. Les 1 500 bénévoles des antennes girondines du Secours populaire français se sentent démunis face au manque de moyens accordés et s’inquiètent de ne pas pouvoir répondre aux besoins de nouveaux arrivants dans les comités locaux.
Madame la ministre, je demande au Gouvernement d’agir pour que les dispositifs européens et nationaux d’aide alimentaire soient renforcés à la hauteur de la situation actuelle, marquée par l’inflation et l’augmentation du nombre de bénéficiaires.
Un renforcement significatif, hors appels à projets, garantirait aux associations les moyens financiers nécessaires pour leur mission d’aide alimentaire. Les associations seraient en mesure de faire mieux face à une situation d’urgence. Elles demandent également à bénéficier d’aides spécifiques.

Madame la ministre, je reprends une question écrite posée au début du mois de juin pour attirer l’attention du Gouvernement sur la situation dramatique des associations d’aide alimentaire.
Depuis lors, des mesures ont été prises, comme l’aide de 156 millions d’euros attribuée en septembre à ces associations et la rallonge exceptionnelle prévue dans le cadre de la loi de finances pour 2024.
Néanmoins, en Gironde, le Secours populaire français a vu bondir de 10 % le nombre de personnes reçues au second semestre 2022 et de nouveau de 10 % au cours de l’année 2023. Les besoins augmentent dans chaque antenne du département et l’aide alimentaire reçue par les personnes bénéficiaires leur est indispensable. Par ailleurs, les publics concernés sont de plus en plus nombreux.
En France, les Restos du Cœur ont distribué 47 % de repas en plus. Par ailleurs, les personnes accueillies ont augmenté de 15 % à 20 %.
Dans le même temps, les associations ont constaté une baisse de 25 % en 2023 des dotations européennes de soutien à l’aide alimentaire. Ces dernières ont certes été revues à la hausse pour 2024, mais cela ne suffit pas à compenser l’inflation et la hausse du nombre de demandeurs.
En effet, en 2023, les produits alimentaires ont vu leur prix bondir de 15 %. Les aides reçues par ces associations ne sont toujours pas au niveau des besoins et de l’augmentation du nombre de bénéficiaires.
Une telle conjoncture entraîne des conséquences dramatiques sur la situation budgétaire de ces associations. Les 1 500 bénévoles des antennes girondines du Secours populaire français se sentent démunis face au manque de moyens accordés et s’inquiètent de ne pas pouvoir répondre aux besoins de nouveaux arrivants dans les comités locaux.
Madame la ministre, je demande au Gouvernement d’agir pour que les dispositifs européens et nationaux d’aide alimentaire soient renforcés à la hauteur de la situation actuelle, marquée par l’inflation et l’augmentation du nombre de bénéficiaires.
Un renforcement significatif, hors appels à projets, garantirait aux associations les moyens financiers nécessaires pour leur mission d’aide alimentaire. Les associations seraient en mesure de faire mieux face à une situation d’urgence. Elles demandent également à bénéficier d’aides spécifiques.

Madame la ministre, sur l'initiative de la commission spéciale du Sénat, la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite Asap, votée en 2020, a prévu la création d'antennes d'officines pour assurer l'accès aux produits de santé dans les communes à très faible population.
Force est de constater que le lancement de ce dispositif n'est toujours pas effectif, car le décret relatif aux territoires fragiles en matière d'offre pharmaceutique, attendu depuis de nombreux mois, n'a toujours pas été publié.
Il est regrettable que, trois ans après sa promulgation, ce dispositif n'ait trouvé aucune application effective. Les services du ministère de la santé ont récemment confirmé que seul un projet d'antenne de pharmacie avait été autorisé – c'était en octobre 2023 dans les Alpes-Maritimes –, mais face à plusieurs obstacles juridiques et à des difficultés de recrutement, il n'a pas été possible d'ouvrir l'antenne prévue.
Je souscris pleinement à l'objectif poursuivi par cette expérimentation, qui permet de maintenir une offre pharmaceutique dans des communes très faiblement peuplées qui en seraient, sinon, dépourvues. Par ailleurs, j'ai pleinement conscience des enjeux attachés à la réorganisation du réseau officinal et au maintien de l'offre pharmaceutique dans nos territoires ruraux.
L'article 2 decies de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, qui a été définitivement adoptée hier par le Sénat, permettra-t-il enfin de lever les principaux obstacles identifiés ?
Le Gouvernement prévoit-il d'étendre le champ des dérogations et de clarifier le statut juridique des antennes et leur lien avec l'officine de rattachement ?
Outre la possibilité pour le pharmacien de dispenser des médicaments au sein de l'antenne, lui permettrez-vous d'y exercer les autres missions essentielles réalisées par les pharmaciens d'officine : éducation thérapeutique et accompagnement de patients, conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé, prescription et administration de certains vaccins ?
Enfin, la facturation dans les antennes sera-t-elle autorisée pour les pharmaciens adjoints ne disposant pas d'une carte professionnelle de santé ?
Madame la sénatrice, vous interrogez Mme la ministre des solidarités et des familles sur le soutien apporté aux associations d’aide alimentaire.
Afin de lutter contre la précarité, le Gouvernement a mis en place le pacte des solidarités, qui vise à garantir l’accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous, en particulier pour les personnes en situation de vulnérabilité. Ce programme se distingue par un engagement financier sans précédent et par la mise en œuvre de mesures concrètes pour soutenir les associations d’aide alimentaire et les familles en difficulté.
Pour l’année en cours, le Gouvernement a alloué un budget exceptionnel de 156 millions d’euros à l’aide alimentaire nationale, soit plus du double par rapport à l’année 2021. Cette enveloppe budgétaire sert à soutenir les grandes associations telles que les Restos du Cœur, les banques alimentaires, le Secours populaire français et la Croix-Rouge, dans le cadre du programme « Mieux manger pour tous ! ». J’en profite d’ailleurs pour saluer le travail mené au quotidien par ces associations.
En outre, 66 millions d’euros sont dédiés aux associations locales, ce qui souligne l’importance de l’aide de proximité.
Le programme « Mieux manger pour tous ! » a été conçu pour être étendu et renforcé au cours du quinquennat, avec une projection de 100 millions d’euros par an d’ici à 2027. Une telle initiative montre la volonté du Gouvernement de s’engager sur le long terme pour lutter contre la précarité alimentaire.
Il a également sollicité la participation des grandes entreprises pour des dons en nature, doublant ainsi l’aide apportée. Permettez-moi de vous donner un exemple concret : grâce à cet appel, les Restos du Cœur pourront recevoir une aide équivalente à plus de 2, 5 millions d’euros.
En août, le Gouvernement a réussi à obtenir des fonds européens supplémentaires pour l’aide alimentaire, à hauteur de 80 millions d’euros pour la période 2024-2027.
Pour conclure, le pacte des solidarités reflète la détermination du Gouvernement à soutenir les associations d’aide alimentaire et à garantir une assistance aux populations vulnérables, particulièrement au cours de la crise que nous connaissons, marquée par l’inflation.
Monsieur le sénateur Lozach, la France compte en moyenne, pour 100 000 habitants, trente officines, dont plus d'un tiers sont installées dans des communes de moins de 5 000 habitants. Les règles relatives au maillage des officines ont donc permis d'assurer une bonne couverture pharmaceutique sur le territoire.
L'expérimentation relative aux antennes de pharmacie vise à permettre une adaptation locale pour répondre aux besoins de la population dans certaines zones moins desservies.
Dans le cas où la seule officine du village cesse son activité sans avoir trouvé de repreneur – en Côte-d'Or, où je vis, ce cas existe malheureusement –, l'agence régionale de santé (ARS) pourra autoriser une antenne de pharmacie qui sera rattachée à une pharmacie à proximité.
Toutefois, en raison de difficultés juridiques et techniques, l'expérimentation n'avait pas pu être mise en œuvre. C'est pourquoi elle a été réintroduite dans le cadre de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, que vous avez adoptée. Une mesure prévoit ainsi d'étendre le champ des dérogations permettant de mettre en œuvre les antennes et précise leur statut juridique.
Les antennes pourront ainsi proposer l'intégralité des missions qui sont habituellement réalisées dans les officines, facturation incluse. Les conditions seront donc très prochainement réunies pour lancer concrètement cette expérimentation dans les régions concernées.
Je le précise, l'expérimentation des antennes est à distinguer du décret sur l'identification des territoires fragiles. En effet, l'ordonnance du 3 janvier 2018 prévoit qu'un décret détermine les conditions dans lesquelles sont définis les territoires pour lesquels l'accès aux médicaments n'est pas assuré de manière satisfaisante. Les transferts et les regroupements de pharmacie y seront donc facilités. Au début de l'année 2024, une nouvelle version de ce décret sera présentée. Les ARS seront chargées de fixer par arrêté la liste des territoires concernés au sein de leurs régions.
expérimentation des antennes d’officines pharmaceutiques

Madame la ministre, sur l’initiative de la commission spéciale du Sénat, la loi d’accélération et de simplification de l’action publique, dite Asap, votée en 2020, a prévu la création d’antennes d’officines pour assurer l’accès aux produits de santé dans les communes à très faible population.
Force est de constater que le lancement de ce dispositif n’est toujours pas effectif, car le décret relatif aux territoires fragiles en matière d’offre pharmaceutique, attendu depuis de nombreux mois, n’a toujours pas été publié.
Il est regrettable que, trois ans après sa promulgation, ce dispositif n’ait trouvé aucune application effective. Les services du ministère de la santé ont récemment confirmé que seul un projet d’antenne de pharmacie avait été autorisé – c’était en octobre 2023 dans les Alpes-Maritimes –, mais face à plusieurs obstacles juridiques et à des difficultés de recrutement, il n’a pas été possible d’ouvrir l’antenne prévue.
Je souscris pleinement à l’objectif poursuivi par cette expérimentation, qui permet de maintenir une offre pharmaceutique dans des communes très faiblement peuplées qui en seraient, sinon, dépourvues. Par ailleurs, j’ai pleinement conscience des enjeux attachés à la réorganisation du réseau officinal et au maintien de l’offre pharmaceutique dans nos territoires ruraux.
L’article 2 decies de la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, qui a été définitivement adoptée hier par le Sénat, permettra-t-il enfin de lever les principaux obstacles identifiés ?
Le Gouvernement prévoit-il d’étendre le champ des dérogations et de clarifier le statut juridique des antennes et leur lien avec l’officine de rattachement ?
Outre la possibilité pour le pharmacien de dispenser des médicaments au sein de l’antenne, lui permettrez-vous d’y exercer les autres missions essentielles réalisées par les pharmaciens d’officine : éducation thérapeutique et accompagnement de patients, conseils et prestations destinés à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé, prescription et administration de certains vaccins ?
Enfin, la facturation dans les antennes sera-t-elle autorisée pour les pharmaciens adjoints ne disposant pas d’une carte professionnelle de santé ?

Madame la ministre, sur l’initiative de la commission spéciale du Sénat, la loi d’accélération et de simplification de l’action publique, dite loi Asap, votée en 2020, a prévu la création d’antennes d’officines pour assurer l’accès aux produits de santé dans les communes à très faible population.
Force est de constater que le lancement de ce dispositif n’est toujours pas effectif, car le décret relatif aux territoires fragiles en matière d’offre pharmaceutique, attendu depuis de nombreux mois, n’a toujours pas été publié.
Il est regrettable que, trois ans après sa promulgation, ce dispositif n’ait trouvé aucune application effective. Les services du ministère de la santé ont récemment confirmé que seul un projet d’antenne de pharmacie avait été autorisé – c’était en octobre 2023 dans les Alpes-Maritimes –, mais face à plusieurs obstacles juridiques et à des difficultés de recrutement, il n’a pas été possible d’ouvrir l’antenne prévue.
Je souscris pleinement à l’objectif visé par cette expérimentation, qui permet de maintenir une offre pharmaceutique dans des communes très faiblement peuplées qui en seraient, sinon, dépourvues. Par ailleurs, j’ai pleinement conscience des enjeux attachés à la réorganisation du réseau officinal et au maintien de l’offre pharmaceutique dans nos territoires ruraux.
L’article 2 decies de la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, qui a été définitivement adoptée hier par le Sénat, permettra-t-il enfin de lever les principaux obstacles identifiés ?
Le Gouvernement prévoit-il d’étendre le champ des dérogations et de clarifier le statut juridique des antennes et leur lien avec l’officine de rattachement ?
Outre la possibilité pour le pharmacien de dispenser des médicaments au sein de l’antenne, lui permettrez-vous d’y exercer les autres missions essentielles réalisées par les pharmaciens d’officine : éducation thérapeutique et accompagnement de patients, conseils et prestations destinés à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé, prescription et administration de certains vaccins ?
Enfin, la facturation dans les antennes sera-t-elle autorisée pour les pharmaciens adjoints ne disposant pas d’une carte professionnelle de santé ?

Madame la ministre, je souhaite vous alerter sur la situation des infirmières libérales dans les vallées de la Roya, de la Bévéra et de la Tinée-Vésubie de mon département des Alpes-Maritimes. Elles sont confrontées à un nœud de difficultés, symptôme du malaise des infirmières en milieu rural sur l'ensemble du territoire national.
Depuis le 1er septembre 2023, les infirmières de ces vallées ont cessé d'assurer les prises de sang de leurs patients. En effet, elles percevaient jusque-là 3 euros par prise de sang par le biais d'accords financiers avec des laboratoires d'analyse. Or l'État et la sécurité sociale ont mis un coup d'arrêt au système en place.
Leurs conditions de travail en milieu rural sont pourtant difficiles, eu égard au nombre de kilomètres effectués et à la hausse du prix du carburant.
Les habitants sont dorénavant contraints de se rendre dans des laboratoires plus proches du littoral et les patients qui sont dans l'incapacité de se déplacer subissent des retards.
À cela s'ajoute le nombre considérable de kilomètres parcourus en voiture par les infirmières pour les visites. Or le montant des indemnités kilométriques est profondément inégalitaire en montagne, si on le compare à celui d'autres professions, notamment les médecins.
Enfin, il faut considérer la non-prise en compte des indemnités kilométriques entre hameaux séparés à l'intérieur d'une même commune.
Aussi, madame la ministre, je souhaite savoir ce que le Gouvernement compte faire pour répondre à cette situation intenable.
En particulier, quand allez-vous enfin revaloriser les indemnités kilométriques ?
Monsieur le sénateur Lozach, la France compte en moyenne, pour 100 000 habitants, trente officines, dont plus d’un tiers sont installées dans des communes de moins de 5 000 habitants. Les règles relatives au maillage des officines ont donc permis d’assurer une bonne couverture pharmaceutique sur le territoire.
L’expérimentation relative aux antennes de pharmacie vise à permettre une adaptation locale pour répondre aux besoins de la population dans certaines zones moins desservies.
Dans le cas où la seule officine du village cesse son activité sans avoir trouvé de repreneur – en Côte-d’Or, où je vis, ce cas existe malheureusement –, l’agence régionale de santé (ARS) pourra autoriser une antenne de pharmacie qui sera rattachée à une pharmacie à proximité.
Toutefois, en raison de difficultés juridiques et techniques, l’expérimentation n’avait pas pu être mise en œuvre. C’est pourquoi elle a été réintroduite dans le cadre de la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, que vous avez adoptée. Une mesure prévoit ainsi d’étendre le champ des dérogations permettant de mettre en œuvre les antennes et précise leur statut juridique.
Les antennes pourront ainsi proposer l’intégralité des missions qui sont habituellement réalisées dans les officines, facturation incluse. Les conditions seront donc très prochainement réunies pour lancer concrètement cette expérimentation dans les régions concernées.
Je le précise, l’expérimentation des antennes est à distinguer du décret sur l’identification des territoires fragiles. En effet, l’ordonnance du 3 janvier 2018 prévoit qu’un décret détermine les conditions dans lesquelles sont définis les territoires pour lesquels l’accès aux médicaments n’est pas assuré de manière satisfaisante. Les transferts et les regroupements de pharmacie y seront donc facilités. Au début de l’année 2024, une nouvelle version de ce décret sera présentée. Les ARS seront chargées de fixer par arrêté la liste des territoires concernés au sein de leurs régions.
Monsieur le sénateur Tabarot, vous l'avez dit, les infirmières et les infirmiers jouent un rôle essentiel dans notre système de soins, notamment auprès des populations les plus fragiles et en matière de prise en charge à domicile. Aussi, les indemnités relatives à leurs déplacements représentent en effet un enjeu majeur.
C'est pourquoi le ministère de la santé et de la prévention, en lien avec l'assurance maladie, a mené des travaux sur les indemnités kilométriques afin d'adapter leurs modalités de facturation aux spécificités locales, et notamment aux différences d'accès aux soins. Ces travaux ont abouti au protocole d'accord national du 6 mai 2021, qui prévoit la possibilité pour les partenaires conventionnels de conclure des accords locaux portant sur les modalités de facturation des indemnités kilométriques.
Par ailleurs, les négociations engagées en mai dernier entre l'assurance maladie et les infirmiers ont abouti, le 16 juin 2023, à la signature d'un accord qui renforce la prise en charge des patients à domicile, donc le rôle des infirmiers.
Ce texte acte des évolutions importantes : augmentation de 10 % de l'indemnité forfaitaire de déplacement et généralisation, à partir d'octobre 2023 - c'est tout récent -, du déploiement du bilan de soins infirmiers pour les patients dépendants de moins de 85 ans et suivis par l'infirmier à domicile. Il s'agit là de la dernière étape du déploiement de ce bilan, qui constitue une réforme majeure en matière de prise en charge des patients dépendants à domicile.
Concernant plus particulièrement les accords financiers entre les infirmiers libéraux et les laboratoires d'analyse, l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS Paca) et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes ont engagé un travail qui les a conduits, entre autres, à étudier la possibilité d'une adaptation des horaires de ramassage par coursier des échantillons ou encore d'une subvention institutionnelle pour prise en compte de la pénibilité et des contraintes spécifiques aux zones de montagne.
Le ministre ne manquera pas de vous informer des suites qui seront données à ce travail.
situation difficile des infirmières libérales en milieu rural dans les vallées de la roya et de la bévéra dans le département des alpes-maritimes

La parole est à M. Philippe Tabarot, auteur de la question n° 988, adressée à M. le ministre de la santé et de la prévention.

Madame la ministre, je vous entends, mais ce n'est pas suffisant. Ces problèmes et ces différences sans fondement alimentent la précarité des infirmiers libéraux, dont l'activité est pourtant essentielle au bon fonctionnement de notre système de soins, et portent un coup à des patients qui souffrent déjà très fortement.

Madame la ministre, je souhaite vous alerter sur la situation des infirmières libérales dans les vallées de la Roya, de la Bévéra et de la Tinée-Vésubie de mon département des Alpes-Maritimes. Elles sont confrontées à un nœud de difficultés, symptôme du malaise des infirmières en milieu rural sur l’ensemble du territoire national.
Depuis le 1er septembre 2023, les infirmières de ces vallées ont cessé d’assurer les prises de sang de leurs patients. En effet, elles percevaient jusque-là 3 euros par prise de sang par le biais d’accords financiers avec des laboratoires d’analyse. Or l’État et la sécurité sociale ont mis un coup d’arrêt au système en place.
Leurs conditions de travail en milieu rural sont pourtant difficiles, eu égard au nombre de kilomètres effectués et à la hausse du prix du carburant.
Les habitants sont dorénavant contraints de se rendre dans des laboratoires plus proches du littoral et les patients qui sont dans l’incapacité de se déplacer subissent des retards.
À cela s’ajoute le nombre considérable de kilomètres parcourus en voiture par les infirmières pour les visites. Or le montant des indemnités kilométriques est profondément inégalitaire en montagne, si on le compare à celui d’autres professions, notamment les médecins.
Enfin, il faut considérer la non-prise en compte des indemnités kilométriques entre hameaux séparés à l’intérieur d’une même commune.
Aussi, madame la ministre, je souhaite savoir ce que le Gouvernement compte faire pour répondre à cette situation intenable.
En particulier, quand allez-vous enfin revaloriser les indemnités kilométriques ?
Monsieur le sénateur Tabarot, vous l’avez dit, les infirmières et les infirmiers jouent un rôle essentiel dans notre système de soins, notamment auprès des populations les plus fragiles et en matière de prise en charge à domicile. Aussi, les indemnités relatives à leurs déplacements représentent en effet un enjeu majeur.
C’est pourquoi le ministère de la santé et de la prévention, en lien avec l’assurance maladie, a mené des travaux sur les indemnités kilométriques afin d’adapter leurs modalités de facturation aux spécificités locales, et notamment aux différences d’accès aux soins. Ces travaux ont abouti au protocole d’accord national du 6 mai 2021, qui prévoit la possibilité pour les partenaires conventionnels de conclure des accords locaux portant sur les modalités de facturation des indemnités kilométriques.
Par ailleurs, les négociations engagées en mai dernier entre l’assurance maladie et les infirmiers ont abouti, le 16 juin 2023, à la signature d’un accord qui renforce la prise en charge des patients à domicile, donc le rôle des infirmiers.
Ce texte acte des évolutions importantes : augmentation de 10 % de l’indemnité forfaitaire de déplacement et généralisation, à partir d’octobre 2023 - c’est tout récent -, du déploiement du bilan de soins infirmiers pour les patients dépendants de moins de 85 ans et suivis par l’infirmier à domicile. Il s’agit là de la dernière étape du déploiement de ce bilan, qui constitue une réforme majeure en matière de prise en charge des patients dépendants à domicile.
Concernant plus particulièrement les accords financiers entre les infirmiers libéraux et les laboratoires d’analyse, l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS Paca) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes ont engagé un travail qui les a conduits, entre autres, à étudier la possibilité d’une adaptation des horaires de ramassage par coursier des échantillons ou encore d’une subvention institutionnelle pour prise en compte de la pénibilité et des contraintes spécifiques aux zones de montagne.
Le ministre ne manquera pas de vous informer des suites qui seront données à ce travail.

Madame la ministre, je souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur le problème du transport d'urgence dans le secteur du nord-ouest seine-et-marnais, frontalier de trois départements.
Les communes de Mauregard, Compans, Marchémoret, Villeneuve-sous-Dammartin, Othis, Le Mesnil-Amelot, Dammartin-en-Goële, Villeparisis, Mitry-Mory, dont la population s'élève au total de plus de 60 000 habitants, se trouvent à proximité de l'hôpital Robert-Ballanger, en Seine-Saint-Denis, de celui de Senlis, dans l'Oise, et de celui de Gonesse, dans le Val-d'Oise.
Pourtant, les pompiers doivent acheminer les victimes vers les hôpitaux selon une sectorisation totalement inadaptée.
J'en veux pour exemple le cas de Mitry-Mory, dont la maire et les habitants sont fortement mobilisés à propos de cet enjeu depuis des années.
En cas d'intervention, les pompiers y sont contraints de faire appel au service mobile d'urgence et de réanimation (Smur) de Meaux et de transporter la victime à l'hôpital de Jossigny, à plus de 30 kilomètres, alors que l'hôpital Robert-Ballanger, situé à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, est à 10 kilomètres. Cela a des incidences lourdes. Tout d'abord, les délais d'intervention du Smur de Meaux étant bien trop longs, la prise en charge de la victime se fait avec retard, ce qui accroît les risques que le pronostic vital soit engagé. Ensuite, le choix de la victime n'est pas pris en considération ; son dossier médical est à l'hôpital Robert-Ballanger, lequel est par ailleurs desservi par les transports en commun, au contraire de celui de Jossigny. On déplore enfin une incidence opérationnelle concrète sur la disponibilité des véhicules de secours mobilisés pour le transport de victimes sur les axes routiers les plus encombrés de Seine-et-Marne ; ainsi le centre de secours se trouve-t-il privé de ressources humaines et matérielles nécessaires à des interventions urgentes.
C'est pourquoi nombre d'élus, mais aussi des représentants des hôpitaux, de la délégation départementale de Seine-et-Marne de l'agence régionale de santé d'Île-de-France (ARS 77) et du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne (Sdis 77), analysent avec une grande attention la demande qui s'exprime actuellement afin que les services de secours puissent acheminer les patients vers l'hôpital le plus proche, comme c'est d'ailleurs le cas à Paris. La seule préoccupation qui doit nous guider est de sauver des vies, et non de respecter des frontières qui résultent de l'absence de prise en compte des réalités territoriales et s'inscrivent dans le contexte d'une politique de regroupement d'hôpitaux éloignant toujours plus l'offre de soins des habitants.
Madame la ministre, comment le Gouvernement compte-t-il contribuer à ce que l'on avance dans cette direction ?

Madame la ministre, je vous entends, mais ce n’est pas suffisant. Ces problèmes et ces différences sans fondement alimentent la précarité des infirmiers libéraux, dont l’activité est pourtant essentielle au bon fonctionnement de notre système de soins, et portent un coup à des patients qui souffrent déjà très fortement.
Madame la sénatrice Margaté, comme vous le soulignez, les patients de la commune de Mitry-Mory sont plus proches des établissements de Seine-Saint-Denis que de Jossigny, en Seine-et-Marne. Mais les services d'accueil des urgences des hôpitaux publics et privés de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fermés aux patients du territoire Roissy Pays de France.
À titre d'exemple, 10 % de la patientèle du service d'accueil des urgences du centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger provient de communes de Seine-et-Marne. Les Seine-et-Marnais ont ainsi représenté plus de 7 200 passages aux urgences de Robert-Ballanger en 2022. De même, les patients de Seine-et-Marne représentent 34 % des passages – 13 600 passages en 2022 – aux urgences de l'hôpital du Vert-Galant, situé à Tremblay-en-France.
Quant aux urgences du groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil, elles font actuellement l'objet, vous le savez, de travaux de rénovation et d'agrandissement. Ces travaux sont réalisés en site occupé, ce qui a pour conséquence de réduire considérablement la superficie de ce service, dont les espaces étaient déjà très exigus. La limitation de l'accueil des transports sanitaires y est temporaire et sera revue à la fin des travaux.
Plus généralement, une réforme majeure a été engagée en 2022 en matière d'organisation de la garde et des transports sanitaires urgents afin d'améliorer la réponse des entreprises de transport sanitaire privé lorsqu'elles interviennent à la demande du service d'aide médicale urgente (Samu).
Cette réforme est déclinée dans chaque département, depuis l'été 2022, par un programme de travail.
L'organisation de la garde a évolué : d'un véhicule disponible par secteur de vingt heures à huit heures, on est passé à au moins un véhicule de garde disponible par secteur vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Certains secteurs - Jossigny, Meaux et Melun - bénéficient aussi d'un second moyen de garde pendant tout ou partie de la journée, en raison de la plus forte demande en transport sanitaire d'urgence dans ces zones démographiquement très denses.
Au total, ce sont entre neuf et onze ambulances de garde qui sont désormais à la disposition du Samu 77 pour répondre aux besoins de la population.
transport d’urgence et zone géographique

Madame la ministre, je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur le problème du transport d’urgence dans le secteur du nord-ouest seine-et-marnais, frontalier de trois départements.
Les communes de Mauregard, Compans, Marchémoret, Villeneuve-sous-Dammartin, Othis, Le Mesnil-Amelot, Dammartin-en-Goële, Villeparisis, Mitry-Mory, dont la population s’élève au total de plus de 60 000 habitants, se trouvent à proximité de l’hôpital Robert-Ballanger, en Seine-Saint-Denis, de celui de Senlis, dans l’Oise, et de celui de Gonesse, dans le Val-d’Oise.
Pourtant, les pompiers doivent acheminer les victimes vers les hôpitaux selon une sectorisation totalement inadaptée.
J’en veux pour exemple le cas de Mitry-Mory, dont la maire et les habitants sont fortement mobilisés à propos de cet enjeu depuis des années.
En cas d’intervention, les pompiers y sont contraints de faire appel au service mobile d’urgence et de réanimation (Smur) de Meaux et de transporter la victime à l’hôpital de Jossigny, à plus de 30 kilomètres, alors que l’hôpital Robert-Ballanger, situé à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, est à 10 kilomètres. Cela a des incidences lourdes. Tout d’abord, les délais d’intervention du Smur de Meaux étant bien trop longs, la prise en charge de la victime se fait avec retard, ce qui accroît les risques que le pronostic vital soit engagé. Ensuite, le choix de la victime n’est pas pris en considération ; son dossier médical est à l’hôpital Robert-Ballanger, lequel est par ailleurs desservi par les transports en commun, au contraire de celui de Jossigny. On déplore enfin une incidence opérationnelle concrète sur la disponibilité des véhicules de secours mobilisés pour le transport de victimes sur les axes routiers les plus encombrés de Seine-et-Marne ; ainsi le centre de secours se trouve-t-il privé de ressources humaines et matérielles nécessaires à des interventions urgentes.
C’est pourquoi nombre d’élus, mais aussi des représentants des hôpitaux, de la délégation départementale de Seine-et-Marne de l’agence régionale de santé d’Île-de-France (ARS 77) et du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne (Sdis 77), analysent avec une grande attention la demande qui s’exprime actuellement afin que les services de secours puissent acheminer les patients vers l’hôpital le plus proche, comme c’est d’ailleurs le cas à Paris. La seule préoccupation qui doit nous guider est de sauver des vies, et non de respecter des frontières qui résultent de l’absence de prise en compte des réalités territoriales et s’inscrivent dans le contexte d’une politique de regroupement d’hôpitaux éloignant toujours plus l’offre de soins des habitants.
Madame la ministre, comment le Gouvernement compte-t-il contribuer à ce que l’on avance dans cette direction ?

Madame la ministre, je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur le problème du transport d’urgence dans le secteur du nord-ouest seine-et-marnais, frontalier de trois départements.
Les communes de Mauregard, Compans, Marchémoret, Villeneuve-sous-Dammartin, Othis, Le Mesnil-Amelot, Dammartin-en-Goële, Villeparisis, Mitry-Mory, dont la population s’élève au total de plus de 60 000 habitants, se trouvent à proximité de l’hôpital Robert-Ballanger, en Seine-Saint-Denis, de celui de Senlis, dans l’Oise, et de celui de Gonesse, dans le Val-d’Oise.
Pourtant, les pompiers doivent acheminer les victimes vers les hôpitaux selon une sectorisation totalement inadaptée.
J’en veux pour exemple le cas de Mitry-Mory, dont la maire et les habitants sont fortement mobilisés à propos de cet enjeu depuis des années.
En cas d’intervention, les pompiers y sont contraints de faire appel au service mobile d’urgence et de réanimation (Smur) de Meaux et de transporter la victime à l’hôpital de Jossigny, à plus de 30 kilomètres, alors que l’hôpital Robert-Ballanger, situé à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, est à 10 kilomètres. Cela a des incidences lourdes.
Tout d’abord, les délais d’intervention du Smur de Meaux étant bien trop longs, la prise en charge de la victime se fait avec retard, ce qui accroît les risques que le pronostic vital soit engagé.
Ensuite, le choix de la victime n’est pas pris en considération ; son dossier médical est à l’hôpital Robert-Ballanger, lequel est par ailleurs desservi par les transports en commun, au contraire de celui de Jossigny.
Enfin, on déplore une incidence opérationnelle concrète sur la disponibilité des véhicules de secours mobilisés pour le transport de victimes sur les axes routiers les plus encombrés de Seine-et-Marne ; ainsi le centre de secours se trouve-t-il privé de ressources humaines et matérielles nécessaires à des interventions urgentes.
C’est pourquoi nombre d’élus, mais aussi des représentants des hôpitaux, de la délégation départementale de Seine-et-Marne de l’agence régionale de santé d’Île-de-France (ARS 77) et du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne (Sdis 77), analysent avec une grande attention la demande qui s’exprime actuellement afin que les services de secours puissent acheminer les patients vers l’hôpital le plus proche, comme c’est d’ailleurs le cas à Paris. La seule préoccupation qui doit nous guider est de sauver des vies, et non de respecter des frontières qui résultent de l’absence de prise en compte des réalités territoriales et s’inscrivent dans le contexte d’une politique de regroupement d’hôpitaux éloignant toujours plus l’offre de soins des habitants.
Madame la ministre, comment le Gouvernement compte-t-il contribuer à ce que l’on avance dans cette direction ?

C'est aujourd'hui acté : l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » se poursuivra – presque – normalement en 2024.
Il s'agit d'une nouvelle rassurante après quelques annonces déstabilisantes pour ce dispositif qui a fait ses preuves.
Aujourd'hui, cinquante-huit territoires sont habilités et enregistrent des résultats probants, des personnes éloignées de l'emploi qui sont au chômage en moyenne depuis cinq ans étant embauchées en contrat à durée indéterminée dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire. À ce jour, plus de soixante entreprises y emploient près de 2 200 personnes.
Créé en 2016, ce dispositif bénéficiait d'un réel soutien de l'État.
Or un premier coup a été asséné à cette expérimentation avec la réduction de la participation de l'État au financement de l'emploi des salariés embauchés, qui est passée le 1er octobre 2023 de 102 % à 95 % du Smic brut.
A été parallèlement annoncé en conseil des ministres, le 27 septembre 2023, un financement de l'État de 69 millions d'euros, montant insuffisant inscrit dans le projet de loi de finances pour 2024. Une telle dotation aurait eu pour conséquences l'arrêt net des embauches au sein des cinquante-huit territoires habilités et la remise en question de l'entrée de nouveaux territoires dans le dispositif.
Je salue le recul du Gouvernement, qui s'est engagé sur des crédits de 80 millions d'euros en faveur du dispositif – il est à souligner néanmoins que les acteurs du champ de l'insertion estimaient le besoin à 89 millions d'euros.
Compte tenu de l'enjeu en matière d'accès à l'emploi des publics les plus fragiles, sachant par ailleurs que l'évaluation du dispositif est prévue en 2026 et qu'il est donc nécessaire de permettre à cette expérimentation de se développer dans de bonnes conditions, j'ai deux questions à poser à Mme la ministre.
Premièrement, pouvez-vous vous engager dès maintenant à rouvrir la discussion courant 2024 si le budget prévu de 80 millions d'euros s'avère insuffisant ? Cette question se pose d'autant plus que de nouveaux territoires entreront dans le dispositif.
Deuxièmement, l'évaluation du dispositif en 2026 vise à décider de sa pérennisation. Pouvez-vous, jusqu'à cette échéance, garantir une visibilité aux territoires habilités via un engagement pérenne et stable de l'État ?
Madame la sénatrice Margaté, comme vous le soulignez, les patients de la commune de Mitry-Mory sont plus proches des établissements de Seine-Saint-Denis que de Jossigny, en Seine-et-Marne. Mais les services d’accueil des urgences des hôpitaux publics et privés de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fermés aux patients du territoire Roissy Pays de France.
À titre d’exemple, 10 % de la patientèle du service d’accueil des urgences du centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger provient de communes de Seine-et-Marne. Les Seine-et-Marnais ont ainsi représenté plus de 7 200 passages aux urgences de Robert-Ballanger en 2022. De même, les patients de Seine-et-Marne représentent 34 % des passages – 13 600 passages en 2022 – aux urgences de l’hôpital du Vert-Galant, situé à Tremblay-en-France.
Quant aux urgences du groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil, elles font actuellement l’objet, vous le savez, de travaux de rénovation et d’agrandissement. Ces travaux sont réalisés en site occupé, ce qui a pour conséquence de réduire considérablement la superficie de ce service, dont les espaces étaient déjà très exigus. La limitation de l’accueil des transports sanitaires y est temporaire et sera revue à la fin des travaux.
Plus généralement, une réforme majeure a été engagée en 2022 en matière d’organisation de la garde et des transports sanitaires urgents afin d’améliorer la réponse des entreprises de transport sanitaire privé lorsqu’elles interviennent à la demande du service d’aide médicale urgente (Samu).
Cette réforme est déclinée dans chaque département, depuis l’été 2022, par un programme de travail.
L’organisation de la garde a évolué : d’un véhicule disponible par secteur de vingt heures à huit heures, on est passé à au moins un véhicule de garde disponible par secteur vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Certains secteurs - Jossigny, Meaux et Melun - bénéficient aussi d’un second moyen de garde pendant tout ou partie de la journée, en raison de la plus forte demande en transport sanitaire d’urgence dans ces zones démographiquement très denses.
Au total, ce sont entre neuf et onze ambulances de garde qui sont désormais à la disposition du Samu 77 pour répondre aux besoins de la population.
Madame la sénatrice Margaté, comme vous le soulignez, les patients de la commune de Mitry-Mory sont plus proches des établissements de la Seine-Saint-Denis que de Jossigny, en Seine-et-Marne. Mais les services d’accueil des urgences des hôpitaux publics et privés de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fermés aux patients du territoire Roissy Pays de France.
À titre d’exemple, 10 % de la patientèle du service d’accueil des urgences du centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger provient de communes de Seine-et-Marne. Les Seine-et-Marnais ont ainsi représenté plus de 7 200 passages aux urgences de Robert-Ballanger en 2022. De même, les patients de Seine-et-Marne représentent 34 % des passages – 13 600 passages en 2022 – aux urgences de l’hôpital du Vert-Galant, situé à Tremblay-en-France.
Quant aux urgences du groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil, elles font actuellement l’objet, vous le savez, de travaux de rénovation et d’agrandissement. Ces travaux sont réalisés en site occupé, ce qui a pour conséquence de réduire considérablement la superficie de ce service, dont les espaces étaient déjà très exigus. La limitation de l’accueil des transports sanitaires y est temporaire et sera revue à la fin des travaux.
Plus généralement, une réforme majeure a été engagée en 2022 en matière d’organisation de la garde et des transports sanitaires urgents afin d’améliorer la réponse des entreprises de transport sanitaire privé lorsqu’elles interviennent à la demande du service d’aide médicale urgente (Samu).
Cette réforme est déclinée dans chaque département, depuis l’été 2022, par un programme de travail.
L’organisation de la garde a évolué : d’un véhicule disponible par secteur de vingt heures à huit heures, on est passé à au moins un véhicule de garde disponible par secteur vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Certains secteurs – Jossigny, Meaux et Melun – bénéficient aussi d’un second moyen de garde pendant tout ou partie de la journée, en raison de la plus forte demande en transport sanitaire d’urgence dans ces zones démographiquement très denses.
Au total, ce sont entre neuf et onze ambulances de garde qui sont désormais à la disposition du Samu 77 pour répondre aux besoins de la population.
Madame la sénatrice Gacquerre, vous interrogez le Gouvernement sur le soutien à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » ; ce soutien est constant et les moyens que nous y consacrons sont encore renforcés en 2024.
Le Gouvernement a soutenu en 2020 la prolongation de cette expérimentation pour une durée de cinq ans - à l'époque, j'avais moi-même voté en faveur de cette mesure en tant que députée - afin d'habiliter cinquante nouveaux territoires en plus des dix territoires historiques. Ajoutons au tableau les 11 millions d'euros de crédits supplémentaires, enveloppe allouée après de nombreux échanges, actés lors de l'examen du PLF à l'Assemblée nationale.
Résultat : le budget de cette expérimentation est en nette augmentation en 2024. L'État lui consacrera près de 80 millions d'euros, soit une augmentation de plus de 35 millions d'euros, la plus forte hausse dans le budget du ministère du travail.
Ce montant semble suffisant pour assurer une montée en charge de l'expérimentation à la fois ambitieuse et cohérente avec le nombre d'habilitations envisagées en 2024. Il n'y a pas de diminution du soutien financier de l'État ni aucun recul en la matière : je tiens à vous rassurer, madame la sénatrice.
Par ailleurs, deux nouveaux territoires ont été habilités par arrêté, ce qui porte le total à soixante territoires. L'objectif est d'atteindre les 85 territoires habilités d'ici à la fin de l'expérimentation.
L'évaluation du dispositif est en cours, vous le savez. Le comité scientifique constitué début juin a démarré ses travaux. Attendons son rapport définitif, qui nous éclairera sur l'utilité du dispositif « territoires zéro chômeur de longue durée » et sur la durabilité de son modèle économique.
désengagement de l’état du dispositif « territoires zéro chômeur de longue durée »

C’est aujourd’hui acté : l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » se poursuivra – presque – normalement en 2024.
Il s’agit d’une nouvelle rassurante après quelques annonces déstabilisantes pour ce dispositif qui a fait ses preuves.
Aujourd’hui, cinquante-huit territoires sont habilités et enregistrent des résultats probants, des personnes éloignées de l’emploi qui sont au chômage en moyenne depuis cinq ans étant embauchées en contrat à durée indéterminée dans des entreprises de l’économie sociale et solidaire. À ce jour, plus de soixante entreprises y emploient près de 2 200 personnes.
Créé en 2016, ce dispositif bénéficiait d’un réel soutien de l’État.
Or un premier coup a été asséné à cette expérimentation avec la réduction de la participation de l’État au financement de l’emploi des salariés embauchés, qui est passée le 1er octobre 2023 de 102 % à 95 % du Smic brut.
A été parallèlement annoncé en conseil des ministres, le 27 septembre 2023, un financement de l’État de 69 millions d’euros, montant insuffisant inscrit dans le projet de loi de finances pour 2024. Une telle dotation aurait eu pour conséquences l’arrêt net des embauches au sein des cinquante-huit territoires habilités et la remise en question de l’entrée de nouveaux territoires dans le dispositif.
Je salue le recul du Gouvernement, qui s’est engagé sur des crédits de 80 millions d’euros en faveur du dispositif – il est à souligner néanmoins que les acteurs du champ de l’insertion estimaient le besoin à 89 millions d’euros.
Compte tenu de l’enjeu en matière d’accès à l’emploi des publics les plus fragiles, sachant par ailleurs que l’évaluation du dispositif est prévue en 2026 et qu’il est donc nécessaire de permettre à cette expérimentation de se développer dans de bonnes conditions, j’ai deux questions à poser à Mme la ministre.
Premièrement, pouvez-vous vous engager dès maintenant à rouvrir la discussion courant 2024 si le budget prévu de 80 millions d’euros s’avère insuffisant ? Cette question se pose d’autant plus que de nouveaux territoires entreront dans le dispositif.
Deuxièmement, l’évaluation du dispositif en 2026 vise à décider de sa pérennisation. Pouvez-vous, jusqu’à cette échéance, garantir une visibilité aux territoires habilités via un engagement pérenne et stable de l’État ?

C’est aujourd’hui acté : l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » se poursuivra – presque – normalement en 2024.
Il s’agit d’une nouvelle rassurante après quelques annonces déstabilisantes pour ce dispositif qui a fait ses preuves.
Aujourd’hui, 58 territoires sont habilités et enregistrent des résultats probants, des personnes éloignées de l’emploi qui sont au chômage en moyenne depuis cinq ans étant embauchées en contrat à durée indéterminée dans des entreprises de l’économie sociale et solidaire. À ce jour, plus de 60 entreprises y emploient près de 2 200 personnes.
Créé en 2016, ce dispositif bénéficiait d’un réel soutien de l’État.
Or un premier coup a été asséné à cette expérimentation avec la réduction de la participation de l’État au financement de l’emploi des salariés embauchés, qui est passée le 1er octobre 2023 de 102 % à 95 % du Smic brut.
A été parallèlement annoncé en conseil des ministres, le 27 septembre 2023, un financement de l’État de 69 millions d’euros, montant insuffisant inscrit dans le projet de loi de finances pour 2024. Une telle dotation aurait eu pour conséquences l’arrêt net des embauches au sein des 58 territoires habilités et la remise en question de l’entrée de nouveaux territoires dans le dispositif.
Je salue le recul du Gouvernement, qui s’est engagé sur des crédits de 80 millions d’euros en faveur du dispositif – il est à souligner néanmoins que les acteurs du champ de l’insertion estimaient le besoin à 89 millions d’euros.
Compte tenu de l’enjeu en matière d’accès à l’emploi des publics les plus fragiles, sachant par ailleurs que l’évaluation du dispositif est prévue en 2026 et qu’il est donc nécessaire de permettre à cette expérimentation de se développer dans de bonnes conditions, j’ai deux questions à poser à Mme la ministre.
Premièrement, pouvez-vous vous engager dès maintenant à rouvrir la discussion courant 2024 si le budget prévu de 80 millions d’euros s’avère insuffisant ? Cette question se pose d’autant plus que de nouveaux territoires entreront dans le dispositif.
Deuxièmement, l’évaluation du dispositif en 2026 vise à décider de sa pérennisation. Pouvez-vous, jusqu’à cette échéance, garantir une visibilité aux territoires habilités via un engagement pérenne et stable de l’État ?

Le centre régional jeunesse et sports (CRJS) de Petit-Couronne, dans le département de la Seine-Maritime, fait face à une diminution de 28 000 euros des subventions annuelles qui lui sont accordées par la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (Drajes) pour l'année 2023 et ses responsables craignent la suppression totale desdites subventions pour l'année 2024.
Le centre régional jeunesse et sports de Petit-Couronne est une structure majeure dans le domaine du sport sur le territoire de la métropole de Rouen, puisqu'il accueille 150 sportifs chaque année dans sept disciplines olympiques.
Il est par ailleurs pleinement engagé dans la dynamique des jeux Olympiques de Paris 2024 : il a été sélectionné en tant que centre de préparation aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris dans sept disciplines sportives différentes : athlétisme olympique et paralympique, badminton olympique, basketball, basketball fauteuil, judo olympique, tennis de table olympique.
Il est en outre, depuis plusieurs années, terre d'accueil de la solidarité olympique et permet à des sportifs venus du monde entier de s'entraîner en vue de la préparation des jeux Olympiques.
Toutefois, madame la ministre, malgré la qualité du centre, consacrée par le label Grand Insep de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et le passage de grands champions tel que Teddy Riner, l'avenir de cette structure semble de plus en plus flou pour les dix-neuf personnes qui y travaillent.
L'Agence nationale du sport a annoncé une diminution, voire une suppression, des subventions allouées au CRJS de Petit-Couronne ; la concrétisation de cette annonce aura pour conséquence la dégradation des services du centre et la perte de son attractivité, ce qui affectera les fédérations sportives du département.
Ces décisions vont à rebours de la volonté affichée par le Gouvernement de faire du sport la grande cause nationale de 2024, année des jeux Olympiques en France. La mobilisation en faveur d'une telle cause devrait au contraire nous encourager à soutenir partout le sport pour toutes et pour tous.
Dans ce contexte, madame la ministre, pouvez-vous me rassurer, et rassurer les sportifs professionnels et amateurs qui fréquentent le CRJS de Petit-Couronne, quant au maintien pour l'année 2024 d'un niveau de subvention qui soit à la hauteur des besoins de la structure ?
Madame la sénatrice Gacquerre, vous interrogez le Gouvernement sur le soutien à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » ; ce soutien est constant et les moyens que nous y consacrons sont encore renforcés en 2024.
Le Gouvernement a soutenu en 2020 la prolongation de cette expérimentation pour une durée de cinq ans - à l’époque, j’avais moi-même voté en faveur de cette mesure en tant que députée - afin d’habiliter cinquante nouveaux territoires en plus des dix territoires historiques. Ajoutons au tableau les 11 millions d’euros de crédits supplémentaires, enveloppe allouée après de nombreux échanges, actés lors de l’examen du PLF à l’Assemblée nationale.
Résultat : le budget de cette expérimentation est en nette augmentation en 2024. L’État lui consacrera près de 80 millions d’euros, soit une augmentation de plus de 35 millions d’euros, la plus forte hausse dans le budget du ministère du travail.
Ce montant semble suffisant pour assurer une montée en charge de l’expérimentation à la fois ambitieuse et cohérente avec le nombre d’habilitations envisagées en 2024. Il n’y a pas de diminution du soutien financier de l’État ni aucun recul en la matière : je tiens à vous rassurer, madame la sénatrice.
Par ailleurs, deux nouveaux territoires ont été habilités par arrêté, ce qui porte le total à soixante territoires. L’objectif est d’atteindre les 85 territoires habilités d’ici à la fin de l’expérimentation.
L’évaluation du dispositif est en cours, vous le savez. Le comité scientifique constitué début juin a démarré ses travaux. Attendons son rapport définitif, qui nous éclairera sur l’utilité du dispositif « territoires zéro chômeur de longue durée » et sur la durabilité de son modèle économique.
Madame la sénatrice Gacquerre, vous interrogez le Gouvernement sur le soutien à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » ; ce soutien est constant et les moyens que nous y consacrons sont encore renforcés en 2024.
Le Gouvernement a soutenu en 2020 la prolongation de cette expérimentation pour une durée de cinq ans - à l’époque, j’avais moi-même voté en faveur de cette mesure en tant que députée - afin d’habiliter 50 nouveaux territoires en plus des 10 territoires historiques. Ajoutons au tableau les 11 millions d’euros de crédits supplémentaires, enveloppe allouée après de nombreux échanges, actés lors de l’examen du PLF à l’Assemblée nationale.
Résultat : le budget de cette expérimentation est en nette augmentation en 2024. L’État lui consacrera près de 80 millions d’euros, soit une augmentation de plus de 35 millions d’euros, la plus forte hausse dans le budget du ministère du travail.
Ce montant semble suffisant pour assurer une montée en charge de l’expérimentation à la fois ambitieuse et cohérente avec le nombre d’habilitations envisagées en 2024. Il n’y a pas de diminution du soutien financier de l’État ni aucun recul en la matière : je tiens à vous rassurer, madame la sénatrice.
Par ailleurs, 2 nouveaux territoires ont été habilités par arrêté, ce qui porte le total à 60 territoires. L’objectif est d’atteindre les 85 territoires habilités d’ici à la fin de l’expérimentation.
L’évaluation du dispositif est en cours, vous le savez. Le comité scientifique constitué début juin a démarré ses travaux. Attendons son rapport définitif, qui nous éclairera sur l’utilité du dispositif « territoires zéro chômeur de longue durée » et sur la durabilité de son modèle économique.
Monsieur le sénateur Marie, malgré la restructuration du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives (Creps) d'Houlgate, en 2008, l'État a poursuivi son soutien au développement de la haute performance en Normandie, via notamment la mise à disposition de cadres d'État - trois postes de direction sur les sites de Petit-Couronne, Le Havre et Caen - et une subvention annuelle moyenne de 70 000 euros.
La nouvelle organisation territoriale de l'État, qui s'est traduite en 2020 par la création des Drajes et par un transfert des missions, a conduit à engager en 2022 la procédure d'installation en Normandie d'une mission régionale de la performance hébergée par le groupement d'intérêt public (GIP) Centre sportif de Normandie.
Afin d'asseoir sa montée en compétences, le ministère chargé des sports a financé trois postes : un poste de responsable régional de la haute performance et deux postes de conseiller haut niveau et haute performance, pour un montant total de 230 000 euros.
L'Agence nationale du sport octroie par ailleurs une subvention de 14 000 euros pour compléter le financement du poste de responsable régional de la haute performance. Elle participera également au financement des actions et des projets territoriaux de la maison régionale de la performance à destination des sportifs de haut niveau et de l'écosystème territorial : 150 000 euros, ce n'est pas rien.
Au total, ce sont donc près de 400 000 euros qui sont garantis annuellement au bénéfice du sport de haut niveau en Normandie.
L'Agence nationale du sport propose enfin un accompagnement des structures du territoire, notamment sur le volet des équipements ou sur celui de l'emploi. À cela s'ajoutent les moyens déjà alloués aux fédérations sportives au titre des programmes d'accession au sport de haut niveau via les projets sportifs fédéraux, soit plus de 700 000 euros versés au territoire normand en 2022.
Comme vous pouvez le constater, monsieur le sénateur, l'État est pleinement mobilisé sur le sujet.
subventions allouées au centre régional jeunesse et sports de petit-couronne

Le centre régional jeunesse et sports (CRJS) de Petit-Couronne, dans le département de la Seine-Maritime, fait face à une diminution de 28 000 euros des subventions annuelles qui lui sont accordées par la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (Drajes) pour l’année 2023 et ses responsables craignent la suppression totale desdites subventions pour l’année 2024.
Le centre régional jeunesse et sports de Petit-Couronne est une structure majeure dans le domaine du sport sur le territoire de la métropole de Rouen, puisqu’il accueille 150 sportifs chaque année dans sept disciplines olympiques.
Il est par ailleurs pleinement engagé dans la dynamique des jeux Olympiques de Paris 2024 : il a été sélectionné en tant que centre de préparation aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris dans sept disciplines sportives différentes : athlétisme olympique et paralympique, badminton olympique, basketball, basketball fauteuil, judo olympique, tennis de table olympique.
Il est en outre, depuis plusieurs années, terre d’accueil de la solidarité olympique et permet à des sportifs venus du monde entier de s’entraîner en vue de la préparation des jeux Olympiques.
Toutefois, madame la ministre, malgré la qualité du centre, consacrée par le label Grand Insep de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance et le passage de grands champions tel que Teddy Riner, l’avenir de cette structure semble de plus en plus flou pour les dix-neuf personnes qui y travaillent.
L’Agence nationale du sport a annoncé une diminution, voire une suppression, des subventions allouées au CRJS de Petit-Couronne ; la concrétisation de cette annonce aura pour conséquence la dégradation des services du centre et la perte de son attractivité, ce qui affectera les fédérations sportives du département.
Ces décisions vont à rebours de la volonté affichée par le Gouvernement de faire du sport la grande cause nationale de 2024, année des jeux Olympiques en France. La mobilisation en faveur d’une telle cause devrait au contraire nous encourager à soutenir partout le sport pour toutes et pour tous.
Dans ce contexte, madame la ministre, pouvez-vous me rassurer, et rassurer les sportifs professionnels et amateurs qui fréquentent le CRJS de Petit-Couronne, quant au maintien pour l’année 2024 d’un niveau de subvention qui soit à la hauteur des besoins de la structure ?

Ma question concerne la situation préoccupante de la maternité de Guingamp, confrontée à une menace persistante de fermeture qui nuit à son attractivité. Ce sont 500 naissances annuelles qui sont ainsi fragilisées.
Depuis le mois d'avril 2023 et jusqu'au mois d'avril 2024, les accouchements sont suspendus.
Malgré les engagements du Président de la République et des ministres successifs en faveur du maintien à Guingamp d'un centre hospitalier de plein exercice, aucune perspective concrète n'est envisagée. Sans projet, il ne sera pas possible de rester attractif ; or la population, soutenue par les élus, n'accepte pas cette dégradation de l'offre de soins.
Cette suspension est une violence de plus faite aux femmes et aux enfants, créant un sentiment d'abandon au sein de la population la plus vulnérable de Bretagne et aggravant le renoncement aux soins, phénomène unanimement constaté.
Depuis la suspension de l'activité de la maternité, plusieurs femmes ont accouché en route. Mi-novembre, faute de pouvoir rallier à temps la maternité référente, Nathalie, d'Yvias, a accouché d'une petite Margot entre une pizzeria et un garage.
Alors que la prise en charge des femmes se détériore, que la perspective d'accoucher est une angoisse pour ces femmes que j'ai rencontrées - elles refusent d'aller attendre l'arrivée de bébé à l'hôtel -, les discussions avec l'agence régionale de santé tournent au dialogue de sourds.
Elles sont sur le point de rompre ; il est donc urgent de trouver une issue à cette impasse en instaurant un dialogue entre les représentants locaux, les autorités sanitaires, les professionnels de santé, les élus et les représentants des usagers et en travaillant ensemble à une solution viable.
Dans ce contexte, madame la ministre, je souhaite savoir ce qu'envisage de faire le Gouvernement pour lever l'incertitude persistante autour du maintien de la maternité de Guingamp.
Monsieur le sénateur Marie, malgré la restructuration du centre de ressources, d’expertise et de performance sportives (Creps) d’Houlgate, en 2008, l’État a poursuivi son soutien au développement de la haute performance en Normandie, via notamment la mise à disposition de cadres d’État - trois postes de direction sur les sites de Petit-Couronne, Le Havre et Caen - et une subvention annuelle moyenne de 70 000 euros.
La nouvelle organisation territoriale de l’État, qui s’est traduite en 2020 par la création des Drajes et par un transfert des missions, a conduit à engager en 2022 la procédure d’installation en Normandie d’une mission régionale de la performance hébergée par le groupement d’intérêt public (GIP) Centre sportif de Normandie.
Afin d’asseoir sa montée en compétences, le ministère chargé des sports a financé trois postes : un poste de responsable régional de la haute performance et deux postes de conseiller haut niveau et haute performance, pour un montant total de 230 000 euros.
L’Agence nationale du sport octroie par ailleurs une subvention de 14 000 euros pour compléter le financement du poste de responsable régional de la haute performance. Elle participera également au financement des actions et des projets territoriaux de la maison régionale de la performance à destination des sportifs de haut niveau et de l’écosystème territorial : 150 000 euros, ce n’est pas rien.
Au total, ce sont donc près de 400 000 euros qui sont garantis annuellement au bénéfice du sport de haut niveau en Normandie.
L’Agence nationale du sport propose enfin un accompagnement des structures du territoire, notamment sur le volet des équipements ou sur celui de l’emploi. À cela s’ajoutent les moyens déjà alloués aux fédérations sportives au titre des programmes d’accession au sport de haut niveau via les projets sportifs fédéraux, soit plus de 700 000 euros versés au territoire normand en 2022.
Comme vous pouvez le constater, monsieur le sénateur, l’État est pleinement mobilisé sur le sujet.
Madame la sénatrice Le Houerou, la situation de la maternité de Guingamp est bien connue du ministère de la santé et de la prévention, qui, en lien avec les professionnels, les élus du territoire et l'agence régionale de santé, en assure le suivi régulier.
En effet, les accouchements ont été suspendus dans cette maternité à compter du 26 avril 2023, du fait de risques liés à un manque de professionnels de santé - car qui dit « risques » dit « danger pour la mère ».
Oui, certaines maternités font face, comme le reste du système de santé, à des tensions qui touchent notamment aux ressources humaines. Sont concernées plusieurs professions indispensables au fonctionnement d'une maternité : gynécologues, obstétriciens, anesthésistes-réanimateurs, sages-femmes. Ces tensions sont pour partie liées aux problèmes d'attractivité qui affectent ces professions et à la charge que représente la permanence des soins.
L'engagement du Gouvernement en la matière est constant et nous continuons d'apporter des réponses adaptées. Garantir partout sur le territoire la santé maternelle, néonatale et infantile est une des priorités du ministère de la santé et de la prévention, dont l'action consiste toujours, dans ce domaine, à trouver un équilibre entre proximité et sécurité.
Pour ce qui est de Guingamp, la suspension des accouchements, initialement prévue pour durer deux mois, a été en effet reconduite plusieurs fois. Pourquoi ? Pour des raisons de sécurité. Malgré l'engagement de l'ARS, qui est pleinement mobilisée et fait tout pour aider la maternité à retrouver les équipes professionnelles nécessaires à son fonctionnement, les difficultés persistent, je le reconnais.
Je sais que le cabinet du ministre, Aurélien Rousseau, a organisé pas plus tard qu'hier, madame la sénatrice, un temps d'échange auquel vous et de nombreux autres élus avez participé, toujours dans l'optique de trouver des solutions adaptées.
situation de la maternité de guingamp

La parole est à Mme Annie Le Houerou, auteure de la question n° 963, adressée à M. le ministre de la santé et de la prévention.
Mme Fadila Khattabi, ministre déléguée. C'est bien sûr dans cette voie qu'il faut poursuivre pour se redonner des perspectives partagées.

Ma question concerne la situation préoccupante de la maternité de Guingamp, confrontée à une menace persistante de fermeture qui nuit à son attractivité. Ce sont 500 naissances annuelles qui sont ainsi fragilisées.
Depuis le mois d’avril 2023 et jusqu’au mois d’avril 2024, les accouchements sont suspendus.
Malgré les engagements du Président de la République et des ministres successifs en faveur du maintien à Guingamp d’un centre hospitalier de plein exercice, aucune perspective concrète n’est envisagée. Sans projet, il ne sera pas possible de rester attractif ; or la population, soutenue par les élus, n’accepte pas cette dégradation de l’offre de soins.
Cette suspension est une violence de plus faite aux femmes et aux enfants, créant un sentiment d’abandon au sein de la population la plus vulnérable de Bretagne et aggravant le renoncement aux soins, phénomène unanimement constaté.
Depuis la suspension de l’activité de la maternité, plusieurs femmes ont accouché en route. Mi-novembre, faute de pouvoir rallier à temps la maternité référente, Nathalie, d’Yvias, a accouché d’une petite Margot entre une pizzeria et un garage.
Alors que la prise en charge des femmes se détériore, que la perspective d’accoucher est une angoisse pour ces femmes que j’ai rencontrées - elles refusent d’aller attendre l’arrivée de bébé à l’hôtel -, les discussions avec l’agence régionale de santé tournent au dialogue de sourds.
Elles sont sur le point de rompre ; il est donc urgent de trouver une issue à cette impasse en instaurant un dialogue entre les représentants locaux, les autorités sanitaires, les professionnels de santé, les élus et les représentants des usagers et en travaillant ensemble à une solution viable.
Dans ce contexte, madame la ministre, je souhaite savoir ce qu’envisage de faire le Gouvernement pour lever l’incertitude persistante autour du maintien de la maternité de Guingamp.

Ma question concerne la situation préoccupante de la maternité de Guingamp, confrontée à une menace persistante de fermeture qui nuit à son attractivité. Ce sont 500 naissances annuelles qui sont ainsi fragilisées.
Depuis le mois d’avril 2023 et jusqu’au mois d’avril 2024, les accouchements sont suspendus.
Malgré les engagements du Président de la République et des ministres successifs en faveur du maintien à Guingamp d’un centre hospitalier de plein exercice, aucune perspective concrète n’est envisagée. Sans projet, il ne sera pas possible de rester attractif ; or la population, soutenue par les élus, n’accepte pas cette dégradation de l’offre de soins.
Cette suspension est une violence de plus faite aux femmes et aux enfants, créant un sentiment d’abandon au sein de la population la plus vulnérable de Bretagne et aggravant le renoncement aux soins, phénomène unanimement constaté.
Depuis la suspension de l’activité de la maternité, plusieurs femmes ont accouché en route. À la mi-novembre, faute de pouvoir rallier à temps la maternité référente, Nathalie, d’Yvias, a accouché d’une petite Margot entre une pizzeria et un garage.
Alors que la prise en charge des femmes se détériore, que la perspective d’accoucher est une angoisse pour ces femmes que j’ai rencontrées - elles refusent d’aller attendre l’arrivée de bébé à l’hôtel -, les discussions avec l’agence régionale de santé tournent au dialogue de sourds.
Elles sont sur le point de rompre ; il est donc urgent de trouver une issue à cette impasse en instaurant un dialogue entre les représentants locaux, les autorités sanitaires, les professionnels de santé, les élus et les représentants des usagers et en travaillant ensemble à une solution viable.
Dans ce contexte, madame la ministre, je souhaite savoir ce qu’envisage de faire le Gouvernement pour lever l’incertitude persistante autour du maintien de la maternité de Guingamp.
Mme Annie Le Houerou hoche la tête en signe de dénégation.
Vous me dites « non », madame la sénatrice ; voici en tout cas les échos et les informations que j'ai eus : une réunion s'est tenue hier sur ce sujet.
Madame la sénatrice Le Houerou, la situation de la maternité de Guingamp est bien connue du ministère de la santé et de la prévention, qui, en lien avec les professionnels, les élus du territoire et l’agence régionale de santé, en assure le suivi régulier.
En effet, les accouchements ont été suspendus dans cette maternité à compter du 26 avril 2023, du fait de risques liés à un manque de professionnels de santé - car qui dit « risques » dit « danger pour la mère ».
Oui, certaines maternités font face, comme le reste du système de santé, à des tensions qui touchent notamment aux ressources humaines. Sont concernées plusieurs professions indispensables au fonctionnement d’une maternité : gynécologues, obstétriciens, anesthésistes-réanimateurs, sages-femmes. Ces tensions sont pour partie liées aux problèmes d’attractivité qui affectent ces professions et à la charge que représente la permanence des soins.
L’engagement du Gouvernement en la matière est constant et nous continuons d’apporter des réponses adaptées. Garantir partout sur le territoire la santé maternelle, néonatale et infantile est une des priorités du ministère de la santé et de la prévention, dont l’action consiste toujours, dans ce domaine, à trouver un équilibre entre proximité et sécurité.
Pour ce qui est de Guingamp, la suspension des accouchements, initialement prévue pour durer deux mois, a été en effet reconduite plusieurs fois. Pourquoi ? Pour des raisons de sécurité. Malgré l’engagement de l’ARS, qui est pleinement mobilisée et fait tout pour aider la maternité à retrouver les équipes professionnelles nécessaires à son fonctionnement, les difficultés persistent, je le reconnais.
Je sais que le cabinet du ministre, Aurélien Rousseau, a organisé pas plus tard qu’hier, madame la sénatrice, un temps d’échange auquel vous et de nombreux autres élus avez participé, toujours dans l’optique de trouver des solutions adaptées.

Si une réunion s'est tenue, elle s'est tenue sans les élus et sans les représentants des professionnels de santé et des usagers.
Il y a bel et bien un problème d'attractivité !
Nous demandons un engagement clair sur la reconstruction - promise - d'un hôpital de plein exercice.
Nous demandons un projet médico-soignant qui réponde aux besoins de santé du territoire.
Nous demandons une bonification des rémunérations des soignants, car nous sommes en déficit.
Des solutions existent : des postes d'internes doivent être ouverts aux futurs médecins, fussent-ils étudiants à l'étranger, afin qu'ils soient affectés en France dans les établissements en tension, comme à Guingamp, pour y soutenir les médecins seniors et maîtres de stage. Des médecins français étudiant à l'étranger demandent à faire leur internat ici : des solutions existent donc, j'y insiste !
Mme Fadila Khattabi, ministre déléguée. C’est bien sûr dans cette voie qu’il faut poursuivre pour se redonner des perspectives partagées.
Mme Annie Le Houerou hoche la tête en signe de dénégation.

Une autre piste pourrait consister à former une équipe d'accompagnement des femmes, de la conception jusqu'aux premiers mois de l'enfant, en lien avec les sages-femmes libérales.
Vous me dites « non », madame la sénatrice ; voici en tout cas les échos et les informations que j’ai eus : une réunion s’est tenue hier sur ce sujet.
Vous me répondez « non », madame la sénatrice ; voici en tout cas les échos et les informations que j’ai eus : une réunion s’est tenue hier sur ce sujet.

Une demande s'exprime en faveur de l'organisation d'une table ronde impliquant l'ensemble des parties prenantes ; je m'en fais ici le relais.

Si une réunion s’est tenue, elle s’est tenue sans les élus et sans les représentants des professionnels de santé et des usagers.
Il y a bel et bien un problème d’attractivité !
Nous demandons un engagement clair sur la reconstruction - promise - d’un hôpital de plein exercice.
Nous demandons un projet médico-soignant qui réponde aux besoins de santé du territoire.
Nous demandons une bonification des rémunérations des soignants, car nous sommes en déficit.
Des solutions existent : des postes d’internes doivent être ouverts aux futurs médecins, fussent-ils étudiants à l’étranger, afin qu’ils soient affectés en France dans les établissements en tension, comme à Guingamp, pour y soutenir les médecins seniors et maîtres de stage. Des médecins français étudiant à l’étranger demandent à faire leur internat ici : des solutions existent donc, j’y insiste !

Nous en avons terminé avec les réponses à des questions orales.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.

Une autre piste pourrait consister à former une équipe d’accompagnement des femmes, de la conception jusqu’aux premiers mois de l’enfant, en lien avec les sages-femmes libérales.
La séance, suspendue à douze heures trente,

Une demande s’exprime en faveur de l’organisation d’une table ronde impliquant l’ensemble des parties prenantes ; je m’en fais ici le relais.
Si vous avez des professionnels, envoyez-les-nous !

L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution (projet n° 219, rapport n° 220).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi de finances pour 2024 que nous examinons aujourd'hui en nouvelle lecture s'inscrit dans la droite ligne des objectifs que nous avons fixés dans la loi de programmation des finances publiques pour 2023 à 2027.
Nous sommes sur une ligne de crête
Mme Christine Lavarde s'en amuse
Nous devons atteindre ces objectifs sans dégrader notre trajectoire, en maîtrisant nos finances publiques et en poursuivant une politique de justice fiscale et de lutte contre la fraude.
En première lecture, ici, au Sénat, ces grandes orientations ont été confortées. En effet, malgré des points de désaccord sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir, vous avez voté pour un budget qui confirme le chemin que nous souhaitons emprunter.
Sur la maîtrise de la dépense publique, d'abord, la trajectoire que nous nous sommes fixée établit un déficit public à 4, 4 % pour 2024. C'est une nouvelle étape importante qui doit nous permettre de repasser sous la barre des 3 % de déficit en 2027. Nous avons ici un point d'accord : la maîtrise des finances publiques est une priorité.
Nous réaliserons cet objectif, car nous ferons des économies. Les dépenses de l'État baisseront en 2024 : 14 milliards d'euros seront économisés grâce à la sortie des dispositifs de crise.
Par ailleurs, 350 millions d'euros seront économisés sur la politique de l'emploi grâce à la réduction du chômage et 500 millions d'euros en améliorant l'efficience de la politique de formation professionnelle et de l'apprentissage.
Ces économies sont ciblées. Nous ne souhaitons pas faire de grands coups de rabot dans la dépense publique…
… qui auraient un effet contre-productif sur la croissance, l'emploi et qui pourrait finalement amoindrir nos recettes.
Nous réaliserons cet objectif sans augmenter les impôts.
C'est notre ligne directrice depuis 2017. Cette politique fonctionne et nous permet d'atteindre les résultats économiques que nous avons aujourd'hui. Nous ne changerons pas de cap, car il produit des résultats. La réforme reste et restera le moteur de notre politique de maîtrise des finances publiques.
Nous nous sommes également accordés sur le financement de la transition écologique. Dans ce projet de loi de finances, 10 milliards d'euros supplémentaires seront consacrés à la rénovation des logements et des bâtiments publics, à l'énergie décarbonée, au verdissement du parc automobile.
Vous avez également soutenu le principe des budgets verts pour les collectivités territoriales et les opérateurs, et inscrit la possibilité de calculer la part de dette dédiée à l'investissement dans la transition écologique. Je suis convaincu que nous ne parviendrons à respecter notre trajectoire en matière de réduction des émissions que si nous nous dotons de boussoles communes. Il s'agit d'une avancée majeure.
Vous avez été favorables à des choix politiques ambitieux pour accompagner la transition écologique : la sortie progressive du gazole non routier (GNR), la taxe sur les gestionnaires d'infrastructures de transport les plus polluantes, le malus sur les véhicules polluants, l'accompagnement du nouveau modèle agricole.
En ce qui concerne la poursuite de notre politique de l'offre, vous avez aussi souhaité garder nos grandes orientations en faveur de l'emploi, de la production et de la croissance. En 2024, nous poursuivrons donc la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Nous créerons aussi un nouveau crédit d'impôt en faveur de l'industrie verte.
Nous nous sommes également retrouvés sur le soutien dans nos services publics : l'augmentation du budget de l'éducation nationale, pour le porter à un niveau historique ; l'augmentation du budget de nos armées pour qu'elles puissent faire face aux défis stratégiques que nous connaissons ; l'augmentation du budget de la justice pour renforcer l'accès au droit et augmenter le nombre de places en prison.
Vous avez aussi souhaité valider les grandes orientations de justice fiscale comme le « pilier II », qui permettra une imposition minimale des sociétés à 15 % dès le 1er janvier 2024.
Cette mesure, prise à l'échelle de l'OCDE, représente une avancée majeure dans la lutte contre le dumping fiscal.
La France a été leader dans cette initiative. Nous pouvons collectivement nous réjouir de cette mesure.
Vous avez aussi voté l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, qui est une mesure forte de soutien au pouvoir d'achat des ménages. Cette mesure représente un manque à gagner de 6 milliards d'euros pour l'État et bénéficiera directement à 18 millions de foyers dans notre pays.
La justice fiscale passe également par la lutte contre la fraude.
C'est un enjeu de cohésion sociale. Sur le sujet, vous avez adopté les très nombreuses mesures présentes dans ce texte visant à lutter contre toutes les fraudes.
Par le renforcement des moyens d'abord : ce sont 250 agents supplémentaires qui seront dédiés à la lutte contre la fraude à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Nous renforçons aussi les techniques d'enquête sur internet avec, notamment, la permission d'accéder aux contenus publics et d'enquêter sous pseudonyme. Nous renforçons la lutte contre les nouveaux types de fraudes en ligne.
Nous renforçons aussi les sanctions contre les fraudeurs avec une sanction administrative balais pour la fraude aux aides publiques et une nouvelle sanction d'indignité fiscale.
Ces grandes orientations ont donc fait l'objet d'accords avec vous, mais vous avez aussi fait de très nombreuses propositions, que nous avons débattues longuement.
Le président de la commission des finances, le rapporteur général, les 49 rapporteurs spéciaux, les 76 rapporteurs pour avis et plus globalement l'ensemble des sénateurs ont proposé, en première lecture, 3 760 amendements que nous avons examinés pendant 150 heures de débats. Vous avez adopté au total 663 amendements.
Ces amendements traduisent parfois des désaccords entre le Sénat et le Gouvernement. Ils traduisent aussi une volonté que le Sénat a eue d'enrichir le texte proposé par le Gouvernement.
Contrairement à ce que j'ai pu entendre, nous avons écouté et retenu les amendements qui représentaient des points d'accord importants.
Protestations et vives exclamations sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Thomas Dossus s'en amuse.
Le texte qui vous est soumis aujourd'hui est riche des débats qui ont eu lieu au Sénat.
Le Sénat a validé les grandes orientations du texte sur le financement de la transition écologique, la poursuite de la politique de l'offre, l'investissement dans les services publics prioritaires comme l'éducation nationale. Le Sénat a adopté 663 amendements. Le texte voté par le 49.3 en reprend plus de 120.
C'est un record historique !
Nous avons retenu des amendements transpartisans défendus par la plupart des groupes, comme le prolongement de la garantie sur l'évolution de la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (DPEL) des communes nouvelles, mesure que je sais très chère à Françoise Gatel, ou le gel de la trajectoire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) en outre-mer en 2024.
Je citerai également parmi les amendements transpartisans l'augmentation de l'objectif d'incorporation d'énergies renouvelables dans les gazoles pour le calcul de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports (Tiruert).
Nous avons également retenu des amendements de la majorité sénatoriale et du rapporteur général comme le principe d'une taxe sur les plateformes de streaming…
… grande avancée attendue, grâce au dialogue, ici, au Sénat.
Je pense aussi à l'aménagement des conditions d'éligibilité des fonds de capital investissement au dispositif d'apport-cession, dispositif défendu par Christine Lavarde, ou à l'aide aux départements du Nord et du Pas-de-Calais,
Nous avons aussi retenu des amendements du groupe Socialiste, Écologiste et Républicains, comme l'ajustement soutenu par Thierry Cozic des règles de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou la suppression du critère de potentiel financier dans le DPEL pour le soutien aux élus locaux, mesure défendue notamment par Éric Kerrouche.
Du groupe Union Centriste, nous avons retenu le dégrèvement en faveur des logements ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation « seconde vie », la mise en place d'un fonds de compensation perte de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), défendue par le sénateur Bonneau, la bonification de 20 % de la fraction péréquation de la dotation de solidarité rurale (DSR) des communes classées France ruralités revitalisation (FRR) du sénateur Delcros.
Pour le groupe RDPI, nous avons retenu l'exonération des aides versées aux entreprises touchées par la crise de l'eau à Mayotte, et le soutien au département de Mayotte et au syndicat de gestion de l'eau, défendus par le sénateur Soilihi.
Pour le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, nous avons retenu la suppression de la redevance d'eau dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes, proposition défendue par la présidente Cukierman.
Pour le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, nous avons retenu le doublement du montant des amendes prononcées par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (Acnusa), mesure proposée par la sénatrice Senée.
Pour le groupe Les Indépendants, nous avons retenu le renforcement de l'assouplissement des règles de lien des taux d'impôts locaux du sénateur Capus.
Je pourrais continuer
Vives exclamations sur toutes les travées.
… sur les dons de sommes d'argent en nue-propriété et sur la TVA pour les locations de biens meublés du groupe RDPI et du sénateur Rambaud.
Je citerai aussi les 2 millions d'euros au bénéfice des épiceries solidaires portés par le président Mouiller, la sénatrice Micouleau, la sénatrice Canalès et le sénateur Jean-Baptiste Lemoyne.
Je citerai également les 1 million d'euros pour la lutte contre les scolytes qui menacent nos forêts, demande de la sénatrice Loisier.
Parce que nous connaissons votre expertise sur le sujet des collectivités, nous avons aussi avancé sur les sujets suivants : l'ajustement des règles de la Tascom en cas de fusion d'EPCI ; la neutralisation à 100 % de la réforme de l'effort fiscal en 2024, demande des sénateurs Sautarel et Cukierman ; la création de 15 équivalents temps plein (ETP) pour le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) afin de soutenir les collectivités dans leurs projets d'investissement, notamment dans la transition écologique, demande du sénateur Capo-Canellas.
Ces avancées proviennent des travaux de tous les groupes du Sénat. Nous les avons étudiées avec sérieux et avons adopté celles qui contribuaient à la réussite des objectifs que nous avons fixés. Nous avons dialogué, écouté.
Malgré cela, force est de constater que nous avons eu des points de désaccord qui ont animé nos débats en première lecture.
« Ah ! » sur les travées des groupes Les Républicains et UC.
D'abord, et ce n'est pas un petit différend, nous ne sommes pas d'accord avec la suppression de plusieurs missions dans la seconde partie du texte – « Cohésion des territoires », « Plan de relance », « Immigration, asile et intégration », « Administration générale et territoriale de l'État » – et du compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ». Le déficit ramené à 3 % à l'issue de la première lecture au Sénat était un trompe-l'œil.
Vous avez considéré comme insuffisants les efforts de ce gouvernement en faveur des collectivités territoriales.
Sur les recettes comme sur les dépenses, nous avons des désaccords.
Vous avez souhaité augmenter les recettes allouées aux collectivités de 3 milliards d'euros supplémentaires en première partie et de 200 millions d'euros lors de l'examen de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Cette augmentation s'ajoute au 1, 15 milliard d'euros prévu dans le texte du Gouvernement.
Nous devons cibler le soutien aux collectivités. Il faut soutenir celles qui sont en difficulté et permettre à celles qui se portent bien de contribuer, à la hauteur de leurs moyens, à nos efforts de maîtrise de la dépense publique et aux besoins d'investissement.
Sur le bouclier énergétique, nous avons également souhaité modifier le texte du Sénat. Si la sortie des dispositifs exceptionnels sur l'électricité est légitime, un retour à la situation d'avant-crise, du jour au lendemain, serait trop brutal. Nous avons opté pour une sortie progressive des boucliers, je m'en suis expliqué.
Le dispositif que vous avez proposé a permis d'enrichir le texte pour aboutir à la version de compromis que nous vous proposons aujourd'hui. L'augmentation que nous prévoyons, plafonnée à 10 %, est déjà un effort important demandé aux Français.
Je souhaite que le texte qui vous est finalement présenté en nouvelle lecture, enrichi par le travail du Sénat, puisse vous convaincre que nous avons su écouter, dialoguer…
… et enrichir le texte. Cette méthode est et restera la mienne.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, nous examinons, en nouvelle lecture le projet de loi de finances pour 2024, après l'usage, une nouvelle fois, de la procédure de l'article 49.3 à l'Assemblée nationale.
Comme vous le savez, la commission mixte paritaire, qui s'est réunie mardi dernier, n'a pas abouti. Au-delà de nos divergences sur de nombreux articles du projet de loi, c'est bien d'après moi notre opposition sur le fait d'engager - ce que vous ne voulez pas en l'espèce - le redressement des finances de notre pays qui a rendu impossible tout accord avec l'Assemblée nationale.

Malheureusement, à l'issue de ce nouvel usage du 49.3, pour la vingt-deuxième fois, le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale ne fait qu'aggraver la situation.
Les dépenses nettes du budget général sont en hausse de 700 millions d'euros par rapport au texte initial de septembre.

Monsieur le ministre, où sont les économies supplémentaires annoncées par le Gouvernement ?
Au total, le déficit est de 146, 9 milliards d'euros, aggravé de 2, 4 milliards d'euros supplémentaires par rapport au texte initial.
Pas un centime des 7 milliards d'euros d'économies votées par notre assemblée, monsieur le ministre, n'a été repris par le Gouvernement !
La baisse d'impôt sur les tarifs de l'électricité reste non ciblée, elle bénéficiera donc prioritairement à ceux qui en ont le moins besoin.
Les aides à l'apprentissage sont conservées, y compris les aides exceptionnelles pour les grandes entreprises embauchant des apprentis hautement diplômés. Aucun effort n'est prévu pour l'audiovisuel public alors que vous-même, monsieur le ministre, annonciez dans La Tribune que ce secteur devrait faire des efforts. Vous réintégrez même toutes les surbudgétisations supprimées par le Sénat.
C'est donc ce même gouvernement qui demande à l'envi au Parlement de faire des économies, à défaut de savoir les proposer lui-même, qui ne les reprend pas quand le Parlement les vote !
C'est un jeu de dupes, monsieur le ministre, qui décrédibilise le monde politique en général et donc la démocratie, en plus de nuire gravement aux finances publiques de notre pays.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Vous n'avez finalement repris du Sénat que les quelques dispositifs que vous aviez vous-même transmis aux sénateurs pour les faire adopter avec avis favorable
M. le ministre délégué le conteste.

, et qui ne reflètent aucunement les 150 heures de débats sérieux, constructifs et responsables que nous avons eues au sein de notre assemblée. À ce propos, qu'il me soit permis de remercier l'ensemble de mes collègues !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Nadia Sollogoub et M. Thomas Dossus applaudissent également.

Vous nous dites, monsieur le ministre, que la « taxe streaming », qui figure dans le texte, est un apport du Sénat. Mais alors, pourquoi ne pas avoir repris le dispositif défendu dans les amendements identiques, qui rassemblaient largement le Sénat ?

Vous avez poussé la provocation jusqu'à vouloir procéder à trois pages de réécriture d'un nouvel amendement, comme pour mieux appuyer sur un dispositif sur lequel vous aviez rendu un avis défavorable ?

Le peu qu'il reste des apports du Sénat ne relève même pas de la compétence du ministère de l'économie et des finances, mais relève de celui des collectivités territoriales. Ce sont, notamment, les aménagements au dispositif des zones France ruralités revitalisation, prévus à l'article 7 du projet de loi, sujet qui était piloté par la ministre Dominique Faure.
Je citerai tout de même deux autres apports importants de notre assemblée : à l'article 5 duodecies, dit « niche Airbnb », …

… vous avez repris le texte du Sénat, qui résulte du vote de plusieurs amendements identiques réduisant à 30 % l'abattement fiscal pour les locaux meublés de tourisme, sous un plafond de revenus de 15 000 euros.

La loi prévoira donc bien son application aux revenus perçus l'année prochaine. Rassurez-nous, monsieur le ministre : vous comptez bien appliquer la loi ?

À l'article 15, qui crée la taxe additionnelle sur les autoroutes et les aéroports, je me réjouis que vous conserviez l'amendement de la commission qui affecte 100 millions d'euros de son produit aux communes et aux départements. Je vous indique, d'ailleurs, officiellement que je souhaite que la commission des finances, à l'origine de cette disposition, soit associée au décret d'application prévu par la loi pour déterminer les modalités de ce reversement.
Vous l'aurez compris, pour moi, les quelques « accords » trouvés sont des écrans de fumée qui masquent le fait que l'exécutif choisit de s'exonérer de toute validation parlementaire.
Il s'exonère de toute validation à l'Assemblée nationale par l'usage du 49.3, je le rappelle, sans aucun débat en séance publique, ce qui est nouveau par rapport à la pratique historique du 49.3, et n'est pas conforme à l'esprit de la Constitution.
M. André Reichardt renchérit.

Il s'exonère aussi de toute validation au Sénat par l'absence de prise en compte de nos votes !
De fait, la réalité, c'est qu'aucun des principaux votes du Sénat n'est retenu ! On ne retrouve aucun des dispositifs fiscaux en faveur de la transmission de patrimoine et du logement. Le prêt à taux zéro (PTZ) n'est pas maintenu. Il n'y aura pas de ciblage des aides pour l'électricité – je l'ai évoqué –, pas de fonds d'urgence climatique pour les collectivités territoriales, pas de prise en compte des demandes du Sénat sur les dotations aux collectivités : la hausse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) reste à 100 millions d'euros, et l'aide d'urgence aux départements ne sera pas de 100 millions d'euros.
Pas un centime de quota carbone ne sera mis au service des autorités organisatrices de la mobilité de province.
On décèle même, en examinant précisément le 49.3, une volonté du Gouvernement de ne pas être constructif. En effet, monsieur le ministre, par le 49.3, vous revenez sur des dizaines d'avis favorables que vous avez vous-même émis, à ce banc, devant nous !

Encore une fois, quelle est la crédibilité de la parole politique et du Gouvernement dans ces conditions ?

Ce sont les propres engagements du Gouvernement qui sont reniés.
Je prends un exemple : la commission des finances, et le Sénat à sa suite, a appliqué la loi de programmation des finances publiques (LPFP), tout juste votée, pour borner à trois ans, soit jusqu'en 2026, les nouvelles niches fiscales. Pourtant, dans le 49.3, vous revenez sur la majorité de ces bornages, qui sont pourtant des engagements que vous avez vous-mêmes pris, à travers un autre 49.3 – sur la LPFP. C'est à n'y plus rien comprendre.
Ce non-respect des engagements pris est encore plus flagrant s'agissant de la trajectoire d'emplois du PLF, où l'objectif de stabilité de la LPFP est piétiné, autant que les amendements du Sénat qui visaient pourtant à produire un effort sur les emplois des opérateurs.
Enfin, et c'est un peu la cerise sur le gâteau, le texte du 49.3 pose d'importants problèmes constitutionnels.
En nouvelle lecture, le Gouvernement a introduit dans le texte des dispositions entières sans lien direct avec les dispositions encore en discussion, qui n'auront donc été examinées par aucune des assemblées : à l'article 5 quindecies, une réécriture globale du « dispositif Madelin » ; à l'article 16 quater A, une réforme de la taxe générale sur les activités polluantes d'une grande technicité, qui n'a rien à voir avec la TGAP en outre-mer, dont traitait l'article initialement ; à l'article 25 bis, une réforme jamais discutée de la compensation des compétences exercées par les régions en matière de formation professionnelle continue.
Par ailleurs, le Gouvernement se laisse de plus en plus de marges fiscales hors la vue du Parlement, en violation de la compétence fiscale du législateur. À l'article 11, vous vous autorisez à augmenter de 1, 9 milliard d'euros les accises sur le gaz payées par les ménages français. À l'article 16 sexies, vous déplafonnez complètement les tarifs de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers.
Enfin, comme je l'ai déjà évoqué lors de l'examen des articles non rattachés, vous réintroduisez l'article 44 sur les reports de crédits, qui supprime, sans justification précise, tout plafond de report de crédits pour désormais non pas 12 programmes, comme le prévoyait le texte initial, ni 37 programmes, comme dans le texte issu du premier 49.3, mais pour 43 programmes budgétaires distincts !
Je rappelle, monsieur le ministre, que la Lolf impose, pour ces reports, un plafond par programme et une justification précise ! C'est le principe même de l'annualité budgétaire, donc le principe même de l'autorisation parlementaire, qui est piétiné ici.
Je ne saurais finir ma présentation de cette nouvelle lecture sans évoquer la caricature que constitue l'article visant les fédérations internationales olympiques
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Tenez-vous bien, mes chers collègues : il est désormais acté que le Gouvernement réintroduit, dans le 49.3, le paradis fiscal pour la Fédération internationale de football association (Fifa).
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Excusez du peu : pas d'impôt sur les sociétés, pas de cotisation foncière des entreprises, pas d'impôt sur le revenu pour ses salariés… Tout cela au profit d'une organisation privée qui brasse des milliards d'euros !

Cette disposition, monsieur le ministre, n'a pas été votée à l'Assemblée nationale, ni en première ni en nouvelle lecture. Et je rappelle qu'elle a été supprimée ici, au Sénat, à l'unanimité.
Cette réintroduction par le Gouvernement n'est pas un manque de prise en compte du Parlement ; elle ne pose pas la question des éventuels apports du Sénat : c'est une véritable provocation, non seulement pour le Sénat, mais aussi pour les Français !

Cette décision est particulièrement grave, tant elle manque de mesure, d'équité et de justice.
Je vous pose la question, monsieur le ministre : pourquoi cet aveuglement coupable et cet acharnement forcené ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Guislain Cambier applaudit également.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En conclusion – il en faut bien une, monsieur le ministre -, vous ne serez pas étonné que la commission des finances ait proposé, ce matin, à une large majorité, d'opposer la question préalable, en nouvelle lecture, sur ce projet de loi de finances pour 2024.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et sur des travées du groupe UC. – M. Christian Bilhac applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, que dire après ce réquisitoire ?
Sans surprise, la commission mixte paritaire, qui s'est réunie le 12 décembre dernier, n'a pu aboutir favorablement.
Comme l'a rappelé notre rapporteur général, un trop grand nombre d'articles restaient en discussion. Une nouvelle lecture n'a évidemment pas permis au Gouvernement d'avancer, et nous avons subi les conséquences d'une nouvelle mise en œuvre de l'article 49.3, qui a balayé d'un revers de main la quasi-totalité des apports du Sénat.
Monsieur le ministre, vous avez, tout à l'heure, pratiqué le name dropping. Cela peut faire plaisir, mais ne règle pas du tout la question ! Avouez qu'un ratio de 120 amendements sur 3 800 n'est pas très favorable…
Pour l'année prochaine, la prévision de déficit public demeure inchangée par rapport à la version du texte adoptée à l'issue de la première lecture du budget à l'Assemblée nationale, à savoir 4, 4 % du PIB. Malgré le retrait des mesures de crise, la dépense publique devrait, toutes sphères d'administration confondues, augmenter de plus de 100 milliards d'euros par rapport au niveau de 2022.
Nous aurions pourtant dû revenir à une plus juste appréciation des « ordres de grandeur ». Après le « quoi qu'il en coûte » et les montants astronomiques de concours publics déployés pour limiter l'impact des crises sanitaire et énergétique, les ajustements doivent, plus que jamais, être calibrés « au trébuchet », plutôt qu'au doigt mouillé.
Le Sénat vous a ainsi fait de nombreuses propositions d'économies, améliorant de 0, 3 point le solde public, compte non tenu, évidemment, du rejet de différentes missions budgétaires – nous sommes d'accord.
À cet égard, nous sommes nombreux, au sein du groupe Union Centriste, à déplorer le rejet des crédits de cinq missions cette année.
La préservation de nos ressources publiques comme le respect du principe d'égalité devant l'impôt appellent, de notre part, une rationalisation accrue des niches fiscales. Or plus de 40 % des articles de la première partie concernent des niches !
Nous avons formulé des propositions en ce sens.
Je m'arrêterai évidemment quelques instants sur la giganiche fiscale de la Fifa, que M. le rapporteur général a évoquée.
Les sénateurs de toutes les travées de cet hémicycle se sont unis pour supprimer l'article correspondant, qui est malgré tout revenu.

Je rappelle tout de même que les recettes totales de la Fifa s'élevaient, en 2022, à 4, 6 milliards de dollars !
Alors que nous venons de parler d'égalité devant l'impôt, comment allons-nous expliquer aux infirmiers, aux enseignants et aux autres salariés de ce pays qu'ils doivent payer l'impôt, quand les salariés de la Fifa en seront exonérés ?
Nous verrons comment se présente la partie non lucrative…
Très franchement, je me demande, d'ailleurs, monsieur le ministre, si cette mesure survivra au contrôle du Conseil constitutionnel, tant il est vrai que la rupture d'égalité devant l'impôt semble ici une évidence.

D'autres mesures, adoptées elles aussi à la quasi-unanimité du Sénat, auraient mérité une plus grande attention de la part du Gouvernement.
Je pense, par exemple, au maintien du PTZ pour un logement neuf sur l'ensemble du territoire, ou encore, toujours à l'article 6 du PLF, à la transformation de l'exonération de taxe foncière pour les logements sociaux en dégrèvement, afin de préserver les ressources fiscales locales malmenées.
Quelques motifs de satisfaction méritent soulignés.
Je pense ainsi à quelques mesures contre la fraude fiscale, sans que l'on ait touché à l'arbitrage des dividendes ou aux conventions fiscales internationales ; à la préservation, à l'article 7 du PLF, des améliorations apportées au bon fonctionnement du nouveau régime zoné d'exonérations fiscales et sociales France ruralités revitalisation, sur l'initiative de notre collègue Bernard Delcros ; à la suppression de la hausse de la redevance pour pollutions diffuses ainsi qu'à la suppression des tarifs planchers de la redevance pour irrigation dite « non gravitaire », malgré le rétablissement de l'article 16 ; au relèvement, à l'article 28 – toujours au bénéfice de nos agriculteurs –, du montant de taxe affectée aux chambres d'agriculture, conformément au souhait exprimé sur l'ensemble de ces travées ; à la majoration de 100 millions d'euros de la hausse de la DGF, afin de soutenir les collectivités locales les plus fragiles ; ou encore, sur l'initiative de Laurent Lafon et des membres de la commission de la culture, à l'instauration d'une taxe streaming ou à la revalorisation, à hauteur de 3, 7 millions d'euros, de la dotation versée par l'État aux scènes de musiques actuelles (Smac).
Comme je l'ai dit, compte tenu de l'échec de la CMP, nous voterons évidemment la motion.
Cependant, monsieur le ministre, je pense qu'il est très important de réfléchir aux conditions, absolument détestables, dans lesquelles nous travaillons sur le PLF. Certes, je comprends bien que nous soyons, comme toujours, contraints par le temps. Mais je rappelle que 3 800 amendements ont été déposés cette année ! Le Gouvernement n'y est pas pour grand-chose, mais je pense qu'il faudra vraiment travailler plus en amont pour l'année prochaine !

Cela vaut pour le rapporteur général, pour le président de la commission des finances comme pour l'ensemble d'entre nous.
Je pense que nous pouvons progresser sur certains sujets. Je pense notamment à la fraude fiscale, sur laquelle vous avez montré beaucoup de bonne volonté et de bonnes intentions.
Compte tenu de l'état de notre situation budgétaire, je pense qu'il vaut mieux prendre l'argent dans la poche des voleurs que dans celle des contribuables.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe UC. – Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Bernard Fialaire applaudit également.
Applaudissements s ur les travées du groupe GEST.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de l'ouverture de nos débats budgétaires, il y a un mois, j'avais résumé l'approche parlementaire du Gouvernement ainsi : « À l'Assemblée : taisez-vous. Au Sénat : cause toujours. »
J'aurais pu emprunter une formule plus récente du président Larcher, mais nous avons pour coutume de laisser la vulgarité à la porte de notre hémicycle…
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

À la lecture du texte issu du 49.3, il nous apparaît que cet adage a prévalu une nouvelle fois. Compte tenu de l'investissement de chacun des sénateurs et de chacune des sénatrices dans nos débats, on peut dire, au regard de leurs résultats réels, tangibles dans le budget, que l'effort parlementaire ne paie pas, ou qu'il paie très peu.
Rembobinons le mauvais film qu'est devenu le débat budgétaire dans notre République, au parlementarisme dit « rationalisé », même si « piétiné » conviendrait mieux.
Nous avons commencé à échanger ensemble, monsieur le ministre, lors des « dialogues de Bercy ». Vous nous aviez alors annoncé un budget historique pour la transition, avec un cap : le verdissement de notre fiscalité.
Je vous avais déjà fait part de nos doutes, tant les ordres de grandeur annoncés étaient loin de ce qui est attendu pour être à la hauteur de nos engagements, de nos trajectoires climatiques et des générations futures.
Vous aviez ouvert la porte aux débats parlementaires pour enrichir éventuellement cette trajectoire budgétaire historiquement verte.
Malgré 150 heures de débats en séance publique dans cet hémicycle, aucune ouverture n'a semblé possible sur le verdissement de notre fiscalité, que ce soit les propositions de fiscalité incitative ou la mise à contribution des comportements les plus polluants ou des plus aisés : tout a été balayé avec le mépris habituel.
Cependant, sur d'autres sujets, des dizaines d'amendements ont été adoptés, parfois de façon très large et transpartisane, sur des points essentiels.
Mais ce n'est pas le Parlement qui tient le stylo, et ce n'est pas le respect du débat parlementaire qui guide ce gouvernement. Nous sommes donc amenés, après ces heures de débats, à statuer sur un texte qui a largement balayé le travail de notre Haute Assemblée. Et, quand il ne l'a pas fait, quand, par miracle, un amendement transpartisan a survécu, cela nous est présenté comme un oubli à corriger !
Vous avez refusé de maintenir le prêt à taux zéro. Vous avez refusé de mieux cibler les aides sur l'énergie. Vous avez refusé de retravailler la dotation globale de fonctionnement des collectivités. Même la recherche de financements pour les transports publics n'a pas trouvé grâce à vos yeux ! L'égalité territoriale a été bafouée : la seule autorité organisatrice de la mobilité qui a pu se doter de ressources supplémentaires reste, une nouvelle fois, l'Île-de-France.
Nous saluons tout de même un progrès, objet d'un combat historique de certains des sénateurs de notre groupe : nous nous félicitons de la création d'un fonds de soutien de 250 millions d'euros pour accompagner, dans leur fonctionnement, les collectivités dotées d'un plan climat.
Enfin, la persévérance de mon collègue Ronan Dantec a fini par payer. Ce combat de longue haleine permettra à de nombreuses collectivités d'accélérer leurs projets. C'est un pas dans la bonne direction. Ne doutons pas que les prochaines années amèneront à amplifier le mouvement.
Je vais conclure, monsieur le ministre, par un message de colère, cette colère qui monte dans un certain nombre de territoires et chez un certain nombre d'élus locaux.
Monsieur le ministre, le Gouvernement et l'État ne sont pas à la hauteur de leurs obligations en matière d'hébergement. Des milliers d'enfants – oui, des enfants ! – dorment toujours à la rue.
Nous avons voté ici, de manière transpartisane, 6 000 nouvelles places d'hébergement d'urgence. Mais, d'un trait de plume, en mauvais comptable, vous avez décidé de les annuler ! D'un trait de plume, vous avez décidé de laisser des gamins dormir dans des tentes.
Vous n'avez eu de cesse de rappeler à quel point la France renouait avec l'investissement et le retour de la richesse produite, à quel point les comptes se redressaient, à quel point nous sommes au rendez-vous de la compétition mondiale.
Mais que valent toutes ces paroles quand des gamins continuent de dormir à la rue ? Qui peut accepter cela ?
Monsieur le ministre délégué chargé des comptes publics, ce trait de plume pèsera lourd dans votre bilan. Nous saurons vous le rappeler ! Vous serez désormais le comptable qui aura préféré laisser dormir des gamins à la rue pour rassurer les banquiers.
Nous ne voterons donc pas ce budget.
Applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER, ainsi que sur des travées du groupe CRCE-K.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat budgétaire est un long chemin ! Le 49.3 en est le mur ultime.
Monsieur le ministre, par « solisme » budgétaire, vous vous employez à éliminer les volontés des parlementaires, jugés trop peu prompts à gérer les finances publiques – un comble quand la copie du Gouvernement prévoit 4, 4 % de déficit par rapport au PIB et un endettement record !
Plus qu'un « solisme », c'est une méthode et des choix hors sols qui vous conduisent à persister, face à l'unanimité du Sénat, à vouloir faire de la France un paradis fiscal pour les grandes fédérations sportives lucratives. Ces articles sont profondément contraires à l'esprit de Coubertin, à l'image de celui sur le chronométreur des jeux Olympiques et sur ses filiales, qui ne paieront pas d'impôt. L'important, c'est de participer, mais surtout pas au financement des services publics !

Le « solisme » budgétaire expose également à des « erreurs matérielles », pour reprendre les termes du conseiller d'un ou d'une ministre cité dans la presse. En cause, l'amendement de notre groupe, porté par notre collègue Ian Brossat, qui visait à remédier à une injustice majeure : le taux d'imposition était plus favorable aux logements loués à un touriste étranger pour quelques jours sur Airbnb qu'aux logements loués à un travailleur ou une travailleuse pour quelques années. L'objectif était d'y mettre un terme.
Sauf que le Gouvernement voulait supprimer cet amendement, à en croire la presse, où, toujours anonymement, quelqu'un a annoncé que l'article « sera modifié à l'occasion d'un prochain vecteur législatif, au plus tard dans le budget 2025 » et que « la disposition n'a pas vocation à s'appliquer dans l'intervalle ».
Imaginez un gouvernement qui fait fuiter dans la presse que le budget – la loi donc ! – ne s'appliquera pas... Ouvrons les yeux ! Ce budget, c'est celui pour 2024. La loi, c'est l'imposition des loueurs sur Airbnb. Tous les élus locaux la réclament, mais le Gouvernement prétend avoir raison contre tout le monde. Les seuls moments où il a raison, c'est quand il se trompe...
Notre taxe sur les rachats d'actions modestes, avec son taux de 2 % – soit 400 millions d'euros selon les projections de recettes –, irait trop loin pour le rapporteur général de l'Assemblée nationale, M. Jean René Cazeneuve.
Peu importe que les rachats d'actions aient doublé depuis 2019, pour dépasser aujourd'hui les 20 milliards d'euros. Peu importe que les États-Unis aient institué une telle taxe à 1 %, à compter du 1er janvier 2023.
Le rapporteur général botte en touche, en renvoyant au partage de la valeur, comme si une prime Macron de quelques centaines d'euros pouvait contrebalancer l'enrichissement indu de milliards d'actionnaires. Le « solisme » budgétaire fait fi des comparaisons internationales, dans un aveuglement coupable au service des plus riches.
Notre taxe sur le streaming musical et vidéo, fruit de l'initiative de notre collègue Fabien Gay et, pour sa part, retenue – tout arrive ! –, a été dévitalisée, son taux ayant été abaissé de 1, 75 % à 1, 2 %. Les multinationales du streaming en sont quittes pour une juste imposition et la déstructuration du monde de la création musicale…
Les collectivités pâtissent également de ce « solisme » budgétaire.
Ainsi, il n'y aura pas de fonds exceptionnels pour les collectivités en proie aux catastrophes climatiques.
Le fonds de sauvegarde pour la baisse des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements est réduit à sa portion congrue – 53 millions d'euros supplémentaires. Il est déjà insuffisant en sortant du Sénat.
La DGF augmentera en dessous de l'inflation, conformément à la loi de programmation des finances publiques.
On le sait, les collectivités territoriales ne sont pas à la fête.
Nous continuerons de mener ces batailles, mais, en attendant la responsabilité démocratique, sur la méthode, et la responsabilité budgétaire, nous rejetterons ce budget pour 2024.
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K et SER.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire n'a pas été conclusive et l'examen de ce projet de loi de finances pour 2024 est marqué du sceau du mépris : le mépris pour le travail du Sénat, pour ses 150 heures de débats calmes et respectueux, et pour l'examen de plus de 3 800 amendements qui ont été balayés d'un revers de la main.
Il revient à l'exécutif d'arbitrer, certes, mais il y a des limites…
L'exonération fiscale de la Fifa, rejetée à la quasi-unanimité des sénateurs, puis rétablie dans le texte, est emblématique de ce mépris. Lors de l'examen de l'amendement tendant à supprimer cette exonération, je vous avais dit, monsieur le ministre, que vous devriez vous demander, lorsque les groupes sont unanimes, si vous n'aviez pas tort…
Restent quelques amendements rescapés.
Pour ce qui concerne les recettes, le groupe RDSE doit se contenter du rehaussement du plafond de la taxe transférée aux chambres d'agriculture, …

… ainsi que de l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la réglementation en matière d'assujettissement des entreprises au titre des contributions de formation professionnelle et d'alternance.
En seconde partie, beaucoup de dispositions utiles ont disparu, comme celles qui sont relatives, par exemple, à l'amélioration du logement des gendarmes, à la santé scolaire ou à la création d'une banque de ressources biologiques.
Dans le domaine de l'écologie, il nous reste la protection des cétacés
Sourires.
Mêmes mouvements.

… à défaut des 100 millions d'euros pour rénover le réseau ferroviaire ou du bénéfice du chèque énergie pour les habitants des HLM.
Ont été rayées de la carte des autorisations d'engagement de quelques millions d'euros supplémentaires pour l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », ou encore pour l'Institut national du cancer (INCa), la prévention de la maladie de Lyme, la maladie de Charcot. Par ailleurs, 2 millions d'euros ont été refusés à la nouvelle commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise).
Pour ce qui concerne les collectivités territoriales, je me contenterai de rappeler que le texte proposé supprime 1, 4 milliard d'euros par rapport à celui qu'a voté le Sénat.
Supprimés les votes du Sénat sur les dotations aux collectivités locales !
Supprimé le rétablissement du prêt à taux zéro pour le logement neuf à tout le territoire !
Supprimée l'aide d'urgence aux départements !
Supprimée la fraction des produits des quotas carbone pour les autorités organisatrices de la mobilité en province !
Supprimé le fonds d'urgence climatique pour les collectivités locales !
Vous avez même supprimé lors de votre arbitrage, monsieur le ministre, des amendements sur lesquels vous aviez émis un avis favorable !

M. Christian Bilhac . Nous saluons, bien évidemment, le nouveau zonage France ruralités revitalisation, la prorogation de l'exonération fiscale et sociale sur les pourboires, la transposition de la directive européenne pour une imposition mondiale minimale des entreprises multinationales, ou encore l'amendement streaming visant à augmenter la taxe sur les services vidéo. Je n'oublie pas non plus le taux réduit de TVA sur les préservatifs !
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.

Mais ces quelques avancées sont autant de pièces jaunes jetées avec mépris à la représentation nationale.
Pour ne paraphraser personne, à l'Assemblée nationale, le recours à l'article 49.3 signifie : « Ferme ta gueule ! » ; au Sénat, on nous dit plutôt : « Cause toujours, mais je suis sourd ! »
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.

Ce texte aggrave le déficit de l'État de 2, 4 milliards d'euros. Et vous n'hésitez pas à bafouer le grand principe budgétaire de l'annualité, avec le report massif de crédits d'une année sur l'autre.
Dans le droit fil de sa position de principe, le groupe RDSE ne votera pas la motion tendant à opposer la question préalable qui va nous être soumise. Cela ne signifie pas, tant s'en faut, que le présent projet de loi de finances nous satisfait.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. - M. le rapporteur général de la commission des finances applaudit également.
Courage ! et sourires sur les travées du groupe Les Républicains.
Un sénateur du groupe Les Républicains. Jusqu'ici, ça va !
Sourires.

M. Thani Mohamed Soilihi . … le Sénat a adopté la semaine dernière un texte dont notre groupe a déploré le déséquilibre.
Oh ! sur les travées du groupe Les Républicains.

Plusieurs missions ont été supprimées par la majorité sénatoriale : plus de politique du logement ; plus de crédits pour le sport l'année même des jeux Olympiques et Paralympiques ; plus de crédits pour la politique migratoire, alors que la droite sénatoriale a fait de sa radicalité en la matière un symbole politique au cours des derniers jours.
De la même manière, le volet fiscal du budget, après son examen au Sénat, comportait des réformes de grande ampleur, adoptées sans cohérence ni évaluation préalable, parfois avec le soutien de la majorité sénatoriale, parfois contre elle.
Dans ces conditions, le sort de ce budget en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale était écrit : il fallait rétablir les crédits des politiques publiques essentielles, corriger les mesures fiscales adoptées lorsque leurs objectifs s'avéraient incohérents entre eux, revenir à un budget qui puisse être exécuté et financer notre service public, quand le texte qui sortait du Sénat se contentait d'afficher des messages politiques, dont je ne conteste d'ailleurs pas la légitimité.
C'est ce travail de réécriture que le Gouvernement a fait en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Je me félicite ainsi qu'ait été conservée dans ce texte l'exonération fiscale pour les entreprises mahoraises, que j'ai portée avec le soutien de mon groupe. Je pense également au soutien apporté aux chambres de commerce et d'industrie, amendement défendu par notre collègue Didier Rambaud.
Notre groupe déplore toutefois que nous ne puissions pas débattre de ce texte en nouvelle lecture. Aussi voterons-nous contre la motion de rejet qui nous sera soumise.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Dommage ! sur des travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, sénatrice depuis 2020, j'ai bien compris que les marges de manœuvre des parlementaires étaient réduites sur les projets de loi, qui plus est sur ceux qui sont relatifs à nos finances publiques.
La révision constitutionnelle de 2008 n'a pas marqué la fin du parlementarisme rationalisé. L'initiative gouvernementale en matière de loi de finances demeure totale.
Pour autant, travailler sur le projet de loi de finances n'est jamais décevant. En passant des centaines d'heures en séance publique, en examinant des milliers d'amendements, je n'ai pas eu l'impression de perdre mon temps.
C'est le moment de l'année où les parlementaires débattent des orientations choisies par le Gouvernement pour notre pays. Monsieur le ministre, je ne vous cache pas que j'aurais préféré que celles-ci soient différentes…
Ce moment est donc aussi l'occasion pour nous, à gauche, de présenter nos propositions visant à rééquilibrer la fiscalité au bénéfice des classes populaires et moyennes, et à encourager, tant en recettes qu'en dépenses, la transition écologique.
Malgré ces conditions dégradées, le Sénat a constamment joué son rôle en permettant que se déroulent des débats qui n'avaient pas eu lieu à l'Assemblée nationale. Nous avons apporté des évolutions notables au texte, avec notamment l'amélioration du nouveau zonage France ruralités revitalisation.
Avec mes collègues socialistes, nous avons tiré la sonnette d'alarme sur certains sujets, comme la mise en place de budgets verts pour les collectivités. Nous avons aussi pointé les incohérences de l'exécutif.
La France est « à l'euro près » quand il s'agit de transformer une réduction d'impôt en crédit d'impôt pour tous les résidents d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Mais elle ne l'est pas pour le transport de chevaux, qui voit sa TVA réduite !
Mme Nathalie Goulet proteste.

En fin de compte, cette dernière mouture reste foncièrement injuste et en décalage avec les enjeux d'aujourd'hui.
Après trois semaines de débats au Sénat, le texte a été remanié selon le bon vouloir du Gouvernement, via un énième 49.3 à l'Assemblée nationale.
Monsieur le ministre, je voudrais rappeler que la fonction première du Parlement, c'est de voter l'impôt. Et les parlementaires doivent rester au cœur de l'adoption de la législation fiscale.
Prenons l'exemple de l'article relatif à la Fifa. Celui-ci promet de multiples exonérations fiscales et sociales en cas d'installation de fédérations sportives internationales, dont certaines – il faut bien le dire – n'ont pas fait preuve d'une grande exemplarité.

Cette mesure est symptomatique de la vision qu'a le Gouvernement du Parlement : cet article, absent du projet de loi de finances, a été intégré via le 49.3 en première lecture, puis supprimé au Sénat. Même en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, le rapporteur général n'a pas proposé de revenir sur sa suppression.
Pourtant, le Gouvernement a souhaité réintroduire cette mesure, qu'il juge certainement fondamentale…
Au-delà du fond, cette situation interroge sur le rôle du Parlement. L'exécutif va-t-il gouverner de cette manière jusqu'en 2027 ? La fiscalité n'est admissible que dans la mesure où elle est consentie par les parlementaires.
Cette attitude du Gouvernement à l'égard de la représentation nationale, reléguée au second plan, pose un problème démocratique. L'exécutif devrait donc faire plus attention à la place qu'il accorde au Parlement dans notre République.
La motion tendant à opposer la question préalable sera votée par le Sénat, et nous la voterons. Cette issue n'en est pas moins regrettable, mais elle relève de la seule et unique responsabilité du Gouvernement.
Applaudissements sur les travées du groupe SER. - M. Christian Bilhac applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je commencerai mon propos en posant une question toute simple : qui sait, ici, qu'à partir du 1er janvier prochain toutes les communes devront envoyer leur budget douze jours avant la date de convocation du conseil municipal ?

Personne, sauf ceux qui étaient présents dans notre hémicycle ! Ce seul exemple illustre la différence entre une approche technocratique et une approche pragmatique.
Le Gouvernement a résolument choisi la première voie ; nous maintenons que la seconde est la seule qui peut réconcilier les citoyens avec la politique.

Telle est la philosophie qui nous a guidés dans la défense de nos amendements. C'est la raison pour laquelle le Sénat a rejeté à l'unanimité le « paradis fiscal » prévu pour la Fifa.
La semaine dernière, nous avons tous ici réfléchi à la façon d'améliorer le travail parlementaire. À cet égard, je vous soumets une idée toute simple : le Gouvernement n'a qu'à abandonner les soixante-dix jours de navette parlementaire ! En effet, deux jours pourraient suffire : l'un pour l'Assemblée nationale, et l'autre pour le Sénat !
Le Gouvernement pourrait ainsi utiliser à son profit la soixantaine de jours supplémentaires pour finaliser la rédaction de tous les articles et envoyer le tout au Conseil d'État afin qu'il donne son analyse. Pourquoi pas, après tout, puisque le rôle de l'Assemblée nationale et du Sénat se limite à une simple discussion générale ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Même les amendements mettant en conformité le projet de loi de finances pour 2024 avec la loi de programmation des finances publiques ont été supprimés !
Ce projet de loi de finances s'affranchit d'une loi que la majorité a elle-même écrite, grâce au recours au 49.3 il y a quelques semaines. Ce texte foule aux pieds le Parlement ! J'ajoute même, et je regrette de devoir vous le dire, qu'il vous humilie, monsieur le ministre, puisque vous aviez donné un avis favorable sur certains de nos amendements.
M. Bruno Belin acquiesce.

Les mesures de bon sens ou de simplification ? Balayées, sans que les propos du ministre au bancaient vraiment permis d'en comprendre la raison ! Je considère, pour ma part, qu'elles avaient pour unique défaut de ne pas avoir étéprésentées par la majorité présidentielle.

Je pensenotamment ici au non-assujettissement des locauxd'enseignement privé sous contrat à la taxed'habitation sur les résidences secondaires. Leministre de l'éducation nationale, ancien ministrechargé des comptes publics, y est pourtantfavorable.
Rien n'a été repris de ce qu'a proposé le Sénat, ou bien uniquement desamendements puisés à bonne source, c'est-à-direauprès du Gouvernement.
Une exception notable : la définition des zones FRR. Heureusement, d'ailleurs ! Car cette disposition préparée pendant dix-huit mois par la ministre Dominique Faure -- a nécessité une nouvelleconcertation entre tous les groupes du Sénat, jusqu'à la dernière minute, pour déboucher sur unerédaction adoptée à l'unanimité.
Des amendements de la commission des financesou du groupe Les Républicains, on ne trouve que des traces.
L'article 5 vicies A instaurant une taxe sur le streaming, porté notamment par unamendement du rapporteur général et par un amendementidentique du président de la commission de laculture, …

… a été supprimé au profit de l'article 5 vicies B, qui a été réécrit : ce n'est pas le texte du Sénat !

Le Gouvernement a partiellement entendu la demande d'application du principe « qui paye décide » en matière d'exonération de taxe foncière sur le foncier bâti.
L'exonération, introduite à l'article 27 sexies, portant sur les logements individuels sera à la discrétion des communes ; en revanche, celle qui est prévue par l'article 6, qui porte sur les logements sociaux, sera obligatoire.
Certes, l'État a bien introduit un prélèvement sur recettes (PSR) complémentaire pour dédommager les communes. Mais pour combien de temps ? Quelle est la garantie de ce PSR dans la durée ? Chat échaudé...
En effet, une exonération accordée en 2024 a une durée de quinze ans. Par ailleurs, il ne vous aura pas échappé que les membres de l'association des maires du Val-de-Marne (AM 94) avaient justement défilé la semaine dernière pour protester contre cette disposition.
Sur l'exonération de TGAP dans les outre-mer, la rédaction finalement retenue est bien éloignée des ambitions sénatoriales : l'article devient une réforme complète de la taxe.
Il en est de même pour la résidence secondaire des Français résidant à l'étranger. Le Gouvernement a retenu, à l'occasion du recours à l'article 49.3, l'amendement du groupe RDPI relatif à une simple résidence de repli, là où le groupe LR visait une résidence d'attache.
En fait, le Gouvernement peut porter au crédit du groupe LR seulement trois mesures, qui sont certes importantes pour les secteurs concernés, mais qui ne vont pas révolutionner la fiscalité française.
Il s'agit de : l'aménagement des conditions d'éligibilité des fonds de capital investissement au dispositif d'apport-cession – un amendement également porté par le groupe Les Indépendants – ; la déduction de la TVA concernant les véhicules de transport de chevaux – un amendement défendu aussi par le groupe Union Centriste – ; enfin, des mesures d'ajustement de l'écotaxe alsacienne, via un amendement porté par tous les sénateurs alsaciens.
Je n'ai pas retenu dans cette courte liste la minirévolution de l'alignement du régime fiscal des locations de meublés de tourisme sur celui du régime du micro-foncier pour locations nues. Nous avons bien compris qu'il s'agissait d'une erreur, après les multiples doublons de la première navette.
C'est dommage, car c'est finalement la seule mesure de ce projet de loi de finances en faveur du logement. Toutes les autres dispositions votées sur l'initiative de la majorité sénatoriale ont, elles aussi, été supprimées : l'exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sur les dons pour l'acquisition et la construction d'une résidence principale, ou pour des travaux de rénovation énergétique ; le remplacement de l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive ; le rétablissement du recentrage du prêt à taux zéro dans le logement neuf.
Pourtant, monsieur le ministre, le secteur du logement va très mal : 150 000 emplois sont en jeu et la baisse annuelle des ventes n'a jamais été aussi forte en dix ans. Or vous ne faites rien !
Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a jeté, hier, une nouvelle pierre dans la mare : il dénonce une fiscalité du logement incohérente et inégalitaire, et plaide pour une simplification radicale. Pour autant, il ne me semble pas que ces questions soient traitées dans la future loi relative au logement, tant le périmètre de celle-ci se réduit au fil des jours.
Des 7 milliards d'euros d'économies proposées par le Sénat, là encore, il ne reste rien. Pourtant, il ne s'agissait pas de coups de rabot à l'aveugle, contrairement à ce que vous avez dit, de façon caricaturale, monsieur le ministre !
M. le rapporteur général de la commission des finances acquiesce.

Pis encore, le déficit de l'État est encore dégradé de 2, 5 milliards d'euros, principalement du fait d'une augmentation de la dépense publique de près de 2 milliards. Dans le même temps, les recettes fiscales sont augmentées via le relèvement, par arrêté, des accises sur le gaz et l'électricité. Or vous l'avez caché aux Français.

Certes, vous l'avez dit dans notre hémicycle, monsieur le ministre, mais combien de personnes suivent nos débats ? Cette hausse pèsera de manière uniforme sur le budget de tous les ménages, là où le Sénat avait proposé une mesure différenciée pour soutenir les plus fragiles.
Encore tout à l'heure, vous avez osé, monsieur le ministre, évoquer la justice fiscale...

Mais vos mesures ne relèvent pas de la justice fiscale !
En 2022, nous étions le pays le plus taxé de l'OCDE, loin devant le deuxième : les recettes fiscales représentaient 46, 1 % du PIB.
Je crains que cette révision à la hausse du déficit ne soit qu'une hypothèse basse, car le Gouvernement n'a pas modifié son hypothèse de croissance, alors même que les dernières estimations de l'OCDE ou de la Banque de France s'écartent de la cible.
Ce projet de loi de finances devait marquer le retour au sérieux budgétaire. C'est complètement raté !
Je ne peux manquer de rappeler que le ministre Bruno Le Maire…

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est où ?
Sourires.

… appelait, le 9 octobre dernier, les députés de la majorité à trouver 1 milliard d'euros d'économies supplémentaires.
Pour conclure, je relève, monsieur le ministre, que vous vous donnez tous les moyens de ne pas revenir devant le Parlement. Le relèvement des reports de crédits de 43 programmes budgétaires, au-delà de ce que permet la Lolf, est un déni du parlementarisme. Un de plus…
Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera pour la motion de rejet qui nous est présentée et se mettra dès demain au travail pour contrôler l'action du Gouvernement, seule prérogative encore à la main des sénateurs.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. - M. Christian Bilhac et Mme Véronique Guillotin applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, personne dans cet hémicycle ne souhaite priver l'État de son budget. C'est une évidence, mais il me semble nécessaire de la rappeler à ce stade du débat.
Le Gouvernement a engagé sa responsabilité pour faire adopter le projet de loi de finances pour 2024. C'était malheureusement la seule issue afin de doter l'État d'un budget. Notre groupe soutient évidemment cette volonté de faire adopter le projet de loi de finances pour cette année. À dire vrai, le contraire serait inquiétant…
Toutefois, cette volonté ne doit pas dévaloriser les débats parlementaires. On l'a vu avec le projet de loi sur l'immigration, c'est grâce au débat parlementaire que le texte a été enrichi.
Exclamations sur des travées des groupes SER et GEST.

Au long de l'examen du projet de loi de finances, nous avons eu de nombreux débats, durant près de 150 heures, qui ont également permis d'enrichir le texte, à l'aide de plusieurs mesures fortes, notamment pour les collectivités.

La commission des finances a également été force de proposition pour réaliser des économies importantes et améliorer les comptes publics.
Je constate que beaucoup de ces propositions, pour ne pas dire une large majorité d'entre elles, n'ont pas été retenues dans le texte adopté en nouvelle lecture.
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Je pense notamment à la mission « Travail et emploi », dont j'ai eu l'honneur de rapporter les crédits avec ma collègue Ghislaine Senée. Nous avions proposé d'économiser 600 millions d'euros cette année…

… en révisant les critères d'attribution des aides exceptionnelles à l'apprentissage dans les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises pour les bac+3, ainsi que le rapporteur général l'a rappelé.
J'espère que cette proposition, qui n'a pas été retenue, pourra au moins déboucher sur une concertation, puis les années prochaines aboutir à un meilleur ciblage des aides, et donc à une meilleure pertinence de la dépense publique.
En conséquence, la situation de nos comptes publics demeure particulièrement dégradée. Le déficit est redescendu à 4, 4 % du PIB ; c'est une bonne chose. Ce ratio est en phase avec la loi de programmation des finances publiques, comme le ministre l'a rappelé, mais il est encore loin de nos engagements européens.
Il ne s'agit pas de se soumettre à un supposé diktat bruxellois ; il s'agit de tenir la parole de la France vis-à-vis de nos partenaires européens. Il y va de notre crédibilité.
De même, la dette publique reste à un niveau trop élevé, à 110 % du PIB. Là encore, ce ratio est en phase avec la loi de programmation, mais non avec nos engagements européens. Réduire le poids de la dette est essentiel pour garantir la pérennité de notre modèle social. La croissance n'y suffira pas, il faudra également réduire les dépenses publiques.
MM. Pascal Savoldelli et Éric Bocquet soupirent.

Notre groupe continuera de suivre cette même ligne : il faut réduire les dépenses publiques pour réduire la dette et préserver notre souveraineté économique.
Monsieur le ministre, le Gouvernement aurait sans doute pu intégrer au texte définitif davantage de propositions du Sénat. Mais je reconnais aussi que vous avez su conserver quelques points intéressants.
Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.

… notamment, comme l'a rappelé Christine Lavarde, au sujet du zonage du dispositif France ruralités revitalisation.

Vous avez aussi conservé des amendements – j'y suis particulièrement sensible –, au sujet de la rénovation du patrimoine religieux, et de l'intégration des communes nouvelles à la souscription voulue par le Président de la République…

… et suggérée par nos collègues Pierre Ouzoulias et Anne Ventalon, qui avaient rendu un rapport sur cette question.

Je m'étais mobilisé avec mes collègues sénateurs Stéphane Piednoir, Grégory Blanc et Corinne Bourcier pour avancer sur cette proposition.
Mes chers collègues, vous l'aurez compris : traditionnellement, notre groupe ne vote pas les questions préalables – ici, on ne parle pas de motion de rejet, madame Lavarde… -, parce que nous considérons qu'il ne faut pas se priver d'un débat.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.

Je suis saisi, par M. Husson, au nom de la commission, d'une motion n° I-1.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat ;
Considérant que les sous-jacents macroéconomiques sur lesquels repose le projet de loi de finances pour 2024 ne sont pas suffisamment réalistes, en particulier la prévision de croissance de 1, 4 % du produit intérieur brut (PIB) pour 2024, deux fois plus élevée que celle du consensus des économistes, et qui sous-estime fortement l'effet du relèvement historique des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) ;
Considérant qu'aucun effort de maîtrise de la dépense publique n'est proposé dans le texte renvoyé en nouvelle lecture, qui présente un déficit de l'État dégradé de 2, 4 milliards d'euros supplémentaires par rapport au texte initial, maintenant la France à des niveaux de déficits historiques, proches ou au-delà de 150 milliards d'euros par an, contre en moyenne 90 milliards d'euros par an avant 2020 ;
Considérant que, dans ce contexte, le Gouvernement, dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, n'a pourtant repris aucune des économies votées par le Sénat, qui totalisaient plus de sept milliards d'euros et permettaient d'engager le redressement des comptes publics de la France : ciblage des baisses d'impôt sur l'électricité, aides à l'apprentissage, réforme de l'audiovisuel public, aide au développement ou encore aide médicale d'État ;
Considérant ainsi que le Gouvernement n'a pas pris la mesure de l'effort à faire et des priorités d'action à fixer malgré la hausse des taux directeurs et l'accroissement massif de la charge de la dette qu'elle entraîne et entraînera dans les années à venir ;
Considérant qu'à l'heure où les autres pays de l'Union européenne ont, dans leur très grande majorité, engagé le nécessaire rétablissement de leurs comptes publics après la période de crise qui s'est achevée, la France est désormais identifiée comme faisant partie des pays de l'Union qui se signalent par leur mauvaise gestion budgétaire, caractérisée par les déficits et la dette publics parmi les plus élevés des États membres ;
Considérant que le seul apport significatif du Sénat, conservé par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en nouvelle lecture en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution est l'article 7 du présent projet de loi, pour sa partie relative à la création des zones « France ruralités revitalisation » ;
Considérant que le Gouvernement est, à l'inverse, revenu sur la quasi-totalité des apports du Sénat, y compris ceux pour lesquels il avait rendu un avis favorable en séance publique et ceux qui ne faisaient que traduire les engagements pris par ce même Gouvernement et votés dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ;
Considérant en particulier que le Gouvernement ne retient aucun des dispositifs fiscaux votés par le Sénat en faveur de la transmission de patrimoine et du logement, qu'il ne maintient pas le prêt à taux zéro (PTZ) en l'état sur tout le territoire, qu'il ne cible pas les aides pour l'électricité, qu'il supprime le fonds d'urgence climatique pour les collectivités territoriales, qu'il ne prend pas en compte les votes du Sénat sur les dotations aux collectivités territoriales, en particulier la dotation globale de fonctionnement (DGF) et l'aide d'urgence aux départements, et que, enfin, aucune fraction du produit de la mise aux enchères des quotas carbone ne viendra financer les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de province, dont le financement reste dans l'impasse ;
Considérant en conséquence, malgré la multiplication des déclarations du Gouvernement enjoignant les parlementaires à lui proposer des économies budgétaires, le peu de cas que celui-ci fait des plus de 150 heures de débat en séance publique au Sénat et des votes de notre assemblée, qui s'ajoute à l'absence quasi totale de discussion du présent projet de loi de finances par l'Assemblée nationale en séance publique ;
Considérant en particulier que cette procédure budgétaire dégradée conduit le Gouvernement à maintenir dans son texte, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, l'article 3 sexvicies, qui prévoit de très larges exonérations fiscales pour les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique, alors même que le Sénat, seule assemblée ayant été en mesure de se prononcer sur cet article, l'a supprimé à l'unanimité, et que l'Assemblée nationale n'a jamais pu en débattre, et qu'il apparaît extrêmement fragile au regard des impératifs constitutionnels d'égalité devant l'impôt, l'avantage ainsi procuré apparaissant injustifiable ;
Considérant, de manière générale, la mauvaise qualité du texte transmis, qui présentait déjà en première lecture un nombre important de scories, d'erreurs et de doublons et qui comporte en nouvelle lecture de nouvelles incohérences, sur lesquelles le Gouvernement annonce d'ores et déjà qu'il compte revenir alors que le texte est encore en discussion ;
Considérant la persistance de pratiques de mauvaise gestion budgétaire qui portent préjudice à l'autorisation parlementaire, notamment les surbudgétisations récurrentes, auxquelles il n'est pas mis fin, la pratique des reports de crédits, qui n'est pas conforme à la loi organique relative aux lois de finances, ou encore la multiplication des articles transférant au profit de l'exécutif le pouvoir fiscal dévolu au Parlement ;
Considérant, enfin, au regard de ce qui précède, que l'examen en nouvelle lecture par le Sénat de l'ensemble des articles restant en discussion du projet de loi de finances pour 2024 ne conduirait vraisemblablement pas à faire évoluer le texte ;
Le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture n° 219 (2023-2024).
La parole est à M. le rapporteur général, pour la motion.

Pour l'essentiel, j'ai déjà développé le contenu de cette motion et dit quel était l'état d'esprit qui nous anime lors de ma prise de parole durant la discussion générale.
Dès lors, monsieur le ministre, je souhaite simplement rappeler quelques données, que certains de nos collègues ont parfois reprises.
Nous vous alertons : vous avez la responsabilité des finances de notre pays, en tandem avec un grand absent, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Nous en avons une certaine habitude…
Les chiffres du Fonds monétaire international (FMI) prévoient qu'en matière de déficit public, la France sera classée au dix-neuvième rang sur vingt dans la zone euro. Nous ne pouvons ni nous en réjouir ni en tirer une gloire particulière.
En ce qui concerne la dette, monsieur le ministre, seuls deux pays de la zone euro sont derrière la France : la Grèce et l'Italie. Mais ces deux pays sont en train de remonter la pente, alors nos comptes continuent à se dégrader.

Monsieur le ministre, votre majorité est à ce jour la plus dépensière depuis bien longtemps.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mais la crise, monsieur le ministre, concerne tous les pays ! Je vous réponds directement, afin d'aider les équipes rédigeant les comptes rendus, que je remercie.
Sourires.

Les prévisions de croissance retenues par le Gouvernement tablent sur +1, 4 point, mais le consensus des économistes se rejoint autour d'une croissance pour moitié inférieure, autour de +0, 7 point. La Banque de France, quant à elle, prévoit une croissance de 0, 9 point. Je souhaite que le Gouvernement ait raison, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que la dynamique s'émousse.
Monsieur le ministre, votre ministre de tutelle est donc absent, mais il nous a souvent invités à dialoguer. Lors des assises des finances publiques au mois de juin dernier, puis lors des dialogues de Bercy qui se tiennent depuis deux ans, les moyens de réaliser 1 milliard d'euros d'économies ont été proposés.
Ici, au Sénat, nous pensons que dialoguer à l'extérieur du Parlement peut servir à dessiner un fond de carte sympathique, mais reste quelque peu inutile. Je vous le dis, monsieur le ministre, il faut arrêter : que de temps perdu pour si peu de constructions !

Le débat doit avoir lieu avec les élus, au Parlement. Profitez du temps d'échange dont vous disposez à l'Assemblée nationale pour engager un dialogue ! Au Sénat, nous avons fait « carton plein » pour ce qui est de la durée des débats, mais le résultat nous semble bien décevant !
Monsieur le ministre, je me souviens que lors de ma première prise de parole dans l'examen de ce projet de loi de finances pour 2024, je nous avais alertés en nous rappelant à notre responsabilité particulière, due au fait que nous serions la seule chambre à procéder à l'examen du projet de loi de finances pour 2024.
Monsieur le ministre, je vous avais également rappelé cette responsabilité particulière lors des explications de vote sur l'ensemble du texte, renforcée eu égard à nos échanges sereins, constructifs, et à l'ambiance de travail que nous avons partagée.
Ce que je trouve éminemment regrettable, c'est le signal que le Gouvernement envoie. Notre collègue Christian Bilhac parlait d'une forme de mépris du Gouvernement envers la représentation nationale, mais il me semble qu'il y a aussi une forme de mépris à l'égard des Français.

Les Français commencent à considérer que vos manières de procéder sont relativement critiquables et dangereuses.
Enfin, monsieur le ministre, je conclurai en indiquant que, lors de cette séquence budgétaire, deux interventions que la Première ministre a faites en dehors du débat budgétaire devant le Parlement m'ont posé problème.
Tout d'abord, elle a annoncé que les départements allaient recevoir une dotation supplémentaire – une onction - de 53 millions d'euros, sans que l'on en connaisse précisément les détails, et sans que ces fonds soient repris dans le projet de loi de finances.
Ensuite, après avoir reçu les Jeunes Agriculteurs et la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), elle a annoncé sur le parvis de Matignon la suppression de certains dispositifs, en renonçant notamment à la hausse de la redevance pour pollution diffuse.
Monsieur le ministre, cela me pose un problème : lorsque j'avais proposé de renoncer à cette hausse en supprimant l'article 16 du projet de loi, que n'avais-je entendu de votre part ? Pas d'écoute ; vous déclariez avoir des préoccupations écologiques ; que nenni !
J'avais tout de même insisté sur le manque de concertation avec les élus locaux. Vous avez tenu des propos relativement accusateurs, bien que sympathiques, à mon endroit. Vous demanderez à la Première ministre ce qu'elle en pense, puisque vos critiques peuvent s'appliquer à elle, comme elle a décidé, en dehors du Parlement, de renoncer à cette hausse. En tout cas, il me semble que cela témoigne d'une certaine forme de cacophonie au sein du Gouvernement.
Voilà, monsieur le ministre, les éléments que je souhaitais rappeler en complément de ceux que j'ai invoqués tout à l'heure, et qui nous conduisent à défendre cette motion tendant à opposer la question préalable.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Christian Bilhac applaudit également.

Y a-t-il un orateur contre la motion ?…
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.
Naturellement, cela ne vous surprendra pas, l'avis sera défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je sais que cela engendre une grande déception dans ces travées…
Sourires.
Sans refaire le débat, je voudrais vous demander comment, dans les délais auxquels nous sommes contraints, enrichir un texte. La veille de son examen, plus de 3 700 amendements avaient été déposés sur ce texte.
Je ne partage pas totalement votre avis, monsieur le rapporteur général, au sujet des dialogues de Bercy. J'aurais aimé vous y retrouver…
Aucun soupçon, monsieur le rapporteur général ! Nous aurions pu continuer à avancer comme nous l'avons fait.
Les dialogues de Bercy ont été utiles, car nous avons repris des amendements issus de propositions faites par des députés et des sénateurs.
La grande difficulté, monsieur le rapporteur général, c'est que l'on ne peut pas restreindre nos échanges à ces quelques jours passés dans l'hémicycle, alors que 3 700 amendements ont été déposés. C'est tout simplement impossible !
Je vous l'ai indiqué, y compris en aparté, monsieur le rapporteur général : je suis favorable à ce qu'un travail soit mené très en amont de la discussion budgétaire au Parlement, pour que l'on puisse, en fonction des propositions du président de la commission des finances et du rapporteur général, se concentrer sur certains sujets. Sinon, la discussion est matériellement impossible !
J'en suis convaincu, il y a parfois des dispositions utiles contenues dans les milliers d'amendements sur lesquels j'émets un avis défavorable, mais il est matériellement impossible de construire des solutions au moyen de ce flot d'amendements.
Je vous le redis, monsieur le rapporteur général, je suis favorable à ce que l'on se voie beaucoup plus tôt autour de sujets sur lesquels la commission des finances a travaillé, afin d'avancer.
À l'inverse, avec ce nombre d'amendements, il est très compliqué de faire un travail de qualité qui ne soit pas frustrant.

Un contraste saisissant se fait jour. Le Gouvernement écrit le projet de loi sur l'immigration sous la dictée des membres du parti Les Républicains, …

… mais le groupe politique des Républicains au Sénat se fait balader.
Dans les considérants de la motion, je lis les mots « après la période qui s'est achevée ». Mais ce diagnostic ne parle pas aux gens ! Ils et elles le savent pour le vivre, la crise est installée, et elle est angoissante.
Cette motion tendant à opposer la question préalable marque une forme d'impuissance du Sénat à peser sur la procédure budgétaire, face, il est vrai, à l'aveuglement du Gouvernement.
Elle témoigne de l'incapacité de la majorité sénatoriale à construire un budget alternatif crédible. Brandir le totem du déficit est en totale contradiction avec votre comportement et avec les amendements que vous avez adoptés.
Toutes les mesures proposant des recettes nouvelles ont reçu un avis défavorable dans cet hémicycle.
Accroissement de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ? Non ! Mise à contribution des profits indus ? Non ! Accroissement de la taxe sur les transactions financières ? Non ! Taxe sur les rachats d'actions ? Non !
L'ensemble des mesures d'économies adoptées ne compensent pas la hausse de vos dépenses. Vous prétendiez que, dans le budget issu du Sénat, le solde budgétaire serait amélioré de 0, 2 point de PIB, soit 5, 5 milliards d'euros. Mais non !
C'est l'adoption de votre amendement de suppression du programme 369 « Amortissement de la dette de l'État liée à la covid-19 » qui a permis cette amélioration, pour 6, 5 milliards d'euros. En gros, un jeu de passe-passe gouvernemental a débouché sur un jeu de dupes.
M. le rapporteur général agite le doigt en signe de dénégation.

La prorogation des niches fiscales coûte très cher aux finances publiques. Une modeste restriction des aides à l'apprentissage mise à part, les profits des entreprises ne seront partagés en 2024 ni avec leurs salariés ni avec le reste de la population.
Nous nous abstiendrons sur cette motion, car il faut mettre fin au simulacre de la procédure budgétaire menée sous le joug du 49.3 !
Mes chers collègues, la droite sénatoriale ne résout rien en rejetant ce texte bien trop tard. Lorsque nous proposions une motion de rejet préalable au début de l'examen du texte, vous vous berciez d'illusions et feigniez d'oublier que le Gouvernement réglerait ce budget tout seul ! Le retour à la réalité est brutal : membres des Républicains et du Gouvernement, ensemble, vous aggravez la dette et le déficit.
Je vous le demande : qui en profitera ? Prêteurs et profiteurs !
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE -K. - Mme Émilienne Poumirol applaudit également.

Je mets aux voix la motion n° I-1, tendant à opposer la question préalable.
Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi de finances.
Je rappelle également que le Gouvernement a émis un avis défavorable.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 108 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, le projet de loi de finances pour 2024 est rejeté.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.

M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration est parvenue à l'adoption d'un texte commun.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Applaudissements sur des travées des groupes UC et INDEP. – Huées sur des travées des groupes SER et GEST. – M. Thomas Dossus s'exclame.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à quinze heures cinquante, est reprise à quinze heures cinquante-cinq.