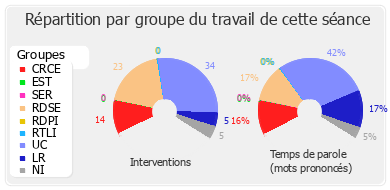Séance en hémicycle du 3 mars 2011 à 14h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à douze heures vingt, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Guy Fischer.

La séance est reprise.

Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de deux organismes extraparlementaires.
La commission des affaires étrangères et la commission de la culture proposent respectivement les candidatures de Mme Catherine Tasca et de M. Louis Duvernois pour siéger au sein du conseil d’administration de l’Institut français, créé en application de l’article 6 du décret n° 2010-1695 du 30 décembre 2010.
Par ailleurs, la commission de la culture propose la candidature de Mme Claudine Lepage pour siéger au sein du conseil d’orientation stratégique de l’Institut français, créé en application de l’article 5 du décret n° 2010-1695 du 30 décembre 2010.
Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.
(Texte de la commission)

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la garde à vue.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. François Pillet.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, pour la première fois depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, notre assemblée est saisie d’un projet de loi visant à tirer les conséquences d’une décision rendue dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel.
En abrogeant le support légal de la garde à vue, tout en renvoyant les effets de sa décision au 1er juillet prochain, le Conseil constitutionnel a plus largement mis le législateur en demeure de définir un nouvel équilibre entre les droits de la défense et la protection de l’ordre public, au cours d’une mesure progressivement devenue un symbole de l’enquête policière.
Le 1er juillet prochain, nous serons donc dans l’obligation d’avoir réformé la garde à vue en préservant l’équilibre fragile entre le respect des droits individuels, du gardé à vue mais aussi des victimes, et le respect des droits de la société, que nous sommes chargés de protéger face au crime et à la délinquance.
La clef de la réussite de cet équilibre réside dans des règles procédurales claires, excluant tout risque d’arbitraire ou de laxisme. L’exercice qui nous incombe aujourd’hui est donc très délicat.
Au surplus, la navette parlementaire entre nos deux assemblées devra être un véritable marathon, afin de permettre au Conseil constitutionnel, le cas échéant, d’effectuer son contrôle dans les délais impartis.
En réalité, ce calendrier pose une question de fond. Nous devons faire évoluer notre garde à vue en dehors de la réforme globale de la procédure pénale, et préalablement à celle-ci, c’est-à-dire avant même que nous ayons mis en chantier la nécessaire refondation de notre code de procédure pénale.
La réforme que nous examinons doit ainsi se frayer un étroit chemin entre divers intérêts, souvent contradictoires.
Elle doit reconnaître que la personne mise en cause puisse exercer les droits légitimes à sa défense. À cet égard, la possibilité pour le suspect d’être accompagné d’un avocat dès le début de la garde à vue est actée. En posant ce principe dans la loi, nous allons tourner une page de l’histoire de la procédure pénale de notre pays.
La réforme doit donner les moyens de mener l’enquête sans entrave, afin de permettre la manifestation de la vérité, malgré les difficultés de la tâche des services chargés de mener l’enquête, en particulier dans un contexte où la criminalité évolue, où elle est sans doute plus complexe, mieux organisée, souvent de dimension internationale. Nous devons donc éviter que le déroulement de la garde à vue ne gêne ou n’entrave la mission de l’enquêteur.
Elle doit aussi accorder à la victime les moyens d’être respectée et protégée, et éviter que celle-ci n’ait dans les faits, comme c’est hélas ! le cas, le sentiment que les rôles sont inversés, en d’autres termes qu’elle est mise en accusation tandis que l’auteur du délit apparaîtrait comme une victime du système qu’il faudrait protéger à tout prix.
C’est sans doute sur ce point qu’il existe un défi très important à relever.
Nous devons donc veiller à ce que nos concitoyens s’approprient cette réforme et qu’ils y adhèrent en ayant acquis la certitude qu’elle ne se fera pas au détriment de la vérité – celle des faits, celle des préjudices –, en somme qu’elle n’empêchera pas la justice de passer.
Le projet de loi que vous nous présentez, monsieur le ministre, est un progrès. Le renforcement du rôle tenu par l’avocat lors de la garde à vue constitue désormais un point consensuel du débat.
Le Président de la République lui-même déclarait devant la Cour de cassation, le 7 janvier 2009 : « Parce que [les avocats] sont auxiliaires de justice et qu’ils ont une déontologie forte, il ne faut pas craindre leur présence dès les premiers moments de la procédure. Il ne le faut pas parce qu’elle est, bien sûr, une garantie pour leurs clients, mais elle est aussi une garantie pour les enquêteurs, qui ont tout à gagner d’un processus consacré par le principe du contradictoire. »
C’est là, monsieur le garde des sceaux, une vision partagée : le progrès qui n’est perçu aujourd’hui que pour le gardé à vue est également un progrès pour les policiers et les forces de gendarmerie. Il n’y a pas de contradiction dans le texte, il ne me semble pas inutile de le réaffirmer.
Avant d’aborder plusieurs points essentiels, je veux rappeler un aspect doublement fondamental de ce projet de loi.
Tout d’abord, la garde à vue fait, pour la première fois dans notre procédure pénale, l’objet d’une définition. Ensuite, elle ne peut être mise en œuvre que pour atteindre six objectifs clairement définis. Ces objectifs sont d’autant plus protecteurs que, s’agissant de textes pénaux, ils doivent recevoir une interprétation restrictive.
La garde à vue ne peut désormais trouver application que pour des délits et crimes passibles d’une peine d’emprisonnement.
Le déroulement de la garde à vue présente en outre des droits nouveaux ou plus étendus.
Parmi ceux-ci, je souhaite relever la consécration du droit de se taire, le droit de faire prévenir un proche, son représentant légal et son employeur, la garantie immédiate d’un interprète pour la notification des droits, la limitation de la force probante des déclarations faites hors l’intervention de l’avocat et l’extension de l’assistance de l’avocat.
Ce dernier point est sans doute celui qui fit l’objet des plus larges commentaires.
Le débat sur la présence d’un avocat en garde à vue est ancien. Il achoppait jusqu’alors à l’une de nos traditions juridiques, celle d’une conception de la procédure pénale selon laquelle le caractère contradictoire des phases d’instruction puis de jugement permettait de poser certaines restrictions aux droits de la défense lors de la phase policière, sans remettre en cause pour autant ni la présomption d’innocence ni l’équilibre du procès pénal lui-même.
Incontestablement, l’année écoulée a fait voler en éclats les lignes de fracture qui marquaient traditionnellement ce débat.
Le droit à l’assistance effective d’un avocat durant toute la durée de la mesure est affirmé et organisé.
De même, et ce parallélisme est important, la victime pourra aussi être assistée d’un avocat lors des éventuelles confrontations.
Ces dispositions s’accompagnent d’un point important : la résolution de la question de l’accès au dossier.
L’avocat peut ainsi consulter dès le début de l’instruction non seulement le procès-verbal de notification du placement en garde à vue et le procès-verbal de notification des droits, mais aussi les procès-verbaux des auditions qui ont déjà été réalisées, y compris le certificat médical si un examen de ce type a eu lieu.
L’avocat pourra assister la personne en garde à vue dès le début de la mesure, il pourra même poser des questions à la fin de l’audition et le texte va plus loin dans la définition des possibilités qu’il aura dans ce domaine.
Ce dispositif novateur est, pour moi, fondamental et équilibré dès lors qu’il trouve uniquement sa limite dans les hypothèses où il serait illégitimement porté atteinte au bon déroulement de l’enquête ou à la dignité de la personne.
C’est à mon sens avec sagesse que l’Assemblée nationale a prévu un délai de carence de deux heures pour tenir compte de la situation concrète des barreaux et donner à l’avocat le temps de se rendre sur les lieux où s’exerce la garde à vue.
Ici encore, l’idée est de sécuriser le processus, et non de gêner ou de favoriser les uns ou les autres. Il s’agit de faire en sorte qu’il n’y ait pas de contestation ultérieure du processus de la garde à vue. Ainsi, l’effectivité du droit accordé à la personne gardée à vue est renforcée, tout en tenant compte de certains obstacles susceptibles de retarder l’arrivée de l’avocat sans que, parallèlement, l’indisponibilité de celui-ci soit de nature à retarder une enquête qui souvent réclame des diligences et des constatations rapides.
Nous notons enfin, avec satisfaction, que la création d’un régime d’auditions libres sans recours nécessaire à un avocat, bien que tentée, a été définitivement écartée.
Je souhaiterais m’arrêter un instant sur la place du juge et du parquet.
Tout d’abord, je veux rendre hommage à la qualité du travail accompli par les procureurs de la République et à la manière dont, avec les services de police et de gendarmerie, ils assument leurs responsabilités.
Au besoin, je conseille à mes collègues qui n’ont pas eu l’occasion de le faire de visiter un tribunal de grande instance et d’y observer la permanence du parquet, le jour et la nuit, et le travail effectué par les magistrats de ces unités. C’est une tâche extrêmement difficile, remplie de pièges pouvant ensuite avoir des conséquences redoutables dans les procédures et effectuée avec un dévouement remarquable. Cela aussi me paraît devoir être rappelé.
Il nous faut ici, dans le respect des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH, et de la Cour de cassation, trouver un dispositif qui définisse le plus précisément possible le rôle du procureur de la République ainsi que le rôle du juge.
Je ne m’engagerai pas dans un débat dogmatique sur ce point. Essayons d’être pratiques : nous devons mettre en place un dispositif juridique qui fonctionne.
La spécificité française a beaucoup été critiquée à cette tribune, mais le parquet à la française a aussi souvent démontré ses avantages. Il s’agit non pas uniquement de la garde à vue, mais du fonctionnement général de la justice.
Au surplus, le débat sur l’évolution du statut du parquet dans le cadre de l’étude du prochain code de procédure pénale sera ouvert.
Je tiens donc à rappeler que nous soutenons le processus d’intervention du procureur et du juge tel que notre rapporteur l’a évoqué, les responsabilités étant confiées au procureur de la République au début du processus et le juge intervenant le plus rapidement possible.
Je rappellerai aussi, comme cela a déjà été fait, que la CEDH n’a jamais imposé que la garde à vue soit contrôlée par un magistrat du siège. Elle exige seulement qu’au-delà d’un délai variant entre trois et quatre jours une personne privée de liberté soit présentée à un juge indépendant. Le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation n’ont d’ailleurs jamais dit autre chose.
En matière de police des gardes à vue, il faut éviter que le législateur ne stigmatise la profession d’avocat en préjugeant d’un mauvais comportement. Je soutiens donc ardemment le rapporteur dans son souhait de partir de l’assurance que l’avocat se comportera selon sa déontologie.
En tant qu’avocat et ancien bâtonnier, je peux vous assurer que cette réforme est un véritable défi pour la profession d’avocat. Cette dernière attend que, dans ce domaine, une juste rémunération lui soit reconnue et assurée.
Mais, au-delà de cette question, il ne faut pas se cacher les difficultés que rencontreront certains barreaux pour assurer, dans la pratique, l’application de cette loi et la satisfaction de ses exigences. Je ne doute pas néanmoins que la profession prendra très rapidement les dispositions et les initiatives nécessaires.
Mes chers collègues, nous ne pouvons pas prendre le risque de donner un coup de frein à la lutte contre la délinquance menée inlassablement par le Gouvernement.
Ce serait un mauvais signal pour les Français, qui nous disent tous les jours leur besoin de sécurité.
Ce serait un mauvais signal pour les délinquants, qui pourraient croire que tout est permis, en totale impunité.
Ce serait un mauvais signal, enfin, pour nos forces de l’ordre qui, voyant leur efficacité mise à mal pour des questions procédurales, nourriraient non seulement un sentiment de lassitude mais, pire, souffriraient d’une véritable démotivation dans leur lutte quotidienne contre la délinquance.
Ce serait également une injustice envers les victimes d’infraction.
Nous devons aussi éviter de faire une réforme pour rien. J’entends par là que nous ne pouvons pas nous permettre de mettre en place un dispositif qui pourrait encourir dans les mois qui viennent de nouvelles sanctions, soit du Conseil constitutionnel, soit de la Cour européenne des droits de l’homme, soit encore de nos plus hautes juridictions.
Nous sommes aujourd’hui face à une réforme essentielle, très attendue par le Sénat pour les raisons qui ont été développées ce matin par notre rapporteur. Elle est cependant, en raison de ses objectifs, techniquement complexe.
Au nom du groupe dont je suis le porte-parole, je veux vous dire que la réforme que vous nous présentez, monsieur le ministre, nous convient. Elle permet de parvenir à un certain équilibre entre les différentes contraintes que j’ai évoquées. Quant aux dispositions qui nous semblaient initialement poser problème, elles ont été modifiées, voire supprimées.
Les apports dus à la qualité du travail et de l’écoute de notre rapporteur doivent être salués. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous voterons avec satisfaction le texte qui nous est soumis.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP, ainsi qu’au banc des commissions.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui était – c’est le moins que l’on puisse dire – très attendu. Depuis un peu plus d’un an, c’est d’ailleurs la quatrième fois, si je ne me trompe, que nous examinons la question de la garde à vue, que ce soit au travers d’une question orale avec débat, de propositions de loi, ou enfin, aujourd’hui avec le présent projet de loi.
Le sujet n’est donc nouveau ni pour notre Haute Assemblée ni pour sa commission de lois, surtout pas pour son rapporteur, François Zocchetto, qui a déjà eu l’occasion d’approfondir cette thématique au travers des travaux réalisés par le Sénat que j’évoquais à l’instant.
La réforme de la garde à vue était devenue, depuis plusieurs mois, non plus souhaitable, mais tout simplement indispensable et urgente. Cela a déjà été rappelé, la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 fait peser une épée de Damoclès sur notre tête puisque, sans intervention du législateur avant le 1er juillet prochain, la garde à vue serait privée de base légale.
Une telle situation est évidemment inenvisageable. Mais cette décision du Conseil constitutionnel, si elle est sans doute celle qui a l’effet le plus contraignant pour le Parlement, n’est pas la seule ayant relevé les insuffisances de notre système de garde à vue. En effet, aussi bien la Cour de cassation que la Cour européenne des droits de l’homme ont rendu ces dernières années plusieurs arrêts constatant les insuffisances du système actuel, le thème récurrent de ces décisions étant la présence et l’assistance de l’avocat au cours de la garde à vue.
La Cour européenne des droits de l’homme a, dans sa jurisprudence, abordé cette problématique sous plusieurs angles : le moment d’intervention de l’avocat, avec les arrêts Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996 et Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008, mais aussi la portée de l’intervention de l’avocat au travers des arrêts Dayanan c. Turquie et Brusco c. France, rendus respectivement en 2009 et en 2010.
Mais, au-delà de ces aspects purement juridiques qu’il nous faut traiter, la réforme doit aussi être l’occasion de faire évoluer l’usage de la garde à vue au quotidien et de remédier à certaines dérives qui ont pu être relevées.
Tout d’abord, comment ne pas être interpellé par le nombre de gardes à vue prononcées chaque année ? Il atteint des records, et les chiffres que l’on évoque doivent nous faire réfléchir : près de 800 000 gardes à vue par an aujourd’hui, contre 300 000 à 400 000 il y a une dizaine d’années...
Il n’est pas question, évidemment, de promouvoir une quelconque forme de laxisme dans ce domaine. La garde à vue reste un acte de police judiciaire bien souvent indispensable, mais il faut en faire une utilisation plus rigoureuse, qui tienne surtout et d’abord compte de la gravité des comportements en cause et qui ne soit pas banalisée. Non, il n’est pas normal d’être placé en garde à vue pour une simple contravention, comme on l’a parfois vu ces dernières années !
Le texte qui nous est proposé prévoit donc que la garde à vue n’est possible que pour une personne à l’encontre de laquelle il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ». Cela paraît bien être la moindre des choses.
Un débat a eu lieu en commission sur la question du seuil d’emprisonnement encouru qui pourrait justifier le placement en garde à vue. Plusieurs collègues souhaitaient limiter la garde à vue aux personnes encourant un emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans.
À cette occasion, notre rapporteur a justement rappelé un principe fondamental qu’il ne faut pas oublier : la garde à vue est d’abord et avant tout créatrice de droits pour la personne interpellée. Augmenter le seuil conduirait à accroître mécaniquement le nombre des personnes soupçonnées de faits graves qui seraient auditionnées sans les garanties prévues au titre de la garde à vue, notamment hors la présence d’un avocat.
Néanmoins, et les débats en commission l’ont mis en évidence, prévoir cette seule condition pour être mis en garde à vue n’évacue pas le débat sur la hiérarchie et la logique des peines prévues dans notre code pénal.
Entre les incriminations créées il y a plusieurs décennies avec une échelle des peines qui avait sa logique à l’époque et celles qui ont été instituées au coup par coup au détour d’un article d’une loi nouvelle qui n’a pas à titre principal de caractère pénal, il y a, à l’évidence, des incohérences.
Ces dernières justifieraient que l’on toilette le système pour que le fait d’encourir une peine de prison, qui peut justifier juridiquement une mise en garde à vue, corresponde bien, dans tous les cas, à un acte d’une réelle gravité. Or, force est de le reconnaître, la diversité de l’échelle des peines actuelle est telle qu’elle ne garantit pas que le seul critère d’un an d’emprisonnement encouru suffise en lui-même à limiter la garde à vue à des actes d’une réelle gravité.
J’en viens aux aménagements apportés par l’Assemblée nationale.
Le premier changement majeur concerne précisément la question de l’audition libre.
Afin de contribuer à la réduction du nombre des gardes à vue, l’article 1er du projet de loi initial posait le principe, aujourd’hui absent du code de procédure pénale, de l’audition libre d’une personne suspectée et du caractère subsidiaire de son placement en garde à vue. Pour les raisons que j’évoquais précédemment – l’absence de reconnaissance de droits suffisants pour le suspect entendu librement et l’absence d’assistance d’un avocat –, l’audition libre a été écartée et, comme notre rapporteur, nous approuvons cette évolution du texte.
À l’article 9, qui encadre les mesures de sécurité et les fouilles dont peut faire l’objet la personne gardée à vue, l’Assemblée nationale avait prévu la possibilité pour la personne gardée à vue de conserver « certains objets intimes », en contrepartie de la signature d’une décharge. Il s’agit d’apporter une réponse aux difficultés soulevées par une pratique humiliante et souvent inutile, critiquée notamment par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, consistant à retirer systématiquement lunettes et soutien-gorge afin de prévenir tout risque d’agression ou de suicide, alors même que ce risque est en réalité infime et que cette pratique semble dater d’une époque révolue.
Notre commission a jugé que la garantie apportée par l’Assemblée nationale devait être renforcée et a prévu que la personne devait, en tout état de cause, disposer, au cours de son audition, de ses effets personnels. Là encore, il s’agit d’une amélioration bienvenue dont on s’étonne qu’elle n’ait pas été introduite plus tôt. Ce type d’aménagement permettra de contribuer à un meilleur respect de la dignité des gardés à vue.
Autre aménagement majeur lié à l’assistance d’un avocat, les députés ont institué un « délai de carence » de deux heures, avant l’expiration duquel la première audition de la personne gardée à vue ne pourra pas débuter.
Le texte initial du projet de loi ne prévoyait expressément ni que les auditions pourraient débuter sans attendre l’arrivée de l’avocat ni qu’elles ne le pourraient pas. Le silence de la loi sur cette question essentielle était source d’insécurité juridique. Le nouveau dispositif précise bien la situation.
Sans remettre en cause la suppression de l’audition libre, je voudrais cependant, et à titre personnel, attirer votre attention, mes chers collègues, sur le fait que le délai de carence de deux heures prévu pour permettre à l’avocat de rejoindre les locaux de garde à vue et pendant lequel l’interrogatoire ne peut pas commencer, du moins en règle générale, risque, dans certains cas, de nuire à l’efficacité de l’enquête.
Un tel risque existe quand on a affaire non pas à des voyous chevronnés – ils savent comment se comporter, si je puis dire ! –, mais à des délinquants débutants : ces derniers reconnaissent parfois les faits sans difficulté simplement parce qu’ils sont conduits à la brigade ou au commissariat de police. Les deux heures de carence pouvant alors, mais j’espère me tromper, permettre à un suspect qui a réellement quelque chose à se reprocher d’échafauder un scénario qui retardera l’apparition de la vérité.
Très bien !

Mes chers collègues, encore une fois, il s’agit là d’une réflexion personnelle, et non de la position de mon groupe.
Il ne faudrait donc pas que le recadrage – certes nécessaire, personne ne le conteste – de la garde à vue nuise, dans certains cas, à l’efficacité de l’enquête.
Au final, les travaux de l’Assemblée nationale et de notre commission des lois ont permis d’aboutir aujourd’hui à un texte bien plus abouti que le texte initial.
Je voudrais également développer une réflexion plus générale sur quelques aspects qui suscitent encore des interrogations.
Tout d’abord, les avocats sont devant un défi important à relever, comme cela a été notamment relevé par mon collègue François Pillet : assurer sur tout le territoire l’assistance des centaines de milliers de gardés à vue, même si le nombre des mesures diminue.
Il faut bien reconnaître que le risque d’un traitement discriminant entre zones urbaines et zones rurales existe bel et bien. J’espère me tromper, mais notre collègue Jacques Mézard a eu l’occasion d’insister à juste titre sur cet aspect en commission.
Le rôle des barreaux sera déterminant, mais il faut reconnaître que certaines zones du territoire vont être confrontées à des difficultés difficilement surmontables. Chacun comprend bien la différence qui existe entre un commissariat des Hauts-de-Seine et une brigade de gendarmerie d’un village isolé de montagne en plein hiver...
Il est évident que, dans certains secteurs géographiques de notre pays, il sera beaucoup plus difficile pour l’avocat d’arriver dans les deux heures du délai de carence que dans d’autres secteurs, notamment urbains.
M. Alain Gournac opine.

Certains pourraient en tirer la conclusion qu’il faut que les gardes à vue soient centralisées dans les principales villes de nos départements.

Mais, alors, on irait vers deux catégories de commissariats et, surtout, vers deux catégories de brigades de gendarmerie, ce qui serait inacceptable.
Sur cette question, mes chers collègues, nous devons être fermes. Si nous voulons que la sécurité soit assurée de la même manière sur tous les points du territoire, et si nous ne voulons pas décourager certains services de police et de gendarmerie, il nous faut affirmer la nécessité de conserver le maillage national des brigades et de garder partout des brigades de plein exercice où puissent se dérouler les gardes à vue.

Alors, évidemment, cela nécessitera parfois des travaux d’aménagement de certains locaux…

… et cela coûtera sûrement plus cher en frais d’avocats – je pense notamment à l’aide juridictionnelle – qu’aujourd’hui.
En tant que rapporteur pour avis du budget des services judiciaires à la commission des lois depuis plusieurs années, je me permets d’insister, monsieur le ministre, pour que les crédits nécessaires soient bien prévus, au bon niveau, et sans qu’on les prélève sur d’autres actions ou d’autres programmes de la mission « Justice ».
Au-delà de ces difficultés pratiques, si la réforme que nous examinons aujourd’hui était indispensable, va-t-elle assez loin ?
Certes, monsieur le ministre, ce n’est pas encore la grande réforme de la procédure pénale que l’on nous annonce depuis des années. Je crains d’ailleurs qu’avec l’annonce, hier, du débat, dès le mois prochain, sur l’introduction des jurés populaires en correctionnelle – réforme que, au demeurant, peu de gens réclamaient –, on ne continue, après cette loi, à modifier par petites touches notre droit pénal, ce qui n’est pas, selon moi, la meilleure méthode.
J’espère donc que nous aurons bientôt un débat de fond sur l’ensemble de notre procédure pénale, car il est nécessaire. Les nombreuses polémiques autour du statut du parquet, relancées par des arrêts importants de la CEDH, que l’on ne pourra continuer à ignorer, ne sont qu’un exemple, parmi d’autres, des questions que nous devrons réexaminer.
Néanmoins, la réforme que nous examinons aujourd’hui est la bienvenue. C’est pourquoi le groupe de l’Union centriste votera en faveur de l’adoption de ce projet de loi sur lequel la commission des lois, notamment son rapporteur, a fait un excellent travail.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour ma part, et je pense que cela ne vous étonnera pas, je ne partage pas vraiment l’optimisme de notre rapporteur quant à l’avenir et à l’évolution de ce projet de loi, qu’il a qualifié de largement imparfait, si tant est que cet avenir et cette évolution restent entre vos mains.
Il en aura fallu de l’énergie, de la volonté et même des condamnations pour en arriver là où nous en sommes : un tout petit pas pour l’Homme, comme pour la justice, en l’occurrence. Et pourtant, on ne demandait pas la lune !
Pourquoi agit-on toujours contraint et forcé, une fois le dos au mur ? Car vous avez été sourd et aveugle à toutes les propositions, qu’elles émanent de l’opposition ou parfois même des rangs de votre majorité, mais aussi des professionnels, quel que soit le texte et quelle que soit la réforme.
Oui, mille fois oui, ce texte est nécessaire, indispensable. La gauche et d’autres le disent et le répètent, et ce sans avoir attendu la condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme ni l’avis du Conseil constitutionnel.
Oui, mille fois oui, les officiers de police judiciaire, tous les intervenants au sein de la justice sont aujourd’hui d’accord pour travailler mieux ensemble. Et vous le savez !
Tout changement proposé suscite au départ des inquiétudes, ce qui est normal. Mais si ce changement annoncé est accompagné d’une vraie concertation et d’un vrai débat avec les professionnels concernés, s’il est expliqué, voire amendé à l’écoute des propositions des acteurs et des intervenants, il fera l’objet d’un réel consensus et deviendra pleinement efficace.
Oui, mille fois oui, les principes énoncés sur le papier sont indispensables. Mais, tels qu’ils sont énoncés, seront-ils efficaces ? Seront-ils applicables ? Seront-ils appliqués ? Certains, oui, sans doute : je pense à la notification du droit de se taire, à la disparition de certaines fouilles humiliantes, à la possibilité de faire avertir son entourage, au fait de ne plus être condamné sur la base de simples aveux, notamment obtenus sans l’intervention de l’avocat.
Mais qu’en sera-t-il des autres mesures ? Pour ma part, je doute fortement de leur application.
Quelles sont les raisons de ce nouveau ratage ?
C’est, monsieur le garde des sceaux, la manière de gouverner du gouvernement auquel vous appartenez, certes depuis peu, et de la majorité, à laquelle vous appartenez depuis un bon moment : agir dans l’immédiateté, avec un calendrier uniquement lié aux échéances électorales et aux faits divers.
Je le répète, vous n’engagez des réformes que contraints et forcés, une fois que vous avez le dos au mur. Quand on n’a plus le temps d’avoir un réel débat ni de mener une vraie concertation, on n’est plus dans le calendrier de la Politique avec un « p » majuscule. Celle-ci doit se faire sur le long terme, surtout quand on touche aux structures mêmes de notre société et de notre démocratie, surtout quand on touche à la justice et à la sécurité.
Nous attendions une réforme du code de procédure pénale. Il nous vient un texte réducteur, un texte d’affichage. Chacun le sait ici, pas grand-chose de concret, malheureusement, n’en sortira.
Le Gouvernement et le Président de la République, en particulier, ont ce véritable don de transformer tout ce qui aurait dû être une grande réforme, fondatrice de nouveaux liens sociaux, en de « petits textes minimalistes à visée électorale ou de mise en conformité apparente ».
Le Gouvernement et le Président de la République, en particulier, ont ce véritable don de transformer tout ce qui aurait dû être un débat de fond, un débat d’idées, un débat de société, en affichage de réformes, en affrontements interinstitutionnels, les uns étant montés contre les autres et chacun à tour de rôle.
Sait-on assez que l’assistance de l’avocat au gardé à vue est rendue tellement obligatoire en Turquie qu’aucune déposition faite en dehors de la présence d’un avocat ne peut être versée au dossier de l’instruction sans confirmation par la personne des faits incriminés ?

À l’instar de mon collègue Jacques Mézard, je réaffirme que les forces de sécurité, que les officiers de police judiciaire ne sont pas les responsables de la politique pénale imposée à tous par le gouvernement auquel vous appartenez, monsieur le ministre.
Les gardes à vue abusives ou abusivement mal menées ne sont que le résultat de la politique de répression croissante, de la judiciarisation galopante, de l’accélération des procédures judiciaires que mène le Gouvernement.
Le nombre d’officiers de police judiciaire a beaucoup augmenté, non pas parce que l’on a recruté, mais parce que l’on a diminué le niveau de qualification nécessaire pour placer en garde à vue.

J’ai bien dit que ce n’était pas eux les responsables, monsieur le président de la commission des lois, mais le Gouvernement et la politique qu’il mène.
Je suis désolée de le dire, mais les officiers de police judiciaire qui peuvent mener des gardes à vue sont aujourd’hui moins qualifiés qu’hier.

Je suis d’accord avec vous pour les gendarmes. Je trouve simplement dommage que l’on diminue le niveau de qualification requis de ceux qui placent des personnes en garde à vue.
La garde à vue est une étape particulièrement importante de l’enquête. Elle nécessite donc une formation particulière, car c’est un moment humainement compliqué et crucial pour la manifestation de la vérité. Diminuer la formation des personnes habilitées à mener des gardes à vue est dramatique non seulement pour notre société, mais aussi pour les gendarmes et les policiers, pour tous les officiers de police judiciaire.
Et si l’on parlait un peu de qualité, au lieu de parler de chiffres et de performances ? Et si, pour qualifier et quantifier le service public, on appliquait des critères différents de ceux qui sont utilisés pour le secteur privé ? Et si l’on offrait tout simplement des moyens à ceux qui doivent agir ? Et si, au lieu de compter le nombre de gardes à vue, on s’intéressait, par exemple, à celles qui ont conduit à une élucidation ou à une condamnation ?

Le gouvernement auquel vous appartenez, monsieur le ministre, aime les chiffres. Je ne les déteste pas non plus, mais à condition qu’ils signifient quelque chose. Reste que, aux chiffres, je préfère les notions de dignité, de respect de la présomption d’innocence – on l’oublie un peu trop souvent –, d’indépendance de la justice et d’équilibre des parties.
Pour atteindre ces objectifs, il faut s’en donner les moyens. Il faut donc élever de nouveau le niveau de qualification requis des officiers de police judiciaire qui mènent les gardes à vue et diminuer le nombre des placements en garde à vue.
La dignité implique, on le sait, cela a été dit ce matin, la réfection et la rénovation des locaux. Cela suppose donc des moyens financiers, mais ils n’apparaissent pas dans le projet de loi.
Si l’on veut que l’avocat, même non présent, puisse avoir accès aux auditions telles qu’elles se sont déroulées, il faut augmenter le nombre de caméras et de dispositif de vidéo. À cet effet, pourquoi ne bascule-t-on pas, au profit des espaces ici concernés, une partie des moyens du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, qui nous inflige déjà un certain nombre de caméras dans l’espace public ?
Les moyens existent ; il suffit de les affecter là où il faut.
L’introduction de l’avocat et du contradictoire dans l’enquête avant que le dossier n’arrive chez le juge est une très bonne chose. Cependant, pour être efficace, cela nécessitera une égalité renforcée de tous les justiciables, y compris pendant l’enquête. Or ce principe ne figure pas dans votre texte : l’aide juridictionnelle n’est pas là !
Savez-vous combien la justice paiera un avocat de Rennes devant se rendre à deux heures du matin à Redon pour assister un gardé à vue ? Elle lui donnera 71 euros. C’est une misère !
Vous ne le savez pas, le montant n’a pas été fixé !

En tout cas, ce sont les chiffres qui ont été donnés aux professionnels.
Savez-vous que, aujourd’hui, 115 avocats du barreau de Rennes sont volontaires pour assurer des permanences et assister des gardés à vue ? Je ne sais pas combien il en restera une fois qu’on leur aura dit que, pour aller de Rennes à Redon à deux heures du matin, ils recevront 71 euros !
Savez-vous quel est le budget de l’aide juridictionnelle en Angleterre ? Il est de 3 milliards d’euros. En France, c’est dix fois moins !
Ce système introduira nécessairement une justice à deux vitesses dès l’enquête, qui sera devenue contradictoire : une justice urbaine et une justice rurale, une justice des riches et une justice des pauvres. Cette évolution a déjà été bien entamée avec la réforme de la représentation devant les cours d’appel aux termes de laquelle seuls les justiciables ayant les moyens et résidant en zone urbaine, où il y a de grands cabinets d’avocats, pourront faire appel.
Voilà ce qu’il adviendra des beaux principes posés dans ce texte ! En tout cas, j’attends de voir le sort que vous réserverez à nos amendements et les moyens que vous entendez consacrer à cette réforme essentielle avant de décider de mon vote. Mais je suis assez pessimiste !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la garde à vue nous est présenté comme découlant de la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, selon laquelle les dispositions actuelles de la loi concernant les conditions de placement en garde à vue sont inconstitutionnelles.
Permettez-moi cependant d’indiquer que ce texte arrive bien tardivement. En effet, il y a des années que la Cour européenne des droits de l’homme confronte les exigences conventionnelles aux pratiques et à la procédure en matière de garde à vue et rappelle le respect dû aux droits des personnes gardées à vue et à leur défense effective.
Dès l’arrêt Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, la France aurait notamment dû réagir en rendant « effectif et concret » le droit pour le gardé à vue de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Plus récemment, dans une série d’arrêts rendus contre la Turquie et contre l’Ukraine, en 2009, la Cour européenne des droits de l’homme est à nouveau venue préciser le champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable dans la phase antérieure au procès pénal. C’est ainsi que la Cour de Strasbourg a défini de manière précise les principes directeurs applicables au régime de la garde à vue.
Dans la continuité de ces arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme datant de la fin de 2009, j’ai moi-même déposé une proposition de loi portant réforme de la garde à vue, et ce dès janvier 2010, tirant ainsi les conséquences de ces exigences conventionnelles. Ce texte n’a malheureusement pas abouti, car il a été renvoyé à la commission à la fin d’avril 2010.
Il aura donc fallu attendre que le Conseil constitutionnel rende sa décision de juillet 2010 pour que vous daigniez enfin vous intéresser à la question. Il était temps !
Vous avez déposé le présent projet de loi le 13 octobre 2010 à l’Assemblée nationale, et la France était condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme le lendemain, le 14 octobre, avec l’arrêt Brusco, puis le 23 novembre, avec l’arrêt Moulin c. France…
Cette réforme de la garde à vue, qui nous est soumise aujourd’hui, ou devrais-je dire cette « réformette » – pardonnez-moi d’employer ce terme, mais c’est la vérité –, outre qu’elle est tardive, est largement insuffisante.
En effet, si les sénatrices et sénateurs d’Europe écologie-Les Verts se réjouissent des quelques avancées relatives au rôle de l’avocat lors de la garde à vue et à la possibilité pour lui d’assister son client lors des auditions ou des confrontations, ce projet de loi présente de nombreuses lacunes, des insuffisances et des incohérences.
Il semblerait que vous n’ayez absolument pas tenu compte in fine de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, qui pointe pourtant du doigt les modalités de placement en garde à vue, aussi bien celles de son contrôle que celles de son déroulement.
Tout d’abord, j’aborderai ce qui me semble essentiel, à savoir le rôle controversé accordé au procureur de la République dans ce projet de loi.
Le parquet intervient à la fois au stade du contrôle de la garde à vue et de son renouvellement.
Il s’agit dans ce projet de loi de reproduire une anomalie procédurale pourtant dénoncée par tous. Les magistrats eux-mêmes, dans le rapport rendu par le Conseil national de la magistrature en 2008, considéraient à 64 % que les membres du parquet n’étaient pas indépendants. Il en va de même pour les avocats, les juristes et les universitaires et, surtout, pour la Cour européenne des droits de l’homme, qui, dans l’arrêt Moulin c. France du 23 novembre 2010, pose clairement le principe selon lequel les membres du ministère public français ne sont pas indépendants et ne peuvent pas être assimilés, en matière de garde à vue, à une « autorité judiciaire » au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Seul le Conseil constitutionnel est resté frileux sur cette question de l’indépendance du procureur de la République. C’est sans doute pour cette raison que le Gouvernement s’est abstenu de résoudre cette question pourtant essentielle.
Dès 1979, pourtant, la Cour de Strasbourg indiquait que le procureur n’était pas une autorité judiciaire indépendante. Ce principe fut rappelé récemment à la France avec les arrêts Medvedyev du 10 juillet 2008 et du 29 mars 2010, pour la Grande Chambre.
Le ministère public français ne dispose pas d’une indépendance suffisante vis-à-vis de l’exécutif et ses membres ne sont donc pas des « magistrats » au sens des dispositions conventionnelles qui encadrent les privations de liberté.
Au vu de l’arrêt Moulin c. France, il est donc désormais difficile d’imaginer que le présent projet de loi puisse être adopté en l’état, sans une réforme du statut du parquet ou de ses compétences.
Permettez-moi, monsieur le garde des sceaux, de vous rappeler l’un des paragraphes de cet arrêt : « […], la Cour considère que, du fait de leur statut ainsi rappelé, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de “magistrat” au sens de l’article 5, alinéa 3 ».
Il me semble que les choses sont claires ! Cet arrêt confirme la nécessité d’une modification profonde de l’organisation judiciaire française.
Pourtant, votre projet de loi prévoit dès son article 1er l’insertion d’un nouvel article 62-5 dans le code pénal, qui dispose de manière ostentatoire que « la garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, […] ».
Alors, excusez-moi, mais je ne vois pas où est l’avancée en termes d’indépendance !
Les sénatrices et sénateur écologistes ont donc cosigné une série d’amendements consistant à supprimer toute référence au procureur de la République dans ce projet de loi et à tirer les conséquences de cette jurisprudence de la Cour de Strasbourg.
Il est essentiel en effet que la garde à vue puisse bénéficier des garanties légales nécessaires, et que son contrôle ainsi que son renouvellement puissent ainsi être confiés au juge judiciaire. Ce devrait être le juge des libertés et de la détention qui assume, dans ce texte, le rôle que vous vous obstinez à octroyer au procureur de la République.
Mais pourquoi faites-vous à ce point « la sourde oreille », monsieur le ministre ? Pourquoi votre gouvernement souhaite-t-il s’affranchir des exigences conventionnelles et jurisprudentielles en matière de droits et de libertés fondamentales ? Autant proclamer ici, haut et fort, que vous aspirez à ce que la France se retire du Conseil de l’Europe ! Ce serait ridicule ! Vous ne faites, ainsi, que vous attirer les foudres des professionnels du droit, des associations, des universitaires et des instances de Strasbourg !
Un autre élément est tout aussi choquant dans ce projet de loi : le seuil de déclenchement de la garde à vue. Dans la définition que l’article 1er du présent texte donne de la garde à vue, il est prévu que le placement puisse intervenir dès que l’on soupçonne que la personne a commis ou tenté de commettre « un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ».
Il me semblait, monsieur le ministre, vous avoir entendu arguer du fait que ce projet de loi avait également pour objet de diminuer le nombre des gardés à vue. Or, vous le savez, près de 800 000 gardes à vue ont été décidées en 2009. Pensez-vous que ce seuil, outre qu’il porte atteinte aux droits des personnes concernées, notamment de la présomption d’innocence, permette de faire diminuer ces chiffres ? Évidemment non, bien au contraire !
C’est pourquoi les sénatrices et sénateur écologistes refusent le placement en garde à vue de personnes soupçonnées d’infractions mineures, et donc les gardes à vue abusives ou excessives !
Nous sommes donc favorables à ce que le seuil de placement en garde à vue soit porté à trois ans d’emprisonnement, et nous nous associons également aux amendements présentés par le groupe auquel nous sommes rattachés.
Je tiens enfin à indiquer que je regrette le caractère bien trop limité qu’accorde ce texte à l’intervention de l’avocat.
Je prendrai ici l’exemple de la durée insuffisante accordée par l’article 6 du projet de loi à l’avocat pour s’entretenir avec la personne gardée à vue. Cela présuppose qu’en trente minutes maximum, et ce quelle que soit la complexité de l’affaire, un avocat ait le temps d’échanger avec son client, de l’écouter exposer sa situation, de prendre connaissance du procès-verbal ou des autres pièces du dossier…
Or vous n’êtes pas sans savoir, monsieur le ministre, que cette durée excessivement réduite sera évidemment insuffisante dans les affaires les plus complexes, pour prendre connaissance des faits ainsi que des nombreuses pièces présentes dans le dossier de la personne gardée à vue.
Cela porte atteinte au droit à une défense effective, en particulier au recours effectif à un avocat. J’espère donc que l’amendement que nous avons déposé à l’article 6 du projet de loi visant à augmenter la durée de l’entretien avec l’avocat sera adopté lors de nos débats.
Vous l’aurez compris, les sénatrices et sénateur écologistes considèrent que ce texte ne fait que feindre de s’aligner sur des prescriptions conventionnelles et constitutionnelles, mais dissimule finalement son manque d’ambition derrière des dispositions vraiment inefficaces et incomplètes.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Je répondrai brièvement à l’ensemble des orateurs, que je remercie d’avoir participé à cette discussion générale. Beaucoup d’entre eux ont souligné les avancées que comporte ce texte, notamment concernant la mise en œuvre de libertés fondamentales garanties par la Constitution. D’autres ont préféré indiquer que ce texte n’était pas bon : c’est leur droit, et je le respecte, mais j’ai trouvé que leurs propos, parfois excessifs, rendaient la critique moins efficace.
Plusieurs orateurs, notamment Mmes Borvo Cohen-Seat et Boumediene-Thiery, MM. Anziani et Mézard, nous ont reproché d’avoir agi sous la contrainte, d’avoir attendu trop longtemps, …
… de ne pas en faire assez et de ne pas proposer de réforme complète du code de procédure pénale.
Des travaux extrêmement sérieux et approfondis ont été menés pendant plusieurs mois, en particulier par un groupe de travail composé d’universitaires, de parlementaires de la majorité et de l’opposition.
Ils ont eu raison, au contraire ! Le code de procédure pénale concerne tous les Français et je félicite ces parlementaires d’avoir su dépasser les divisions partisanes. Il est bon que tout le monde puisse travailler à l’élaboration de ce code qui s’appliquera, demain, quel que soit le gouvernement en place.
Si nous n’avons pas déposé un texte plus large, c’est tout simplement faute de temps. En effet, nous sommes tenus, vous l’avez souligné, de prendre des mesures sur la garde à vue avant le mois de juillet, voire avant la fin du mois d’avril.
Pour ma part, je ne verrais que des avantages à publier l’ensemble des travaux qui ont été réalisés par le groupe de travail afin d’alimenter les débats qui ne manqueront pas d’avoir lieu sur l’ensemble des sujets traités.
Je voudrais tout d’abord signaler que le Gouvernement n’a pas attendu les dernières décisions du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation ou de la Cour de Strasbourg pour réfléchir à la question.
Le comité de réflexion présidé par Philippe Léger avait travaillé, dès le mois d’octobre 2008, et des textes ont été votés, ces dernières années, pour améliorer les droits de la défense. Ainsi, la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale a rendu obligatoire l’enregistrement des gardes à vue en matière criminelle, ce qui constitue une première avancée.
Enfin et surtout, les questions à résoudre sont particulièrement complexes. S’agissant notamment des exigences de la Cour européenne des droits de l’homme, madame Boumediene-Thiery, c’est par une décision du 8 février 1996, Murray c. Royaume-Uni, que la Cour a indiqué que violait l’article 5 de la Convention le fait de refuser à une personne gardée à vue dans une affaire de terrorisme l’accès à un avocat pendant les quarante-huit premières heures de la mesure.
Depuis 1996, madame Boumediene-Thiery, nous avons tous eu le temps de commencer à réfléchir ! Si nous ne sommes pas parvenus à aller plus vite, c’est pour des questions de pratique. Des occasions se sont cependant présentées.
Quatre ans plus tard, la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, très bon texte défendu par Mme Guigou, a maintenu, malgré cette jurisprudence européenne, l’absence d’avocat pendant quarante-huit heures en matière de trafic de stupéfiants et de terrorisme.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’exclame.
Vous êtes dans votre rôle en critiquant le Gouvernement et je suis dans le mien, je l’assume parfaitement, et avec enthousiasme, …
… en prenant sa défense. La démocratie peut être apaisée, mesdames, messieurs les sénateurs. On peut se dire les choses, mais il faut tout mettre sur la table.
De même, la loi du 4 mars 2002, défendue par Mme Lebranchu, tout en maintenant le report de l’intervention de l’avocat pendant deux jours dans les deux matières précitées, facilitait le placement en garde à vue en exigeant non plus des « indices » de culpabilité, mais des « raisons plausibles » ; elle donnait un délai de trois heures aux enquêteurs pour mettre en œuvre le droit du gardé à vue d’informer un proche ou d’être examiné par un médecin.
Si je rappelle ces faits, ce n’est pas pour critiquer mes prédécesseurs, c’est simplement pour montrer que ces affaires sont complexes, demandent réflexion et doivent nous conduire à analyser dans le détail ce que veut la Cour de Strasbourg.
Les récentes décisions ne mettent pas le Gouvernement le dos au mur ; elles permettent de connaître clairement les exigences constitutionnelles et conventionnelles, éclairant ainsi le Gouvernement et le Parlement sur le contenu de la réforme.
Le Gouvernement s’est astreint à intégrer dans ce texte l’ensemble des décisions du Conseil constitutionnel, de la Cour de Strasbourg et de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ce qui n’était pas toujours chose facile.
De nombreux orateurs ont soulevé la question de l’encadrement de la garde à vue par la fixation d’un seuil minimal d’emprisonnement encouru. Le rapporteur a également expliqué la raison pour laquelle la commission avait écarté cette formule, et je partage son point de vue. MM. Mézard et Anziani, Mme Borvo Cohen-Seat, souhaitent instaurer un seuil – un an, trois ans, cinq ans, suivant les cas – en deçà duquel la garde à vue serait impossible.
La commission des lois du Sénat a eu raison de ne pas retenir ces propositions, qui auraient conduit à priver les enquêteurs d’un moyen d’enquête essentiel, même s’il ne doit pas être banalisé.
Comme l’a très justement souligné M. Pillet, l’article 1er du texte comporte une définition de la garde à vue selon des critères précis, ce qui est nouveau et important.
Plusieurs d’entre vous considèrent que ce projet de loi ne nous permet pas de nous mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Je me suis longuement expliqué sur ce point dans mon intervention liminaire et j’aurai l’occasion d’y revenir au moment de la discussion des articles. Je rappellerai simplement que la France n’a jamais été spécifiquement condamnée pour une garde à vue réalisée sous le contrôle du parquet, comme l’a souligné M. Pillet. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a pas de problème.
Je l’ai dit dans mon intervention liminaire et je le répète à Mme Alima Boumediene-Thiery, dont l’extrême sévérité l’a entraînée bien au-delà de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg : le procureur n’est pas une « autorité judiciaire », au sens de la Cour européenne des droits de l’homme.
C’est vrai, et je l’ai dit moi-même ce matin, mais là n’est pas le sujet. Nous sommes d’accord avec la Cour de Strasbourg sur l’exigence conventionnelle qui veut que, une fois un court délai dépassé - environ quarante-huit heures -, l’autorité judiciaire, telle qu’elle est définie par la Cour de Strasbourg, doit être un juge du siège.
Mais qui va contrôler la garde à vue dans les quarante-huit premières heures ? Voilà le sujet ! Ou bien on s’en remet aux seules forces de police et de gendarmerie, ou bien on instaure un autre contrôle. La France a choisi, et nous devrions en être fiers, de faire contrôler la garde à vue dans les quarante-huit premières heures par un magistrat. Et personne n’a jamais dit que le procureur de la République n’était pas un magistrat.
La Constitution, madame Boumediene-Thiery, je suis obligé de vous le dire, s’impose à vous comme à moi. Et nous avons de la chance car, sans Constitution, point de libertés !
Les décisions du Conseil constitutionnel – je parle sous le contrôle de l’un de ses anciens présidents – s’imposent à tous, même à vous, madame la sénatrice.
Le Conseil constitutionnel a rappelé…
Je vous remercie de me laisser parler !
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 30 juillet dernier, a rappelé le texte de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. » C’est l’habeas corpus. « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. » Or l’autorité judiciaire est composée des magistrats du siège et du parquet, un point, c’est tout.
Nous avons donc fait le choix clair, et je pense que c’est un bon choix, de faire confiance au procureur, parce qu’il est un magistrat. §Madame, je peux entendre tout et son contraire, mais ne pas vouloir reconnaître le bien-fondé de ce raisonnement, c’est s’enfermer dans l’aveuglement.
Je rappelle que, en Grande-Bretagne, par exemple, le contrôle de la garde à vue est confié exclusivement à un officier de police pendant toute la durée de la mesure, qui peut atteindre, dans certains cas très spécifiques – ce n’est pas la règle –, jusqu’à vingt-six jours. Honnêtement, en termes de garantie des droits, notre situation est bien meilleure.
L’article 55 de la Constitution nous oblige, c’est tout à fait vrai, je l’admets, à introduire dans notre droit la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Tel est notre système, très particulier et différent de celui d’autres États européens. À cet égard, sachez que le Parlement britannique a rappelé voilà quelques jours la souveraineté absolue de la Chambre des communes face à la Cour de Strasbourg. Cette décision peut être discutée, mais force est de constater qu’elle a été votée par le Parlement anglais.
En France, nous savons depuis bien longtemps, grâce à Carré de Malberg, probablement parce qu’il a été professeur à Strasbourg, que le parlementarisme absolu est dépassé.
Nous disposons de deux garanties, l’une conventionnelle, l’autre constitutionnelle, ce qui nous place parmi les meilleurs pour ce qui est de la garde à vue.
Je ne reviendrai pas sur ce tout ce qui a été dit, mais je tiens à remercier les orateurs qui ont bien voulu reconnaître que ce texte contient des avancées, même s’il n’est pas parfait. La perfection absolue n’existe pas. L’important est de progresser.
Un nouvel équilibre est atteint, c’est une avancée, entre les exigences de l’enquête – trouver les responsables des crimes et des délits – et le respect des libertés fondamentales. Il nécessite de véritables efforts de la part des forces de gendarmerie et de police. Je tiens d’ailleurs ici à leur rendre hommage, car nous avons besoin d’elles. Il ne s’agit pas de les désarmer, et personne ne l’a proposé d’ailleurs, je le reconnais bien volontiers. Aujourd'hui, avec ce texte, nous nous adressons aussi à elles.
Des évolutions sont nécessaires. La présence de l’avocat dès la première minute constitue un changement fondamental. Nombre d’entre vous ont évoqué les moyens nécessaires pour rémunérer les avocats. Je sais parfaitement que ce problème est posé et qu’il doit être résolu.
Pour diverses raisons, les négociations sur cette question n’ont pas pu être entamées avant le vote du texte par l’Assemblée nationale. Des premiers contacts ont été pris, nous en aurons d’autres. Il nous faudra également trouver des modalités techniques. Comme beaucoup d’entre vous, je suis très opposé à tout regroupement des gardés à vue. Toutes les brigades de gendarmerie doivent être des brigades de plein exercice, avec donc chacune leurs officiers de police judiciaire.
Je suis ouvert à toutes modifications techniques. Aujourd’hui, le choix de l’avocat est libre. En revanche, le paiement de l’aide judiciaire ne l’est pas. Je suis prêt à négocier avec les barreaux afin de trouver un système efficace. Il doit être possible de choisir un avocat même à quelques kilomètres au-delà des limites du ressort, pourvu qu’il soit plus proche de la gendarmerie concernée qu’un autre de ses confrères du chef-lieu d’arrondissement ou d’une grande ville. S’il faut trouver de nouvelles modalités techniques, nous les trouverons. Je suis ouvert à de telles mesures.
Je sais parfaitement que les avocats doivent parfois parcourir des centaines de kilomètres pour assister un gardé à vue, mais, madame Klès, très honnêtement, de Rennes à Redon, il y a une deux fois deux voies, et le trajet est un plaisir toujours renouvelé !
Sourires
Pour se rendre chez M. Mézard, en revanche, il faut affronter la neige !
Plus sérieusement, nous devons parvenir à indemniser les avocats dans des conditions dignes de leur profession et de la présente réforme, tout en préservant les finances publiques, ce qui n’est pas chose aisée.
J’évoquerai maintenant le délai de carence. Sur ce point, j’ai compris quelle était la position de la plupart d’entre vous. Je rappelle que je soutiendrai un amendement tendant à réduire ce délai à une heure afin de laisser plus de temps à l’enquête. Il vous appartiendra ensuite de le voter.
C’est la démocratie, en effet.
Pour terminer, je rappelle que ce texte constitue une véritable avancée. La plupart d’entre vous l’ont souligné, en particulier Mme Borvo Cohen-Seat, et je les en remercie. Il est important que le plus grand nombre de Français s’approprient ce texte afin de faire vivre notre procédure pénale, qui s’adresse à tous, sans considérations partisanes, que l’on soit dans la majorité ou dans l’opposition.
Oui, ce texte constitue une véritable avancée, et ce dans deux domaines.
Pour avoir un droit pénal moderne, nous devons clairement abandonner la culture de l’aveu au profit de celle de la preuve. Cela nécessite des changements. Tout ce qui se fait dans le domaine de la police technique et scientifique va dans ce sens. Le rôle de l’enquête est d’apporter des preuves et de faire émerger la vérité.
Mais je ne saurais oublier les droits nouveaux que prévoit le texte, tels que le respect de la dignité de la personne placée en garde à vue ainsi que l’assurance qu’elle pourra bénéficier des conseils et de l’assistance d’un avocat dès le début du placement en garde à vue.
Il y a là matière à débattre et à avancer ensemble vers un renouveau de notre procédure pénale, mesdames, messieurs les sénateurs.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Je rappelle que la commission de la culture et la commission des affaires étrangères ont proposé des candidatures pour deux organismes extraparlementaires.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame Mme Catherine Tasca et M. Louis Duvernois en tant que membres du Conseil d’administration de l’Institut français, créé en application de l’article 6 du décret n° 2010-1695 du 30 décembre 2010 ; Mme Claudine Lepage en tant que membre du Conseil d’orientation stratégique de l’Institut français, créé en application de l’article 5 du décret n° 2010-1695 du 30 décembre 2010.

J’informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats aux éventuelles commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique et du projet de loi relatifs au Défenseur des droits.
Cette liste a été affichée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.
(Texte de la commission)

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la garde à vue.
Je rappelle que la discussion générale a été close.
Nous passons à l’examen des trois motions qui ont été déposées sur ce texte.

Je suis saisi, par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, d'une motion n°65.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la garde à vue (n° 316, 2010-2011).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à M. Jean-Pierre Michel, auteur de la motion.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, c’est le dos au mur que le Gouvernement nous présente aujourd'hui sa réforme. En effet, le Conseil constitutionnel a fixé au 1er juillet prochain la date limite pour mettre en œuvre une nouvelle législation en matière de garde à vue. Vous avez donc une épée de Damoclès sur votre tête, monsieur le ministre ! Bien entendu, c’est non pas votre personne que je mets en cause, car vous venez d’arriver au ministère, mais le Gouvernement, qui, depuis 2007, alors qu’il aurait dû agir, n’a rien fait.
Pourtant, les avertissements n’ont pas manqué, ici même, au Sénat, où plusieurs débats ont eu lieu. Le président de la commission des lois a mis en garde à plusieurs reprises le Gouvernement, le menaçant d’agir s’il ne faisait rien, car il était temps. Il n’a pas été entendu.
Tous ces signaux, tous ces appels se sont heurtés à l’attitude fermée et hautaine de votre prédécesseur, monsieur le ministre, qui nous a renvoyés à nos chères études, au motif que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ne concernaient pas la France, mais visaient des pays plus ou moins barbares comme la Turquie ! Voilà ce que nous avons entendu en commission des lois. Mais je suppose que votre prédécesseur ne faisait que suivre en cela les avis de son ministère…
Aujourd'hui, monsieur le ministre, vous finassez, notamment sur le rôle du parquet. Nous y reviendrons. Nous analyserons très exactement la jurisprudence européenne : elle ne dit pas ce que vous prétendez qu’elle dit, j’en suis absolument persuadé.
Je ne rappellerai pas toutes les décisions qui se sont succédé depuis l’arrêt Medvedyev du 10 juillet 2008. En commission, il nous a été signifié que nous n’étions pas concernés par ces décisions ! Il faut attendre l’arrêt Moulin c. France du 23 novembre 2010 de la Cour européenne des droits de l’homme pour apprendre que le procureur de la République ne constitue pas une autorité judiciaire indépendante - on ne parle pas de magistrat, le terme n’est pas employé ; il ne nous regarde pas ! –, seule autorité à même de décider la prolongation d’une garde à vue.
Ce n’est pas dans le sens de ce que le Gouvernement propose, ce n’est pas dans le sens de ce que la commission des lois propose, les dispositions qui nous sont soumises sont donc inconstitutionnelles, et je vais le démontrer.
La réforme intervient dans un contexte particulièrement incohérent.
En effet, il est totalement incohérent de proposer dans l’urgence une réforme de la garde à vue sans envisager le reste de la procédure pénale. C’est que la chaîne pénale est un tout. On ne peut pas modifier le seul régime de la garde à vue – il est différent de l’ancien, je le reconnais, monsieur le rapporteur – sachant que le reste de la procédure pénale sera à terme, je suppose, différente, elle aussi, de ce qu’elle est aujourd'hui.
On a parlé de deux cents pages. Que sont-elles devenues ? Nous n’en savons rien ! Peu importe ! Tout cela s’envole au vent de l’Histoire.
Vous le reconnaissez vous-même, monsieur le ministre, comme les mesures nécessaires n’ont pas été prévues, vous êtes aujourd’hui dans l’impossibilité d’appliquer la réforme. Et vous commencez donc maintenant les négociations afin de déterminer comment les locaux de garde à vue seront équipés ou comment les avocats seront rémunérés…
Non, monsieur le ministre, tout cela n’est ni sérieux ni à la hauteur de la question traitée !
Trois mots peuvent qualifier l’actuel état de la législation française relative à la garde à vue : confusion, complexité, dérives.
Cette législation n’est pas à la hauteur de ce qu’elle devrait être dans un État de droit. Elle est en retrait par rapport à celle de nombreux États voisins. Je n’invente rien en disant cela. En effet, l’étude de législation comparée du 31 décembre 2009 l’a largement démontré. Lorsque nous sommes allés en Allemagne ou en Italie, monsieur le rapporteur, nous avons fait le même constat.
Cette situation a valu à la France d’être condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme. La Grande-Bretagne considère que ce n’est pas trop grave ; nous pensons autrement. En tant qu’Européen convaincu, monsieur le ministre, vous considérez certainement – comme d’autres – qu’il est très grave d’être condamné par la Cour européenne des droits de l’homme.
La législation a également été censurée, en partie, par le Conseil constitutionnel. Enfin, elle a été critiquée par la Cour de cassation, qui a fini par comprendre qu’elle devait s’inscrire dans le droit fil de l’Histoire. Mieux vaut tard que jamais !
S’agissant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – alors que la France a attendu près de vingt-cinq ans, après avoir signé la Convention en 1950, pour la ratifier en 1974 –, la France n’a accepté les recours individuels qu’en 1981, grâce à M. Robert Badinter, que je remercie.
Ces faits s’expliquent essentiellement par l’absence de réglementation sur la garde à vue avant 1958 ainsi que par la faiblesse des garanties, qui devaient ensuite être introduites dans le code de procédure pénale.
À mon sens, le projet de loi que nous examinons est un texte a minima qui encourt plusieurs critiques quant à sa cohérence avec les décisions tant du Conseil constitutionnel que de la Cour européenne des droits de l’homme, sur trois points notamment.
Le premier est l’audition libre. Initialement prévue – nous en avions beaucoup discuté dans cette enceinte -, elle a été abandonnée par l’Assemblée nationale, mais elle est réapparue dans l’article 11 bis du présent projet de loi. Aucun droit n’est accordé à la personne auditionnée par le policier enquêteur, même si la durée maximale de présence dans les locaux de police n’est pas fixée.
Nous arrivons par conséquent à un régime sans droits, contraire aux exigences du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation.
Il existe un important risque de dérive vers un régime de substitution de la garde à vue, mais sans droits pour les personnes concernées !
Afin que l’audition réponde aux exigences minimales de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, nous proposerons un certain nombre d’amendements visant à encadrer cette audition et à la rendre conforme aux exigences précédemment visées.
Comme mon ami Alain Anziani le disait tout à l’heure, ces amendements ont malheureusement été rejetés par la commission des lois. J’espère qu’ils seront adoptés aujourd’hui. En effet, il y a certainement là un motif de censure. Vous me répondrez que, si le Conseil constitutionnel ne censurait qu’un article au mois de juin, cela ne serait pas si grave, et nous nous passerions de l’audition libre !
Sourires

Mais il y a plus.
Il faut aussi, c’est mon deuxième point, évoquer les régimes dérogatoires concernant la criminalité organisée et le terrorisme, laissés intacts. Nous n’y touchons pas. À cet égard, certains n’hésitent pas à écrire que la conformité à la Constitution de ces régimes a été réaffirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010. Or c’est faux, totalement faux ! En effet, le Conseil constitutionnel n’a pas examiné la question au fond.
La persistance du Gouvernement à ignorer totalement la jurisprudence établie par la Cour européenne des droits de l’homme frise la pathologie, avec le résultat que ces régimes ne sont pas traités. La France conserve donc toutes ses chances d’être condamnée à Strasbourg également sur ce fondement !
Mais, surtout, et c’est le troisième et dernier point, le projet de loi confie au procureur de la République, autorité de poursuite, les pouvoirs d’ordonner des placements en garde à vue, de prolonger la mesure, d’en contrôler le bon déroulement et de sauvegarder mais aussi de limiter les droits de la personne gardée à vue.
Le texte aboutit ainsi à une confusion des rôles, alors que plusieurs arrêts, tels que l’arrêt Medvedyev, avaient indiqué que la personne arrêtée ou détenue devait être présentée devant une personne présentant les garanties requises en termes d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties. Cela exclut notamment que cette personne puisse agir, par la suite, contre le requérant.
Pourtant, même si nous n’évoquons pas aujourd’hui son indépendance, le procureur de la République est l’autorité qui exercera les poursuites dans la suite de la procédure, du moins telle qu’elle existe aujourd’hui et telle qu’elle avait été présentée par votre prédécesseur, monsieur le ministre.
Dans l’arrêt du 15 décembre 2010, la Cour de cassation reprend à son compte cette interprétation. Selon elle, le ministère public n’est pas une autorité judiciaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention, dans la mesure où il ne présente ni les garanties d’indépendance requises ni les garanties d’impartialité, puisqu’il est partie prenante.
Le récent arrêt Moulin c. France de la Cour européenne des droits de l’homme est encore beaucoup plus clair. En effet, la Cour affirme par cet arrêt que le procureur ne remplit pas les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice des fonctions judiciaires, c’est-à-dire des fonctions de contrôle de la liberté individuelle de la personne placée en garde à vue. Il s’agit de décisions judiciaires, pas de décisions de sécurité !
Le placement en garde à vue est une décision de sécurité, qui peut ressortir au procureur de la République. Tout le reste correspond à du judiciaire, et relève du contrôle des libertés publiques et des libertés individuelles.
Il est donc aujourd’hui essentiel de repenser totalement l’architecture du ministère public. En effet, dans l’arrêt Medvedyev du 29 mars 2010, la Cour européenne des droits de l’homme avait nuancé sa position, mais elle l’a affirmée de manière plus claire dans l’arrêt Moulin c. France. La Cour affirme en effet que l’indépendance compte au même titre que l’impartialité. Parmi les garanties d’indépendance, la notion d’autonomie du magistrat est soulignée.
La Cour rappelle en outre que les garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties excluent notamment que les magistrats puissent agir par la suite, comme le requérant, dans la procédure pénale. C’est pourtant, à l’évidence, le cas du procureur de la République.
Dès lors, la Cour européenne des droits de l’homme considère que le procureur de la République, membre du ministère public, ne présente pas, au regard de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention, les garanties d’indépendance exigées par la jurisprudence pour pouvoir être qualifié de « juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». Vous remarquerez l’emploi du terme « magistrat ».
Je soutiens que tout ce qui concerne le contrôle des libertés individuelles relève des fonctions judiciaires, et non de fonctions policières ou de sécurité, qui ne peuvent donc pas être exercées par le procureur de la République.
Ainsi, le pouvoir actuellement reconnu au parquet d’autoriser la prolongation de la garde à vue, confirmé par le projet de loi, est contraire aux positions prises par la Cour de Strasbourg, cela me semble parfaitement lumineux.
Compte tenu du rôle confié au parquet, il est indispensable de procéder à une modification tant des règles de nomination que du régime disciplinaire de ses membres, ainsi qu’à un renforcement des compétences du Conseil supérieur de la magistrature.
Cette réforme implique en effet une révision constitutionnelle de la composition et des compétences du CSM, telles qu’elles sont définies à l’article 65 de la Constitution. Cette mesure a d’ailleurs été adoptée par les deux assemblées à la suite d’une réforme engagée en 1998 par M. Jacques Chirac après la publication du rapport confié à une commission présidée par M. Pierre Truche.
Pour des raisons politiques sur lesquelles je ne reviendrai pas, ce projet de loi constitutionnelle, adopté par les deux chambres, n’a pas été soumis au Congrès, sans le vote duquel il ne pouvait pas avoir de valeur juridique.
Il faut, à mon sens, reprendre les principes de cette réforme inaboutie, qui prévoyait l’avis conforme du CSM sur les nominations des magistrats du parquet ainsi que la compétence du CSM pour statuer en tant que conseil de discipline. Un consensus serait aujourd’hui possible sur ce sujet, j’en suis persuadé.
Toutefois, puisque vous êtes restés sourds, pendant quatre ans, à tout ce que nous vous avons dit, à toutes les mises en garde s’agissant du couperet qui tomberait, sachez que, le 1er juillet, place de la Concorde, la guillotine sera là !
Sourires

Vous affirmez n’avoir pas le temps de mener une réforme constitutionnelle parce qu’il est notamment nécessaire de réunir le Congrès à Versailles ! Excusez-moi, monsieur le garde des sceaux, mais vous vous y êtes très mal pris !

Vous, ou d’autres !
Le préalable à toute chose, et même à une réforme d’ensemble de la procédure pénale telle qu’envisagée dans le pré-rapport de Mme Alliot-Marie – nous l’avons très scrupuleusement examiné en commission des lois avec mon collègue Jean-René Lecerf –, était, de l’avis de tous – procureurs généraux ou membres de comité de réflexion présidé par Philippe Léger, par exemple –, une réforme du statut des magistrats du parquet, afin de les rendre indépendants vis-à-vis du pouvoir exécutif, pour leur nomination comme pour leur régime disciplinaire.
Vous ne l’avez pas fait et vous êtes dans la situation que nous savons. Malheureusement, monsieur le garde des sceaux, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Latin ou pas, c’est bien de cela qu’il s’agit !
Dans l’attente de cette révision indispensable à toute réforme de la procédure pénale – à toute réforme d’ensemble -, nous avons déposé un certain nombre d’amendements tendant à substituer le juge des libertés et de la détention au procureur de la République pour tout ce qui concerne le régime de la garde à vue, après la décision initiale de placement.
Cette solution est la moins mauvaise, mais sans doute pas la meilleure. En effet, le juge des libertés et de la détention ne présente pas aujourd’hui, à mon avis, toutes les garanties nécessaires à l’exercice d’une telle mission. Tout d’abord, qu’est-ce que ce juge ? Par qui est-il nommé ? Il devrait être nommé en conseil des ministres, comme le juge d’instruction. Cela n’est pas le cas. Il peut être déplacé, remplacé et « placé », par le président du tribunal, et affecté à l’exercice de toutes sortes de tâches.
Nous savons parfaitement que ce juge regarde les dossiers très rapidement. Des affaires célèbres ont montré à quel point, dans certains cas, il avait manqué, faute de temps ou des pièces utiles, aux devoirs de sa charge.
Aujourd’hui, certains affirment vouloir lui confier la garde à vue, tandis que d’autres affirment qu’il faut s’en garder, au risque que le juge des libertés et de la détention ne s’en trouve débordé. Il le sera d’autant plus après le 1er août, date à partir de laquelle, du fait encore d’une décision du Conseil constitutionnel, le juge des libertés et de la détention devra contrôler toutes les hospitalisations, d’office ou à la demande d’un tiers, dans les hôpitaux psychiatriques !
Dans un petit département comme le mien, d’après les psychiatres que j’ai rencontrés, cela correspond à environ trois ou quatre déplacements hebdomadaires du juge de Vesoul à l’hôpital psychiatrique !

Comprenne qui pourra ! Les juges feront ce qu’ils pourront ! Même si la réforme est adoptée, comment sera-t-elle appliquée ? Je n’en sais rien !
Nos amendements ont été repoussés en commission des lois. Mes chers collègues, peut-être aurez-vous la sagesse de ne pas suivre l’avis de M. le rapporteur, qui s’est, à cette occasion, départi de sa sagesse habituelle… Dans le cas contraire, vous voterez une loi qui encourra la censure du Conseil constitutionnel, cela ne fait pas l’ombre d’un doute !
Le Gouvernement n’a pas voulu s’interroger sur ces questions à temps. Il a décidé de passer en force !

Il a décidé de passer outre !
Monsieur le ministre, je vous pose la question : que se passera-t-il si le Conseil constitutionnel, saisi, censure, avant le 1er juillet, plusieurs articles du présent texte ? S’il s’agit des régimes dérogatoires et de l’audition libre, me direz-vous, nous pourrons nous en passer, et nous promulguerons une « petite loi ». S’il s’agit, en revanche, du rôle du procureur dans les prolongations, les dérogations, les limitations à l’assistance de l’avocat et toutes ces petites dispositions introduites, je le suppose, à la demande des syndicats de police, tout votre texte tombera à l’eau !
J’en appel à vous, chers collègues de la majorité : une telle issue n’est pas celle que vous voulez, et pas non plus celle que nous voulons. Par conséquent, j’en suis convaincu, vous voterez cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité, le Gouvernement nous convoquera à Versailles très rapidement, puisque le texte est prêt, déjà voté par les deux assemblées, et nous reviendrons alors ici, dans l’urgence, et voterons une réforme qui, enfin, tiendra debout !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons écouté avec beaucoup d’attention notre collègue Jean-Pierre Michel. En tant que praticien, d’une part, et en tant que parlementaire, d’autre part, il est en effet très avisé sur ces questions, et très expérimenté.
Toutefois, j’avoue ne pas avoir été convaincu par son propos, et même un peu déçu.
Vous affirmez, monsieur Michel, que le Gouvernement a le dos au mur. Je laisserai le ministre répondre sur ce point, mais je n’ai pas le sentiment que le Gouvernement agisse dans la précipitation.
Le législateur, en tout cas, n’a certainement pas, lui, le dos au mur ! Depuis des années, en effet, nous nous sommes préparés au débat d’aujourd’hui. Nous sommes parfaitement sereins et parfaitement informés pour apprécier les dispositions qui nous sont soumises.
En réalité, j’ai de plus en plus l’impression que ce sont les parlementaires de l’opposition qui se trouvent « dos au mur » ! Ne pouvant pas refuser un projet de loi qui – ils le reconnaissent d’ailleurs honnêtement – comporte des avancées très importantes, ils doivent se contenter d’exprimer leurs regrets que le texte loi n’aille pas plus loin.
Mais, mes chers collègues, nous aussi, nous aimerions parfois aller plus loin. Simplement, il faut tenir compte des impératifs de calendrier.
Mme Josiane Mathon-Poinat s’exclame.

Monsieur Michel, pour défendre votre motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité, vous faites, me semble-t-il, des interprétations erronées de la jurisprudence et vous raisonnez de manière spécieuse. Vous invoquez trois griefs.
Votre premier grief concerne l’audition libre, réapparue selon vous, à l’article 11 bis du projet de loi, qui ne serait pas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Or l’article 11 bis tel qu’il résulte des travaux de la commission est ainsi rédigé : « Lorsque la personne est présentée devant l’officier de police judiciaire, son placement en garde à vue […] n’est pas obligatoire dès lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu’elle a été informée qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l’officier de police judiciaire. »
Cela concerne donc le cas où la personne dispose d’une totale liberté de parler ou non et de quitter les lieux. Je ne vois pas pourquoi on empêcherait de telles auditions.
Par conséquent, toute votre argumentation visant à faire croire que l’article 11 bis dissimulerait des mesures de contrainte n’est pas recevable.
Votre deuxième grief porte sur les régimes dérogatoires. Sans doute votre analyse se fonde-t-elle sur le texte qui avait été initialement déposé à l’Assemblée nationale. Mais un certain nombre de modifications importantes ont été apportées depuis, si bien que le texte dont vous êtes aujourd'hui saisis, mes chers collègues, est parfaitement compatible avec la jurisprudence de la Cour de cassation, qui fait elle-même référence aux décisions du Conseil constitutionnel.
Par conséquent, il n’y a, me semble-t-il, plus de problème sur la question des régimes dérogatoires.
Votre troisième grief – j’espère que nous n’allons pas revenir à chaque fois sur le sujet, même si nous pouvons en parler dans le cadre de la discussion de la présente motion – a trait au rôle du procureur de la République.
Là, vous nous entraînez dans un autre débat. Vous affirmez que le procureur de la République n’est pas un juge, puisqu’il est, notamment, une autorité de poursuite. Personne ne le conteste ! Le procureur de la République n’est pas un juge ; en revanche, c’est un magistrat, et il fait partie de « l’autorité judiciaire ».
Mais ce n’est pas le sujet. La question qui nous préoccupe est de savoir si le contrôle de la garde à vue dans les premières heures peut être assuré par un membre du parquet. Et la réponse est oui !
Vous pourrez tirer les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme, de la Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel dans tous les sens, vous ne trouverez aucun motif d’irrecevabilité dans le texte qui vous est présenté.
Toutes ces décisions vont dans le même sens : la personne doit être présentée rapidement ; nous avons évoqué ce matin la « promptitude ». En France, elle sera présentée au bout de la quarante-huitième heure s’il y a besoin de dépasser les premiers délais.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas fixé de délai maximal. On peut supposer qu’elle envisageait plutôt un délai de quatre jours. Comme je l’ai indiqué ce matin à la tribune, quarante-huit heures, c’est deux fois moins que quatre jours !
Par conséquent, il n’y a là aucun motif d’inconstitutionnalité et de contrariété par rapport à des dispositions conventionnelles.
Vous nous avez fait part tout à l’heure de votre conception personnelle, qui est au demeurant respectable. Pour vous, un magistrat qui n’est pas juge ne doit pas pouvoir être chargé du contrôle d’une garde à vue. Vous avez le droit de défendre cette thèse ; simplement, elle va à l’encontre non seulement des décisions jurisprudentielles, mais également de la Constitution, qui s’impose à tous ! M. le garde des sceaux vous en a fait la démonstration.
Le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui est parfaitement conforme à la Constitution. Si, d’aventure, vous défériez ce texte au Conseil constitutionnel après son adoption par le Parlement, je suis à peu près certain – bien évidemment, je ne voudrais pas me montrer présomptueux et anticiper sur la décision des Sages – qu’il ferait l’objet d’une déclaration de conformité.
Au sein de la commission des lois, en tout cas, nous n’avons trouvé aucun motif d’inconstitutionnalité ou de contrariété avec des dispositions conventionnelles.
C'est la raison pour laquelle la commission émet sans hésitation un avis défavorable sur cette motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.
Je souscris aux excellents arguments qui viennent d’être développés par M. le rapporteur.
À mon sens, le texte qui ressort des travaux de la commission des lois et dont vous êtes saisis ne présente aucun motif d’inconstitutionnalité, mesdames, messieurs les sénateurs.
J’ai apprécié que M. Michel invoque le vieil adage Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Voilà qui nous rappelle à tous de très bons souvenirs !
Sourires
Nous avons repris à la lettre la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation – je vous renvoie notamment à l’arrêt du mois d’octobre – sur les régimes dérogatoires.
Le débat s’est focalisé, peut-être à tort, sur la question du procureur de la République. Après tout, le projet de loi présente nombre d’avancées sur d’autres sujets, qu’il s’agisse des droits de la personne gardée à vue, de l’interdiction de la fouille à corps ou de la possibilité d’avertir immédiatement non seulement les proches, mais également l’employeur.
Reste que le problème du parquet est soulevé de manière récurrente.
Personne ne prétend que le procureur de la République soit une autorité judiciaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cela dit, ce n’est pas le seul texte qui existe dans notre droit.
Selon la Constitution, c'est-à-dire le texte qui organise et garantit notre vie collective, l’autorité judiciaire est composée des magistrats du siège et du parquet. Le procureur de la République est donc bien un magistrat, même si ce n’est pas un juge. S’il y a une confusion, c’est parce que la Cour européenne des droits de l’homme, au fil de sa jurisprudence, a fini par assimiler juge et magistrat, ce qui ne correspond pas à notre droit.
Dans ces conditions, la possibilité pour le procureur de la République de contrôler la garde à vue dans les quarante-huit premières heures constitue une garantie supplémentaire : c’est un progrès, et non une régression !
C’est ce dont je voudrais convaincre la Haute Assemblée au moment où je l’invite à entrer dans le débat.

Je mets aux voix la motion n° 65, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.
Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.
La motion n'est pas adoptée.

Je suis saisi, par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, d'une motion n° 1.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la garde à vue (n° 316, 2010-2011).
Je rappelle que, en application de l’article 4, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour la motion.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous avons enfin l’occasion de réformer la garde à vue.
On pourrait s’émouvoir de constater qu’il a fallu attendre d’être poussés par les instances européennes pour enfin modifier ce régime tant décrié !

Nous sommes donc invités à revoir notre copie, et ce avant le 1er juillet 2011. Essayons donc de consacrer le délai dont nous disposons à l’élaboration d’une réforme satisfaisante de nature à nous éviter à l’avenir d’avoir à rougir de notre législation.
Il n’y a donc plus de temps à perdre, monsieur le garde des sceaux.
Cependant, s’il s’agit, comme le laisse penser la lettre de la réforme, de se conformer aux attentes constitutionnelles et conventionnelles, encore faut-il que le texte évolue en ce sens. Or, comme l’a fait remarquer avant moi ma collègue Nicole Borvo Cohen-Seat, le chemin est encore long avant d’y parvenir. Surtout si vous vous obstinez à feindre de ne pas comprendre les impératifs qui nous sont pourtant imposés tant par les instances européennes que par notre souci de garantir nos libertés !
Ne vous en déplaise, monsieur le garde des sceaux, le 29 mars 2010, la Cour européenne des droits de l’homme nous a une nouvelle fois rappelé que la conformité de la privation de liberté au paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dépendait, entre autres, de son contrôle par un magistrat devant « présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public. » Je ne fais que répéter la jurisprudence pour M. le garde des sceaux et M. le rapporteur…
On ne peut pas lire dans cette motivation autre chose que la condamnation claire et précise de la garde à vue placée sous le contrôle du procureur, qui n’est indépendant ni de l’exécutif
M. le président de la commission des lois s’exclame.

Vous tenterez certainement – vous avez déjà commencé à le faire, mais en vain – de nous convaincre que les standards européens n’imposeraient pas de retirer au procureur de la République le contrôle des deux premiers jours de garde à vue.
Pour soutenir votre argumentation, vous nous ferez une lecture du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales permettant de considérer que le terme « aussitôt » ne signifierait pas « sur-le-champ » et qu’une « relative rapidité » serait tolérée.
Et vous ferez ensuite état de la jurisprudence strasbourgeoise, en démontrant qu’elle admet un délai de plusieurs jours entre l’arrestation du suspect et sa présentation à un juge. C’est d’ailleurs ce que M. le rapporteur a dit.
De ce fait, vous conclurez que le projet de loi qui nous est soumis respecterait de tels préceptes, puisqu’il ne confie le contrôle de la garde à vue au parquet que durant les premières quarante-huit heures suivant le début de la privation de liberté.
Comme il n’y a pas de temps à perdre, je vous répondrai dès à présent, monsieur le garde des sceaux.
Si la Cour de Strasbourg admet un possible retard dans la présentation de la personne privée de liberté à un membre de l’« autorité judiciaire », c’est uniquement lorsque les circonstances de l’espèce l’imposent.
En d’autres termes, la Cour européenne admet que des circonstances particulières puissent retarder la mise en œuvre du contrôle de la garde à vue par un magistrat indépendant et impartial, mais refuse qu’un tel retard soit érigé en pratique systématique.
Par conséquent, dans la mesure où le procureur de la République n’est pas un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires », le fait de lui confier le contrôle des quarante-huit premières heures de garde à vue revient à retarder de manière systématique la mise en œuvre du principe édicté, ce qui méconnaît « frontalement » les exigences européennes.
Mes chers collègues, après ce récapitulatif, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous sommes contraints de délibérer dans un court délai sur l’une des plus importantes réformes de la procédure pénale de ces dernières années. Mais là n’est pas la difficulté.
Non, la difficulté tient au fait que notre réflexion doit dépasser les quelques dispositions sur la garde à vue pour englober toute la procédure pénale à travers le statut ou, en tout cas, le rôle qu’y tiendra le parquet.
Les magistrats du parquet, nous n’en doutons pas, agissent avec un très grand professionnalisme, en leur âme et conscience. Mais cette conviction, que nous partageons tous, ne suffit pas à contourner les difficultés soulevées quant à leur place dans le système judiciaire.
La nécessité de garantir le déroulement contradictoire, équitable et impartial de la procédure impose une modification profonde, soit des missions du parquet, soit de son statut.
Une modification du statut impliquerait de reformer le mode de nomination de ces magistrats en soumettant leur progression de carrière à l’avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, comme pour les magistrats du siège. Mais cela impliquerait aussi d’anéantir le lien hiérarchique qu’ils ont avec le pouvoir exécutif.
Si l’on s’engageait dans cette voie, demeurerait cependant la question des deux missions jugées incompatibles du magistrat du parquet, à la fois partie au procès et garant des droits de la personne privée de liberté.
Ainsi, il devient plus simple de choisir la première solution et de procéder à une profonde modification des missions du parquet.
Cela implique de confier le contrôle de la mesure privative de liberté à un magistrat du siège. L’indépendance de la justice serait ainsi objectivement garantie. Le parquet resterait une autorité de poursuite et de réquisition à l’audience, mais avec la perspective de voir inévitablement son statut évoluer pour se rapprocher de celui d’une autorité de type préfectoral.
Le débat doit être posé, car les choix que nous serons contraints de faire dans l’empressement les prochaines semaines ne doivent pas nous faire perdre de vue cette problématique, dans la perspective plus lointaine d’une refonte totale de la procédure pénale.
Un autre problème s’impose à nous, et de manière tout aussi urgente, celui de la question cruciale du manque de moyens humains et financiers dédiés à la justice pénale. Le décalage entre les dispositions théoriques du projet de loi et la réalité pratique de la mise en œuvre de ses dispositions doit être gommé.
Tout d’abord, pour que la présence de l’avocat soit effective, une mobilisation des barreaux sera nécessaire. Il faut pour cela leur en donner les moyens !
Une revalorisation de l’aide juridictionnelle est primordiale, car le budget voté, déjà largement insuffisant, se révèle aujourd’hui totalement dérisoire.
Vous devez, dans un premier temps, vous engager à fournir un financement complémentaire suffisant. Ensuite, sera enfin venu le moment de s’attarder sur un autre sujet de discorde, je veux parler de la réforme de l’aide juridictionnelle, dont l’examen ne peut plus être différé.
Nous apporterons des solutions par voie d’amendements, à moins que vous ne votiez cette motion tendant à opposer la question préalable.
De nombreuses questions d’ordre organisationnel se poseront par ailleurs, aussi bien pour les officiers de police que pour les avocats et devront rapidement être résolues. L’avocat contraint d’assister son client pendant tout le temps de la garde à vue, ce qui implique éventuellement de rester sur place la nuit, doit pouvoir compter sur la mise en place de moyens spécifiques.
Enfin, comme nous l’a rappelé la Commission nationale consultative des droits de l’homme, l’affirmation du principe du respect de la dignité humaine de la personne gardée à vue dans le projet de loi restera lettre morte tant que les conditions matérielles de la garde à vue, notamment les locaux, ne seront pas améliorées.
En effet, mes chers collègues, il est effrayant de constater que tant le Comité contre la torture des Nations unies et le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ont dénoncé, respectivement le 20 mai 2010 et le 10 décembre 2007, l’état intolérable de locaux de police, trop souvent vétustes et insalubres.
Toutes ces réalités de terrain doivent sérieusement être prises en considération, car une défense pénale de qualité nécessite que les moyens matériels et humains déployés soient à la mesure de ce que représentent, pour nous, les droits fondamentaux engagés.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.

Mme Mathon-Poinat est très audacieuse lorsqu’elle affirme qu’il n’y a pas lieu de délibérer !

Son raisonnement est extrême, voire paradoxal, comme le souligne M. le président de la commission des lois.
Notre collègue se plaint que le Gouvernement a le dos au mur et, dans le même temps, elle déclare qu’il n’y a pas lieu de légiférer, que l’examen de la question peut être renvoyé à plus tard !
M. Alain Gournac s’esclaffe.

Ma chère collègue, opposer la question préalable est sans doute pour vous un passage obligé dans le débat, mais, je le reconnais, l’exercice est difficile dans les circonstances présentes !
Nous connaissons tous la décision du 30 juillet 2010. Pourquoi le Conseil constitutionnel a-t-il fixé, ce qui a pu surprendre, un délai jusqu’au 1er juillet 2011 ? Tout simplement parce qu’il a estimé que les conséquences qui découleraient d’une application immédiate de sa décision seraient trop lourdes.
Je le redis, il y a urgence à légiférer : il n’est même pas envisageable de laisser s’installer l’insécurité juridique, faute d’une nouvelle législation.
J’ajoute que les conséquences financières de la réforme ont été évaluées dans l’étude d’impact jointe au projet de loi. Les chiffres varient entre 45 millions et 65 millions d’euros. J’attire l’attention du garde des sceaux sur le fait que les nouvelles dispositions introduites à l’Assemblée nationale, et que nous allons voter, concernant, notamment, la retenue douanière et les régimes dérogatoires, nécessitent d’ajuster à la hausse ce qui est prévu dans l’étude d’impact. C’est la seule remarque que l’on puisse faire ici.
La commission est totalement défavorable à la motion tendant à opposer la question préalable. Il y a au contraire nécessité et même urgence à légiférer, mes chers collègues.
Si Mme Mathon-Poinat affirme qu’il n’y a pas lieu d’engager l’examen du texte alors qu’elle pense qu’il y a urgence à délibérer, comme l’a reconnu Mme Borvo Cohen-Seat, qui soutient que nous n’avons que trop tardé, c’est qu’elle utilise toutes les possibilités offertes par le droit parlementaire. C’est un peu paradoxal, mais c’est de bonne guerre…
Je reviendrai simplement sur un point.
Je fréquente assidûment depuis quelques semaines, même si je les rencontrais déjà auparavant, tous les acteurs du service public de la justice : les magistrats du siège, les procureurs, les greffiers, les fonctionnaires, les avocats et tous les autres auxiliaires de justice, que je n’oublie pas. J’éprouve un immense respect pour tous ces professionnels sans lesquels le service public de la justice n’existerait pas.
Les attaques répétées contre le parquet ne sont pas une bonne chose. Jamais un procureur n’a prétendu qu’il était juge ! Le procureur sait qu’il est un magistrat, il sait qu’il joue un rôle constitutionnel. Il est membre de l’autorité judiciaire et doit agir en veillant au respect des libertés individuelles. Le rôle que jouera le procureur dans la garde à vue tient compte du fait qu’il n’est pas juge. C'est pourquoi il n’interviendra que pendant un bref délai, comme l’a voulu la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 décembre dernier.
Oui, nous avons besoin d’un parquet. Oui, nous avons besoin d’un parquet dont les membres sont des magistrats, sinon nous aurions uniquement la police. Ce sont là des garanties qu’il ne faut jamais oublier.
Ce projet de loi est pour moi l’occasion de rappeler notre attachement, premièrement, à l’unicité du corps des magistrats, qu’ils soient du siège ou du parquet, et, deuxièmement, au rôle du procureur en tant que magistrat. Voilà pourquoi nous devons discuter de ce texte et pourquoi le Sénat doit rejeter la motion tendant à opposer la question préalable. C’est ce à quoi je convie la Haute Assemblée.

Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question préalable.
Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.
La motion n'est pas adoptée.

Je suis saisi, par M. Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, d'une motion n°66.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 5, du règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la garde à vue (n° 316, 2010-2011).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
Aucune explication de vote n’est admise.
La parole est à M. Robert Badinter, auteur de la motion.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est la troisième motion que nous examinons, et je conçois que chacun commence à s’interroger sur la longueur de nos débats.
Je souhaite cependant synthétiser les incertitudes ainsi que les inquiétudes que suscite ce texte.
Personne ne discutera le fait que le projet de loi constitue un progrès, et Dieu sait que nous avons été ardents et nombreux à le réclamer ! Monsieur le rapporteur, nous avons, nous aussi, apprécié les efforts qui ont été faits et les avancées que la commission des lois a réussi à introduire dans le texte.
À titre personnel, j’ai été sensible à l’attention portée au respect de la dignité des personnes placées en garde à vue. Cet aspect n’est pas assez pris en compte dans le cadre de nos procédures et, plus communément, de nos pratiques. C’était particulièrement important en matière de garde à vue, mais nous avons assez parlé soutiens-gorges et lunettes pour ne pas recommencer le débat du début !
À cet égard, monsieur le garde de sceaux, qu’il me soit permis de dire, mais cette préoccupation nous est commune, que nos locaux de garde à vue ne sont pas dignes d’une grande nation comme la nôtre. Quelles que soient les améliorations récentes qui ont été apportées, nous sommes encore très loin du compte. Or il n’y a rien de plus humiliant, le Sénat l’a signalé, que de s’entendre rappeler par des institutions internationales objectives que la condition carcérale et, en l’occurrence, la condition des personnes placées en détention est, par certains degrés, inhumaine ou, en tout cas, dégradante.
Je laisse ce point de côté pour en venir à l’essentiel.
Cette motion est modeste quant à son objectif ; elle consiste à dire que la copie est faite, mais qu’elle n’est pas parfaite. Par conséquent, nous vous invitons à la compléter, ce qui permettra d’éviter certaines décisions, notamment, et à coup sûr, de la part de la Cour européenne des droits de l’homme. C’est sur ce point que portera essentiellement mon propos.
Quelle est, à ce stade, la situation ?
Premièrement, le droit à l’assistance du conseil est un progrès considérable. Le système que nous avions si péniblement réussi à faire élaborer, et que, dans l’opposition, nous n’avons cessé de vouloir améliorer, ce système ne convient pas, l’avocat apparaissant et disparaissant régulièrement comme une sorte de « coucou » suisse. Non, ce n’était pas admissible.
Le droit à l’assistance de l’avocat étant ici consacré par ce texte, nous devons nous interroger sur son étendue – est-elle suffisante ? – et sur les moyens consacrés à l’exercice de ce droit, donc à cette assistance.
S’agissant de l’étendue, je vous le dis franchement, il me semble que vous méconnaissez grandement la portée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : limiter à la personne placée en garde à vue le droit à l’assistance de l’avocat est trop réducteur.
Je vous renvoie sur ce point à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Salduz contre Turquie du 27 novembre 2008 : « Pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 demeure suffisamment “concret et effectif” […], il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti – il s’agit d’une traduction de l’anglais, mieux vaudrait dire « satisfait » – dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police. » D’autres décisions disent la même chose.
L’idée profonde et essentielle est que toute personne suspectée d’avoir commis une infraction, qu’elle soit ou non placée en garde à vue, doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat, si elle le demande. C’est aussi simple que cela ! Ce principe général, qui ne vaut pas uniquement en cas de garde à vue, même si son respect revêt alors une importance particulière, devrait être consacré au travers de ce projet de loi et régir la procédure pénale ! Le présent texte ne satisfaisant pas à cette exigence fondamentale du procès équitable, il faut le reprendre et aller plus loin.
Au-delà de cet aspect, paradoxe inouï, le projet de loi prévoit la possibilité, pour le ministère public, partie poursuivante, de différer la présence de l’avocat pendant douze heures, voire jusqu’à la vingt-quatrième heure avec l’accord du juge des libertés et de la détention ! Je le redis, ce sont ici les principes du procès équitable qui sont en jeu ! Le 2 octobre 1981, jour dont je conserve un très grand souvenir, j’étais allé à Strasbourg lever les réserves qui privaient les justiciables français du droit de saisir la Commission européenne des droits de l’homme. À partir de ce moment, la jurisprudence que nous savons s’est développée, mais nous nous heurtons encore, des décennies plus tard, à une sorte de pesanteur, de défiance à l’encontre de ce qui constitue le cœur même de la procédure pénale contemporaine : le procès équitable avec l’égalité des armes. J’ajoute que la référence faite par le texte à la nécessité de justifier de « raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête » pour différer la présence de l’avocat n’apporte pas de garanties à cet égard, car nous savons bien qu’aucun contrôle ne sera possible.
Cela m’amène à la deuxième question clé : celle du contrôle de la garde à vue.
Monsieur le garde des sceaux, vous avez tenu à rappeler – était-ce nécessaire dans cette enceinte ? – que la magistrature, en France, est composée d’une part des magistrats du siège, d’autre part des magistrats du parquet. Ils ont tous la qualité de magistrat, personne ne le conteste, et surtout pas moi : la question n’est pas là !
Le problème – Dieu sait qu’il est complexe ! – est en fait le suivant : alors que l’article 66 de la Constitution dispose que l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle, la Cour européenne des droits de l’homme a dit – sans viser particulièrement la France au départ – que les membres du parquet français ne répondent pas aux critères requis pour pouvoir être considérés comme faisant partie de l’autorité judiciaire.
Ce considérant a un double motif.
Le premier motif est l’absence d’indépendance des magistrats du parquet. Ce n’est pas leur faire offense – j’ai pour eux la plus grande considération ! – que de rappeler que, malheureusement, la Constitution, dans son état actuel, ne leur donne pas, en ce qui concerne leur carrière, leur nomination et leur responsabilité disciplinaire, les garanties dont doit bénéficier tout magistrat. C’est ici non pas l’organisation du parquet qui est en question, mais le statut individuel de ses membres. En définitive, leur carrière dépend de l’exécutif : c’est le fait capital, constamment rappelé par la Cour européenne des droits de l’homme ! Je n’aurai pas, monsieur le garde des sceaux, la cruauté de rappeler le nombre des magistrats du parquet qui ont été nommés par vos prédécesseurs contre l’avis du Conseil supérieur de la magistrature…

Tant que la carrière de ces femmes et de ces hommes dépendra du pouvoir exécutif, la Cour européenne des droits de l’homme ne pourra que dénoncer cette situation et estimer que les nécessaires garanties d’indépendance de ces magistrats ne sont pas réunies.
J’irai plus loin, monsieur le garde des sceaux : le grand, le profond malaise qui règne actuellement au sein de la magistrature et dont je n’ai pas, au cours d’une très longue carrière, vu d’autre exemple, trouve sa source, pour une grande part, dans le fait que l’exécutif, en France, ne veut pas desserrer son emprise sur la carrière des magistrats du parquet, parce que, pense-t-il, elle lui donne une possibilité d’intervention dans les affaires qui l’intéressent ! Ne jouons pas les naïfs, il suffit de consulter la grande actualité judiciaire pour s’en convaincre. Tant qu’il n’aura pas été remédié à cette situation, tant que les nominations des magistrats du parquet ne seront pas au moins soumises à avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, comme l’Assemblée nationale et le Sénat en avaient manifesté la volonté par des votes à la suite du rapport de la commission Truche, ce malaise persistera, car il est profond et structurel.
Le second motif de la position de la Cour européenne des droits de l’homme tient à la question de l’impartialité. La Cour européenne des droits de l’homme ne cesse de le rappeler : il faut que le public soit convaincu que la justice a été rendue de façon impartiale et avec objectivité.
Si nous envisageons les formalités et le déroulement de la garde à vue sous cet angle de l’impartialité, nous nous trouvons placés devant un autre prodigieux paradoxe : c’est le parquet, partie poursuivante dans le procès pénal, qui décide de l’étendue des droits de la défense pendant la garde à vue ! C’est une situation inouïe, on le reconnaîtra ! Comment peut-on parler, dans ces conditions, de procès équitable ?
Il s’agit là, j’en suis bien conscient, d’une question extraordinairement difficile, compte tenu de ce que sont aujourd’hui les principales lignes de force de notre procédure pénale, mais nous ne pouvons pas l’esquiver. À cette question majeure, on ne peut répondre que d’une façon : un magistrat du siège, autorité totalement impartiale et indépendante, doit donner au parquet l’autorisation de prendre des mesures restrictives des droits de la défense. Je ne fais ici que rappeler des évidences ! Une même personne ne peut pas, à la fois, poursuivre une personne et restreindre les droits de la défense. Puisque l’on évoque volontiers le duel judiciaire, imaginez que, sur le pré, l’une des parties se munisse d’une Kalachnikov tout en obligeant l’autre à se contenter d’une escopette d’un autre âge ! C’est impossible : le procès équitable commande l’égalité des armes ; vous ne pouvez échapper à cet impératif.
C’est pourquoi il faut renvoyer ce projet de loi à la commission, afin que nous puissions revoir les différentes phases d’intervention du parquet dans le cadre de la garde à vue et procéder aux ajustements nécessaires.
Monsieur le ministre, ne voyez pas dans mon attitude un réflexe d’opposant. Je le dis clairement : autant les assemblées ont fait tout ce qu’elles ont pu pour améliorer le droit de la garde à vue, autant le Gouvernement s’est employé à le durcir au cours des cinq dernières années. Le Gouvernement n’a pas voulu cette réforme, il y a été traîné, s’écriant, à l’instar de Mme du Barry devant le bourreau : « Encore un moment de garde à vue paisible, sans avocat, à la Maigret ! »
Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le garde des sceaux, nous avons entendu vos prédécesseurs nous expliquer, à l’occasion notamment d’une question orale posée par M. Mézard ou de l’examen de propositions de loi présentées par l’opposition, que la garde à vue serait réexaminée dans le cadre de la grande réforme de la justice. « Un peu de patience », nous disaient-ils ! Les mois, les années ont passé dans l’attente du grand débat, de la grande réforme, des conclusions de la commission Léger… Tout, sauf réformer la garde à vue !
Vous avez estimé, monsieur le garde des sceaux, que cette réforme était une conséquence heureuse de l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité. Je me réjouis de l’intervention du Conseil constitutionnel, mais je ne peux pas m’empêcher de rappeler que si l’exception d’inconstitutionnalité, dont j’ai été le père, avec la précieuse coopération de M. Drai, premier président de la Cour de cassation, et de M. Long, vice-président du Conseil d’État, avait été votée par cette assemblée en 1990, la question de la garde en vue aurait été réglée depuis longtemps, à la satisfaction générale ! Vous me permettrez d’exprimer ce regret. Pour le reste, et avec les tempéraments que j’ai eu plaisir à évoquer, il vous faut reprendre votre copie !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – Mme Jacqueline Gourault applaudit également.

Le projet de loi doit-il être renvoyé à la commission ? Je rappellerai brièvement que, en seulement une année, celle-ci s’est réunie une dizaine de fois pour évoquer la question de la garde à vue, soit exclusivement, soit à l’occasion d’autres débats sur la procédure pénale. En outre, c’est la quatrième fois en moins d’un an que le Sénat débat en séance publique de la garde à vue. Enfin, nous avons auditionné de très nombreuses personnalités.
Le travail de la commission n’est peut-être pas parfait, mais il me semble abouti eu égard aux conditions dans lesquelles il a été accompli. J’émets donc un avis défavorable sur la demande de renvoi à la commission formulée par M. Badinter, dont j’ai écouté les observations avec beaucoup d’attention.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Sueur, je vais m’efforcer d’aider le rapporteur : à nous deux, peut-être vaudrons-nous un tiers, deux tiers ou trois quarts de M. Badinter. C’est notre seule ambition !
Sourires.
Monsieur Badinter, j’ai pour vous un grand respect et je vous écoute toujours avec intérêt, même si nous pouvons avoir des points de désaccord, comme il est de règle dans un débat démocratique.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Sueur, il n’est déjà pas si mal que nous ayons encore du pain à manger ! Ne vous plaignez pas continuellement de l’abondance !
Sourires.
Il est exact que notre droit progresse selon un long chemin ; tous les gouvernements ont tenté d’apporter leur pierre à l’édifice. Vous regrettez, monsieur Badinter, que le Sénat n’ait pas voté l’exception d’inconstitutionnalité en 1990 : nous pouvons toujours nous consoler en nous disant que, pour notre part, nous l’aurions fait si nous avions été sénateurs à l’époque. En tout cas, nous ne pouvons que nous réjouir de l’introduction de l’exception d’inconstitutionnalité dans notre droit, quels qu’en aient été les promoteurs.
La situation est analogue s’agissant du statut des magistrats. Sur ce point, j’ai trouvé vos propos quelque peu sévères. Longtemps, la nomination des magistrats du siège par le Gouvernement n’a été soumise qu’à un avis simple du Conseil supérieur de la magistrature. Ce n’est qu’en 1993 que Pierre Méhaignerie, alors garde des sceaux, a décidé que cet avis devrait être conforme.
Quant aux magistrats du parquet, leur nomination est désormais soumise à un avis simple du CSM. Il ne s’agit donc pas d’un avis conforme, certes, mais, jusqu’à présent, je ne suis jamais allé à l’encontre d’un avis du CSM. Je ne prétends nullement qu’il en ira toujours de même à l’avenir, mais dès lors que le CSM sera composé différemment, qu’il jouira d’une plus grande indépendance et ne sera plus présidé par le Président de la République ou par le garde des sceaux, ses avis sur la nomination des magistrats du parquet, qui seront plus largement rendus publics qu’ils ne le sont à ce jour et pourront être, s’il le souhaite, motivés, auront plus de poids. Le pouvoir exécutif sera nécessairement amené à en tenir compte, nous le savons bien, vous comme moi.
Je ne prétends pas que le présent projet de loi soit parfait – la perfection n’existe d’ailleurs pas –, néanmoins il permettra d’établir un équilibre nouveau entre deux exigences essentielles : la sûreté et la liberté.
Dès lors que l’avocat sera présent dès le début de la garde à vue, la valeur probante de l’enquête conduite au cours de celle-ci par l’officier de police judiciaire s’en trouvera renforcée. C’est en tout cas ma conviction. Il ne faut donc pas opposer les officiers de police judiciaire aux avocats.
Nous pourrions longuement discuter les termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et sans doute ne manquerons-nous pas de le faire au cours du débat. Néanmoins, nous nous accorderons certainement sur un point : cette jurisprudence, au fil de son évolution, tend à étendre la notion de procès équitable – et donc de juge –, non seulement au procès lui-même, mais à l’ensemble de la procédure qui peut conduire à celui-ci. Vous n’avez pas dit autre chose, monsieur Badinter, lorsque vous nous avez expliqué que l’on se devait d’appliquer à la garde à vue les règles du procès équitable.
Toutefois, cela ne correspond pas au droit français et telle n’était pas nécessairement, en outre, la volonté des signataires de la Convention européenne des droits de l’homme. Sinon, pourquoi auraient-ils établi une distinction entre les mesures qui précèdent le procès, figurant à l’article 5, et celles qui concernent le procès, inscrites à l’article 6 ?
Que la jurisprudence de la Cour de Strasbourg ait connu des évolutions, c’est évident, mais je soutiens que le présent projet de loi se situe dans le droit fil de celle-ci.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je vous renvoie, monsieur Badinter, aux conclusions que M. Marc Robert a brillamment présentées devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Je ne doute pas que vous serez plus sensible à ses arguments qu’aux miens !
Sourires.
En tout état de cause, le Gouvernement ne peut qu’émettre un avis défavorable sur cette motion tendant à renvoyer le texte à la commission.
La motion n'est pas adoptée.

En conséquence, nous passons à la discussion des articles.
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l’encadrement de la garde à vue
Le III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. »

L’article 1er A du projet de loi, qui résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement, vise à modifier l’article préliminaire du code de procédure pénale en prévoyant que, « en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui ».
À juste titre, M. le rapporteur a fait adopter un amendement tendant à préciser que cela implique à la fois que la personne en question ait pu s’entretenir avec son conseil et qu’elle ait été assistée par lui.
Cette précision est très importante, car elle souligne la nécessité que l’assistance de l’avocat soit organisée de telle sorte qu’elle permette à ce dernier d’assurer une défense effective des droits de son client, conformément à la jurisprudence européenne.
En revanche, la commission, en choisissant de maintenir l’adjectif « seul », prive dans une large mesure l’article 1er A de sa portée vertueuse.
En effet, comme le relève le rapport sans en tirer les conséquences, une telle rédaction revient à admettre que les déclarations d’une personne mise en cause qui n’aurait pas bénéficié du droit essentiel d’être assistée d’un avocat puissent néanmoins corroborer des preuves.
L’article 1er A tend à inscrire dans la loi que des déclarations incriminantes faites hors la présence d’un avocat peuvent faire partie intégrante du processus conduisant à prononcer une condamnation. Il n’impose pas que les déclarations recueillies dans le cadre d’une procédure irrégulière soient écartées des débats ; il prévoit seulement qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée contre une personne sur leur seul fondement, ce qui constitue une différence substantielle au regard des droits de la défense. Certains avocats ont d’ailleurs exprimé leurs craintes que cet article ne soit utilisé pour éviter la nullité de la procédure.
Dernièrement, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que, bien qu’une garde à vue hors l’assistance d’un avocat ne puisse être annulée avant le 1er juillet 2011, les éléments recueillis lors de l’interrogatoire d’une personne n’ayant pas eu accès à un avocat ne peuvent constituer des éléments de preuve suffisants pour fonder une condamnation. Ainsi, si la procédure ne peut être annulée, du moins les éléments recueillis en violation de droits qui devraient être immédiatement garantis ne peuvent servir de preuves.
Cela étant dit, pour la période postérieure au 1er juillet 2011, nous estimons nécessaire, au regard des exigences européennes et dans l’intérêt du justiciable, de revoir la rédaction de l’article 1er A. En effet, l’arrêt Salduz contre Turquie stipule qu’ « il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation ».
Toute déclaration faite hors la présence d’un avocat implique donc une violation substantielle des droits de la défense, qui doit conduire à une annulation de la condamnation. Non seulement l’atteinte aux droits de la défense est irrémédiable, mais elle doit s’étendre à l’ensemble de la procédure.

L'amendement n° 67, présenté par MM. Anziani, Michel, Badinter et Sueur, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, M. Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Toute personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être interrogée, au cours de l'enquête, sans avoir eu la possibilité, si elle en fait la demande, de s'entretenir avec un avocat ou d'être assistée par lui dans les conditions fixées par le présent code.
La parole est à M. Alain Anziani.

Évidemment, nous ne pouvons que nous féliciter de ce que ce projet de loi consacre la nécessité de la présence de l’avocat lors de la garde à vue. Cela étant, qu’en est-il dans les autres cas ?
Dans le rapport de la commission, il est indiqué que la moitié des personnes mises en cause en 2010 avaient été entendues sous le régime de l’audition libre. Or la présente réforme a précisément pour objet de réduire le nombre des gardes à vue, et donc d’accroître parallèlement celui des auditions libres. Quels seront les droits des personnes entendues dans ce cadre ?
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une personne a le droit d’être assistée par un avocat non parce qu’elle est placée sous contrainte – c’est le cas lorsqu’elle est mise en garde à vue –, mais parce qu’elle est suspectée. Autrement dit, toute personne soupçonnée a droit à l’assistance d’un avocat.
C’est la raison pour laquelle nous proposons, par cet amendement, d’inscrire parmi les principes généraux de notre procédure pénale le droit, pour toute personne soupçonnée, de s’entretenir avec un avocat ou d’être assistée par lui.

Dans le droit fil des propos tenus tout à l’heure par M. Badinter, les auteurs de cet amendement entendent poser le droit, pour toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, de s’entretenir avec un avocat ou d’être assistée par lui.
Cette idée d’une intervention généralisée de l’avocat participe d’une recherche de la perfection de la procédure pénale. Cependant, bien qu’elle soit extrêmement séduisante, une telle proposition n’est pas réaliste. La mettre en œuvre impliquerait un droit général à l’assistance d’un avocat, même lorsqu’une personne défère librement à une convocation des services de police ou de gendarmerie, ce qui va bien au-delà des exigences conventionnelles.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable sur cet amendement.
L’article 1er A du projet de loi tend à compléter l’article préliminaire du code de procédure pénale, qui fixe les principes généraux de notre procédure résultant de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, dite « loi Guigou ». Il s’agit de distinguer clairement le régime de la garde à vue, qui est une mesure de coercition et est assortie de garanties spécifiques pour celui qui en fait l’objet. Dans les autres cas, il en va différemment. Il ne faut pas tout mélanger ! Contrairement à ce qu’on a pu me reprocher tout à l’heure, je n’ai pas fait dire à Mme Guigou autre chose que ce que ce qu’elle avait déclaré à l’époque à la tribune de l’Assemblée nationale.

Monsieur le garde des sceaux, il est de notre responsabilité d’attirer une nouvelle fois votre attention sur le fait que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme lie le droit à l’assistance d’un avocat à la condition de personne soupçonnée et non pas à celle de personne sous contrainte.

Cet amendement est bienvenu : cela prendra peut-être du temps, puisque le Gouvernement se livre à des manœuvres de retardement, mais on y viendra inéluctablement.
Vous déclarez, monsieur le garde des sceaux, que seules les personnes placées en garde à vue bénéficient de garanties. §En l’absence de risque manifeste d’emprisonnement, il n’y aurait donc pas de garanties ? Cela est contraire aux dispositions actuelles du code de procédure pénale et à son article préliminaire ! La procédure pénale doit être équitable et contradictoire, et préserver l’équilibre des droits des parties.
Quand une personne défère librement à une convocation au commissariat ou à la gendarmerie, ce n’est pas pour parler de la pluie et du beau temps ! Il faudra tôt ou tard aller dans le sens indiqué par les auteurs de l’amendement. Pour l’heure, vous cherchez à gagner du temps, une fois de plus. Je ne crois pas que ce soit raisonnable.

Je tiens absolument à clarifier les choses et à dissiper l’équivoque dans laquelle, monsieur le garde des sceaux, vous vous inscrivez.
Le problème posé est celui du procès équitable. Les garanties accordées aux personnes placées en garde à vue dans les cas définis par la loi sont une chose, mais l’équilibre doit régner dans le procès pénal. C’est la raison pour laquelle, je le redis, l’accès à un avocat doit être possible dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, et non pas seulement en cas de placement en garde à vue. Il faut tenir compte de l’utilisation qui pourra être faite contre elle des propos qu’aura tenus une personne n’ayant pas été placée en garde à vue !
Je vous parle ici du procès pénal, et non de la protection de la personne. Nous n’aurons jamais une meilleure occasion d’inscrire dans le projet de loi le principe de l’intervention de l’avocat auprès de tout suspect ! Veut-on ou non le procès équitable ? À cet instant, pardonnez-moi de vous le dire, monsieur le garde des sceaux, vous ne le voulez pas !
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 14, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
En matière criminelle et correctionnelle, il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

On peut douter de la volonté du Gouvernement, de la majorité et du rapporteur de vraiment clarifier les choses.
En dépit des modifications apportées en commission, le dispositif de l’article 1er A n’est toujours pas satisfaisant au regard de l’objectif affiché de garantir un droit fondamental à l’assistance d’un avocat. Il ne suffit pas d’afficher une intention !
Afin de donner une portée concrète à cet article, le présent amendement tend à reprendre la lettre de la jurisprudence européenne.

L'amendement n° 2 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, MM. Vial et J. Gautier et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer le mot :
seul
La parole est à M. Jacques Gautier.

Cet amendement, s’appuyant sur la position de la Cour européenne des droits de l’homme et sur deux décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation, tend à supprimer le mot « seul », qui est source de difficultés. Toutefois, je crois avoir deviné quel serait l’avis du rapporteur et du garde des sceaux…

L'amendement n° 68, présenté par MM. Anziani, Michel, Badinter et Sueur, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, M. Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui
par les mots :
été informée de son droit de ne pas s'auto incriminer et de son droit de s'entretenir avec un avocat
La parole est à M. Alain Anziani.

Il importe qu’une personne mise en cause soit informée de son droit de ne pas s’« auto-incriminer » et de son droit d’être assistée par un avocat.
Ce point est important. En effet, tous ceux qui ont une expérience de ces choses savent que la garde à vue est le moment du plus grand dénuement, de la plus grande angoisse, où certaines personnes refusent même d’être assistées, estimant que, étant innocentes, elles n’ont pas besoin d’un avocat ! On a encore pu entendre cet argument à l’occasion d’une affaire récente qui a défrayé la chronique. Il faut alors convaincre ces personnes soupçonnées que la présence d’un avocat n’est pas une manifestation de culpabilité et qu’elle est nécessaire dans toutes les hypothèses. Nous en sommes là !
Il convient donc de prendre toutes les précautions, en prévoyant qu’une personne soupçonnée doit être informée de ses droits avec beaucoup de précision.

Il s’agit d’une question importante, qui a donné lieu à de longs débats à l’Assemblée nationale.
Les amendements n° 14 et 2 rectifié, bien que formulés de manière différente, ont les mêmes effets et appellent les mêmes observations.
L’article 1er A prévoit qu’aucune condamnation ne doit reposer sur le seul fondement de déclarations faites hors la présence d’un avocat. En d’autres termes, cet article admet que des déclarations recueillies dans ces conditions puissent être prises en compte dès lors qu’elles sont complétées par d’autres preuves. Il faut le dire clairement, même si ce n’est pas écrit.
Les auteurs des amendements n° 14 et 2 rectifié entendent retirer toute valeur probante aux déclarations faites hors la présence de l’avocat, même si elles sont corroborées par d’autres preuves. Une telle modification du dispositif s’imposerait, selon eux, au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de deux arrêts récents de la Cour de cassation. La commission ne suivra pas ce raisonnement pour quatre raisons.
Premièrement, dans l’arrêt Yoldas contre Turquie du 23 février 2010, la Cour européenne des droits de l’homme semble admettre que des déclarations, mêmes faites hors la présence d’un conseil, peuvent être prises en compte à la condition qu’elles soient étayées par d’autres éléments de preuve.
La Cour de cassation, quant à elle, a précisé que, même si c’est à tort que des cours d’appel ont prononcé la nullité de la garde à vue avant la mise en œuvre de la réforme, les arrêts n’encourent pas la censure dès lors qu’ils ont pour seule conséquence que « les actes annulés n’ont pas constitué des éléments de preuve fondant la décision de culpabilité du prévenu ». La Cour de cassation ne s’est donc pas prononcée sur le cas où les éléments recueillis au cours de la garde à vue auraient été étayés par d’autres preuves.
Deuxièmement, la suppression du mot « seul », monsieur Gautier, risquerait de fragiliser beaucoup de procédures. Ainsi, on peut se demander si des éléments de preuve tout à fait objectifs identifiés à partir des déclarations faites hors la présence de l’avocat pourraient être pris en compte. La suppression du mot « seul » serait ainsi source d’un nombre considérable de nullités.
Troisièmement, l’article 1er A marque d’ores et déjà un progrès réel et tangible par rapport au droit en vigueur, chacun en conviendra. Cet article constitue une garantie très appréciable, en particulier – nous aurons l’occasion d’y revenir – dans l’hypothèse, prévue par l’article 7, où le procureur de la République aura différé l’assistance de l’avocat lors des auditions.
Quatrièmement, la commission des lois a amélioré la disposition issue des travaux de l’Assemblée nationale, afin d’indiquer que la valeur probante des déclarations de la personne implique qu’elle ait pu s’entretenir avec son conseil et qu’elle ait pu être assistée par lui. Nous avons rendu ces deux conditions cumulatives.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’avis de la commission est défavorable sur les amendements n° 14 et 2 rectifié.
Quant à l’amendement n° 68, il me semble être plutôt en retrait par rapport au texte que nous examinons. Par ailleurs, sa rédaction est directement inspirée du droit anglo-saxon : je ne suis pas sûr qu’il soit très opportun d’inscrire dans notre droit le terme d’« auto-incrimination ». La situation du gardé à vue nous paraît beaucoup mieux garantie par la notification du droit à garder le silence reconnu par la nouvelle rédaction du code de procédure pénale proposée.
En conséquence, la commission a également émis un avis défavorable sur l’amendement n° 68.
Il s’agit d’un article de principe extrêmement important, qui fixe la philosophie du texte.
Au terme d’un long débat à l’Assemblée nationale, nous avons été conduits à reprendre les termes employés par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Salduz contre Turquie, en faisant référence à un entretien avec un avocat ou à l’assistance d’un défenseur.
La commission des lois du Sénat souhaite aller plus loin, en rendant cumulatives les deux conditions prévues : la personne mise en cause devra avoir pu à la fois s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
Je me range à la position de la commission des lois du Sénat. Dans cette perspective, l’avis du Gouvernement sera identique à celui que vient d’exprimer M. le rapporteur.
L’amendement n° 68 est largement satisfait par le texte de la commission.
L’amendement n° 14 reprend les termes de l’arrêt Salduz contre Turquie. Or, nous rédigeons ici non pas un arrêt, mais la loi !
Ce n’est pas la même chose ! C’est l’arrêt qui est la conséquence de la loi, et non l’inverse. Il s’agit d’un amendement de nature descriptive ; même s’il est intéressant, c’est le droit positif, dont relève la rédaction élaborée par la commission des lois du Sénat, qui permet aux juges de travailler.
Quant à l’amendement n° 2 rectifié, son adoption serait à mon sens source d’un certain nombre d’incertitudes. La rédaction actuelle du texte reprend des dispositions figurant déjà ailleurs dans le code de procédure pénale. Il ne me paraît pas souhaitable de créer un cas particulier, et je demande donc à M. Jacques Gautier de bien vouloir retirer cet amendement.

Compte tenu des quatre précisions que nous a apportées M. le rapporteur, je me conforme à la demande de M. le garde des sceaux et je retire l’amendement.

L’amendement n° 2 rectifié est retiré.
La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote sur l’amendement n° 14.

Comme l’a indiqué M. le garde des sceaux, l’article 1er A est très important. Je pense que sa rédaction évoluera encore au cours du débat…
En ce qui me concerne, aucune des rédactions proposées ne me satisfait. En particulier, celle de la commission des lois me semble insuffisante, dans la mesure où la jurisprudence conventionnelle – dont je ne suis au demeurant pas un inconditionnel – indique d’abord que la personne soupçonnée doit être informée qu’elle a le droit de ne pas s’auto-incriminer, c’est-à-dire de se taire, ensuite qu’elle a le droit de faire appel à un avocat. Or, monsieur le rapporteur, dans votre rédaction, ces deux droits sont confondus.
Pour ma part, je préfère de loin la rédaction proposée au travers de l’amendement n° 68, qui, si elle ne règle peut-être pas tout, présente au moins l’avantage de distinguer nettement le droit de ne pas s’auto-incriminer et le droit de s’entretenir avec un avocat.

Monsieur le garde des sceaux, je ne vois pas du tout pourquoi il nous serait interdit de reprendre dans la loi les termes de la jurisprudence de la CEDH.
Votre amendement n’est pas opératoire !

Mais si ! Sa rédaction est en outre beaucoup moins ambiguë que celle qui nous est proposée, car elle implique clairement la nullité de la procédure si l’incrimination se fonde sur des déclarations faites sans que la personne en cause ait eu la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat.

Cela étant, vous préférez à l’évidence rester dans l’ambiguïté, en abordant les problèmes sans avoir une réelle volonté de les régler.

Ne tournons pas autour du pot : l’auto-incrimination ou le fait d’avoir prononcé des aveux, pour dire les choses autrement, est déterminant pour toute la suite de la procédure, et vous tenez à ce qu’il en soit ainsi ! Reconnaissez-le franchement !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1 er A est adopté.
Après l’article 62-1 du même code, sont insérés cinq articles 62-2 à 62-6 ainsi rédigés :
« Art. 62 -2. –
Supprimé
« Art. 62 -3. – La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
« 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
« 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
« Art. 62 -4. –
Supprimé
« Art. 62 -5. – La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2, 706-88, 706-88-1 et 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat. Le procureur de la République compétent est celui sous la direction duquel l’enquête est menée et celui du lieu d’exécution de la garde à vue.
« Ce magistrat apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.
« Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
« Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
« Art. 62 -6. –
Supprimé

En présentant, dans un premier temps, une définition de la garde à vue et une série de conditions régissant le recours à celle-ci, l’article 1er donne l’illusion d’une avancée significative. Mais en confiant, dans un second temps, le contrôle de la garde à vue au procureur de la République, il témoigne de votre obstination, monsieur le garde des sceaux…
L’article 1er, en énumérant les conditions du placement en garde à vue, semble dresser un rempart contre d’éventuels abus de pouvoirs, ce qui peut de prime abord paraître satisfaisant. Mais une mise en perspective permet vite de se rendre compte qu’il s’agit d’un simple trompe-l’œil. En effet, l’objectif affiché est de « maîtriser le nombre des gardes à vue, en constante augmentation depuis plusieurs années ». Dans cette optique, la limitation du champ d’application de cette mesure aux seules infractions punies d’une peine d’emprisonnement est présentée comme une innovation majeure. Mais cette affirmation est fallacieuse, dans la mesure où les infractions qui ne sont pas punies d’une peine d’emprisonnement sont très peu nombreuses.
De plus, n’oublions pas que l’application de la théorie des apparences permettra aisément de valider le recours à une garde à vue lorsque, au moment des faits, les circonstances rendaient vraisemblable la commission d’une infraction punie d’une peine d’emprisonnement.
Ainsi, à la lecture des premiers alinéas de l’article 1er, on constate que « la maîtrise du nombre de garde à vue » souhaitée est bien loin d’être acquise et que les libertés individuelles, auxquelles nous sommes attachés, n’en ressortent malheureusement pas renforcées.
Quant aux derniers alinéas de l’article, ils démontrent votre obstination, monsieur le garde des sceaux.
Lors de la tenue de la conférence annuelle des bâtonniers, le 28 janvier dernier, vous avez réaffirmé votre position sur la question du contrôle des gardes à vue par le parquet. Vous avez alors indiqué à une assemblée experte en la matière que votre lecture des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation était la bonne. Si vous êtes parvenu à vous persuader que le texte, en l’état, est conforme à l’ensemble des principes rappelés dans ces décisions, force est de constater que vous ne réussissez pas à en convaincre vos interlocuteurs.
Vous vous obstinez néanmoins dans votre choix de confier le contrôle de la garde à vue au parquet, lequel serait, selon vous, une autorité judiciaire indépendante et impartiale, quoi qu’en pense la Cour de Strasbourg. Aux termes des arrêts Medvedyev c. France et Moulin c. France, ce contrôle devrait être confié à un juge du siège. Que la chancellerie l’accepte ou non, le message est parfaitement clair ! Il n’est pas satisfaisant que le contrôle de la garde à vue soit laissé, pour les premières quarante-huit heures, au procureur de la République.
Avec le soutien des magistrats et des avocats, nous continuerons à porter ce combat, car il est pour nous déroutant que le procureur de la République, pourtant partie au procès, puisse être le garant des droits reconnus à la personne gardée à vue.

L'amendement n° 15, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
contrainte
Insérer le mot :
exceptionnelle
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

M. le rapporteur l’a souligné, la très forte augmentation du nombre des gardes à vue au cours des dix dernières années ne permet plus d’éluder la question d’un recours abusif à cette mesure.
En effet, il a été trop longtemps abusivement recouru au placement en garde à vue, qui est une mesure privative de liberté. Les chiffres le montrent, même si on a essayé de nous faire croire qu’ils étaient faux, alors que M. le garde des sceaux et l’ex-ministre de l’intérieur en ont eux-mêmes fait état.
L’augmentation du nombre des gardes à vue est, à nos yeux, la conséquence de la mise en œuvre d’une politique du chiffre qui perdure depuis trop longtemps et qui a immanquablement conduit à une banalisation de cette mesure. Sous les pressions sécuritaires, le nombre des gardes à vue est devenu un indicateur de performance, ce que dénoncent d’ailleurs les représentants d’un syndicat de policiers que nous avons, contrairement à vous, auditionnés.
Nous souhaitons donc que soit indiqué de manière plus explicite que la garde à vue est une mesure de contrainte exceptionnelle, afin que chacun prenne bien conscience de sa gravité. L’article préliminaire du code de procédure pénale, qui dispose que les mesures de contrainte doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, doit trouver ici une pleine application.

Madame Borvo Cohen-Seat, la portée normative de votre amendement est très limitée.
Le texte de l’article me paraît mieux rédigé en l’état. En effet, son alinéa 4 prévoit que la garde à vue « doit constituer l’unique moyen » – cela est très clair – d’atteindre l’un au moins des six objectifs énumérés ensuite.
La commission émet donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement partage tout à fait l’avis de la commission.
Pour la première fois, la garde à vue sera clairement définie, et la loi fixera des limites précises au champ d’application de cette mesure. C’est là, me semble-t-il, l’apport majeur de cet article. Préciser que la garde à vue est une mesure de contrainte « exceptionnelle » n’apporterait rien, car il va de soi que nous souhaitons mettre un terme à la banalisation de la garde à vue constatée depuis quelques années. À cette fin, il me paraît plus efficace d’inscrire dans la loi une définition précise de cette mesure que d’ajouter des adjectifs dénués de portée normative.
Dans cet esprit, je vous invite, madame la sénatrice, à retirer votre amendement et à vous rallier au texte de la commission des lois.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
de l’autorité judiciaire
par les mots :
du juge des libertés et de la détention
La parole est à M. Jacques Mézard.

Dans le droit fil des très pertinentes observations de M. Badinter, nous souhaitons que l’officier de police judiciaire qui décide le placement en garde à vue soit placé sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
La difficulté tient à la définition de l’autorité judiciaire. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, la réponse est claire : la notion autonome de magistrat, dont découle celle d’autorité judiciaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, est garantie à la fois par l’impartialité et par l’indépendance à l’égard de l’exécutif. Toujours selon la CEDH, le statut du parquet français ne remplit pas cette seconde condition, comme elle l’a rappelé très clairement dans l’arrêt Moulin c. France du 23 novembre 2010.
Dans ces conditions, la référence à l’autorité judiciaire comme autorité de contrôle de la garde à vue est clairement insuffisante. En outre, comment le parquet pourrait-il exercer un contrôle sur quelque 800 000 gardes à vue ? Nous savons tous ce qu’il en est à cet égard…
L’article préliminaire du code de procédure pénale dispose que « les mesures de contrainte dont [une] personne peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire ».
Or, pour le Gouvernement, le parquet est une autorité judiciaire. Mais c’est bien parce que le parquet est placé sous l’autorité hiérarchique de la chancellerie qu’il est à nos yeux impossible qu’il puisse contrôler la garde à vue. Ce contrôle ne saurait, en effet, se limiter aux seules nécessités de l’enquête ; il doit aussi concerner l’appréciation du respect de l’indispensable équilibre entre l’action des forces de l’ordre et les droits de la personne privée de liberté. Or, comme l’a rappelé M. Badinter, le procureur de la République est, par définition, partie à l’enquête. C’est bien ce qu’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 15 décembre 2010, aux termes duquel c’est à tort que la chambre d’instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, alors qu’il ne présente pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par ce texte et qu’il est partie poursuivante.
M. le garde des sceaux s’exclame.

De ce fait, il nous apparaît primordial de confier au juge des libertés et de la détention le contrôle de l’ensemble de la mesure, sans préjudice des autres prérogatives du procureur.

Il est vrai que le Conseil constitutionnel a posé dans sa décision du 30 juillet 2010 que « l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet ». La situation actuelle est donc très ambiguë. Le présent amendement a pour objet de permettre d’en sortir, grâce à une clarification.

Sur ce point très important du contrôle du début de la garde à vue, deux conceptions s’opposent, sachant que la question est réglée au-delà de la quarante-huitième heure : c’est le juge qui exerce alors le contrôle.

Qui doit intervenir au début de la garde à vue : la police, un magistrat du parquet ou un magistrat du siège ? Dans beaucoup de pays européens, c’est la police, parfois même au-delà de la quarante-huitième heure ; en France, c’est un magistrat qui exerce le contrôle dès le placement en garde à vue. Il y a tout lieu de se réjouir, me semble-t-il, que dans notre pays ce soit un membre de l’autorité judiciaire qui assure le contrôle de cette mesure de privation de liberté qu’est la garde à vue.

Les jurisprudences évoquées n’exigent pas du tout qu’un juge intervienne dès le début de la garde à vue.
Le système français fixe un cadre protecteur que nous proposons de maintenir ; en conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je ne me lasserai pas de répondre à M. Mézard, car je suis sûr qu’au fond de lui-même, il est déjà presque convaincu !
M. Jacques Mézard rit.
Il faut toujours interpréter les textes potius ut valeant quam ut pereant, c’est-à-dire de façon qu’ils aient un sens plutôt qu’ils n’en aient point.
Sourires.
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire sous le contrôle de l’autorité judiciaire, cette dernière étant composée, aux termes de la Constitution, de magistrats du siège et de magistrats du parquet, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010.
Le texte, tel qu’il est rédigé, précise que c’est d’abord le procureur qui intervient, au cours des quarante-huit premières heures de la garde à vue, puis un magistrat du siège. Ces deux magistrats appartiennent bien à l’autorité judiciaire.
La lecture de l’arrêt rendu le 15 décembre 2010 par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’affaire Creissen montre parfaitement que nous nous conformons à la position des hauts magistrats de ce pays : le procureur de la République n’est pas, n’a jamais été et ne prétend pas être une autorité judiciaire indépendante au sens de l’article 5-3 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais le fait qu’il dirige la garde à vue durant les premières heures n’a pas pour conséquence de rendre illégale cette dernière. En effet, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que le demandeur a été libéré à la suite d’une privation de liberté d’une durée compatible avec l’exigence de brièveté imposée par le texte conventionnel.
J’ai veillé à ce que la rédaction de la disposition soumise à la Haute Assemblée respecte parfaitement l’arrêt en question de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ainsi que les jurisprudences du Conseil constitutionnel et de la CEDH. Nous avons consenti de gros efforts à cette fin ! Le procureur, membre de l’autorité judiciaire, interviendra durant les premières heures de la garde à vue, et le juge des libertés et de la détention à partir de la quarante-huitième heure. Dans les deux cas, c’est toujours l’autorité judiciaire qui exerce le contrôle.
Je conclurai, monsieur Mézard, sur l’indépendance du parquet. J’entends fréquemment dire que le parquet est soumis au garde des sceaux et que, par conséquent, les procureurs lui obéissent.
Peut-être suis-je un peu naïf, voire benêt, mais depuis que j’occupe les fonctions de garde des sceaux, je n’ai pas encore vu un procureur qui m’obéisse ! D’ailleurs, je ne leur ai jamais rien demandé, sinon d’appliquer la loi.
J’observe que c’est sous un gouvernement issu de la même majorité qu’aujourd’hui, dont le garde des sceaux était d’ailleurs centriste, que l’autonomie des magistrats, spécialement celle des membres du parquet, a progressé. C’est en effet M. Méhaignerie qui, en 1993, a défini comment s’exerçait l’autorité de l’exécutif sur le parquet : le ministre de la justice peut adresser des instructions générales aux procureurs généraux ; dans des affaires particulières, il peut, s’il le souhaite, donner des instructions écrites, qui sont versées au dossier. Je m’inscris pleinement dans cette lignée.
Les procureurs de la République ont toute latitude lorsqu’ils mènent l’action publique. La seule règle est l’obéissance à la loi. Cette règle, tous les magistrats de ce pays la respectent, c’est pourquoi je les défends toujours quand ils sont attaqués. Ils appliquent la loi telle que le Parlement l’a votée, dans toute sa rigueur et son exigence.

Tous les gardes des sceaux ne les ont pas défendus ainsi, hélas ! Ils sont sans cesse attaqués !
Ils ont été attaqués, vous le savez bien, de tout temps et sous tous les gouvernements. Malheureusement, monsieur Badinter, ni vous ni moi ne sommes des perdreaux de l’année ! Nous avons exercé des responsabilités, nous connaissons bien la réalité des choses. J’assume parfaitement les propos que je viens de tenir, et je suis sûr que toutes ces explications auront convaincu M. Mézard de retirer son amendement ! Dans l’hypothèse contraire, je serais contraint d’émettre un avis défavorable.

Monsieur le garde des sceaux, vos efforts sont louables, mais même l’amendement de M. Mézard est insuffisant…
En effet, cet article, qui prévoit que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée sous le contrôle de l’autorité judiciaire, introduit une ambiguïté fondamentale, car si l’autorité judiciaire est certes constituée des magistrats du parquet et des magistrats du siège, il faudrait indiquer d’emblée que la garde à vue est décidée par un officier de police judiciaire, sur l’autorisation du parquet et sous le contrôle du juge.

D’ailleurs, aux termes de l’alinéa 13 de l’article, le procureur de la République « apprécie » si le maintien de la personne en garde à vue et la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits. Or apprécier, c’est juger ! Le procureur de la République est-il donc un juge ? Vous dites vous-même que non ! Nous sommes en pleine confusion ! Le procureur de la République n’a rien à apprécier : il a autorisé initialement la garde à vue, c’est tout !
Il faut en revenir à ce qu’est véritablement la garde à vue. Dans son traité de droit pénal, Émile Garçon écrivait que la garde à vue, c’est la prise de corps par la police, rien d’autre ! Ensuite, c’est le juge qui intervient.
Dans ces conditions, bien que l’amendement de M. Mézard constitue une avancée, je pense qu’il est insuffisant. Il faut indiquer d’emblée que la garde à vue est décidée par un officier de police judiciaire, sur l’autorisation du procureur, et placée sous le contrôle d’un juge du siège.
Il faut sortir de l’ambiguïté que j’ai soulignée, tout le reste n’est que littérature ! Vous aurez beau invoquer toutes les jurisprudences possibles ou triturer les déclarations de la Cour européenne des droits de l’homme en expliquant qu’elles sont mal traduites de l’anglais, vous ne pourrez échapper à cette réalité !

M. Jacques Mézard. Si j’ai bien compris les explications de notre collègue Jean-Pierre Michel, mon amendement est finalement plutôt centriste, monsieur le ministre…
Sourires.

Monsieur le ministre, vous nous avez dit ne pas être un perdreau de l’année ; pour ma part, je ne suis pas un pigeon.
Nouveaux sourires

Je crois vraiment, monsieur le ministre, qu’il s’agit là d’un problème de fond. Deux conceptions s’affrontent ici : vous voulez continuer à donner à la partie poursuivante…

… un avantage, ce qui signifie très clairement que, contrairement à nous, vous ne voulez pas d’un procès équitable.
Je n’épiloguerai pas sur l’indépendance du parquet. Nous savons qu’une immense majorité de parquetiers accomplissent en toute indépendance leur difficile mission.

Cela étant, monsieur le garde des sceaux, vous nous affirmez que vous ne donnerez jamais d’instructions au parquet, …
J’ai dit que je n’en n’avais jamais donné, pas que je n’en donnerai jamais !

… mais j’observe que vous aviez dit le contraire, d’ailleurs avec fermeté, en prenant vos fonctions ! Relisez vos déclarations de l’époque ! Cela dit, c’est votre droit, vous assumez votre fonction politique. En revanche, personne ne vous croira si vous dites qu’il n’y a jamais eu d’instructions dans des dossiers sensibles et que le parquet est totalement indépendant !

Je partage le point de vue de M. Michel, mais je voterai néanmoins l’amendement de M. Mézard.
Vous entretenez la confusion à dessein, monsieur le garde des sceaux, …

… mais nous ne sommes pas dupes !
La notion d’autorité judiciaire est nécessairement ambiguë en droit français, puisqu’elle recouvre à la fois les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Tout le monde le sait, et il n’est nullement besoin d’épiloguer sur ce point.
La difficulté tient au fait que, dans la procédure que vous entendez perpétuer, c’est la partie poursuivante qui est chargée d’exercer le contrôle de la garde à vue. Là est l’ambiguïté ! Elle n’existe pas dans d’autres pays, où l’enquête est dirigée par un fonctionnaire, qui n’appartient donc pas à l’autorité judiciaire, à laquelle est confié le contrôle de la garde à vue.
En pratique, dans notre pays, l’officier de police judiciaire demande au procureur d’autoriser la garde à vue. Ce dernier donne son autorisation en se fiant aux seuls dires de l’OPJ, sans rien vérifier du tout. Par conséquent, tout se passe entre les deux personnes qui dirigent l’enquête : elles sont supposées contrôler en outre la garde à vue !

C’est précisément ce qui est reproché à notre procédure ! Cessez donc de prétendre que nous comprenons mal les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ou ce que recouvre la notion d’indépendance du parquet !
Nonobstant toutes les critiques formulées tant dans notre pays par les tenants d’un contrôle par un juge du siège que hors de nos frontières, vous persistez à vouloir confier le contrôle d’une mesure privative de liberté à ceux-là mêmes qui mènent l’enquête. Ce n’est pas ainsi que vous garantirez des droits aux personnes gardées à vue !

Il est beaucoup question, à l’heure actuelle, de conflits d’intérêts : en voilà un !

Il est tout de même extraordinaire que personne ne le relève ! En l’occurrence, il y a conflit d’intérêts dans la mesure où le procureur a la double fonction de poursuivre et de garantir les droits de la personne poursuivie.

C’est là toute l’ambiguïté du texte ! C’est ce point qui achoppera devant la Cour européenne des droits de l’homme. Si la mission du procureur est de poursuivre, il ne peut pas dans le même temps contrôler le respect des droits de la personne poursuivie. Il faut mettre un terme à ce conflit d’intérêts !

Tous les arguments méritent d’être entendus, mais je ne vois pas en quoi le fait d’être chargé d’exercer un contrôle entraînerait un conflit d’intérêts ! Sinon, il serait impossible d’assumer certaines fonctions.
Monsieur Mézard, j’ai apprécié que vous ayez quelque peu corrigé vos propos sur les procureurs.
De mon point de vue, il est plutôt positif que les parquets contrôlent les conditions de la garde à vue. D’ailleurs, s’ils exerçaient davantage cette mission, peut-être aurions-nous évité depuis longtemps que de telles mesures soient prononcées en aussi grand nombre, car les officiers de police judiciaire seraient tenus de justifier les demandes d’autorisation de placement en garde à vue qu’ils présentent. Si ce contrôle n’est pas toujours satisfaisant – je connais des procureurs qui sont extrêmement vigilants –, sans doute est-ce dû à un manque de moyens. Mon cher collègue, vous le savez bien, si le contrôle était confié au juge, il faudrait opérer une restructuration complète de l’ensemble du système.
Concernant la garde à vue, il s’agit d’assurer un contrôle par un magistrat, car les libertés publiques sont en jeu. Nous réaffirmons ce principe, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Les dispositions du texte constituent à mes yeux une avancée, contrairement à ce que certains disent. Simplement, monsieur le garde des sceaux, je souhaite qu’elles trouvent une traduction dans la réalité et que les parquets assument complètement leur mission de contrôle sur les gardes à vue décidées par les officiers de police judiciaire.
Quand nous aurons atteint cet objectif, je peux vous garantir que ce sera un grand progrès au regard des libertés publiques. Les magistrats ont le sens de ces dernières ; les officiers de police judiciaire aussi, en principe, mais il faudrait peut-être améliorer la formation de certains d’entre eux sur ce sujet.

La garde à vue, madame Borvo Cohen-Seat, est décidée non par le procureur, comme vous l’avez affirmé tout à l’heure, sans doute par mégarde, mais par l’officier de police judiciaire, sous le contrôle du procureur. Cela est très clair.

Évidemment, si le procureur décidait la garde à vue, on voit mal comment il pourrait aussi la contrôler.
Quant à la question de savoir si le contrôle devrait être assuré par un juge – qui ne pourrait être que le juge des libertés et de la détention – dès le début de la garde à vue, j’indiquerai simplement que nous nous sommes longuement interrogés sur ce point. Nous avons pesé les avantages et les inconvénients respectifs des différentes options : comme l’indique mon rapport, il est plus avantageux, notamment en termes de délais de procédure et de garanties, de confier le contrôle au procureur.
L’observation du travail des parquets sur le terrain, dans des juridictions de tailles extrêmement variées, m’a plutôt rassuré. J’ai également recueilli sur ce point l’avis d’un certain nombre d’avocats : en règle générale, ils ne se plaignent pas du contrôle exercé par le parquet. Pour des raisons théoriques, certains voudraient que cette fonction soit confiée au juge, mais je crois pouvoir dire que, en pratique, les choses se passent plutôt bien.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 69, présenté par MM. Anziani, Michel, Badinter et Sueur, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, M. Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
par les mots :
un ou plusieurs indices laissant présumer
La parole est à M. Alain Anziani.

L’amendement n° 69 est retiré.
L'amendement n° 105 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
plausibles
par le mot :
sérieuses
La parole est à M. Jacques Mézard.

L’alinéa 3 de l’article 1er prévoit que « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judicaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ».
Compte tenu de sa nature, la garde à vue doit rester une mesure exceptionnelle. Ce principe est fondamental, mais, pour l’heure, avec quelque 800 000 gardes à vue par an, il n’est guère respecté… Dans cette perspective, il nous semble préférable de prévoir que les raisons de soupçonner la personne devront être « sérieuses », l’adjectif « plausibles » ne paraissant pas assez fort. Il renvoie au champ lexical du vraisemblable, sinon du possible. À l’évidence, ce n’est pas suffisant pour garantir que le placement en garde à vue aura bien un caractère exceptionnel, surtout si le texte devait être adopté en l’état, c’est-à-dire si le recours à cette mesure devait être autorisé pour toute infraction passible d’une peine d’emprisonnement.
Nous souhaitons renforcer les critères de la garde à vue, sans toutefois faire peser de contraintes excessives sur les enquêteurs. Il nous apparaît donc indispensable que la garde à vue ne puisse être décidée qu’au vu d’éléments suffisamment sérieux, en d’autres termes beaucoup plus importants que ce que prévoit aujourd’hui le texte.
Certes, l’adjectif « plausible » figure aussi dans la loi Lebranchu de 2002 ou à l’article 5, paragraphe 1 c), de la Convention européenne des droits de l’homme. Mais nous rappelons que le paragraphe 3 de ce même article 5 de ladite convention précise bien qu’une personne détenue dans ces conditions « doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ».
Or, en l’état, l’article 1er du projet de loi confie au procureur de la République le contrôle de la garde à vue, alors que la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt Moulin c. France du 23 novembre dernier, a dit que le procureur ne pouvait être considéré comme un « magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ».
Dans ces conditions, il nous paraît important de relever le niveau des critères du placement en garde à vue.

C’est en 2002 que nous avons adopté la terminologie en question.
Nous avons bien fait de retenir cette formulation, puisque la notion de raisons plausibles figure à l’article 5, paragraphe 1 c), de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de Strasbourg a donné à cette notion un sens très précis : « Les soupçons sont plausibles lorsque les faits ou les renseignements sont propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir commis l’infraction. »
Je trouve pour ma part très sécurisant de conserver une notion qui non seulement a fait ses preuves au regard de la jurisprudence française, mais est de plus adossée à une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Je remercie M. Anziani d’avoir retiré son amendement, …

… et je suggère à M. Mézard d’en faire autant. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
Je partage tout à fait l’avis de M. le rapporteur, et je joins ma voix à la sienne pour prier M. Mézard de retirer son amendement, même si je connais déjà sa réponse !

Si le terme « plausibles » était efficace, 800 000 gardes à vue n’auraient pas été décidées l’an dernier dans notre pays… Par réalisme, je maintiens l’amendement.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 16 rectifié est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 106 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Après les mots :
d'une peine
insérer les mots :
supérieure ou égale à trois ans
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié.

Tout le monde semble souhaiter une diminution du nombre des gardes à vue, celles-ci ayant concerné, en 2008, 1 % de la population…
Cette dérive tout à fait inquiétante tient, bien entendu, à l’aggravation des sanctions pénales et au contexte politique, caractérisé par un discours sécuritaire et la mise en œuvre d’une politique du chiffre.
Dans ce contexte légal et politique, la rédaction du projet de loi ne nous semble pas suffisante pour atteindre l’objectif affiché par le Gouvernement, et partagé par tous, de réduire le nombre des gardes à vue.
Je voudrais plus particulièrement m’attarder sur la condition définie à l’article 62-3 du code de procédure pénale, qui prévoit que, pour pouvoir être placée en garde à vue, la personne doit être « soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ».
Comme le note très justement le Syndicat de la magistrature, cette disposition, présentée par le Gouvernement comme un gage de réduction du nombre des gardes à vue, aura en réalité une portée très limitée. En effet, seules 7 % des condamnations délictuelles prononcées le sont pour des infractions qui ne sont pas punies d’une peine d’emprisonnement. Force est donc de constater que le nombre de procédures concernées est minime ! D’ailleurs, les officiers de police judiciaires appliquent déjà cette règle dans la pratique.
Nous proposons de relever à trois ans le quantum de peine en deçà duquel il est impossible de placer une personne en garde à vue. Nous sommes parfaitement conscients des éventuels effets pervers que pourrait avoir l’instauration d’un tel seuil, eu égard notamment à la possibilité de voir rehausser, à terme, les peines encourues pour certaines infractions ou encore de constater un recours systématique à une « surqualification de la peine ».
Nous sommes également tout à fait conscients de l’inadaptation de l’échelle des peines, compte tenu de l’aggravation sécuritaire, qui a entraîné un alourdissement des peines sanctionnant divers délits, tels que l’occupation d’un hall d’immeuble, désormais susceptible de déboucher sur un emprisonnement… En revanche, il est vrai que d’autres infractions n’ont pas donné lieu à la même évolution, sans doute en raison d’un manque de visibilité médiatique.
Quoi qu’il en soit, l’instauration d’un tel seuil nous paraît être le moyen le plus efficace d’obtenir une diminution significative du nombre des gardes à vue, sans que cela nuise aucunement aux enquêtes.
En adoptant cet amendement, le Sénat enverrait un véritable message et montrerait qu’il est attaché à faire de la garde à vue une mesure de contrainte exceptionnelle. Pour l’heure, une peine d’un an de prison pouvant s’appliquer à toutes sortes de délits, la garde à vue ne saurait être une mesure d’exception.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 106 rectifié.

Cet amendement est extrêmement important.
Je regrette que la commission ait suivi le Gouvernement, car prévoir la possibilité de placer en garde à vue toute personne soupçonnée d’avoir commis un délit puni d’une peine d’emprisonnement, quelle que soit sa durée, contredit complètement l’objectif affiché au travers de ce projet de loi.
Une nouvelle fois, vous marchez à reculons, …

… au lieu d’adopter une vision prospective, innovante du droit pénal.
M. le rapporteur nous a affirmé que si l’on fixait le seuil à trois années d’emprisonnement, il ne pourrait pas y avoir de placement en garde à vue dans le cas de certaines atteintes sexuelles. Je pourrais tirer du code pénal des exemples d’infractions réprimées par des peines d’emprisonnement de cinq ans ou plus qui feraient sourire notre assemblée… Je pense en particulier aux jeux, à la pêche maritime et à bien d’autres domaines encore. Il faudrait revoir tout cela, car une telle échelle des peines n’a plus guère de sens.
En tout cas, considérer que le placement en garde à vue doit être possible quel que soit le quantum de la peine d’emprisonnement encourue, ce n’est pas aller dans le sens de la décision du Conseil constitutionnel et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
En effet, dans sa décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel avait fondé la censure des articles 62, 63-1 et autres du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue sur le fait que l’évolution de la pratique avait contribué à en banaliser l’usage, de telle sorte que la procédure était devenue déséquilibrée au détriment de la personne gardée à vue. Il avait notamment relevé que la garde à vue pouvait être prolongée sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité.
Nous sommes vraiment là au cœur du débat.
Monsieur le ministre, si vous voulez réellement réduire le nombre des gardes à vue, dont l’augmentation est devenue intolérable et va à l’encontre d’une bonne administration de la justice, ce n’est pas en refusant de fixer un seuil de peine encourue que vous y parviendrez.
Il est illusoire d’affirmer que limiter la garde à vue aux seules infractions passibles d’emprisonnement en fera diminuer le nombre. Nous savons tous que seuls 7 % des délits ne sont pas punis d’emprisonnement et qu’il s’agit d’infractions mineures, comme les outrages les moins graves ou le défaut d’assurance. Il s’agit donc d’être raisonnables, tout simplement.
Quand M. le rapporteur nous dit que fixer un quantum de peine risquerait d’entraîner un développement sans frein du recours à la prétendue audition libre prévue à l’article 11 bis, il nous fait un aveu : s’il soutient cet argument irrecevable, cela signifie que, hors de la garde à vue, il n’existe aucune garantie pour les personnes mises en cause ni aucun respect de la liberté individuelle.
Dans l’intérêt général, dans l’intérêt des forces de l’ordre et dans celui de la justice, il convient d’aller dans le sens que nous proposons, car c’est le sens de la mesure, monsieur le garde des sceaux. Puisque vous entendez être un homme d’équilibre et de mesure, suivez-nous sur ce point !

L'amendement n° 71, présenté par MM. Anziani, Michel, Badinter et Sueur, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, M. Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
d'emprisonnement
par les mots :
égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou, en cas de délit flagrant, d'une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement
La parole est à M. Alain Anziani.

Nous sommes sans doute tous d’accord sur le principe que la garde à vue, mesure privative de liberté, doit être proportionnée à la gravité des faits. Cependant, il convient de déterminer comment nous déclinons ce principe. Dans certains pays, des seuils de peine d’emprisonnement ont été fixés : deux ans en Italie, cinq ans en Espagne, par exemple. C’est une possibilité.
Vous faites d’ailleurs un pas modeste dans cette voie, puisque, aux termes du droit actuel, on peut être placé en garde à vue sans même qu’une peine d’emprisonnement soit encourue. Toutefois, ce n’est pas suffisant, dans la mesure où il est peu d’infractions qui ne soient pas punies d’une peine d’emprisonnement.
Par conséquent, il nous semble souhaitable de prévoir un seuil. Nous proposons de le fixer à trois ans, par cohérence avec le seuil en vigueur en matière de détention provisoire, ou à un an en cas de flagrant délit. Certes, je ne nie pas que la fixation d’un tel seuil puisse entraîner des effets pervers, évoqués par M. le rapporteur, mais ceux-ci sont sans doute liés à l’inadaptation de l’échelle des peines, qu’il conviendrait de revoir. Cela n’est pas simple, je le concède, mais c’est une nécessité au regard de la rationalité de l’ensemble de notre code pénal. En tout cas, il ne faut pas, au nom de cette difficulté, tourner le dos au principe de proportionnalité.

L'amendement n° 99 rectifié quinquies, présenté par MM. Vial et Houel, Mme B. Dupont, MM. J. Gautier, Milon, Cléach et Dulait, Mme Lamure, MM. Doublet, Laurent, Portelli, Doligé, Bernard-Reymond, Hérisson, Leclerc, B. Fournier, Trillard, Gouteyron et Alduy et Mme Papon, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Après le mot :
emprisonnement
insérer les mots :
d’une durée supérieure ou égale à trois ans
II. - Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois elle peut être décidée quelle que soit la durée de la peine en cas de flagrant délit contre les personnes ou les biens.
La parole est à M. Hugues Portelli.

Je relève que, en 2004, le Conseil constitutionnel avait jugé les mêmes dispositions parfaitement conformes à la Constitution. C’est l’évolution de la politique pénale et l’augmentation exponentielle du nombre des gardes à vue qui l’ont amené depuis à changer d’avis…

D’ailleurs, cette évolution a eu pour effet pervers qu’il a fallu plus que doubler le nombre d’officiers de police judiciaire, au point parfois d’accorder cette qualification à des gens qui n’avaient pas forcément reçu toute la formation nécessaire, y compris juridique, pour exercer la prérogative qui leur était octroyée.
Un vrai problème se pose donc. Ces amendements visent à garantir une diminution drastique du nombre des gardes à vue. On sait très bien que, de toute façon, une grande partie des personnes placées en garde à vue sont finalement relaxées, après avoir néanmoins subi une situation extrêmement dommageable. Atteindre cet objectif permettrait, parallèlement, de réduire le nombre des officiers de police judiciaire.
M. le rapporteur nous a très brillamment objecté, en commission, que le code pénal est fait – ou défait ! – de telle manière que l’échelle des peines est en fait assez arbitraire et que, parfois, des peines d’emprisonnement assez légères sanctionnent des infractions relativement graves, et inversement.
Mais là n’est pas le problème : cette loi devra être appliquée, or elle ne pourra l’être si nous ne fixons pas un seuil. Si le nombre des gardes à vue demeure élevé, les personnes concernées seront accueillies dans des lieux inadaptés, car on sait très bien que l’on n’aura jamais le temps de remettre aux normes tous les locaux de garde à vue. Des procédures seront alors annulées, et des recours seront formés devant la Cour de cassation, qui sera obligée d’appliquer la jurisprudence de la CEDH, beaucoup plus dure que celle du Conseil constitutionnel, lequel avait accordé au législateur un délai pour des considérations d’ordre public…
Nous pourrions alors nous trouver dans la situation où une loi votée par le Parlement et déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel serait sanctionnée par la Cour de cassation !

Aujourd’hui, on peut être placé en garde à vue pour toutes sortes d’infractions, sauf en cas d’enquête de flagrance. La garde à vue peut ainsi être décidée pour des contraventions, pour toutes sortes de délits qui ne sont pas susceptibles d’être sanctionnés par une peine d’emprisonnement.
Le texte qui vous est soumis introduit deux limites importantes.
En premier lieu, il exclut du champ de la garde à vue toutes les infractions qui ne sont pas punies d’une peine d’emprisonnement.

Dans un certain nombre de cas, oui, malheureusement !
En second lieu, le texte prévoit que la prolongation de la garde à vue ne sera possible que si la personne encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an.
Cette double restriction introduite par le texte constitue un changement considérable.
Comme je l’ai déjà dit en commission et à la tribune, si nous suivions les auteurs des amendements, la fixation d’un seuil écarterait de la garde à vue des infractions qui présentent un caractère de réelle gravité et qui peuvent justifier une telle mesure.
Ainsi, sont punis de moins de trois ans d’emprisonnement et seraient donc exclus du dispositif de la garde à vue les atteintes sexuelles sur un mineur de plus de 15 ans commises par un ascendant ou une personne ayant autorité, les atteintes à la vie privée, la soustraction des parents à leurs obligations légales, le harcèlement sexuel ou moral, la mise en danger de la vie d’autrui, les propositions sexuelles à un mineur par internet, les infractions liées aux dérives du bizutage, les atteintes au respect dû aux morts, le délit de fuite, les destructions ou dégradations d’un bien appartenant à autrui, ainsi qu’un certain nombre de délits d’outrage. Convenez que cela mérite réflexion, d’autant que cette liste n’est pas exhaustive !
Par ailleurs, fixer un seuil de trois ans d’emprisonnement entraînerait obligatoirement une diminution des droits des personnes mises en cause. En effet, en l’absence de garde à vue, l’avocat n’interviendrait plus. On assisterait à un développement des auditions libres, dont vous ne voulez pas plus que moi.

Si l’amendement n° 67, que nous avons examiné précédemment et qui visait à prévoir que toute personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction ne pourrait être interrogée sans avoir eu la possibilité de s’entretenir avec un avocat ou d’être assistée par lui, avait été adopté, la garde à vue aurait pu être réservée à un nombre limité d’infractions. Mais, dès lors qu’il n’a pas été voté, …

… l’adoption des amendements en discussion aurait pour effet de restreindre les droits des personnes mises en cause.
Au terme d’échanges nourris, la commission a donc émis un avis défavorable sur ces quatre amendements.
Je partage l’objectif des auteurs de ces amendements, qui est de diminuer fortement le nombre des gardes à vue. Sur ce point, nous sommes tous d’accord.
En revanche, nous divergeons sur la méthode à employer pour y parvenir. Comme l’a dit M. Badinter lors de la discussion générale, tout est affaire de proportionnalité, et le procureur aura la responsabilité de veiller à ce que la mesure soit proportionnée à la gravité des faits. Il devra décider au cas par cas s’il est ou non justifié de recourir à la garde à vue, car il n’y a pas de règle générale, pas d’automaticité en la matière. C’est bien pour cette raison que le procureur doit exercer un contrôle effectif sur les motifs de la décision de placement en garde à vue, comme l’a souligné M. Hyest.
Fixer un quantum de peine ne serait pas compris par la population, qui n’admettrait pas que, de façon générale et absolue, il ne soit pas possible de placer en garde à vue les auteurs de faits de rébellion, d’outrages, d’exhibitions sexuelles, d’infractions à la législation sur les étrangers, de refus d’obtempérer, de violations de domicile, de délits de fuite, de délits de détention de faux documents administratifs ou de détention d’images de mineurs présentant un caractère pornographique. Il faut faire confiance au magistrat chargé de contrôler la garde à vue. Ne tombons pas dans un système automatique : chaque situation doit pouvoir être jugée in concreto !
Très honnêtement, la méthode proposée par les auteurs des amendements ne me semble pas être la bonne. Nos débats de ce soir pourront peut-être servir de base à la rédaction d’une instruction destinée à expliquer tout cela, en insistant notamment sur la notion de proportionnalité et sur l’absence d’automaticité, aux procureurs généraux, qui veilleront ensuite à ce que les procureurs chargés de contrôler les gardes à vue œuvrent dans l’esprit que je viens de définir devant la Haute Assemblée.
Au bénéfice de cet engagement, je demande aux auteurs des amendements de bien vouloir les retirer.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote sur les amendements n° 16 rectifié et 106 rectifié.

Monsieur le garde des sceaux, nous sommes nous aussi sensibles aux craintes de l’opinion publique.
Cela étant, le placement en détention provisoire n’est déjà pas possible quand la peine encourue est inférieure à trois ans d’emprisonnement. La personne concernée comparaît libre.
Par ailleurs, la plupart des infractions que vous avez citées relèvent du flagrant délit. Or, dans ce cas, notre amendement prévoit que le quantum de peine ne soit que d’un an d’emprisonnement, car les faits, commis en public, choquent la population. La garde à vue est alors possible.

Il a suffi que nous annoncions une réforme pour que l’on enregistre une diminution de 10 % !

Si cela suffisait, cela aurait été fait depuis longtemps, et nous n’en serions pas là aujourd'hui !
Vous avez mis la barre trop bas, et vous le savez bien, par peur de réactions dans l’opinion publique et parmi les professionnels, alors que ceux-ci sont unanimes pour estimer que la situation est devenue inacceptable, insupportable, d’abord pour eux-mêmes.
En prévoyant, à l’article 2, que la prolongation de la garde à vue ne sera possible que si la personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction punie d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an, vous reconnaissez implicitement que vous n’êtes pas sur le bon chemin…

Vous pourriez faire un effort et envoyer un signal positif, qui témoignerait de la sincérité de votre intention de diminuer le nombre des gardes à vue.

Monsieur le rapporteur, les arguments que vous avez avancés ne valent que lorsque la personne encourt une peine d’emprisonnement. Sinon, elle ne dispose pas de plus de garanties dans votre système.
Par ailleurs, dans les pays où un quantum de peine a été fixé en matière de garde à vue, les exhibitionnistes, les harceleurs sexuels et autres délinquants relevant des catégories que vous avez citées sont-ils pour autant moins punis qu’en France ?
Enfin, qu’insinuez-vous, monsieur le garde des sceaux, en invoquant les réactions de la population ? Que les délinquants ne seront pas punis s’ils n’ont pas été placés en garde à vue ? C’est de la propagande ! Il suffit d’expliquer clairement que la punition et l’emprisonnement ne sont pas liés à la garde à vue !

Monsieur le ministre, vos arguments m’étonnent quelque peu.
Alors que nous débattons de l’équilibre entre le respect des libertés individuelles et les nécessités de l’enquête, vous nous avez indiqué, à deux reprises, que votre attitude, en tant que garde des sceaux, garantissait le maintien de cet équilibre.

Ainsi, le fait que vous n’ayez jamais donné d’instructions aux procureurs depuis votre prise de fonctions, somme toute récente, garantirait selon vous leur indépendance ! Mais, à mes yeux, seule la loi peut la garantir !
Dans le même esprit, à vous en croire, le nombre des gardes à vue va baisser parce que vous allez adresser une instruction en ce sens aux procureurs généraux !
Permettez-moi de vous dire que le comportement d’un ministre, aussi exemplaire soit-il, n’apporte aucune garantie ! La seule garantie, c’est la loi !

Je mets aux voix les amendements identiques n° 16 rectifié et 106 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 99 rectifié quinquies.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 169 :
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 70, présenté par MM. Anziani, Michel, Badinter et Sueur, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, M. Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La confirmation du placement en garde à vue par le procureur de la République intervient sous quatre heures.
La parole est à M. Alain Anziani.

Cet amendement vise à prévoir que la garde à vue décidée par l’officier de police judiciaire sera confirmée par le procureur de la République dans un délai de quatre heures.

La rédaction proposée par M. Anziani réduirait les droits du gardé à vue, dans la mesure où certains procureurs pourraient être tentés de n’intervenir qu’au bout de quatre heures, alors qu’aujourd’hui ils doivent contrôler la garde à vue immédiatement.
Par conséquent, la commission n’est pas favorable à cet amendement.

Monsieur le président, je rectifie cet amendement afin de préciser que la confirmation du placement en garde à vue par le procureur de la République doit intervenir au plus tard au bout de quatre heures.

Je suis donc saisi d’un amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Anziani, Michel, Badinter et Sueur, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, M. Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La confirmation du placement en garde à vue par le procureur de la République intervient au plus tard au bout de quatre heures.
Veuillez poursuivre, monsieur Michel.

Permettez-moi de profiter de cette rectification pour répondre au propos de notre cher rapporteur sur les officiers de police judiciaire.
Monsieur Zocchetto, les OPJ n’ont aucun pouvoir propre et ne décident de rien.

Non, ils sont sous l’autorité du procureur de la République et n’ont pas de pouvoir propre.
Par conséquent, quand ils prennent la décision de placer en garde à vue, c’est en fait le procureur de la République qui décide. Ensuite, il faut l’intervention d’un juge.

La rectification ne modifie pas l’avis de la commission, qui reste défavorable à l’amendement.
Monsieur Jean-Pierre Michel, il s’agit d’une question que nous avons étudiée. La garde à vue doit-elle être décidée par l’officier de police judiciaire ou sur instruction du procureur ? Nous en sommes restés au système actuel : l’officier de police judiciaire décide le placement en garde à vue.
Monsieur Jean-Pierre Michel, il faut distinguer deux cas : le contrôle et l’habilitation.
Il est tout à fait exact que les officiers de police judiciaire sont sous le contrôle du procureur de la République. Toutefois, l’article 63 du code de procédure pénale précise bien que « L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. ». Par conséquent, les officiers de police judiciaire ont un pouvoir propre.
On peut toujours échanger des arguments. Mais, même si j’ai moins rédigé d’articles du code que vous-même et donc moins commis de péchés que vous en matière pénale, je maintiens qu’un pouvoir propre est reconnu à l’officier de police judiciaire.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 108 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, la personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un délit flagrant puni par une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à six mois d’emprisonnement peut être placée en garde à vue. Cette mesure fait l'objet d'une décision motivée du juge des libertés et de la détention et ne peut être utilisée que si elle est l'unique moyen de procéder à la vérification d'identité du suspect, de faire cesser la commission de l'infraction sous réserve de l'application de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique, ou de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République aux fins de mettre ce magistrat en mesure d'apprécier la suite à donner à l'enquête.
La parole est à M. Jacques Mézard.

L’efficacité du travail des forces de l’ordre et des magistrats peut justifier, dans certaines conditions très précises, qu’une personne soit placée en garde à vue, même si les faits dont elle est soupçonnée sont punis de moins de trois ans d’emprisonnement conformément à ce que nous proposions.
Cet amendement a donc pour objet d’établir un tel dispositif placé sous l’appréciation du juge des libertés et de la détention, lequel devra, le cas échéant, motiver sa décision.

Monsieur Jacques Mézard, dans mon extrême bonté, je vous ai laissé présenter cet amendement qui, en vérité, n’a plus d’objet...
Je vous présente toutes mes excuses, monsieur le président de la commission.
Cela s’appelle le supplice de Vénissieux !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le tout est de ne pas faire de récidive !
Sourires
Nouveaux sourires.

L’amendement n° 108 rectifié n’a donc plus d’objet.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 17, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Après les mots :
le contrôle
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
du juge des libertés et de la détention ou, à défaut, du président du tribunal de grande instance ou de son délégué.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 72, présenté par MM. Anziani, Michel, Badinter et Sueur, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, M. Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 12, première phrase
Remplacer le mot :
Quarante-huitième
par le mot :
vingt-quatrième
La parole est à M. Alain Anziani.

Cet amendement ne tombant pas, j’ose vous demander encore un petit effort, monsieur le garde des sceaux !
Il tend à prévoir que la prolongation de la garde à vue au-delà de vingt-quatre heures relève du juge des libertés et de la détention.
Nous l’avons dit, dans le contexte actuel et avec les moyens dont on dispose, après ce délai, il nous semble que la décision doit revenir au juge naturel de la détention : le juge judiciaire.

L'amendement n° 175, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 12, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. - En conséquence, alinéa 13
Remplacer les mots :
Ce magistrat
par les mots :
Le procureur de la République
La parole est à M. le rapporteur pour présenter l'amendement n° 175 et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 72.

L’amendement n° 175 vise à clarifier la rédaction des alinéas 12 et 13 de l’article 1er.
Pour des raisons déjà longuement évoquées, la commission ne peut accepter l’amendement n° 72, car elle est défavorable au fait d’avancer le contrôle effectué par le juge des libertés et de la détention à la vingt-quatrième heure plutôt qu’à la quarante-huitième heure.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme elle-même, le juge du siège ne doit intervenir qu’à la quarante-huitième heure. Par conséquent, nous sommes parfaitement dans ce délai, que les États membres peuvent aménager à leur guise.
Nombre d’entre eux ont choisi, pendant ce délai, de confier la garde à vue uniquement aux forces de police. La France choisit, si le Sénat le veut bien, de confier le contrôle à un magistrat, ce qui est quand même un peu mieux. Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n° 72 de M. Anziani.
En revanche, il est favorable à l’amendement n° 175 de la commission.

Je souhaite effectivement expliquer mon vote sur l’amendement n° 175 de la commission. Mais, auparavant, permettez-moi de clore une discussion que j’ai eue avec M. le garde des sceaux.
Je soutiens que le parquet est hiérarchisé et qu’il est indivisible. Par conséquent, même les substituts n’ont pas de pouvoir propre. Ils agissent à la place du procureur de la République.
Il en est de même des officiers de police judiciaire qui les assistent, même s’ils prennent la décision. Aucune disposition du code de procédure pénale n’y changera rien : c’est la pyramide ! Le procureur de la République du tribunal est le seul à avoir le pouvoir et, dans la conduite de l’action publique, il n’est même pas placé sous l’autorité du procureur général. Que les choses soient claires !
S’agissant de votre amendement, monsieur Zocchetto, c’est le bouquet, le fin du fin ! Il reviendrait au procureur de la République – je passe sur le reste… –, partie poursuivante, décidant de la garde à vue ou de sa prolongation, de délimiter les droits de la défense. C’est absolument ubuesque !
Le texte était flou mais, dans votre grande rectitude et honnêteté, vous voulez l’éclaircir et précisez que c’est le procureur de la République qui « assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue ».

Par conséquent, celui-ci tout à la fois poursuit et assure la protection de la défense.

Franchement, les bras m’en tombent ! Cela ne veut strictement rien dire !
Le procureur de la République n’a pas à contrôler le respect des droits de la défense – encore serait-il un juge du siège… Il n’a aucun pouvoir en la matière, même pas un pouvoir disciplinaire !
En définitive, monsieur Zocchetto, vous êtes trop honnête : il valait mieux rester dans l’ambiguïté !

Je suis très heureux que M. Jean-Pierre Michel reconnaisse mon exigence de clarté vis-à-vis du texte. En effet, nous assumons complètement la rédaction du projet de loi, telle qu’elle a été retenue par la commission des lois. Il était nécessaire, à ce stade de nos travaux, de préciser quel était le magistrat concerné, en l’occurrence le procureur de la République.
Mais j’aurais presque pu vous proposer une autre solution, mes chers collègues, à savoir la suppression de l’alinéa 14 de l’article 1er. Cette disposition me semble effectivement aller de soi. Cela a déjà été expliqué longuement, dès lors que le procureur de la République est un magistrat et que, selon la Constitution, l’autorité judiciaire protège la liberté individuelle, nous aurions normalement pu nous passer d’ajouter qu’il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il s’agit simplement d’une précision supplémentaire, qui clarifie le texte et, de ce fait, m’apparaît bonne.
Par ailleurs, mes chers collègues de l’opposition, vous ne cessez de parler de partie poursuivante. Ce n’est vraiment pas le sujet ! En outre, tout comme, précédemment, l’auto-incrimination, ce terme fait référence à des procédures anglo-saxonnes. À un moment, il va nous falloir réécrire toutes ces notions en français, car nous en arrivons à des confusions entre les procédures anglo-saxonnes de type accusatoire et notre procédure pénale en vigueur et ces différentes notions finissent par s’entrechoquer. Nous voyons bien les limites de l’exercice…
Donc, ne parlez plus de partie poursuivante, en tout cas dans ce débat sur la garde à vue.
À ce stade de l’intervention du parquet, qui ne fait qu’assurer le contrôle de la garde à vue, je ne conçois pas le procureur de la République comme une partie poursuivante.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 107 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il apprécie également si l’exécution de la mesure se fait dans des conditions compatibles avec le principe du respect de la dignité de la personne.
La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement peut être considéré comme une rustine, mes chers collègues, car, manifestement, son adoption n’apporterait qu’une très légère amélioration au malheureux texte qui nous est proposé.
Exclamations.

Dans sa décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a posé le principe selon lequel il appartenait aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire compétentes de « veiller à ce que la garde à vue [fût], en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne ». Je considère que ce principe doit être affirmé dans la loi.
Permettez-moi également d’indiquer que, s’agissant du très intéressant débat entre M. le garde des sceaux et notre collègue Jean-Pierre Michel, ce dernier a bien raison.
En effet, l’article 12 du code de procédure pénale, qui est une des bibles du garde des sceaux, établit ce que nous savons tous : « La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre ». Selon l’article 13 du même code, traitant de la cour d’appel, « la police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d’appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction conformément aux articles 224 et suivants ».
D’ailleurs, il y aurait peut-être lieu à modifier et améliorer les dispositions de cet article 224.

J’ai démontré que Jean-Pierre Michel a tout à fait raison sur ce point.

M. Jacques Mézard est vraiment un perfectionniste !
En effet, l’article 8 du projet de loi tend à prévoir que « la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne ». Vous n’allez pas remettre en cause ce point, mes chers collègues. On peut donc considérer, dès à présent, que vous voterez cet article.
Il est en outre précisé, à l’alinéa 14 de l’article 1er, que « le procureur de la République assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue ».
Le procureur de la République garantit donc obligatoirement le respect de la dignité de la personne pendant sa garde à vue. Nous n’avons pas besoin de le dire deux fois !
C’est pourquoi, monsieur Mézard, je vous suggère de retirer votre amendement.
J’estime que M. Jacques Mézard a entièrement satisfaction. Le texte est clair et l’adoption de cet amendement en affaiblirait la portée. L’avis du Gouvernement est donc naturellement défavorable.

Je constate que M. le ministre ne souhaite pas que cette référence à la dignité de la personne figure dans l’article 1er du projet de loi, ce qui aurait tout de même été beaucoup plus significatif. Néanmoins, pour ne pas prolonger les débats, j’accepte de retirer mon amendement.

L’amendement n° 107 rectifié est retiré.
L'amendement n° 64, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art... - La garde à vue constitue le support nécessaire du défèrement. »
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Il ressort d’une jurisprudence constante que les actes subséquents à la garde à vue annulée ne sont touchés par la nullité que pour autant que la garde à vue en constitue le support nécessaire.
Or si la chambre criminelle considère que l’inobservation des droits énoncés par le code de procédure pénale est susceptible d’entraîner la violation de la garde à vue, elle a une conception restrictive des conséquences de l’annulation sur les autres actes de procédure.
Le projet de loi tend à accorder, en conformité avec les obligations conventionnelles de la France, des droits à la personne placée en garde à vue. Néanmoins, il ne prévoit aucune disposition sur la sanction de la violation de ces droits. La jurisprudence en la matière reste donc la règle.
Il serait utile de donner une cohérence au système en précisant que la garde à vue est le support nécessaire au défèrement.
Comme le note très justement le syndicat de la magistrature, le régime des nullités est très stratégique, car c’est lui qui permet de passer des droits formels aux droits réels. Sans lui, rien n’incite les enquêteurs et les magistrats à se conformer à la loi.
Tel est l’objet de notre amendement.

Votre proposition, madame Borvo Cohen-Seat, n’est pas parfaitement claire et nous avons réellement eu du mal, les uns et les autres, à vous suivre.
Vous proposez, si j’ai bien compris, qu’il ne puisse pas y avoir de défèrement sans qu’une garde à vue ait été effectuée au préalable. Or vous savez qu’un certain nombre de présentations au parquet se font sans garde à vue. On ne peut pas se plaindre du nombre trop important de gardes à vue et, dans le même temps, vouloir rendre cette mesure systématique alors qu’elle n’est pas toujours utile.
Par conséquent, je ne comprends pas très bien votre proposition et ne verrai pas d’inconvénient à ce que vous retiriez cet amendement.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’exclame.

Celui-ci, quant à lui, me paraît aller à l’encontre des thèses que vous défendez.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1 er est adopté.
Les articles 63 et 63-1 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 63. – I. – Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-3, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° du I de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
« II. – La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
« Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-3.
« L’autorisation ne peut être accordée qu’après présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.
« III. – L’heure du début de la mesure est fixée, le cas échéant, à l’heure à laquelle la personne a été appréhendée.
« Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure.
« Art. 63 -1. – I. – La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits :
« 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
« 2° De la nature et de la date présumée de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
« 3° Du fait qu’elle bénéficie :
« – du droit de faire prévenir un proche et son employeur, conformément à l’article 63-2 ;
« – du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
« – du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
« – du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
« Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
« Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
« Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
« II. –
Supprimé

En faisant du droit au silence une exigence à valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 30 juillet 2010, imposé un revirement législatif. Dès lors, le projet de loi qui nous est soumis tend naturellement à rétablir ce droit.
L’histoire chaotique du droit au silence au cours de la garde à vue est à l’image de la conception française consistant à rendre antinomiques les impératifs de préservation de l’efficacité de l’enquête et les impératifs de protection de la présomption d’innocence et des droits de la défense. Cette conception doit aujourd’hui être dépassée.
Le rétablissement du droit au silence constitue une petite avancée dans ce sens, bien que nous regrettions – une fois n’est pas coutume – que le Gouvernement n’envisage pas cette fois-ci de suivre son « modèle » d’outre-Atlantique. Celui-ci conçoit effectivement le droit au silence, droit érigé en principe constitutionnel, de manière beaucoup plus large, cette notion comprenant non seulement le droit de se taire, mais également celui de ne pas être interrogé.
Par ailleurs, il est consternant de voir, à la lecture de cet article 2, les pouvoirs qui sont dévolus à l’officier de police judiciaire.
L’officier de police judiciaire décide seul du placement en garde à vue et celle-ci est prolongée à sa seule demande, certes sous le contrôle théorique du parquet – cela nous a été dit et redit au moment de l’examen de l’article 1er –, mais un parquet dont l’information est assurée par le même officier de police judiciaire. Ainsi, le placement en garde à vue, pour vingt-quatre heures ou plus, se fait sur l’initiative et sous le contrôle quasi-exclusif de la police, le parquet ne portant sur l’affaire qu’un regard lointain.
Cette remarque ne doit pas nous amener à voir de la défiance systématique envers les forces de l’ordre. Il s’agit uniquement de nous interroger sur la place réelle qui est accordée, dans notre société, à un principe aussi fondamental que celui du droit à la sûreté, entendu comme le droit d’aller et venir sans être détenu arbitrairement.
Une prise en compte réelle de ce principe impliquerait idéalement que le gardé à vue soit interrogé par un magistrat. Toutefois, au vu du contenu du projet de loi que vous nous soumettez, monsieur le ministre, je crois que ce souhait est aujourd’hui proche de l’utopie.
Cet article 2 est également consternant en ce qu’il n’intègre pas réellement tous les enseignements de la décision rendue par le Conseil constitutionnel. Selon celle-ci, les textes en vigueur violent effectivement la Constitution dans la mesure où la prolongation de la garde à vue n’est pas réservée aux « infractions présentant une certaine gravité ».
Loin de là, le projet de loi tend à réserver le placement en garde à vue à tous les crimes et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement. Quant à la prolongation de la garde à vue, elle concernerait ceux qui sont punis d’une peine de prison supérieure ou égale à un an, puisque – hélas ! les amendements déposés à ce sujet n’ont pas été adoptés.
Vous devez prendre conscience, monsieur le ministre, que, comme l’écrit très justement l’un des auteurs ayant porté un regard critique sur votre projet, les mots ont un sens. Lorsqu’il est précisé que la prolongation doit être réservée aux « infractions présentant une certaine gravité », vous vous devez tout de même de respecter ces exigences.

L'amendement n° 18, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
procureur de la République
Insérer les mots :
après autorisation du juge des libertés et de la détention
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 19, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase :
Remplacer les mots :
, du placement de la personne en garde à vue.
par les mots et une phrase ainsi rédigée :
garantissant l'information réelle et personnelle de ce magistrat, du placement de la personne en garde à vue. Il procède également à un premier compte rendu téléphonique d'étape auprès du procureur de la République entre la huitième et la douzième heure de la garde à vue.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Nous avons déjà eu l’occasion de le dire à de nombreuses reprises depuis le début de ce débat, le nombre de gardes à vue n’a cessé d’augmenter, tout comme leur durée ! Voilà qui a créé un surplus de travail considérable pour les OPJ et a entraîné un allongement de la durée des enquêtes.
Le temps de la garde à vue est également lié aux interventions du directeur d’enquête, c'est-à-dire du procureur de la République. Certaines décisions pourraient intervenir plus rapidement si ce magistrat était effectivement informé de la mise en œuvre de cette procédure. Depuis la loi sur le renforcement de la présomption d’innocence, les OPJ doivent prévenir le parquet immédiatement et non plus sans délai lorsqu’ils placent un suspect en garde à vue. Cette précision avait été apportée afin que la notification du placement en garde à vue n’arrive plus dans un bureau vide sur un télécopieur qui n’est relevé que le matin. Or, il semblerait que ce soit, hélas ! encore le cas.
Par notre amendement, nous demandons que les moyens mis en place soient utilisés de manière immédiate – c’est déjà le cas – et qu’ils aboutissent à une information réelle et personnelle du parquetier.
Nous proposons qu’il soit procédé à un compte rendu téléphonique d’étape entre la huitième et la douzième heure de la garde à vue, afin d’inciter les enquêteurs à terminer dans ce délai les enquêtes les plus simples.

Madame Mathon-Poinat, le projet de loi présente d’ores et déjà des avancées concernant le contenu de l’information qui doit être transmise par l’OPJ au parquet. C’est ainsi que l’OPJ devra désormais préciser les motifs justifiant la garde à vue, ainsi que la qualification des faits notifiée à la personne.
Vous souhaitez également une information « réelle et personnelle » du procureur. M. Michel a rappelé tout à l’heure, à juste titre, que le parquet était indivisible. Nul ne peut contester que l’information du substitut vaut information du procureur.
Le compte rendu téléphonique d’étape, lui, est établi presque systématiquement en cas de difficulté ou lorsque l’OPJ est désemparé quant aux suites à donner à un dossier. Je l’ai souvent constaté lors des stages ou des visites que j’ai effectuées dans les services du parquet : les OPJ téléphonent souvent plusieurs fois au parquetier de permanence pour échanger avec lui des informations. La pratique va donc bien au-delà de ce que vous proposez.
Dans ces conditions, je vous suggère, ma chère collègue, de retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
Madame la sénatrice, je comprends votre souci de faire en sorte que le procureur soit le mieux informé possible. Mais l’amendement tel qu’il est rédigé n’ajoute rien à l’état actuel du droit.
La possibilité d’un avis par télécopie, y compris la nuit, a été validée par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2001. Cette possibilité a été rappelée par la circulaire du 4 décembre 2000 de Mme Guigou et dans celle du 10 janvier 2002 de Mme Lebranchu.
Ces deux circulaires précisent qu’il ne peut être recouru à la télécopie que dans les procédures ne posant pas de difficultés et qu’une information téléphonique doit intervenir. Vous avez donc déjà entièrement satisfaction.
Pour cette raison, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 149 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sous peine de nullité de la mesure, le juge des libertés et de la détention rend, avant l'expiration des six premières heures de garde à vue, une décision écrite confirmant la garde à vue.
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 109 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sous peine de nullité de la mesure, le procureur de la République rend, avant l'expiration des six premières heures de garde à vue, une décision écrite confirmant la garde à vue.
La parole est à M. Jacques Mézard.

Nombreux sont ceux qui évoquent des « avancées » en parlant de ce projet de loi. Mais cela signifie qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, sinon vous auriez dit que le résultat était atteint, ce qui – nous en sommes tous conscients – n’est pas le cas !
Il s’agit d’un amendement de repli. Si le JLD ne peut intervenir pour apprécier la légalité du placement en garde à vue, il est indispensable que le procureur de la République puisse exercer un véritable contrôle.
Contrairement à ce qui a été affirmé à plusieurs reprises au cours de ce débat, le contrôle est aujourd'hui extrêmement difficile et rare. Il est vrai que certains procureurs de la République procèdent par sondages et se déplacent dans les commissariats et dans les gendarmeries. Mais avec 800 000 gardes à vue, il est évident qu’ils ne peuvent pas effectuer un contrôle digne de ce nom de manière systématique. La situation est en réalité très variable selon les territoires et la personnalité des parquetiers.
En instituant une décision écrite de confirmation de la garde à vue, cet amendement va dans le bon sens : il devrait permettre de contribuer à limiter le nombre de gardes à vue, ce qui est notre souhait commun.

Monsieur Mézard, l’amendement n° 70 rectifié présenté à l’article 1er par M. Anziani était d’inspiration similaire au vôtre, si ce n’est qu’il faisait référence aux quatre premières heures, au lieu des six premières heures. C'est la raison pour laquelle votre amendement n’est pas devenu sans objet du fait du rejet de celui de M. Anziani, mais vous comprendrez que mon avis soit là aussi défavorable, pour les raisons que j’ai développées tout à l’heure à propos de l’amendement n° 70 rectifié.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 110 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur décision motivée du juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ou du juge d’instruction, si la prolongation de la détention est l’unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-3. Cette décision est motivée au regard de la légalité de la mesure et des circonstances de l’affaire.
La parole est à M. Jacques Mézard.

Avec cet amendement, nous considérons que la prolongation de la garde à vue, plus encore que la décision initiale de mise en garde à vue, est une mesure de privation de liberté qui doit relever de la compétence du procureur de la République. Dans ce cas, vingt-quatre heures seront déjà passées, qui auront permis de faire avancer l’enquête. Au-delà de ce délai, une prolongation de la garde à vue constitue une privation encore plus grande de liberté : il est donc normal qu’elle relève de la compétence du JLD.
Les statistiques qui sont en notre possession – mais je ne pense pas qu’elles soient différentes de celles de M. le garde des sceaux –, indiquent qu’il y a environ 100 000 prolongations de gardes à vue.

En tout cas, elles se comptent plus en dizaines de milliers qu’en centaines de milliers, ce qui est une bonne chose ! Cela étant, ces chiffres montrent que la prolongation de la garde à vue doit relever de la compétence du JLD, comme l’exige d’ailleurs la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH.
La décision de prolongation doit non seulement satisfaire à la finalité de la garde à vue, mais être également motivée au regard du principe de proportionnalité et des circonstances de l’espèce. Nous sommes là au cœur du débat.

L'amendement n° 21, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 6
Remplacer les mots :
procureur de la République
par les mots :
juge des libertés et de la détention
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Rappelons, une fois encore, que, aux termes de la décision de la CEDH du 23 novembre 2010, le procureur de la République, qui est un magistrat, ne remplit pas les conditions d’indépendance nécessaires pour être qualifié de juge, en raison de sa soumission hiérarchique à l’exécutif et, donc, de l’absence de garanties réelles d’impartialité.
Or, tels qu’ils sont rédigés, les alinéas 5 et 6 de l’article 2 maintiennent les prérogatives du parquet dans la prolongation de la garde à vue. Le procureur est ainsi à la fois partie poursuivante – l’accusateur – et juge de la légalité et de la nécessité de prolonger la privation de liberté. Il existe donc bien une confusion des rôles et une mise en cause de l’égalité des armes entre les parties.
Mme Mireille Delmas-Marty estime que c’est « comme si renforcer les garanties d’un côté amenait à créer des procédures parallèles sans garanties ». Dans la mesure où vous laissez au parquet la maîtrise de la garde à vue pendant les premières vingt-quatre heures, il est encore plus essentiel d’instituer une sorte de droit de recours devant un juge du siège, en l’occurrence le JLD. Une telle mesure me paraît être un minimum.
En outre, l’alinéa 5 exige la commission d’une infraction passible d’au moins un an de prison. Il ne s’agit que d’une toute petite avancée. En effet, le nombre de délits punis d’une peine autre que l’emprisonnement ou d’une peine inférieure à un an d’emprisonnement est très faible.
La privation de liberté est tout de même un acte grave, qui doit rester exceptionnel, pour reprendre les termes employés par le Premier ministre en juillet dernier lorsqu’il évoquait la question de la garde à vue devant la Commission nationale consultative des droits de l’homme.
Ce caractère de gravité de la garde à vue est encore renforcé en cas de prolongation : l’intervention du JLD est donc plus que nécessaire, au moins à cette phase de la procédure.

L'amendement n° 73, présenté par MM. Anziani, Michel, Badinter et Sueur, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, M. Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
procureur de la République
par les mots :
juge des libertés et de la détention
La parole est à M. Alain Anziani.

La prolongation de la garde à vue au-delà des vingt-quatre premières heures nous semble effectivement devoir relever de la compétence du JLD, et non de celle de l’OPJ sous contrôle du procureur. Mon argumentation vaut également pour l'amendement n° 75.

L'amendement n° 75, présenté par MM. Anziani, Michel, Badinter et Sueur, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, M. Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
procureur de la République
par les mots :
juge des libertés et de la détention
La parole est à M. Alain Anziani.

L'amendement n° 74, présenté par MM. Anziani, Michel, Badinter et Sueur, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, M. Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après les mots :
supérieure ou égale
Insérer les mots :
à trois ans d'emprisonnement ou, en cas de flagrant délit,
Cet amendement n’a plus d’objet.
L'amendement n° 20, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'autorisation et les raisons qui la motivent sont immédiatement communiquées à la personne dont la garde à vue est prolongée et à son conseil.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

L’article 2 du projet de loi détaille les conditions d’exécution de la garde à vue, sa durée et les modalités d’une prolongation de la mesure.
Le projet de loi encadre trop partiellement la prolongation de la garde à vue au regard du préjudice qui en résulte pour la personne qui, je le rappelle, est présumée innocente.
Les conséquences psychologiques sur l’individu qui vient déjà de passer vingt-quatre heures enfermé ne doivent pas être sous-estimées.
C’est pourquoi nous proposons non seulement qu’une telle décision soit prise après autorisation du juge des libertés et de la détention, mais également que la présentation de la personne ne se fasse pas par vidéoconférence. Il est en effet important que le gardé à vue puisse bénéficier d’un entretien judiciaire de qualité et s’exprimer librement sur les conditions de sa détention.
Il est vrai que ce principe se heurte aux restrictions budgétaires imposées par le Gouvernement à la justice. Ainsi, on sait que la quasi-totalité des prolongations de garde à vue dans le cadre de l’enquête préliminaire se font sans présentation en raison de l’importance de la charge de travail des magistrats.
Compte tenu de ces remarques, nous demandons par notre amendement que soit expressément inscrit dans la loi le droit pour le gardé à vue et son conseil d’avoir communication de l’autorisation de prolongation et les raisons qui la motivent, et ce de manière immédiate. Cette demande est d’autant plus importante que le projet de loi entend réserver cette décision au procureur de la République.
La personne placée en garde à vue doit être en mesure de pouvoir constater cette prolongation. À ce titre, il est important qu’elle possède les éléments qui la fondent.

L'amendement n° 111 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 6
1° Première phrase
Remplacer les mots :
procureur de la République
par les mots :
juge des libertés et de la détention
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jacques Mézard.

L'amendement n° 22, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 6, deuxième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

L’alinéa 6 de l’article 2 pose une règle précise : la présentation de la personne gardée à vue au procureur de la République avant toute autorisation de prolongation de la garde à vue.
Cependant, cette règle est immédiatement contredite par deux dispositions : la première permet l’utilisation d’un moyen de communication audiovisuelle ; la seconde va jusqu’à autoriser l’absence de présentation préalable.
Nous considérons que la présentation de la personne gardée à vue au procureur de la République doit être obligatoire et ne souffrir aucune exception.
La possibilité d’utiliser la visioconférence dans ce domaine comme dans d’autres, par exemple le contentieux de l’immigration où ce système quelque peu honteux a été mis en place, est incompatible avec un entretien judiciaire de qualité. Comment en serait-il autrement quand la personne gardée à vue devra s’exprimer dans les locaux de la police ou de la gendarmerie en présence des enquêteurs qui souhaitent précisément obtenir la prolongation de sa garde à vue ?
De plus, aucune condition précise n’est mise à cette utilisation. Ne risque-t-elle pas d’ailleurs de devenir monnaie courante ? C’est en tout cas ce que nous redoutons.
Quant à la possibilité de déroger purement et simplement à la présentation préalable, elle est déjà effective, hélas ! pour la quasi-totalité des prolongations de garde à vue en matière d’enquête préliminaire en raison essentiellement, je le répète, de la charge de travail des magistrats de permanence. Il est donc à craindre que, là aussi, l’exception ne devienne la norme.
Dans ces conditions, notre amendement apporte quelques mesures restrictives bienvenues.

L'amendement n° 11, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Alinéa 6, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jean Desessard.

Par cet amendement, les sénatrices et sénateur écologistes demandent la suppression de la deuxième phrase de l’alinéa 6 de l’article 2 aux termes de laquelle la présentation du gardé à vue au procureur de la République, dans l’hypothèse d’une prolongation de la mesure de garde à vue, pourra être réalisée au moyen d’une télécommunication audiovisuelle.
L’instauration de cette possibilité est très inquiétante à nos yeux. En effet, cette mesure fera perdre toute sa substance au principe de présentation du gardé à vue.
Chaque avancée du projet de loi est mise à mal par des exceptions ou des conditions qui en suppriment immédiatement les effets vertueux. C’est de nouveau le cas ici.
La présentation du gardé à vue au procureur de la République pourra donc, d’après les dispositions de la deuxième phrase de l’alinéa 6 de l’article 2, avoir lieu de manière virtuelle. Cette substitution de la visioconférence à une présentation effective constitue une limitation des droits du gardé à vue, qui doit être entendu dans l’hypothèse d’un renouvellement de la mesure de garde à vue.
L’effectivité de la présentation à un magistrat est un élément essentiel d’une procédure équitable, d’autant qu’il s’agit dans ce cas de statuer sur le renouvellement de la garde à vue. Durant cet entretien, le magistrat devrait donc avoir l’occasion de constater de visu l’état physique ou psychologique de l’individu dont il s’apprête à prolonger la garde à vue, cette mesure privative de liberté, pour vingt-quatre longues heures supplémentaires.
La procédure de présentation, déjà mise à mal par la possibilité d’y déroger, dont il sera question dans notre prochain amendement, perdra avec cet entretien virtuel tout ce qui lui reste de substance. De surcroît, l’entretien ne se fera plus dans un lieu neutre, mais dans un milieu carcéral, sous le regard des policiers, ce qui affectera sans nul doute la liberté de parole du gardé à vue. Cette technique de présentation est révélatrice de la mise à l’écart de l’autorité judiciaire dans le cadre de la procédure de garde à vue.
C’est sans doute la réduction constante des budgets alloués au personnel de justice qui pousse aujourd’hui le Gouvernement à souhaiter une généralisation de la vidéoconférence, mais la justice ne peut se rendre de manière effective à travers un écran.
Le recours ici à la vidéoconférence est à l’image du peu de cas que l’on fait des garanties procédurales du justiciable. La présentation effective à un magistrat indépendant du gardé à vue n’est pas consacrée par ce texte.
Ces dispositions adoptées à la hâte ne sont en aucun cas une avancée vers une procédure plus équitable. C’est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement.

L'amendement n° 12, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Alinéa 6, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jean Desessard.

Cet amendement vise à supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6 de l’article 2, qui prévoit que la prolongation de la garde à vue peut, à titre exceptionnel, être accordée sans présentation préalable.
Cette disposition procède, une nouvelle fois, d’une limitation des garanties offertes à la personne gardée à vue.

En effet, aucune mesure ne prévoit d’encadrer et de contrôler la mise en œuvre de cette prétendue exception ni les motivations de la décision écrite du procureur de la République. On ne peut donc accorder aucune valeur juridique à une telle disposition, qui porte atteinte à la fois à la sécurité juridique et au principe de présentation effective.
Les pirouettes sémantiques qui consistent à appeler « exception » ce qui, sans nul doute, se transformera en « principe » ne dupent personne. En effet, jusqu’à présent, en cas de renouvellement de la mesure de garde à vue, l’alinéa 2 de l’article 63 du code de procédure pénale accordait la faculté au procureur de la République de demander la présentation du gardé à vue. Avec ce texte, il devra demander sa présentation, mais il pourra exceptionnellement ne pas le faire. Vous avouerez, monsieur le garde des sceaux, que la nuance est mince.
En pratique, cette dérogation risque fort d’être généralisée du fait de l’importante charge de travail des magistrats. En effet, ils ne pourront certainement pas recevoir systématiquement les personnes gardées à vue dans le cadre d’un entretien avant de décider du renouvellement de cette mesure privative de liberté pour vingt-quatre heures supplémentaires.
Voilà pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter cet amendement.

L'amendement n° 3 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, MM. Vial et J. Gautier et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Alinéa 6, dernière phrase
Après les mots :
écrite et
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
spécialement motivée tant au regard de l'impossibilité d'une présentation en personne que de l'utilisation d'un moyen de télécommunication.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?

Concernant les amendements n° 110 rectifié, 21, 73, 75 et 111 rectifié, qui visent à faire ressortir la compétence de la prolongation de la garde à vue au juge des libertés et de la détention au lieu et place du procureur de la République, j’émets un avis défavorable pour les raisons déjà expliquées.
Aux termes de l’amendement n° 20, les motifs justifiant le renouvellement de la garde à vue doivent être communiqués à l’intéressé ou à son avocat. Or je ne pense pas que cette mesure soit utile. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.
L’amendement n° 22 vise à supprimer la faculté de recourir à la visioconférence. Je suis un peu étonné par cette proposition. En effet, la visioconférence, que l’on s’efforce de mettre en place là où c’est possible, permet au moins d’avoir un contact, même s’il est à distance, ce qui est tout de même préférable à l’absence totale de contact. D’ailleurs, je pense que cette technique va se répandre.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement, ainsi que sur l’amendement n° 11 pour les mêmes raisons.
Enfin, l’amendement n° 12 tend à exclure toute possibilité de déroger au principe de présentation devant le procureur de la République. Cette dérogation doit bien entendu conserver un caractère exceptionnel. Reste que, dans certains cas, il n’est pas possible de présenter l’intéressé devant le procureur de la République alors que le renouvellement de la garde à vue est impératif au regard des exigences de sécurité.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Le Gouvernement émet le même avis défavorable que la commission sur l’ensemble de ces amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.

La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 12.

Monsieur le rapporteur, vous indiquez que la dérogation à la règle de présentation devant le procureur de la République doit conserver un caractère exceptionnel. Certes, mais cette exception doit être motivée. Vous auriez donc pu déposer un amendement afin de l’encadrer.
À partir du moment où l’exception consiste simplement à dire « on ne peut pas faire autrement », cela fonctionnera une fois, mais, le mois suivant, on y dérogera et de nouveau le mois d’après, et ainsi de suite.

Il s’agira donc non plus d’une exception, mais d’une pratique courante.
Vous n’avez pas suffisamment encadré cette mesure exceptionnelle.
L'amendement n'est pas adopté.

Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion de commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique et du projet de loi relatifs au Défenseur des droits, il va être procédé à la nomination des membres de ces commissions mixtes paritaires.
La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à ces éventuelles commissions mixtes paritaires :
Titulaires : MM. Jean-Jacques Hyest, Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Paul Amoudry, Jean-Pierre Sueur, Jean-Pierre Michel, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat ;
Suppléants : MM. Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, M. François Pillet, Mme Catherine Troendle, MM. Jean-Pierre Vial, Richard Yung.
Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de ces commissions mixtes paritaires et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt-et-une heures trente.