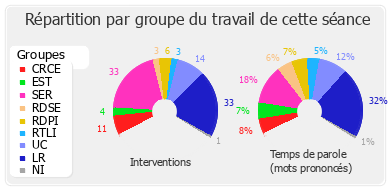Séance en hémicycle du 21 mars 2023 à 14h30
Sommaire
- Conventions internationales (voir le dossier)
- Favoriser les travaux de rénovation énergétique (voir le dossier)
- Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire sur une proposition de loi (voir le dossier)
- Approvisionnement en produits de grande consommation (voir le dossier)
- Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire sur une proposition de loi (voir le dossier)
- Violences intrafamiliales (voir le dossier)
- Fusion des filières rep d'emballages ménagers et de papier (voir le dossier)
La séance
La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Alain Richard.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle l’examen de deux projets de loi tendant à autoriser l’approbation de conventions internationales.
Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.
Je vais donc les mettre successivement aux voix.
Est autorisée l’approbation de l’accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un arrangement administratif signé le 15 mars 2018 et un avenant sous forme d’échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021), et dont le texte est annexé à la présente loi

Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (projet n° 81, texte de la commission n° 431, rapport n° 430).
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.
Le projet de loi est adopté.
Conventions internationales
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement du royaume des pays-bas relatif à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américain de la république française et du royaume des pays-bas
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américain de la République française et du Royaume des Pays-Bas, signé à Paris le 25 juin 2021, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération en matière de défense et au statut de leurs forces sur les territoires caribéens et sud-américain de la République française et du Royaume des Pays-Bas (projet n° 288, texte de la commission n° 409, rapport n° 408).
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.
Le projet de loi est adopté définitivement.

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à ouvrir le tiers-financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique (texte de la commission n° 422, rapport n° 421).
La parole est à Mme la rapporteure.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis que le texte qui nous réunit aujourd’hui parvienne au terme de son parcours parlementaire, à l’issue d’une commission mixte paritaire conclusive, dans une version équilibrée qui reprend très largement les apports du Sénat introduits lors de son examen en février dernier.
Nous avions alors accueilli favorablement ce texte, qui offrira au secteur public un nouvel outil pour relever l’immense défi que représente la transition énergétique des bâtiments publics, soumis par la loi à d’ambitieuses obligations de performance énergétique.
Or le coût de ces travaux est estimé à 500 milliards d’euros pour l’ensemble du secteur public, à mobiliser d’ici à 2050. Fidèles à notre rôle constitutionnel de représentants des collectivités territoriales, il nous est par conséquent apparu nécessaire d’accompagner ces dernières dans la réalisation de ces travaux, favorisant ainsi l’atteinte des objectifs de performance énergétique que leur impose la loi.
La solution prévue par ce texte peut représenter une avancée et permettre de débloquer de nombreux projets locaux : les acheteurs publics pourront plus facilement programmer des travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments, en faisant partiellement reposer leur financement sur les économies d’énergie qui résulteront de ces travaux, le coût initial étant pris en charge par un tiers-financeur.
Il s’agit ainsi d’une dérogation au code de la commande publique, lequel prohibe, à juste titre, tant les dérapages sont possibles, le paiement différé.
C’est pourquoi nous sommes restés attachés au principe d’une expérimentation, qui prendra fin au bout de cinq ans. Nous avons renforcé les exigences de suivi et d’évaluation de cette dernière, afin de nous assurer que les dérogations au code soient limitées, que les collectivités territoriales soient accompagnées et que soit ainsi évité tout accident financier.
Sur ce point, nous avons accentué les conditions de soutenabilité financière des projets, conscients que le tiers-financement représente un coût final plus élevé pour l’acheteur public, le tiers-financeur répercutant son avance de trésorerie lors du paiement différé.
Comme j’ai pu l’exprimer à plusieurs reprises lors des diverses étapes de la navette parlementaire, ce texte ne constituera pas une solution miracle effaçant les difficultés du secteur public en matière de rénovation énergétique. Il s’agit d’une solution complémentaire, certes bienvenue, mais qui ne nous dédouanera pas d’une réflexion d’ensemble sur les moyens de mettre en œuvre la transition environnementale à l’échelon local.
Nous serons donc attentifs à l’application qui sera faite de cette nouvelle faculté laissée aux mains du secteur public, en formulant le vœu que l’évaluation demandée par la loi que nous nous apprêtons à voter soit effective.
Tous les apports du Sénat ont été maintenus lors de la commission mixte paritaire (CMP). C’est donc un texte presque identique à celui que nous avions adopté en février dernier qu’il vous est proposé de voter aujourd’hui.
Outre des modifications rédactionnelles, la CMP a notamment permis d’inclure l’étude préalable parmi les documents transmis aux assemblées délibérantes devant approuver la signature du contrat – une précision utile –, et d’encadrer la durée du marché, celui-ci devant se limiter à la durée de l’amortissement des investissements.
Compte tenu de ces avancées et du compromis qui a été trouvé, à l’unanimité, en commission mixte paritaire, je vous invite, mes chers collègues, à voter en faveur de ce texte, qui permettra de trouver des solutions locales pour améliorer le quotidien des usagers du service public et respecter nos engagements en matière de décarbonation.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la synthèse du sixième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), parue hier, nous rappelle l’urgence d’agir face au réchauffement climatique, d’accélérer notre transition et, en particulier, d’avancer sur la décarbonation de nos sociétés.
Ce défi majeur de la transition écologique passe nécessairement par la décarbonation des bâtiments, qui produisent 23 % des émissions de gaz à effet de serre de notre pays.
Ce chantier crucial de la rénovation de nos bâtiments, nous l’avons déjà lancé, et il a un coût, notamment pour l’État et les collectivités dont le bâti représente 30 % du parc tertiaire national, avec un important potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique.
C’est un chantier où l’État comme les collectivités se doivent d’être exemplaires. En effet, avec 75 % du parc des bâtiments publics, les collectivités territoriales sont tout particulièrement en première ligne.
Cette proposition de loi, qui vise à ouvrir le tiers-financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique, parvient aujourd’hui au terme de son parcours parlementaire. Elle est à présent soumise à votre approbation.
La réalisation de travaux de rénovation énergétique constitue un investissement important pour les collectivités. Or, jusqu’à présent, le code de la commande publique interdit tout paiement différé dans les marchés globaux de performance énergétique passés par l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
Une dérogation à ce principe existait déjà, uniquement dans le cadre très spécifique et contraignant des partenariats publics-privés, de facto très peu utilisés pour les travaux de rénovation des bâtiments des collectivités territoriales.
Cette proposition de loi constitue donc une avancée très concrète. Elle fournira aux collectivités, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, un outil renforcé pour leur permettre d’accélérer les démarches de rénovation qu’elles entreprennent.
Je tiens à saluer l’esprit dans lequel cette proposition de loi a été conçue, dans le dialogue avec les collectivités territoriales, les élus locaux et le Parlement, en particulier avec l’apport décisif du Sénat.
Le texte a été débattu, enrichi, amendé, et cette version issue de la commission mixte paritaire est un bel exemple de compromis en vue de l’intérêt général. La qualité des échanges doit beaucoup aux rapporteurs, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, et je tiens, madame la sénatrice Eustache-Brinio, à vous remercier personnellement de votre engagement.
Le tiers-financement n’est ni une réforme du code de la commande publique – nous sommes dans une logique d’identification des bonnes pratiques et d’expérimentation – ni un désengagement de l’État.
C’est une arme supplémentaire, mise à la disposition des élus qui le souhaiteront. Elle s’ajoute à la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour ce qui concerne la rénovation ; aux appels à projets dans le cadre des certificats d’économies d’énergie (C2E) ; à la mobilisation du fonds Chaleur de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), dont le montant a été porté à un demi-milliard d’euros ; et à celle du fonds vert, abondé à hauteur de deux milliards d’euros pour 2023.
Ainsi, dans le cadre du fonds vert, 5 000 dossiers de subvention ont été déposés par les collectivités locales, dont 2 150 concernent la rénovation thermique des bâtiments publics, représentant 5 millions de mètres carrés à rénover. Les financements correspondants permettraient de réaliser des économies représentant la consommation de 40 000 foyers français.
Enfin, des propositions seront réalisées dans le cadre du plan de rénovation des écoles, qui s’appuiera sur le tiers-financement, mais pas seulement. Avec la Banque des territoires, nous préparons un dispositif pour accompagner massivement les écoles, collèges et lycées de notre pays.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le chantier de rénovation du bâti public est une priorité de la lutte que nous menons contre le réchauffement climatique. Mais il n’y a pas, d’un côté, la question environnementale, et, de l’autre, les questions économiques et sociales. C’est le dernier point sur lequel je souhaiterais insister : la rénovation du bâti public a un coût, mais elle ouvre des perspectives extrêmement concrètes de réduction des dépenses.
Investir pour rénover, c’est agir directement pour les finances de sa commune et de sa collectivité. Mais c’est aussi améliorer la vie de nos concitoyens, des agents qui travaillent dans ces bâtiments et de tous leurs usagers.
Le texte qui vous est soumis est un texte de consensus, qui permettra de renforcer notre action publique pour le bénéfice de nos concitoyens, sur le long terme, mais aussi sur le court terme. Il favorisera également la mobilisation de l’ensemble des acteurs du bâtiment, au service de la décarbonation du secteur, et leur ouvrira de nouvelles perspectives économiques sans lesquelles ce chantier systémique ne pourrait être mené à bien.
C’est pourquoi je ne doute pas que l’adoption de ce texte fera l’objet d’un large consensus sur vos travées.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – M. Jean-Louis Lagourgue applaudit également.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conclure des contrats de performance énergétique dérogeant aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique, sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments. Lorsque le contrat conclu en application du présent article porte sur plusieurs bâtiments, les résultats des actions de performance énergétique sont suivis de manière séparée pour chaque bâtiment.
Les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être conclus pour la prise en charge des travaux prévue au dernier alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.
Pour le calcul de la rémunération du titulaire, le marché global de performance précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés :
1° Les coûts d’investissement, notamment les coûts d’étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ;
2° Les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d’entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ;
3° Les coûts de financement ;
4° Le cas échéant, les revenus issus de l’exercice d’activités annexes ou de la valorisation du domaine.
Par dérogation aux articles L. 2193-10 à L. 2193-13 du code de la commande publique, le sous-traitant direct du titulaire du marché global de performance est payé, pour la part du marché dont il assure l’exécution, dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Pour l’application des articles L. 2313-1, L. 3313-1, L. 3661-15, L. 4313-2, L. 4425-18, L. 5217-10-14, L. 71-111-14 et L. 72-101-14 du code général des collectivités territoriales, les documents budgétaires sont accompagnés :
a) D’une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l’établissement public résultant des contrats de performance énergétique signés dans les conditions prévues au présent article ;
b) D’une annexe retraçant la dette liée à la part d’investissements de ces contrats.
I. – Le présent article est applicable aux marchés globaux de performance conclus en application de l’article 1er.
II. – Un marché global de performance peut être conclu pour la réalisation d’une opération répondant aux besoins d’une autre personne morale de droit public ou de droit privé en vue de l’exercice de ses missions. Dans ce cas, une convention est signée entre l’acheteur et la personne morale pour les besoins de laquelle le marché global de performance est conclu.
III. – Lorsque la réalisation d’un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs acheteurs, ces derniers peuvent désigner par convention celui d’entre eux qui conduira la procédure de passation et, éventuellement, signera le contrat et en suivra l’exécution. Le cas échéant, cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme.
IV. – Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l’acheteur procède à une étude préalable ayant pour objet de démontrer l’intérêt du recours à un tel contrat. La procédure de passation de ce marché ne peut être engagée que si cette étude préalable démontre que le recours à un tel contrat est plus favorable que le recours à d’autres modes de réalisation du projet, notamment en termes de performance énergétique. Le critère du paiement différé ne peut à lui seul constituer un avantage.
Cette étude préalable est soumise pour avis à l’organisme expert mentionné à l’article L. 2212-2 du code de la commande publique.
Les modalités d’application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d’État.
V. – Avant de décider de recourir à un marché global de performance, l’acheteur réalise une étude de soutenabilité budgétaire, qui apprécie notamment les conséquences du contrat sur les finances publiques et la disponibilité des crédits. Cette étude est soumise pour avis au service de l’État compétent.
Lorsque le marché global de performance est conclu pour les besoins de plusieurs personnes morales, l’étude de soutenabilité budgétaire précise les engagements financiers supportés par chacune d’elles.
VI. – Pour les marchés globaux de performance conclus par l’État et ses établissements publics, le lancement de la procédure de passation est soumis à l’autorisation des autorités administratives compétentes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
VII. – Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’étude préalable, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l’assemblée délibérante ou à l’organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.
VIII. – Pour les autres acheteurs, l’étude préalable, l’étude de soutenabilité budgétaire et les avis sur celles-ci sont présentés à l’organe décisionnel, qui se prononce sur le principe du recours à un marché global de performance.
IX. – L’acheteur peut prévoir que les modalités de financement indiquées dans l’offre finale présentent un caractère ajustable.
Ces ajustements ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les conditions de mise en concurrence en exonérant l’acheteur de l’obligation de respecter le principe du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse ni de permettre au titulaire pressenti de bouleverser l’économie de son offre.
L’ajustement de l’offre ne porte que sur la composante financière du coût global du contrat et est seulement fondé sur la variation des modalités de financement, à l’exclusion de tout autre élément.
X. – Le soumissionnaire auquel il est envisagé d’attribuer le marché global de performance présente le financement définitif dans un délai fixé par l’acheteur. À défaut, le marché global de performance ne peut lui être attribué et le soumissionnaire dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne peut être sollicité pour présenter le financement définitif de son offre dans le même délai.
XI. –
Supprimé
XII. – Les autorités administratives compétentes autorisent la signature des marchés globaux de performance par l’État et ses établissements publics, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
XIII. – L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l’organe délibérant de l’établissement public local autorise la signature du marché global de performance par l’organe exécutif.
XIV. – L’organe décisionnel des autres acheteurs autorise la signature du marché global de performance.
XIV bis
XV. – Une fois signés, les marchés globaux de performance et leurs annexes sont communiqués à l’organisme expert mentionné à l’article L. 2212-2 du code de la commande publique. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu’à des fins de recensement et d’analyse économique.
XVI. – En cas d’annulation ou de résiliation du marché global de performance par le juge faisant suite au recours d’un tiers, le titulaire peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur.
XVII. – Parmi les dépenses mentionnées au XVI du présent article, figurent, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du marché, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.
La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes au marché global de performance, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché.
XVIII. – Lorsqu’une clause du marché global de performance fixe les modalités d’indemnisation du titulaire en cas d’annulation ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat.
XIX. – La rémunération due par l’acheteur dans le cadre du marché global de performance peut être cédée conformément aux articles L. 313-29-1 et L. 313-29-2 du code monétaire et financier.
L’expérimentation prévue à l’article 1er fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation par le Gouvernement, qui remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les contrats conclus en application du même article 1er. Ce rapport est mis à jour et à nouveau transmis au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
Ce rapport examine notamment :
1° A Le nombre et la destination des bâtiments publics ayant fait l’objet de travaux de rénovation énergétique par le recours à ces contrats ;
1° B Les économies d’énergie réalisées du fait des travaux de rénovation énergétique effectués dans le cadre de ces contrats ;
1 °C L’atteinte des objectifs chiffrés de performance énergétique définis dans ces contrats ;
1° La qualité et la quantité de la sous-traitance dans ces contrats ;
1° bis L’accès à ces contrats par catégorie d’entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
1° ter Le recours à ces contrats par catégorie de collectivités territoriales, notamment par les communes de moins de 3 500 habitants ayant eu recours à la mutualisation de plusieurs opérations entre différentes communes ;
2° La participation des usagers du service public en lien avec les bâtiments publics faisant l’objet des contrats conclus en application de l’article 1er, au stade de leur passation comme de leur exécution ;
3° L’association des agents du service public en lien avec les bâtiments publics faisant l’objet de ces contrats, au stade de leur passation comme de leur exécution ;
4° L’accompagnement des acheteurs publics, en particulier les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, notamment pour la passation et l’exécution de ces contrats ;
5° Les conséquences budgétaires desdits contrats sur les finances des acheteurs publics concernés.
Le dernier alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « membres, », sont insérés les mots : « des études et » ;
1° bis À la deuxième phrase, après le mot : « ces », sont insérés les mots : « études et de ces » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « À cette fin, des conventions sont conclues avec les membres bénéficiaires. »
La présente loi est applicable, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments, par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.

Sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
La parole est à M. Éric Bocquet, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme l’a précisé Michelle Gréaume lors de l’explication de vote sur ce texte en première lecture, nous sommes très attachés aux débats autour de la transition écologique, tout comme, je l’imagine, chacun d’entre nous ici.
Aujourd’hui, on le sait, les dépenses en fluides représentent une part importante du budget de nos collectivités, surtout dans un contexte marqué par une crise de l’énergie couplée à une inflation galopante.
Les bâtiments publics qui font la force et l’image de notre service public dans nos territoires doivent répondre aux enjeux du développement durable. Ils représentent près de 400 millions de mètres carrés, dont les trois quarts relèvent de la compétence directe des collectivités territoriales.
Chaque année, l’énergie pour chauffer des équipements ou des bâtiments représente 2, 6 % de la consommation finale d’énergie du pays.
Je viens de le dire, ce sont 400 millions de mètres carrés qu’il faut rénover. Encore une fois, nous saluons l’initiative qui est prise, mais nous restons dubitatifs sur l’effet de levier que l’on espère de cette loi : faire reposer les financements sur les économies d’énergie qui résulteront des travaux.
Nous reconnaissons volontiers que cette proposition de loi semble un outil adapté pour accompagner la rénovation énergétique, notamment pour permettre à des communes, surtout dans les secteurs ruraux, de lever les freins à certains investissements.
Lors de la commission mixte paritaire, les sujets sur lesquels nous avions eu des réticences et des interrogations n’ont pas été débattus : je pense notamment aux dépenses nécessaires et indispensables pour la mise aux normes des réseaux électriques, la sécurité, les systèmes anti-incendie, ou encore les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Je pense aussi à la question de la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur du bâtiment et à la nécessité d’envoyer des ouvriers en formation, ainsi qu’à l’impact de cette loi sur les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME). Nous n’avons pas eu d’éclaircissements sur ces sujets lors de la commission mixte paritaire et nous le regrettons.
À l’heure où les collectivités débattent de leur budget et le votent, beaucoup d’élus ont dû faire des choix concernant des projets de rénovation ou de construction, sans réelle visibilité ni horizon clair. Nous ne pouvons donc crier victoire avec cette proposition de loi.
Les collectivités doivent faire ces choix à un moment où la crise sociale et la crise de l’énergie mettent sérieusement en difficulté les finances locales, un sujet qu’il est difficile de ne pas évoquer ! Contrairement à l’État, elles doivent présenter, vous le savez, un budget à l’équilibre.
Madame la rapporteure, vous l’avez rappelé, lors de la commission paritaire mixte, notre abstention était bienveillante. Nous réitérons ce vote : le groupe CRCE s’abstiendra sur cette proposition de loi.
Nous resterons très attentifs au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre du texte, afin d’ajuster, si nécessaire, notre position sur le sujet.

M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour le groupe Union Centriste.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à ouvrir le tiers-financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.
Nous nous félicitons que la CMP soit parvenue à un accord et que sa version soit presque identique à celle qui a été adoptée par le Sénat le 16 février dernier. Nous avions alors voté en faveur de ce texte à l’unanimité, exception faite de l’abstention, tout de même bienveillante, de nos collègues du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Au travers de ce texte, nous faisons face à l’immense défi de la transition énergétique des bâtiments publics, ainsi qu’à celui de son financement. Nous nous félicitons qu’un tel sujet puisse faire l’objet d’un compromis entre nos deux chambres.
Le respect de nos objectifs ambitieux, inscrits dans la loi en 2009 et en 2018, suppose de dégager pas moins de 400 milliards d’euros d’ici à 2050. Le défi est considérable. Il nous faudra mobiliser des ressources supplémentaires en quantité pour accomplir nos desseins en matière climatique, mais aussi pour améliorer les conditions d’accueil des usagers et des agents du service public, et, ainsi, réduire les factures énergétiques des collectivités, en particulier celles qui sont relatives aux bâtiments scolaires.
Nul besoin de vous rappeler, mes chers collègues, l’ensemble des problèmes de financement auxquels sont confrontées les collectivités. C’est à cet enjeu que la présente proposition de loi entend répondre, grâce à un nouvel outil mis au service de la stratégie de transition énergétique des personnes publiques.
Cet outil n’est évidemment pas une solution miracle, mais il n’en demeure pas moins un dispositif complémentaire. Il permettra de faciliter l’accès aux financements aux collectivités, à l’État et à leurs établissements en faisant partiellement reposer les investissements sur les économies d’énergie qui résulteront des travaux de rénovation, le coût initial étant pris en charge par un tiers-financeur.
Concernant le texte en lui-même, cinq articles restaient en discussion et, comme l’a souligné Mme la rapporteure, outre des modifications rédactionnelles, la version que nous examinons maintenant ne diverge de celle du Sénat que sur des points mineurs.
L’article 1er comprend le dispositif central de cette proposition de loi. Je rappelle qu’il a pour objet l’instauration pour cinq ans d’une expérimentation visant à ce que les contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance énergétique, peu employés par les personnes publiques, puissent déroger à certaines dispositions du code de la commande publique.
Nous soutenons cette idée, car c’est une solution pertinente, d’autant qu’elle consiste en une expérimentation, ce qui nous permettra de procéder à une évaluation rigoureuse, puis, éventuellement, d’en corriger les défauts.
En outre, la commission mixte paritaire a retenu la rédaction de cet article assouplie par le Sénat, notamment l’extension ici défendue, particulièrement par notre rapporteure Jacqueline Eustache-Brinio, que je tiens à saluer, du bénéfice de cette expérimentation aux travaux de rénovation énergétique menés par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et par les syndicats d’énergie pour le compte de leurs membres.
Mes chers collègues, l’ensemble des associations d’élus locaux soutient ce texte, qui leur offre de nouvelles possibilités de financement. Il nous revient de leur adresser ce signal fort en faveur de la transition énergétique. Vous l’aurez compris, nous voterons en faveur des conclusions de la CMP sur ce texte.

M. le président. La parole est à M. Éric Gold, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi, qui devrait bientôt être adoptée définitivement, arrive à un moment particulièrement opportun, ce qui peut justifier cette nouvelle dérogation aux règles habituelles de la commande publique. En effet, les crises auxquelles l’État et les collectivités doivent faire face sont multiples.
La première crise est écologique. La nécessité d’agir s’impose à tous, notamment aux pouvoirs publics.
L’immobilier et la construction représentent un tiers de la consommation d’énergie et un quart des émissions de dioxyde de carbone en France. Les bâtiments publics y contribuent en grande partie, puisqu’ils représentent 37 % du parc tertiaire national.
Leur rénovation énergétique doit donc faire figure de priorité si le pays veut atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Elle doit aussi permettre aux Français de mieux vivre, dans un pays soumis, comme jamais auparavant, aux aléas climatiques, notamment à des canicules répétées. Cet objectif ambitieux doit être soutenu par des actions concrètes, dès aujourd’hui, et la rénovation thermique en est l’un des piliers.
La deuxième crise est géopolitique. La guerre en Ukraine a fait grimper à des niveaux vertigineux le coût des énergies. Elle remet en question notre modèle d’approvisionnement, et rend plus impérative encore la nécessité de réduire cette dépendance énergétique que nous payons si cher.
La troisième crise, qui découle de la précédente, est économique. Elle a plongé, du fait de l’inflation record, bon nombre de collectivités territoriales dans la difficulté en multipliant leurs factures par deux ou par trois. Elle rend plus que jamais nécessaire la réduction de nombreux postes de dépenses, au premier rang desquels l’énergie.
Pourtant, alors que le bâtiment est responsable de 76 % de la consommation énergétique des communes, les travaux de rénovation sont trop peu mis en œuvre dans le secteur public, probablement parce que le coût d’investissement est trop élevé. En effet, il faudrait dépenser la somme colossale de 500 milliards d’euros d’ici à 2050 pour respecter les obligations de la loi en matière de rénovation énergétique. Cette somme est évidemment impossible à mobiliser pour l’État et pour les collectivités.
Il s’agit donc, au travers de ce texte, de lever l’obstacle financier lié à l’investissement à consentir pour financer la rénovation des bâtiments publics. L’accord trouvé en CMP ne diffère presque pas du texte voté au Sénat, qui avait semblé satisfaisant, au point qu’aucun groupe n’avait voté contre.
La proposition de loi vise donc à autoriser l’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements au recours au tiers-financement pour des travaux de rénovation énergétique. Ainsi, ils pourraient faire financer par un tiers un programme de changement d’équipement ou une rénovation de bâtiment.
L’opération était jusqu’à présent impossible du fait des règles de la commande publique, qui interdisent tout paiement différé.
Avec le tiers-financement, une fois les travaux terminés, la collectivité reverse au tiers-financeur une forme de loyer dont le montant équivaut aux économies d’énergie consécutives aux équipements installés, sur une période déterminée. Ce mode de financement pourrait permettre aux administrations de réaliser des travaux d’envergure, dont le coût serait lissé dans le temps.
Si nous accueillons toujours favorablement les mesures de simplicité et d’efficacité, nous sommes également vigilants quand il s’agit d’assouplir les règles d’utilisation de l’argent public. Il ne faudrait pas, notamment pour des collectivités dont les finances sont déjà exsangues, contribuer à l’émergence de mauvaises pratiques ou de mauvaises dettes.
La proposition de loi semble répondre à cette inquiétude. D’une part, il est prévu que l’expérimentation se limite à cinq ans ; correctement évaluée, elle nous permettra de voir si ce nouvel outil a été pris en main et s’il n’a pas entraîné de difficultés inattendues. D’autre part, un contrôle accru, notamment avec l’étude de soutenabilité, permettra d’identifier clairement les incidences budgétaires pour chacune des parties prenantes.
Pour conclure, l’accord trouvé en CMP nous offre un compromis satisfaisant et retient l’essentiel des apports du Sénat.
Le texte qui ressortira de notre examen répondra à un devoir d’exemplarité de l’État et des collectivités, à l’heure où l’on en demande beaucoup aux Français pour s’adapter, voire survivre aux différentes crises que j’ai mentionnées plus tôt. Il contribuera à l’atteinte des objectifs ambitieux que la France s’est fixés, tout en améliorant les conditions d’accueil des usagers et les conditions de travail des agents. Enfin, il permettra de réduire les factures d’énergie de l’État et des collectivités tout en réduisant la charge financière des rénovations d’envergure au moment des travaux.
Pour toutes ces raisons, vous l’aurez compris, mes chers collègues, les membres du groupe RDSE apporteront leur voix à cet accord.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Di Folco, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui les conclusions de la commission mixte paritaire sur cette proposition de loi qui a fait l’objet d’un accord quasi unanime lors de son examen au sein de notre assemblée, il y a quelques semaines.
Je rappelle que le législateur, dès la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite loi Grenelle 1, avait choisi d’assigner des objectifs de réduction de la consommation d’énergie.
Ces objectifs, bien qu’ils n’aient pas été atteints, ont été confirmés et même amplifiés plus récemment, au moment de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi Élan. Les nouvelles cibles imposent désormais une réduction de 60 % de la consommation d’énergie finale des bâtiments publics d’ici au milieu du siècle. Le défi est donc de taille.
Cette politique de réduction de l’empreinte carbone nationale concerne tout particulièrement les collectivités, qui possèdent une bonne partie des 400 millions de mètres carrés du bâti public. Dans de nombreuses communes, notamment rurales, ce foncier est aussi abondant que vieillissant. Pis, dans un contexte de hausse rapide des prix de l’énergie et de tensions budgétaires, effectuer des rénovations d’une telle ampleur est devenu à la fois plus nécessaire et plus délicat.
Les auditions menées par la commission ont d’ailleurs révélé l’ampleur de la problématique, la direction de l’immobilier de l’État (DIE) allant jusqu’à estimer que, sans mobiliser des ressources supplémentaires dédiées, il ne sera pas possible d’atteindre les cibles de réduction pour le secteur public.
En parallèle, les limites des outils juridiques disponibles sont rapidement devenues manifestes.
Les signatures de contrats de performance énergétique (CPE) demeurent rares, sous la forme tant d’un marché global de performance que d’un marché de partenariat de performance énergétique : seuls 380 contrats de ce type ont été conclus entre 2007 et 2021. De manière révélatrice, l’État lui-même n’a eu que très peu recours au CPE : seulement vingt-quatre fois, selon les chiffres dont nous disposons.
Il était donc indispensable d’apporter une réponse. Par conséquent, le Sénat a accueilli favorablement la proposition de loi de nos collègues députés et l’a utilement enrichie suivant les préconisations de notre rapporteure, Mme Eustache-Brinio, dont je salue la qualité du travail.
Toutefois, comme elle l’a souligné à plusieurs reprises, les possibilités offertes par le recours au tiers-financement résultant de la proposition de loi doivent conserver une dimension strictement complémentaire. La politique de rénovation énergétique ne doit pas se limiter à une recherche de fonds privés, sans quoi elle risquerait de contribuer à fragiliser les finances publiques locales.
Ce n’est clairement pas ce que nous souhaitons en assouplissant certaines limites imposées à ces mécanismes de financement.
Pour cette raison, l’évaluation préalable du recours aux marchés globaux de performance énergétique et l’anticipation de leur soutenabilité budgétaire ont particulièrement retenu notre attention. Loin de dénaturer le texte initial, ces préoccupations nous ont permis de construire un texte plus solide.
Face à la convergence d’intentions des députés et des sénateurs autour de ces objectifs, la commission mixte paritaire est parvenue sans difficulté à un accord sur un texte commun. Celui-ci reprend les apports du Sénat, comme l’extension du bénéfice du dispositif aux EPCI et aux syndicats d’énergie, ou encore la transparence renforcée sur les conséquences financières du recours au marché global de performance.
Le compromis obtenu avec le rapporteur de l’Assemblée nationale sur les dispositions relatives à l’analyse de l’intérêt économique effectuée dans l’étude préalable nous semble satisfaisant.
De même, l’ajout en CMP d’un alinéa prévoyant la prise en compte de la « durée d’amortissement des investissements » dans la durée du marché global de performance constitue un apport opportun, qui va dans le sens des remarques formulées au Sénat.
Avant de conclure, je tiens à souligner que, cette proposition de loi créant un dispositif expérimental, il conviendra de mener une évaluation soigneuse, aussi bien après trois ans, par le biais du rapport prévu à l’article 2, qu’au terme de l’expérimentation, dans cinq ans.
Ces évaluations seront essentielles, non seulement pour juger de l’efficacité de la future loi et de ses conséquences potentielles sur la situation financière des acheteurs publics, mais aussi pour observer les progrès effectués dans le sens de la réalisation des objectifs nationaux en matière de performance énergétique.
Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera en faveur de la proposition de loi, dans sa rédaction résultant des travaux de la CMP.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

M. le président. La parole est à M. Dany Wattebled, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis que la commission mixte paritaire soit parvenue à une rédaction commune sur l’ensemble des dispositions restant en discussion de cette proposition de loi. Je félicite l’auteure de la proposition de loi et les rapporteurs, de même que je salue votre engagement, monsieur le ministre.
Grâce à ce texte, l’État et ses établissements publics, sans oublier les collectivités et leurs groupements, pourront désormais recourir au tiers-financement. Cette expérimentation représente une avancée majeure, que je salue.
Adopté le 19 janvier dernier à l’Assemblée nationale, puis le 16 février suivant au Sénat, le texte a bénéficié d’apports constructifs de la part des deux chambres. Au fil des débats, le dispositif a gagné en souplesse et en simplicité. Il en a résulté un outil facilitateur, dont je suis certain que nos élus sauront tirer profit.
Je suis particulièrement heureux que la commission mixte paritaire ait conservé une très grande partie des enrichissements proposés lors des débats au Sénat ; je pense notamment aux dispositions visant à améliorer la transparence sur les engagements financiers. Il est essentiel de pouvoir anticiper de manière précise les conséquences financières des engagements qui seront pris au travers de ce dispositif.
Ces contrats sont bien encadrés et favoriseront l’accomplissement des projets de territoire défendus par nos élus, avec toutes les précautions qui s’imposent, afin d’aller vers une réduction importante de l’empreinte carbone dans les années à venir.
Le Gouvernement remettra un rapport d’évaluation qui permettra une analyse rigoureuse du dispositif. Nous jugeons cela utile et serons particulièrement attentifs à l’étude de ses bénéficiaires, mais aussi à la nature des projets accompagnés, ainsi qu’aux catégories d’entreprises qui seront concernées.
Les défis environnementaux s’imposent à nous avec une urgence croissante. Comme le souligne le dernier rapport du Giec, les effets du réchauffement se font ressentir dans nos territoires, à l’image de la sécheresse dramatique qui sévit en ce moment même dans de nombreux départements.
Tous les outils en faveur de la transition écologique mis à la disposition de nos élus sont les bienvenus. Comme nous l’avons rappelé lors de l’examen du texte, cette expérimentation est un atout supplémentaire dans le jeu des élus locaux. Il est très important de leur faire confiance. Nous pouvons donc nous féliciter de participer ensemble à la création d’une nouvelle pratique vertueuse, qui s’ajoutera au panel des solutions existantes.
Cette proposition de loi représente une avancée concrète pour nos territoires. Le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera en sa faveur.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Mme Esther Benbassa applaudit.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que le Giec nous implore encore de prendre la mesure du changement climatique et d’adopter dans l’urgence des dispositions, simplement pour préserver les conditions de vie sur notre planète, nous nous retrouvons pour voter l’accord trouvé par la CMP visant à instaurer de nouvelles modalités d’action en faveur des travaux de rénovation énergétique.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires et les écologistes en général lancent depuis bien longtemps l’alerte sur les passoires thermiques et sur les charges que ces dernières font peser sur de nombreux foyers modestes.
Nous considérons cet enjeu comme prioritaire. Nous avons été à l’initiative d’une commission d’enquête sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique, dont Guillaume Gontard, le président de notre groupe, est rapporteur ; son rapport devrait être rendu au début du mois de juillet prochain. Il s’est prononcé pour aller vers « un reste à charge zéro », et, au vu des sommes à débourser par les ménages, la question du tiers-financement doit se poser.
Elle se pose aussi pour nos collectivités. Le Sénat, chambre des territoires, connaît bien les problèmes auxquels elles sont confrontées.
La crise énergétique et les discussions sur le filet de sécurité ont montré que ces difficultés étaient présentes partout, en milieu rural comme en milieu urbain, dans les petites collectivités comme dans les grandes. Pour autant, les bâtiments publics sont loin d’être épargnés par la surconsommation d’énergie. Ceux de l’État et des collectivités locales sont responsables de 76 % de la consommation énergétique des communes.
À l’occasion de la première lecture du texte, j’avais rappelé que la Cour des comptes, à l’automne dernier, avait noté l’incohérence et le risque d’inefficacité des mesures gouvernementales destinées à améliorer l’empreinte environnementale des bâtiments : « Le secteur du bâtiment, résidentiel et tertiaire, constitue en France la première source de consommation d’énergie. La politique de rénovation énergétique des bâtiments, à laquelle l’État a consacré plusieurs réformes législatives au cours de la dernière décennie, est un outil majeur pour la mise en œuvre de la stratégie bas-carbone et l’accentuation de la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. »
Par exemple, l’effort sur les écoles a trop longtemps été repoussé. Alors que les diverses échéances se rapprochent, les factures continuent de s’envoler ; le coût du filet de sécurité, si utile, et des rénovations éventuelles ne doit pas être pris à la légère.
En outre, l’effort du Gouvernement en matière de purification d’air, promis par le Président de la République lors de sa campagne, a lui aussi été oublié.
Le coût de la dette climatique est bien trop nocif pour notre société, et les dépenses énergétiques indues grèvent les finances publiques, en particulier les finances locales. On retrouve donc bien, dans le cadre du patrimoine public, la double peine que vivent les foyers, ce cercle vicieux que nous connaissons trop bien : le renoncement aux travaux de rénovation pour des raisons financières maintient des dépenses énergétiques abyssales.
L’urgence est là ! Ce texte issu de la CMP est une première étape dans la gestion du coût très élevé de travaux souvent nécessaires ; il a pour objet une expérimentation pendant cinq ans de l’aménagement du droit de la commande publique, particulièrement en matière de paiement différé.
Conscient de l’attente des collectivités, et favorable à l’accélération de la transition énergétique des bâtiments publics, notre groupe est favorable à cette expérimentation, mais il continuera à exprimer sa prudence envers un risque de captation par le secteur privé d’une grande partie de la rentabilité des activités économiques suscitées par les économies d’énergie, à la faveur d’une forme de privatisation de la maîtrise d’ouvrage de ces travaux et de leur financement.
Hélas, les fameux partenariats public-privé (PPP) ont souvent été accompagnés d’abus de la part des partenaires privés. L’inertie des dernières décennies a déjà un coût. Il convient de s’assurer qu’il ne soit pas encore amplifié.
Au-delà de cette expérimentation, c’est bien la question du financement de la transition énergétique qui se pose, et je salue le constat de notre rapporteure à ce sujet : cette proposition de loi ne représente qu’« un dispositif complémentaire bienvenu, mais qui ne peut représenter l’unique solution pour réussir la transition énergétique du secteur public », d’autant que « le tiers-financement […] ne doit pas être favorisé de façon systématique en raison des surcoûts finaux qu’il entraîne ».
J’espère que beaucoup sur ces travées sont en accord avec le principe de pollueur-payeur et qu’ils défendraient ainsi une taxation des entreprises les plus polluantes pour mieux alimenter le budget de MaPrimeRenov’ ou de tout autre dispositif d’aide à la rénovation des logements des particuliers…
L’expérimentation proposée dans ce texte reste une bonne idée. Son évaluation, voulue par notre commission, doit faire l’objet d’une réelle et indispensable ambition au vu des sommes qui pourraient être engagées.
L’objectif de réduction de 60 % de la consommation énergétique des bâtiments publics d’ici à 2050 ne peut être atteint sans des mécanismes d’accompagnement, de préférence pérennes, lisibles et peu coûteux. L’expérimentation permettra de dresser le bilan des mécanismes qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas.
Cette loi n’offrira qu’un appui très limité aux ambitions qui doivent être les nôtres en matière de rénovation thermique ; elle ne permettra pas à elle seule d’atteindre les objectifs fixés. Nous en sommes loin. Une grande stratégie de rénovation thermique aurait dû et devrait être une priorité majeure de l’État, au même titre que notre stratégie énergétique.
Néanmoins, ce texte va dans le bon sens. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera en sa faveur, en restant attentif aux dérives des marchés de rénovation.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – MM. Jean-Yves Leconte et Jean-Claude Tissot applaudissent.

La parole est à Mme Nadège Havet, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, déposée le 29 novembre 2022 par les membres du groupe Renaissance, cette proposition de loi a été adoptée par l’Assemblée nationale le 19 janvier dernier, puis par le Sénat le 16 février suivant. Cette quasi-unanimité parlementaire a débouché, logiquement, sur une commission mixte paritaire conclusive, il y a deux semaines. Je remercie les deux rapporteurs, la sénatrice Eustache-Brinio et le député Cazenave, de leurs travaux.
En moins de quatre mois, le Parlement se sera prononcé en faveur de l’ouverture du tiers-financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales, traduisant une volonté de soutenir la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Il nous faut bel et bien accélérer, alors que la loi Élan a imposé en 2018 une réduction de 60 % de la consommation d’énergie finale des bâtiments publics d’ici à 2050 par rapport à leur niveau de 2010. C’est le sens du décret dit « tertiaire ».
Réaliser cette transition énergétique, c’est devoir engager, pour le seul parc public, près de 500 milliards d’euros dans les vingt-cinq prochaines années.
Ce cap que nous nous sommes fixé est ambitieux et nécessaire. Il rend impératif un effort massif et continu, notamment budgétaire, afin de rendre possible la rénovation énergétique des 400 millions de mètres carrés concernés.
L’objectif est triple : réduire nos émissions de CO2 et préserver notre environnement, diminuer les factures énergétiques à la charge de l’État et des collectivités territoriales, enfin, améliorer les conditions de travail des agents et d’accueil du public.
C’est dans ce cadre d’action que le groupe RDPI a souhaité créer une mission d’information sur « Le bâti scolaire à l’épreuve de la transition écologique », puisque 12 millions d’élèves sont scolarisés chaque année.
Face aux défis colossaux qu’il nous faut relever, de nombreux leviers doivent être activés, afin de bénéficier d’expertises juridiques et techniques de qualité, mais aussi d’établir un diagnostic pour faciliter et de diversifier les sources et les modalités de financement. Le dispositif innovant dont nous discutons aujourd’hui se veut une réponse pertinente pour ce faire. Il vient encourager et faciliter le recours des personnes publiques aux contrats de performance énergétique, qui sont encore trop peu utilisés.
En levant quelques freins à l’investissement qui résultent du coût élevé que représentent les travaux, le texte que nous nous apprêtons à adopter définitivement vient déroger, sous forme expérimentale et pour une durée de cinq ans, au code de la commande publique. Il vise ainsi à engager plus facilement des travaux de rénovation énergétique en différant leur paiement.
Il s’agit ni plus ni moins de lisser le coût de la rénovation en faisant porter par un tiers le paiement immédiat des travaux, d’où le terme de « tiers-financement ». Cela permettra un remboursement progressif, sous forme de loyer annuel, en partie réalisé grâce aux économies d’énergie induites. Il s’agit bel et bien d’un nouvel outil au service de la transition énergétique, un « dispositif complémentaire » parmi d’autres, qu’il nous faudra évaluer.
Comme je le rappelais à l’occasion de l’examen en première lecture, il viendra s’ajouter, d’une part, aux partenariats public-privé, lesquels permettent aussi le tiers-financement, mais qui, en matière de rénovation énergétique, ne sont presque jamais utilisés par les collectivités territoriales, et, d’autre part, aux marchés globaux de performance.
Pour les élus locaux, le tiers-financement permettra de conserver la maîtrise d’ouvrage et de contractualiser en se basant sur une offre qui intégrera le financement et la réalisation des travaux de bout en bout.
Le texte de compromis trouvé en CMP ne diverge du texte établi par le Sénat que sur quelques points mineurs, comme vous nous l’avez précisé, madame la rapporteure.
En ce qui concerne l’article 1er bis, l’étude préalable à l’engagement de la procédure de passation d’un marché global de performance devra « démontre[r] que le recours à un tel contrat est plus favorable que le recours à d’autres modes de réalisation du projet », et non « au moins aussi favorable ». Mon groupe soutient cette formulation.
Il a également été précisé que la durée du marché global sera déterminée « en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues » ; encore une fois, nous y sommes favorables.
Le groupe RDPI votera pour ce nouvel outil mis au service de la transition énergétique.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.

M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le sujet est majeur, mais il ne s’agit pas pour autant d’un grand moment de la vie parlementaire. Au travers de ce texte, nous ne résoudrons pas le problème du réchauffement climatique, ni même celui de la rénovation de l’ensemble des 400 millions de mètres carrés de bâtiments publics…
Pour autant, grâce au texte élaboré en commission, puis grâce à la CMP conclusive, le Parlement peut rapidement mettre un nouvel outil au service des collectivités et des établissements publics pour atteindre des objectifs importants. Beaucoup d’entre vous ont évoqué ceux qui sont présents dans la loi Élan ; j’ajouterai pour ma part ceux du paquet Fit for 55.
En effet, ce paquet vise une réduction de 55 % des émissions carbone d’ici à 2030. Un trilogue, réuni en décembre dernier, a abouti à la mise en place à partir de 2027 d’un marché carbone pour les bâtiments.
Ce marché conduira à une augmentation du coût du chauffage pour l’ensemble des bâtiments publics et abondera le Fonds social pour le climat à hauteur de 25 %, le reste devant être financé par les différents pays de l’Union européenne. On estime ses revenus à environ 210 milliards d’euros pour la période 2027-2032, un montant consacré à l’accompagnement des efforts en matière de rénovation énergétique et, d’une manière générale, de lutte contre le réchauffement climatique.
Toutefois, face aux 400 millions de mètres carrés à rénover, qui, comme cela a été précisé, comprennent de nombreuses écoles, il est indispensable de disposer de nouveaux outils. Ce texte tend à déroger provisoirement au code de la commande publique, pour permettre aux collectivités ou aux établissements publics de faire porter de manière transitoire le financement d’opérations par un tiers-financeur. Un tel outil peut être utile.
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain émet quelques réserves et inquiétudes sur la proposition de loi issue de la CMP conclusive. J’en citerai trois.
Tout d’abord, l’effet rebond, bien connu en matière de rénovation énergétique, est à craindre : si les économies réalisées poussent à consommer plus que prévu dans d’autres secteurs, alors même qu’il faudra payer en décalage les travaux réalisés, les budgets de nos collectivités ou des établissements publics pourraient être fragilisés.
Ensuite, se concentrer sur la rénovation énergétique conduit à oublier d’autres rénovations indispensables, notamment, cela a été dit, en matière de sécurité ou de conservation du patrimoine. Si la rénovation se limite à la dimension énergétique et ne prend pas en compte l’ensemble des normes, des difficultés risquent de se présenter.
Enfin, nous avons une réserve sur les opérateurs potentiellement intéressés par ce tiers-financement. Il s’agira probablement des plus grosses entreprises, au détriment de celles qui présentent des compétences plus locales, qui n’auront pas la surface financière pour accompagner ce tiers-financement dont un certain nombre de collectivités ou d’établissements publics auront besoin.
Au-delà de ces réserves, nous considérons que ce texte représente un outil utile qui mérite d’être soutenu.
Monsieur le ministre, je voudrais que vous m’apportiez un éclaircissement. Les collectivités ont été évoquées, mais, en tant que sénateur représentant les Français de l’étranger, je crois qu’il faut également mentionner les établissements publics.
Nos établissements en gestion directe à l’étranger ont aussi besoin de rénovation énergétique et ils sont gérés par une agence qui n’a pas de capacité d’emprunt. Lorsque cette dernière émettra des propositions de rénovation énergétique, nous espérons que l’État autorisera le recours au tiers-financement pour ce type d’opérations. Le cas échéant, la solution serait intéressante pour nos établissements scolaires à l’étranger, qui sont bloqués dans leur développement.
En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit sur toutes les travées au sujet de cette CMP conclusive, nous voterons en faveur de cette proposition de loi.

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble de la proposition de loi visant à ouvrir le tiers financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.
La proposition de loi est adoptée.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à quinze heures quinze, est reprise à quinze heures vingt.

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (texte de la commission n° 429, rapport n° 428).
La parole est à Mme la rapporteure.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis heureuse de vous présenter les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à renforcer l’équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, le troisième volet des lois dites Égalim, c’est-à-dire pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
Le législateur tente de nouveau dans ce texte de réguler des relations commerciales plus tendues que jamais entre industriels et distributeurs, dans un contexte d’inflation croissante.
Je me réjouis que nous soyons parvenus à un accord entre sénateurs et députés sur des points cruciaux, comme le rééquilibrage des rapports de force entre ces acteurs, en affirmant le caractère d’ordre public de notre droit commercial et en protégeant la valeur des matières premières agricoles, donc le revenu des agriculteurs.
Les discussions ont été vives, compte tenu des éléments nouveaux que le Sénat a introduits dans le texte et des divergences de vues initiales entre nos deux assemblées, notamment sur les articles 2 et 3, mais nous avons su trouver des compromis au service de l’intérêt général.
Je tiens à souligner l’écoute et la qualité des échanges sur ce texte, que ce soit entre nous, mes chers collègues, ou avec l’auteur et rapporteur de la proposition de loi à l’Assemblée nationale, M. Frédéric Descrozaille – qu’il en soit remercié, ainsi que ses équipes.
La grande majorité des apports du Sénat, et ils sont nombreux, ont été conservés par la commission mixte paritaire.
Premièrement, nous avons contribué à protéger l’emploi, l’investissement et l’innovation dans nos territoires, en mettant fin pour les produits non alimentaires aux « promos chocs », qui sont devenues destructrices de valeur et qui mettent en jeu la survie des entreprises. Je pense bien sûr aux produits bradés, parfois jusqu’à des taux de 90 %, qui sont imposés aux fournisseurs par les distributeurs.
À l’heure où les politiques publiques tentent de réindustrialiser notre pays pour plus d’emplois et de souveraineté, il était essentiel d’être attentif aux entreprises du secteur de la droguerie, parfumerie, hygiène (DPH), ô combien déterminantes durant la crise sanitaire, qui produisent et créent de l’emploi dans nos territoires.
Mes chers collègues, je vous proposerai un amendement visant à ce que cette mesure entre en vigueur en 2024 ; s’il n’était pas adopté, tous les accords et plans d’affaires élaborés ces dernières semaines, pendant les négociations, deviendraient caducs.
Deuxièmement, nous avons complété le dispositif de protection des matières premières agricoles au sein des négociations commerciales, pour une plus juste rémunération des agriculteurs.
En effet, si ces matières premières sont sanctuarisées pour ce qui est de la négociation sur les marques nationales depuis la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite Égalim 2, ce n’était pas le cas pour les produits vendus sous marque de distributeur (MDD), alors même que ces produits prennent de plus en plus de place dans les rayons. C’est désormais chose faite.
Dans la même perspective de protection des filières agricoles, la commission mixte paritaire a conservé l’exclusion de la filière des fruits et légumes du dispositif de seuil de revente à perte, dit « SRP+10 », qui s’est révélé préjudiciable aux producteurs de cette filière depuis quatre ans. Il était temps de les en sortir, pour soutenir la production française de fruits et légumes et garantir sa pérennité.
Troisièmement, en ces temps d’inflation, nous avons renforcé les obligations de transparence des distributeurs quant à leur usage des 600 à 800 millions d’euros de recettes suscitées chaque année par le SRP+10.
Depuis 2018, le Sénat pointe la fragilité de ce dispositif opaque, unique en Europe, qui consiste à donner un chèque en blanc aux distributeurs en espérant qu’ils utiliseront cette marge pour mieux rémunérer les producteurs.
En CMP, nous sommes tombés d’accord avec nos collègues députés pour exercer un contrôle renforcé et raccourcir d’un an la durée de l’expérimentation, jusqu’en 2025.
Quatrièmement, les avancées du Sénat sur les pénalités logistiques ont été conservées. Si leur existence même n’est pas contestable, encore faut-il qu’elles soient utilisées à leur juste mesure et à bon escient par les distributeurs. Les dispositions que nous avons adoptées permettront de s’en assurer.
Enfin, nous avons longuement débattu de l’article 3, qui entend régir les cas où industriels et distributeurs ne se mettent pas d’accord au 1er mars.
Le compromis trouvé permet seulement au fournisseur, à titre expérimental, de choisir entre cesser subitement de livrer ou appliquer un préavis de rupture qui tiendra compte des conditions économiques du marché. Cette solution, qui ne nous semblait pas idéale, présente des inconvénients qui, nous l’espérons, ne se révéleront pas trop importants. Mais c’est le propre des CMP que de rechercher des compromis…
Tels sont, mes chers collègues, les différents points d’accord auxquels la CMP est parvenue. Je vous invite bien évidemment à en adopter les conclusions pour permettre la mise en œuvre rapide de ces dispositions, qui constituent des avancées considérables en matière de rééquilibrage des relations commerciales et, surtout, de protection de la rémunération des agriculteurs.
Applaudissements sur des travées des groupes UC et Les Républicains. – Mme la présidente de la commission des affaires économiques applaudit également.
Monsieur le président, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens tout d’abord à saluer l’accord trouvé en CMP sur cette proposition de loi relative à la juste répartition de la valeur – sujet capital pour l’avenir de l’agriculture ! – entre les différents maillons de la chaîne agroalimentaire. C’est le signe, je crois, d’une volonté partagée avec le Parlement d’œuvrer de façon continue en ce sens.
Cette proposition de loi, sur laquelle le Sénat va se prononcer définitivement, contribuera à la poursuite du rééquilibrage des relations commerciales dans la chaîne agroalimentaire et, ce faisant, à un meilleur partage de la valeur au bénéfice des agriculteurs.
Les ajustements apportés s’inscrivent dans la continuité de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, dite Égalim 1, et de la loi Égalim 2, respectivement de 2018 et 2021, qui ont déjà produit des effets tout à fait significatifs.
C’est du reste ce que constate l’inspection générale des finances dans son rapport actualisé sur l’inflation alimentaire, qui souligne une progression de l’excédent brut d’exploitation de la filière agricole et de l’industrie agroalimentaire (IAA). Ne nous y méprenons pas, ce sont des éléments déterminants pour préserver notre souveraineté alimentaire.
À cet égard, ce texte va globalement dans le bon sens, en particulier sur la nécessaire prolongation du dispositif expérimental de relèvement du seuil de revente à perte de 10 % pour les produits agricoles et alimentaires. Cette prolongation constituait une attente très forte du monde agricole.
Sur ce point, j’aimerais saluer ici l’esprit d’ouverture dans lequel les travaux du Sénat ont été conduits. Le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale proposait de prolonger l’expérimentation jusqu’en 2026. C’était aussi, vous le savez, la position exprimée clairement par le Gouvernement.
En commission, le Sénat a manifesté ses doutes – ceux-ci sont toujours utiles au débat – à l’égard de ce mécanisme, qu’il a proposé de le suspendre durant deux ans, le temps que la période inflationniste que nous traversons prenne fin.
J’avais alors rappelé devant vous, à l’occasion de l’examen du texte, qu’il s’agissait non pas d’opposer le revenu des agriculteurs à la protection du pouvoir d’achat des ménages, en particulier les plus modestes, mais bien de mener ces deux combats de front.
J’avais rappelé qu’il fallait, à mon sens, assumer collectivement le fait qu’une alimentation de qualité, sûre, produite dans des conditions respectueuses de notre environnement et de notre biodiversité ait un coût.
De même, j’avais souligné que le maintien d’un outil de production agricole et agroalimentaire dans nos territoires avait un coût. Et j’avais constaté avec vous que l’évaluation de cette expérimentation avait été rendue difficile par la crise sanitaire, à laquelle avait succédé un choc inflationniste concomitant de la guerre en Ukraine.
Il semblait donc nécessaire au Gouvernement de prolonger cette expérimentation, mais avec les dispositifs de contrôle et d’évaluation adéquats, pour répondre aux préoccupations légitimes de votre commission et de votre rapporteur.
C’est dans cet esprit que le Sénat a entendu les inquiétudes exprimées par le monde agricole et qu’il a voté la prolongation du SRP+10 jusqu’en 2025.
Bien sûr, le Gouvernement demeure convaincu qu’une prolongation de trois années à périmètre constant aurait été plus adaptée en termes de lisibilité et de cohérence du dispositif pour les acteurs des relations commerciales. Je pense naturellement à la désynchronisation des dates entre encadrements des promotions et SRP+10, ainsi qu’à l’exclusion des fruits et légumes sans justification préalable.
Toutefois, malgré ces deux réserves, l’équilibre global auquel la CMP est parvenue me semble satisfaisant.
J’en viens maintenant à l’article 3, qui fixe les modalités de la relation commerciale entre fournisseurs et distributeurs en cas d’échec de la négociation annuelle. Cette disposition, très discutée, avait pour objectif d’apporter une réponse adaptée à un angle mort des négociations commerciales annuelles.
Les opérateurs, qu’ils soient fournisseurs ou distributeurs, ont un intérêt commun à ce que les flux de ventes ne s’interrompent pas en cas d’échec de la négociation annuelle. Mais la relation commerciale doit parfois s’interrompre. C’est précisément cette situation qui requérait un encadrement juridique beaucoup plus précis.
Le Gouvernement considérait qu’un équilibre satisfaisant avait été trouvé à l’issue de vos travaux en commission. À cet égard, je tiens tout particulièrement à remercier de leur engagement Mme la présidente Sophie Primas et Mme la rapporteure Anne-Catherine Loisier, qui ont essayé de sécuriser juridiquement ce dispositif assez complexe tout au long de la navette. C’est en effet de visibilité et de clarté que les acteurs de la chaîne agroalimentaire ont besoin.
L’écriture retenue en CMP laisse un choix clair au fournisseur et dispose que tout préavis tient compte des conditions économiques de marché, précision ô combien utile en période inflationniste.
Par ailleurs, le recours à la médiation pour conclure un préavis est facultatif, ce qui évitera l’engorgement des saisines du médiateur et le report systématique que nous pouvions craindre de la date butoir.
C’est un texte qui a atteint son point d’équilibre en évitant les écueils que les versions antérieures avaient pu soulever. C’est aussi un texte empreint d’une certaine prudence, parce qu’il est expérimental. L’apport décisif du Sénat sur cet article doit être salué.
Je salue également le rehaussement des amendes administratives pouvant être infligées en cas de non-respect de la date du 1er mars. Je serai attentif à ce que nos services de contrôle s’en saisissent pleinement, afin de lutter contre les pratiques de certains distributeurs tentés de jouer la montre pour mettre la pression sur les producteurs.
Permettez-moi d’être moins disert sur les autres avancées de cette proposition de loi, que le Sénat a contribué largement à améliorer.
Le souhait d’un encadrement renforcé des pénalités logistiques est exaucé, avec des obligations plus précises et des sanctions alourdies.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez veillé au caractère opérationnel de cet enrichissement de notre cadre législatif. Il faut en finir avec cette exception très française consistant de la part de certains acteurs à reconstituer leurs marges par l’application de pénalités abusives.
Le mécanisme de suspension de l’application des pénalités logistiques en cas de circonstances exceptionnelles est également tout à fait pertinent. En témoignent les crises d’ampleur traversées ces dernières années, comme celle du covid-19, qui viennent légitimer auprès de nos concitoyens l’usage par l’État de ce type de prérogative régalienne.
Par ailleurs, la proposition de loi consacre la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve des dispositions applicables du droit de l’Union européenne, pour connaître des litiges portant sur les négociations commerciales annuelles. Il s’agissait d’un autre angle mort de notre droit qu’il convenait de rectifier. Comme vous, le Gouvernement a particulièrement à cœur de lutter contre les comportements de contournement de la loi française que nous constations tous.
Le texte apporte enfin quelques correctifs bienvenus à la loi Égalim 2, notamment en ce qui concerne la clause de renégociation, le fonctionnement de l’option 3 de transparence – un enjeu déjà soulevé par Daniel Gremillet – ou encore le renforcement du cadre applicable aux produits vendus sous marque de distributeur, que Laurent Duplomb, entre autres, a défendu. Je ne puis évidemment que partager cet objectif.
Pour conclure, je voudrais une nouvelle fois remercier tout particulièrement Mme la rapporteure et Mme la présidente de la commission de leur investissement dans l’examen de ce texte, de la finesse de leur expertise et de l’expression toujours respectueuse de leurs convictions.
Jamais les divergences de points de vue ou d’analyse qui se sont légitimement fait jour ne nous ont fait perdre de vue les finalités, à savoir la protection de nos agriculteurs et celle de notre souveraineté alimentaire. C’est ce chemin que nous devons continuer d’emprunter.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, RDSE et UC, ainsi qu ’ au banc des commissions.

Nous passons à la discussion du texte de la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
En conséquence, les amendements seront mis aux voix, puis le vote sur les articles sera réservé.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Dispositions générales
« Art. L. 443 -9. – Les chapitres Ier, II et III du présent titre s’appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou services commercialisés sur le territoire français. Ces dispositions sont d’ordre public. Tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
1° Le I ter est ainsi rédigé :
« I ter. – Le I du présent article n’est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
« Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le I du présent article est applicable, sur demande motivée de l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, d’une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;
2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « respectivement avant le 1er octobre 2021 et avant le 1er octobre 2022 deux rapports » sont remplacés par les mots : «, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « remis avant le 1er octobre 2022 » sont supprimés ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est associé à son élaboration. » ;
3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat ce document, qui ne peut être rendu public. » ;
4° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Le I et le premier alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2025.
« Le II et le second alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2026. »
II. –
Supprimé
(Texte du Sénat)
Le III de l’article L. 441-4 du code de commerce est complété par les mots : « ainsi que chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale et leur prix unitaire ».
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le 4° du I de l’article L. 442-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « S’agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l’article L. 441-1-1, » sont supprimés ;
2° La référence : « L. 443-8 » est remplacée par la référence : « L. 441-4 ».
(Supprimé)
(Texte de la commission mixte paritaire)
La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : «, notamment celle des produits issus de l’agriculture biologique ».
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de la mise en place d’un encadrement des marges des distributeurs sur les produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine afin qu’elles ne puissent pas être supérieures aux marges effectuées sur les produits conventionnels.
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
1° À la fin du A du II, les mots : « denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation au sens du premier alinéa de l’article L. 441-4 du code de commerce » ;
2° Au 2° du C du même II, le mot : « alimentaires » est remplacé par les mots : « de grande consommation » ;
3° Au premier alinéa du III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation pour lesquels » ;
4° Au 1° du même III, les mots : « denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées » sont remplacés par les mots : « produits de grande consommation concernés » ;
5° Le 2° dudit III est ainsi rédigé :
« 2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1°, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des produits ou catégories de produits concernés. Pour les denrées ou les catégories de denrées alimentaires, lorsqu’une interprofession représentative des denrées ou des catégories de denrées concernées existe, la dérogation fait l’objet d’une demande présentée par ladite interprofession. » ;
6° Le second alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets de l’encadrement des promotions prévu au II du présent article sur les prix de vente des produits de grande consommation. Ce rapport analyse ces effets en distinguant, d’une part, les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et, d’autre part, les autres produits de grande consommation. Il analyse spécifiquement les conséquences sur l’évolution du revenu des agriculteurs et les effets de la mesure sur les petites et moyennes entreprises. Il précise, le cas échéant, la liste des pratiques constatées par les services de l’État tendant à contourner les objectifs dudit encadrement et indique les moyens mis en œuvre pour remédier à ces pratiques. »
(Texte de l’Assemblée nationale)
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, les mots : « expérimentation de » sont supprimés.
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 441-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La négociation de la convention écrite est conduite de bonne foi, conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil. » ;
1° bis
Supprimé
2° L’article L. 442-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément aux dispositions de l’article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l’article L. 441-3 ou à l’échéance de la durée d’un mois mentionnée à l’article L. 441-4-1 » ;
b) Le premier alinéa du II est complété par les mots : «, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties » ;
3° L’article L. 443-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du VII, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux I à VI du présent article » ;
b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Pour les produits mentionnés au I du présent article, les dispositions du II de l’article L. 442-1 sont applicables ainsi que, pour la détermination du prix applicable durant la durée du préavis, le II du présent article. »
II. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, à défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :
– soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier ne puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442-1 du code de commerce ;
– soit demander l’application d’un préavis conforme aux dispositions du II du même article L. 442-1.
Les parties peuvent également saisir la médiation des relations commerciales agricoles ou des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier ne puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II dudit article L. 442-1 ou demander l’application d’un préavis conforme aux dispositions du même II.
(Texte du Sénat)
L’article L. 441-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l’article L. 441-4, le non-respect de l’échéance du 1er mars prévue au IV de l’article L. 441-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
Après le I de l’article L. 441-3 du code de commerce, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les obligations réciproques en matière de logistique auxquelles s’engagent le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service, notamment le montant des pénalités mentionnées à l’article L. 441-17 et les modalités de détermination de ce montant, font l’objet d’une convention écrite, distincte de celle mentionnée au I du présent article. Les dispositions du IV du présent article relatives à l’échéance du 1er mars ne s’appliquent pas à cette convention.
« L’arrivée à échéance ou la résiliation de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne saurait entraîner la résiliation automatique, le cas échéant, de la convention écrite mentionnée au I. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-17 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée. » ;
a bis) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l’inexécution d’engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant. » ;
a ter) La première phrase du quatrième alinéa du même I est ainsi rédigée : « Lorsque le distributeur, conformément au premier alinéa du présent I, transmet au fournisseur un avis de pénalité logistique en raison d’une inexécution d’engagement contractuel, il apporte en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement constaté et celle du préjudice subi. » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé de l’agriculture peuvent, en cas de situation exceptionnelle, extérieure aux distributeurs et fournisseurs, affectant gravement les chaînes d’approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs, suspendre par décret en Conseil d’État l’application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre entre les distributeurs et le ou les fournisseurs intervenant dans ces secteurs et concernés par ladite situation, pour une durée maximale de six mois renouvelable. » ;
2° Les deuxième et troisième phrases de l’article L. 441-18 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur, au sein de la commande, de la catégorie de produits commandés concernée par l’inexécution desdits engagements. »
II. –
Supprimé
(Texte du Sénat)
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-17 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le présent article n’est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l’article L. 441-4. » ;
2° L’article L. 441-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable aux relations commerciales avec les grossistes au sens du II de l’article L. 441-4. »
(Texte du Sénat)
L’article L. 441-19 du code de commerce est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants de pénalités logistiques qu’il a infligées à ses fournisseurs au cours des douze derniers mois, ainsi que les montants effectivement perçus. Il détaille ces montants pour chacun des mois.
« Chaque distributeur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, avant le 31 décembre 2023, les montants de pénalités logistiques qu’il a infligées à ses fournisseurs respectivement en 2021 et en 2022, en les détaillant mois par mois, ainsi que les montants effectivement perçus.
« Chaque fournisseur communique au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou à son représentant nommément désigné, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les montants de pénalités logistiques qui lui ont été infligés par ses distributeurs au cours des douze derniers mois, ainsi que ceux qu’il a effectivement versés.
« Le Gouvernement transmet chaque année au président de la commission chargée des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat une synthèse des communications prévues aux deuxième à quatrième alinéas du présent article, qui ne peut être rendue publique. Il précise, le cas échéant, les manquements aux dispositions de l’article L. 441-17 constatés par le ministre chargé de l’économie ainsi que les actions mises en œuvre pour les faire cesser.
« Tout manquement aux deuxième à quatrième alinéas du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et à 1 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le 3° du I de l’article L. 441-1-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention, aux frais du fournisseur, d’un tiers indépendant chargé d’attester la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette attestation, notamment la méthodologie employée pour déterminer l’impact sur son tarif de l’évolution du prix desdites matières premières agricoles ou desdits produits transformés. L’attestation est fournie par le fournisseur au distributeur dans le mois qui suit l’envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, le tiers indépendant est aussi chargé d’attester au terme de la négociation que, conformément au II de l’article L. 443 8, celle-ci n’a pas porté sur la part de l’évolution du tarif du fournisseur qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. À défaut d’attestation dans le mois qui suit la conclusion du contrat, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial. »
(Texte du Sénat)
L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La négociation du prix ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441-1-1. » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :
« I bis A. – Lorsque le contrat porte sur une période supérieure à douze mois, il fixe une date annuelle à laquelle le prix est renégocié pour tenir compte des fluctuations des prix des matières premières entrant dans la composition du produit.
« La négociation ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant à l’occasion de cette renégociation, que représente le prix des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit. Le quatrième alinéa du I du présent article s’applique lors de cette renégociation. »
(Texte du Sénat)
Le IV de l’article L. 443-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « de la matière première agricole » sont remplacés par les mots : « des matières premières agricoles » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les évolutions de prix résultant de la clause de révision automatique des prix sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause. »
(Texte du Sénat)
I et II. –
Supprimés
III. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au V de l’article L. 441-1-1, les mots : « au sens du II de l’article L. 441-4 » sont remplacés par les mots : « tels que définis au I de l’article L. 441-1-2 » ;
2° Après le même article L. 441-1-1, il est inséré un article L. 441-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 441 -1 -2. – I. – Le grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou à plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilés à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.
« Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.
« II. – Les conditions générales de vente applicables aux grossistes, tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les acheteurs, comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
« III. – Tout grossiste qui établit des conditions générales de vente est tenu de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.
« Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent III porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs.
« IV. – Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale.
« Dans le cadre de cette négociation, le grossiste et son acheteur peuvent convenir de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au III.
« Lorsque le prix d’un service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
« V. – L’article L. 441-1-1 n’est pas applicable aux grossistes.
« VI. – Tout manquement au II du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. » ;
3° Après l’article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441 -3 -1. – I. – La convention écrite conclue soit entre le fournisseur et le grossiste, tel que défini au I de l’article L. 441-1-2, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.
« II. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.
« III. – La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :
« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix et, le cas échéant, les types de situation et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;
« 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou des services du fournisseur, que le grossiste lui rend, ou des produits ou des services du grossiste, que le distributeur ou le prestataire de services lui rend, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou les services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;
« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale, soit entre le fournisseur et le grossiste, soit entre le grossiste et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations ;
« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels se rapporte tout service ou toute obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.
« IV. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.
« V. – Le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente telles que définies à l’article L. 441-1-2, dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou les services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.
« VI. – Les articles L. 441-4 et L. 443-8 ne sont pas applicables aux grossistes tant dans leurs relations avec les fournisseurs que dans leurs relations avec les distributeurs ou les prestataires de services. » ;
4° Le II de l’article L. 441-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « grossiste », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «, tel que défini au I de l’article L. 441-1-2. » ;
b) La deuxième phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé.
(Texte du Sénat)
L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains produits agricoles et alimentaires pour lesquels, par dérogation, le I du présent article n’est pas applicable. Cette dérogation fait l’objet d’une demande motivée de l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, d’une organisation professionnelle représentant des producteurs. »
(Texte du Sénat)
L’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa du II, après la seconde occurrence du mot : « conclusion », il est inséré le mot : « et » ;
2° Le VIII est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le présent VIII n’est pas applicable aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers au sens du III de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, ou comportant une indexation à de tels contrats ou des stipulations qui prévoient la conclusion d’un contrat financier pour la détermination du prix. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux contrats conclus par les collecteurs mentionnés à l’article L. 666-1 du présent code lorsqu’ils prévoient une indexation conformément au 1° du III du présent article et en l’absence de contrat financier de référence. » ;
3° Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. – Pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent article, les parties peuvent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »
(Supprimé)

Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par la commission.

Sur les articles 1er à 2 ter BA, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.

L’amendement n° 1, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er mars 2024.
La parole est à Mme la rapporteure.

Cet amendement vise à réparer un oubli de la CMP.
Il s’agit de préciser la date d’entrée en vigueur de l’encadrement des produits non alimentaires, que nous proposons de fixer au 1er mars 2024.
Le Gouvernement et le Sénat étaient en désaccord sur ce point.
Cela dit, ce dispositif ayant été voté et approuvé en CMP, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
L ’ amendement est adopté.

Sur l’article 2 ter, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article ?…
Le vote est réservé.

L’amendement n° 2, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer les mots :
ou à l’échéance de la durée d’un mois mentionnée à l’article L. 441-4-1
La parole est à Mme la rapporteure.
L ’ amendement est adopté.

Sur les articles 3 bis A et 3 bis B, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.

L’amendement n° 3, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – En cas de situation exceptionnelle, extérieure aux distributeurs et fournisseurs, affectant gravement les chaînes d’approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs, l’application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre entre les distributeurs et le ou les fournisseurs intervenant dans ces secteurs et concernés par ladite situation peut être suspendue par décret en Conseil d’État, pour une durée maximale de six mois renouvelable. » ;
La parole est à Mme la rapporteure.
L ’ amendement est adopté.

Sur les articles 3 ter A à 5, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.

L’amendement n° 4, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-8 est ainsi modifié :
II. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
par la référence :
a)
III. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « deux premiers alinéas », sont insérés les mots : « du présent I » ;
IV. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
par la référence :
c)
V. – Compléter cet article par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :
2° À l’article L. 954-3-5, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du I ».
II. – À l’article L. 631-25-1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « troisième alinéa », sont insérés les mots : « du I ».
La parole est à Mme la rapporteure.
L ’ amendement est adopté.

Sur les articles 7 à 8, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements de la commission, je vais donner la parole, pour explication de vote, à un représentant par groupe.
La parole est à Mme Amel Gacquerre, pour le groupe Union Centriste.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, 14, 5 %, tel est le bond qu’ont réalisé les tarifs des produits alimentaires entre les mois de février 2022 et février 2023 selon l’Insee. Au-delà d’un mois de mars alarmant, c’est la preuve qu’une année noire vient de s’écouler pour les Français.
Cette inflation inédite des prix de l’alimentation frappe en premier lieu les portefeuilles des consommateurs les plus modestes, ce que nous ne pouvons accepter.
Notre action en faveur du pouvoir d’achat ne signifie pas pour autant que nous devons pénaliser les petites et moyennes entreprises, les coopératives agricoles et nos exploitations qui font tout pour que les Français puissent bénéficier de produits de qualité au prix le plus compétitif possible.
Pour ce faire, nous devions corriger le déséquilibre inhérent à la relation fournisseurs-distributeurs, qui demeure très souvent défavorable à nos producteurs. C’est tout le sens de l’initiative présentée par Frédéric Descrozaille.
Remanié grâce au travail de fond effectué par le Sénat et par la commission mixte paritaire, ce texte complète les mesures issues des deux lois Égalim.
Nous pouvons aujourd’hui nous féliciter d’avoir conservé les principales avancées du Sénat dans la rédaction finale.
Je pense tout d’abord à l’ancrage définitif du principe de non-négociabilité des matières premières agricoles et de sa déclinaison pour les produits vendus sous marque de distributeurs. C’était attendu ; nous l’avons fait. Cette disposition était essentielle pour assurer à nos agriculteurs une plus juste rémunération de leur travail.
Nous avons aussi su entendre les demandes de la filière des fruits et légumes frais, que nous avons exclue du dispositif du seuil de revente à perte, ce fameux SRP+10, hérité des lois Égalim, qui instaure une marge obligatoire de 10 %. Il était primordial d’agir vite, car les effets néfastes sur la rémunération de ces exploitations étaient réels.
Enfin, nous avons fait un pas en avant non négligeable concernant l’encadrement de l’arme absolue des distributeurs : les pénalités logistiques. Les dérives et les excès étaient connus. Au moindre retard, quelles qu’en soient les raisons, les distributeurs sanctionnaient lourdement les fournisseurs, ce qui pouvait conduire ces derniers à des situations financières dramatiques.
Le plafonnement du montant des pénalités logistiques et le renforcement de leur encadrement sont de véritables victoires pour l’ensemble de ces industriels et de ces exploitations agricoles qui assurent l’approvisionnement des Français au quotidien.
En sus de ces avancées, je me réjouis de voir que la commission mixte paritaire a su trouver un compromis concernant l’encadrement de la période de négociation commerciale annuelle.
En cas d’échec de ces négociations, l’alternative proposée entre l’interruption des livraisons et l’application du préavis de rupture « classique » constitue un consensus à même de rééquilibrer la relation entre distributeurs et fournisseurs.
Il sera de notre responsabilité de dresser le bilan de cette expérimentation et de prendre la bonne décision quant à sa pérennisation. Je sais la qualité du travail réalisé par le groupe de suivi de la loi Égalim. Je suis donc persuadée que celui-ci sera tout aussi efficace pour étudier la mise en œuvre de cette mesure.
Parce que cette proposition de loi est un texte exigeant, qui met en lumière certaines limites du droit en vigueur, et parce qu’elle est le fruit d’un travail de compromis avec l’ensemble des acteurs politiques, économiques et des mondes agricoles et industriels, la majorité des membres du groupe Union Centriste votera en faveur de son adoption.
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi qu ’ au banc des commissions.

M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà un pas de plus en avant !
Nous avons décidé d’appréhender ce texte de façon positive, en ce qu’il est le reflet de plusieurs dispositions proposées par le Sénat. La CMP a été conclusive, et nous devons nous en réjouir, car le contexte de négociations commerciales tendues, dans une période d’inflation galopante, qui induit des efforts communs, nous impose la raison. Mais les efforts sont-ils communs ?
L’inflation, qui fait la une de tous les médias, nous assène des hausses de prix incroyables : 14 % pour l’alimentation et jusqu’à 30 % pour la viande dans certains endroits. Le trimestre du panier anti-inflation a commencé par un constat mitigé de la part des consommateurs, ceux d’entre eux qui vivent dans la précarité ne pouvant acheter les produits dont les tarifs ont pourtant baissé.
Dans cette guerre des prix, les distributeurs s’achètent une conscience tout autant qu’une image en affichant un objectif bienveillant : faire supporter le moins possible au consommateur les conséquences de l’inflation. Mais qui paye ?
On parle d’un financement grâce à la baisse des marges. C’est oublier que la guerre des prix a toujours été à charge pour les producteurs. Et ce sont les agriculteurs, une fois de plus, qui payent la note et subissent une double peine, pris entre l’inflation des prix des matières premières – emballages, carburant, produits phyto, etc. – et une asphyxie à la vente, avec des prix négociés au plus bas. Personne n’est dupe !
Les médias se polarisent sur cette hausse des prix des produits alimentaires, mais le budget d’un foyer n’est-il pas actuellement plus fortement atteint par d’autres postes, tels que l’énergie ou les loyers ?
Cette situation suscite des problèmes quant au modèle d’agriculture verte déterminé par l’Europe. La France, bon élève, en haut du tableau d’honneur, perd en compétitivité : quand le bio, par exemple, se vend au prix du conventionnel, un énorme problème se pose, qu’il faut résoudre rapidement. Certains agriculteurs se désengagent de ces modes de production qui sont plus onéreux et n’offrent aucun débouché à certains produits. Il faut agir très vite !
C’est la raison pour laquelle, comme je l’ai déjà souligné dans cet hémicycle, il faut revoir la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, la LME, qui a permis à la grande distribution de mutualiser via la mise en place de centrales d’achats. Cette mesure a renforcé la pression sur les agriculteurs. Nous devons y travailler et tirer, a minima, un bilan objectif après quinze ans d’application.
Dans ce contexte commercial tendu, toute mesure positive pour les agriculteurs doit être encouragée et défendue. Mon groupe salue donc plusieurs avancées.
L’article 1er, tout d’abord, rappelle que les dispositions du code de commerce s’appliquent à toute relation contractuelle dès lors que les produits que celle-ci vise sont commercialisés en France. Il s’agit ici de contrer le phénomène d’évasion juridique consistant à délocaliser la négociation contractuelle, afin de la soumettre à des dispositions juridiques plus favorables et moins protectrices des intérêts des agriculteurs français et du fabriqué en France.
L’article 2 prolonge les dispositions de la loi Égalim 1 sur l’encadrement des promotions et le seuil de revente à perte, déjà prolongées une première fois par la loi d’accélération et de simplification de l’action publique, dite loi Asap, en 2020.
Le SRP+10 est prorogé jusqu’en 2025, comme l’avait voté le Sénat en première lecture. L’exclusion de la filière des fruits et légumes du dispositif est maintenue, conformément à plusieurs amendements adoptés par le Sénat, notamment celui de ma collègue Nathalie Delattre.
La CMP a conservé la disposition introduite par le Sénat sur la non-négociabilité des matières premières agricoles des produits vendus sous marques de distributeur. C’est à mon sens un acquis important.
Un grand pas est également franchi avec l’expérimentation de rupture des livraisons en cas d’échec des négociations commerciales annuelles entre un fournisseur et un distributeur. Cette mesure répond clairement à un enjeu d’équilibre entre ces deux parties.
Je salue Mme la rapporteure, Anne-Catherine Loisier, qui a déclaré : « Le Parlement est obligé d’intervenir, non pas par plaisir, mais parce que les acteurs se livrent à une partie de “poker menteur” qui se fait souvent au détriment des consommateurs, des agriculteurs et des PME. » Vous avez bien raison, madame la rapporteure, et nous sommes nombreux à partager ce constat.
Toutefois, ne soyons pas trop naïfs, car cela pourrait se retourner contre les agriculteurs français, la concurrence mondiale étant à l’affût. Dans une économie de marché libérale qui se conjugue à un contexte d’inflation exacerbée, les distributeurs achèteront ailleurs. L’article 1er est donc fondamental pour enrayer ce risque.
Bref, la voie est bonne, mais il faut persévérer, car l’un des problèmes majeurs de notre agriculture est le faible revenu. Alors que se profilent le pacte et la loi d’orientation et d’avenir agricoles, le sujet du prix rémunérateur doit être l’un des enjeux primordiaux de notre réflexion.
Au-delà de l’orientation et de la formation nécessaires, de l’installation et de la question primordiale de la transmission ou de l’adaptation obligatoire au changement climatique, il ne faut pas oublier une question essentielle : pour soixante heures de travail hebdomadaires en moyenne, il faut un revenu à la hauteur ! La logique est implacable : il y va de notre souveraineté alimentaire.
Mon groupe votera bien entendu en faveur de cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et RDPI, ainsi que sur des travées des groupes UC et Les Républicains et au banc des commissions.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte est effectivement un rendez-vous supplémentaire s’agissant de la mise en marché des productions agricoles.
Comme nous l’avions dit à plusieurs reprises – je parle sous le contrôle de mes collègues de la commission des affaires économiques –, nous savions que la loi Égalim 1 nécessiterait des modifications. Nous en sommes à la troisième modification, et sans doute la quatrième, voire la cinquième, interviendra-t-elle bientôt, mais n’anticipons pas.
En cet instant, je souhaite remercier Mme la rapporteure, car le travail qu’elle a réalisé permet de résoudre un problème absolument considérable. En effet, dans le cadre des produits des marques de distributeur, les MDD, les lois Égalim 1 et Égalim 2 ne concernaient pas 50 % de la mise en marché des matières agricoles. Pis, si on considère la moyenne sur les dix dernières années, nous avions, avant même la loi, une montée en gamme de 2, 3 % à 2, 5 % par an, en prenant en compte le couplage volume-prix.
En 2022, nous avons assisté à un arrêt historique de la montée en gamme, puisque nous avons connu une diminution de 1, 3 %, toujours en tenant compte du couplage volume-prix.
Je le rappelle, les marques prennent à leur charge la recherche et l’innovation, ainsi que tout ce qui concerne les avancées réalisées dans le pays en matière de sécurité alimentaire. Ce sont, en langage cycliste, des « suceurs de roue » : elles utilisent et généralisent ce qui a été fait, si cela fonctionne.
J’y insiste, monsieur le ministre, grâce au travail mené par le Sénat, qui a été repris par la commission mixte paritaire, l’ensemble de la matière agricole mise sur le marché sera désormais protégé.
Par ailleurs, le sujet du seuil de revente à perte, le SRP+10, est également très important. L’initiative prise à la demande des producteurs de fruits et légumes pourra apporter un espoir supplémentaire à cette filière ô combien importante pour nos territoires !
J’en viens au secteur des DPH, droguerie, parfumerie, hygiène. Nous avons trouvé le moyen de protéger nos entreprises sur nos territoires. Certaines entreprises, très exposées, pouvaient rapidement perdre leur part de marché, compte tenu des exigences demandées. Là encore, sans faiblesse, le Sénat a maintenu sa position, et j’en remercie Mme la rapporteure.
S’agissant de l’article 3, nous avons trouvé un compromis. Mais les travaux que nous avons menés dans le cadre du groupe de suivi du Sénat en témoignent – je remercie à cet égard toute l’équipe de la commission des affaires économiques –, nous devrons sans doute très rapidement revenir sur le sujet.
Toutefois, ce texte est un compromis, et compte tenu de l’importance du sujet MDD, il paraissait essentiel de protéger l’ensemble des productions agricoles.
Bien évidemment, le groupe Les Républicains votera le texte de la commission mixte paritaire, qui est favorable à l’agriculture.
Pour finir, monsieur le ministre, je souhaite vous alerter sur un point. Alors que nous n’avons pas encore voté définitivement cette proposition de loi, M. le ministre de l’économie et des finances affirme d’ores et déjà qu’il faut entrer dans les box de la renégociation pour le mois de mai.
Or, vous le savez, les chiffres présentés par le Sénat n’ont pas été démentis. Concernant la MPA, la matière première agricole, les prix ont été respectés pour ce qui concerne les marques et seront sanctuarisés par les MDD.
Pourtant, nous le savons tous, monsieur le ministre, pour ce qui concerne la MPI, la matière première industrielle, à peine un tiers est appliqué ! S’agissant des négociations commerciales de 2023, nous savons que la situation se répétera à l’identique.
Méfions-nous donc des déclarations trop rapides, qui pourraient mettre en péril les espoirs des agriculteurs, des consommateurs, des distributeurs, ainsi que des diverses entreprises agricoles dans notre territoire, qui est si riche.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.

La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est la troisième fois en cinq ans que nous nous penchons sur un texte visant à réglementer les relations entre agriculteurs, producteurs, transformateurs, industriels, fournisseurs et distributeurs.
Si nous y revenons, c’est non pas par coquetterie, mais par nécessité. Depuis le début, la loi Égalim a eu pour objet une meilleure répartition de la valeur sur toute la chaîne. Or nous constatons, comme c’est souvent le cas, un écart entre la théorie et la pratique.
Par ailleurs, il s’agit de métiers évoluant dans le temps et affectés par des phénomènes extérieurs, tels que le contexte international et l’explosion des coûts de l’énergie, sur lesquels l’Europe doit se pencher lors du prochain Conseil européen, même si nous regrettons d’ores et déjà qu’il ne soit pas prévu de remettre en cause l’indexation du prix de l’électricité sur le gaz.
Je pense également à la hausse des matières premières et à l’inflation générale, qui jouent sur les coûts de production, de transformation et de distribution des acteurs de la filière.
Derrière ces questions se pose celle de notre capacité à rester l’une des premières puissances agricoles et celle de notre souveraineté alimentaire, donc le problème central de notre indépendance.
Si la loi Égalim est un sujet très important pour l’agriculture, elle ne constitue pourtant pas la question essentielle. La vraie difficulté, c’est que, à coups de normes, à force de vouloir laver plus blanc que blanc, on a attaché depuis longtemps un boulet aux agriculteurs français.
Monsieur le ministre, nous attendons donc beaucoup de la future loi agricole et de l’engagement pris par le Président de la République au salon de l’agriculture sur le lancement d’un nouveau plan visant à coordonner l’action de la France avec celle de l’Union européenne, avec l’objectif de ne pas pénaliser les agriculteurs français par rapport à leurs voisins, auxquels s’imposent des normes moindres.
Nous saluons les avancées trouvées en commission mixte paritaire, qui reprennent des apports importants du Sénat. Depuis la loi Égalim 1, nous sommes tous animés par le même objectif : faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, du fournisseur au consommateur, en passant par le distributeur.
Nous le savons, l’équilibre n’est pas facile à trouver. L’article 2 relatif à l’expérimentation du seuil de revente à perte a fait couler beaucoup d’encre. Et pour cause ! L’efficacité du dispositif n’a toujours pas été prouvée. La prolongation de l’expérimentation nous permettra, nous l’espérons, d’apporter des précisions.
S’agissant de l’exclusion, sur sa demande, de la filière fruits et légumes, nous pensons que tout le monde ou presque sera d’accord pour l’accorder.
L’autre avancée concerne l’exclusion des grossistes du système des pénalités logistiques.
Nul ne conteste l’utilité des pénalités en cas de non-respect des obligations du contrat, qui permet de s’assurer que le distributeur sera bien livré dans les temps et conformément à ce qu’il a commandé. Cependant, des dérives ont été constatées. Les pénalités logistiques semblent être devenues une façon, pour la grande distribution, de compenser des pertes de marge sur certains produits.
Ces dispositions ont donc été revues dans cette proposition de loi. Elles ont d’ailleurs été portées par plusieurs sénateurs du groupe Les Indépendants – République et Territoires, l’objectif étant d’éviter que les règles des pénalités logistiques n’aillent à l’encontre de la filière et de ses intérêts.
Pour ce qui concerne l’article 3, il fallait régler le vide juridique existant lorsque fournisseurs et distributeurs ne trouvent pas d’accord et empêcher que, dans certains cas, un fournisseur ne puisse livrer à perte contre sa volonté.
Depuis le début, la loi Égalim n’a pas apporté des résultats à la hauteur des espoirs suscités. C’est pourquoi nous y revenons pour proposer des améliorations. À n’en pas douter, nous y reviendrons encore. Nous en sommes à la saison 3 d’Égalim, et ce n’est sûrement pas la dernière de la série !
Même si nombre d’entre nous croient au marché, nous savons qu’il a besoin de règles, d’un cadre et d’un suivi, afin de nous assurer que, dans le prix final du produit payé par le consommateur, chaque acteur soit rémunéré à sa juste valeur.
Monsieur le ministre, je le répète, nous attendons beaucoup de la future loi agricole. Nous sommes à vos côtés pour travailler sur les futurs pacte et loi d’orientation et d’avenir agricoles, en matière de formation, de transmission des exploitations et d’adaptation au changement climatique.
Le groupe Les Indépendants votera donc en faveur de ce texte issu de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi qu ’ au banc des commissions.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous le savons tous, l’inflation alimentaire poursuit sa course, avec pour conséquence des difficultés pour les producteurs, les fournisseurs et, bien sûr, un grand nombre de nos concitoyens. Dans ce contexte, nous nous apprêtons à voter une nouvelle loi pour tenter de rééquilibrer les rapports de force au sein de ces relations commerciales.
Jusqu’à aujourd’hui, ces tentatives – je pense aux lois Égalim 1 et 2 – ont toujours abouti, face à une grande distribution toute-puissante, à un revenu agricole indécent et à des difficultés pour de nombreuses PME agroalimentaires. Si le texte que nous allons voter aujourd’hui comporte quelques avancées, on ne peut que douter de son efficacité, comme de celle des textes qui l’ont précédé.
Certes, de petits pas sont effectués pour corriger les déséquilibres du système. Je pense notamment aux mesures sur les MDD, les pénalités logistiques ou la lutte contre les contournements de la loi via les centrales étrangères.
Toutefois, dans un secteur marqué par une forte opacité et des rapports de force violents, l’incertitude sur l’efficacité des mesures et leurs effets de bord éventuels persiste, comme le montre la question du seuil de revente à perte. En effet, si on peut se satisfaire qu’un compromis ait été trouvé, on ne peut qu’espérer une fois de plus qu’il permette un vrai ruissellement pour les agriculteurs.
Pour le groupe écologiste, il faut des mesures bien plus structurantes pour trouver l’équation garantissant à la fois un revenu à nos agriculteurs et une accessibilité à une alimentation durable et de qualité pour tous.
Pour ce qui concerne la première partie de l’équation, sans régulation des marchés, sans clauses miroirs, sans paiements pour services environnementaux, sans une PAC plus juste, sans une promotion du commerce équitable, nous ne parviendrons pas à rémunérer correctement les producteurs.
Nous nous devons de sortir l’alimentation d’une concurrence mondiale délétère, qui est l’une des principales causes de la faiblesse du revenu agricole.
Je voudrais ici évoquer l’accord avec le Mercosur, une nouvelle fois. En effet, pendant que nous votons ce texte, en nous félicitant d’agir pour les agriculteurs, la filière bovine s’inquiète, dans la presse, d’une possible volte-face de la France s’agissant de son engagement de non-ratification de ce traité. Nous devons refuser ces accords de libre-échange, qui auront, nous le savons déjà, bien plus d’impacts négatifs sur le revenu agricole – sans même évoquer les effets délétères sur l’environnement –, que ce texte n’aura d’impacts positifs.
J’en viens maintenant aux consommateurs. Les mesures visant à mieux rémunérer les producteurs doivent s’accompagner de politiques fortes pour un accès à l’alimentation durable et de qualité pour tous, en particulier dans un contexte d’inflation.
Ici encore, les leviers sont connus. Une partie des mesures a même déjà été votée : je veux parler de la loi Égalim 1, qui comportait des engagements, à savoir 20 % de bio et 50 % de local et de qualité dans la restauration collective. Or ce pan de la loi n’est pas appliqué, et cela dans l’indifférence générale.
On peut rappeler également les divers errements du chèque alimentation durable, qui a été voté dans la loi Climat et résilience, puis reporté, abandonné, puis, récemment, annoncé comme possible au niveau départemental. Encore une fois, il règne un trop grand flou autour d’une mesure susceptible de contribuer à concilier débouché rémunérateur et accès à l’alimentation durable. Nous continuons donc de plaider pour une véritable sécurité sociale de l’alimentation.
Sans grand espoir, nous voterons ce texte, dont nous reconnaissons les avancées. Pour autant, nous savons qu’il nous faudra nous remettre à l’ouvrage dans les mois qui viennent.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi qu ’ au banc des commissions.

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’était le 15 mars dernier : deux CMP, deux salles, deux ambiances… Quoi qu’il en soit, je me félicite du bon travail mené ensemble, entre l’Assemblée nationale et le Sénat, ainsi qu’entre les différents groupes parlementaires, pour aboutir à un compromis dans ce texte issu de la commission mixte paritaire.
Grâce à ce texte, nous parachevons le travail engagé avec Égalim 1 et Égalim 2. Nous permettons la correction de dérives inadmissibles, qui sont le fruit du déséquilibre dans le rapport de force et dans les négociations commerciales.
Il faut sans cesse s’adapter à la créativité d’un certain nombre de centrales – j’ai notamment en tête l’article 1er –, car un certain nombre d’entre elles mènent leurs négociations hors de France, afin de contourner notre législation. Ce sera impossible après l’adoption de ce texte.
Je me réjouis que le texte de la CMP maintienne les éléments essentiels de la proposition de loi initiale portée par Frédéric Descrozaille, ainsi que des ajouts issus du Sénat, tels que la prolongation de l’expérimentation du SRP+10 et de l’encadrement des promotions, la correction des effets de bord et l’exemption de la filière fruits et légumes.
Au vu des chiffres, il fallait agir. C’est fait ! Je pense aux produits DPH, un sujet porté de longue date dans cet hémicycle. Je pense également à l’encadrement des pénalités logistiques, un système qui était dévoyé, il faut le dire très clairement, ainsi qu’à la non-négociabilité des MPA pour les produits vendus sous marque de distributeur. Cette mesure permettra aux agriculteurs de ne pas être pénalisés par les négociations ardues sur ces produits.
Quant à l’article 3, il est le fruit de la réflexion collective. Il y a eu une version issue de l’Assemblée nationale, adoptée en commission, puis en séance, et une version issue du Sénat, adoptée en commission, puis en séance. Mais en commission mixte paritaire, nous avons trouvé, me semble-t-il, un bon équilibre.
Cela permettra, à titre expérimental, que le fournisseur ait le choix entre l’interruption des livraisons, si le prix durant le préavis est jugé trop bas, ou l’application d’un préavis de rupture classique, qui devra tenir compte des conditions économiques du marché. Il s’agit d’un apport très intéressant de notre assemblée.
Nous pouvons donc être fiers de parachever la protection du revenu agricole dans les négociations. Nous agissons pour préserver l’emploi, l’innovation et l’investissement dans nos territoires.
Dans la presse quotidienne nationale, ces derniers jours, un distributeur a trouvé les moyens de publier des placards selon lesquels cette loi viserait à limiter les prix bas. Non, je le dis, cette loi vise à obtenir des prix justes, et non des prix bas !
Mme la présidente de la commission des affaires économiques approuve.

Les PME et les ETI n’ont pas les moyens de se payer de tels placards dans la presse… Ce distributeur affirme que « nous marchons sur la tête ». Non, c’est bien la situation actuelle qui nous conduit à marcher sur la tête ! Nous nous contentons de remettre les choses à l’endroit. Ce distributeur se vante également de défendre « tout ce qui compte pour vous »… Je le dis, ce qui compte pour nous, c’est l’agriculture française, l’industrie française, les transformateurs français et les consommateurs français !
Bien souvent, le consommateur est aussi un salarié ou un indépendant. Il doit toucher un salaire lui permettant d’acheter. Ce n’est pas en serrant les conditions tarifaires d’un certain nombre de fournisseurs que nous contribuerons à maintenir son salaire.
Par conséquent, il me paraît quelque peu indécent de se prévaloir d’une action en faveur du pouvoir d’achat des Français. Ces derniers doivent savoir que, comme le dit l’adage, quand c’est gratuit ou presque, ce sont eux les produits.
Le Parlement peut être fier du travail conduit. Celui-ci constitue assurément un nouveau pas dans la défense du revenu des agriculteurs et de la pérennité de nos PME, qui font le rayonnement de nos territoires, en France, mais aussi à l’étranger.
Bravo ! et applaudissements sur les travées des groupes RDPI et UC, ainsi qu ’ au banc des commissions.

La parole est à M. Serge Mérillou, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, Alphonse Karr, célèbre écrivain et journaliste français du XIXe siècle, écrivait : « En France, on parle quelquefois de l’agriculture, mais on n’y pense jamais. » Cette citation est à l’image de ce texte, surnommé « Égalim 3 » injustement, car il y est question non pas d’agriculture, mais de négociations commerciales entre les transformateurs et les distributeurs.
Or qui sont les vraies victimes de l’inflation et de l’augmentation du coût des intrants et de l’énergie ? Sur qui se répercutent les hausses ? Sur les consommateurs, bien sûr, mais aussi sur les agriculteurs.
Avec ce texte, nous examinons une énième loi agricole. Après Égalim 1, voilà Égalim 2, puis Égalim 3 ! Quelle sera la prochaine étape ?
Mes chers collègues, à la veille d’une grande loi agricole que nous appelons de nos vœux, nous devons impérativement nous intéresser à la situation de nos agriculteurs. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs ! La situation n’est pas le seul fruit de la covid-19 ni de la guerre en Ukraine. Force est de le constater, la conjoncture n’est pas la seule responsable de ce manque de résultats.
Égalim 1 et Égalim 2 n’ont pas fait leurs preuves. Nous sommes loin du compte, et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Le groupe socialiste avait pourtant alerté le Gouvernement sur le manque d’ambition de ces textes au vu de la gravité de la situation de notre agriculture.
En effet, la ferme France est en déclin, notre agriculture souffre. Pourtant, des solutions existent. Dans La Nouvelle Héloïse, Jean-Jacques Rousseau écrivait : « La condition naturelle à l’homme est de cultiver la terre et de vivre de ses fruits. » Mes chers collègues, nous devons mener bataille pour assurer notre souveraineté alimentaire.
Nous le savons, le juste partage de la valeur est la condition sine qua non d’un modèle vertueux. Agriculteurs, transformateurs et distributeurs, tous doivent trouver leur compte dans les négociations commerciales.
Nous déplorons que ce texte ne fasse pas de la question des agriculteurs le cœur de sa réflexion. Mais tel n’était sans doute pas son objectif ! Il s’agit d’une proposition de loi d’ajustement, qui, malgré ses lacunes, permet tout de même un certain nombre d’avancées que nous saluons.
Tout d’abord, nous nous félicitons que la plupart des améliorations votées par le Sénat aient été conservées dans la version finale.
Bien qu’ils aient des répercussions trop marginales sur les revenus des agriculteurs, nous sommes satisfaits du prolongement de l’expérimentation du SRP+10 et, surtout, de l’exclusion des fruits et légumes du dispositif. Mon groupe et moi-même avions notamment porté cette revendication de la filière par voie d’amendements.
Nous saluons aussi la réaffirmation du principe de la non-négociabilité de la matière première agricole pour les produits vendus sous marque de distributeur.
Parce qu’il est de la responsabilité du législateur de corriger les dispositifs au fur et à mesure, nous saluons l’article 1er, dont les dispositions visent à lutter contre les stratégies de contournement du droit par la grande distribution. Je pense à la constitution de centrales d’achat à l’étranger, pour échapper aux règles encadrant les négociations commerciales, telles qu’elles sont issues des lois Égalim.
N’en déplaise à la grande distribution, s’il y a des règles, c’est pour qu’elles soient respectées, et notre rôle est d’y veiller.
Mes chers collègues, je ne vais pas passer l’ensemble du texte en revue. Toutefois, nous notons avec intérêt l’accord en commission mixte paritaire sur l’article 3, qui tend à fixer les règles en matière de relations commerciales en cas d’échec des négociations.
Le texte que nous votons aujourd’hui n’a pas pour vocation d’inverser la vapeur. Selon moi, il ne donnera pas une toute-puissance aux transformateurs. Il s’agit au contraire d’équilibrer une situation qui ne l’était pas. Forcément, il y a des mécontents. Et ceux-ci se livrent au chantage en agitant la menace d’une explosion des prix.
La réalité, c’est que chacun doit faire un effort. Il convient de fournir une alimentation de qualité, produite par nos agriculteurs, à des prix abordables, quitte à rogner sur les marges de la distribution.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous l’aurez compris, les socialistes voteront ce texte, même si nous considérons qu’il n’est qu’une goutte d’eau. Il doit s’inscrire dans une réforme globale de notre modèle agricole, dans le cadre d’une réflexion plus large à laquelle nous souhaitons être associés.
Je souhaite qu’il permette un rééquilibrage des relations commerciales entre industriels et distributeurs, ce qui devrait avoir, par ruissellement, des répercussions sur les producteurs.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE, ainsi qu ’ au banc des commissions.

La parole est à M. Gérard Lahellec, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le moins que l’on puisse dire, c’est que les conclusions de cette commission mixte paritaire interviennent dans un contexte complexe, dans lequel il est difficile de donner satisfaction à toutes les catégories impliquées, du producteur au consommateur, de la fourche à la fourchette.
Nous sommes invités à voter un texte dont l’objet affiché est de mieux protéger tous les acteurs de la filière, ce qui est fort louable du point de vue de l’intention, mais quasiment impossible dans le cadre dans lequel nous évoluons.
Les produits alimentaires connaissent une hausse spectaculaire, les prix de l’énergie restent à la hausse et nos agriculteurs demeurent confrontés à cette difficulté structurelle découlant du fait que l’essentiel de la valeur ajoutée des produits alimentaires ne revient pas à la production.
La vie chère s’installe de manière durable, et les salaires ne suivent pas. Au fond, consommateurs, salariés et paysans sont confrontés au même problème de la juste rémunération de leur travail.
Nous assistons à une hausse des prix, dont on ne sait pas toujours exactement à quoi elle est due, à une croissance faible, à une inflation forte et à un système économique saturé. Et ce sont toujours les mêmes qui en font les frais !
Bien entendu, l’objet de cette proposition de loi n’était pas de traiter la question des salaires ni du retour de la valeur ajoutée à la ferme. Pourtant, dans l’agroalimentaire, la proportion des entreprises voulant relever leurs prix atteint 70 %, ce qui laisse augurer une poursuite de la flambée des prix.
Le Gouvernement nous a annoncé la création prochaine d’un « chèque alimentaire pour les plus modestes », dont on ne connaît aucun détail. Nous savons seulement que le Gouvernement ne « souhaite pas distribuer d’aide alimentaire au niveau global, pour s’assurer que les consommateurs ne fassent pas le choix de la malbouffe dans les grandes surfaces. »
Le pays est au bord de la rupture, il s’appauvrit, et nous continuons à débattre d’une proposition de loi qui ne résoudra malheureusement pas le problème. Nous jouons les équilibristes, alors que nous avons besoin de mesures d’ampleur, de réformes de fond, et non pas de dispositifs qui toilettent le marché.
Or cette proposition de loi, nous le savons tous, aura un impact minime sur le revenu agricole et sur les 10 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté.
Nous comprenons la recherche du compromis le plus équilibré possible, mais il ne faudrait pas que cette recherche d’équilibre conduise à une dualité entre les souhaits exprimés, d’une part, par le secteur de la production alimentaire, plutôt favorable au prolongement de l’expérimentation SRP+10, et, d’autre part, par les associations de consommateurs, plutôt opposées au prolongement de ce dispositif expérimental.
Je le reconnais, le compromis n’était pas facile à trouver ! Il conviendrait donc de traiter le sujet au fond, en reconsidérant la LME, la loi de modernisation de l’économie, qui fait peser de nombreuses hypothèques sur le secteur de la production.
Le pire, c’est que les entreprises sont incitées à payer peu. Ce sont les allègements généraux de cotisations sur les bas salaires qui pèsent sur les salaires et qui provoquent une forme de recul de la possibilité d’acheter.
Nous ne voulons pas décourager les bonnes intentions qui sous-tendent ce texte. Dans le même temps, nous en mesurons toutes les limites. Telles sont les raisons essentielles qui nous conduisent à nous abstenir.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE, ainsi que sur des travées du groupe SER. – M. Henri Cabanel applaudit également.

Conformément à l’article 42, alinéa 2, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements de la commission, l’ensemble de la proposition de loi tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures quinze, est reprise à seize heures vingt.

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales (proposition n° 344, texte de la commission n° 401, rapport n° 400).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, l’enfance a été placée par le Président de la République au nombre des priorités du nouveau quinquennat, et la protection des droits des enfants est au cœur de la feuille de route du Gouvernement qui en fait un engagement fort et prioritaire.
« Le foyer familial doit être érigé en sanctuaire protecteur au sein duquel il ne saurait être accepté la moindre violence. » Voilà la directive ferme et sans ambiguïté que j’ai adressée à tous les procureurs de France dans ma dernière circulaire de politique pénale générale, en septembre dernier.
Oui, la protection des mineurs exposés aux violences intrafamiliales est l’une des priorités absolues de ma politique pénale.
Déjà, dans une circulaire du 21 avril 2022 relative à la prise en charge des mineurs présents lors d’un homicide commis au sein du couple, j’ai incité les procureurs à conclure localement des protocoles de prise en charge du traumatisme des mineurs présents lors d’un homicide commis au sein du couple, afin qu’ils soient accompagnés au mieux.
J’ai rappelé par circulaire du 28 février 2022 les dispositions du décret du 23 novembre 2021 énonçant que « lorsqu’un mineur assiste aux violences commises au sein du couple, il n’en est pas simplement le témoin, il en est victime à part entière ».
Je demande ainsi aux magistrats de restituer aux faits commis en présence d’un mineur leur exacte qualification, de veiller à la préservation des droits du mineur dans la procédure pénale et de s’assurer que la juridiction de jugement dispose d’informations lui permettant de statuer sur l’autorité parentale.
Je vous annonce la diffusion cette semaine d’une nouvelle circulaire de politique pénale en matière de lutte contre les violences faites aux mineurs.
Cette circulaire porte la lutte contre les violences sur mineurs à un niveau équivalent à celui mis en œuvre en matière de violences conjugales, dans la continuité des actions qui ont été menées ces dernières années.
Porter cette politique ambitieuse et nécessaire implique de lutter non seulement contre toutes les formes de violences qui sont faites aux mineurs dans leur quotidien proche, qu’il s’agisse du cadre familial ou institutionnel – scolaire, parascolaire, sportif, culturel, religieux, etc. –, mais également contre toutes les formes d’exploitation, comme la prostitution, dont ils sont victimes, notamment de la part de réseaux organisés.
Vous connaissez aussi ma volonté de généraliser les unités d’accueil pédiatrique enfants en danger (Uaped), avec mes collègues François Braun et Charlotte Caubel, dont je veux saluer l’engagement.
Je sais également pouvoir compter sur tous les juges des enfants, tous les juges aux affaires familiales (JAF) et tous les membres du parquet, qui exercent leurs missions au quotidien sur l’ensemble du territoire afin de protéger l’enfant dans son intégrité physique et morale, et de veiller à la préservation de ses intérêts.
Enfin, je n’oublie évidemment pas votre engagement, celui du Sénat, dans ce domaine. En témoignent les textes que vous avez été nombreux à voter au cours de l’année écoulée.
Car si le foyer familial doit être ce lieu de la sécurité affective, il est malheureusement des situations où il devient un lieu de persécution. Il en est ainsi lorsque l’un des parents devient le bourreau de l’enfant.
Ces situations viennent bouleverser le présupposé naturel sur lequel repose la relation parent-enfant. Elles mettent au jour l’inaptitude de ces parents à assurer le rôle dont la loi les a pourtant investis : protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Lorsque le parent maltraitant n’est à l’évidence plus en mesure d’assurer ce rôle, il faut nous résoudre à remettre en cause le lien parental.
Ces questionnements ont été menés au cours de la précédente mandature lors des travaux parlementaires relatifs à la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille. Ils vous ont conduit à doter notre droit de dispositifs innovants à même de protéger l’enfant dans sa relation avec un parent maltraitant.
Je pense, tout d’abord, au mécanisme de suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent qui est poursuivi ou condamné pour avoir commis un crime sur l’autre parent. Introduit à l’article 378-2 du code civil, c’est ce dispositif que l’article 1er de la présente proposition de loi vise à étendre.
Il s’agit, ensuite, de la possibilité pour le juge pénal de retirer l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui a été condamné pour un crime ou un délit sur l’autre parent ou sur son enfant, objet de l’article 2 de la présente proposition de loi.
Les débats que nous menons aujourd’hui démontrent toutefois que ces dispositifs peuvent et doivent encore être améliorés.
À l’heure où l’ampleur du traumatisme engendré par les violences sexuelles n’est plus à démontrer, les conclusions intermédiaires de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) font ce constat alarmant qu’un adulte sur dix a été victime de violences sexuelles dans son enfance.
Si l’enfance est le lieu privilégié des abus, il y a donc urgence à agir afin de s’assurer que le parent maltraitant ne puisse continuer à se prévaloir de ses droits pour maintenir une emprise sur son enfant ou pour réitérer ses agissements.
L’Assemblée nationale – en particulier la députée Isabelle Santiago, ainsi que les membres de la majorité – ne s’y est pas trompée lors de ses travaux, pas plus que votre commission des lois, en adoptant le texte que nous allons examiner aujourd’hui et qui vise à renforcer la protection de l’enfant victime de violences intrafamiliales.
L’article 1er de la proposition de loi tend à modifier l’article 378-2 du code civil afin d’étendre le mécanisme de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou condamné.
Le texte adopté vise à élargir le mécanisme de suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement en cas de poursuite ou de condamnation du parent pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, ou pour une agression sexuelle incestueuse ou un crime commis sur la personne de l’enfant.
La rédaction retenue par la commission des lois est opportune à bien des égards.
Le choix de viser tous les crimes commis sur l’enfant constitue ainsi une amélioration sensible du dispositif puisqu’il évite d’introduire une hiérarchie inopportune entre les crimes dont un enfant peut être victime.
Il le limite toutefois aux infractions les plus graves afin de garantir la constitutionnalité et la conventionnalité du dispositif. Une disposition miroir est prévue à l’article 2 bis de cette loi pour permettre une délégation forcée de l’exercice de l’autorité parentale dans ces hypothèses, initiative que je soutiens fortement.
Il est cependant regrettable que la commission des lois n’ait pas repris le mécanisme qui, dans ces cas de suspension, dispensait le parquet de saisir pour une confirmation le juge aux affaires familiales, car on constate en pratique que ce n’est que très rarement fait. Cette situation n’est d’ailleurs pas sans poser quelques difficultés quant au rétablissement ou non des droits de l’autre parent…
L’article 2 de la proposition de loi tel qu’il est issu des travaux de votre commission tend à créer trois mécanismes de retrait facultatif de l’autorité parentale ou de son exercice.
Saluons ici la volonté de votre commission, madame la rapporteure, de renforcer la protection des enfants. Toutefois, cet article 2 ne permet pas d’atteindre pleinement cet objectif.
En droit positif, le juge pénal a déjà l’obligation de se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice en cas de viol, d’agression sexuelle ou de violence.
Il apparaît plus efficace et protecteur de l’intérêt de l’enfant de créer un mécanisme de retrait obligatoire de l’autorité parentale ou de son exercice pour les crimes et les agressions sexuelles incestueuses commis sur l’enfant et les crimes commis sur l’autre parent, avec une possibilité pour le juge d’y déroger par une motivation spéciale. Il s’agit là de mettre en œuvre les recommandations du rapport intermédiaire de la Ciivise.
L’article 3, quant à lui, vise à ne pas laisser le code pénal en reste et à le faire évoluer en conformité avec les modifications introduites dans le code civil. J’observe que la rédaction de cet article laisse transparaître un souci de simplification puisqu’il procède manifestement de la volonté d’inciter les magistrats à faire directement usage des dispositions du code civil, auquel il est renvoyé.
Le texte présente également l’intérêt de regrouper en un article unique du code pénal les dispositions qui ont trait à l’autorité parentale, lesquelles sont en droit positif dispersées dans différents chapitres du code pénal. En la matière, la simplification est évidemment la bienvenue.
Je suis d’avis de parfaire cette idée en soutenant l’un des amendements visant à ajouter dans votre texte une expression classique dans le code pénal en cas de renvoi à une autre disposition : « et selon les distinctions prévues par… ».
Toutefois, la commission a également souhaité introduire la possibilité, pour la juridiction de jugement, de renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale. Je suis réservé quant à cette disposition, car elle porte en elle un risque, qui n’est pas à écarter, d’augmentation de la charge des audiences et, subséquemment, des délais d’audiencement, lesquels sont un facteur à part entière de l’efficacité de la justice. Il conviendrait que le texte précise bien qu’un tel renvoi de la décision portant sur l’autorité parentale ne peut intervenir qu’une fois la décision sur la peine rendue.
Les réflexions doivent donc se poursuivre dans le cadre de vos débats. J’ai à cœur d’aboutir avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs, à un dispositif ambitieux, mais respectueux de nos principes constitutionnels.
Aussi, je forme le vœu que nos débats nous permettent d’envoyer un signal fort à tous les enfants victimes de violences intrafamiliales.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées des groupes UC et Les Républicains. – M. Jean-Noël Guérini applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, je me réjouis que le Gouvernement n’ait pas engagé la procédure accélérée sur cette proposition de loi d’Isabelle Santiago, ce qui nous permettra de travailler dans la durée sur un sujet éminemment complexe : la question de l’autorité parentale en cas de violences intrafamiliales. Je tiens aussi à féliciter notre collègue députée d’avoir travaillé sur cette question.
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui vise à intervenir ponctuellement sur deux mécanismes : la suspension provisoire de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale, créée par la loi du 28 décembre 2019, et le retrait de l’autorité parentale par les juridictions pénales.
Pour bien comprendre les enjeux de ces dispositions, il convient de garder à l’esprit que le retrait de l’autorité parentale prive un parent de l’ensemble de ses attributs, y compris les plus symboliques comme le droit de consentir au mariage ou celui de consentir à l’adoption de son enfant. C’est donc la titularité même qui est mise en cause.
Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale revient, quant à lui, à confier exclusivement à l’autre parent le soin de veiller sur l’enfant et de prendre les décisions nécessaires pour sa santé, son éducation, etc. Pour autant, l’autre parent conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant via les droits de visite et d’hébergement qui lui sont accordés, sauf « motifs graves » appréciés par le JAF. Il conserve aussi un droit de surveillance qui oblige l’autre parent à le tenir informé de tous les choix importants relatifs à la vie de l’enfant.
Cela étant rappelé, venons-en à la proposition de loi dont nous sommes saisis.
L’article 1er vise tout d’abord à étendre la suspension provisoire de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement aux cas de poursuites ou de condamnation pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur l’enfant. La commission a été favorable à cette extension qui permet de prendre en compte la situation de l’enfant et non pas seulement celle de l’autre parent, se conformant ainsi aux souhaits de la Ciivise.
L’article 1er tend également à revoir les conditions de durée : au lieu d’une durée maximale de six mois et d’une obligation pour le procureur de la République de saisir le JAF dans les huit jours, la suspension courrait jusqu’à la décision de non-lieu, la décision de la juridiction de jugement ou la décision du juge aux affaires familiales, s’il est saisi par le parent poursuivi.
Sur cette question, la commission a choisi de s’en tenir à la position qu’elle avait adoptée en 2020 lorsqu’elle avait été saisie d’amendements similaires, en acceptant une suspension de plein droit, mais uniquement pour six mois, et en exigeant une intervention du juge pour la suite.
Il nous semble en effet disproportionné, au regard de la présomption d’innocence et du droit de chacun de mener une vie familiale normale, de permettre une suspension automatique tout le temps de la procédure pénale, qui peut durer plusieurs années, et sans intervention obligatoire d’un juge, seul à même d’apprécier l’intérêt de l’enfant.
Enfin, les députés ont créé un régime de suspension distinct en cas de condamnation pour des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de huit jours sur l’autre parent. Le texte vise à prévoir dans ce cas une suspension provisoire de l’autorité parentale, mais uniquement si l’enfant a assisté aux faits. La suspension vaudrait jusqu’à la décision du JAF, qui devrait être saisi par l’un des parents dans les six mois à compter de la décision pénale. À défaut, le parent retrouverait l’exercice de l’autorité parentale.
Ce dispositif ne nous a pas semblé cohérent à cause de la condition liée à la présence de l’enfant – car un enfant, même non présent au moment des violences, peut tout autant ressentir la souffrance et l’insécurité –, et à cause de l’exclusion des violences volontaires sur l’enfant lui-même.
Enfin, ce dispositif nous a semblé manquer d’intérêt pratique puisque les juridictions doivent d’ores et déjà se prononcer sur l’autorité parentale en cas de condamnation pour cette infraction. Je relève que les magistrats sont de plus en plus sensibilisés à l’importance des mesures relatives à l’autorité parentale et que le nombre de mesures prononcées augmente, ce dont on ne peut que se réjouir.
L’article 2 de la proposition de loi vise ensuite à rendre plus « automatique », sans toutefois l’imposer au juge pénal, le retrait de l’autorité parentale en cas de condamnation pour un crime ou une agression sexuelle commis sur l’enfant ou pour un crime commis sur l’autre parent.
Cette disposition a le mérite d’inciter plus fortement les juges à prononcer un retrait total d’autorité parentale en cas d’infraction grave contre l’enfant ou l’autre parent, sans toutefois les priver de leur liberté de moduler leur décision au regard de l’intérêt de l’enfant, à charge pour eux de la motiver spécialement.
La commission des lois en a revu la rédaction afin de rendre le dispositif plus intelligible, et donc d’en favoriser l’application par les juridictions pénales. Elle a posé le principe du retrait total de l’autorité parentale en cas de condamnation pour un crime ou une agression sexuelle commis sur l’enfant ou pour un crime commis sur l’autre parent, et l’obligation des juridictions de se prononcer dans tous les cas de condamnation d’un parent pour crime ou délit commis sur son enfant ou pour crime commis sur l’autre parent.
Nous aurons tout à l’heure un débat sur cette rédaction : celle que nous avons choisie a le mérite de la vérité puisqu’elle expose clairement que le juge conserve malgré tout, sous réserve d’une motivation spéciale, la possibilité de ne pas prononcer le retrait total de l’autorité parentale. Les formules du type « prononce le retrait » ou « ordonne le retrait » nous semblent de ce point de vue relever davantage de l’affichage…
L’article 2 bis de la proposition de loi vise ensuite à ajouter un nouveau cas de délégation forcée de l’exercice de l’autorité parentale à un tiers en cas de poursuite, de mise en examen ou de condamnation pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur l’enfant par un parent qui est seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. La commission y a apporté un simple ajustement rédactionnel.
La commission a adopté un article additionnel 2 ter pour instituer un « répit » pour l’enfant en cas de retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement. Il tend à prévoir qu’aucune demande au juge aux affaires familiales ne puisse être présentée par le parent moins de six mois après le jugement. Une disposition similaire existe en cas de retrait de l’autorité parentale et il nous a semblé opportun de le prévoir aussi en matière d’exercice.
J’en arrive à l’article 3, qui vise à procéder à diverses modifications dans le code pénal, à des fins de coordination avec l’article 2.
Cet article nous a semblé l’occasion de mettre fin au décalage qui existe entre le code civil et le code pénal en matière de retrait de l’autorité parentale. La rédaction proposée introduirait une disposition générale dans le code pénal, applicable à chaque fois qu’il y a condamnation d’un parent pour crime ou délit sur la personne de son enfant ou l’autre parent.
La commission s’est attachée à rendre les dispositions dont elle était saisie plus intelligibles et plus cohérentes, étant consciente qu’il fallait faciliter le travail des pénalistes pour qu’ils s’emparent de ces mécanismes de nature civile. C’est dans cet esprit constructif qu’elle a adopté le texte que je vous invite à voter.
Nous avons besoin de bonnes lois, mais aussi d’une volonté politique absolue et de moyens dans les juridictions. C’est à ce prix que nous pourrons protéger les plus fragiles et infléchir ce monde de violence.
Nous devons tous être des protecteurs de l’enfance et des guetteurs de violence. Car cette violence au sein de la famille empêche un enfant, tout simplement, de vivre.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et RDPI.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, c’est l’histoire de Malakai, un petit garçon âgé de 7 ans, battu à mort dans la nuit du 12 au 13 octobre 2022 par le compagnon de sa mère. Celui-ci avait déjà été condamné huit fois pour des faits de vols, de menaces et de violences conjugales.
Pourtant, en avril 2022, les services sociaux s’étaient saisis du cas de la mère et de son fils, qui avaient fait l’objet d’un signalement à la justice en raison de « carences éducatives et de conduites addictives de la mère et d’un père totalement absent ».
La mort tragique de Malakai est loin d’être anodine. En France, un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups de ses parents dans un contexte de violences conjugales. À ce titre, 400 000 enfants vivent dans un foyer où s’exercent des violences conjugales et 160 000 enfants subissent chaque année des violences sexuelles.
Les travailleurs sociaux croulent sous les dossiers qu’ils ne parviennent plus à traiter, faute de moyens suffisants. De surcroît, les tribunaux dénoncent une dégradation dramatique de la situation du pôle des affaires familiales. Les JAF sont débordés et en sous-effectif, mais je ne vous apprends ici rien de nouveau…
Dans tout ce désordre judiciaire, y a-t-il une place à consacrer à l’intérêt supérieur de l’enfant ? La responsabilité de l’État est immense.
Aujourd’hui, nous discutons d’un texte qui vise à améliorer la protection des enfants en renforçant le dispositif existant de retrait de l’exercice de l’autorité parentale. Désormais, tout parent ayant été poursuivi, mis en examen ou condamné pour un crime commis sur l’autre parent et/ou crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur l’enfant se verra suspendre de plein droit l’exercice de l’autorité parentale, ainsi que les droits de visite. Cette proposition de loi pourrait être une réelle avancée en matière pénale et civile.
Certes, cela n’est toujours pas suffisant pour lutter contre les violences intrafamiliales. Le Gouvernement devrait élaborer une véritable politique publique ambitieuse en matière de protection de l’enfance. On ne peut pas se contenter de petites mesures ou de numéro vert.
C’est notre devoir d’empêcher qu’un autre Malakai ne meure sous les coups d’un parent violent. Il nous faut garantir un accompagnement effectif pour tous ces enfants victimes de violences intrafamiliales et permettre leur reconstruction.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE. – Mmes le rapporteur et Martine Filleul applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe RDSE se réjouit de la présentation de cette proposition de loi, qui soulève des enjeux primordiaux et nous ramène à notre responsabilité collective de protéger nos enfants. Notre édifice institutionnel et législatif relatif à la protection des enfants doit s’enrichir de nos débats.
Je rappelle que le groupe RDSE, sensible à la question de la protection des enfants, s’est déjà positionné sur un renforcement de la répression des abus sexuels intrafamiliaux.
Les violences intrafamiliales sont le quotidien d’un trop grand nombre de nos concitoyens. Pire encore, celles dont sont victimes nos enfants posent un problème dont notre société a du mal à reconnaître le caractère massif et systémique.
Or la réalité, c’est que, chaque année, 400 000 enfants vivent dans un foyer où s’exercent des violences conjugales, et 160 000 enfants subissent des violences sexuelles avérées.
Chocs traumatiques, troubles psychotraumatiques, phénomènes de dissociation, troubles de la mémoire : derrière ces violences, qu’elles soient physiques, sexuelles ou psychologiques, les conséquences sur l’enfant et son développement sont graves. Néanmoins, rappelons qu’elles sont réversibles si une protection et un traitement psychothérapique spécialisés sont mis en place.
Nous plaidons pour une mise à l’abri rapide des enfants victimes et une prise en charge la plus précoce possible, afin de limiter les conséquences sur leur santé. Tout retard dans cette mise en sécurité et cette prise en charge équivaut à une perte de chance pour chaque enfant concerné.
Au-delà des questions d’élargissement du mécanisme de suspension provisoire de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et de systématisation du prononcé du retrait de l’autorité parentale par les juridictions pénales, notamment en cas de crime commis sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent ou d’agression sexuelle incestueuse sur l’enfant, nous devons nous interroger sur la bonne temporalité pour agir et protéger l’enfant en coupant le lien avec le parent violent, que ce soit de façon temporaire ou définitive.
Nous devons avoir cette réflexion sans perdre de vue l’objectif de protection des victimes et de préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Nous devons également mettre l’accent sur une meilleure sensibilisation de la société sur ces sujets, afin de traiter le plus en amont possible les violences intrafamiliales sur la personne de l’enfant.
Si la législation progresse depuis quelques années, il nous faut faire mieux, d’abord en accroissant l’arsenal législatif en matière de suspension et de suppression de l’autorité parentale ou de son exercice, sans oublier de rendre davantage lisibles et applicables les mesures déjà en place dans le droit en vigueur.
Dans ce cadre, le groupe RDSE se félicite des avancées que comporte ce texte, notamment l’élargissement du régime de suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement aux crimes et agressions sexuelles incestueuses commis sur la personne de son enfant. Cependant, nous regrettons que la commission ait souhaité atténuer la portée du dispositif principal en excluant la suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale du parent violent le temps de la procédure pénale.
Si cette modification répond au principe de présomption d’innocence et au droit de chacun, enfant comme parent, de mener une vie familiale normale, elle ne permet pas, compte tenu notamment de la longueur de la procédure pénale, d’améliorer un dispositif qui se caractérise aujourd’hui par son ineffectivité en raison d’un manque de lisibilité.
Si nous conservons la procédure actuelle, il reviendra toujours au procureur de saisir le juge aux affaires familiales afin de déclencher la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité familiale, ce qui, rappelons-le, n’est pas systématique. Surtout, suivant la procédure actuelle, si le JAF ou le juge pénal ne s’est pas prononcé dans un délai de six mois, le parent poursuivi récupère ses droits automatiquement.
Prévenir ou guérir ? Tel est le dilemme qu’affrontent les acteurs de la protection de l’enfance. Où doit-on placer le curseur ? Toujours est-il qu’il serait opportun que nous trouvions des solutions afin que notre appareil répressif ne souffre plus d’une ineffectivité dont les conséquences peuvent être lourdes.
Néanmoins, en dehors de ces quelques observations, nous pensons que cette proposition de loi va dans le bon sens et contribuera à briser davantage le silence autour des violences commises dans le cadre intrafamilial. La systématisation du prononcé du retrait de l’autorité parentale par les juridictions pénales en cas de crime commis sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent ou d’agression sexuelle incestueuse sur l’enfant en est le formidable symbole.
C’est pourquoi le groupe RDSE votera cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE et sur des travées du groupe UC. – Mme le rapporteur et M. Thani Mohamed Soilihi applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le retrait de l’autorité parentale est, dans notre culture, encore difficile à envisager. Pourtant, cette option reste nécessaire dans l’éventail des moyens de protection de l’enfant victime de sa famille.
Depuis des décennies, les philosophies des acteurs de la protection de l’enfant s’affrontent. Le législateur doit trancher : pour nous, il est indispensable de sanctionner le parent coupable de violences extrêmement graves sur l’enfant et de protéger cet être vulnérable physiquement en l’éloignant juridiquement de l’autorité dont il dépend et qui le détruit.
De 1979 à 1982, dans le cadre de mes études, j’avais travaillé sur la situation des enfants placés dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (Ddass), qui dépendaient alors de l’État, souvent pour des faits de violences intrafamiliales graves. J’avais à l’époque remarqué que de nombreux enfants placés, en principe temporairement, étaient oubliés dans leur lieu de placement, sans surveillance, par l’administration toute puissante. Les enfants étaient souvent transférés à la campagne, au vert, loin des « mauvais parents ». Ceux-ci n’avaient plus de droits sur la vie de leurs enfants du fait, non de la loi, mais de la toute-puissance de l’administration.
La loi du 24 juillet 1889 – cela ne date pas d’hier ! – avait installé cette disjonction de protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, par l’éloignement des parents et par la déchéance de leurs droits de puissance paternelle.
Ce texte était fondé sur le caractère exemplaire de la peine. Il pouvait avoir – du moins l’espérait-on – un rôle dissuasif à l’égard des parents qui compromettaient la santé, la sécurité ou la moralité de leurs enfants. Mais il n’abordait pas le devenir des enfants. La seule mesure pérenne pour eux était le placement, le plus souvent irréversible.
La loi du 4 juin 1970 a remplacé la puissance paternelle par l’autorité parentale. Elle marque une étape essentielle dans l’évolution de la protection de l’enfant en ce qu’elle consacre l’égalité des parents.
À partir de cette époque, si le magistrat peut retirer l’enfant de sa famille en cas de nécessité, il doit s’efforcer, par principe, de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et faire en sorte que les liens soient maintenus dans la mesure du possible.
Le législateur de l’époque a cependant prévu une divisibilité des prérogatives de l’autorité parentale. La loi prévoit ainsi de diminuer les possibilités légales des père et mère quant à l’éducation de l’enfant si son intérêt le justifie.
Le législateur présente les mesures restreignant l’autorité parentale en respectant une gradation. Les magistrats, dès lors, peuvent limiter, voire retirer, l’autorité parentale des parents. Cependant, dès cette époque, le législateur invite les juges à considérer la mesure prise comme provisoire et à recourir le plus souvent possible à l’assistance éducative.
En ce qui concerne les mesures judiciaires propres à l’enfant, la loi du 6 janvier 1986 est venue renforcer les droits de la famille, en exigeant que les mesures soient limitées dans le temps, c’est-à-dire en deçà de deux ans.
Aujourd’hui, la révision des situations est orientée avant tout vers le retour de l’enfant dans sa famille, quoi qu’il en soit.
Avant les lois de décentralisation de 1983, la protection de l’enfant en danger reposait sur l’État. C’est la loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance qui a organisé la protection de l’enfance en danger.
Cette loi fixe les attributions du département. Elle établit les responsabilités de prévention, de détection et de protection des enfants maltraités en redéfinissant le rôle de chaque autorité. C’est à partir de là qu’apparaissent des antagonismes.
En 1997, j’ai soutenu une thèse sur la collaboration des institutions – pénales, civiles, sociales, médicales, éducatives – protégeant l’enfant. Chacune avait son rôle de détection, de signalement au juge, de prise en charge de l’enfant maltraité. Des progrès énormes ont été faits depuis trente ans, mais force est de constater que la coordination des justices pénale et civile n’est toujours pas évidente. Le dépôt en 2023 de cette proposition de loi montre que nous devons encore apporter des précisions.
Je voterai ce texte, car il replace l’enfant victime au cœur du dispositif judiciaire. Coordonner le civil et le pénal est une priorité pour la protection de l’enfant victime. C’est mon intime conviction. Le retrait de l’autorité parentale peut être nécessaire pour arrêter la reproduction de la violence familiale au sein des générations suivantes, mais il faut, en même temps, prévoir l’avenir de cet enfant, lui donner une stabilité juridique et une institution affective définitive.
Je compte sur vous, mes chers collègues, et surtout sur vous, monsieur le garde des sceaux, pour mettre à profit l’expérience qui est la vôtre en la matière.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et des travées du groupe UC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, un sur cinq, c’est la proportion des adultes qui auraient été victimes de violences sexuelles lorsqu’ils étaient mineurs. C’est considérable !
Certes, ce chiffre a pu être contesté. Il provient d’une méta-analyse conduite par le Conseil de l’Europe, reprenant plusieurs estimations de diverses organisations indépendantes, comme l’Unicef ou l’OMS.
Le rapport Sauvé, rendu public en octobre 2021, a donné une autre estimation, avec près de 15 % des femmes et plus de 6 % des hommes majeurs qui auraient été sexuellement agressés lorsqu’ils étaient mineurs. Cela ramène la prévalence dans la population totale à un peu plus de 10 %, comme l’a précisé M. le ministre.
En tout état de cause, il s’agit d’un phénomène massif. Des milliers d’enfants subissent chaque année des violences, et des millions d’adultes vivent toute leur vie avec le poids du traumatisme. Le grand public commence à saisir l’ampleur du problème, mais il est difficile de savoir si les violences sexuelles contre les enfants ont tendance à gagner du terrain, ou si nous en prenons davantage conscience à mesure que la parole se libère sur le sujet. Quoi qu’il en soit, il serait irresponsable d’ignorer ce phénomène qui brise les individus et divise les familles.
En outre, les violences sexuelles ne sont qu’une partie du problème, sans doute la plus glaçante et la plus révoltante, mais une partie seulement. Les enfants subissent d’autres formes de violences au sein du foyer.
En 2019, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes estimait à 400 000 le nombre des enfants concernés par ces violences. Il s’agit bien sûr des violences subies par les enfants eux-mêmes, le plus souvent à cause d’un père violent. Mais il s’agit aussi, et il ne faut pas le négliger, des violences qu’ils ne subissent pas directement, mais qui sont infligées par l’un des parents à l’autre. Celles-ci peuvent traumatiser les enfants presque autant que lorsqu’ils sont eux-mêmes victimes d’éclats de colère, de coups ou d’insultes.
Dans chacune de ces situations, la famille n’est plus le cocon protecteur qui permet à l’enfant de s’épanouir en sécurité ; la famille devient une prison dont il ne peut plus s’échapper.
Je me réjouis que les pouvoirs publics se soient emparés du sujet. Le lancement de la Ciivise, voilà deux ans, a permis de mettre nos institutions à l’écoute des victimes. C’était un préalable indispensable, car, en matière de violences intrafamiliales, une seule boussole doit guider l’action publique : l’intérêt de l’enfant. C’est pourquoi cette proposition de loi doit contribuer à faire avancer le débat sur ces sujets délicats et sensibles.
Ils sont délicats, car il n’existe pas de solution miracle. Nous parlons de situations où l’agresseur est, par définition, un proche de la victime, et même le plus souvent un élément structurant de sa famille. Punir l’agresseur est nécessaire, mais parfois douloureux, malheureusement, pour la victime.
Ces sujets sont également sensibles, car nous avons souvent, dans notre entourage, connaissance d’une situation particulière, d’un cas de figure où la violence a déjà assombri les relations familiales. Je rappelle au passage qu’il s’agit d’un phénomène qui dépasse tous les clivages sociaux et territoriaux.
Je tiens à saluer Mme le rapporteur, qui a conduit un travail sérieux sur ce sujet complexe. Le texte de la commission nous paraît plus respectueux de l’intérêt de l’enfant, alors même qu’il peut paraître moins sévère contre les parents violents. Je le répète : notre seule boussole doit rester l’intérêt de l’enfant.
Je m’arrête plus précisément sur la réécriture de l’article 1er. La commission a limité l’extension de la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale aux cas de crime ou d’agression sexuelle commis sur la personne de l’enfant. Elle a également souhaité conserver le caractère provisoire de cette suspension, comme c’est déjà le cas actuellement.
Je le répète, il s’agit de sujets délicats et sensibles. En tant que législateurs, nous devons veiller à préserver la présomption d’innocence et les relations au sein des familles où sévissent de telles violences.
C’est pourquoi il nous paraît judicieux de préserver aussi le rôle du juge aux affaires familiales dans l’application des sanctions à l’encontre des parents violents. Le législateur doit veiller à ne pas se substituer au juge. Rendre automatique le retrait de l’autorité parentale et de son exercice ne nous semble pas la réponse idoine. Nous faisons confiance aux juges pour préserver l’intérêt des enfants.
Mme le rapporteur applaudit.
M. Joël Labbé applaudit.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, quand on ne peut pas se protéger soi-même, on doit pouvoir appeler à l’aide. Et quand on appelle à l’aide, on doit nous croire. Et quand on nous croit, on doit nous aider.
Ces principes très simples devraient aller de soi. Pourtant, les protections accordées aux enfants victimes de violences intrafamiliales sont en France largement insuffisantes. Or il y a urgence, compte tenu de l’ampleur du phénomène : 165 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année ; 400 000 enfants vivent dans un foyer dont un membre exerce des violences conjugales, et en sont les victimes directes ou collatérales ; 2 enfants par classe et 1 à 2 adultes sur 10 ont été victimes de violences sexuelles, soit entre 35 et 70 d’entre nous, au Sénat, avec les fractures perpétuelles que cela implique.
Les violences subies pendant l’enfance ont de graves conséquences psychologiques et somatiques qui durent souvent la vie entière. Le mouvement #MeTooInceste et la Ciivise, créée en réaction, ont démontré que la clé n’était pas tant la parole que l’écoute, car les victimes qui parlent ne sont que rarement crues, encore moins aidées convenablement, quand elles le sont.
Il y a donc urgence à agir pour renforcer le cadre légal pour la protection des victimes. À cet égard, je remercie Mme Isabelle Santiago de son initiative et Mme la rapporteure, Marie Mercier, de son travail. L’ensemble du groupe écologiste soutient bien évidemment cette proposition de loi, qui est une étape importante pour améliorer la protection des victimes.
En particulier, elle permettrait d’élargir les cas de suspension d’exercice de l’autorité parentale, et ce afin de protéger l’enfant du parent violent. Si l’on croit la parole des victimes, il faut les protéger et, dans les cas de violences intrafamiliales, cela veut dire aussi parfois qu’il faut les protéger de leurs propres parents. C’est pourquoi l’élargissement de ces cas est une bonne chose.
À ce titre, je voudrais m’attarder sur deux points qui me paraissent particulièrement importants.
Premièrement, je regrette que la commission ait voulu supprimer certaines dispositions adoptées à l’Assemblée nationale.
Elle a décidé, en particulier, de ne pas étendre la suspension de l’exercice de l’autorité parentale dans certains cas qui avaient été prévus par les députés. Or cette suspension est souvent essentielle pour permettre, dans les faits, la protection des enfants victimes de leurs parents violents.
Le mouvement #MeTooInceste nous a montré que, dans de trop nombreux cas, on ne croit pas les victimes. Et comme on ne les croit pas, elles ne sont pas protégées par la justice. C’est ce que l’Assemblée nationale a retenu, et c’est pour cette raison que les députés ont voté pour un élargissement de cette suspension. Aussi avons-nous déposé des amendements visant à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale.
Deuxièmement, je souhaite m’inscrire en faux contre la théorie du syndrome de l’aliénation parentale. Le texte ne revient pas sur ce point, et c’est particulièrement inquiétant. De quoi s’agit-il ?
Prenons le cas d’un couple marié qui a une fille âgée de 7 ans. Après un divorce conflictuel, l’enfant part vivre avec un des parents. L’autre parent obtient un droit de visite pour l’enfant, qui vient chez lui un week-end sur deux. Un certain dimanche, celle-ci revient incontestablement traumatisée. Elle se confie au parent chez lequel elle vit – disons que c’est la mère –, racontant qu’elle subit des violences chez l’autre parent – admettons qu’il s’agisse du père.
La mère établit qu’il s’agit de violences sexuelles, alerte la justice et refuse ensuite de laisser partir sa fille pour la protéger de son ex-conjoint violent. À ce stade, il faut remarquer que nous nous trouvons devant un cas rare : l’enfant parle, on le croit et on agit.
Or, au lieu de protéger l’enfant en retirant l’exercice de l’autorité parentale, la justice remet parfois en cause le récit du parent protecteur et le suspecte d’accuser l’ex-conjoint pour se venger et d’instrumentaliser l’enfant. On ajoute ainsi du traumatisme au traumatisme en prétendant que l’enfant ment et en condamnant le parent qui agit comme il se doit. Ce faisant, on laisse l’enfant en danger.
La fausse théorie du syndrome de l’aliénation parentale, qui fonde ce raisonnement, est malheureusement répandue en France. Le Conseil de l’Europe a d’ailleurs mis en garde la justice française à ce propos, mais trop peu a été fait jusqu’à présent pour lutter contre ces croyances qui ont cours dans l’institution judiciaire. Nous devons mettre fin à cette absurdité.
Je conclurai en rappelant ce qu’a dit M. le ministre dans son propos liminaire : la lutte contre les violences faites aux mineurs va être mise au même niveau que celle contre les violences conjugales.
Compte tenu du nombre croissant de féminicides – 112 l’année dernière ! –, …

Mme Mélanie Vogel. … permettez-moi, monsieur le ministre, d’exprimer mon inquiétude…
Applaudissements sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, 400 000 enfants vivent aujourd’hui dans un foyer où s’exercent des violences intrafamiliales, et un enfant en meurt tous les cinq jours. Par ailleurs, plus de 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles, selon un rapport de plusieurs inspections datant de 2018.
Ces chiffres sont éloquents, mais ils sont d’une tout autre ampleur dans les territoires d’outre-mer. Dans une étude de 2017, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) rapportait que les violences intrafamiliales étaient plus fréquentes et plus graves outre-mer qu’en métropole, et ce en raison de l’insularité et de la faible superficie de certains territoires, qui peuvent entraver la libération de la parole et rendre inopérant l’éloignement du conjoint violent ou le choix d’un lieu anonyme pour être accueilli et écouté sans crainte. Plus récemment, un bilan du ministère de l’intérieur révélait qu’à Mayotte, ces violences avaient augmenté entre 2021 et 2022.
L’un des enjeux de la lutte contre les violences intrafamiliales est de mieux reconnaître la souffrance des enfants qui en sont victimes et de les protéger. Nous savons aujourd’hui que les traumatismes répétés qu’ils subissent peuvent déclencher diverses maladies et être un facteur de reproduction de violences à l’âge adulte.
Aussi, dans le prolongement du Grenelle des violences conjugales, lancé par le Gouvernement le 3 septembre 2019, le Parlement avait adopté deux lois prévoyant le renforcement des pouvoirs du juge pour retirer l’autorité parentale ou son exercice au parent violent, et pour protéger l’enfant et le parent victime.
Tout d’abord, la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a notamment créé un mécanisme de suspension provisoire de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur l’autre parent.
Ensuite, la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a, entre autres dispositions, ajouté les délits commis sur l’autre parent à la liste des infractions pouvant fonder une décision de retrait de l’autorité parentale par le juge pénal.
Pour traiter ces violences, notre arsenal juridique s’est, certes, considérablement renforcé ces dernières années, mais il reste encore perfectible.
Le présent texte, qui s’inspire des recommandations de la Ciivise, s’inscrit dans cette optique et prévoit la mise en place de mécanismes automatiques de retrait ou de suspension de l’autorité parentale, ou de son exercice, lorsque le parent est poursuivi, mis en examen ou condamné pour les infractions les plus graves commises sur son enfant ou sur l’autre parent.
Depuis son dépôt, des modifications substantielles ont été apportées au texte, toujours dans un esprit transpartisan et dans le cadre d’un travail de coconstruction avec le Gouvernement, qui a fait de la protection des mineurs exposés aux violences intrafamiliales une priorité absolue de sa politique pénale.
Entièrement réécrite par l’Assemblée nationale, qui l’a adoptée à l’unanimité, cette proposition de loi prévoyait plus précisément d’élargir les cas de suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement : premièrement, jusqu’à la décision du JAF éventuellement saisi par le parent poursuivi ou jusqu’à la décision de non-lieu ou la décision de la juridiction de jugement en cas de poursuite, mise en examen ou condamnation pour un crime commis sur l’autre parent, ou de crime ou agression sexuelle incestueuse commis sur l’enfant ; deuxièmement, jusqu’à la décision du JAF qui devrait être saisi par l’un des parents dans les six mois à compter de la décision pénale en cas de condamnation, même non définitive, pour des violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits.
La proposition de loi prévoyait également le retrait systématique de l’autorité parentale ou de l’exercice de l’autorité parentale en cas de condamnation pour crime ou agression sexuelle incestueuse sur l’enfant ou pour crime sur l’autre parent, sauf si le juge en décidait autrement, à charge pour lui de motiver spécialement ce choix.
Par ailleurs, elle ajoutait un nouveau cas de délégation forcée de l’exercice de l’autorité parentale à un tiers en cas de poursuite, de mise en examen ou de condamnation pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur l’enfant par un parent, seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale.
Sur l’initiative de notre rapporteur, Marie Mercier, dont je tiens à souligner la qualité du travail, notre commission a choisi de réserver le déclenchement du mécanisme de suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement aux crimes et agressions sexuelles incestueuses commis sur la personne de l’enfant.
Nous approuvons cette position, mais il nous semble indispensable de prévoir le retrait de plein droit de l’autorité parentale ou de son exercice et des droits de visite et d’hébergement en cas de condamnation d’un parent pour ce même type d’infraction commise sur son enfant ou pour un crime commis sur l’autre parent.
Nous vous présenterons, au cours de la discussion, trois amendements visant à concrétiser le plus fidèlement possible les recommandations de la Ciivise et à sécuriser la portée du dispositif.
Au-delà de ces aménagements qui, je l’espère, recueilleront votre assentiment, nous débattrons dans les heures qui viennent d’un texte équilibré, tenant compte de la nécessité de protéger l’enfant et de préserver les relations familiales et des liens d’attachement. Voilà pourquoi le groupe RDPI, que je représente, votera en faveur de son adoption.
Applaudissements sur des travées du groupe UC. – M. Éric Gold applaudit également.
Applaudissements sur les travées d u groupe SER. – Mme Laurence Cohen applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est une bien triste litanie que je reprends : près de 400 000 enfants en France vivent dans un foyer où des violences intrafamiliales sévissent ; dans 21 % des cas, ils en sont directement victimes. Ces violences – nous le soulignons tous – leur laissent des séquelles psychologiques et physiques.
Cette proposition de loi, déposée par notre collègue députée Isabelle Santiago, présente aujourd’hui dans les tribunes du Sénat, et votée à l’unanimité à l’Assemblée nationale, après – il est vrai – un certain nombre de modifications et un travail avec la Chancellerie, a pour objectif de mieux protéger les enfants victimes et covictimes, directes ou indirectes, de ces violences.
Ce texte est pour nous important, car il constitue un pas de plus vers la protection des enfants et prend place dans un continuum législatif qui, peu à peu, se consolide. À chaque fois, nous sommes au rendez-vous.
Rappelons, par exemple, que nous avons approuvé la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, qui a opéré un changement attendu dans l’appréhension pénale des violences sexuelles perpétrées sur des victimes mineures, en insérant dans le code pénal de nouvelles infractions d’agressions sexuelles autonomes sur mineur de moins de 18 ans dans le cas de l’inceste. Rappelons tout de même que c’est le groupe socialiste qui avait, par amendement, proposé de relever l’âge du non-consentement de 15 ans à 18 ans dans le cas du crime d’inceste.
De même, nous avions proposé par amendement le retrait de l’autorité parentale, notamment dans le cadre de l’ordonnance de protection, lors de l’examen de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi Taquet, mais cela avait été rejeté. C’est regrettable, car de nombreux mois ont été perdus.
Pour nous, la question de la protection des enfants victimes ou covictimes de violences intrafamiliales doit être comprise dans un ensemble plus large, qui prend en compte aussi la protection du parent victime et la question de l’emprise du parent violent sur la victime par l’instrumentalisation de l’enfant. Protéger l’enfant est primordial, mais c’est aussi une manière de protéger le parent victime, la plupart du temps la mère. Rappelons que le nombre de féminicides a augmenté de plus de 20 % lors des trois dernières années et que nous en sommes à 34, déjà, pour l’année 2023.
Le cœur de ce texte, c’est bien l’article 1er relatif à la suspension de l’exercice de l’autorité parentale ainsi que des droits de visite et d’hébergement, non seulement après une condamnation, mais aussi pendant toute la période présentencielle.
Cet article, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, a été voté à l’unanimité par nos collègues députés. Aussi regrettons-nous, comme d’autres sur ces travées, que la commission des lois du Sénat, sur l’initiative de notre rapporteure qui a pourtant fait un travail approfondi – je le sais pour avoir auditionné avec elle de nombreuses personnes –, l’ait en partie vidé de son contenu. C’était pourtant un point majeur pour la portée de ce texte.
En effet, si la commission a maintenu l’élargissement du dispositif au crime ou à l’agression sexuelle incestueuse commis sur un enfant, elle est en revanche revenue sur la suppression du délai maximal de six mois, limitant ainsi la suspension de l’exercice de l’autorité parentale, ainsi que sur le nouveau régime prévu en cas de condamnation pour des violences ayant entraîné une ITT de plus de huit jours.
Dans la mesure où – je le rappelle – une procédure peut durer plusieurs années, il est à nos yeux nécessaire de protéger l’enfant pendant l’intégralité de cette période.
Nous souhaitons aussi que la loi précise que la suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement doit être effective dans un délai maximal de six jours. Ce délai est calqué sur celui prévu par l’article 515-11 du code civil relatif à la délivrance de l’ordonnance de protection.
Si ces dispositions étaient rétablies, ce qui permettrait de recentrer le texte sur son objet initial, nous pourrions le voter. Tel est l’objet de nos amendements, ainsi que de nombreux amendements issus de toutes les travées – nous tenons à le souligner, car cela montre qu’il manque encore des éléments essentiels dans cette proposition de loi.
Nous attendons encore des évolutions en termes de droits de l’enfant, notamment le droit pour un enfant d’être entendu ou celui d’être automatiquement assisté par un avocat lors de toute procédure judiciaire le concernant.
Les annonces gouvernementales vont certes dans la bonne direction, mais, au-delà des textes, se pose aussi la question des moyens. Il ne faudrait pas, au prétexte que l’argent manque, limiter la portée de cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe SER. – Mmes Laurence Cohen, Mélanie Vogel et Esther Benbassa applaudissent également.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à saluer notre collègue députée Isabelle Santiago, et à remercier notre rapporteure, Marie Mercier, pour le travail qu’elle a effectué sur ce texte.
Hannah Arendt écrivait que le développement de l’enfant était la continuité du monde. L’enjeu de cette proposition de loi est de faire en sorte que les enfants ne soient pas tributaires d’un passé douloureux, marqué par la violence, responsable de traumas lourds.
Les études et les statistiques sont glaçantes, sans équivoque : 60 % des enfants témoins de violence souffrent de stress post-traumatique ; 50 % des victimes de viol durant leur enfance ont fait une tentative de suicide.
Nombreux sont les psychiatres et pédopsychiatres, tels Muriel Salmona ou Luis Alvarez, à considérer que les enfants ayant été au centre de violences conjugales développent par la suite des symptômes caractéristiques d’un stress similaire à celui dont sont atteintes les victimes de guerre.
Grâce à la mobilisation des mouvements et des associations féministes, les violences faites aux femmes et les féminicides ne sont plus considérés comme des drames passionnels, mais comme la résultante du système patriarcal qui gangrène nos sociétés.
Permettez-moi de dénoncer de nouveau la culture du viol et de l’inceste, véhiculée par l’industrie pornographique notamment, et que nous avons analysée dans le rapport que nous avons présenté au nom de la délégation aux droits des femmes, ainsi que dans la proposition de résolution adoptée à l’unanimité par notre assemblée au début du mois.
Malheureusement, les enfants sont encore trop souvent des victimes collatérales, l’objet de chantages de la part de conjoints violents. Malgré les avancées législatives de 2019 et de 2020, les enfants ne sont toujours pas assez pris en considération.
Mes chers collègues, non seulement nous devons protéger les enfants témoins de violences commises sur la personne de l’autre parent – dans la majorité des cas, la mère –, mais nous devons également faire en sorte que plus aucun enfant ne meure des suites de maltraitance.
Aujourd’hui encore, un enfant meurt tous les cinq jours de maltraitance. Un an après l’adoption de la loi Taquet, nous considérons toujours que les moyens accordés à la protection de l’enfance sont insuffisants.
Il est plus que temps d’agir. C’est pourquoi nous saluons cette proposition de loi, inspirée des recommandations de la Ciivise, qui va dans le bon sens. Nous tenterons de renforcer la portée de ce texte par nos amendements, notamment à l’article 1er, en proposant la suspension de l’autorité parentale, et pas seulement celle de l’exercice de l’autorité parentale.
Pour ce qui me concerne, j’ai toujours considéré qu’un conjoint violent ne pouvait pas être un bon père, et je me réjouis que cette analyse soit de plus en plus largement partagée. La vulnérabilité des enfants nous commande de prévoir une protection stricte, sans concession.
Nous regrettons par ailleurs que la présente proposition de loi ne traite pas de tous les cas de violence à l’encontre de l’enfant qui, quelle que soit leur forme, doivent être dénoncés. Ayons en tête que la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) nous oblige à protéger les enfants contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalité physique ou mentale.
Mettons-nous réellement au service de l’intérêt supérieur de l’enfant, mes chers collègues, et ce d’autant plus que, bien souvent – on le sait –, les enfants victimes reproduisent ces violences à l’âge adulte.
Avant de conclure, je souhaiterais vous interpeller, monsieur le garde des sceaux, au sujet de l’un de nos amendements, qui a été déclaré irrecevable.
Il nous semblait pourtant essentiel de faire évoluer l’article 227-5 du code pénal relatif au délit de non-représentation d’enfant.
M. le garde des sceaux opine.

De même, il est grand temps d’en finir avec le prétendu syndrome d’aliénation parentale, trop souvent utilisé lors des conflits ou en cas de violences conjugales. Je tiens à dénoncer ce concept et à vous faire partager mes réserves à ce sujet, mes chers collègues.
Dans la mesure où cette proposition de loi est un pas supplémentaire vers une meilleure protection des enfants en cas de violences intrafamiliales, nous la voterons, en espérant tout de même pouvoir encore en améliorer le dispositif grâce à nos amendements.
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et SER. – M. Joël Labbé et Mme le rapporteur applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe UC et sur des travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à saluer Mme la députée Isabelle Santiago, présente aujourd’hui dans nos tribunes.
Enfin ! L’immuable lien entre parent et enfant peut enfin être considéré comme délétère lorsque le parent est violent. Que d’années perdues, que de vies abîmées, pour n’avoir pas su dissocier le père du mari, la femme de la mère, pour avoir nié l’évidence qu’un mari violent – car c’est souvent un mari – est un homme violent, un père violent !
Non, un enfant ne peut pas se construire de façon équilibrée dans un climat de violence. Même si cette dernière n’est exercée que sur la mère, elle constitue une violence pour l’enfant.
Il s’agit d’une violence psychologique : l’enfant est pris dans un étau entre son père et sa mère, impuissant, inquiet pour sa propre sécurité face à un conflit qui, pour reprendre les termes du juge Édouard Durand, s’apparente à une scène de guerre ou à un attentat. Pour lui, c’est même pire que cela, car, dans une guerre ou après un attentat, l’enfant peut encore se réfugier dans les bras de l’un de ses parents.
L’enfant n’a d’autre choix que de se taire, d’assister, impuissant, au délitement des piliers de son existence. Cette violence psychologique aura incontestablement des effets graves sur son développement, sur l’enfant qu’il est et sur l’adulte qu’il deviendra.
Protéger l’enfant, c’est donc l’éloigner de cette violence, quitte à suspendre l’autorité parentale qui, rappelons-le, vise à protéger l’enfant, sa sécurité, sa santé et sa moralité, afin de garantir son éducation et de permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale est une responsabilité vis-à-vis de l’enfant, un devoir. Un parent violent n’est pas un bon parent. De nombreuses études montrent qu’un père violent se sert de ses enfants pour nuire à la mère ; car la victime est souvent la mère. Il l’utilise comme monnaie d’échange, y compris après la séparation.
L’autorité parentale que peut exercer le parent violent, condamné, soumet l’enfant à une pression insidieuse, perverse, qui ne permet pas à l’enfant de se reconstruire et qui place la mère face à un danger permanent. Aujourd’hui, le bourreau dicte encore sa loi.
Et que dire de la violence directe, de l’inceste ! À ce titre, je tiens à saluer tout particulièrement le travail et l’engagement de longue date sur ce sujet de notre rapporteure, Marie Mercier.
La commission des lois a fait le choix d’autoriser la suspension en urgence, avant tout jugement, de l’exercice de l’autorité parentale d’un parent mis en cause pour les infractions les plus graves sur son enfant – crime, viol et agression sexuelle.
Je comprends cette position équilibrée, qui tend à concilier présomption d’innocence et protection de l’enfant. Je souhaite cependant que nous puissions aller plus loin : plus que l’exercice de l’autorité, c’est bien l’autorité parentale en tant que telle qu’il faut suspendre, car le parent privé de l’exercice de cette autorité en reste néanmoins le titulaire. Ainsi, le parent poursuivi, mis en examen ou condamné pour des faits graves, conserve certains attributs fondamentaux de l’autorité parentale, comme le droit de surveillance de l’enfant. Il est important de corriger cette situation.
Nous devons être plus ambitieux ! Pourquoi ne pas étendre le dispositif de l’article 1er aux atteintes sexuelles incestueuses ? Nous aurons l’occasion d’en rediscuter, madame la rapporteure.
Je me félicite également du choix de la commission d’ériger en principe la suspension du droit de visite et d’hébergement dans le cadre d’un contrôle judiciaire pour violences intrafamiliales. Il s’agit là encore d’une mesure de cohérence, qui aura pour effet d’acculturer les juges et de les inciter à porter un regard neuf sur ces dossiers complexes.
En tant que présidente de la délégation aux droits des femmes et auteure de la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels, texte enrichi des apports du Parlement et complété par vos travaux, madame la rapporteure, je me félicite des avancées proposées aujourd’hui par la commission des lois.
Ce texte marque bien le début d’un changement profond dans notre manière d’appréhender les violences intrafamiliales et d’accompagner les victimes. C’est, du reste, la raison pour laquelle le groupe Union Centriste le votera.
En m’exprimant à la tribune cet après-midi, je n’oublie pas toutes les personnes que j’ai reçues et rencontrées. J’ai une pensée toute particulière pour cette maman, qui m’a sollicitée pour la première fois il y a quelques mois, et dont les trois enfants avaient été victimes d’inceste.
Cette mère, comme beaucoup d’autres, a besoin que la justice l’aide à éloigner ses enfants de leur père. Je lui emprunterai ses mots : « Les enfants sont l’avenir, protégeons-les ! » Pour l’instant, hélas, nous n’y parvenons pas…
Enfin, je souhaite rendre hommage au travail de la sénatrice Dominique Vérien, qui aurait également dû prendre la parole à cette tribune, et qui est actuellement chargée par l’exécutif d’une mission sur le traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Nous attendons, monsieur le garde des sceaux, les conclusions de ce rapport qui nous permettra d’avancer sur ces sujets.
Applaudissements sur les travées du groupe UC. – Mme Michelle Meunier et Mme le rapporteur applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la présente proposition de loi, qui aménage les conditions du retrait ou du maintien de l’autorité parentale et de son exercice en cas de violences intrafamiliales, est un texte attendu par de nombreuses associations.
Elle traduit le principe, enfin admis, selon lequel un parent violent ne saurait être un bon parent. Elle vise aussi à ce que les enfants bénéficient de la meilleure protection juridique possible. Cela suppose de trouver la bonne articulation entre cet impératif et le respect de l’autorité parentale et de la présomption d’innocence, ce qui n’est pas chose facile.
L’autorité parentale ne peut pas se résumer à un droit sur l’enfant, car elle constitue un ensemble de droits et de devoirs qui, en principe, garantissent une protection à l’enfant dans le cadre de son éducation.
D’emblée, je tiens à approuver la réécriture de l’intitulé du texte opéré par la commission, laquelle a fait disparaître le terme de « covictimes ». En effet, si l’on comprend l’intention de l’auteure de la proposition de loi, il n’en reste pas moins qu’un enfant qui vit des violences intrafamiliales est une victime directe de ces violences. Le terme « covictime » pouvait laisser entendre que l’enfant était une victime collatérale. Ce changement d’intitulé vaut surtout reconnaissance, pour l’enfant, du statut de victime de violences intrafamiliales.
Sur proposition de la rapporteure, Marie Mercier, la commission a simplifié ou complété les dispositifs initialement conçus.
Pour ce qui est des simplifications apportées, je salue l’approche pragmatique adoptée par la commission à l’article 1er, qui impose aux juridictions de se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice. Cette réécriture assure la lisibilité du lien, désormais automatique, entre condamnation pour violences sur la personne de l’autre parent ou sur l’enfant et autorité parentale. Il s’agit d’une réelle avancée.
De même, le texte initial prévoyait fort opportunément d’étendre la mesure de suspension automatique de l’autorité parentale, prévue à l’article 378-2 du code civil, aux violences provoquant une ITT de plus de huit jours sur l’autre parent, ainsi qu’aux faits de viol ou aux agressions sexuelles incestueuses sur l’enfant.
La commission a limité cette suspension aux cas les plus graves, considérant que, pour les autres cas, l’objectif visé était déjà satisfait par le droit.
L’article 2, qui garantit l’individualisation des décisions des magistrats, pose le principe du retrait de l’autorité parentale avec, si je puis dire, une différenciation entre les obligations incombant aux magistrats en matière de prononcé de décision relative à l’autorité parentale ou son exercice.
La possibilité pour le juge de maintenir l’autorité parentale ou son exercice sur décision spécialement motivée devra, quant à elle, permettre de prendre en compte les cas, même marginaux, de crimes commis à la suite de violences subies par l’un des deux parents. Vous avez sans doute en tête, tout comme moi, la terrible histoire de Valérie Bacot.
Avec force, les associations œuvrant contre les violences faites aux femmes et, plus particulièrement, celles qui accompagnent les familles de victimes de féminicide, réclament une suspension automatique de l’autorité parentale jusqu’au procès.
Cette demande se justifie par les situations dramatiques que vivent les enfants orphelins à la suite de féminicides, qui sont restés sous l’autorité parentale du parent survivant, voire pire, sous la menace de l’exercice du droit de visite. Ces cas sont rarissimes, mais en la matière – vous en conviendrez, monsieur le ministre, mes chers collègues –, un cas c’est déjà trop !
Si je ne doute pas une seconde de la rigueur du travail des magistrats et de leur souci de l’intérêt de l’enfant, j’ai été étonnée, à la faveur des témoignages, par l’existence de disparités territoriales en matière de coordination.
Comment garantir une articulation optimale entre l’ensemble des acteurs impliqués pour ce qui est des décisions de maintien ou de retrait de l’autorité parentale ? En matière de féminicide, le « protocole féminicide » me semble offrir un cadre adapté.
J’ai moi-même engagé un travail pour concevoir un statut propre à ces enfants orphelins, qui dépasse le simple cadre de ce texte. À ce titre, je vous adresserai prochainement, monsieur le ministre, les conclusions du colloque que j’ai coorganisé avec l’Union nationale des familles de féminicides (UNFF) en février dernier.
L’article 2 bis élargit et précise les cas de délégation de l’autorité parentale. Il facilitera le quotidien des enfants recueillis et des familles les accueillant. Il existe en effet, hélas, des situations dans lesquelles l’autorité parentale peut devenir une arme entre les mains du parent.
Les féminicides sont des drames que l’on n’anticipe pas. Les enfants sont souvent placés dans de telles situations que chaque obstacle administratif ou juridique paraît insurmontable aux familles.
Cet article 2 bis apporte une solution à l’une des conséquences pratiques des violences intrafamiliales. Il en va de même pour la mesure de stabilisation prévue à l’article 2 ter, qui est prise dans l’intérêt de l’enfant.
Vous l’aurez compris, ce texte me semble contribuer à la protection des enfants victimes de violences intrafamiliales. On ne peut que se féliciter de son enrichissement tout au long de son examen.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC. – Mme le rapporteur applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord saluer Isabelle Santiago, l’autrice de la proposition de loi, que je remercie pour son initiative. Je profite également de l’occasion qui m’est donnée pour remercier la Chancellerie, qui, si j’ai bien compris, a collaboré avec notre collègue députée sur ce texte.
Je voudrais, pour commencer, vous faire part de trois regrets.
Le premier concerne le choix de la commission des lois de restreindre la portée de cette proposition de loi.
Le deuxième porte sur la méthode. Je déplore un patchwork législatif : on avance sur ce sujet de proposition de loi en proposition de loi – c’est la quatrième en quatre ans ! –, ce qui nous conduit à laisser des trous énormes dans la raquette.
Troisième regret, nous nous apprêtons à voter des dispositions similaires à des mesures que certains de mes collègues et moi-même avions défendues via des amendements il y a moins de deux ans de cela, et qui, à l’époque, avaient été rejetées, certainement parce qu’elles n’avaient pas eu l’heur de plaire à la commission des lois… En attendant, on a perdu du temps ! Et nous avons toujours besoin d’une belle et grande loi sur la protection des femmes et des enfants, ainsi que sur les violences intrafamiliales.
Cela étant dit, permettez-moi de vous raconter ce que je vis : il ne se passe pas une semaine – j’y insiste – sans que je sois saisie par des mères de famille ou des avocates de dossiers qui, tous, se ressemblent.
Ces affaires commencent généralement par la séparation des parents, laquelle découle presque toujours du départ de la mère. Ayant été quitté, abandonné, le père en ressort à chaque fois l’orgueil blessé. La séparation se passe mal, et c’est évidemment autour des enfants que se cristallise le conflit consécutif à la séparation.
Quelque temps plus tard en effet, les enfants rentrent du week-end qu’ils ont passé chez leur père en dénonçant des comportements incestueux, dont ils n’avaient jamais été victimes jusqu’ici. Il se passe vraisemblablement des choses graves dans de pareilles situations, monsieur le garde des sceaux
M. le garde des sceaux acquiesce.

À étudier ces cas de près, j’ai le sentiment que le père se venge de la mère en lui portant des coups là où cela lui fait le plus mal, c’est-à-dire en commettant des agressions sexuelles sur leurs enfants.
La mère de famille porte ensuite plainte et c’est alors que commence pour elle le chemin de croix. Car c’est un chemin de croix ! Sachez que le doute profite toujours à l’accusé, au père donc, dans ce type d’affaires par nature complexes.
J’ai en tête l’exemple d’une mère de famille devant laquelle le juge a admis savoir que son enfant disait la vérité ; mais il a conclu qu’il ne pouvait rien faire d’autre que de lui recommander de renvoyer cet enfant chez son père, pour mieux établir la matérialité des faits…
Finalement, les experts s’en mêlent, et c’est à cette occasion que le fameux syndrome d’aliénation parentale, que certaines de mes collègues ont évoqué, fait son apparition. En règle générale, on en déduit que la mère est une manipulatrice, une affabulatrice qui transforme la parole de son enfant, et que le père est une victime.
De ce fait, la mère finit par ne plus vouloir envoyer l’enfant chez son père, de peur qu’il ne soit exposé à des comportements incestueux. Et le père se retourne immanquablement contre elle en invoquant le délit de non-représentation d’enfant.
Ces cas sont légion ! Évidemment, je ne remarque que les trains qui arrivent en retard, puisque c’est de ceux-là que l’on me parle, monsieur le garde des sceaux…
Ces femmes vivent un enfer judiciaire, au point, pour certaines d’entre elles, de devoir partir à l’étranger avec leurs enfants, seule solution à leur disposition pour s’en sortir.
Je tenais absolument à évoquer ces dossiers devant vous. Nous devons absolument réfléchir ensemble à des solutions permettant d’apporter des réponses plus efficaces. Ce que je viens de décrire s’apparente en effet à de la maltraitance institutionnelle infligée aux femmes et aux enfants !
Mes chers collègues, nous sommes beaucoup trop frileux sur le sujet : il nous faut répondre à cette immense souffrance et non poursuivre cette politique des petits pas.
Monsieur le garde des sceaux, permettez-moi de vous remercier pour le décret du 23 novembre 2021 relatif au délit de non-représentation d’enfant, qui a déjà permis d’améliorer les choses. Il faudra aller encore plus loin et supprimer totalement ce délit, qui ne sert finalement qu’aux pères.
De même, quand s’inquiétera-t-on enfin de la différence de traitement entre, d’un côté, ces pères qui, bien que n’exerçant pas leur droit de visite et d’hébergement, ne sont jamais sanctionnés et jamais condamnés au paiement d’une amende civile et, de l’autre, ces mères qui, parce qu’elles ne remettent pas leur enfant à leur père un week-end, sont régulièrement harcelées par celui-ci ?
Qui n’a jamais entendu parler des « enfants à la fenêtre », ces enfants qui, chaque week-end, passent leur temps à attendre un père qui ne vient pas parce que c’est le meilleur moyen que celui-ci a trouvé pour empêcher la mère de sortir de chez elle ?
Brouhaha sur les travées du groupe Les Républicains, car l ’ oratrice a épuisé son temps de parole.

Pour terminer, j’évoquerai cette circulaire, diffusée en 2017 auprès des magistrats, pour les mettre en garde au sujet du syndrome d’aliénation parentale : il y est question de « mères manipulatrices », ce qui montre bien que nous sommes face à un problème de culture. C’est en changeant la culture du milieu que les choses changeront !
Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons vise à mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales. Le 9 février dernier, elle a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale. Le Gouvernement n’a pas engagé la procédure accélérée sur ce texte, car il traite d’un sujet sensible, celui de la protection de l’enfance, qui requiert que toutes les précautions soient prises par le législateur.
Nous constatons que cette proposition de loi a fait l’objet de modifications lors de chaque lecture, depuis son dépôt jusqu’à son examen aujourd’hui en séance publique par notre assemblée. Elle s’inscrit dans la droite ligne de la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.
Ce texte a introduit dans notre droit une distinction entre le retrait de l’autorité parentale et celui de l’exercice de l’autorité parentale.
Il vise à élargir le mécanisme de suspension provisoire de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale dans le cadre des procédures pénales, et à rendre plus systématique le prononcé du retrait de l’autorité parentale par les juridictions pénales en cas de crime commis sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent ou d’agression sexuelle incestueuse.
Depuis 2016, le nombre de cas de violences intrafamiliales ne cesse d’augmenter.
En 2019, 44 % des plaintes pour violences physiques et sexuelles enregistrées par les services de sécurité concernaient des violences commises au sein de la famille. Un pic a été atteint en 2020 en raison du confinement, mais la tendance à la hausse ne semble pas fléchir, comme le prouvent les chiffres enregistrés depuis 2021. La libération de la parole et l’encouragement à signaler toutes les formes de violences intrafamiliales ont sans aucun doute contribué à cette augmentation.
Ces chiffres effrayants, derrière lesquels il convient de mettre des visages, nous obligent, en notre qualité de législateur, à agir : il s’agit pour nous d’enrayer ce phénomène.
Je tiens à saluer le travail minutieux de réécriture effectué par notre rapporteur, Marie Mercier, qui maîtrise parfaitement ces mécanismes juridiques complexes, et qui a déjà beaucoup œuvré sur le sujet des violences conjugales et intrafamiliales. Je la rejoins dans son choix de limiter son intervention à quelques ajustements, en se concentrant sur l’amélioration des dispositifs que sont la suspension provisoire de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et le retrait de cette autorité par les juridictions pénales.
Le respect des principes généraux du droit, constitutionnels et conventionnels, que sont la présomption d’innocence, l’intervention nécessaire du juge appréciant in concreto l’intérêt de l’enfant, le droit à une vie familiale et privée normale, a très nécessairement guidé le travail de la commission des lois.
J’ajoute que les amendements adoptés en commission ont permis de rationaliser et de mettre en cohérence le droit civil avec le droit pénal.
Ainsi, à l’article 1er, le dispositif adopté par la commission réserve l’extension de la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement aux cas les plus graves, ceux de crime ou d’agression sexuelle incestueuse sur la personne de l’enfant. Cette disposition permettra de suspendre en urgence, avant tout jugement, l’exercice de l’autorité parentale d’un parent mis en cause commission des infractions les plus graves sur son enfant, le temps qu’un juge se prononce.
La commission a considéré qu’une suspension automatique, tout le temps de la procédure – comme on le sait, celle-ci peut durer des années –, était disproportionnée au regard de la présomption d’innocence et du droit de chacun de mener une vie normale.
L’article 2 prévoit de faire un principe du retrait total de l’autorité parentale en cas de crime ou d’agression sexuelle incestueuse sur l’enfant ou de crime sur l’autre parent.
Enfin, l’article 3 contribuera à rendre plus cohérentes et effectives les mesures figurant dans cette proposition de loi.
Ainsi modifié par la commission des lois, le texte améliore les dispositifs juridiques existants, afin de garantir une meilleure protection des enfants victimes de parents violents. C’est pourquoi le groupe Les Républicains votera naturellement cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mmes Annick Billon et Colette Mélot ainsi que Mme le rapporteur applaudissent également.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite m’adresser plus particulièrement aux sénatrices Laurence Rossignol et Laurence Cohen.
Je regrette comme vous, madame Rossignol, ce que vous avez qualifié de « patchwork législatif ». Mais convenez avec moi que nous n’avons pas le don de médiumnité et qu’il faut savoir s’adapter au fur et à mesure aux évolutions, parfois terrifiantes d’ailleurs, de notre société et de notre époque. Au fond, ce n’est pas le droit qui fait la société, mais la société qui fait le droit.
Ce que vous venez de décrire, nous l’avons déjà évoqué ensemble devant la délégation sénatoriale aux droits des femmes. Je vous remercie d’avoir rappelé que vous aviez attiré mon attention sur les enfants témoins, auxquels nous avons souhaité conférer le statut de victimes : quand vous êtes le témoin, alors que vous êtes encore tout petit, d’une scène au cours de laquelle votre père tabasse votre mère, vous n’êtes plus un simple témoin, mais une victime. Cette mesure, nous l’avons prise.
Reste la question des poursuites pour non-représentation d’enfant. J’entends ce que vous dites : cela se passe souvent – mais pas toujours, et c’est pourquoi il faut rester prudent – comme vous le décrivez. Dans cette hypothèse terrifiante, une maman doit livrer son enfant à son bourreau.
Vous le savez mieux que moi, l’irrecevabilité des initiatives parlementaires ne revêt aucune signification sur le fond. Qu’un amendement soit déclaré irrecevable pour un motif juridique ne signifie pas que nous ne sommes pas, les uns et les autres, préoccupés par la question qu’il soulève. Et je me permets de vous prendre à témoin, madame la rapporteure, à ce sujet.
Mme le rapporteur approuve.
Je vous promets, madame la sénatrice, que nous allons avancer sur cette question. J’attends simplement – ce n’est pas anormal – le rapport de Mmes Dominique Vérien et Émilie Chandler qui devrait bientôt m’être remis. Il traitera de cette problématique importante : il faudra effectivement qu’à l’avenir on soit en mesure de protéger les femmes qui, n’écoutant que leur amour maternel, ne livrent pas – je reprends cette expression – leur enfant à leur père quand elles savent que celui-ci exerce sur lui des violences ou commet des actes inadmissibles.
Dans le même temps, il convient d’être respectueux des règles constitutionnelles – c’est bien le moins –, notamment du principe de présomption d’innocence.
Nous réfléchissons bel et bien à ce sujet. Je vous avais d’ailleurs dit, lors de mon audition par la délégation aux droits des femmes, que nous y travaillerions. Je vous le redis, madame Rossignol, et je m’adresse également à Mme Cohen qui partage votre préoccupation – une préoccupation qui nous est commune : nous avancerons prochainement sur ce point dont l’enjeu est fondamental.
Cette question met en exergue un traitement totalement injuste dans les situations que vous évoquez. Pas plus que vous, le garde des sceaux ne peut accepter qu’une telle injustice puisse être perpétrée.
Nous devons toutefois attendre, en prenant du recul et en faisant preuve de prudence, les résultats des travaux qui vont nous parvenir. Je sais d’ores et déjà qu’ils sont de grande qualité, ne serait-ce qu’en raison du nombre de personnes auditionnées et de l’engagement de Mme la députée Chandler et de Mme la sénatrice Vérien sur ces sujets. J’ai la conviction que nous pourrons, ensemble, tirer toutes les conséquences de leur rapport.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
L’article 378-2 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le mot : « poursuivi », sont insérés les mots : « par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « parent », sont insérés les mots : « ou pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ».

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, au moment de commencer l’examen de l’article 1er relatif à la suspension provisoire de l’exercice de l’autorité parentale, je souhaite rappeler que, lorsqu’un enfant est en danger, la question de l’autorité parentale ou de son exercice ne se pose que dans un second temps. L’urgence est en effet, dans un premier temps, de mettre l’enfant à l’abri. Il existe alors plusieurs procédures possibles, bien souvent à la main du parquet qui joue un rôle central.
En amont de toute poursuite, le parquet peut ordonner en urgence, et sans aucune procédure contradictoire, le placement provisoire de l’enfant, éventuellement chez l’autre parent, à charge pour lui de saisir le juge des enfants dans un délai de huit jours. Il peut aussi placer l’enfant dans un lieu de placement pour enfants en danger ; mais encore faut-il que des places soient disponibles.
Le parquet peut également, à tous les stades de la procédure ou même en amont, requérir la délivrance d’une ordonnance de protection auprès du JAF, avec des mesures d’interdiction d’entrer en relation et de se rendre dans certains lieux, ou la suspension du droit de visite et d’hébergement.
Enfin, dans le cadre d’une information judiciaire ou de procédures rapides de jugement, la personne poursuivie peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence sous surveillance électronique. Là encore, peuvent être prononcées une interdiction d’entrer en contact et de paraître en certains lieux ou la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur.
Mes chers collègues, il est nécessaire de garder à l’esprit que ces dispositifs se cumulent et que la mise à l’abri de l’enfant, à proprement parler, ne repose pas sur les articles 378-2 et 378 du code civil, dont nous discutons actuellement.

Le dispositif initial défini à l’article 1er visait à créer un régime spécifique en cas de condamnation, même non définitive, pour des violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits.
Je partage l’avis de Mme la rapporteure sur le point suivant : rien ne justifie de conditionner cette mesure au fait que l’enfant ait assisté aux violences.
Selon le juge Édouard Durand, président de la Ciivise, l’ajout de cette condition de présence de l’enfant lors des faits permet de diviser par quatre ou cinq le nombre de dossiers à traiter. Or nous ne sommes pas ici pour réduire le nombre de dossiers aux dépens des victimes, mais pour renforcer la protection des enfants ! J’en profite donc pour remercier Mme la rapporteure d’avoir pris en considération l’amendement que j’avais déposé en commission et qui a été intégré au texte.
Toutefois, il est fondamental de tenir compte des violences conjugales – et pas uniquement des crimes commis sur l’autre parent – comme motif de suspension de l’autorité parentale ou de son exercice. Nous devons consacrer la formule suivante : « Un parent violent ne peut pas être un bon parent. » C’est d’ailleurs l’un des objectifs de l’amendement que je défendrai dans quelques instants.
En effet, tel qu’il est rédigé, l’article 1er ne permet pas une prise en compte globale de la problématique des femmes victimes de violences conjugales et, intrinsèquement, des enfants victimes de violences intrafamiliales.

Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 22, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, ou pour une agression sexuelle incestueuse ou atteinte sexuelle incestueuse ou un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.
L’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent prévues soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux sections 1, 3 et 3 bis du chapitre II du même titre II, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale.
À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis.
À défaut, le retrait partiel provisoire de l’autorité parentale peut être prononcé. Dans ce cas, la suspension provisoire de l’autorité parentale comprend le retrait du droit de surveiller l’éducation de l’enfant.
Peut se voir retirer totalement l’autorité parentale ou, à défaut, l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice, hors le cas prévu au précédent alinéa, d’un délit commis sur la personne de son enfant, soit comme coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un délit sur la personne de l’autre parent.
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, nous souhaitons aller plus loin en matière de protection des enfants.
Par conséquent, nous proposons de retirer l’autorité parentale – et non simplement l’exercice de l’autorité parentale – du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, que ce soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, pour une agression sexuelle incestueuse, pour une atteinte sexuelle incestueuse, ou encore pour un crime commis sur la personne de son enfant, et ce jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales.
Nous proposons donc de rétablir la version du texte adoptée à l’Assemblée nationale, pour que ces dispositions s’appliquent pendant toute la durée de la procédure pénale. Cela nous paraît, madame la rapporteure, bien plus protecteur.
Nous proposons également d’étendre ces dispositions à l’ensemble des violences volontaires commises dans le cadre conjugal ou post-séparation.
En ce sens, nous regrettons, et nous ne comprenons pas, l’exclusion de ces violences par la commission des lois. Il est primordial de préserver les enfants victimes durant le temps de l’enquête. Le doute doit profiter à la protection de l’enfant. Nous ne devons pas prendre le risque qu’un acte de nature pénale soit commis contre l’enfant pendant ce temps de latence.
Mes chers collègues, la simple suspension de l’exercice de l’autorité parentale ne suffit pas à protéger efficacement les enfants victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. En effet, dans ce cas, l’autre parent a l’obligation de donner au parent poursuivi pour violences l’adresse du nouveau domicile ou de l’école. Ce dernier doit également être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant. Selon nous, ce n’est pas acceptable !
Je vous appelle donc à soutenir notre amendement visant à réécrire l’article 1er dans un sens qui nous semble bien plus protecteur.

Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 44 rectifié bis est présenté par Mme Vérien, MM. Détraigne et Henno, Mme de La Provôté, M. Cadic, Mme Dindar, M. Delahaye, Mmes Ract-Madoux et Sollogoub, M. Le Nay, Mmes Jacquemet et Vermeillet, M. Levi, Mme Loisier, M. Janssens, Mmes Perrot et Saint-Pé, M. Duffourg, Mmes Herzog et Guidez, M. Longeot et Mme Doineau.
L’amendement n° 45 rectifié ter est présenté par Mme Billon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 378-2. – L’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, ou pour une agression sexuelle incestueuse ou atteinte sexuelle incestueuse ou un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.
« L’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent prévues soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux sections 1, 3 et 3 bis du chapitre II du même titre II, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis.
« À défaut, le retrait partiel provisoire de l’autorité parentale peut être prononcé. Dans ce cas, la suspension provisoire de l’autorité parentale comprend le retrait du droit de surveiller l’éducation de l’enfant. »
La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour présenter l’amendement n° 44 rectifié bis.

La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 45 rectifié ter.

Ma collègue Dominique Vérien et moi-même proposons une nouvelle rédaction de l’article 1er, tout en conservant les deux dispositifs introduits entre-temps au travers de l’amendement de Mme la rapporteure. L’objectif est d’aboutir à une rédaction juridique complète de l’article 378-2 du code civil.
Le présent amendement vise à prévoir une suspension de plein droit de la titularité de l’autorité parentale, et non simplement de son exercice.
La distinction entre exercice et titularité est primordiale. Un parent titulaire de l’autorité parentale maintient des relations personnelles avec l’enfant et conserve un droit de surveillance sur ce dernier. Le parent poursuivi, mis en examen ou condamné, conserve donc certains attributs fondamentaux de l’autorité parentale : nous souhaitons corriger cette situation.
Nous estimons nécessaire de prendre en compte l’ensemble des violences sexuelles incestueuses commises à l’encontre d’un enfant, et voulons étendre les cas de retrait provisoire de plein droit de l’autorité parentale du parent poursuivi ou condamné au délit d’atteinte sexuelle incestueuse.
La notion d’atteinte sexuelle permet d’englober un plus grand nombre de cas dans lesquels l’enfant est victime d’inceste et de lui assurer ainsi une meilleure protection. Une agression sexuelle est une atteinte sexuelle non consentie.
Enfin, cet amendement vise à prendre en considération les condamnations pour violences conjugales, et pas seulement les crimes commis par un parent à l’égard de l’autre parent, sans les conditionner à un nombre minimum de jours d’ITT ou à la présence de l’enfant.
Il n’est pas question d’attendre que l’un des parents tue l’autre parent avant de mettre à l’abri le ou les enfants. La protection des enfants doit nous guider.

L’amendement n° 25, présenté par Mmes Harribey, Meunier, Rossignol, Monier et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit dans un délai maximal de six jours, jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.
« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, sont suspendus de plein droit dans un délai maximal de six jours jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »
La parole est à Mme Laurence Harribey.

Par cet amendement, nous souhaitons manifester notre attachement, souligné lors de la discussion générale, à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Celle-ci nous semble en effet particulièrement intéressante et fidèle à l’idée originelle du texte, et les propos de M. le garde des sceaux ont montré qu’il semblait partager cette appréciation.
Nous défendons la non-limitation de la suspension de l’exercice de l’autorité parentale ainsi que des droits de visite et d’hébergement : cela nous semble impérieux en cas de poursuite ou de condamnation pour des faits criminels ou d’agressions sexuelles commises par un parent sur son enfant. Cette suspension revient à accorder le bénéfice d’une protection durable, qui peut couvrir une longue période.
Les violences conjugales sont trop nombreuses et trop lourdes de conséquences pour les enfants qui en sont victimes pour ne pas conduire à la suspension de l’autorité parentale ainsi que des droits de visite et d’hébergement.
Afin de faciliter le travail des juges et d’éviter une limitation excessive de la portée du texte sur ce point, nous proposons de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

L’amendement n° 26, présenté par Mmes Harribey, Meunier, Rossignol, Monier et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.
« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »
La parole est à Mme Laurence Harribey.

Par cet amendement de repli, nous souhaitons proposer une nouvelle rédaction de l’article 1er incluant les violences conjugales à partir de huit jours d’ITT, ainsi que le crime ou l’agression sexuelle commis sur son enfant, sans délai maximal de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement.
Nous considérons que ces deux dispositions constituent l’un des apports majeurs de la proposition de loi. Nous souhaitons que l’article 1er retrouve l’esprit de sa rédaction initiale.

Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 3 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon.
L’amendement n° 27 est présenté par Mmes Harribey, Meunier, Rossignol, Monier et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.
« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »
La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l’amendement n° 3.

La commission est revenue sur plusieurs mesures protectrices qui avaient pourtant été adoptées à l’Assemblée nationale. Le présent amendement vise à en rétablir deux.
Premièrement, il s’agit de permettre la suspension de l’exercice de l’autorité parentale pour certaines violences graves jusqu’à ce que la justice statue.
Cette suspension est actuellement limitée à une durée de six mois, même lorsque le parent est poursuivi par le ministère public, mis en examen ou condamné pour un crime commis sur l’autre parent, pour agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis contre son enfant. Or, si la justice est trop lente et met plus de six mois avant de statuer – cela peut arriver –, l’enfant est de nouveau en danger une fois ce délai écoulé.
Deuxièmement, nous souhaitons rétablir la suspension de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite visant le parent condamné pour des violences volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, si l’enfant a assisté aux faits.
Nous parlons de cas extrêmement graves. Comme l’ont dit de nombreuses collègues, l’enfant est alors non pas seulement témoin mais victime, car il souffrira sans doute toute sa vie d’avoir assisté à ces faits.
Il paraît donc important, dans ces cas, de suspendre l’autorité parentale ainsi que les droits de visite et d’hébergement du parent condamné pour de tels faits, jusqu’à ce que le JAF statue sur l’autorité parentale.

La parole est à Mme Laurence Harribey, pour présenter l’amendement n° 27.

Lorsque des violences sont commises sur l’autre parent, nous sommes prêts à réintroduire la condition selon laquelle l’enfant doit avoir assisté aux faits pour que l’exercice de l’autorité parentale soit suspendu. Nous soulignons cependant qu’il s’agit là d’un premier pas ; un enfant peut en effet être considéré comme victime de violence sans avoir assisté à de tels faits.

L’amendement n° 28, présenté par Mmes Harribey, Meunier, Rossignol, Monier et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal. »
La parole est à Mme Laurence Harribey.

Cet amendement nous donne l’occasion d’attirer une nouvelle fois l’attention sur l’un des points les plus importants de ce texte.
Nous entendons l’intention de Mme le rapporteur, qui souhaite conserver l’ajout relatif au crime ou à l’agression sexuelle commis sur la personne de son enfant à l’article 378-2 du code civil. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit une limitation de la suspension de l’autorité parentale à un délai maximal de six mois.
Si nous comprenons les inquiétudes exprimées en commission au sujet de la présomption d’innocence, nous insistons sur l’importance de supprimer ce délai maximal.
Nous avons évoqué précédemment l’instrumentalisation, qu’il convient d’éviter, par des parents de cette disposition. Il est fondamental de ne pas remettre en cause la suspension de l’autorité parentale, et ce jusqu’à l’extinction des poursuites, car c’est une façon de protéger l’enfant.

Je consacrerai davantage de temps au premier de ces amendements, car l’article 1er est assez complexe.
L’amendement n° 22, défendu par Mme Cohen, vise à suspendre non pas l’exercice de l’autorité parentale, mais l’autorité parentale elle-même, c’est-à-dire sa titularité. Cela change totalement la nature de cette suspension, tout en maintenant une durée qui pourrait atteindre plusieurs années.
Le but de cette modification est de couper, durant le temps de la procédure pénale, tout lien avec l’enfant et de veiller à ce que le parent poursuivi ou mis en examen ne soit plus informé du devenir de son enfant. En effet, l’article 373-2-1 du code civil dispose : « Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. »
L’amendement vise également à intégrer, dans le champ de la procédure de suspension provisoire de plein droit, les atteintes sexuelles incestueuses, ce qui recouvre l’exhibition ou le visionnage de film pornographique en présence de l’enfant.
Enfin, l’amendement tend à réintégrer un dispositif, distinct, de suspension provisoire de plein droit, en cas de condamnation pour violences volontaires sur l’autre parent, sans qu’il soit fait référence à une durée d’ITT ou à la présence des enfants au moment des faits. Précisons qu’une partie des infractions visées sont des crimes, lesquels entrent dans le dispositif proposé par la commission.
Les modifications suggérées vont plus loin que la proposition de loi initiale et le texte adopté par la commission. Le dispositif proposé aggrave la mesure de suspension en étendant son champ à des délits, ce qui porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
Compte tenu de son caractère automatique et de l’absence de toute intervention du juge, la commission a souhaité réserver la suspension provisoire de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale aux seuls cas les plus graves – les crimes et les délits d’agression sexuelle incestueuse – et conserver les mêmes effets limités dans le temps qu’actuellement, soit une durée maximale de six mois jusqu’à la décision du JAF.
De surcroît, la rédaction proposée pose de nombreuses difficultés techniques, car elle mélange les notions de suspension et de retrait. Les auteurs de l’amendement partent du principe que la suspension serait prononcée par un magistrat, alors qu’elle est de plein droit et s’opère automatiquement par simple effet de la loi en cas de poursuite par le ministère public, de mise en examen par le juge d’instruction ou de condamnation. Elle n’est donc pas formalisée par une décision qui pourrait acter un retrait partiel au lieu d’un retrait total.
Par ailleurs, le JAF n’est pas compétent en matière d’autorité parentale, mais d’exercice de l’autorité parentale. Si l’autorité parentale est suspendue, c’est donc non pas ce juge qui pourrait la rétablir, mais la juridiction judiciaire en formation collégiale.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 22.
Les amendements identiques n° 44 rectifié bis et 45 rectifié ter sont similaires au précédent : ils visent à suspendre l’autorité parentale dans l’objectif de supprimer tout lien entre le parent violent, l’enfant et l’autre parent.
J’émets les mêmes réserves sur ces amendements, fondées sur l’absence de proportionnalité et les difficultés techniques d’application.
J’y insiste, dans le texte issu des travaux de la commission, les violences volontaires les plus graves sont incluses dans le dispositif de suspension puisqu’il s’agit de crimes.
Par ailleurs, en cas de condamnation pour violences conjugales de nature délictuelle, selon les dispositions du décret du 23 novembre 2021, l’enfant témoin de ces violences est considéré comme une victime ; la juridiction pénale a donc l’obligation de se prononcer sur l’autorité parentale. Tel est le sens des modifications que j’ai proposées en commission, qui visent à obliger les juridictions à se prononcer en cas de délit à l’encontre de la personne de l’enfant.
Notre boussole est l’intérêt de l’enfant, lequel doit être au centre du dispositif en matière d’autorité parentale. La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
L’amendement n° 25 vise à rétablir le texte de l’Assemblée nationale, tout en ajoutant un délai de six jours pour l’intervention de la suspension et en supprimant la condition relative à la présence de l’enfant pour ce qui concerne les violences conjugales.
La commission a entendu limiter le jeu de la suspension provisoire de plein droit aux seules infractions les plus graves – crimes et délits d’agression sexuelle incestueuse sur l’enfant – et conserver le même effet dans le temps de cette suspension automatique qu’actuellement, afin que le juge soit systématiquement saisi et se prononce au terme de six mois. Il s’agit de la contrepartie nécessaire de l’automaticité.
Par ailleurs, le délai de six jours prévu – l’équivalent de celui qui existe en matière d’ordonnance de protection – n’a pas de sens en l’espèce, puisque la suspension est de plein droit et intervient par simple effet de la loi : elle n’est pas formalisée par une décision de justice, mais court dès qu’il y a mise en examen ou poursuite par le parquet.
Enfin, je partage les propos de mes collègues sur le point suivant : la condition liée à la présence de l’enfant lors des faits n’a pas de sens. Toutefois, la commission a choisi de ne pas créer de régime de suspension particulier en cas de condamnation pour violences conjugales de nature délictueuse. Il appartient donc à la juridiction pénale de se prononcer, au moment de la condamnation, sur l’autorité parentale. C’est le sens de l’article 228-1 que nous avons introduit dans le code pénal au travers de l’article 3 de la proposition de loi.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 26, variante du précédent, vise à rétablir le texte de l’Assemblée nationale, tout en supprimant la condition relative à la présence de l’enfant.
L’avis de la commission est également défavorable sur cet amendement.
Les amendements identiques n° 3 et 27, qui visent à rétablir le texte de l’Assemblée nationale, vont à l’encontre de la position de la commission.
Pour des raisons de proportionnalité et compte tenu de l’automaticité, la commission a entendu – je le répète – limiter la suspension provisoire de plein droit aux seules infractions les plus graves et conserver la procédure existante, qui garantit qu’un juge soit systématiquement saisi et se prononce au bout de six mois. Encore une fois, c’est la contrepartie nécessaire de l’automaticité.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Enfin, la commission est défavorable à l’amendement n° 28. On le sait, tout un chacun ne dispose pas des ressources nécessaires pour saisir un juge – et en la matière, il ne s’agit pas uniquement d’argent : tout le monde n’ose pas saisir un juge.
Mesdames les sénatrices, vous proposez au travers de ces amendements de créer deux mécanismes de suspension de plein droit de la titularité de l’autorité parentale ou de son exercice, ainsi que des droits de visite et d’hébergement.
Le premier mécanisme, en cas de poursuite ou de condamnation du parent pour un crime commis sur l’autre parent ou pour une agression sexuelle incestueuse ou un crime commis sur l’enfant, s’appliquerait jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, la décision de non-lieu du juge d’instruction ou la décision du juge pénal.
Le second mécanisme, en cas de condamnation du parent pour violences entraînant une ITT supérieure à huit jours commises sur l’autre parent, alors que l’enfant a assisté aux faits, s’appliquerait jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales saisi dans un délai de six mois à compter de la décision pénale.
Je vous rejoins évidemment sur la nécessité de prévoir que le mécanisme de suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale ainsi que des droits de visite et d’hébergement s’applique aux crimes et aux agressions sexuelles incestueuses dont un enfant peut être victime. En revanche, il me paraît excessif de suspendre automatiquement – les adverbes ont beaucoup d’intérêt ! – la titularité même de l’autorité parentale alors qu’aucun juge n’a examiné la situation.
Je suis donc défavorable aux amendements n° 22 et 25, ainsi qu’aux amendements identiques n° 44 rectifié bis et 45 rectifié ter.
Sur les amendements identiques n° 3 et 27 visant à rétablir la rédaction de l’article 1er dans sa version issue de l’Assemblée nationale, j’avais indiqué que celle-ci me semblait équilibrée.
Pour des raisons constitutionnelles, il nous faut être prudents. Il est impératif de limiter le mécanisme de suspension de l’exercice de l’autorité parentale aux infractions les plus graves et aux violences conjugales entraînant un ITT de plus de huit jours, à condition qu’elles soient commises en présence de l’enfant.
Dans un souci de cohérence, j’émets un avis de sagesse « bienveillante » sur ces amendements identiques.
L’amendement n° 26, qui vise à supprimer la condition de présence de l’enfant, rompt, selon moi, les équilibres ; j’y suis donc défavorable.
Enfin, pour ce qui concerne l’amendement n° 28 relatif à la durée de suspension de l’autorité parentale, il convient de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, qui prévoit la saisine du JAF par les parties et non plus par le procureur de la République.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.

Cette explication de vote porte sur l’ensemble des amendements faisant l’objet de cette discussion commune.
Mme la rapporteure reproche à notre amendement n° 22 de comporter quelques maladresses qui risquent d’entraîner des contresens juridiques ; je l’entends.
Je la trouve particulièrement sévère à l’égard des amendements, présentés par d’autres groupes que le mien, qui visent à rétablir la version issue de l’Assemblée nationale, laquelle me semble plus protectrice. J’apprécie, en, revanche, l’avis de sagesse et l’avis favorable émis par le garde des sceaux.
J’appelle nos collègues à réfléchir. Nous cherchons sur toutes les travées, comme Mme la rapporteure, à mettre en place une protection qui soit la meilleure possible pour l’enfant. Il faut donc trouver l’équilibre entre les différentes propositions. À cet égard, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale me semble plus juste et plus protectrice.

J’ai entendu les arguments de la rapporteure et du garde des sceaux, mais nous partageons tous un même objectif : la protection de l’enfance. Au travers de ces amendements, nous avons voulu attirer l’attention sur la dangerosité.
Il ne saurait y avoir de gradation de la dangerosité. Lorsqu’existe un soupçon, quelle que soit la nature de la violence intrafamiliale, il y a danger. Le nombre d’enfants qui décèdent sous les coups d’un parent – un tous les cinq jours – et celui des femmes tuées dans le cadre de violences intrafamiliales nous obligent à mettre en œuvre au maximum ce principe de précaution.
En dépit de l’avis défavorable de Mme la rapporteure, je maintiens l’amendement n° 45 rectifié ter. Quant à l’amendement identique n° 44 rectifié bis, il sera certainement maintenu par ses signataires. Je vous invite à les voter, mes chers collègues !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 44 rectifié bis et 45 rectifié ter.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 9 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol, Meunier, Blatrix Contat et Le Houerou, MM. Michau, Pla et Todeschini, Mme Jasmin, M. P. Joly, Mmes Lubin, Poumirol, Conway-Mouret, Briquet, Féret et Monier et MM. J. Bigot, Tissot, Temal et M. Vallet, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
incestueuse commis sur la personne de son enfant
La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Monsieur le président, les dispositions de ces amendements ayant toutes le même but, je les présenterai en même temps.
Mes chers collègues, au préalable, je tiens à rappeler que mon premier choix eût été le vote conforme de l’article 1er. Mais, puisque tel ne peut être le cas, nous avons décidé de déposer quelques amendements.
En vertu du présent texte, l’autorité parentale est suspendue ou retirée « pour un crime ou une agression sexuelle commis sur la personne de son enfant ». J’en déduis qu’elle peut être maintenue sur les autres enfants de la fratrie, ce qui, selon moi, pose un premier problème. Comment un père – c’est l’exemple le plus fréquent – qui a commis un inceste sur l’un de ses enfants peut-il conserver son autorité parentale sur les autres ?
S’y ajoute un second sujet de préoccupation. Prenons le cas d’un père de famille qui se livre à des agressions sexuelles sur mineur, qu’elles soient incestueuses ou non : ce dernier peut être victime d’un oncle ou d’un ami de la famille.
J’imagine que beaucoup d’entre vous ont vu Les Chatouilles, d’Andréa Bescond, qu’il s’agisse de son seul en scène ou de son film : cette histoire, c’est celle d’une petite fille violée pendant toute son enfance par un ami de la famille.
Peut-on imaginer qu’un père de famille condamné pour violences sexuelles sur mineur conserve l’exercice de son autorité parentale sur ses propres enfants ? On peut considérer que pèse sur lui, sinon une suspicion, du moins une présomption de commission d’actes répréhensibles.
Un homme, poursuivi ou condamné pour une agression sexuelle, incestueuse ou non, perpétrée sur un enfant ne saurait conserver son autorité parentale : tel est l’objet de ces cinq amendements.
Nous proposons cinq rédactions différentes. L’une d’elles conviendra peut-être à la commission et au garde des sceaux. Pleine d’espoir, je me dis que la même rédaction pourrait convenir à la commission et au garde des sceaux.
Sourires sur les travées du groupe SER.

L’amendement n° 8 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol, Meunier, Blatrix Contat et Le Houerou, MM. Michau, Pla et Todeschini, Mme Jasmin, M. P. Joly, Mmes Lubin, Poumirol, Conway-Mouret, Briquet, Féret et Monier et MM. J. Bigot, Tissot, Temal et M. Vallet, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
incestueuse commis sur la personne de son enfant
par les mots :
prévu aux articles 222-22, 222-22-1, 222-2-2, 222-22-3, 222-23-1, 222-23-2 et 227-23 du code pénal sur un mineur de seize ans
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° 10 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol, Meunier, Blatrix Contat et Le Houerou, MM. Michau, Pla et Todeschini, Mme Jasmin, M. P. Joly, Mmes Lubin, Poumirol, Conway-Mouret, Briquet, Féret et Monier et MM. J. Bigot, Tissot, Temal et M. Vallet, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
incestueuse commis sur la personne de son enfant
par les mots :
commise sur un mineur
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° 11 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol, Meunier, Blatrix Contat et Le Houerou, MM. Michau, Pla et Todeschini, Mme Jasmin, M. P. Joly, Mmes Lubin, Poumirol, Conway-Mouret, Briquet, Féret et Monier et MM. J. Bigot, Tissot, Temal et M. Vallet, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
incestueuse commis sur la personne de son enfant
par les mots :
commise sur un mineur de moins de 16 ans
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° 12 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol, Meunier, Blatrix Contat et Le Houerou, MM. Michau, Pla et Todeschini, Mme Jasmin, M. P. Joly, Mmes Lubin, Poumirol, Conway-Mouret, Briquet, Féret et Monier et MM. J. Bigot, Tissot, Temal et M. Vallet, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
commis sur la personne de son enfant
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?

Ne me parlez pas comme à une enfant : je n’ai pas peur de la sévérité !

Il s’agissait d’une simple remarque…
( Mme le rapporteur se met à parler très rapidement.) Ces dispositions me semblent aller bien plus loin que les recommandations de la Ciivise, laquelle ne s’est intéressée qu’au lien entre un parent et son enfant.
Protestations sur des travées du groupe SER.

Ces cinq amendements visent tous à étendre les motifs de suspension de l’exercice de l’autorité parentale, en cas de crime ou d’agression sexuelle commis sur un enfant quel qu’il soit, afin d’intensifier la lutte contre la pédocriminalité. §

L’amendement n° 9 rectifié bis tend à permettre une suspension de plein droit pour tout crime ou agression sexuelle sur un tiers, quel que soit l’âge de la victime ou son lien de parenté avec le parent.
L’amendement n° 8 rectifié bis vise à rendre cette suspension automatique chaque fois qu’un parent est poursuivi pour un crime, un viol, une agression sexuelle ou la diffusion et l’enregistrement d’images à caractère pornographique d’un mineur de 16 ans.
L’amendement n° 10 rectifié bis vise à permettre une suspension de plein droit pour tout crime, sans préciser qui est la victime, ou toute agression sexuelle commise sur un mineur.
L’amendement n° 11 rectifié bis est le même que le précédent, mais ses dispositions se limitent aux mineurs de 16 ans.
Enfin, l’amendement n° 12 rectifié bis vise à permettre une suspension en cas de crime ou d’agression sexuelle incestueuse, quel que soit le lien de parenté de la victime avec l’auteur.
L’idée sous-jacente serait qu’une personne commettant un crime, un viol ou une agression sexuelle sur quelqu’un – c’est l’objet de l’amendement n° 9 rectifié bis – ou, plus précisément, sur un mineur – c’est l’objet des autres amendements – ne pourrait être un bon parent. En conséquence, il faudrait suspendre l’exercice de son autorité parentale dès les poursuites.
Une telle extension n’a pas été envisagée par l’auteure de cette proposition de loi. Je n’ai donc pas conduit de travaux à ce titre. Elle n’a pas non plus été envisagée par le législateur, puisque l’article 378 du code civil ne prend en considération que les crimes et délits commis sur l’enfant ou les crimes commis sur l’autre parent.
Il me semble que ces dispositions élargiraient énormément le champ de la suspension automatique, au point d’encourir un grief d’atteinte à la proportionnalité. Plus on s’éloigne de l’enfant qui fait l’objet de l’autorité parentale, plus il faut se méfier des solutions automatiques. Gardons en tête que la situation de l’enfant doit être examinée in concreto, en fonction de son intérêt, par le JAF. Il ne s’agit pas de punir le parent délinquant ou d’appliquer un principe de précaution de manière maximaliste.
Enfin, j’observe que les amendements n° 8 rectifié bis et 11 rectifié bis ont pour objet les mineurs de 16 ans. Il s’agit certes de la limite d’âge figurant dans le code civil, que ce soit pour l’émancipation ou pour la nationalité ; mais le code pénal retient quant à lui l’âge de 15 ans pour la définition de certaines infractions. De telles dispositions créeraient donc un décalage.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ces cinq amendements.
Madame Rossignol, la suppression des mots « incestueuse commis sur la personne de son enfant » entraînerait de facto le déclenchement de la suspension en cas d’infractions de natures extrêmement variées commises par l’auteur en dehors de son cercle familial.
Un parent qui se lance dans le faux monnayage commet un crime : il perdrait ainsi son autorité parentale sur ses enfants…
De même, un notaire commettant un faux en écriture publique se verrait privé de l’exercice de l’autorité parentale. Je suis donc évidemment défavorable à l’amendement n° 9 rectifié bis.
Par l’amendement n° 8 rectifié bis, vous excluez en réalité du dispositif les mineurs de 16 à 18 ans, qui ne seraient plus protégés, même en cas de crime sexuel. J’y suis évidemment défavorable.
J’en viens aux amendements n° 10 rectifié bis et 11 rectifié bis. Des mineurs ayant commis une agression sexuelle sur un autre mineur, quel qu’il soit, ne seraient pas à l’abri de subir une suspension de leur autorité parentale sur des enfants nés longtemps après les faits. §J’y suis forcément défavorable.
Enfin, en vertu de l’amendement n° 12 rectifié bis, la suspension de l’exercice de l’autorité parentale aurait lieu en cas de crime, quelle que soit la victime, qu’elle appartienne ou non au cercle familial de l’auteur. Une nouvelle fois, vous excluez du dispositif le mineur de 16 à 18 ans, qui ne serait plus protégé, même en cas de crime.
En résumé, l’adoption de ces amendements mettrait en péril la cohérence même du dispositif. Leurs effets de bord seraient particulièrement étendus, au point que l’intérêt même de l’enfant pourrait ne plus être protégé.
Voilà pourquoi je suis défavorable à l’ensemble de ces amendements.

Je note que la commission et le Gouvernement sont défavorables à ces amendements. Je n’ai pas tout compris des raisons avancées par Mme la rapporteure, car elle a parlé très vite, mais j’ai tout de même pu noter un certain nombre d’éléments.
Elle fait valoir que la situation de l’enfant s’apprécie in concreto. Mais – je le répète – comment apprécie-t-on in concreto la situation d’un enfant dont le frère ou la sœur a été victime d’inceste de la part du père ?
C’est une question de bon sens. Comment justifiez-vous qu’un père, après s’être livré à des agressions sexuelles sur l’un de ses enfants, continue, sans aucune restriction, d’exercer son autorité parentale sur ses autres enfants ? In concreto, ces derniers me semblent être dans une situation préoccupante, pour ne pas dire dangereuse.

Monsieur le garde des sceaux, je m’adresse également à vous. J’ai bien compris que les rédactions proposées avaient toutes des défauts. Mais, si vous êtes sensible à mes propos – et je pense que n’importe qui peut l’être –, vous avez la possibilité de nous proposer une autre formulation.
J’admets volontiers ce que vous me dites au sujet de l’amendement n° 9 rectifié bis. Vos observations corroborent d’ailleurs mes inquiétudes.
Vous relevez également que la suspension de l’autorité parentale pourrait frapper une personne ayant commis un crime ou une agression sexuelle quand elle-même était mineure ; l’intéressé se verrait appliquer cette mesure quinze ans après les faits, une fois devenu parent.

Je suis perplexe…
Je vois que vos conseillers hochent la tête et j’en déduis que cette interprétation fait consensus au sein de votre équipe. Mais, dans ce cas, sous-amendons pour ajouter la mention « par un majeur ».
Après la présentation de ces cinq amendements, vous ne pouvez pas vous contenter de me répondre que l’on va laisser un père exercer son autorité parentale sur les frères et sœurs d’un enfant victime d’inceste.
Ce débat me rappelle l’affaire Marina : depuis la prison, le père de cette enfant continuait d’exercer son autorité parentale sur ses frères et sœurs, ce qui avait choqué beaucoup de personnes, moi la première. C’est précisément ce dont nous parlons aujourd’hui.
Dans six mois, dans un ou deux ans, peut-être nous retrouverons-nous pour examiner une autre proposition de loi, à la suite d’une nouvelle affaire. On nous dira alors : « Il y a un problème avec les frères et sœurs. Le père a conservé son droit de visite et d’hébergement tous les week-ends et, quand il est sorti de prison, il s’est livré à de nouvelles agressions sexuelles sur ses enfants. »

J’ai entendu la présentation de ces cinq amendements et j’ai compris que notre collègue Laurence Rossignol avait tout mis en œuvre pour tenter de trouver une rédaction opportune.
À mon sens, le principe de proportionnalité ne s’applique pas en la matière. Nous sommes là pour protéger les enfants et cela me dérange d’entendre parler d’une telle proportionnalité pour les agresseurs et les victimes d’agression. En revanche, j’entends évidemment les arguments relatifs aux effets de bord.
Les problèmes exposés par Laurence Rossignol méritent toute notre attention. Nous devons trouver, ensemble, une rédaction permettant d’éviter les situations qu’elle vient de décrire.
Monsieur le garde des sceaux, madame la rapporteure, je vous engage vivement à travailler en ce sens. On sait bien qu’en la matière les agressions isolées n’existent pas : il y a toujours des récidives. Nous devons créer les outils législatifs permettant d’éviter ces agressions et ces récidives.
Madame Rossignol, ma circonspection ne signifie pas qu’il ne faut pas travailler ensemble, sur la base de vos propositions.
Je vous l’ai dit précédemment en vous remerciant de vos remerciements. §Devant la délégation sénatoriale aux droits des femmes, nous avons évoqué la prise en charge des enfants témoins, qui doivent également être considérés comme victimes. Je vous ai promis d’agir en ce sens et j’ai tenu parole.
Dans les situations que vous évoquez, il faut procéder avec prudence afin de préserver les équilibres textuels, notamment constitutionnels et conventionnels. Il faut également veiller à la présomption d’innocence : ce principe est tout sauf anecdotique. Travaillons ensemble sur ces amendements, dont je comprends évidemment le sens.
Madame Billon, de fait, l’enjeu n’est pas la proportionnalité : pour ma part, je souligne qu’il ne faudrait pas ouvrir la porte à d’autres crimes.
Permettez-moi de reprendre, sans provocation aucune, l’exemple d’un notaire qui commet un faux en écriture publique. Il s’agit d’un crime qui mérite sanction, mais cela ne fait pas de lui un mauvais père. Chacun l’admettra : il faut bien distinguer sa paternité, la manière dont il exerce ses fonctions et les infractions qu’il a pu commettre à ce titre.
Nous allons travailler ensemble…
Nous allons étudier la question. Peut-être faudra-t-il remplacer un « ou » par un « et ». Nous allons trouver !

Monsieur le garde des sceaux, je suis pleine d’espoir depuis le début de l’examen de ce texte et, par votre attitude encourageante, vous confortez mon optimisme : vous avez envie, comme nous, d’avancer sur ces questions.
Madame la rapporteure, pourriez-vous nous préciser plus tranquillement les raisons de votre refus ? Vous avez parlé très vite, sans doute sous l’effet de l’émotion provoquée par les remarques de certains de nos collègues. J’entends les observations formulées par M. le garde des sceaux, même si je ne suis pas une spécialiste de légistique. Mais pourquoi refusez-vous ces dispositions ?
Il y va de l’intérêt supérieur de l’enfant, dont, à l’évidence, ce débat s’est très vite écarté. On parle à présent de la situation du père incarcéré ou du père empêché. Or – j’y insiste – il s’agit des droits de l’enfant et de son intérêt supérieur. C’est pourquoi je souhaite comprendre vos explications.

… et j’espère que nous allons trouver la bonne rédaction avant la deuxième lecture à l’Assemblée nationale.
Tout d’abord – nous sommes bien d’accord sur ce point –, un père ne saurait exercer son autorité parentale sur les frères et sœurs de l’enfant sur lequel il a commis un inceste.

Exactement : l’agression sexuelle peut avoir été commise par un oncle, sur son neveu ou sur sa nièce.
Ensuite, et plus largement, je porte à votre attention la question des hommes reconnus coupables d’agression sexuelle sur mineur : comment peuvent-ils exercer leur autorité parentale ?
Monsieur le garde des sceaux, vous avez lu, comme nous tous certainement, la récente enquête du Monde relative aux viols en streaming. Elle décrit la dérive de ces pères qui commencent par regarder, puis offrent leurs propres enfants. Ce n’est pas un petit sujet.
Ces précisions étant apportées, je vous fais confiance et je retire mes cinq amendements.

Les amendements n° 9 rectifié bis, 8 rectifié bis, 10 rectifié bis, 11 rectifié bis et 12 rectifié bis sont retirés.
L’amendement n° 29, présenté par Mmes Harribey, Meunier, Rossignol, Monier et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours
La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Il s’agit d’un amendement de repli.
Mme Harribey et les membres de notre groupe renouvellent un souhait déjà exprimé : que l’article 1er de la proposition de loi inscrive à l’article 378-2 du code civil la suspension de l’exercice de l’autorité parentale, des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou condamné pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours.
Une initiative législative visant à lutter contre les violences intrafamiliales et, qui plus est, à en protéger les enfants ne saurait faire l’économie de dispositions liant les violences conjugales à une suspension de l’exercice de l’autorité parentale.

Ma chère collègue, vous avez bien compris que l’autorité parentale ne pouvait être disjointe de la protection de l’enfant : l’une et l’autre vont de pair.
Contrairement au dispositif proposé par l’Assemblée nationale, cet amendement tend à préciser que la suspension provisoire de plein droit peut avoir lieu dès les poursuites ou la mise en examen en phase amont de la procédure pénale, pas seulement en cas de condamnation et quand l’enfant a assisté aux faits.
Nous sommes bien d’accord sur ce point : cela ne signifie pas que, lorsqu’il n’a pas assisté aux faits, l’enfant ne se rend pas compte de ce qui se passe. Françoise Dolto disait toujours : dans une famille, les premiers informés, ce sont le bébé et le chien ! Même s’il n’a pas assisté aux faits, l’enfant sait très bien que des choses graves sont en train de se passer.
Je rappelle que la commission a choisi de réserver la suspension provisoire de plein droit aux cas les plus graves – crimes et agressions sexuelles incestueuses sur l’enfant –, au nom du principe de proportionnalité.
Cet amendement a pour objet les ITT de plus de huit jours. Pour avoir signé beaucoup d’ITT, je vous assure qu’une telle durée n’est pas courante.
En outre, signe-t-on des ITT lorsque les violences conjugales sont de nature purement psychologique ? Non, …

… même s’il s’agit bien entendu de violences gravissimes.
Voilà pourquoi ce critère n’est pas pertinent. Les violences dont il s’agit ont des conséquences psychologiques extrêmement graves, dont les ITT ne font pas état.
Enfin – nous l’avons souligné en commission –, il ne serait pas cohérent de ne pas inclure les violences volontaires directement dirigées contre l’enfant.

Je voterai évidemment cet amendement.
Madame la rapporteure, je pensais comme vous que les ITT de plus de huit jours étaient exceptionnelles. Mais, pas plus tard qu’hier – c’est le hasard du calendrier –, lors d’une visite à la fédération Solidarité Femmes de Loire-Atlantique, j’ai appris que tel n’était plus le cas. Les ITT de plus de huit jours sont désormais prononcées de manière plus fréquente, précisément pour des violences psychiques.
Les médecins, eux aussi, font évoluer leurs pratiques : c’est ce que l’on constate sur le terrain et je souhaitais vous communiquer cette information.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 1 er est adopté.
L’article 378 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 378. – En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total de l’autorité parentale ou, à défaut, de l’exercice de cette autorité et des droits de visite et d’hébergement. La décision de ne pas ordonner le retrait total de l’autorité parentale est spécialement motivée.
« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.
« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité. » ;
2° Au début du second alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Le ».

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 13 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol, Meunier, Blatrix Contat et Le Houerou, MM. Michau, Pla et Todeschini, Mme Jasmin, M. P. Joly, Mmes Lubin, Poumirol, Conway-Mouret, Briquet, Féret et Monier et MM. J. Bigot, Tissot, Temal et M. Vallet, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article 378 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigé :
« Se voit retirer totalement l’autorité parentale ou, à défaut, l’exercice de l’autorité parentale, par une décision expresse du jugement pénal, le parent qui est condamné soit comme auteur, coauteur ou complice d’une agression sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne d’un enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée par la juridiction.
« Peut se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale, par une décision expresse du jugement pénal, le parent qui est condamné soit comme auteur, coauteur ou complice, hors le cas prévu au premier alinéa, d’un délit commis sur la personne d’un enfant, soit comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un délit sur la personne de l’autre parent. »
La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 2, tout en étendant ses dispositions à d’autres enfants que celui sur lequel l’agression sexuelle ou l’inceste a été commis.
Pour les raisons exposées précédemment et par cohérence, je retire aussi cet amendement, monsieur le président.

L’amendement n° 13 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 19, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l’article 378 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Se voit retirer totalement l’autorité parentale ou, à défaut, l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal, le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice d’une agression sexuelle incestueuse ou d’une atteinte sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne de son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.
« Peut se voir retirer totalement l’autorité parentale ou, à défaut, l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal le parent qui est condamné, soit comme auteur, coauteur ou complice, hors le cas prévu au précédent alinéa, d’un délit commis sur la personne de son enfant, soit comme coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un délit sur la personne de l’autre parent. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Cet amendement est presque identique au précédent.
J’insiste sur ce point : il est extrêmement important d’ajouter le délit d’atteinte sexuelle incestueuse à la liste des cas dans lesquels le parent condamné se voit retirer totalement l’autorité parentale.
Nous en sommes tous conscients, les répercussions de tels actes sur l’enfant victime sont désastreuses. On ne peut pas penser que leurs auteurs puissent continuer d’exercer leur autorité parentale sur la victime.
Nous devons garantir aux enfants un environnement familial sain, sans violence et, notamment, sans ces violences sexuelles incestueuses qui peuvent aller jusqu’à briser leur vie. La cicatrice qu’elles laissent est souvent indélébile. Nous devons donc protéger ces enfants de toute nouvelle violence sexuelle commise par un ascendant, afin que leur souffrance cesse. On ne doit pas laisser la moindre place à la récidive ou à l’aggravation des violences.
Un certain nombre d’éléments ont déjà été rappelés lors de l’examen de l’article 1er. J’y reviens, car il s’agit d’un sujet de la plus haute importance. Certes, nous dressons tous le même constat sur l’ensemble des travées, mais nous en tirons ensuite diverses interprétations.
Une seule violence sexuelle incestueuse – peu importe qu’elle soit qualifiée de crime ou de délit – doit entraîner le retrait total de l’autorité parentale.
Enfin, à rebours des modifications apportées par Mme la rapporteure, nous souhaitons non seulement une obligation, mais une véritable automaticité de ce retrait.
La répétition a, dit-on, une vertu pédagogique : peut-être va-t-elle porter ses fruits.

En l’état du texte de la commission, en cas de délit d’atteinte sexuelle incestueuse, la juridiction pénale doit se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale, mais le principe retenu n’est pas le retrait total. Ces dispositions semblent proportionnées par rapport à l’infraction considérée.
J’émets donc un avis défavorable.
Madame la sénatrice, je vous propose de retirer votre amendement au profit de l’amendement n° 46, dont l’examen suit. Sa rédaction me semble plus adéquate.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Parfois, le hasard fait bien les choses !
Sourires.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Monsieur le président, je sollicite une brève suspension de séance.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures quarante-cinq, est reprise à dix-huit heures cinquante.

La séance est reprise.
L’amendement n° 46, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, Théophile, Patriat, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
se prononce sur
par le mot :
ordonne
II. – Alinéas 4 et 5
Remplacer ces deux alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, ou comme coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par son enfant, ou comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale peut ordonner le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice. » ;
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Cet amendement vise à traduire le plus fidèlement possible les recommandations de la Ciivise.
Dans son rapport intermédiaire publié il y a un an, celle-ci préconise de « prévoir, dans la loi, le retrait systématique de l’autorité parentale en cas de condamnation d’un parent pour violences sexuelles incestueuses contre son enfant ».
Le groupe RDPI souscrit pleinement à cette proposition, qui participe d’une meilleure protection des enfants victimes de violences sexuelles. Or force est de constater que la rédaction adoptée par la commission des lois ne garantit pas le caractère systématique du retrait de l’autorité parentale, le juge devant seulement se prononcer sur le sujet.
Aussi, pour redonner sa pleine portée au dispositif, nous souhaitons que le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice soit systématiquement ordonné par le juge, sauf décision contraire spécialement motivée.
Par ailleurs, dans un souci de clarté et de lisibilité, nous suggérons de fusionner les alinéas 4 et 5 afin de permettre au juge de retirer l’autorité parentale ou son exercice en cas de condamnation d’un parent pour un délit commis sur son enfant autre que l’agression sexuelle incestueuse, ou commis sur l’autre parent, ou en qualité de coauteur ou de complice d’un crime ou délit commis par son enfant.

Les juridictions pénales pourront toujours prononcer une autre mesure que le retrait total de l’autorité parentale. Il s’agit d’une condition impérative de la constitutionnalité et de la conventionnalité de la mesure.
Ainsi, il a semblé plus juste à la commission de distinguer entre l’obligation de se prononcer et l’obligation de motiver spécialement une décision autre que celle d’un retrait total de l’autorité parentale.
L’amendement vise à proposer, en second lieu, une modification qui semble en retrait par rapport à ce qui a été voté en commission. En effet, il tend à indiquer que les juridictions, en cas de condamnation pour un délit commis sur la personne de son enfant autre qu’une agression sexuelle incestueuse, peuvent ordonner le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice.
Sur ce point, l’amendement est moins-disant que le texte de la commission, lequel impose aux juridictions, dans ce cas, de se prononcer sur l’autorité parentale, multipliant ainsi les chances de les voir retirer l’autorité parentale ou son exercice lorsque cela est dans l’intérêt de l’enfant.
L’avis est donc défavorable.
Cet amendement me paraît très équilibré, pour deux raisons.
D’une part, il renforce la protection des enfants en tendant à instaurer un mécanisme de retrait automatique de l’autorité parentale.
D’autre part, il tend à respecter nos exigences constitutionnelles et conventionnelles en limitant ce retrait automatique aux infractions les plus graves et en permettant aux juges de l’écarter.
Dans ces conditions, l’avis du Gouvernement est favorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 30 rectifié, présenté par Mmes Rossignol, Harribey, Meunier, Monier et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
ou, à défaut, de l’exercice de cette autorité et des droits de visite et d’hébergement
La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Dans la réécriture de l’article à laquelle elle a procédé, la commission a offert au juge la possibilité de prononcer une autre peine que le retrait total de l’autorité parentale, en ajoutant au texte la mention « ou, à défaut, de l’exercice de cette autorité et des droits de visite et d’hébergement ».
Cet ajout est surprenant, car il donne le sentiment que la commission éprouverait des difficultés à envisager le retrait de l’autorité parentale, comme si nous nous trouvions encore dans cette période, que nous pensions révolue, durant laquelle prévalait l’idée selon laquelle le lien biologique entre le père et l’enfant devait être maintenu en toutes circonstances. Pourtant, nous parlons bien ici d’agressions sexuelles incestueuses.
Votre rédaction propose que, dans de tels cas, le juge puisse ne pas prononcer le retrait de l’autorité parentale, mais se contenter de suspendre les droits de visite et d’hébergement – cette suspension étant généralement soumise à discussion devant lui.
Nous estimons qu’il est nécessaire de conserver l’esprit initial de la proposition de loi et d’affirmer clairement, sans hésiter ni barguigner, qu’un parent ayant commis une agression sexuelle incestueuse sur son enfant se voit retirer l’autorité parentale. Il ne faut pas laisser au juge la possibilité d’appliquer des peines plus clémentes, qui permettraient de maintenir l’autorité parentale.
Cet amendement répond également à une recommandation de la Ciivise.

Je me prononce exclusivement sur l’amendement lui-même, qui tend à supprimer la mention « ou, à défaut de l’exercice de cette autorité ». En supprimant cette mention, qui offre une alternative au retrait total de l’autorité parentale, l’amendement vise à envoyer un message plus clair aux juridictions pénales.
Ainsi, le principe serait bien un retrait total de l’autorité parentale, et toute mesure alternative devrait être mûrement réfléchie et spécialement motivée.
C’est ce que nous avons compris ; en conséquence, nous sommes favorables à cet amendement.
Signes de satisfaction sur les travées du groupe SER.
Il me semble que nous devons laisser une alternative pour répondre à toutes les situations qui sont soumises au juge. Le retrait automatique de la titularité de l’autorité parentale ou, à défaut, de son exercice nous semble problématique. Nous ne voyons pas pour quelle raison nous devrions craindre l’intervention du juge.
Dans ces conditions, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 7 rectifié quater, présenté par MM. Bonneau, Le Nay, Pellevat et Laugier, Mme Herzog, MM. Henno, Kern, Belin et Somon, Mme Jacquemet, MM. Détraigne, D. Laurent, Canévet et Burgoa, Mme Drexler, MM. Houpert et Hingray, Mme Férat, M. Wattebled, Mme Thomas et M. Chasseing, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
portant sur l’enfant victime et le cas échéant, ses frères et sœurs
La parole est à M. François Bonneau.

Cet amendement vise à étendre la portée du retrait de l’autorité parentale, ainsi que des droits de visite et d’hébergement, à l’ensemble de la fratrie.
Cette mesure avait déjà fait l’objet d’un amendement que j’avais proposé dans le cadre de l’examen de la loi relative à la protection des enfants, en 2021.
Il relève, me semble-t-il, de notre devoir non seulement de veiller à la protection de l’enfant directement concerné, mais également de garantir la sécurité et le bien-être de l’ensemble de la fratrie, en la préservant de tout danger potentiel.

Cet amendement est satisfait par l’article 379-1 du code civil ; je vous propose donc de le retirer.
L ’ article 2 est adopté.
L’article 377 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale :
« 1° En cas de désintérêt manifeste des parents ;
« 2° Si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ;
« 3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci ;
« 4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu’il est le seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ce dernier cas » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 3° et 4° ». –
Adopté.

L’amendement n° 52, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 380 du code civil, les mots : « ou du droit de garde » sont supprimés.
La parole est à Mme le rapporteur.

Cet amendement vise à mettre à jour l’article 380 du code civil en supprimant la référence au droit de garde, lequel n’existe plus depuis 1987.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2 bis.
L’article 381 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le mot : « total », sont insérés les mots : « ou partiel » et les mots : « ou d’un retrait de droits » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le jugement a prononcé un retrait de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement pour l’une des causes prévues aux articles 378 et 378-1, aucune demande au titre de l’article 373-2-13 ne peut être formée moins de six mois après que ce jugement est devenu irrévocable. »

L’amendement n° 47, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, Théophile, Patriat, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
aux articles 378 et 378-1
par les mots :
à l’article 378
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

Cet amendement est de nature rédactionnelle.
L’article 2 ter modifie l’article 381 du code civil afin d’encadrer les conditions de la demande aux fins de rétablissement de l’exercice de l’autorité parentale, ainsi que des droits de visite et d’hébergement et de la titularité de l’autorité parentale.
Il fait référence aux articles 378 et 378-1 du code civil ; or ce dernier article concerne le retrait de l’autorité parentale et non le retrait de son exercice, ainsi que des droits de visite et d’hébergement.
Nous proposons donc de supprimer la référence à cet article du code civil.

L’article 379-1 du code civil permet à la juridiction saisie en vertu de l’article 378 ou de l’article 378-1 de prononcer un retrait de l’exercice de l’autorité parentale plutôt qu’un retrait de l’autorité parentale. Il semble donc nécessaire de conserver les deux visas.
L’avis est défavorable.
Cet amendement rédactionnel tend à ne viser que l’article 378 du code civil dans le cadre de la procédure de demande de restitution d’exercice de l’autorité parentale.
Il s’agit ici d’encadrer les conditions de cette demande ; or l’article 378-1 du code civil, dont vous souhaitez supprimer la référence, est relatif au retrait de la titularité de l’autorité parentale.
Pour aller plus loin, la référence à l’article 378-1 doit être supprimée, car cet article ne porte que sur le retrait de la titularité de l’autorité parentale dans le cadre civil, alors même que l’objet de l’article 2 ter en discussion est d’instaurer un délai avant lequel il n’est pas possible de saisir le JAF pour demander la restitution de l’exercice de l’autorité parentale, retiré dans un cadre pénal, sur le fondement de l’article 378 du code civil.
Je suis donc favorable à cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 6 rectifié quater, présenté par MM. Bonneau, Le Nay et Pellevat, Mme Herzog, MM. Laugier, Henno, Kern, Belin et Somon, Mme Jacquemet, M. P. Martin, Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Détraigne, D. Laurent et Burgoa, Mme Drexler, MM. Hingray, Houpert et Wattebled, Mme Férat, MM. Cadec, Panunzi et Canévet, Mme Thomas et M. Chasseing, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer le mot :
six
par le mot :
douze
La parole est à M. François Bonneau.

Cet amendement a pour objet de porter de six mois à un an le délai pendant lequel un parent condamné ne peut saisir le juge aux affaires familiales d’une demande visant à retrouver l’exercice de l’autorité parentale dont il a été privé.
Le code civil dispose que ce délai, d’une durée maximale de six mois, court jusqu’à la décision du juge. Charge alors au procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales dans un délai de huit jours.
Cette temporalité est très courte, car le parent peut rapidement faire appel de cette suspension. En outre, elle ne permet pas la mise en œuvre d’un suivi psychologique du parent violent en l’espace de six mois.
Cette proposition vise le bien-être et la stabilité de l’enfant, qu’un allongement de ce délai permettra de mieux protéger.

La commission souhaite tenir compte du répit de l’enfant.
Ainsi, un délai d’un an était prévu pour le retrait de l’autorité parentale ; nous proposons six mois pour le retrait de son exercice, car nous entendons respecter la gradation entre ces deux peines. Il s’agit, à notre sens, d’une avancée.
Nous demandons donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Je suis défavorable à cet amendement, car il est dans l’intérêt de l’enfant que le juge aux affaires familiales statue rapidement en la matière.
L ’ article 2 ter est adopté.

Je suis saisi de cinq amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 32 rectifié, présenté par Mmes Rossignol, Harribey, Meunier, Monier et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 373-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas au parent victime de violences conjugales. »
La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Le dernier alinéa de l’article 373-2 du code civil fait obligation à un parent d’informer l’autre parent de tout changement de résidence, car un tel changement peut affecter les modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment en ce qui concerne les écoles. L’idée est d’éviter qu’un parent puisse dissimuler à la fois son domicile et l’école des enfants.
Toutefois, nous proposons que cette obligation ne s’applique pas lorsqu’un parent est victime de violences conjugales.
On pourrait objecter que, en ces circonstances, un retrait de l’autorité parentale serait possible, mais cela n’étant pas garanti, il convient de sécuriser la situation en précisant que le parent victime n’est pas tenu d’informer l’autre de son changement de résidence.

L’amendement n° 33 rectifié, présenté par Mmes Rossignol, Harribey, Meunier, Monier et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 373-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une ordonnance de protection prévue par l’article 515-9 du présent code si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent. »
La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Cet amendement, toujours inspiré des recommandations de la Fédération nationale solidarités femmes (FNSF), vise à exempter le parent bénéficiaire d’une ordonnance de protection de l’obligation de communiquer à l’autre parent tout changement de résidence lorsque celui-ci modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Cet amendement est plus restreint que le précédent, car il se situe spécifiquement dans le cadre de l’ordonnance de protection. Pour autant, je le dépose encore et encore, à chaque discussion d’un texte concernant ces sujets, car cette mesure est nécessaire.

Le sous-amendement n° 54, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
ordonnance de protection prévue par l’article 515-9
par les mots :
autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6 bis de l’article 515-11
La parole est à Mme le rapporteur.

La commission est défavorable à l’amendement n° 32 rectifié, et lui préfère l’amendement n° 33 rectifié, qu’elle entend sous-amender de manière à remplacer les mots « ordonnance de protection prévue par l’article 515-9 » par les mots « autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6 bis de l’article 515-11 ».
Il s’agit donc d’un sous-amendement de précision.

L’amendement n° 50 rectifié ter, présenté par Mmes Rossignol, Meunier, Blatrix Contat et Le Houerou, MM. Michau, Pla et Todeschini, Mme Jasmin, M. P. Joly, Mmes Lubin, Poumirol, Conway-Mouret, Briquet, Féret et Monier et MM. J. Bigot, Tissot, Temal et M. Vallet, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 373-2-1 du code civil est complété par les mots : «, parmi lesquels figure notamment la commission de violences, quelle qu’en soit la nature, sur l’autre parent ou sur le ou les enfants ».
La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Le présent amendement, toujours inspiré des recommandations de la FNSF, vise à faire figurer explicitement la commission de violences sur l’autre parent parmi les motifs graves susceptibles d’emporter le refus de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.

L’amendement n° 24 rectifié, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un parent a exercé ou exerce des violences sur l’autre parent, la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de ce dernier. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Considérant qu’un conjoint violent ne peut être un bon père, les auteurs de cet amendement proposent que la résidence alternée ne soit pas possible en cas de violences conjugales.

Je me suis exprimée sur les amendements n° 32 rectifié et 33 rectifié.
S’agissant de l’amendement n° 50 rectifié ter, il existe déjà dans le code civil, à l’article 373-2-11, une disposition d’ordre général selon laquelle, dans toutes ses décisions, le juge aux affaires familiales prend en considération les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Quant aux violences sur l’enfant, c’est une évidence : le rôle même du JAF est de prendre en compte l’intérêt de l’enfant, dont sa sécurité et sa santé.
L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° 50 rectifié ter.
La rédaction proposée à l’amendement n° 24 rectifié nous semble un peu trop rigide, car, dans certains cas, l’intérêt de l’enfant sera d’avoir une résidence habituelle chez un tiers.
Par ailleurs, les violences conjugales sont évidemment un élément à considérer par le JAF au moment de prendre sa décision. L’article 373-2-11 du code civil prévoit expressément que celui-ci, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, tient compte des pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’avis est donc défavorable.
L’avis est favorable sur l’amendement n° 33 rectifié de Mme Rossignol, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 54 de Mme la rapporteure, et défavorable sur tous les autres.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Le sous-amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2 ter.
Je mets aux voix l’amendement n° 50 rectifié ter.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Du retrait total ou partiel de l’autorité parentale et du retrait de l’exercice de l’autorité parentale
« Art. 228 -1. – En cas de condamnation d’un parent pour un crime ou un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant ou pour un crime prévu au présent titre commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, dans les conditions prévues aux articles 378, 379 et 379-1 du code civil. Cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
« La juridiction de jugement peut aussi décider du retrait de l’autorité parentale ou de l’exercice de cette autorité à l’égard des autres enfants mineurs du parent condamné.
« Si la juridiction de jugement ne dispose pas des informations nécessaires pour statuer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, elle peut renvoyer l’affaire à une date ultérieure sur cette question et procéder à toute mesure d’instruction utile.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés. » ;
b) Les articles 221-5-5, 222-31- 2, 222-48- 2 et 227-27- 3 sont abrogés ;
c) Le dernier alinéa de l’article 225-4-13 est supprimé ;
2° À l’article 711-1, la référence : « n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » est remplacée par la référence : « n° … du … visant à mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales ».

L’amendement n° 20, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 1
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 221-5-5 est ainsi rédigé :
« Art. 221 -5 -5 – I. – En cas de condamnation pour un délit prévu à la présente section, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil.
« II. – En cas de condamnation pour un crime commis par un parent sur la personne de son enfant ou sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379-1, sauf décision spécialement motivée.
« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité sur les frères et sœurs mineurs de la victime.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question.
« La décision prévue au premier alinéa du présent II est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. » ;
II. - Alinéa 10
Supprimer la référence :
La parole est à Mme Laurence Cohen.

Nous souhaitons permettre à la juridiction de jugement d’ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, ainsi que des droits de visite et d’hébergement, en cas de condamnation pour un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne, commis par un parent sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent.
Le lien enfant-parent ne doit pas être maintenu à tout prix et il est préférable que l’enfant soit préservé de tout contact avec celui qui s’en est pris à sa vie ou à celle de son autre parent. Préserver un tel lien serait contre-productif et toxique.
On ne peut pas penser qu’un enfant puisse se reconstruire lorsqu’il est contraint de revoir son bourreau ou le bourreau de l’un de ses parents ; ne restent que des angoisses, des cauchemars et surtout des syndromes post-traumatiques.

Cet amendement tend à rétablir la structure actuelle du code pénal, qui ne contient que des dispositions spécifiques et aucune disposition générale, contrairement au code civil.
La commission a fait le choix de supprimer les dispositions spécifiques et de créer un nouvel article 228-1, qui s’appliquerait à tous les crimes et délits commis sur la personne de l’enfant ou de l’autre parent. Cette disposition offre une meilleure intelligibilité et favorise la cohérence entre code civil et code pénal.
Hormis cette différence de structure, l’amendement n° 20 est satisfait par l’article 3 tel que rédigé par la commission.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

L’amendement n° 20 est retiré.
L’amendement n° 21, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. - Après l’alinéa 1
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 222-48-2 est ainsi rédigé :
« Art. 222 -48 - 2 – I. – En cas de condamnation pour un délit prévu aux sections 1, 3 ou 3 bis du présent chapitre II, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil.
« II. – Lorsque l’infraction mentionnée au I du présent article est un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur la personne de son enfant ou un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378, 379 et 379-1, sauf décision spécialement motivée.
« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité sur les frères et sœurs mineurs de la victime.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question.
« La décision prévue au présent article est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. » ;
II. - Alinéa 10
Supprimer la référence :
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Nous souhaitons que la juridiction de jugement puisse ordonner systématiquement le retrait de l’autorité parentale en cas de condamnation pour un viol incestueux, une agression sexuelle incestueuse ou une atteinte sexuelle incestueuse commis contre un mineur par une personne titulaire de l’autorité parentale sur celui-ci.
Comment concevoir qu’une marge d’appréciation demeure au cas par cas dans de telles situations incestueuses ? Pour le bien de l’enfant, pour son avenir et sa reconstruction, il est fondamental que le retrait de l’autorité parentale soit automatique dans ces circonstances.
Aucune raison ne saurait justifier le maintien de l’autorité parentale, aucun mot ne saurait effacer le traumatisme.
Pour ne pas périr, et afin de se reconstruire, l’enfant doit se trouver dans un environnement neutre, sain, loin de son bourreau.
Notre devoir est de garantir une protection sans faille aux enfants victimes des crimes et délits incestueux.
Pour ce faire, mes chers collègues, votons la systématisation du retrait de l’autorité parentale dans de tels cas de figure.

Comme l’amendement n° 20, le présent amendement est satisfait par la disposition générale que nous avons introduite.
J’en demande donc le retrait. À défaut, l’avis sera défavorable.
Je partage l’analyse de Mme la rapporteure.
Sur cet amendement, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Puisque cet amendement est satisfait, je le retire, monsieur le président.

L’amendement n° 21 est retiré.
L’amendement n° 18 rectifié bis, présenté par Mmes Rossignol, Meunier, Blatrix Contat et Le Houerou, MM. Michau, Pla et Todeschini, Mme Jasmin, M. P. Joly, Mmes Lubin, Poumirol, Conway-Mouret, Briquet, Féret et Monier et MM. J. Bigot, Tissot, Temal et M. Vallet, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
de son enfant
par les mots :
d’un mineur de seize ans
La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Il s’agit, encore une fois, de remplacer les mots « de son enfant » par les mots « d’un mineur de seize ans ». Le dossier étant entre les mains du garde des sceaux, je retire cet amendement.

L’amendement n° 18 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 48, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert et Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
dans les conditions
insérer les mots :
et selon les distinctions
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 31, présenté par Mmes Harribey, Meunier, Rossignol, Monier et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
peut aussi décider du
par les mots :
se prononce sur le
La parole est à Mme Laurence Harribey.

Nous proposons d’introduire, à l’alinéa 7, une formulation par laquelle la juridiction de jugement aurait, non pas seulement la faculté, mais l’obligation de se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice à l’égard des autres enfants mineurs du parent condamné. Cet amendement vise donc à protéger la fratrie.

Il me semble préférable de laisser aux juridictions pénales la faculté de se prononcer au sujet des frères et sœurs de la victime plutôt que de leur en faire l’obligation.
En effet, les juridictions ne disposent pas toujours des éléments nécessaires pour se prononcer sur la situation familiale de la victime elle-même – c’est la raison pour laquelle nous avons ouvert la possibilité d’un renvoi. Elles ne pourront donc a fortiori pas toujours se prononcer sur la situation des frères et sœurs.
Je rappelle par ailleurs que lorsque les frères et sœurs sont eux-mêmes victimes, ne serait-ce que parce qu’ils ont assisté aux violences, l’obligation de statuer existe déjà.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 41, présenté par Mmes Harribey, Meunier, Rossignol, Monier et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, la juridiction de jugement doit entendre l’enfant capable de discernement afin de recueillir sa parole et les sentiments qu’il exprime, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement ou, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, désigner une personne à cet effet.
La parole est à Mme Michelle Meunier.

Cet article prévoit un retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou de son exercice, notamment lorsque le parent s’en est pris à son enfant dans les conditions qui ont été indiquées précédemment.
Il doit en être ainsi, en particulier lorsque des actes incestueux ont été commis. Par la transgression de l’interdit fondamental de nos sociétés, de tels actes justifient un retrait définitif et automatique des attributs de l’autorité parentale. Retirer l’autorité parentale à celui qui s’affranchit des interdits sexuels organisateurs des rapports intergénérationnels revient tout simplement à entériner ce qu’il a lui-même mis en œuvre.
Si la protection des enfants exige que des décisions soient prises, y compris lorsque celles-ci peuvent aller à l’encontre de ce que les enfants eux-mêmes revendiquent, ceux-ci doivent toujours être considérés. Pour que la décision judiciaire ait toute sa légitimité, leur parole doit être entendue.
C’est cette préoccupation que nous entendons prendre en compte par cet amendement.

Votre amendement, ma chère collègue, vise à instaurer une obligation d’entendre l’enfant.
Or la possibilité d’entendre un mineur concerné par une mesure de retrait de l’autorité parentale existe déjà pour les mineurs capables de discernement, et elle est de droit lorsque ceux-ci le demandent.
Il ne semble pas opportun de rendre systématiques de telles auditions qui supposent que l’enfant s’exprime en public, et devant le parent auteur des violences.
L’avis est donc défavorable.

Je ne fais que reprendre l’une des recommandations formulées par la Défenseure des droits en 2020, qui précise que l’enfant a le droit d’être entendu et représenté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 53, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Après le mot :
peut
insérer les mots :
, après avoir prononcé la peine,
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 3 est adopté.

L’amendement n° 43, présenté par Mmes Harribey, Meunier, Rossignol, Monier et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 388-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les procédures concernant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, ou la suspension de l’exercice de cette autorité et les droits de visite et d’hébergement, dans les conditions prévues aux articles 378 et 378-2 du présent code, le mineur capable de discernement est assisté par un avocat. »
La parole est à Mme Laurence Harribey.

Dans le même ordre d’idée que les amendements précédents, l’objet de cet amendement procède de l’idée selon laquelle l’enfant qui est concerné par une procédure portant sur l’autorité qui s’exerce sur lui doit être considéré comme une personne à part entière et, à ce titre, être systématiquement représenté par un avocat lui étant entièrement dédié.
En effet, si l’intérêt de l’enfant est une considération primordiale qui doit guider la décision du juge, il convient de ne pas oublier que cet enfant a également des droits, dont l’avocat doit être le garant.
Ces droits, notamment les droits procéduraux, sont des droits universels, dont le rôle de l’avocat est précisément d’assurer le respect.

Cet amendement vise à transformer le droit d’être assisté par un avocat en obligation. Or le coût de cette assistance n’est pas évoqué, faute de quoi l’amendement aurait été susceptible d’être frappé d’irrecevabilité au titre de l’article 40 de la Constitution, ce qui rend cette disposition en pratique non opérante.
J’ajoute que cet amendement est a priori satisfait dès lors que l’enfant est lui-même victime et se porte partie civile.
Aux explications de Mme la rapporteure, auxquelles je souscris pleinement, j’ajoute que la suspension de l’autorité parentale opère de plein droit, sans audience ni décision de justice. L’assistance du mineur par un avocat est donc selon moi sans objet.
Par ailleurs, lorsqu’un retrait de l’autorité parentale est prononcé par le juge pénal, ce sont les règles de la procédure non pas civile, mais pénale qui s’appliquent.
Dans ces conditions, je suis défavorable à cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 36, présenté par Mmes Rossignol, Harribey, Meunier, Monier et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de décisions de retrait total ou partiel de l’exercice de l’autorité parentale, en application de la présente loi.
La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Mme Laurence Rossignol. Il s’agit en quelque sorte de ma lettre, non pas au père Noël, mais au garde des sceaux.
Sourires.

Je souhaiterais vivement disposer de statistiques de la Chancellerie qui nous permettraient de mieux comprendre les violences faites aux femmes et leur traitement judiciaire, les violences faites aux enfants, les violences intrafamiliales, ou encore l’impact – nous l’avons évoqué avec ma collègue Annick Billon et le garde des sceaux – de la consommation de films pornographiques sur la commission de violences sexuelles.
De telles statistiques nous seraient très utiles pour mieux comprendre le comportement des individus dans notre société ainsi que les sanctions prononcées et l’accompagnement proposé par la justice.
En l’espèce, le présent amendement vise à demander à la Chancellerie de remettre un rapport faisant état du nombre de mesures de protection de l’enfance, de retraits de l’autorité parentale et de décisions motivées de ne pas retirer celle-ci prises dans l’année suivant la promulgation de la présente loi.
Il s’agit au fond de vous demander des statistiques, monsieur le garde des sceaux.

Mme Marie Mercier, rapporteur. Conformément à sa jurisprudence habituelle, et bien qu’il s’agisse d’une lettre au père Noël
Sourires.

Nous estimons préférable qu’en application de l’article 24 de la Constitution, le Parlement exerce son pouvoir de contrôle.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. J’ai les qualités et les vertus du père Noël, mais vous me concéderez, madame la sénatrice, que ce n’est pas tout à fait la saison.
Sourires.
Nous manquons de statistiques. De fait, mon ministère n’a pas la culture de l’indicateur ou de la statistique, mais je souhaite – c’est l’un des grands chantiers que je lance – que nous disposions désormais de données chiffrées relatives aux réformes que nous menons, non pas pour les garder par-devers moi, mais bien pour les communiquer.
Je ne suis pas très enthousiaste à l’idée de rendre un rapport – le Gouvernement ne le souhaite généralement pas. En revanche, mais vous le savez mieux que moi, madame la sénatrice, vous avez la possibilité de contrôler l’action du Gouvernement.
En tout état de cause, ma porte est ouverte. Nous allons travailler ensemble, et comme je l’ai indiqué tout à l’heure, je vous communiquerai à la fois toutes les statistiques dont je dispose déjà, mais également les données que nous allons recueillir dans les mois qui suivront la mise en place des nouveaux outils.
Si, en l’état, je suis donc défavorable à votre amendement, madame la sénatrice, cela ne signifie nullement que je ne souhaite pas partager les éléments chiffrés que j’ai en ma possession. Encore une fois, je tiens au contraire ces derniers à votre disposition.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Au 17° de l’article 138 du code de procédure pénale, après la référence : « 17° bis, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « la décision de ne pas ordonner la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur, dont la personne mise en examen est titulaire, est spécialement motivée ; ». –
Adopté.

L’amendement n° 5 rectifié sexies, présenté par MM. Bonneau, Pellevat, Le Nay et Belin, Mme Herzog, MM. Laugier, Kern et Somon, Mme Jacquemet, M. P. Martin, Mmes Saint-Pé et Billon, MM. Détraigne, D. Laurent, Canévet et Burgoa, Mme Drexler, MM. Houpert, Cadec, Panunzi et Hingray, Mme Thomas et M. Chasseing, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’infraction constitue une atteinte sexuelle incestueuse contre son enfant, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention prononce la suspension du droit de visite et d’hébergement des enfants mineurs dont la personne mise en examen est titulaire ; la décision de ne pas ordonner le retrait total de l’autorité parentale est spécialement motivée. »
La parole est à M. François Bonneau.

Cet amendement vise à compléter les dispositions du code de procédure pénale afin de systématiser la suspension, par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, des droits de visite et d’hébergement du parent mis en examen pour une infraction incestueuse.
Il s’agit non pas de remettre en cause la présomption d’innocence, mais de prendre une mesure de précaution à l’égard de l’enfant victime ainsi que de sa fratrie. Le principe de précaution repose sur la prise en compte de situations de risques potentiellement graves et irréversibles.
En l’espèce, tel est le cas d’un enfant ayant subi des agressions sexuelles.

Mon cher collègue, le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale visant toute infraction commise « contre ses enfants », cet amendement est satisfait par l’article 3 bis du présent texte.
J’en demande donc le retrait. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Puisque l’amendement est satisfait, je le retire, monsieur le président.

L’amendement n° 5 rectifié sexies est retiré.
L’amendement n° 40, présenté par Mmes Harribey, Meunier, Rossignol, Monier et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 388-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les procédures concernant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, ou la suspension de l’exercice de cette autorité et les droits de visite et d’hébergement, dans les conditions prévues aux articles 378 et 378-2 du présent code, le mineur capable de discernement doit, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. »
La parole est à Mme Laurence Harribey.

Par cet amendement, nous souhaitons garantir le respect de l’enfant par l’écoute de sa parole. Nous pensons que chaque enfant doit être entendu dans sa singularité, et qu’aucune généralisation ne doit gommer celle-ci.
Cet amendement vise donc à s’assurer que l’enfant soit entendu par le juge ou par la personne désignée à cet effet, et ainsi à faire en sorte qu’il soit au centre de la décision qui est prise dans son intérêt.
Il est précisé que la parole de l’enfant doit être recueillie sans aucun préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement.

Encore une fois, il ne nous semble pas opportun de rendre obligatoire l’audition de l’enfant par le juge.
L’avis est donc défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
(Supprimé)

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Michelle Meunier, pour explication de vote.

Comme mes collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain l’ont indiqué lors de la discussion générale, nous aurions souhaité retrouver l’esprit de la proposition de loi présentée par notre collègue Isabelle Santiago à l’Assemblée nationale.
Nous sommes en effet très attachés à l’égalité entre les femmes et les hommes, et particulièrement révoltés contre toute manifestation de violence à l’égard des femmes.
La persistance d’un système qui minimise les violences, néglige leurs conséquences et hésite à sanctionner les auteurs constitue une entrave à la liberté des femmes victimes et à l’instauration de cette égalité.
Nous souhaitons corriger les failles de notre justice familiale et pénale, cette justice qui laisse parfois entendre qu’un mauvais mari pourrait être un bon père. Cette justice qui néglige les conséquences des conflits perpétue le continuum des violences.
Que vaut aux yeux de l’enfant la loi qui ne l’a pas protégé de la violence d’un parent ?
La psychologue clinicienne Karen Sadlier explique que l’enfant sculpte sa personnalité, par mimétisme, sur le modèle de l’auteur des violences. Elle précise qu’il ne saurait y avoir de lien parental en l’absence de protection.
C’est cette exigence de protection dans l’intérêt des victimes, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, que nous devons renforcer.
Notre souhait de revenir à l’esprit initial de ce texte n’a pas été satisfait, à l’exception de certains aspects. Considérant toutefois les légères avancées qu’elle permet, nous voterons toutefois cette proposition de loi.

Je souhaite d’abord, avec le groupe Union Centriste, saluer la qualité du travail de la commission des lois et de la rapporteure.
Je me félicite également des débats que nous avons eus ce soir. De nombreux amendements ont en effet pu être débattus, et M. le garde de sceaux nous a apporté des réponses claires et constructives.
Avant que nous ne nous prononcions sur ce texte, j’estime important de rappeler les faits. Si nous manquons de statistiques – ma collègue Laurence Rossignol l’évoquait tout à l’heure –, celles dont nous disposons montrent que la situation est dramatique.
Dans un rapport intitulé Droits des enfants en France – Aperçu des avancées et des défis 2022, l’Unicef indique qu’un enfant est tué par l’un de ses parents tous les cinq jours en moyenne. Dans 86 % des cas, les parents sont les auteurs présumés des maltraitances subies par les enfants.
Dans le même temps, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, présidée par le juge Édouard Durand, estime dans son rapport que 160 000 enfants subissent des violences sexuelles chaque année en France, un nombre longtemps sous-estimé, voire négligé, en particulier en raison du tabou anthropologique dont ce crime fait l’objet.
Plus largement, une personne sur dix est victime d’inceste dans son enfance, soit plus de 5 millions de femmes et d’hommes.
Pour toutes ces raisons, le groupe Union Centriste votera cette proposition de loi visant à mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales.
Comme je l’indiquais dans mon propos liminaire, ce texte n’est pas une fin en soi ; il marque le début d’un changement profond de l’approche de notre société sur les violences intrafamiliales, prenant en compte que le parent violent n’est jamais un bon parent.
Les débats et les propositions d’amendements issues de toutes les travées de notre assemblée attestent notre volonté collective d’améliorer le texte. La navette – je n’en doute pas – apportera des avancées nouvelles, puisque ce soir, en séance publique, vous avez proposé d’y travailler, monsieur le garde des sceaux.
La mission sur le traitement judiciaire des violences intrafamiliales menée par notre collègue Dominique Vérien apportera également – j’en suis persuadée – des solutions pour mieux traiter ces violences intrafamiliales et accompagner les enfants qui en sont victimes.

Si nos débats ont été très intéressants, je regrette moi aussi que la commission se soit montrée quelque peu sévère vis-à-vis du texte de l’Assemblée nationale et qu’un certain nombre de recommandations, notamment celles de la Ciivise, n’aient pas été suivies.
C’est d’autant plus regrettable que – j’en suis persuadée – nous partageons le même but, à savoir la meilleure protection possible de l’enfant. Or j’estime à cette fin que l’avis du magistrat Édouard Durand, qui fait un travail remarquable, mérite d’être pris en considération.
Je regrette également qu’un certain nombre d’amendements n’aient pas été adoptés, mais je note la bienveillance du garde des sceaux, et sa volonté de retravailler ensemble sur ces propositions dont certaines étaient peut-être formulées de manière maladroite.
Il m’importe enfin de travailler sur le délit de non-représentation d’enfant par la mère quand celle-ci est certaine que son enfant est victime de violences ou d’attouchements. La rapporteure et le garde des sceaux en étant d’accord, nous pourrons avancer ensemble sur ce sujet, de même que sur celui du syndrome d’aliénation, trop souvent utilisé contre les mères. En la matière, j’estime que nous pourrons continuer à travailler de manière positive.
Pour toutes ces raisons, et comme je l’ai indiqué lors de mon propos liminaire, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera cette proposition de loi.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je voterai bien sûr ce texte, en tant que parlementaire, mais aussi en tant que mère soucieuse de la protection de nos enfants.
Je souhaite toutefois vous interpeller, monsieur le garde des sceaux, sur la nécessité de soutenir l’organisation de la justice dans les territoires ultramarins, pollués par ce mal. Outre l’éloignement, nos territoires sont en effet confrontés, dès lors que des enfants sont victimes, à la barrière des langues. Imaginez un enfant polynésien de 6 ans qui doit s’exprimer devant un juge !
Je vous lance donc un appel du cœur, monsieur le garde des sceaux : envoyez des renforts, et améliorez l’organisation de la justice dans nos territoires ultramarins !

Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi visant à mieux protéger les enfants victimes de violences intrafamiliales.
La proposition de loi est adoptée.

M. le président. Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et RDPI.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à dix-neuf heures quarante.

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier et amplification des encarts publicitaires destinés à informer le public sur la transition écologique (proposition n° 305, texte de la commission n° 426, rapport n° 425).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d’État.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le sujet des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) nous réunit aujourd’hui.
Nous avons collectivement construit notre socle de filière REP – Sénat, Assemblée nationale et Gouvernement –, en particulier lors de la discussion de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi Agec. C’est une fierté française.
Madame la rapporteure, vous étiez déjà rapporteure de la loi Agec. Je sais votre attachement à ces principes, et comme vous, je considère que la loi Agec est une loi fondamentale.
Celle-ci, ainsi que la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et résilience, a démontré notre ambition environnementale et notre volonté d’accélérer notre transition écologique.
Elles permettent le déploiement de nombreux dispositifs.
Elles apportent également aux collectivités des moyens et des outils nouveaux dans leur gestion quotidienne des déchets.
Depuis ma prise de fonctions, je travaille pour que les collectivités disposent des moyens financiers suffisants pour rendre le traitement des déchets plus performant. C’est à ce titre que, pour 2023, le fonds vert alloue une enveloppe de 60 millions d’euros à la collecte et à la valorisation des biodéchets. En parallèle, 90 millions d’euros ont été ajoutés au fonds économie circulaire.
Je me suis enfin engagée à revoir les barèmes de soutien au regard de la crise énergétique que nous vivons et que les collectivités subissent de plein fouet.
Notre politique de développement de l’économie circulaire fait figure d’exemple sur la scène européenne et internationale. Je souhaite que le texte que nous examinons aujourd’hui s’inscrive dans cette dynamique.
Cette proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale posait un principe clair : donner les moyens à la filière papier-carton de gagner en performance environnementale via la fusion des REP papier et emballages.
Il avait aussi pour objectif de pérenniser, pour le secteur de la presse, la possibilité de contributions en nature, en prévoyant l’accès direct et majoritaire des collectivités à ce dispositif tout en restant exigeant sur l’ambition environnementale fixée par l’État dans ce cadre.
Les filières REP sont les clés de voûte de notre système de financement et de gestion des déchets. Elles sont aussi à la base de notre système de prévention, de réparation, de réemploi et de propreté.
Vous le savez, la loi Agec a créé onze nouvelles filières REP. En 2025, celles-ci permettront de dégager environ 6 milliards d’euros d’écocontributions.
En responsabilité, je suis chargée de la mise en place effective de ces nouvelles filières. Au regard des dispositions que nous examinons aujourd’hui, il m’importe d’insister sur mon entière mobilisation en faveur de l’amélioration constante des performances de chaque filière REP et de l’entrée en vigueur effective des nouvelles REP.
Soyez assurés, mesdames, messieurs les sénateurs, que je maintiendrai le cap sur ces objectifs pour les collectivités que vous représentez et pour les citoyens qui nous écoutent.
La fusion proposée des filières papier et emballages est au cœur de cet engagement. Vous l’avez conservée lors des travaux de commission, et je m’en félicite.
Cette fusion est cohérente avec la logique de collecte simplifiée des déchets d’emballages et de papier que nous avons instaurée. Si cette proposition de loi est adoptée, nous aurons une filière REP pour un bac jaune.
Au-delà de la cohérence et de la simplification recherchées, cette fusion permet également d’avoir une vision commune entre ces deux filières concernant l’écoconception, et partant, de gagner en performance environnementale.
Par ailleurs, la filière papier connaît un changement d’équilibre économique. En seulement deux ans, l’activité de production de papier a diminué de 12 %, et cette trajectoire perdurera.
Dans ce contexte, la fusion devra dans tous les cas avoir lieu tôt ou tard. En la votant dès à présent, nous prenons nos responsabilités quant à la pérennité de la filière. Cette fusion permettra de mieux partager les coûts structurels de gestion du bac jaune et du recyclage, et ainsi, d’améliorer l’assise et la visibilité financière de la filière.
J’en viens à la deuxième disposition, qui – je le comprends – concentre l’essentiel des débats.
Je note que le Sénat et l’Assemblée nationale se retrouvent sur un même constat : la presse est dans une situation économique telle qu’il nous faut collectivement trouver des solutions. Pour autant, et j’y tiens particulièrement, il n’est pas question d’exonérer un secteur de sa responsabilité environnementale et de minimiser le manque à gagner pour les collectivités. Dans le cadre de ce texte, nous nous sommes donc tous interrogés sur la meilleure manière d’adapter le dispositif de responsabilité de la presse sans freiner l’ambition environnementale du secteur.
La proposition de loi initiale du député Denis Masséglia prévoyait ainsi que le dispositif de responsabilité qui préexistait depuis 2015 soit reconduit et renforcé. Grâce à un débat parlementaire de qualité, elle a été ajustée dans la bonne direction. Ce débat a permis que des amendements déposés par des élus issus de tous les groupes politiques soient adoptés. Ensemble, vos collègues ont amélioré le texte à l’Assemblée nationale.
En effet, ils ont tout d’abord garanti aux collectivités territoriales d’être associées à l’élaboration de la convention de partenariat ainsi qu’au contenu des encarts, alors que le texte prévoyait que les collectivités en bénéficieraient majoritairement.
A également été ajouté le fait de quantifier chaque année les économies dégagées par cette mise à disposition gratuite d’encarts pour les collectivités.
Ensuite, la lecture à l’Assemblée nationale a permis d’enrichir le texte de critères environnementaux demandés au secteur de la presse. Il a ainsi été prévu que les encarts concernent, en plus du geste de tri et de l’économie circulaire, la préservation de la ressource en eau et la protection de la biodiversité.
Par ailleurs, le texte a précisé que les exigences environnementales qui s’appliquent au secteur de la presse ne pourront pas être en dessous de celles que le secteur doit respecter jusqu’au 1er janvier 2023.
Votre commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, la semaine dernière, a fait le choix de ne pas retenir cette disposition. J’en prends acte.
J’émets néanmoins des réserves sur la solidité juridique du dispositif prévu dans le texte que nous allons examiner en séance publique, ainsi que sur son bien-fondé écologique.
Je tiens tout d’abord à attirer votre attention sur deux points juridiques.
En premier lieu, le bonus d’écocontribution proposé ne correspond pas à un critère d’écoconception comme prévu par le droit européen sur les filières REP.
En second lieu, les bonus imaginés pour la mise à disposition gratuite d’encarts d’information devront bien être compensés par l’augmentation des écocontributions d’autres personnes. L’idée du dispositif proposé par la commission du Sénat serait de faire supporter cette compensation par le seul secteur de l’emballage. Cette piste soulève toutefois une interrogation sur l’équité de ce dispositif. Il me semble donc juridiquement fragile.
D’un point de vue écologique ensuite, le dispositif adopté en commission revient à ouvrir à tous les acteurs de l’emballage et des papiers la possibilité de bénéficier d’un bonus financier s’ils mettent à disposition gratuitement des encarts. Mais pour ajouter des encarts d’information équivalents à ceux que peut proposer la presse, il faudrait ajouter du suremballage. En d’autres termes, le dispositif adopté en commission incite les producteurs à ajouter encore plus d’emballages.
Madame la rapporteure, vous conviendrez que ce n’est pas l’esprit de la loi Agec, à laquelle nous sommes tous attachés. C’est même à l’opposé du combat que nous menons et que vous menez aussi, et à l’opposé de ce que nous demandent les citoyens et les responsables politiques.
Je sais que vous recherchez, comme moi, des solutions. Pour avoir exercé le mandat de députée, j’ai un grand respect pour le débat parlementaire. Je fais confiance aux parlementaires pour trouver, dans ce cadre, un consensus et une sortie par le haut.
Quoi qu’ils décident, je tiens à affirmer très clairement que ces encarts ne doivent pas être utilisés à des fins promotionnelles, mais exclusivement pour sensibiliser le citoyen, dans une optique d’intérêt général. Il me semble primordial que le dispositif qui sera voté à l’issue de la navette parlementaire intègre cette exigence.
Pour conclure sur ce point, le Gouvernement maintiendra son ambition dans le déploiement de toutes les filières REP de la loi Agec et il n’y aura aucune remise en cause de ces filières.
Certaines sont en cours de mise en œuvre, dès cette année, comme la filière REP bâtiment, celle des véhicules hors d’usage, celle des pneumatiques ou encore celle des emballages de la restauration.
D’autres viendront plus tard comme la filière des textiles sanitaires à usage unique en 2024 ou encore la filière REP des déchets d’emballages industriels et commerciaux en 2025. La mise en œuvre de ces filières REP est une attente forte des collectivités. Sachez qu’elle est entendue et qu’elle guide mon action au quotidien.
Applaudissements au banc des commissions. – MM. Michel Laugier et Yves Bouloux applaudissent également.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, pour celles et ceux qui étaient présents dans cet hémicycle à l’automne 2019 pour débattre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, l’échange que nous aurons ce jour aura, à l’évidence, un goût de déjà-vu.
En effet, il y a quatre ans environ, nous avions dans cet hémicycle largement complété la copie proposée par le Gouvernement, afin notamment de renforcer la responsabilité élargie des producteurs, une application du principe pollueur-payeur qui permet de transférer le coût de la prévention et la gestion des déchets aux producteurs.
Pour les filières couvertes par le service public de gestion des déchets géré par les collectivités territoriales, la responsabilité élargie des producteurs se traduit par un soutien financier des producteurs aux collectivités territoriales via des contributions financières transitant par un éco-organisme.
Il y a quatre ans, le deal de la loi Agec était très clair. Oui, les collectivités territoriales doivent améliorer la prévention et la gestion des déchets, en modernisant leurs centres de tri, en mettant en place la collecte séparée des biodéchets ou encore en développant la collecte hors foyer ; mais ces politiques ont un coût. La loi Agec prévoyait donc de renforcer la responsabilité élargie des producteurs pour que l’amélioration de notre politique d’économie circulaire pèse non pas exclusivement sur le contribuable local, en aval, mais aussi sur le producteur, en amont.
Nous avons donc créé de nouvelles REP, par exemple sur les produits et matériaux de construction ou sur les articles de bricolage, de jardinage et de sport. Nous avons aussi étendu des REP existantes : une REP emballages professionnels a par exemple été créée pour compléter la REP emballages ménagers.
Le sens de l’Histoire était donc celui de la montée en puissance des filières REP, concomitante de celle du service public de gestion des déchets.
Les choses se sont depuis quelque peu déréglées, car la mise en place ou l’extension des REP a pris du retard et même de manière importante dans le cas de la REP bâtiment, pourtant très attendue dans nos territoires pour lutter contre les dépôts sauvages.
Les contraintes sur les collectivités territoriales n’ont, quant à elles, pas été reportées. Pendant que les REP tardaient à se mettre en place, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) a continué d’augmenter et les investissements en matière de tri des biodéchets ou de modernisation des centres de tri n’ont pas été retardés.
C’est dans ce contexte qu’est arrivée la proposition de loi dont nous débattons ce soir. N’ayons pas peur des mots : ce texte est la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour nos collectivités territoriales.
Le volet le plus problématique n’est pas celui qui est relatif à la fusion des filières REP emballages ménagers et papier, à laquelle notre commission est favorable et qui ne constitue pas le cœur du texte dont nous sommes saisis ; il porte sur la sortie de la presse de la REP.
Disons-le clairement : exclure la presse de la REP, comme le prévoyait la proposition de loi initiale, revient à faire payer, une fois de plus, les collectivités territoriales. Je rappelle que tout ce qui n’est pas pris en charge par les metteurs sur le marché doit être financé par les contribuables locaux.
J’entends déjà ceux qui estiment que le manque à gagner pour le service public de gestion des déchets est limité – une vingtaine de millions d’euros – et pourrait être facilement absorbé par les collectivités.
Je répondrai que sortir la presse de la REP pourrait constituer un dangereux précédent susceptible d’affaiblir l’ensemble des REP et, partant, le financement du service public de gestion des déchets. Ce serait en effet la première fois dans l’histoire de ce système, né en France dans les années 1990 et ayant essaimé partout en Europe, qu’un gisement serait retiré de la REP. D’autres secteurs pourraient à l’exemple de ce premier régime d’exception demander des aménagements et des exonérations pour l’avenir, au détriment des collectivités territoriales et de la protection de l’environnement.
Nous ne pouvons pas accepter une telle régression environnementale et une telle atteinte au service public de gestion des déchets géré par nos collectivités territoriales.
Cela étant dit, nous nous devons d’apporter une réponse au secteur de la presse, qui est actuellement en grande difficulté. Je le dis ici avec fermeté, comme j’ai déjà eu l’occasion de le faire avec mes collègues sénateurs de la commission de la culture, en premier lieu desquels le président Lafon et Michel Laugier, avec qui j’ai beaucoup échangé lors de mes travaux préparatoires.
Je salue à cet égard le travail de Michel Laugier, dont le récent rapport a mis en exergue les difficultés conjoncturelles et structurelles auxquelles fait face la presse, notamment notre presse quotidienne régionale : doublement du prix du papier en un an, augmentation des coûts de l’énergie et diminution structurelle des ventes de la presse papier de 5 % par an. Nous nous devons d’aider la presse, cela est certain.
Fallait-il, pour autant, le faire aux dépens des collectivités territoriales, au risque de fragiliser le bel édifice que constitue la loi Agec, matrice de notre politique d’économie circulaire ? Bien évidemment, la réponse est non.
Le Gouvernement avait d’autres options pour concilier protection du service public de gestion des déchets et préservation du secteur de la presse. Il n’a tout simplement pas voulu les étudier.
La première option était que l’État prenne sa responsabilité en aidant le secteur de la presse à payer son écocontribution à compter du 1er janvier 2023. Il ne l’a pas fait.
La seconde option, c’est celle que la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a adoptée la semaine passée.
Le texte issu des travaux de notre commission maintient en effet la presse dans le champ de la REP, mais en permettant de moduler les contributions financières de la filière REP pour les produits contribuant à une information du public d’intérêt général sur la prévention et la gestion des déchets, notamment par la mise à disposition gratuite d’encarts, sous réserve de respecter des critères de performance environnementale fixés par décret. Cette modulation des contributions sous forme de prime pourra pleinement bénéficier aux publications de presse.
Les avantages de cette proposition sont nombreux. Elle préserve l’intégrité de la REP en maintenant la presse en son sein. Elle est financièrement neutre pour le service public de gestion des déchets, car les primes versées devront être compensées par la filière REP. Elle offre enfin des garanties environnementales, en conditionnant l’octroi des primes à l’atteinte de critères de performance environnementale. Elle répond enfin clairement aux préoccupations du secteur de la presse, qui pourra continuer à utiliser le système existant des encarts.
Cette option avait d’ailleurs été envisagée par les services ministériels au cours des travaux préparatoires à la loi Agec que j’avais menés il y a quatre ans.
Cette proposition me semble plus robuste juridiquement que la convention de partenariat hors REP qui était proposée dans le texte initial. Contrairement à la proposition faite par les députés, nous nous appuyons en effet sur un outil bien connu, appliqué dans l’ensemble des filières REP : la modulation des écocontributions. Le législateur peut tout à fait créer des critères d’écomodulation qui ne sont pas spécifiquement prévus par le droit européen et qui n’ont pas trait à l’écoconception du produit : c’est par exemple le choix que nous avions fait dans la loi Agec, en créant un critère d’écomodulation pour les produits ayant une visée publicitaire ou promotionnelle.
Je suis consciente que ce choix est moins confortable pour le Gouvernement que ce qui est proposé dans le texte initial, car il devra en assumer les conséquences et mettre en œuvre les modulations proposées au sein de la filière REP. Il eût sans doute été plus confortable pour lui de laisser le législateur assumer seul la responsabilité de faire payer les collectivités territoriales.
Vous l’aurez compris, ma priorité est d’abord de préserver les filières REP pour protéger le service public de gestion des déchets et nos collectivités territoriales. Elle est ensuite d’aider la presse, en lui apportant une réponse proportionnée pour faire face aux difficultés auxquelles elle fait face. Tel est le chemin de crête que notre commission a emprunté la semaine passée. Mes chers collègues, je vous propose maintenant de l’emprunter à votre tour.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de Mme Valérie Létard.