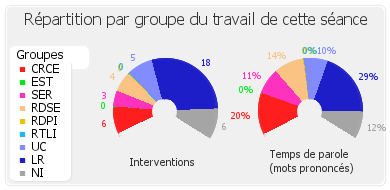Séance en hémicycle du 11 juillet 2012 à 14h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Dépôt de rapports
- Communication d'un avis sur un projet de nomination
- Modifications de l'ordre du jour
- Rappel au règlement (voir le dossier)
- Harcèlement sexuel (voir le dossier)
- Discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission (voir le dossier)
- Communication du conseil constitutionnel
- Demande d'avis sur un projet de nomination
- Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi
- Harcèlement sexuel
La séance
La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

M. le président du Sénat a reçu de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, le rapport de certification des comptes du régime général de sécurité sociale pour l’exercice 2011, établi en application de l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières.
Il a également reçu de Mme Claire Favre, présidente du conseil d’administration du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, le rapport d’activité du FIVA pour 2011, établi en application de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.
Ils ont été transmis respectivement à la commission des finances et à la commission des affaires sociales et sont disponibles au bureau de la distribution.
Acte est donné du dépôt de ces rapports.

En application de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, et en application de l’article R. 518-2 du code monétaire et financier et de l’article 1er du décret n° 59-587 du 29 avril 1959, la commission des finances, lors de sa réunion du mardi 10 juillet 2012, a émis un vote favorable – 20 voix pour, 3 voix contre et 5 votes blancs – en faveur de la nomination de M. Jean-Pierre Jouyet en qualité de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Acte est donné de cette communication.

Par lettre en date de ce jour, M. Alain Vidalies, ministre chargé des relations avec le Parlement, a demandé l’inscription, à la suite de l’ordre du jour du jeudi 12 juillet, de la suite de l’examen du projet de loi relatif au harcèlement sexuel.
Acte est donné de cette communication.
L’ordre du jour du jeudi 12 juillet s’établit donc comme suit :
Jeudi 12 juillet 2012
À 9 heures 30 :
1°) Débat sur la politique commune de la pêche
À 15 heures :
2°) Questions d’actualité au Gouvernement
3°) Éventuellement, suite de l’ordre du jour du matin
4°) Éventuellement, suite du projet de loi relatif au harcèlement sexuel.
Au cours de sa réunion du mardi 10 juillet, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a proposé que cinq conventions internationales supplémentaires inscrites à l’ordre du jour du mercredi 18 juillet fassent l’objet d’une procédure d’examen simplifié.
Conformément à l’article 47 decies du règlement, un président de groupe peut demander le retour à la procédure normale pour l’examen d’un projet de loi, avant le lundi 16 juillet, à 17 heures.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
L’ordre du jour du mercredi 18 juillet s’établit donc comme suit :
Mercredi 18 juillet 2012
À 14 heures 30 :
1°) Projet de loi autorisant la ratification du traité d’amitié et de coopération entre la République française et la République islamique d’Afghanistan
2°) Sept conventions internationales en forme simplifiée
3°) Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de coopération en matière de sécurité intérieure entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État des Émirats arabes unis.

Madame la présidente, mon rappel au règlement se fonde sur les articles 29 et 29 bis relatifs à l’organisation de nos travaux.
Mes chers collègues, vous vous souvenez certainement que, la semaine dernière, Catherine Troendle, au nom du groupe UMP, a protesté au sein même de cet hémicycle, après l’avoir fait lors de la réunion de la conférence des présidents du 28 juin, contre l’ordre du jour arrêté pour la session extraordinaire. Celui-ci ne prévoit en effet qu’une seule séance de questions d’actualité au Gouvernement pour le mois de juillet, alors que, traditionnellement et, d’ailleurs, juridiquement, …

… deux séances ont lieu chaque mois.
Nous venons d’apprendre que la conférence des présidents de l’Assemblée nationale, à la réunion de laquelle le Premier ministre a participé hier, a décidé, à la demande de l’opposition, qu’une nouvelle séance de questions d’actualité y serait organisée. Cela porte à cinq le nombre total de séances de questions d’actualité prévues à l’Assemblée nationale, contre une pour le Sénat.
Le groupe UMP souhaite que le Sénat bénéficie du même traitement que l’Assemblée nationale, …

… d’autant que le président du Sénat l’a lui-même envisagé et proposé lors de la conférence des présidents du 28 juin, évoquant la date du jeudi 26 juillet, qui nous convient très bien. Je ne doute d’ailleurs pas qu’il en soit de même pour l’ensemble de nos collègues.
Il est tout à fait anormal et discriminatoire que la Haute Assemblée ne dispose que d’une seule séance de questions d’actualité au Gouvernement, contre cinq à l’Assemblée nationale.
Madame la présidente, nous souhaitons que vous puissiez relayer cette information et user de votre pouvoir d’influence…

Mme Muguette Dini. Madame la présidente, le groupe UCR s’associe totalement à cette demande, comme il l’a fait la semaine dernière.
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UCR et de l'UMP.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, l’ordre du jour d’aujourd’hui est très important.
Madame Jouanno, l’ordre du jour de la session extraordinaire a été établi par la conférence des présidents, acté par l’ensemble des groupes. La semaine dernière, par l’intermédiaire de Mme Troendle, le groupe UMP a déjà fait un rappel au règlement identique.
Ces querelles ne sont pas à la hauteur des enjeux actuels. §

En règle générale, les séances de questions d’actualité au Gouvernement sont beaucoup plus nombreuses à l’Assemblée nationale…

Nous vous ferons des propositions à la rentrée. Pour l’instant, il n’est pas prévu que la conférence des présidents se réunisse de nouveau.
Une séance de questions d’actualité au Gouvernement aura lieu demain. Il aurait pu sans problème y en avoir une autre. Dès la prochaine session ordinaire, nous continuerons à organiser des séances de questions d’actualité au Gouvernement tous les quinze jours, le jeudi après-midi.
Je tiens à rappeler en toute tranquillité, ainsi que nous l’avons fait la semaine dernière, que la conférence des présidents a validé ce programme, à l’unanimité de tous les présidents de groupe : aucune abstention ou voix contre n’a été dénombrée.

L’organisation de nos travaux aurait pu être différente, ce n’est pas la question.

Pourquoi l’opposition est-elle respectée à l’Assemblée nationale et pas au Sénat ?

La majorité et le président du Sénat n’ont nullement la volonté de restreindre le nombre de séances de questions d’actualité au Gouvernement.
L’ordre du jour a été ainsi décidé pour nous permettre de discuter tous les textes que nous avons à examiner au cours de cette session extraordinaire.

Au nom de la majorité sénatoriale, je veux vous dire qu’il ne s’agit nullement pour nous d’un enjeu polémique ou d’un sujet de débat. Le principe d’une séance de questions d’actualité au Gouvernement a été décidé pour le mois de juillet, mais, dès la rentrée, nous retrouverons notre rythme normal.
Je rappelle, pour terminer, que, à l’Assemblée nationale, les séances de questions d’actualité au Gouvernement ont lieu depuis des années le mardi et le mercredi, alors qu’elles ne sont organisées qu’un jeudi sur deux au Sénat. Sans doute pouvons-nous le déplorer et envisager d’améliorer cet état de fait. §

Madame Jouanno, acte vous est donné de ce rappel au règlement.
Madame la garde des sceaux, madame la ministre, je ne doute pas que vous informerez M. le Premier ministre et M. le ministre chargé des relations avec le Parlement de cette demande.

L’ordre du jour appelle la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif au harcèlement sexuel (projet n° 592, texte de la commission n° 620, rapport n° 619, avis n° 613).
Compte tenu du changement de l’ordre du jour, les débats de notre séance d’aujourd’hui ne sauraient se poursuivre au-delà de zéro heure trente.
Madame la garde des sceaux, ministre de la justice, madame la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, mes chers collègues, à la suite de l’invalidation par le Conseil constitutionnel de la disposition de notre code pénal réprimant le harcèlement sexuel, le Sénat a mené un travail approfondi sur ce sujet pendant la suspension des travaux.
Sept propositions de loi ont été déposées et un groupe de travail associant la commission des lois, la commission des affaires sociales et la délégation aux droits des femmes a établi un rapport, après avoir procédé à de très nombreuses auditions.
Je remercie le Gouvernement d’avoir pris en compte ces initiatives sénatoriales en déposant le projet de loi relatif au harcèlement sexuel sur le bureau de notre assemblée.
Le texte établi par la commission des lois constitue une synthèse des différents travaux menés.

Je tiens à en féliciter M. Alain Anziani, rapporteur du projet de loi, ainsi que l’ensemble de nos collègues qui se sont impliqués sur ce sujet.
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la garde des sceaux. §
Madame la présidente, je vois dans le fait que nos travaux soient placés sous votre présidence un signal particulier, auquel je suis très sensible.
Monsieur le président de la commission des lois, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, monsieur le rapporteur, madame le rapporteur pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, cela n’aura échappé à personne : le projet de loi que j’ai l’honneur de présenter devant vous est à la fois urgent et important.
Ce texte est urgent, car il convient de mettre un terme, le plus rapidement possible, à la situation résultant d’une décision du Conseil constitutionnel, lequel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, a, le 4 mai dernier, abrogé le délit de harcèlement sexuel.
Cette abrogation, entrée immédiatement en vigueur, a créé, de fait, un vide juridique qui nous oblige. Placés devant l’impératif d’agir avec célérité, nous avons veillé à obéir à trois principes.
Il s’agissait, premièrement, de mettre fin à une telle impunité conjoncturelle, qui laisse sans réponse pénale appropriée les faits de harcèlement sexuel, en sachant que la nouvelle loi ne saurait être rétroactive puisqu’elle est plus sévère que les dispositions abrogées. Vous le savez, en droit pénal, seules les lois plus douces peuvent être rétroactives.
Il s’agissait, deuxièmement, de porter une attention particulière aux victimes, dans la mesure où, depuis le 4 mai dernier, les faits nouveaux de harcèlement sexuel ne peuvent être poursuivis par la voie pénale. Il ne reste donc à celles-ci que la voie civile, dont nous savons qu’elle est assez peu satisfaisante.
Il s’agissait, troisièmement, de veiller à la solidité juridique du texte que nous avons souhaité vous présenter en vue de définir l’infraction, compte tenu des motifs exposés par le Conseil constitutionnel pour justifier cette abrogation.
Comme vous le souligniez, madame la présidente, le Sénat a parfaitement saisi l’urgence et la nécessité de pallier un vide juridique. Dans les semaines qui ont suivi la décision du Conseil constitutionnel, sept propositions de loi d’origine sénatoriale ont été déposées ; la commission des lois, la commission des affaires sociales ainsi que la délégation aux droits des femmes ont constitué un groupe de travail, qui s’est aussitôt attelé à trouver les solutions les plus adaptées.
Je tiens à saluer cette contribution essentielle du Sénat. La qualité des propositions de loi présentées, des auditions conduites et l’état des lieux qui a pu dès lors être dressé nous ont permis de poser, en un court délai, les bases de notre réflexion.
Au cours de sa séance du 27 juin dernier, la commission des lois a adopté à l’unanimité le projet de loi, en intégrant des modifications appréciables sur l’initiative de M. Alain Anziani, rapporteur de la commission des lois, de Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, et de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation aux droits des femmes. C’est donc sur ce texte enrichi que porteront nos débats.
Le Président de la République s’étant engagé, durant la campagne, à traiter ce sujet en priorité, le Gouvernement s’en est saisi promptement. Il tient à la fois du symbole et de la volonté politique qu’il s’agisse du premier projet de loi de la nouvelle législature examiné devant la Haute Assemblée.
Je l’ai dit : ce texte est important, car il y est question de la dignité de la personne. Si les victimes ne sont pas toutes des femmes, celles-ci en composent les gros bataillons et il n’en demeure pas moins que le harcèlement sexuel est avant tout un « harcèlement de genre », comme l’a souligné le sociologue Michel Bozon, ce qui renvoie à la fois à la différenciation et aux représentations sociales.
Le sujet est universel. Un beau film récent de Mohamed Diab, Les Femmes du bus 678, nous rappelle que le délit de harcèlement sexuel n’est reconnu en Égypte que depuis trois ans. Dans ce film, trois femmes exposées à des formes diverses de harcèlement et d’agression sexuelle répondent, réagissent différemment selon leur appartenance sociale, leur éducation, leur tempérament : de ces combats disparates et dispersés émerge une même volonté de modifier à la fois la loi et les mentalités, donc la société.
En 2000, une enquête nationale fixait à 1, 9 le pourcentage de femmes se déclarant victimes de harcèlement dans les douze derniers mois. Dans le cadre de l’étude la plus récente sur le sujet, diligentée en 2007 par le conseil général de la Seine-Saint-Denis, plus de 1 500 femmes ont été interrogées : 22 % d’entre elles ont dit avoir été victimes d’un harcèlement ou d’une agression sexuelle durant les douze derniers mois. Ces faits concernent toutes les catégories sociales, les femmes exposées ayant des profils divers : étudiantes, employées, cadres, professions libérales.
C’est pour cela que la délégation sénatoriale aux droits des femmes parle, à juste titre, de « plaie sociale ».
Mesdames, messieurs les sénateurs, le texte que nous présentons n’est ni misérabiliste ni victimaire, et ce en dépit de l’empathie que nous éprouvons pour les victimes.
Nous connaissons les effets dévastateurs du harcèlement. Nous savons à quel point il peut détruire la personnalité, l’estime de soi, réduire la capacité à se projeter dans des projets personnels ou professionnels. Mais nous connaissons aussi la combativité des femmes qui refusent de se laisser écraser. Selon nous, mieux vaut les bien armer que les mal servir.
Je ferai un rapide historique de l’infraction.
Le délit de harcèlement sexuel est entré dans notre droit pénal le 1er mars 1994, lors de l’adoption du nouveau code pénal. Il résultait d’une disposition introduite en 1991 à l’Assemblée nationale, par le biais d’un amendement déposé par Mme Yvette Roudy et M. Gérard Gouzes.
La rédaction initiale de l’article 222-33 du code pénal réprimait « le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ».
La loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, défendue par Mme Élisabeth Guigou, alors garde des sceaux, modifia la définition en y ajoutant les « pressions graves » : le gouvernement et le législateur de l’époque visaient à réprimer des comportements, qui, bien que n’étant pas des ordres, des contraintes ou des menaces, constituaient des atteintes insupportables aux personnes.
La nouvelle rédaction de l’article 222-33 du code pénal réprimait ainsi par un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende le fait de « harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ».
À côté du harcèlement proprement dit, le code du travail interdisait et punissait les discriminations commises contre les salariés ayant subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel.
Ces discriminations étaient punies d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. À la suite d’une erreur malencontreuse intervenue lors de la recodification du code du travail opérée en 2007 et entrée en vigueur le 1er janvier 2008, ces peines ont été supprimées.
Le 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel, saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas suffisamment définis et que l’article 222-33 du code pénal méconnaissait le principe de légalité des délits et des peines. Il a, en conséquence, déclaré cet article contraire à la Constitution et précisé que cette censure était applicable immédiatement à toutes les affaires non encore définitivement jugées.
Le 10 mai, la Chancellerie a adressé aux parquets une circulaire invitant à procéder aux requalifications de l’incrimination de harcèlement sexuel, désormais inexistante, en violences volontaires, éventuellement avec préméditation, en harcèlement moral ou en tentative d’agression sexuelle.
Le 7 juin, j’ai pour ma part adressé une dépêche aux parquets, leur demandant de me faire retour, pour le 30 juin, des réquisitions et décisions qu’ils avaient été amenés à prendre sur les procédures en cours.
Évidemment, cette demande portait sur des informations impersonnelles. Les parquets ont fait remonter les données techniques et juridiques qui permettent de saisir ce que sont devenues les affaires non définitivement jugées au moment de l’abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel.
Mesdames, messieurs les sénateurs, avant de vous indiquer les données sur ces procédures, je souhaite parcourir rapidement l’évolution des statistiques sur les vingt dernières années.
Les données les plus fiables dont dispose le ministère de la justice sont extraites du casier judiciaire et concernent les condamnations.
De 1994 à 2003, le nombre de condamnations pour harcèlement sexuel s’est établi entre 30 et 40 par an.
En 1992, des voix se sont élevées pour prédire que la création du délit de harcèlement sexuel conduirait à une excessive « judiciarisation » des rapports sociaux dans l’entreprise, où – argument pour le moins étonnant – peuvent exister des jeux de séduction.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 19 janvier 2005, qu’« une attitude de séduction même dénuée de tact ou de délicatesse ne saurait constituer le délit de harcèlement sexuel, pas davantage que de simples signaux conventionnels lancés de façon à exprimer la manifestation d’une inclinaison ». Il n’y a donc pas eu de phénomène de judiciarisation excessive, comme vous avez pu le constater.
En 2004, le nombre de condamnations est monté à 63, pour s’établir entre 70 et 85 par an entre 2005 et 2010. Il est probable que cette augmentation, commencée en 2004, aboutissant à un doublement, tout relatif, en 2005, est liée à l’extension de la définition du délit intervenue en 2002.
La durée moyenne de l’instruction, de l’audiencement, du dépôt de la plainte jusqu’au jugement de première instance, est d’environ vingt-sept mois.
Environ la moitié de ces condamnations ne porte que sur l’infraction de harcèlement sexuel. Pour celles-ci, la peine d’emprisonnement a été prononcée dans 78 % des décisions entre 2005 et 2010, mais elle a été assortie d’un sursis total dans la très grande majorité des cas. Des peines d’emprisonnement totalement ou partiellement fermes n’ont été prononcées que dans 0 à 4 cas par an pour le seul délit de harcèlement sexuel.
L’autre peine la plus fréquemment prononcée à titre principal est l’amende, dans 17 % des condamnations. Elle est très majoritairement ferme et d’un montant moyen de 1 000 euros.
Par ailleurs, il convient de relever qu’en moyenne un quart des condamnations sont prononcées par les cours d’appel. Le taux d’appel est donc relativement élevé.
Il est raisonnable de penser que la réalité sociologique du harcèlement sexuel, tel qu’il est ressenti par victimes et tel qu’en attestent les études et enquêtes, insuffisantes d’ailleurs par leur nombre, dépasse sensiblement la traduction juridique qui lui est donnée au travers de ces quelques données.
Personne ne peut en effet sérieusement penser que seules quelques dizaines de femmes sont harcelées sexuellement en France aujourd’hui.
Le ministère de la justice dispose également de données sur le traitement des procédures en matière de harcèlement sexuel, issues des nouveaux dispositifs informatiques, notamment Cassiopée. Ce dernier étant en cours de généralisation, il ne peut s’agir que d’évaluations partielles.
Depuis 2003, le nombre d’affaires nouvelles, enregistrées au sein des juridictions sous la qualification de harcèlement sexuel, oscille autour d’un millier par an.
Plus de la moitié de ces procédures – environ 60 % – font l’objet d’un classement, car l’infraction ne peut être poursuivie, soit que le délit n’est pas constitué, soit qu’il existe un obstacle juridique aux poursuites, comme la prescription.
Pour les autres procédures, les parquets privilégient plutôt la poursuite – dans plus de 60 % des cas –, en recourant un peu plus à l’information judiciaire pour ce type de contentieux que pour les autres, avec un taux de 11 % contre 3, 9 % constaté en 2009.
Entre 20 % à 30 % des plaintes sont classées « pour inopportunité », la majeure partie de ces classements se fondant sur un désistement du plaignant.
Environ 30 % des affaires font l’objet d’une alternative aux poursuites, le plus souvent d’un rappel à la loi.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’en reviens maintenant aux remontées d’informations que j’ai sollicitées des parquets sur le devenir des procédures concernées depuis le 4 mai 2012, par le biais de la dépêche de requalification en date du 10 mai et de la circulaire du 7 juin demandant l’état des réquisitions et des décisions.
D’une façon générale, les parquets ont procédé à une requalification chaque fois que cela était possible.
Cent trente procédures menées du chef de harcèlement sexuel ont été signalées à la Direction des affaires criminelles et des grâces, la DACG. Sur quatre-vingts enquêtes préliminaires en cours, six ont pour le moment fait l’objet d’un classement du fait de l’abrogation de la loi. Sur dix-neuf informations judiciaires en cours, deux extinctions de l’action publique ont été prononcées et huit requalifications sont déjà engagées. Sur seize affaires en cours d’audiencement, treize pourront être requalifiées. Sur les quinze affaires parvenues à l’audience depuis la décision du Conseil constitutionnel, quatre se sont soldées par une extinction de l’action publique, mais, pour les autres, les requalifications ont pu être établies.
Dans la circulaire d’application du texte qui sera adopté par le Parlement et que j’adresserai aux procureurs de la République dès que la nouvelle loi aura été adoptée et promulguée, j’entends insister fortement sur la nécessité de donner aux faits leur exacte qualification pénale. La précision et l’extension du champ d’application de l’infraction sont telles que ce nouveau délit de harcèlement sexuel est plus étendu qu’aux termes des précédentes dispositions. Cependant, il faudra veiller à ce qu’il ne soit pas utilisé, comme ce fut constaté par le passé, pour sanctionner des agissements qui relèvent d’autres incriminations plus graves, notamment l’agression sexuelle ou le viol.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je présenterai rapidement le projet de loi initial, avant d’en venir au texte issu des travaux de la commission des lois du Sénat.
Le texte déposé par le Gouvernement se fixe trois objectifs : d’abord, donner une définition du harcèlement sexuel qui, tout en respectant les exigences constitutionnelles, permette de couvrir l’ensemble des situations concrètes repérées ou probables dont les femmes peuvent être les victimes ; ensuite, permettre une répression adaptée à la gravité de ces agissements, cohérente au regard de ce qui est prévu pour d’autres infractions sexuelles, ce qui implique la création de circonstances aggravantes ; enfin, réprimer de façon cohérente et exhaustive les discriminations faisant suite à des harcèlements sexuels, ce qui exige de modifier à la fois le code du travail et le code pénal.
Le texte vise à apporter une définition adaptée et élargie du harcèlement sexuel. Pour ce faire, le Gouvernement s’est inspiré de la définition du délit telle qu’elle était rédigée jusqu’à la loi de 2002, laquelle a supprimé la définition, se contentant d’énoncer l’infraction. Il a également tenu compte de la définition du harcèlement sexuel figurant dans les directives européennes sans toutefois la reprendre purement et simplement, car ces directives ne sont pas de nature pénale. Il a aussi choisi de pénaliser les comportements, c’est-à-dire de retenir des éléments objectifs et repérables plutôt que de s’en tenir au ressenti de la victime, intime, probablement réel, mais susceptible d’être contesté au motif de cette subjectivité. Il s’est, en outre, appuyé sur les définitions figurant dans les propositions de loi déposées au Sénat sur le sujet.
Le projet de loi s’est, enfin, nourri du riche dialogue noué avec les associations qui s’emploient à faire vivre et faire respecter au quotidien les droits des femmes. Nous avons aussi pris en considération la cinquantaine d’auditions qu’a organisées le groupe de travail du Sénat. En outre, nous avons nous-mêmes auditionné des associations, des personnalités qualifiées et des représentants syndicaux. En effet, nous savons bien que ces acteurs vont contribuer à faire vivre la loi aux côtés des praticiens du droit.
Il est clairement apparu qu’une définition unique du harcèlement n’était pas possible. Cette unicité butte, en effet, sur la difficulté de concilier le terme « harcèlement », qui, dans la langue française suppose une réitération, avec la volonté, largement partagée, très largement exprimée au Sénat et qui existait dans la volonté du législateur dès 1992 de sanctionner un fait unique dès lors qu’il présente « une particulière gravité ».
Pour bien rendre compte de cette dualité, le texte du Gouvernement distingue ainsi deux grandes catégories de situations dans les I et II du nouvel article 222-33 du code pénal.
Le harcèlement « simple » prévu par le I est ainsi constitué par des comportements imposés, répétés, qui présentent une connotation sexuelle et « qui, soit portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant ».
Il n’est donc plus exigé, comme par le passé, des pressions tendant à obtenir une relation de nature sexuelle.
Devant la commission des lois, j’ai fait mention d’une réflexion de la sénatrice Virginie Klès qui compare le harcèlement sexuel au supplice de la goutte d’eau, puisque « c’est souvent une multitude de petits faits sans gravité manifeste qui, répétés, deviennent insupportables ».
Après débat, aux termes de « non désiré » ou « subi », nous avons préféré le vocable « imposer », car il existe déjà dans le code pénal pour l’infraction d’exhibition sexuelle. Il signifie que la victime n’a pas consenti aux actes de harcèlement, qu’elle ne les a pas désirés, mais qu’elle les a subis.
S’il appartient à la victime de démontrer la matérialité des faits, il ne peut être exigé d’elle qu’elle ait démontré sa réprobation de manière expresse. Le juge appréciera, au regard du contexte, des déclarations des parties et des témoins, s’il existait ou non un accord de la victime. C’est ce que font habituellement les juridictions dans les dossiers de mœurs.
La notion d’environnement mentionnée au I ne doit pas être interprétée comme exigeant que cet environnement résulte également du comportement de personnes autres que l’auteur de l’infraction. En pratique, elle doit être comprise comme faisant référence aux « conditions de vie » ou aux « conditions de travail », expressions qui figurent dans la définition d’autres délits prévus par le code pénal.
Je sais que la commission des lois a encore travaillé sur la notion d’environnement. Cette discussion nourrira de nouveau nos débats tout à l’heure.
Toutefois, le II de l’article 222-33 prévoit que, lorsque les faits prévus au I s’accompagnent de telles pressions, il s’agit d’une nouvelle forme de harcèlement, s’apparentant à du « chantage sexuel » – je place cette expression entre guillemets, car elle n’est pas juridique – et punie plus sévèrement. Dans ce cas, les faits sont sanctionnés même s’ils ne sont pas commis de façon répétée.
Il faut le souligner : dans ces deux cas, les faits peuvent être commis par toute personne, et pas seulement par un supérieur hiérarchique de la victime qui abuserait de son autorité.
La volonté du législateur de 1992 était de pouvoir incriminer un fait unique « d’une particulière gravité ». Les débats parlementaires de cette période en témoignent. Mais la loi, dont la rédaction ne faisait pas référence à cette gravité, n’avait pas permis de transcrire cette volonté dans la réalité.
La difficulté est de préciser ce qui doit être considéré comme un acte « d’une particulière gravité », notion qui, bien entendu, peut être relative.
Il est proposé dans le projet de loi que cette gravité soit caractérisée par deux éléments précis et objectifs : en premier lieu, un comportement, une pression grave exercée sur la victime par le recours notamment à des menaces, contraintes, ou ordres ; en second lieu, un but : obtenir une relation de nature sexuelle.
Concrètement, il s’agit de sanctionner ce qui a pu être qualifié en langage courant de « chantage sexuel », étant rappelé qu’en l’état du droit le chantage est une infraction qui ne couvre pas ce cas de figure. Il s’agit de comportements lors d’entretiens d’embauche, à l’occasion d’une promotion, de la notation, de la délivrance d’un diplôme ou de l’obtention d’un logement en contrepartie de l’acceptation d’une relation de nature sexuelle.
La preuve peut, en ce domaine, se rapporter par tous moyens.
J’en viens au texte issu des travaux de la commission des lois. Celle-ci a repris la distinction proposée par le projet de loi dans les I et II de l’article 222-33 tout en la simplifiant, dans des conditions qui améliorent la définition du délit et reçoivent ainsi le plein accord du Gouvernement.
Le I définit le harcèlement « simple » comme « le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant ».
Le II prévoit qu’« est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user d’ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir une relation de nature sexuelle, que celle-ci soit recherchée au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ». La définition du II n’est ainsi plus liée à celle du I et elle n’exige toujours pas de faits répétés.
Cette double définition permet ainsi de réprimer toutes les formes de harcèlement sexuel, qu’il s’agisse de faits répétés ou d’un fait unique mais particulièrement grave. Sont ainsi protégées trois catégories de victimes : d’abord, la personne qui subit, à plusieurs reprises, des comportements, paroles, gestes ou autres, à connotation sexuelle et portant atteinte à sa dignité ; ensuite, la personne dont les conditions de vie ou de travail deviennent insupportables en raison des propos, gestes ou comportements sexistes dont elle fait l’objet ; enfin, la personne qui est exposée à un chantage sexuel parce qu’elle cherche, par exemple, un appartement ou un emploi ou qu’elle est dans l’attente d’un diplôme ou d’un service quelconque. Toutes les situations seront ainsi couvertes par le droit pénal.
J’en arrive à la répression adaptée du harcèlement sexuel. J’évoquerai, en premier lieu, la répression de l’infraction principale.
Le projet de loi prévoyait de réprimer d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le harcèlement « simple », défini au I, et de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le harcèlement accompagné de pressions, tel qu’il est décrit au II. La commission des lois a proposé d’unifier la répression en la portant, dans les deux cas, à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende.
Cette solution reçoit l’accord du Gouvernement dans la mesure où l’on peut considérer qu’un fait unique peut avoir une gravité et des conséquences pour la victime aussi fortes que la réitération des faits isolément moins graves. Il appartiendra au juge d’en faire l’appréciation.
J’évoquerai, en second lieu, la création de circonstances aggravantes.
Le Gouvernement propose d’aggraver les peines du harcèlement dans quatre hypothèses : premièrement, lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; deuxièmement, lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ; troisièmement, lorsque les faits sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; quatrièmement, lorsque les faits sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
Dans ces quatre cas, les peines seront portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.
Ces différentes circonstances aggravantes sont déjà prévues pour le crime de viol ou les agressions sexuelles. Il est ainsi cohérent de les prévoir en matière de harcèlement sexuel.
Le dispositif répressif global est ainsi cohérent et gradué : d’abord, le harcèlement sexuel est puni de deux ans d’emprisonnement et de trois ans d’emprisonnement s’il est aggravé ; ensuite, les agressions sexuelles sont punies de cinq ans et de sept ans ou dix ans d’emprisonnement si elles sont aggravées ; enfin, le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ou plus s’il est aggravé.
J’en arrive à la répression des discriminations.
Au-delà de la répression du harcèlement sexuel proprement dit, le Gouvernement a estimé indispensable de sanctionner les discriminations qui peuvent résulter de ces faits de harcèlement.
Ces discriminations doivent être réprimées, y compris lorsqu’elles interviennent dans des domaines autres que les relations de travail, et y compris si elles font suite à un acte unique.
Cela peut ainsi être le cas d’une personne qui, parce qu’elle a refusé une proposition de nature sexuelle, n’est pas embauchée, est licenciée, n’obtient pas une promotion ou se voit refuser un logement ou n’importe quel bien ou service.
Il était donc indispensable de compléter les articles 225-1 et 225-2 du code pénal réprimant les discriminations, en y ajoutant un article 225-1-1 relatif aux discriminations intervenant en raison de l’acceptation ou du refus par une personne de subir des agissements de harcèlement sexuel, y compris si ces agissements n’ont pas été commis de façon répétée.
Ces faits seront ainsi punis, en application des articles 225-2 et 432-7 du code pénal, de trois ans d’emprisonnement s’ils sont commis par un particulier et de cinq d’emprisonnement s’ils sont commis par un agent public ou dans un lieu accueillant du public, comme une discothèque, ou aux fins d’en interdire l’accès
Le code du travail a également été complété, par coordination, afin de renvoyer à la nouvelle définition du harcèlement sexuel figurant dans le code pénal et de prévoir que les discriminations dans le travail faisant suite à un harcèlement sexuel sont pénalement sanctionnées, ce qui n’était plus le cas depuis le 1er janvier 2008.
Toute la logique du Gouvernement est de lever les obstacles indus à la dénonciation des faits et au dépôt de plainte en protégeant la victime et les témoins des représailles éventuelles. Il s’agit de tout faire pour que les faits cessent le plus rapidement possible.
En effet, comme a pu le souligner la commission des affaires sociales dans son avis : « Les témoignages reçus montrent à quel point les victimes peuvent être profondément affectées par le harcèlement, qui provoque perte d’estime de soi et fragilité psychologique et mine leurs capacités de résistance. »
Mesdames, messieurs les sénateurs, je formulerai maintenant quelques observations sur la problématique de la majorité sexuelle, dont vous avez, je le sais, beaucoup débattu, afin de répondre au projet tendant à modifier la circonstance aggravante de minorité de quinze ans en minorité simple.
Le Gouvernement propose que la minorité de quinze ans soit une circonstance aggravante du harcèlement sexuel.
Pourquoi cette aggravation ne s’applique-t-elle pas pour toutes les victimes mineures, y compris celles qui sont âgées de quinze ans à dix-huit ans ? Cette question est parfaitement pertinente. Il est en effet rare de trouver des mineurs de moins de quinze ans dans les entreprises ; par ailleurs, la tranche de minorité concerne les jeunes de quinze ans à dix-huit ans.
Dans le code pénal, seule la minorité de quinze ans constitue une circonstance aggravante.
C’est le cas pour le meurtre, les tortures et actes de barbarie, les violences, le viol, les agressions sexuelles et d’autres délits ou crimes.
Ce seuil de quinze ans date de l’ordonnance du 2 juillet 1945. Il était de onze ans dans le code pénal de 1810, puis est passé à treize ans dans la loi du 13 mai 1863.
Un mineur de plus de quinze ans a le droit d’avoir des relations sexuelles librement consenties, y compris, depuis 1983, avec une personne du même sexe.
Il en découle que sont punissables les seules atteintes sexuelles – qui, par définition, sont réalisées sans contrainte – commises sur des mineurs de moins de quinze ans, le législateur estimant que ceux-ci n’ont pas le discernement suffisant pour exprimer un consentement éclairé.
C’est pour tenir compte de cette majorité sexuelle à quinze ans que le législateur, lorsqu’il aggrave les peines en raison de la minorité de la victime, fixe également le seuil à quinze ans.
Il semble que la nécessaire cohérence de notre droit pénal, dont la garde des sceaux que je suis est le garant, justifie de conserver ce seuil de quinze ans en matière de harcèlement sexuel.
Cela n’interdira évidemment pas aux juridictions compétentes en matière de harcèlement sexuel, comme c’est le cas pour les autres infractions, d’être plus sévères en pratique, si les faits sont commis sur un mineur de quinze ans à dix-huit ans, par exemple s’il s’agit d’un ou d’une jeune stagiaire. Dans ce cas, l’aggravation pourra fréquemment être liée à l’abus d’autorité.
J’en viens à présent à la problématique de la vulnérabilité économique et sociale, que vous avez soulevée.
Le Gouvernement propose que la sanction soit aggravée lorsque les faits sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.
Lors des travaux en commission, plusieurs voix ont exprimé le souhait d’y adjoindre la vulnérabilité économique et sociale.
Si l’on ne peut qu’entendre le souhait d’assurer une plus grande protection à nos concitoyens, très nombreux, trop nombreux, disposant de faibles revenus, de contrats précaires ou se trouvant dans des situations sociales fragiles – on pense, bien sûr, aux familles monoparentales –, je m’interroge cependant sur la pertinence de confier au juge le soin de définir le degré, forcement subjectif, à tout le moins relatif, de vulnérabilité sociale.
Cette appréciation peut, en effet, être perméable aux préjugés idéologiques.
Je me range à la réserve inscrite dans l’avis de votre commission des affaires sociales, qui indique : « Introduire la notion de vulnérabilité économique dans le code pénal serait une innovation et il est possible que les tribunaux aient du mal à l’appréhender dans un premier temps, en raison de son caractère relatif. »
Il appartiendra en outre à l’accusation de démontrer que cette vulnérabilité aura constitué l’élément déclencheur du passage à l’acte. Nous craignons que cette disposition ne fragilise la poursuite et ne desserve la victime.
Bien entendu, il ne s’agit pas de nous soustraire à notre obligation de combattre ensemble cette vulnérabilité sociale et de mettre en place des politiques publiques, économiques et sociales favorisant une meilleure santé économique générale.
Il convient de garder à l’esprit que le Conseil constitutionnel a invalidé le texte précédent pour non-respect du principe de légalité des délits et des peines, qui impose de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis.
Il y a donc lieu de prendre des précautions en pareil cas : il paraît opportun de reprendre au maximum des termes existant déjà en droit pénal. C’est en fonction de cet impératif que le Gouvernement s’est montré très attentif aux observations juridiques du Conseil d’État, qui a émis un avis globalement favorable sur ce texte.
Bien évidemment, le projet de loi, déjà fortement amélioré par les travaux des commissions des lois, des affaires sociales, de la délégation aux droits des femmeset par les amendements de M. lerapporteur et de Mme le rapporteur pour avis, pourra encore être enrichi, au vu des nombreux amendements qui ont été déposés.
Le Gouvernement est tout à fait ouvert à la discussion et examinera avec la plus grande attention ces amendements, quelle que soit leur provenance. Nos travaux préparatoires ont en effet laissé apparaître qu’il existait un large consensus sur ce texte.
Je tiens à rappeler, en conclusion, que, si le harcèlement sexuel ainsi énoncé figure dans notre droit pénal depuis 1992-1994, des tentatives existaient bien avant. On trouve ainsi dans les lois du 19 mai 1874 et du 2 novembre 1892 des injonctions invitant les patrons et chefs d’établissements au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique. Il s’agit de termes extrêmement paternalistes et d’une conception vieillotte – je ne suis d’ailleurs pas certaine que les mentalités aient tellement évolué depuis... –, mais il est intéressant de noter qu’il s’agit de deux textes relatifs au travail des filles et garçons mineurs dans l’industrie.
Je souhaite évoquer, durant quelques instants, un mouvement social qui a eu lieu à Limoges au début du siècle dernier, au mois de mai 1905, dans l’usine de porcelaine Haviland. Des femmes, qui représentaient la majorité des salariés de cette usine, s’étaient mises en grève afin de protester contre les agissements d’un contremaître qu’elles accusaient de pratiquer le droit de cuissage.
En raccrochant leur grève à un autre mouvement ouvrier destiné à protester contre les bas salaires et les licenciements, ces femmes ont introduit une dimension de dignité de la personne au sein de ce mouvement social et ont augmenté ainsi sa force et son efficacité. Surtout, elles ont arraché la société à son mutisme, à son aveuglement, à sa pruderie et, pour parler un peu brutalement, à son hypocrisie. Elles ont donné une véritable visibilité sociale au phénomène de harcèlement sexuel dans l’entreprise et permis l’évolution de la loi et des mentalités. Cela prouve combien la combativité sociale, politique, féminine, permet souvent de faire évoluer le droit.
Je ne méconnais pas les débats techniques, juridiques et philosophiques portant sur ces incriminations, au demeurant récentes dans notre droit. Je les entends, sans les récuser totalement, lorsqu’ils ont trait à la privatisation du procès pénal et au passage de l’incrimination comme atteinte au corps social vers une prééminence de l’incrimination comme atteinte à l’individu, c’est-à-dire à son intégrité non pas seulement physique, mais également psychique.
La question posée est la suivante : comment appréhendons-nous l’évolution des comportements – qui prend d’ailleurs très souvent la forme d’une régression au regard du droit, des libertés individuelles et de l’altérité – dans la société ? Nous traitons en effet de faits, d’abus de droit ou d’autorité, de souffrances, mais aussi de mutations dans les relations de travail fondées sur une conception managériale que nous avons le droit, et même le devoir, d’interroger aujourd’hui, et qui s’ajoute à la persistance dans la société tout à la fois de clichés et de représentations.
Il est important, par conséquent, de s’interroger sur la réponse qu’il convient d’apporter à de telles situations. Le travail que nous accomplissons aujourd’hui, il est bon de le noter, est susceptible de nous faire avancer dans cette voie.
Nous vivons dans des sociétés où coexistent, à la fois, des technologies très sophistiquées et des comportements relevant de rapports archaïques avec l’autre, qu’il s’agisse de l’autre « féminin » ou de l’autre « différent ».
Toutes ces interrogations, j’en suis persuadée, nourriront et enrichiront nos débats. Nous serons extrêmement attentifs, pour notre part, à toutes vos observations et à nos échanges. Nous acceptons d’être encore habités par le doute, car nous pensons qu’il est un moteur puissant pour l’action de progrès.
Comme l’écrivait Stendhal, « l’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation ». §
Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, monsieur le rapporteur, madame le rapporteur pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, rendant hommage aux femmes victimes de harcèlement qui avaient trouvé le courage de défendre leurs droits, un avocat du barreau de Paris reprenait ainsi, en 2007, la parole de l’une d’entre elles : « Cela valait la peine, la justice m’a rendu justice ! »
Nous étions alors en 2007 et nous étions loin d’imaginer que cette demande de justice, de reconnaissance d’une souffrance véritable, pourrait se trouver compromise par l’effet de l’abrogation d’une loi par le Conseil constitutionnel.
Nous sommes en 2012 et, le 4 mai dernier, le Conseil constitutionnel a abrogé avec effet immédiat le délit de harcèlement sexuel au motif de son inconstitutionnalité.
Les premiers mots que je veux avoir devant vous aujourd’hui sont des mots de soutien pour celles – car, nous le savons, ce sont les femmes qui sont pour l’essentiel concernées – qui ont vu les actions qu’elles avaient engagées s’éteindre brusquement, sans recours ou presque...
Certes, cela a été rappelé, la Chancellerie a donné des instructions pour que des faits puissent être requalifiés et des actions poursuivies sur d’autres terrains, comme les violences volontaires ou les agressions sexuelles ; je veux en remercier la garde des sceaux. Cependant, dans certains cas, on le sait, cela n’a pas été possible ou n’a pas été reconnu par les juridictions.
Cette situation de souffrance sans recours nous oblige. Elle nous oblige tous : vous, parlementaires de toutes sensibilités, et nous, ministres du Gouvernement.
Je dois le dire, le Sénat, par sa mobilisation sans précédent, a été à la hauteur de cette ardente obligation, et ce dès le 4 mai dernier.
Tous ou presque, dans cet hémicycle, avez été acteurs de cette mobilisation : à la commission des lois, sous l’impulsion de M. Jean-Pierre Sueur, à la commission des affaires sociales, sous la conduite de Mme Annie David, ou encore à la délégation aux droits des femmes, bien sûr, grâce à l’engagement de Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Sept propositions de lois, un groupe de travail auditionnant en un temps record une cinquantaine de personnes, des rapports de grande qualité de vos commissions et de votre délégation : c’est un travail immense. Je tiens à remercier, à la suite de Mme la garde des sceaux, les présidents de commissions et de délégation ainsi que les deux rapporteurs, M. Alain Anziani et Mme Christiane Demontès, avec lesquels nous avons œuvré en confiance et qui ont accompli un travail remarquable.
Je salue également le climat très consensuel dans lequel l’ensemble de ce travail a été conduit...
... et l’esprit de responsabilité qui a animé les sénateurs de tous les groupes.
C’est ce travail global, auquel le Gouvernement s’est associé au travers du projet de loi, qu’il nous appartient désormais de faire fructifier ensemble, en rétablissant le délit de harcèlement sexuel censuré, mais aussi en proposant des avancées pour répondre à l’attente des femmes.
Vous l’avez écrit dans votre rapport, monsieur le rapporteur : « Le harcèlement sexuel est un fléau demeuré longtemps ignoré du code pénal, puis méconnu dans la diversité de ses expressions. »
De quoi parle-t-on au juste ?
Il existe, comme souvent en matière de violences faites aux femmes, peu d’études pour nous révéler l’ampleur de ces délits et crimes. C’est un point sur lequel nous discuterons au cours de nos débats puisque, comme vous, je reconnais qu’il nous manque une instance capable de fédérer les enquêtes et d’en faire l’analyse, pour guider les pouvoirs publics.
En l’absence d’une telle instance, il faut remonter à la grande enquête nationale sur les violences faites aux femmes réalisée en 2000 pour avoir quelques éléments au plan national, complétés par l’étude menée par la Commission européenne en 1999.
D’autres enquêtes, que Christiane Taubira a évoquées, ont été conduites en 2007 en Seine-Saint-Denis. Le rapport de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes les mentionne également.
Mesdames, messieurs les sénateurs, les violences faites aux femmes sont une réalité importante de notre société, que l’on ne peut ignorer.
Si l’on passe sur les 45 % de femmes qui déclarent avoir entendu des blagues sexistes ou sexuelles au travail – de façon répétitive pour la moitié d’entre elles –, 13 % des femmes salariées déclarent avoir côtoyé des personnes ayant eu une attitude insistante, gênante et des gestes déplacés. Elles sont 9 % à déclarer avoir reçu des avances sexuelles non désirées au cours de l’année.
Une autre donnée intéressante que vous avez portée à notre connaissance, madame la présidente Gonthier-Maurin, révèle que le harcèlement sexuel, en plus d’être une souffrance personnelle, est un fardeau collectif. Une étude conduite en Israël et que vous citez dans votre rapport évalue à quelque 250 millions d’euros le coût annuel du harcèlement sexuel dans ce pays, délit qui provoque démissions, mutations et ruptures de carrière pour les femmes.
Pourtant, face à cette réalité, la réponse pénale apparaît en décalage. Il a été rappelé que, depuis 2005, 1 000 procédures nouvelles sont enregistrées chaque année pour cette infraction. Plus de la moitié de ces procédures ont fait l’objet d’un classement sans suite, au motif que l’infraction n’était pas constituée. La très grande majorité des peines d’emprisonnement prononcées sont assorties d’un sursis total. Quant aux peines d’amendes, elles sont d’un montant moyen d’environ 1 000 euros…
On le voit : la procédure est exigeante et demande aux victimes un investissement personnel très fort, comme l’ont souligné toutes les associations que vous avez auditionnées.
Cette procédure est aussi ingrate pour les victimes. En effet, les délais d’instruction sont longs et les preuves difficiles à apporter. En outre, le délit, dans la définition qu’en donnait la loi du 17 janvier 2002, ne punissait que les agissements sollicitant une contrepartie de faveurs sexuelles.
Dans ces conditions, même si le délit de harcèlement sexuel n’avait pas été abrogé par le Conseil constitutionnel le 4 mai dernier, nous aurions sans doute dû ouvrir le débat d’aujourd’hui.
En effet, la question du harcèlement sexuel est grave : sans signaux visibles qu’il est considéré comme intolérable, on ne construit pas une société de justice, de respect et d’égalité entre les femmes et les hommes.
Le contexte dans lequel nous finissons par avoir ce débat est très particulier. Il nous conduit à agir dans l’urgence pour ne pas laisser des situations d’impunité s’installer trop longtemps et parce que la protection de la loi est un droit fondamental que le Président de la République et le Premier ministre nous ont demandé de rétablir.
Qu’il faille agir dans l’urgence, nous en sommes toutes et tous convaincus, au Gouvernement comme dans votre assemblée.
Mais Mme la garde des sceaux et moi-même avons aussi été soucieuses de garantir la pérennité de ce nouveau droit. Nous avons voulu nous assurer que la loi serait efficace, qu’elle serait appliquée et qu’une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité ne viendrait pas, dans quelques mois, mettre à bas cette loi aussi, désespérant une nouvelle fois les victimes et les faisant douter de l’action publique et de notre engagement à tous.
C’est parce que nous souhaitions agir en urgence que le Premier ministre a mis en œuvre la procédure accélérée. Je veux remercier le président Sueur qui, lors de notre audition, nous a confirmé qu’il ne voyait pas là une mauvaise manière faite au Sénat.
Nous sommes attachées, comme lui et comme vous, au temps du travail parlementaire et de l’expertise. Mais, ce temps de l’expertise, vous l’avez pris depuis le 4 mai dernier.
C’est parce que nous souhaitions combiner urgence et sécurité juridique que nous avons également consulté le Conseil d’État, pour conforter notre analyse sur certaines questions sensibles : la réitération, la notion d’environnement, l’échelle des peines et les articulations à construire entre le code pénal et le code du travail.
Urgence et sécurité juridique, donc, mais aussi concertation. C’est une exigence à laquelle je suis très attachée. Christiane Taubira et moi-même avons eu le souci de construire ce projet de loi en écoutant les associations, de manière partagée avec les partenaires sociaux.
Dès notre prise de fonction, nous avons travaillé avec les associations. Nous avons continué de le faire durant l’ensemble de la préparation du projet de loi.
Bien entendu, je n’ignore pas que certaines associations s’estiment encore insatisfaites, doutent de certaines notions ou revendiquent des aménagements plus lourds, par exemple sur les peines.
Le travail de la commission des lois a déjà permis de répondre à certaines de ces attentes et de ces interrogations, mais il nous faudra aller plus loin dans le travail d’explication du projet de loi, pour lever les craintes.
Reste que la loi parfaite n’existe sans doute pas. Celle que nous cherchons à construire, avec la contribution des parlementaires, nous la voulons claire, globale et efficace.
Cette loi devra ensuite être appliquée – c’est bien là l’essentiel. C’est pour cela qu’il y aura une circulaire pénale, comme Mme la garde des sceaux l’a dit tout à l’heure.
Cette loi sera un signal pour les femmes victimes, mais aussi pour les auteurs de harcèlement. C’est le sens de la campagne de communication que nous mènerons, à l’automne, en accompagnement de la loi.
Michel Sapin, ministre du travail, et moi-même avons aussi discuté de ce projet de loi avec les partenaires sociaux, qui s’en sont saisi. Toutes les organisations syndicales ont salué le souci de faire face à l’urgence et de répondre à leurs attentes.
Enfin, nous avons dialogué avec votre assemblée, les membres de vos commissions et la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Je me réjouis que le travail collectif mené dans les commissions, en particulier lors des auditions, ait permis d’examiner le projet de loi en même temps que les propositions de loi.
Le travail du Sénat a permis de fixer clairement les termes du débat, s’agissant notamment de la question de l’élément moral et des éléments matériels du délit, des circonstances aggravantes et de la rétroactivité.
Vos travaux nous ont aussi permis de voir se construire un consensus autour de quelques principes qui nous ont guidés.
En premier lieu, la nécessité est apparue d’une approche globale, qui intègre l’application de la définition du harcèlement sexuel dans trois champs : le code pénal, bien sûr, mais aussi le code du travail et le statut général des fonctionnaires. S’agissant de ce dernier champ, je me réjouis que la commission des lois ait apporté les compléments que le projet de loi n’avait pas pu introduire.
En deuxième lieu, il est apparu pertinent d’élargir la définition du harcèlement en s’inspirant des directives européennes, tout en conservant la précision indispensable en matière pénale.
En dernier lieu, nous nous sommes mis d’accord sur l’ajustement des peines et le souci d’une stricte définition des circonstances aggravantes.
Votre commission des lois a enrichi le projet de loi, comme l’a souligné Christiane Taubira. Elle a tranché des questions importantes, par exemple celle de l’alignement des peines sur deux ans d’emprisonnement et une amende de 30 000 euros. Elle a aussi simplifié le projet de loi pour le rendre plus clair encore.
Je souscris à l’ensemble des éléments qui vous ont été présentés par Mme la garde des sceaux. Ils décrivent bien notre intention et les équilibres que nous avons trouvés.
En ma qualité de ministre des droits des femmes, je me permettrai simplement d’insister sur trois points essentiels.
Premièrement, nous avons eu le souci – que vous partagerez bien entendu – qu’aucune situation ne se trouve désormais laissée en dehors du droit. Il s’agit d’une innovation décisive car l’exigence que des faveurs sexuelles aient été obtenues ayant été abandonnée, des faits qui n’étaient pas réprimés hier pourront l’être demain.
Je pense au harcèlement sexuel quotidien que certaines femmes vivent et qu’elles taisaient jusqu’à présent. Mme Tasca a trouvé la bonne formule en parlant d’un « climat qui pourrit la vie des femmes ».
Mais le nouveau dispositif concernera aussi le chantage sexuel, comme l’on dit communément, qui se produit une seule fois, à l’occasion d’un entretien d’embauche ou d’une demande de logement.
À ce propos, nous avons rejoint votre analyse : une définition juridique du chantage existe bien dans le code pénal, mais elle se prête mal aux problèmes dont nous parlons, de sorte qu’il vaut mieux introduire dans le projet de loi une définition précise intégrée à la notion même de harcèlement sexuel.
Je tiens à vous dire, monsieur le rapporteur, madame la rapporteur pour avis, que j’ai été sensible à votre analyse : vous avez bien distingué le harcèlement à connotation sexuel de ce que l’on appelle communément le chantage sexuel, sans pour autant hiérarchiser la souffrance des victimes selon qu’elle est provoquée par un fait répétitif ou un acte unique.
Deuxièmement, je veux souligner que les peines sont aggravées dans une logique respectueuse de l’échelle des peines concernant les atteintes sexuelles aux personnes.
En effet, le projet de loi permet de conserver une cohérence globale dans les peines pour les atteintes sexuelles aux personnes : le nouveau délit, avec ses circonstances aggravantes, s’insère dans une échelle qui va d’une peine d’un an d’emprisonnement pour l’exhibition sexuelle à des peines de cinq ans d’emprisonnement pour l’agression sexuelle hors aggravation et de quinze ans d’emprisonnement pour le viol hors aggravation.
Nous avons entendu les critiques contre ces peines. Elles seraient trop légères et moindres que celles qui sont encourues pour un vol de téléphone portable.
Mais la question de la révision globale de l’échelle des peines sera peut-être abordée au cours de cette mandature, avec Mme la garde des sceaux. Il nous a semblé que l’examen du présent projet de loi n’était pas le moment d’ouvrir ce débat. Je vous sais, au Sénat, sensibles à cette prudence.
Troisièmement, je veux souligner que le projet de loi introduit une véritable nouveauté : les discriminations faisant suite à des faits de harcèlement sexuel, qu’elles s’exercent à l’encontre de la victime ou d’un témoin, deviendront également punissables, ce principe étant inscrit aussi bien dans le code pénal que dans le code du travail.
Pour ce qui est du code du travail, il s’agit en réalité de rétablir une disposition dont la suppression était involontaire... Les victimes n’ont pas à en payer le prix. Nous rétablissons donc la disposition.
Pour finir, je veux insister, au-delà de la répression, sur l’accompagnement des victimes et la prévention. La répression, en effet, n’est jamais suffisante.
D’abord, nous devons faire en sorte que les victimes soient informées des droits que leur ouvre la nouvelle loi. Je mobiliserai les réseaux d’accueil, d’information et d’orientation des femmes à cette fin. C’est une préoccupation forte de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, dont je partage plusieurs analyses.
Nous conduirons aussi un travail sur la prévention, les représentations et les stéréotypes.
D’ailleurs, nous avons commencé d’aborder la question de la prévention dans le dialogue avec les partenaires sociaux. En effet, j’ai évoqué avec eux la question des violences au travail lors de la grande conférence sociale qui s’est achevée hier. Ma collègue Marylise Lebranchu, qui est chargée de la fonction publique, en a fait autant avec les organisations syndicales de la fonction publique.
D’ores et déjà, le texte de la commission a pris en compte certaines des demandes exprimées sur vos travées.
Je répète que, cet automne, nous lancerons une campagne de sensibilisation sur les violences au travail. Nous la préparerons avec les associations et les partenaires sociaux.
En outre, une autre de mes collègues a pris la mesure de cette question : il s’agit de Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Elle a engagé une réflexion sur les procédures disciplinaires applicables en cas de harcèlement au sein de l’université, que des associations nous ont décrites comme largement insatisfaisantes. Nous travaillerons ensemble sur la question de la prévention et de la sensibilisation dans les établissements d’enseignement supérieur.
Mais tout cet effort ne sera rien sans un travail en profondeur sur les représentations et les stéréotypes. Comme vous l’avez chacune souligné, mesdames Jouanno, Demontès et Gonthier-Maurin, il est évident qu’il faut davantage d’études sur le sujet, davantage de travail et, surtout, davantage de volonté. Je n’en manque pas et je conduirai ce combat.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement a construit le présent projet de loi avec le souci d’une approche globale qui permette de prévoir une réponse pénale tout en pensant aux actions concrètes à mener dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les stéréotypes.
Ce projet de loi est une première réponse. D’autres suivront, qui concerneront plus largement les violences faites aux femmes.
Nous avons entendu les associations, qui veilleront très attentivement à ce que la loi soit appliquée. Sachez que Mme la garde des sceaux et moi-même sommes très attachées à ce qu’elle le soit. Je sais que le travail auquel vous avez tous participé depuis le début du mois de mai y contribuera.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE . – Mme Muguette Dini ainsi que MM. Christian Poncelet et Antoine Lefèvre applaudissent également.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, madame la ministre des droits des femmes, mes chers collègues, nous sommes les témoins d’une disparition finalement rare : la disparition d’une infraction.
Avec elle, nous assistons aussi à la disparition de plusieurs centaines, peut-être de plusieurs milliers de procédures. Et ce sont plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers de victimes qui sont plongées dans l’incompréhension.

Elles voient s’ajouter la souffrance judiciaire à la souffrance née du harcèlement sexuel.
Cette évaporation est choquante pour les victimes ; selon nous, pourtant, elle était inéluctable.
Le Conseil constitutionnel s’est trouvé confronté à un délit dont la définition, d’une réforme à l’autre, était devenue une véritable tautologie. Qu’est-ce que le harcèlement sexuel ? Aux termes de la dernière loi votée, c’était « le fait de harceler quelqu'un dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles »… Naturellement, une telle définition ne peut nous convenir. Elle est même contraire au principe de légalité des délits et des peines inspiré par l’article VIII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Cette exigence nous avait d'ailleurs déjà été rappelée par le Conseil constitutionnel à propos de la définition des membres de la famille visée par le texte sur l’inceste.
En tant que législateurs, nous sommes ainsi renvoyés à notre responsabilité : faire des lois claires et précises. Telle sera la première orientation de nos travaux et tel est, mesdames les ministres, le premier objectif de ce texte. La seconde orientation, très ambitieuse, consistera à mieux appréhender une infraction qui demeure largement ignorée.
Beaucoup a déjà été dit sur ce point. J’ajouterai simplement que le harcèlement sexuel déstructure durablement ses victimes, réduites au rang d’objets, de choses, de miroirs de fantasmes. Or, en dépit de sa gravité, il est trop souvent confondu avec de la mauvaise plaisanterie, de la vulgarité machiste, voire avec une forme maladroite de galanterie – on trouve cette expression dans certaines décisions de justice.
Selon l’étude d’impact, ce délit fait l’objet aujourd'hui d’un millier de procédures et de seulement soixante-dix à quatre-vingt-cinq condamnations par an. Pourquoi des procédures qui sont si peu nombreuses et des condamnations qui le sont moins encore ?
La première explication est commune à toutes les infractions sexuelles : en pareil cas, nous le savons, il est difficile pour la victime de porter plainte.
La seconde tient à la difficulté, dans ce domaine plus que dans les autres, de rapporter la preuve de l’infraction. Dans le procès, c’est la parole de l’un, souvent un homme, contre celle de l’autre.
M. Roland Courteau acquiesce.

Notre mission est de refonder l’incrimination en prenant en compte ces deux objectifs : il nous faut adopter une loi qui soit à la fois claire et précise, pour satisfaire les exigences constitutionnelles, et ambitieuse.
Pour y parvenir, nous disposons de nombreux éléments : cinq directives communautaires, la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes, la loi du 27 mai 2008 portant diverses adaptations au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et sept propositions de loi déposées au Sénat, dont je ne nommerai pas les auteurs. À cet égard, certains ont évoqué la frénésie du Sénat. Mais c’est plutôt la marque de l’intérêt porté par notre assemblée à cette cause qui mérite amplement d’être défendue !

Nous disposons également des travaux du groupe de travail présidé par Annie David, Brigitte Gonthier-Maurin et Jean Pierre Sueur, d’une étude de législation comparée tout à fait intéressante, des recommandations de la délégation aux droits des femmes, enfin, bien évidemment, du présent projet de loi, qui, déjà, tient compte de la réflexion du Sénat.
Quels éléments communs se dégagent de ces différents travaux ?
Il s’agit tout d’abord, bien entendu, de la nécessité d’une nouvelle définition. Pour répondre aux objections du Conseil constitutionnel, celle-ci devra obligatoirement comporter des éléments matériels précis. Si tel n’était pas le cas, – j’attire votre attention sur ce point, mes chers collègues – nous risquerions une nouvelle censure.
Le projet de loi précise ainsi que l’infraction nécessitera des pressions répétées, sous forme de propos, de comportements ou de tout autre acte à connotation sexuelle, qui devront provoquer des conséquences dommageables pour la victime, soit parce qu’elles auront porté atteinte à sa dignité, soit parce qu’elles auront créé à son égard, selon les termes du projet de loi, « un environnement intimidant, hostile ou offensant ».
La commission des lois a accepté ce matin deux modifications dans cette définition. Elle a d’abord donné un avis favorable à un amendement de M. Hyest qui substitue le terme d’« agissement » à celui de « comportement ». En effet, il nous a semblé que le mot « agissement » était plus précis, donc correspondait davantage aux exigences constitutionnelles, et permettrait aux victimes de rapporter plus facilement la preuve de l’infraction.
La seconde modification est d’une autre nature. La commission des lois a accepté de renoncer ce matin à la notion d’« environnement », qui figure dans les directives communautaires, au profit de celle de « situation », si je ne me trompe pas...

En effet, elle a considéré que le mot « environnement », issu du droit communautaire, était en réalité une mauvaise traduction d’un terme anglo-saxon et qu’il était moins intelligible par nos juridictions que le terme « situation ».
Pour ma part, je ne partage pas cet avis et je soutiens la notion d’« environnement », comme je l’ai fait depuis le début de nos travaux.

En effet, la notion d’« environnement » n’est pas étrangère au droit français. Elle se trouve dans l’accord national interprofessionnel conclu le 26 mars 2010 sur le harcèlement au travail. Elle a également été reprise dans cinq des sept propositions de loi. Enfin, l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, qui a beaucoup œuvré sur ces questions, l’intègre dans ses réflexions. Cette notion pouvait donc susciter un consensus, me semble-t-il. Quant à savoir si les tribunaux étaient capables, ou non, de l’adapter dans notre droit, j’ai interrogé à ce sujet le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation : pour lui, elle ne poserait pas de difficulté d’interprétation.
Toutefois, évidemment, je me rallie à la position de la commission des lois, que j’ai déjà évoquée.
Une fois cette définition retenue, il reste à l’évidence une difficulté
M. Christian Poncelet opine.

Il fallait nécessairement viser aussi cette situation. Nous pensions utiliser l’expression de chantage sexuel, qui avait d'ailleurs été employée lors des débats parlementaires, en 1992, quand fut créée l’infraction de harcèlement. Le législateur avait alors réfléchi à la question de l’acte unique, qui, selon le ministre délégué à la justice de l’époque, Michel Sapin, devait être réprimé par la loi. Toutefois, après en avoir longuement débattu, le législateur avait estimé inutile de préciser ce point dans la loi.
Nous en avons à l’évidence payé le prix : voilà vingt ans que la discussion se poursuit devant les tribunaux pour savoir si un acte unique relève, ou non, du harcèlement sexuel. Comme vous l’avez souligné, madame la garde des sceaux, si l’on ouvre le dictionnaire, la réponse à cette question est évidemment négative, mais si l’on considère la notion elle-même, elle est positive. Voilà vingt ans que le débat se poursuit !
Madame la garde des sceaux, vous avez employé dans votre texte une formulation très intelligente : « Est assimilé au harcèlement sexuel », qui permet de ne pas brutaliser le dictionnaire tout en reprenant la notion de harcèlement. Tel est l’état du texte. Catherine Tasca, Virginie Klès et d’autres ont souhaité aller plus loin et inscrire dans la loi le terme de chantage sexuel. Toutefois, la commission des lois a considéré ce matin que cette notion n’éclaircissait pas le texte, et cet amendement auquel j’étais pour ma part favorable n’a donc pas été adopté.
Je voudrais évoquer à présent un point très précis. En effet, nous sommes toujours très attentifs aux observations formulées par les uns et les autres. Le II de l’article 1er du texte exposera-t-il les victimes à des risques de requalification de tentatives de viol ou d’agression sexuelle en harcèlement sexuel ? La discussion est ouverte, et je comprends les arguments invoqués, qui tiennent, par exemple, à l’utilisation du mot « contraintes » dans cette disposition.
Il est toujours difficile de répondre à une telle question, mais je ne crois pas que ce risque soit fondé. En effet, la tentative est parfaitement définie dans le droit français. Elle suppose un début d’exécution. Une tentative de viol, par exemple, nécessite un commencement d’exécution, qui n’a été arrêté par son auteur qu’indépendamment de sa volonté propre, selon la jurisprudence. Cela implique un contact ou une pression physique, un acte matériel et, dès lors, nous sortons du harcèlement tel que nous l’entendons.
Madame la garde des sceaux, vous avez ajouté tout à l'heure, et je vous en remercie, que, pour dissiper toute confusion, vous entendiez insister, au travers d’une circulaire ou d’une instruction aux parquets, sur la nécessité de donner aux faits leur exacte qualification pénale. Du reste, la requalification est un mal judiciaire assez répandu, concernant les infractions sexuelles, mais aussi au-delà, et il faudra un jour, si vous en êtes d'accord, que nous nous penchions sur cette question.
M. Roland Courteau approuve.

Quelles peines fixer ? L’ancien texte punissait le harcèlement sexuel d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le projet de loi prévoyait de conserver la même sanction pour le délit de base, mais de la porter à deux ans et 30 000 euros en cas de chantage sexuel.
Il nous a semblé que nous n’avions pas à hiérarchiser la souffrance des victimes en distinguant entre le harcèlement par répétition et le harcèlement par acte unique. La commission des lois a donc retenu la même peine dans les deux cas. Quelle sera-t-elle ? Comme l’a rappelé Mme la ministre des droits des femmes, il y a débat. Il n’est pas normal – disons-le franchement – que le vol d’un portable soit plus sévèrement puni qu’une infraction à la personne. Toutefois, le problème est plus général : il n’est pas admissible que l’échelle des peines prévue par notre code pénal soit devenue aussi incohérente et que les infractions à la personne puissent être moins punies que les atteintes aux biens ! La question se pose de façon globale.
Allons-nous saisir cette occasion pour mettre à jour l’échelle des peines ? Il s'agirait d’un travail considérable et qui mériterait beaucoup d’attention. Aujourd'hui, nous en restons donc à la proposition d’une peine de deux ans de prison et de 30 000 euros d’amende pour toutes les formes de harcèlement sexuel.
Quelles circonstances aggravantes retenir ? Le texte en prévoit quatre, punies de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende : si les faits sont commis par une personne qui abuse de son autorité, sur un mineur de quinze ans, en cas de particulière vulnérabilité, ou, enfin, par plusieurs personnes. Lors de la discussion du texte, nous examinerons des amendements tendant à modifier ces circonstances aggravantes.
Mes chers collègues j’attire votre attention sur un point : il faut veiller à la cohérence du code pénal. Évitons de modifier seulement quelques lignes de ce dernier, sans nous poser la question du droit pénal dans son ensemble.
La limite d’âge de quinze ans, par exemple, a un sens profond. Elle correspond à la majorité sexuelle retenue depuis 1945. Je le répète, un adulte qui a une relation sexuelle avec un mineur ou une mineure de moins de quinze ans peut faire l’objet de poursuites sans que l’on se pose la question du consentement de ce dernier. En revanche, un adulte qui a des relations sexuelles avec une mineure de plus de quinze ans ne pourra être poursuivi que s’il y a absence de consentement du mineur.
Telle est la démarcation. Si, à l'occasion du vote d’un amendement, nous remettions en question cette limite d’âge, cette décision entraînerait des conséquences sur l’ensemble du code pénal. Surtout, nous aboutirions à une situation extrêmement choquante : le viol sur une mineure de 16 ans ne serait pas une circonstance aggravante, alors que le harcèlement sexuel sur une mineure de 16 ans le deviendrait ! Là encore, il faut rester fidèle à un principe de cohérence.
Au titre des circonstances aggravantes, se pose aussi la question de la vulnérabilité économique et sociale, qui a été écartée ce matin par la commission.

C’est l’amendement qui a été écarté, la commission y étant défavorable.

En effet, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement qui tendait à ajouter cette condition de vulnérabilité économique et sociale dans le code pénal.
On voit bien quels arguments ont prévalu : la cohérence globale, le fait que, en l’état du droit, la vulnérabilité ne soit pas de nature économique et sociale, l’arbitrage final des juridictions qui fixera la notion de « vulnérabilité économique et sociale ». On comprend bien quelles sont toutes les contraintes, toutes les difficultés. D’ailleurs, moi-même je m’étais exprimé défavorablement sur ce point.
Cependant, je crois que nous devons rester ouverts. Ce matin, quelqu’un a dit avec beaucoup de justesse que, aujourd’hui, une personne qui se trouve en situation de vulnérabilité économique et sociale – intuitivement, nous voyons bien de quoi il s’agit – est une victime toute désignée de harcèlement sexuel. Il faudra donc en tenir compte.
Je veux maintenant aborder la question de l’orientation sexuelle et des transsexuels.
L’atteinte à une personne en raison de son orientation sexuelle constitue une circonstance aggravante du viol, des agressions sexuelles en général. Je trouverais cohérent qu’elle puisse également devenir une circonstance aggravante en cas de harcèlement. Toutefois, ce matin, tel n’a pas été l’avis de la commission des lois.
Je souhaite maintenant dire quelques mots sur les autres articles du projet de loi.
L’article 2, extrêmement important, traite des discriminations. L’article 1er punit le harcèlement sexuel. L’article 2 tend à punir les conséquences de ce dernier. Ainsi, une femme harcelée sexuellement va pouvoir agir contre ce harcèlement. Si, de surcroît, elle a perdu son emploi, elle pourra également agir du fait de la discrimination qu’elle aura subie.
L’article 2 est, je le répète, très important, car il permet de viser non seulement l’auteur de harcèlement sexuel, mais également l’employeur. Par exemple, dans une entreprise, si l’employeur couvre une personne qui se livre à du harcèlement sexuel et met à la porte la salariée harcelée, la considérant embêtante, il pourra être puni pour faits de discrimination.
De surcroît, l’article 2 permet de protéger le témoin de faits de harcèlement qui les aurait dénoncés et qui se verrait exposé à une sanction disciplinaire.
L’article 3, quant à lui, est un texte de coordination avec le code du travail. Nous examinerons tout à l’heure un amendement proposant la reproduction intégrale du texte figurant dans le code pénal, à l’instar de ce que prévoit l’article 3 bis pour le statut de la fonction publique.
Mesdames les ministres, mes chers collègues, grâce à notre travail collectif, je crois que nous allons aboutir à combler vite et bien le vide juridique existant, qui avait suscité la stupeur des victimes. Nous proposons, me semble-t-il, une loi plus claire et plus précise, comportant un champ élargi de l’infraction.
Comme toute loi, elle demeurera tributaire de l’interprétation de nos juridictions ; cela a été dit tout à l’heure. Et comme toute loi, elle ne nous dispensera pas de mesures de prévention. §

Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avisde la commission des affaires sociales.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Esther Benbassa applaudit également.

Le harcèlement sexuel peut se produire, nous le savons, dans les circonstances les plus variées : engagement associatif, activités sportives, parcours scolaire ou universitaire, relations de voisinage, recherche d’un logement... Cependant, il faut bien admettre qu’il se déroule souvent dans un cadre professionnel, que ce soit dans les entreprises privées ou dans les administrations. C’est ce qui justifie que l’interdiction du harcèlement sexuel figure aussi dans le code du travail et dans le statut de la fonction publique.
Par conséquent, la question du harcèlement sexuel entretient des liens étroits avec des sujets qui sont au cœur des préoccupations de la commission des affaires sociales. Je pense à la qualité de la vie au travail, à la prévention des risques psychosociaux et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
La décision rendue par le Conseil constitutionnel, le 4 mai dernier, a conduit à l’abrogation de l’article du code pénal qui définissait, de manière trop imprécise, le délit de harcèlement sexuel. Il en résulte un vide juridique qui, comme vous l’avez dit, mesdames les ministres, laisse sans protection les victimes, parmi lesquelles figure une grande majorité de femmes. Il nous appartient, en tant que législateur, de remédier au plus vite à cette situation.
Le Sénat a apporté rapidement la preuve de sa détermination à agir.
Dès l’annonce de la décision du Conseil constitutionnel, un groupe de travail a été mis en place. Il a auditionné toutes les parties intéressées et les discussions menées en son sein ont permis de faire émerger de nombreux points d’accord concernant la nouvelle définition du harcèlement sexuel.
Dans le même temps, sept propositions de loi ont été déposées par des sénateurs et sénatrices siégeant sur différentes travées de notre assemblée, ce qui démontre, s’il en était besoin, que la lutte contre le harcèlement sexuel est un objectif qui transcende les clivages politiques.
Certains ont regretté que le Gouvernement n’ait pas laissé prospérer ces initiatives parlementaires et qu’il ait préféré déposer un projet de loi. Pour ma part, je vois surtout dans ce choix un signe de la volonté du Gouvernement de se mobiliser contre le harcèlement sexuel et je me réjouis, à cet égard, que deux ministres soient présentes aujourd’hui pour en soutenir la discussion.
Dès l’origine, le texte du Gouvernement tenait compte des réflexions qui ont été menées au Sénat ; il a été encore amélioré par les amendements adoptés par la commission des lois, de sorte que nous examinons aujourd’hui le fruit d’un véritable travail conjoint qui répond à nos préoccupations.
Le texte qui nous est soumis nous donne satisfaction pour plusieurs raisons.
Premier motif de satisfaction : comme cela a déjà été indiqué, le présent projet de loi parvient à concilier deux impératifs qui pouvaient paraître contradictoires au premier abord, non seulement une exigence de précision dans la définition des éléments constitutifs du délit, afin de satisfaire au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, mais aussi l’obligation de retenir une incrimination suffisamment large pour couvrir tous les cas de harcèlement sexuel.
Le harcèlement consiste, généralement, en une succession de gestes, de propos, de comportements, qui ne sont pas nécessairement très graves pris isolément, mais qui peuvent entraîner, du fait de leur répétition, des conséquences dramatiques sur la santé psychique de la victime ; parfois, il s’apparente davantage à un « chantage sexuel », par exemple quand un employeur menace une salariée de la licencier si elle refuse de céder à ses pressions.
Le projet de loi – c’est l’un de ses principaux mérites – permettra de réprimer ces deux types de harcèlement, puisqu’il retient une double définition du délit, comme Mme la garde des sceaux a déjà eu l’occasion de le rappeler.
Deuxième motif de satisfaction : le texte ne fait plus de la recherche de « faveurs » sexuelles l’objectif exclusif du harcèlement. Les auditions du groupe de travail ont montré que les victimes avaient souvent du mal à prouver que le harceleur poursuivait cette fin, ce qui explique que de nombreuses plaintes aient été classées sans suite ou aient abouti à une relaxe. L’abandon de cette condition devrait permettre aux victimes d’obtenir plus facilement justice. Il leur « suffira » de montrer que le harcèlement a porté atteinte à leur dignité ou a créé pour elles un environnement hostile, intimidant ou offensant pour que le délit soit constitué.
Troisième motif de satisfaction : le texte alourdit les peines encourues en cas de harcèlement sexuel. Jusqu’à ce jour, la sanction prévue était d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Il est proposé de la porter à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende, et même à trois ans de prison et à 45 000 euros d’amende en cas de circonstances aggravantes. Cette mesure, qui a une vertu pédagogique évidente, devrait exercer un effet dissuasif.
Quatrième motif de satisfaction : le projet de loi introduit dans le code pénal une disposition qui permettra désormais de réprimer les mesures discriminatoires dont peuvent faire l’objet les victimes de harcèlement sexuel. Ainsi, un employeur qui licencie une salariée ou qui refuse d’embaucher une candidate lors d’un recrutement parce qu’elle aurait résisté à ses avances pourra être sanctionné.
Permettez-moi, mesdames les ministres, mes chers collègues, de m’attarder un instant sur les articles qui portent sur le code du travail, sur le code du travail applicable à Mayotte et sur le statut de la fonction publique.
Je voudrais d’abord rappeler qu’il est indispensable de modifier le code du travail dans la mesure où, actuellement, il définit le harcèlement sexuel dans les mêmes termes que ceux qui ont été censurés par le Conseil constitutionnel.

Le code du travail renverra désormais à la définition et aux sanctions prévues par le code pénal, ce qui évitera, à l’avenir, tout risque de discordance.

Le projet de loi prévoit également de corriger une erreur intervenue lors de la recodification en 2008. Le code du travail prévoit qu’aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel.
Lors de la recodification, la sanction prévue pour réprimer ces faits discriminatoires a malencontreusement disparu. Il est proposé de la rétablir.
Il est également préconisé de compléter la liste des infractions que l’inspecteur du travail peut constater en y ajoutant le harcèlement sexuel et moral.
Je voudrais maintenant dire quelques mots à propos de Mayotte. Vous le savez, cette île est engagée dans un processus de départementalisation qui conduit à aligner progressivement les règles de droit social qui y sont applicables sur celles qui sont en vigueur en France métropolitaine. Le projet de loi s’inscrit dans cette perspective, puisqu’il propose que les articles relatifs au harcèlement sexuel qui figurent dans le code du travail soient insérés, à l’identique, dans le code du travail applicable à Mayotte.
Enfin, pour ce qui concerne la fonction publique, initialement, le texte du Gouvernement ne prévoyait pas d’adapter les dispositions relatives au harcèlement sexuel qui s’y appliquent. Les deux commissions saisies du présent projet de loi ont eu à cœur de corriger cette lacune en modifiant la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, afin d’y intégrer la nouvelle définition du harcèlement sexuel. Nous visons naturellement les trois fonctions publiques, la fonction publique d’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.
Comme je le disais tout à l’heure, la commission des lois a sensiblement amélioré le texte du Gouvernement. Elle a adopté plusieurs amendements présentés par son rapporteur, Alain Anziani, dont je veux, en cet instant, saluer le travail, et retenu la quasi-totalité des amendements proposés par la commission des affaires sociales saisie pour avis.
Outre des mesures de coordination, nous avons voulu insister sur l’importance de la prévention et de la détection du harcèlement sexuel.
La loi reconnaît aux délégués du personnel le pouvoir de saisir immédiatement l’employeur lorsqu’ils constatent une atteinte aux droits ou à la santé des salariés pouvant résulter de faits de discrimination. Nous avons souhaité indiquer explicitement que les délégués du personnel peuvent aussi saisir l’employeur en cas d’atteinte résultant de faits de harcèlement.
Dans le même esprit, nous avons voulu souligner que les services de santé au travail peuvent conseiller l’employeur en matière de prévention du harcèlement. Cette précision est cohérente avec les dispositions de l’accord interprofessionnel conclu par les partenaires sociaux en 2010, lequel a reconnu que les services de santé au travail sont des « acteurs privilégiés de la prévention du harcèlement et de la violence au travail », du fait de leur rôle d’information et de sensibilisation des salariés et des employeurs.
En revanche, il demeure un point sur lequel la commission des affaires sociales n’a pas été suivie par la commission des lois ; il concerne les circonstances aggravantes du harcèlement sexuel.
Les membres de la commission des affaires sociales auraient souhaité introduire la notion de vulnérabilité économique et sociale dans le code pénal, notion qui figure dans plusieurs propositions de loi sénatoriales.
La commission des lois n’a pas retenu notre proposition au motif que la notion de vulnérabilité économique et sociale serait trop subjective. Je comprends bien les objections qui ont été soulevées et je suis sensible à la nécessité que la loi pénale, qui est d’interprétation stricte, soit aussi précise que possible.
Néanmoins, la commission des affaires sociales a souhaité présenter un amendement en séance publique, afin que nous puissions en débattre et connaître la position du Gouvernement. Il nous semble en effet que la prise en compte des inégalités sociales dans le droit pénal est une question de fond qui mérite une discussion approfondie.

Enfin, je voudrais souligner que la lutte contre le harcèlement sexuel et, plus largement, contre les violences faites aux femmes appelle la mise en œuvre d’une politique globale, dont les mesures pénales que nous examinons aujourd'hui, certes importantes, ne sont que l’un des aspects.
L’une des premières mesures qui doivent être prises pourrait être la création d’un observatoire
Mmes Mireille Schurch et Brigitte Gonthier-Maurin opinent.

C’est d’ailleurs l’une des propositions que formule la délégation aux droits des femmes, proposition dont parlera certainement Mme Gonthier-Maurin et que notre commission soutient totalement.

Dans le monde du travail, un effort de formation et de sensibilisation doit être engagé de manière que les représentants du personnel, les délégués syndicaux, les médecins du travail, les personnels d’encadrement deviennent tous acteurs de la prévention et de la détection du harcèlement.
Enfin, cette politique globale doit comporter un volet consacré à l’accompagnement des victimes : accompagnement dans les procédures judiciaires, et il faut saluer ici le travail formidable accompli par les associations ; accompagnement psychologique également, ce qui suppose qu’un suivi soit assuré par des professionnels formés présents sur l’ensemble du territoire. Plusieurs membres de notre commission se sont notamment émus du sort réservé aux victimes qui se trouvent dépourvues de tout recours du fait de l’abrogation de la loi au moment où elles étaient engagées dans des procédures judiciaires.
Dans l’attente de la mise en œuvre de cette politique globale, l’urgence reste, bien sûr, mesdames les ministres – et je m’adresse particulièrement à Mme la ministre des droits des femmes –, de combler le vide juridique créé par la décision du Conseil constitutionnel.
C’est pourquoi la commission des affaires sociales invite le Sénat à approuver le projet de loi relatif au harcèlement sexuel, …

Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis. … qui permettra de réprimer efficacement ce délit, d’aider les victimes à faire valoir leurs droits et de dissuader, je l’espère, des harceleurs potentiels de passer à l’acte.
Très bien ! et applaudissements

La parole est à Mme la présidente de la délégation aux droits de femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, l’abrogation par le Conseil constitutionnel de la disposition pénale relative au délit de harcèlement sexuel a créé dans notre droit pénal un vide juridique choquant.
Ce vide, nous devons le combler au plus vite pour ne pas laisser sans protection des victimes de telles violences et pour ne pas envoyer un message d’impunité aux harceleurs.
La constitution d’un groupe de travail commun nous a permis, à travers un large programme d’auditions, de mieux prendre la mesure de la réalité du harcèlement sexuel comme des difficultés que pose sa répression et de dresser le cahier des charges d’une nouvelle définition du délit qui soit à la fois conforme aux exigences constitutionnelles de clarté de la loi et plus protectrice pour les victimes.
Nous pouvons en attendre une amélioration de la réponse pénale, mais la lutte contre le fléau social que constitue le harcèlement sexuel ne peut se limiter à son volet répressif. Aussi notre délégation insiste-t-elle également sur la nécessité d’une politique d’information et de prévention.
Parce que l’on a longtemps sous-estimé son impact sur les victimes, le harcèlement sexuel reste un phénomène peu étudié et sous-évalué. L’enquête nationale sur les violences envers les femmes réalisée en 2000 nous en a donné un premier aperçu, mais cette étude a maintenant plus de dix ans et des enquêtes ponctuelles, comme celle qui a été réalisée en 2007 en Seine-Saint-Denis, ont montré que les violences sexuelles étaient sans doute plus fréquentes encore qu’alors, en particulier dans le monde du travail.
Il est nécessaire de mieux appréhender la réalité de ce phénomène pour guider les actions de prévention et pour évaluer les politiques publiques.
C’est pourquoi nos deux premières recommandations portent respectivement sur la réalisation d’une nouvelle enquête sur les violences faites aux femmes en France et sur la création d’un observatoire national des violences envers les femmes.
Cet observatoire n’aurait pas seulement pour vocation de réaliser des études, mais pourrait également, à l’image de l’observatoire des violences de Seine-Saint-Denis, constituer une plateforme de collaboration entre les acteurs engagés dans la lutte contre les violences.
Il serait également le correspondant naturel des observatoires locaux.
Madame la ministre des droits des femmes, au cours de votre audition, le 26 juin dernier, vous nous avez fait part de l’accueil favorable que vous réserviez à titre personnel à ces deux recommandations. Peut-être pourrez-vous nous indiquer les engagements que le Gouvernement peut aujourd’hui prendre et à quelle échéance. C’est d’ailleurs l’objet de l’amendement que j’ai déposé.
Les comportements de harcèlement sexuel ne donnent lieu qu’à un faible nombre – de l’ordre du millier par an – de poursuites devant les tribunaux et à un nombre plus réduit encore – entre soixante-dix et quatre-vingts par an – de condamnations pénales.
En outre, le délit de harcèlement sexuel est souvent utilisé pour déqualifier, dès qu’elles surviennent dans la sphère professionnelle, des atteintes sexuelles plus graves.
Aussi, nous vous demandons, madame la garde des sceaux, et c’est notre troisième recommandation, de veiller à ce que le nouveau délit de harcèlement sexuel ne soit plus utilisé pour sanctionner des agissements qui relèvent, en réalité, d’incriminations pénales plus lourdes.

Nous recommandons la mise en place d’une politique plus systématique de dépistage et de prévention du harcèlement sexuel ainsi que de protection de ses victimes, à travers une meilleure implication des différents acteurs.
La médecine du travail doit pouvoir jouer un rôle plus actif dans la détection des situations de harcèlement sexuel et dans l’accompagnement de ses victimes. Ces deux aspects devraient figurer expressément parmi les missions qui sont assignées aux médecins du travail par l’article R. 4623-1 du code du travail.
Comme le confirment les enquêtes réalisées en Seine-Saint-Denis, c’est d’abord à leur médecin traitant que les victimes se confient le plus volontiers. C’est donc bien l’ensemble des professionnels de santé qu’il faut former à la détection des situations de harcèlement sexuel et à l’accompagnement des victimes.
Nous recommandons également aux organisations syndicales et aux délégués du personnel de s’impliquer pleinement dans la lutte contre le harcèlement sexuel.
Celui-ci, nous le savons, peut constituer une source importante de souffrance au travail, tout particulièrement pour les femmes ou pour des personnes harcelées du fait de leur identité ou orientation sexuelle, comme nous l’ont rappelé les organisations représentant les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres.
Les associations de défense des droits des femmes ont déjà la possibilité d’ester en justice dans les procès pénaux. Nous souhaitons qu’elles puissent, dorénavant, le faire aussi dans des procès civils et, en particulier, devant les juridictions prud’homales.
Les représentants des syndicats nous ont indiqué qu’ils ne souhaitaient pas conserver le « monopole » dont ils disposent actuellement. J’ai donc déposé un amendement en ce sens.
Nous souhaitons également que les employeurs publics – l’État, les collectivités territoriales – se sentent responsables de la lutte contre le harcèlement sexuel dans leurs administrations respectives.
Corollaire de cette responsabilité, il faut intégrer dans la formation initiale et continue des personnels d’encadrement des différentes fonctions publiques des modules d’enseignement qui leur permettent de détecter les situations de harcèlement sexuel et d’y répondre de façon adaptée.
Nous avons, en outre, adopté deux recommandations relatives à l’enseignement supérieur.
Elles font suite aux préoccupations exprimées par le CLASCHES, le collectif de lutte anti-sexiste contre le harcèlement sexuel dans l’enseignement supérieur, qui a attiré notre attention sur la faiblesse des recours dont disposent les étudiants et étudiantes, les doctorants et doctorantes. Étant considérés comme des usagers du service public, ils et elles ne bénéficient pas à ce titre de la protection statutaire assurée aux agents publics.
La future enquête sur les violences envers les femmes devra donc comporter un volet sur les atteintes sexuelles dans l’enseignement supérieur.
Il faudra aussi améliorer la protection des étudiants et doctorants à travers une réforme de la saisine et de la composition des sections disciplinaires des établissements, ainsi que de leurs procédures d’instruction.
Lorsque des faits d’une gravité manifeste seront avérés, les sanctions devront pouvoir être assorties d’une interdiction d’enseigner.
Le harcèlement sexuel est un phénomène également fréquent dans le monde sportif. Il s’agit alors d’agissements d’autant plus choquants qu’ils touchent souvent des enfants ou des adolescents, donc des victimes particulièrement vulnérables.
En 2008, le ministère des sports avait lancé, en partenariat avec le Comité national olympique et sportif français, un plan de lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles dans le sport. Il ne faut pas en rester là et, comme les autres mouvements associatifs ne sont pas exempts de ces comportements, un effort général de sensibilisation nous paraît nécessaire.
En ce domaine comme dans d’autres, une responsabilité particulière échoit au ministère de l’éducation nationale, car c’est très en amont, dès l’école, qu’il convient de lutter contre des stéréotypes de genre qui assurent la reproduction de la domination masculine et sont le terreau de violences envers les femmes.
Je passerai plus rapidement sur nos cinq recommandations « législatives », car nous aurons l’occasion d’y revenir dans le courant de la discussion des articles.
La délégation, d’une façon générale, apporte son soutien à un certain nombre de solutions rédactionnelles dégagées par le groupe de travail, aux réflexions duquel elle a, je dois le dire, activement et assidûment participé : la double référence, dans la définition du délit aux situations où le harcèlement sexuel renvoie à des actes répétés et aux situations où un seul acte grave, assimilable par exemple à une forme de chantage sexuel, suffit à le constituer ; la désignation des « menaces, intimidations, contraintes » comme éléments constitutifs du second volet du « harcèlement sexuel aggravé » ; la désignation de l’atteinte à la dignité comme élément intentionnel principal du délit aux côtés de la « recherche d’une relation sexuelle ».
Enfin, la délégation recommande de retenir comme circonstance aggravante du délit l’abus d’autorité, la minorité de la victime, son état de vulnérabilité et le fait que les agissements soient commis à plusieurs personnes.
S’agissant de l’état de vulnérabilité, nous souhaitons ajouter aux cas de figure prévus par le projet de loi et le texte de la commission, celui de la vulnérabilité sociale ou économique. Nous aurons l’occasion de discuter plusieurs amendements qui vont dans ce sens.
Dans un souci de clarté de la loi, nous recommandons pour finir un alignement des définitions figurant dans les différents codes et textes de référence, sans oublier bien entendu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le texte complété par la commission des lois va en partie dans ce sens.
Telles sont les recommandations que notre délégation a adoptées à l’unanimité.
Je souhaite que les dispositions que nous allons voter, mes chers collègues, et les politiques de prévention qui devront immanquablement les accompagner permettent de lutter plus efficacement contre des agissements qui constituent le premier palier dans le continuum des violences faites aux femmes. §

La parole est à M. le président de la commission des lois, qui, je tiens à le signaler, a joué un rôle éminent pour animer notre réflexion commune.

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, les victimes, d’abord les victimes, uniquement les victimes, voilà ce qui nous a guidés dès que nous avons appris ici, au Sénat, l’annulation de la loi en vigueur par la décision du Conseil constitutionnel. Le 4 mai dernier s’ouvrait en effet un vide juridique douloureusement perçu, vécu par les personnes – le plus souvent des femmes – qui avaient engagé des procédures judiciaires, parfois depuis quatre ans, et qui voyaient subitement tout le travail anéanti puisqu’il n’y avait plus de loi.
Sans doute – il ne nous appartient pas d’en juger – le Conseil constitutionnel a-t-il eu raison puisque la loi en vigueur était tautologique – le harcèlement sexuel était le harcèlement sexuel, disait-elle sans le définir –, mais l’effet est très différent de celui de sa décision précédente sur la garde à vue, laquelle nous laissait un délai.
En l’espèce, la décision avait un côté brutal quant à ses effets.
C'est pourquoi – fait étrange, sans précédent et qui ne se reproduira sans doute pas de sitôt – nous avons nous-mêmes demandé au Gouvernement de déclarer l’urgence, comme l’on disait autrefois, ou d’engager la procédure accélérée, comme l’on dit aujourd'hui – et je vous remercie l’une et l’autre, madame la garde des sceaux, madame la ministre des droits des femmes, d’avoir tout de suite accepté –, afin que ce vide juridique soit comblé le plus vite possible, c'est-à-dire afin qu’un nouveau texte de loi soit promulgué à la fin de ce mois de juillet. J’espère de tout cœur que nous y arriverons : nous le devons aux victimes !
Nous avons travaillé. Je remercie à mon tour Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, qui vient de s’exprimer, et Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales, car nous avons décidé ensemble de constituer ce groupe de travail qui s’est réuni pendant trois semaines.
J’ai lu ici ou là – soyons francs – que telle ou telle association considérait qu’elle n’avait pas été entendue. Nous avons écouté toutes les associations, avec beaucoup de soin et d’attention. Du reste, tant le texte de la commission que certains des amendements sur lesquels nous avons émis un avis ce matin portent véritablement la marque des demandes des associations. Nous avons écouté les organisations syndicales, y compris celles de la fonction publique ; nous avons reçu des représentants des magistrats, des avocats, des juristes, soit cinquante personnes au total. Il est rare que l’on organise autant d’auditions pour un texte qui tient en une page, mais c’était nécessaire : nous le devions aux victimes.
La tâche qui nous était impartie, mes chers collègues, était et demeure difficile. Je pourrais faire observer au Conseil constitutionnel, avec quelque humour – je pense que les membres du Conseil n’en manquent pas –, qu’il est plus facile de déclarer qu’un texte est inconstitutionnel que de libeller une définition correspondant à toutes les situations.
Nous avons donc travaillé, et nous sommes arrivés à une définition en deux alinéas.
Voici le premier alinéa du texte adopté par la commission la semaine dernière : « Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant. »
On peut critiquer cette définition, mais remarquez tout de même qu’elle a le mérite d’être extrêmement précise, comme cela nous était demandé. En effet, plus on est précis et plus on aide non seulement les victimes mais également les accusés, en garantissant les conditions d’un procès équitable.
Une autre question nous a été posée par tous, y compris par les associations. Par définition, le harcèlement implique une pluralité d’actes. Or, comme l’ont très bien dit à la fois Alain Anziani, rapporteur de la commission des lois, et Christiane Demontès, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, il existe de nombreux cas qui se caractérisent par ce que nous avons appelé – peut-être sommes-nous obnubilés par les questions européennes §– « l’acte unique », c'est-à-dire une seule occurrence d’un fait grave, traumatisant pour la personne visée, quand, par exemple, on subordonne explicitement l’embauche ou l’obtention d’un logement à la satisfaction d’une demande qui s’apparente à une contrainte. C’est inacceptable !
Nous avons donc rédigé un second alinéa pour prendre en compte cette deuxième catégorie de situations. On peut nous reprocher aujourd’hui de permettre ainsi la requalification éventuelle d’un viol ou d’une agression sexuelle en simple harcèlement sexuel. Mais faisons confiance à la sagacité des magistrats ! Je rappelle en outre que, si nous n’avions pas prévu cette autre disposition, nous n’aurions pas répondu à la demande des associations. En effet, celles-ci réclament que l’on sanctionne non seulement le harcèlement, qui se caractérise par une pluralité d’actes, mais également le chantage sexuel, qui, pour ne s’exercer qu’une seule fois, n’en est pas moins tout à fait inadmissible.
Voici donc le texte du second alinéa : « Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user d’ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir une relation de nature sexuelle, que celle-ci soit recherchée au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »
Le texte du Gouvernement, qui constituait, comme les sept propositions de loi rédigées par des sénateurs de toutes tendances, une excellente contribution, prévoyait une sanction pour chaque catégorie : une pour le harcèlement, acte répété, et une autre pour le chantage sexuel, acte unique. À la réflexion, et après avoir entendu les associations, nous avons estimé que cela ne convenait pas. En effet, il peut arriver qu’une pluralité d’actes soit moins grave qu’un acte unique insupportable – et vice versa. Par conséquent, il n’est pas souhaitable qu’il existe une sanction pour chaque catégorie : il faut que l’on puisse sanctionner les personnes qui se livrent au harcèlement ou exercent un chantage sexuel à la mesure de la gravité de leurs agissements.
Je le répète : c’est en dialoguant, en écoutant, en faisant des allers et retours entre les associations, les syndicats et les juristes, que nous sommes parvenus là où nous sommes. Il est donc impossible de soutenir que nous n’avons pas écouté les associations, les syndicats, les magistrats, les juristes ou encore nos concitoyens.
Que ce texte puisse encore être amélioré, c’est une évidence. C’est pourquoi nous avons aujourd'hui ce débat, et c’est pourquoi ce dernier se poursuivra dans le cadre de la navette, qui nous permettra d’intégrer les apports de l’Assemblée nationale et de travailler avec nos collègues députés lors de la commission mixte paritaire. Nous restons tout à fait ouverts au dialogue !

Je voudrais achever mon propos, monsieur Hyest, en insistant sur des questions de vocabulaire.

Notre collègue précisait simplement qu’il n’y aurait pas de navette, du fait de la procédure accélérée !

Écrire la loi est un acte d’une grande dignité, un acte qui nous rassemble aujourd’hui comme en beaucoup d’autres occasions. Or, madame la présidente, vous savez fort bien qu’un mot dans la loi peut changer la vie des gens.

Dès lors, il est tout à fait légitime de débattre de chaque amendement, comme nous nous préparons à le faire. Je le répète : il y a une grande dignité à écrire la loi. J’évoquerai donc trois mots inscrits dans le texte, ou qui en ont été ôtés, ou qui lui seront peut-être ajoutés.
Commençons par le mot « connotation » – le texte évoque les « actes à connotation sexuelle ». J’appelle votre attention, comme je l’ai fait à plusieurs reprises en commission, sur le fait que la « connotation » s’oppose à la « dénotation » : cette dernière définit strictement une chose, tandis que la première désigne ce qui est autour, une sorte de halo. Par conséquent, si l’on décide de parler d’« actes à connotation sexuelle », il faut bien préciser – c'est la raison pour laquelle je le fais à cette tribune – que, contrairement à l’usage courant du terme, la « connotation » inclut ici la « dénotation ». §En effet, nous ne serions pas aussi précis que nécessaire si nous nous contentions d’écrire que sont seuls punissables les « actes à connotation sexuelle », au sens du halo dont j’ai parlé, monsieur de Raincourt.
Sourires.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Je le sais bien, cher collègue, mais cela ne m’empêche pas de saluer en cet instant votre présence dans l’hémicycle.
Nouveaux sourires.

J’en viens au mot « agissements ». Nous n’avons pas établi le texte ce matin, madame Demontès : nous l’avons fait la semaine dernière.

Ce matin, nous avons donné l’avis de la commission des lois sur les amendements qui nous étaient soumis. Comme l’a souligné M. Anziani, notre commission a émis un avis favorable sur l’amendement prévoyant de substituer le mot « agissements » au mot « comportements ».
Le choix n’est pas neutre. Beaucoup de magistrats, d’avocats, de praticiens du droit nous ont dit qu’il était très difficile de sanctionner des intentions. Or le terme « agissements » a un caractère plus concret que le terme « comportements », il implique davantage une volonté de la personne. C'est pourquoi ce mot nous paraît plus approprié. Cependant, dans cet hémicycle comme avec tous nos interlocuteurs, nous restons prêts à discuter.
Enfin, l’emploi du mot « environnement » suscite un vrai débat. Ce matin, la commission des lois a choisi de donner son accord à un amendement prévoyant de lui substituer le mot « situation ». Il y a des arguments dans les deux sens : en faveur du terme « environnement », on peut rappeler qu’il est utilisé par les directives européennes définissant la notion de harcèlement sexuel, et qu’il figure également dans le code pénal.

Peut-être ai-je été imprécis, monsieur Hyest. Disons simplement que ce terme figure dans la loi.

Certes, mais je ne suis pas certain que ses titulaires entendent ce mot dans le sens qui lui est donné par le texte de la commission…

Monsieur Hyest, je comprends tout à fait le raisonnement – je peux même dire que, à titre personnel, je le partage – qui vous a conduit à soutenir que l’on devait préférer le terme « situation » au terme « environnement » dans la mesure où le premier a un caractère plus concret que le second et où il s’agit bien, lors du procès, de prouver la réalité de faits allégués. Si nous décidons d’incriminer de manière vague la création d’un « environnement », il est à craindre que les sanctions attendues par les victimes ne soient jamais prononcées. C'est pourquoi il est peut-être – j’insiste sur ce mot, car nous ne sommes pas bardés de certitudes – plus protecteur et plus efficace d’employer le terme « situation ».
J’ai voulu vous dire la réalité de nos échanges, parce que ces débats sont nobles, parce que nul n’est détenteur d’une vérité absolue et parce que nous voulons continuer à dialoguer. Nous n’avons que deux soucis : d'une part, que le vide juridique soit comblé le plus vite possible, par respect pour les victimes ; d'autre part, que nous trouvions les meilleures formulations possibles, toujours par respect pour les victimes mais aussi au nom d’un principe fondamental de notre droit, celui du procès équitable, auquel nous sommes tous attachés. Je sais que vous l’êtes également, mesdames les ministres, et mon dernier mot sera d'ailleurs pour vous, puisque c’est la première fois que nous dialoguons ensemble dans cet hémicycle : nous souhaitons vraiment continuer à travailler avec vous de manière aussi constructive que nous avons pu le faire ces dernières semaines, car de nombreux textes nous attendent.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du groupe écologiste et du RDSE.

Madame la présidente, mesdames les ministres, monsieur le président de la commission des lois, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, madame le rapporteur, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes tous, ici, convaincus de la nécessité de voter, sans délai, le projet de loi discuté aujourd’hui pour combler le vide juridique créé avec la censure, par le Conseil constitutionnel en vertu de sa décision du 4 mai 2012 consécutive à une question prioritaire de constitutionnalité, de l’article 222-33 du code pénal définissant le délit de harcèlement sexuel.
Pour illustrer, s’il est nécessaire, l’urgence d’un tel vote, permettez-moi d’évoquer un cas récent, à mes yeux tristement exemplaire, cela pour insuffler à l’étude de cette loi un peu d’humain !
Je vous lirai ainsi la lettre que j’ai reçue voilà quelques jours d’une jeune collègue universitaire. Je veillerai, bien sûr, à préserver rigoureusement ici l’anonymat de tous les acteurs impliqués.
Voici donc l’essentiel de ce courrier.
« Il y a déjà presque sept ans, entre novembre 2005 et avril 2006, j’ai été victime de harcèlement et d’agressions sexuelles. Agrégée [...] doctorante, j’étais alors allocataire-monitrice à l’université “A” » – c’est ainsi que je désignerai l’université où elle se trouvait – « et mon agresseur était maître de conférences dans ce même établissement.
« Au bout de plusieurs semaines d’un calvaire quotidien, j’ai trouvé la force de parler à quelques-uns de mes collègues allocataires qui m’ont aidée à me rendre au commissariat afin d’y déposer une main courante. S’est alors engagée une très longue procédure qui n’est pas encore totalement achevée. À la suite du dépôt de ma main courante, le procureur de la République, frappé par la gravité des faits que j’avais relatés, a ordonné une enquête. Les services de police, eux-mêmes convaincus par les résultats de leurs investigations, m’ont incitée à me porter partie civile, ce que j’ai fait en juin 2007 par le truchement de mon avocate. Mon agresseur a d’abord été placé sous contrôle judiciaire, puis mis en examen à l’automne 2007 pour harcèlement sexuel et agressions sexuelles par personne ayant autorité.
« Au cours de l’instruction, conduite par le doyen des juges d’instruction du tribunal correctionnel de Paris, mon agresseur a multiplié les manœuvres dilatoires, afin de ralentir, voire de bloquer la procédure en cours.
« Ces nombreuses péripéties expliquent que ce n’est qu’en mai 2010 que le juge d’instruction a pu rendre sa décision et demander le renvoi de mon agresseur devant le tribunal correctionnel de Paris pour harcèlement en vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelle et pour agression sexuelle, le tout par personne ayant autorité.
« [En] novembre 2010 s’est tenu le procès devant le tribunal correctionnel de Paris, qui a reconnu mon agresseur coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à une peine de dix-huit mois de prison avec sursis. Jugé particulièrement dangereux par le tribunal, son inscription sur le fichier Europol des délinquants sexuels a en outre été ordonnée.
« Mon agresseur a alors fait appel et un second procès s’est tenu [en] février 2012, après qu’il eut réussi à faire reporter une première audience en essayant de faire annuler la procédure au motif de questions prioritaires de constitutionnalité. [En] avril 2012, la cour d’appel de Paris a rendu sa décision, réduisant la peine de mon agresseur, mais lui infligeant une condamnation pour harcèlement moral et sexuel par personne ayant autorité et prononçant une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis.
« Malheureusement pour moi, la décision récente du Conseil constitutionnel relative au harcèlement sexuel me prive du bénéfice de toutes ces années d’effort et de souffrance pour faire reconnaître par la justice la réalité du harcèlement que j’ai subi.
« En parallèle à cette procédure judiciaire s’est déroulée une procédure disciplinaire. La commission de discipline de l’université “A” a d’abord infligé un blâme à mon agresseur, puis le CNESER disciplinaire » - le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire – « a confirmé cette sanction. Mais mon agresseur a réussi à faire annuler cette décision par le Conseil d’État pour vice de forme.
« Très récemment, [en] juin 2012, le CNESER disciplinaire en formation de jugement s’est à nouveau réuni. Au mépris des décisions judiciaires, qu’il a estimé pouvoir ignorer en raison de la décision récente du Conseil constitutionnel relative au harcèlement sexuel, il a décidé de relaxer mon agresseur.
« Je conteste avec d’autant plus de vigueur la décision prise par le CNESER disciplinaire qu’elle intervient dans des conditions dont la légalité semble plus que douteuse. En effet, l’un des dix membres de la formation disciplinaire est maître de conférences [...] à l’université “B” et il appartient par conséquent à la même faculté que les deux avocats de mon agresseur, également maîtres de conférences [...] à l’université “B”. En outre, c’est également à l’université “B” que le père de mon agresseur exerçait en qualité de professeur [...] jusqu’à sa retraite très récente. Un autre membre du CNESER disciplinaire, professeur [...] à cette même université “B”, est secrétaire général du syndicat “Y”, alors que le père de mon agresseur est toujours secrétaire de la section de l’université “B” de ce même syndicat.
« De toute évidence, il y avait conflit d’intérêt et ces deux membres du CNESER n’auraient dû pouvoir siéger lors de cette session disciplinaire.
« N’étant que témoin dans cette procédure disciplinaire – ce qui est, soit dit en passant, un statut intenable pour une victime qui n’a pas droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat –, je ne suis pas habilitée à déposer un recours. »
Ce récit dit tout : la souffrance de la victime, le calvaire qu’est son parcours judiciaire, mais aussi les terribles dégâts causés par le vide juridique que nous devons combler aujourd’hui ensemble.
Voilà quelques jours, au téléphone, l’intéressée m’a d’ailleurs avoué qu’aujourd’hui, mise dans la même situation, elle renoncerait à porter plainte, sachant à quelles douloureuses tribulations condamne une telle démarche. On comprend très bien pourquoi il y a si peu de plaignantes et pourquoi, dans ces conditions, le nombre relativement très faible des plaintes effectivement déposées est, de toute évidence, sans commune mesure avec le nombre probable des victimes réelles.
Au fil des dernières semaines, ministres et sénateurs de toutes sensibilités ont collaboré d’une manière exemplaire, dans le cadre d’un dialogue exigeant avec la société civile et avec les professionnels appelés à faire face à ce type de délit ; nous pouvons nous en féliciter !
Mais le courrier que je viens de vous lire souligne aussi le possible décalage entre les jugements rendus par nos tribunaux et les décisions prises par certaines instances disciplinaires internes. Lors de son intervention, Mme la ministre a évoqué ce point.
La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires protège les fonctionnaires ainsi que les agents non titulaires de droit public contre le harcèlement sexuel. Tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à des agissements de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire, indépendante – je le souligne – d’une éventuelle sanction publique.
Toutefois, dans le cas que j’ai cité, le vide juridique a permis à l’instance disciplinaire de blanchir l’accusé en toute « bonne conscience corporatiste » et de lui éviter tout « accroc » de carrière. En général, il ne reste pas grand choix de métier à un universitaire qui est renvoyé de l’Université !
Comment faire coïncider la décision de l’instance disciplinaire avec le jugement des tribunaux, sans pour autant l’en faire dépendre ? Là est peut-être la vraie question. Comment permettre à la victime de ne pas « être seulement témoin », mais d’être aussi assistée par un avocat ? Ces questions sont délicates et notre projet de loi n’y répond pas.
Au-delà de la loi, nous devons songer à un travail de sensibilisation au délit de harcèlement sexuel, travail qui devra être fait dans la société comme auprès de nos administrations. Sur ce point, nous sommes également toutes et tous d’accord.
Dans ce dernier cas, une circulaire serait certainement bienvenue, qui poserait les conditions indispensables à une neutralité et à une équité réelles, prévenant les possibles conflits d’intérêt et rendant impossibles toute connivence ou toute complaisance, au sein des instances disciplinaires internes, « entre collègues de même rang ». On pourrait peut-être ainsi recommander la présence, au sein de ces instances disciplinaires, d’un quota de membres venus d’administrations autres que l’administration dont la personne jugée est issue.
Le projet de loi, dont la rédaction doit manifestement beaucoup aux propositions de loi déposées préalablement par les sénatrices et les sénateurs, définit le harcèlement sexuel avec une clarté et une précision telles qu’il devrait être à l’abri d’une censure du Conseil constitutionnel, en tout cas je l’espère ! Cette clarté et cette précision nous prémunissent, en outre, contre des dérives toujours possibles.
La première dérive serait que des conflits avec l’employeur soient abusivement qualifiés de harcèlement sexuel par l’employé(e) ou par ses représentants.
Une deuxième dérive serait que l’atmosphère dans les entreprises ou les administrations ne devienne irrespirable dès lors que chaque regard, chaque geste amical ou affectueux pourrait être considéré comme relevant du harcèlement sexuel. Connaissant bien les universités nord-américaines, ces temples du « politiquement correct », je sais à quels comportements caricaturaux et à quelle aseptisation étrange de la vie sociale peuvent conduire de tels excès !
Enfin, troisième dérive possible, si le harcèlement sexuel touche très majoritairement les femmes, nous ne devons pas oublier qu’il touche également les hommes et que, s’il touche les personnes hétérosexuelles, il touche aussi les personnes homosexuelles ainsi que, de manière particulière, les transsexuels ou transgenres durant leur transition. Or aucune « monopolisation » féminine et/ou hétérosexuelle du délit de harcèlement ne doit priver les autres victimes potentielles du bénéfice de la protection de la loi.
Le groupe écologiste a déposé quelques amendements visant à renforcer, de ces divers points de vue, la précision d’un texte que, dans son ensemble, il approuve et qu’il votera.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, le 4 mai dernier, une centaine de procédures concernant le harcèlement sexuel, et probablement beaucoup plus encore, ont été anéanties par la décision du Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, présentée par un harceleur dont on aurait pu attendre une conduite exemplaire.
Ancien député, ancien secrétaire d’État, adjoint au maire de sa commune, cet homme a été accusé de harcèlement sexuel par trois employées de la mairie, toutes trois vivant seules avec des enfants. Il a été condamné en première instance et, plus sévèrement, en appel. C’est à l’occasion de son pourvoi en cassation qu’il a saisi le Conseil constitutionnel.
Ses avocats ont estimé que, en ne définissant pas clairement le harcèlement sexuel, l’article 222-33 du code pénal laissait libre cours, selon les termes employés par l’un d’eux, à « tous les débordements et toutes les interprétations ».
La chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis ladite QPC au Conseil constitutionnel, lequel a effectivement considéré que la disposition contestée méconnaissait le principe de légalité des délits et des peines, ainsi que les principes de clarté, de précision, de prévisibilité et de sécurité de la loi, et devait être déclarée contraire à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a décidé que l’abrogation du texte d’incrimination prenait effet immédiatement. Les conséquences d’une telle décision, madame la garde des sceaux, madame la ministre, sont très graves.
Premièrement, le harcèlement sexuel tel qu’il était défini par l’ancien article 222-33 du code pénal est désormais pénalement licite, jusqu’à ce que nous le rendions de nouveau illicite, sauf à requalifier les faits en harcèlement moral, agressions sexuelles ou menaces.
Tel fut d’ailleurs l’objet de la circulaire de la Chancellerie du 10 mai 2012, à l’attention des magistrats du parquet. Celle-ci demandait en effet aux procureurs de contourner l’obstacle de cette abrogation en étudiant toute possibilité d’une requalification juridique des faits.
Deuxièmement, l’action publique, qu’elle ait été ou non engagée, est éteinte pour les infractions d’ores et déjà commises. Le harceleur, en l’espèce, se retrouve totalement blanchi. La presse locale évoque son retour triomphant au conseil municipal, en tant que simple conseiller, le maire lui ayant retiré sa délégation d’adjoint.
Troisièmement, conformément à l’article 112-4, alinéa 2, du code pénal, les personnes irrévocablement condamnées n’ont plus à exécuter leurs peines.
Je rejoins les associations de défense des droits des femmes et une partie de la doctrine, qui estiment que des conséquences aussi radicales ne s’imposaient pas au Conseil constitutionnel. Ce dernier avait en effet la possibilité de reporter dans le temps la prise d’effet de l’abrogation de l’article 222-33 du code pénal.

L’article censuré aurait pu continuer à s’appliquer, sans risque d’inconstitutionnalité, aux faits pour lesquels n’existait aucune ambiguïté !

Surtout, le Conseil constitutionnel a déjà, par le passé, retenu ou suspendu les effets d’une déclaration d’inconstitutionnalité pour des motifs eux-mêmes constitutionnels, en raison des conséquences qui auraient résulté de la censure ou afin de permettre au législateur de remédier lui-même à l’inconstitutionnalité.
Dans sa décision du 30 juillet 2010, à la suite de vingt-six questions prioritaires de constitutionnalité sur les règles applicables à la garde à vue, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er juillet 2011, soit près d’un plus tard, les effets de l’abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution, laissant ainsi au Parlement le temps de corriger le texte incriminé.

Je reprends les commentaires de cette décision, publiés dans Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel : « Le Conseil constitutionnel a estimé que l’application immédiate de l’abrogation des articles encadrant le recours à la garde à vue aurait des conséquences manifestement excessives au regard des objectifs de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infraction. En effet, la garde à vue n’aurait plus de support légal et toutes les poursuites subséquentes à une mesure de garde à vue seraient mises en péril. Sur ce point, le report dans le temps de l’abrogation est fondé sur des considérations analogues à celles qui avaient conduit le Conseil Constitutionnel, pour la première fois, à reporter les effets d’une déclaration d’inconstitutionnalité dans le cadre du contrôle a priori de la loi sur les OGM. »
En d’autres termes, la loi sur les OGM serait plus importante que celle qui concerne le harcèlement sexuel !

Aux termes de sa décision du 19 juin 2008, le Conseil constitutionnel avait en effet fixé la date d’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité, afin d’éviter « des conséquences manifestement excessives ».
Ainsi, en matière de harcèlement sexuel, le Conseil constitutionnel aurait pu éviter les conséquences graves et manifestement excessives de l’abrogation immédiate de l’article contesté.
Je n’ose imaginer que les membres de cette haute institution, majoritairement des hommes, aient pu inconsciemment considérer que leur décision était sans conséquence.
Je n’ose imaginer que cette décision ait été le reflet d’une opinion, largement partagée, selon laquelle le harcèlement sexuel, finalement, ce ne serait pas si grave.
Je n’ose imaginer qu’ils se soient dit inconsciemment : « Certes, le harcèlement sexuel, c’est agaçant, mais enfin il n’y a pas mort d’homme ! »
Non vraiment, je n’ose imaginer tout cela ! Pourtant, s’il n’y a pas mort d’hommes, qui sait s’il n’y a pas ou s’il n’y aura pas mort de femmes, qui se suicideront par désespoir de n’avoir pas été entendues et respectées dans leur douleur !

J’imagine le désarroi, la frustration, de ces trois femmes victimes du harceleur auteur de la QPC, qui ont osé porter plainte, qui ont pris des risques pour leur avenir, qui ont été humiliées par ses dénégations et qui ont souvent dépensé beaucoup d’argent. Elles vont se retrouver confrontées, même si ce n’est qu’au détour d’un couloir, à celui qui leur a, pendant des mois, « pourri la vie ».
Fonctionnaires territoriales, élevant seules leurs enfants, ces victimes n’ont guère la possibilité de changer de poste, car la commune n’est pas très grande. Et changer de lieu de travail reviendrait à changer de ville.
Leur cas illustre bien la situation particulièrement délicate des victimes et justifie mon soutien à l’amendement de notre rapporteur pour avis, Mme Christiane Demontès, sur la vulnérabilité « économique et sociale ».

Madame la garde des sceaux, j’ai compris que vous ne pouviez rien faire pour que justice soit rendue aux victimes de cette QPC, mais qu’envisagez-vous pour celles qui, ayant dépensé beaucoup d’argent pour se défendre, n’ont aucun espoir de recevoir des dommages et intérêts ?
Je reviens sur le projet de loi que vous nous présentez. Je ne m’attarderai pas sur le fond, les précédents orateurs l’ont fait. Le texte est le reflet des différentes propositions de loi que nos collègues et moi-même avons déposées et je le voterai sans états d’âme.
Je soulignerai quelques points qui me semblent essentiels et positifs.
Il s’agit d’abord de la suppression de la pluralité des définitions : le harcèlement sexuel sera désormais défini dans le seul code pénal, le code du travail renvoyant à la définition pénale.
Il en est de même des sanctions pénales du harcèlement sexuel, puisque celles-ci ne sont envisagées que dans le seul code pénal, exception faite toutefois des actes discriminatoires résultant du harcèlement sexuel.
Enfin, une définition plus précise et distinguant deux niveaux de gravité des faits me semble tout à fait satisfaisante.
J’ai déposé cinq amendements et souhaite insister, mais sans grande illusion, sur deux d’entre eux.
Le premier amendement concerne les faits de harcèlement sexuel commis sur des mineurs de quinze ans. Même si j’ai bien entendu l’ensemble des arguments qui plaident contre l’adoption de cet amendement, je propose de supprimer la précision « de quinze ans ». Je considère en effet que la majorité sexuelle n’a rien à voir ici, puisqu’il n’y a pas, à proprement parler, passage à l’acte, comme c’est le cas dans le cadre d’une agression sexuelle ou d’un viol.
Il me semble que c’est jusqu’à dix-huit ans que les circonstances aggravantes devraient s’appliquer. Cela permettrait à de très jeunes stagiaires, élèves, sportifs ou apprentis d’être mieux protégés contre des agissements qu’ils ont d’autant plus de mal à dénoncer qu’ils sont jeunes.
Le second amendement n’est pas moins important : il porte sur le délai de prescription de l’action publique en matière de harcèlement sexuel et d’agressions sexuelles aggravées. C’est un sujet incontournable en matière de violences sexuelles, et je souhaite toujours faire évoluer notre droit sur ce point. Il ne sert à rien d’avoir des incriminations clairement et précisément définies, si les victimes, dans les faits, ne peuvent porter plainte !
Pour dénoncer leur harceleur ou leur agresseur, les victimes, nous le savons tous dans cette assemblée, doivent être physiquement, psychologiquement ou matériellement en état de le faire.
J’ai déposé en octobre 2011 une proposition de loi tendant à allonger le délai de prescription de l’action publique des agressions sexuelles autres que le viol. Elle a été rejetée, principalement au motif qu’elle bouleversait la classification établie par le code pénal des infractions sexuelles, de leurs incriminations et de leurs sanctions, ce que j’ai très bien compris. Ainsi, à la souffrance des victimes, on oppose le respect de la cohérence du dispositif du code pénal !
Cela dit, lors de l’examen en séance publique de ma proposition de loi, plusieurs sénateurs de la majorité actuelle partageaient mon avis.
Notre collègue Catherine Génisson avait alors déclaré : « Outre les arguments d’ordre psychologique avancés par Mme Dini, on peut aussi mettre en avant l’impossibilité pour une victime de déposer plainte et de se reconstruire avant qu’elle n’ait obtenu sa mutation quand l’agression s’est produite en milieu professionnel. »
Je me permets également de reprendre les propos de notre collègue Jean-Pierre Godefroy : « Trois ans, c’est court aussi pour les violences commises dans le milieu professionnel. Tant que la victime d’une agression ou de harcèlement sexuels sur son lieu de travail n’a pas réussi à trouver un autre emploi – et Dieu sait si c’est difficile aujourd’hui – ou obtenu une mutation, la peur de porter plainte peut l’emporter, car elle craint de perdre son travail, elle redoute des agressions encore plus violentes, qui pourraient devenir moralement insupportables. »
Ces propos ont mûri ma réflexion et fondent aujourd’hui cet amendement. Je propose en effet que le délai de prescription de l’action publique des agressions sexuelles aggravées et du harcèlement sexuel commis dans le cadre des relations de travail ne coure qu’à compter du jour où la victime n’est plus en relation avec son agresseur ou son harceleur.
Enfin, je parlerai de la prévention, que vous avez vous-mêmes évoquée, madame la garde des sceaux, madame la ministre. On sait que les violences verbales ou physiques plus particulièrement dirigées vers les filles débutent très tôt, dans la famille quand on donne aux fils une autorité sur leurs sœurs, à l’école quand on n’explique pas aux enfants que l’on ne s’attaque pas aux plus faibles.
J’en suis persuadée, c’est dès l’école maternelle qu’il faut être attentif à ces comportements.

Je l’indiquais déjà en 2005, lors de l’examen de deux propositions de loi relatives à la lutte contre les violences au sein du couple.
Il faut rappeler aux garçons qu’une fille est leur égale, qu’elle peut penser et vivre sa vie comme eux et qu’ils n’ont aucun droit sur elle, pas plus que sur tout autre être humain.
Une sensibilisation constante au respect de la différence sexuelle, comme de toute autre différence, est capitale, et ce dès la petite enfance.
Comment envisagez-vous, madame la garde des sceaux, madame la ministre, de mettre en place une prévention efficace sur toute la durée des années scolaires ?
L’ensemble de mon propos ne remet pas en cause mon adhésion au projet de loi et je me réjouis que le Gouvernement ait réagi rapidement face à ce vide juridique.
Mes amendements ont pour objet de protéger encore mieux les victimes, en particulier les plus jeunes. Mon souhait est que celles-ci osent se manifester et que leurs harceleurs soient punis. Certains d’entre eux, il faut bien l’admettre, sont totalement inconscients du fait qu’ils commettent un délit. Cette loi devrait leur permettre d’en prendre conscience et, pour certains, de renoncer à un comportement intolérable.
Le groupe de l’Union centriste et républicaine, auquel j’appartiens, soutiendra donc ce texte.
Applaudissements.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, je laisserai à mon collègue Christian Bourquin le soin d’évoquer spécifiquement la question du droit des femmes que soulève le texte qui nous est aujourd’hui soumis.
Je me bornerai, pour ma part, à évoquer plus particulièrement son article 1er, sous l’angle juridique.
En apparence, le harcèlement sexuel ne concerne quantitativement que peu de cas, cela a été dit, avec 70 à 85 condamnations annuelles au cours de ces dernières années. Pourtant, ces statistiques cachent mal le nombre important de drames clandestins qui échappent aux tribunaux, lorsque les victimes n’osent pas déposer plainte par peur des conséquences qu’elles auraient à subir.
S’il appartient au Parlement, en tant que garant de l’intérêt général, de répondre à la souffrance de nos concitoyens, il lui appartient tout autant d’agir de façon responsable, c’est-à-dire en produisant une règle de droit juste, précise, lisible et applicable.
Sur ce point, la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai dernier déclarant non conforme à la Constitution l’article 222–33 du code pénal n’a donc pas pu nous surprendre : les éléments constitutifs du délit de harcèlement sexuel posés depuis 2002 n’étaient, de toute évidence, pas suffisamment clairs et ouvraient la voie à un risque d’arbitraire.
Or le principe de légalité des délits et des peines commande, en droit pénal, la règle intangible selon laquelle toute infraction doit être clairement définie, son interprétation étant stricte.
Il était, par conséquent, peu concevable que le harcèlement sexuel ne fût défini que par sa seule finalité, l’obtention de faveurs sexuelles.
On peut sans doute regretter que le Conseil constitutionnel n’ait pas modulé dans le temps les effets de sa décision, comme il l’avait fait pour la garde à vue. Mais c’est dans le cadre qu’il a strictement tracé que nous devons opérer aujourd’hui pour réparer une malfaçon législative que, dès 2002, la doctrine dénonçait.
Je tiens à saluer la promptitude avec laquelle le Sénat a réagi, et, plus particulièrement, la commission des lois, son président, Jean-Pierre Sueur, la commission des affaires sociales et la délégation aux droits des femmes. Il faut encore souligner les sept propositions de loi déposées sur le même sujet.
Le travail mené depuis lors est à l’honneur de notre Haute Assemblée, compte tenu de l’urgence qu’il y avait à combler le vide juridique ainsi créé.
Je sais aussi, madame la garde des sceaux, que la Chancellerie a donné instruction aux parquets de requalifier les actes poursuivis lorsque cela était possible. Mais, dans le cas contraire, la nullité des poursuites s’impose, hélas, ce qu’illustre, par exemple, la décision de classement sans suite d’une affaire de harcèlement concernant la RATP, prononcée par le parquet de Paris le 29 juin dernier.
Le projet de loi dont nous sommes saisis remet en quelque sorte les choses dans l’ordre dont elles n’auraient jamais dû dévier en 2002.
Néanmoins, autant le dire d’emblée, madame la garde des sceaux, la rédaction initiale de ce texte ne nous convenait pas du tout. Quand bien même vous n’avez pas repris le verbatim de la définition posée par la directive du 23 septembre 2002, il nous semblait incohérent et, pour tout dire, inopérant, d’introduire une hiérarchie entre les faits de harcèlement dit « simple » et ceux qui relèvent du harcèlement aggravé, encore appelé « chantage sexuel ».
À notre sens, la répétition d’actes « moins graves » peut tout autant, si ce n’est davantage, conduire à créer un « environnement intimidant, hostile ou offensant » que la commission d’un acte unique.
Il doit revenir, dans tous les cas, au juge d’apprécier la gravité des faits et, surtout, de les replacer dans leur contexte particulier. Il est heureux que la commission des lois ait préféré mettre fin à cette distinction hasardeuse.
Toutefois, si l’on poursuit la réflexion, on peut encore s’interroger sur le fait de savoir s’il n’aurait pas été plus judicieux de créer un délit spécifique et autonome de chantage sexuel.
Je comprends les raisons qui ont poussé la commission à opter pour cette rédaction, à savoir couvrir, dans la mesure du possible, les multiples hypothèses dans lesquelles une personne peut exercer une contrainte ou une pression pour obtenir des relations sexuelles, mais cette rédaction paraît encore poser quelques problèmes.
Tout d’abord, la notion même de « délit assimilé » nous paraît quelque peu hétérodoxe au regard des principes du code pénal.
Ensuite, le harcèlement se définissant par une répétition d’actes, on peut se demander s’il est vraiment utile de réduire ce harcèlement aggravé à un acte unique, si grave soit-il.
Enfin, demeure le problème de la preuve de l’intention d’obtenir une relation sexuelle, que celle-ci soit réelle ou simplement apparente.
Il faut s’interroger pour savoir, madame le garde des sceaux, s’il n’existe pas un risque que ce nouveau délit n’entraîne la déqualification des tentatives d’agression sexuelle, punies plus sévèrement. Toutefois, je note que le rapporteur, Alain Anziani, a déjà, avec brio, tenté d’apporter une réponse à cette question qui demeure malgré tout légitime.
Je vous rappelle en effet que l’article 222–22 du code pénal définit l’agression sexuelle comme « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». L’article 1er du projet de loi évoque quant à lui des « menaces » ou des « contraintes ».
Dans la mesure où les éléments constitutifs de ces deux infractions sont très proches, n’est-il pas à craindre un glissement malheureux vers l’infraction la moins punie, en raison d’une certaine confusion ?
Toujours s’agissant de l’article 1er, je regrette également que les sanctions prévues ne correspondent pas nécessairement à la hiérarchie des peines que pose le code pénal.
Cependant, la définition des circonstances aggravantes du harcèlement constitue tout de même une avancée majeure.
L’alourdissement des peines à raison de l’abus d’autorité, de la minorité ou de la vulnérabilité de la victime ou encore de la commission de l’infraction en groupe se justifie pleinement et s’inscrit en cohérence avec l’objectif de mettre fin à l’impunité qui fonde ce texte.
J’attire au surplus votre attention sur le fait que la question du harcèlement moral, défini à l’article 222–33–2 du code pénal, pourrait bientôt occuper l’actualité. La Cour de cassation devra en effet se prononcer prochainement sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité dont les arguments sont assez proches de ceux qui ont été soulevés s’agissant du harcèlement sexuel.
Pour conclure, je vous indique, madame le garde des sceaux, que le groupe RDSE s’associera bien entendu à ce texte et le votera.
Applaudissements.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi et les sept propositions de loi déposées concomitamment par certains d’entre nous visant à réprimer le harcèlement sexuel attestent l’urgence et l’importance de ce débat, engagé voilà quelques semaines - nous devons donc aller vite. Au-delà, il est aussi porteur de leçons sur notre façon de légiférer.
Tout d’abord, première leçon, la vacance législative – la décision du Conseil constitutionnel est intervenue le 4 mai – a suscité le dépôt de plusieurs propositions de loi – tant mieux ! – et a sans doute facilité l’organisation par le groupe de travail ad hoc de nombreuses auditions. Nous avons le temps, au Sénat…
Cette décision aurait été prise au mois de décembre, nous aurions sans doute pu, dans un délai de quinze jours ou de trois semaines, surmonter les conséquences de la suppression de cette incrimination.
Bien sûr, on ne peut que se féliciter de l’approfondissement de la réflexion commune qu’ont permis ces contributions. En tout état de cause, monsieur le président de la commission des lois, je rappelle que nous débattons désormais du texte de la commission des lois, saisie au fond. Vous conviendrez que c’est un apport considérable de la révision constitutionnelle de 2008.
Sourires.
Mêmes mouvements.

Deuxième leçon : la notion de harcèlement sexuel a évolué. Initialement envisagé dans le cadre professionnel en 1992, ce délit a fini, en 2002, par s’appliquer à toutes les situations. On a ainsi abouti à une tautologie. C’est ce qu’a censuré le Conseil constitutionnel. À cet égard, je vous renvoie à l’excellent rapport d’Alain Anziani.
De fait – privilège de celui qui a un certain passé législatif –, j’ai en mémoire les débats sur la réforme du code pénal en 1992. L’Assemblée nationale voulait que même les actes n’ayant pas un caractère répétitif soient visés par l’incrimination de harcèlement sexuel, ce à quoi s’était refusé le Sénat. Mais, en définitive, et au terme d’un long débat, le législateur n’avait pas tranché cette question du caractère répétitif des actes nécessaires pour que le délit de harcèlement sexuel soit constitué.
Toutefois, la jurisprudence a admis qu’un acte unique pouvait très bien faire l’objet d’une incrimination pénale.
Le Parlement avait veillé également à bien distinguer le délit de harcèlement sexuel de celui d’agression sexuelle, même si, hélas ! les poursuites pénales semblent parfois minimiser les cas d’agressions sexuelles.
Il arrive que l’on correctionnalise des actes qui, normalement, devraient être qualifiés de viol. La raison en est simple : dans les départements où la cour d’assises siège tout au long de l’année judiciaire, sur dix affaires traitées, neuf sont des cas de viol. Aussi, la tentation peut être forte, parfois, de minimiser les qualifications.
C’est dire si nous devons être vigilants pour éviter toute imprécision dans notre démarche, même si, comme le note le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel, « la définition du délit de harcèlement sexuel n’est pas subordonnée à l’insertion de précisions relatives à la fois à la nature, aux modalités et aux circonstances des agissements réprimés ».
On nous laisse tout de même un peu de liberté !
Sourires.

Troisième leçon : beaucoup des propositions de loi se réfèrent aux directives européennes de 2002, de 2004 et de 2006. Ces directives font découler la notion de « harcèlement sexuel » de celle de « discrimination fondée sur le sexe ». Aucune des directives ne nous contraint à une pénalisation de ces agissements et, d’ailleurs, la loi de transposition du 27 mai 2008 n’a pas modifié le code pénal.
Tout à l’heure, l’une de nos collègues observait que la directive permet les condamnations civiles. De fait, la voie civile reste ouverte à certaines victimes qui se sont malheureusement vu priver de recours par la décision du Conseil constitutionnel.
D’ailleurs, la commission des lois, monsieur Sueur, lors de l’examen de loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes, dont François Pillet était rapporteur, n’avait pas non plus repris les termes de la directive.

La raison en est simple : ces deux aspects sont indépendants.
Si, en effet, le monde du travail est un des cadres habituels du harcèlement sexuel, celui-ci peut aussi être présent dans le monde associatif, dans le monde sportif et même dans la vie de tous les jours. C’est ce qu’avait retenu le législateur en 1998, même si le délit était le fait « d’une personne abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions », ce qui ne couvre pas, par exemple, le « chantage » sexuel.
On a beaucoup débattu de ce terme, mais, dois-je le rappeler à nos collègues, si ce terme de « chantage » est sans doute acceptable dans le langage courant, il est totalement inapproprié dans le droit pénal, le chantage étant strictement défini par l’article 312–10 du code pénal, qui dispose qu’il « est le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ».
S’il vous plaît, ne créons pas de confusion supplémentaire dans la définition du harcèlement sexuel !
Avant de porter une appréciation sur le texte de la commission des lois soumis à nos délibérations, vous me permettrez de rappeler l’importance que revêt désormais la question prioritaire de constitutionnalité dans notre ordre juridique.
Cette réforme, attendue par certains depuis plus de vingt ans – Robert Badinter l’avait proposée, sans que sa démarche aboutisse à l’époque– ne peut qu’inciter le législateur à une plus grande vigilance en ce qui concerne la garantie des droits.
D’ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel relative au harcèlement moral nous apporte des garanties – l’un d’entre nous a dit qu’on allait y revenir, mais je ne vois pas pourquoi le Conseil constitutionnel remettrait en cause sa propre jurisprudence -, puisque le Conseil a rappelé à cette occasion la nécessité de caractériser les agissements constitutifs de l’infraction.
Madame la garde des sceaux, pour les textes récents, nous allons être assez tranquilles, du moins pendant un certain temps, nombre de textes ayant été examinés par le Conseil constitutionnel puisque, à l’époque, nos collègues, alors dans l’opposition, soumettaient toutes les lois au Conseil constitutionnel !

Mais veuillez me pardonner ce trait d’humour !
Donc, la décision du Conseil constitutionnel relative au harcèlement moral nous donne une indication.
Marques d’approbation sur certaines travées de l’UMP.

Ne modifions pas le texte pour l’instant, puisque le Conseil constitutionnel l’a déclaré constitutionnel.
Quant à la censure de l’article 222-33 du code pénal, franchement, notre excellente collègue Mme Dini, qui n’est plus là, …

… a lancé en direction du Conseil constitutionnel une véritable attaque. En dehors du fait que, personnellement, je n’aurais pas cité ce cas local, j’estime que la décision sur le harcèlement sexuel n’a rien à voir avec la celle qui est intervenue en matière de garde à vue et qui a imposé la présence de l’avocat : il fallait à l’évidence un certain délai pour mettre en place le dispositif. Mais quand un délit disparaît, comme en l’espèce, comment voulez-vous continuer à le faire vivre ?
Il est vrai que le Conseil constitutionnel ne donne pas d’explication dans sa décision, mais un certain nombre de commentaires ont, hélas ! été faits : si le délit n’existe plus, on ne peut pas poursuivre ; autrement, c’en est fait du principe de légalité des délits et des peines.

Le fait qu’il y ait des victimes, monsieur Bourquin, ne permet pas pour autant de violer la règle de droit.

Je salue d’ailleurs les efforts que vos services, madame la garde des sceaux, ont consentis : vous avez tout fait pour permettre, autant que possible, les poursuites sur le fondement d’autres incriminations.
S’agissant des victimes de harcèlement sexuel, bien entendu, toutes les situations qui ont été évoquées par les uns et les autres sont terribles. D’où l’urgence. Vous le voyez, mes chers collègues, la procédure accélérée se justifie de temps en temps - ce n’est pas la peine de revenir trente-six fois sur un dispositif ayant fait l’objet d’un accord – et, pour une fois, elle a été demandée.

À mes yeux, l’approche que l’on avait de la procédure accélérée, ou de la déclaration d’urgence naguère, était parfois discutable, car elle était devenue rituelle. Mais ici, je pense qu’elle est indispensable si nous voulons adopter ce texte avant la fin de la session extraordinaire.

En lisant le projet de loi, on ne peut qu’être frappé par la bizarrerie de la forme du premier alinéa, surtout en le comparant à l’ensemble des articles du code pénal, notamment celui qui concerne le harcèlement moral. Pourquoi ne pas utiliser la même ?
Trois interrogations principales ont fait l’objet d’un consensus, d’autres – les amendements déposés par nos collègues en témoignent – ont suscité des positions divergentes.
Il s’agissait tout d’abord de rappeler le caractère intentionnel du délit.
Ensuite, parce que la question du caractère répétitif ou non des actes, propos ou comportements, caractéristique du harcèlement, ne permettait pas de couvrir le champ des menaces, ordres ou contraintes, actes parfois uniques mais d’une gravité potentielle réelle, on ne peut qu’approuver l’assimilation au harcèlement sexuel de ce délit.
Madame la garde des sceaux, cette disposition figurait déjà dans le projet de loi initial et a été largement confirmée par la commission des lois.
Il est sans doute plus réaliste de fixer une même échelle des peines pour cette double définition du délit, en laissant au juge le soin d’apprécier la gravité des comportements et leurs conséquences. J’ai entendu que vous aviez donné votre accord sur ce point.
Je n’évoquerai pas les adaptations nécessaires dans le code du travail et le statut de la fonction publique, mais je m’interroge toujours sur l’utilisation du terme « environnement », mis à toutes les sauces. La commission des lois a bien voulu reconnaître ce matin que le terme de « situation » correspondait mieux à la réalité et nous éviterait une imprécision juridique.
Enfin, nous avons intérêt – madame la garde des sceaux, vous avez largement développé cette question –…

… à retenir les mêmes circonstances aggravantes que pour d’autres crimes et délits - sauf à détruire un peu plus l’équilibre de notre code pénal, déjà bien mis à mal - et à ne pas introduire des allusions au « genre » – gender en anglais – qui n’ont pas leur place dans ce débat. En effet, les victimes de harcèlement sexuel n’ont pas à faire l’objet de discrimination : elles sont toutes égales, et doivent être protégées également.
Je pourrais aussi évoquer les circonstances aggravantes, notamment en cas de minorité de la victime. Je ferai observer à ceux de nos collègues qui sont partisans du seuil de quinze ans pour protéger, entre autres, les apprentis, qu’il existe une autre circonstance aggravante, l’abus d’autorité, qui ouvre largement la possibilité de prononcer des peines aggravées.
Voilà, mes chers collègues, quelques observations qui ne remettent évidemment nullement en cause notre volonté commune d’aboutir vite, tout en respectant la règle de droit et en permettant une plus juste appréciation de la gravité des situations dans lesquelles se trouvent les victimes.
Bien entendu, notre groupe soutiendra le texte de la commission des lois, amendé.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UCR, ainsi que sur certaines travées du RDSE, du groupe écologiste et du groupe socialiste.

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, le harcèlement sexuel, voilà un autre fléau trop longtemps sous-estimé, trop longtemps minimisé et, surtout, trop longtemps ignoré du code pénal.
Oui, un fléau qu’il est impératif de combattre, car il est l’un des plus préoccupants, au regard des atteintes à la dignité humaine et à l’intégrité psychique induites.
Le Sénat, qui fut, dans l’histoire de la République, à l’origine de la première loi visant à lutter contre les violences au sein des couples, est saisi en premier lieu sur cet autre fait de société gravissime, et c’est très bien ainsi.
Là encore, dans leur quasi-totalité, les victimes de harcèlement sexuel sont des femmes.
Je salue votre projet de loi, madame la garde des sceaux.
Je salue votre action, madame la ministre des droits des femmes.
Je crois que l’on doit également saluer la très grande réactivité du Sénat sur ce sujet – dépôt de sept propositions de loi, constitution d’un groupe de travail réunissant la délégation aux droits des femmes ainsi que les commissions des lois et des affaires sociales -, et saluer aussi le travail des trois rapporteurs, du président de la commission des lois, de la présidente de la commission des affaires sociales et de la présidente de la délégation.
Le texte du Gouvernement a ainsi été enrichi en retenant aussi, comme vous l’avez souligné, monsieur le rapporteur, les pistes explorées par les propositions de loi. Il devrait donc déboucher sur un consensus, du moins je l’espère, et c’est bien là l’essentiel.
Nous avons, avec le texte qui nous est soumis, un dispositif complet permettant en effet de mieux combattre les manifestations du harcèlement sexuel, qu’il s’agisse d’actes répétés ou de chantage sexuel.
Oui, mes chers collègues, c’est un fléau, qu’il convient de combattre fermement, tant il est destructeur pour la personne qui en est victime.
Je note que le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée.
Je dirais volontiers, pour reprendre vos propos, monsieur le président de la commission des lois, qu’en temps ordinaire je suis également plutôt critique par rapport à l’utilisation de cette procédure. Mais, compte tenu de la situation et de l’urgence qu’il y a à agir, j’approuve la décision du Gouvernement, mesdames les ministres.
Je n’ajouterai rien, cela a été suffisamment exposé, à l’historique de la définition du harcèlement sexuel, progressivement allégée, progressivement simplifiée, et qui a conduit le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, à la déclarer contraire à la Constitution, dans sa décision du 4 mai 2012.
« Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage », pourrait-on dire. En tout cas, force est de constater que des efforts renouvelés – en 1992, en 1998 et en 2002 – ne conduisent pas toujours à la perfection recherchée.

Je ferai une remarque au passage, pour regretter que le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi en 2002 de la loi de modernisation sociale, notamment des dispositions relatives au harcèlement moral, n’ait pas alors soulevé d’office la question de la conformité à la Constitution des modifications apportées à la définition du harcèlement sexuel.
Cela dit, qu’il me soit permis de revenir sur l’ampleur de ce phénomène, pourtant encore mal connu, comme c’est le cas, aussi, pour les violences à l’égard des femmes en général ou encore au sein des couples.
S’il est en effet difficile d’avoir une idée précise du nombre de victimes, les chiffres communiqués par l’Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis prouvent bien l’ampleur du fléau et permettent d’affirmer que le harcèlement sexuel est certainement plus répandu qu’on ne le dit ou que ne l’évalue l’étude d’impact.
Il me paraît donc absolument nécessaire de pouvoir disposer d’un observatoire national des violences envers les femmes.
Bravo ! sur les travées du groupe CRC.

C’est en ce sens que j’étais également intervenu lors des discussions sur les propositions de loi qui furent à l’origine des lois du 4 avril 2006 et du 9 juillet 2010 sur les violences à l’égard des femmes, en demandant une telle création, que nous n’avions pu obtenir.
La seule avancée sur ce point que nous ayons pu réaliser – mais était-ce une avancée ? – figure à l’article 29 de la loi du 9 juillet 2010. Cet article dispose qu’un rapport remis par le Gouvernement sur la création d’un observatoire national des violences faites aux femmes sera présenté au Parlement avant le 31 décembre 2010. Et que lit-on dans ce rapport qui, faut-il le souligner, a été publié avec plus d’un an de retard ? Il est proposé, non pas de créer une structure dédiée, comme nous le souhaitions, mais de s’appuyer sur l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, ce qui ne répond en aucune façon à nos préoccupations.

Je me réjouis donc que vous-même, madame la ministre des droits des femmes, lors d’une audition ici même, vous soyez déclarée ouverte à la création d’un observatoire national des violences faites aux femmes.
J’apprécie également votre intention de lancer une campagne de sensibilisation à l’automne sur ce sujet, afin que plus facilement se déchire le voile du silence et que plus facilement se libère la parole des victimes.
Dans ce domaine précis, qui est aussi celui des violences à l’égard des femmes, plus on informera, plus on sensibilisera, plus on alertera et plus vite on fera reculer ce fléau.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, en 2010, j’avais défendu et fait adopter des amendements, instituant, pour l’un, une journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes, fixée au 25 novembre de chaque année, et préconisant, pour l’autre, la mise en œuvre d’une information dans les écoles, les collèges et les lycées sur l’égalité entre les garçons et les filles, sur le respect, sur la lutte contre les préjugés sexistes et les violences à l’égard des femmes.
Cela nous paraissait essentiel dès lors que l’on constate que les garçons et les filles sont, dès leur plus jeune âge, enfermés dans des représentations très stéréotypées de leur place et de leur rôle dans la société.
M. Jacky Le Menn applaudit.

La prévention est indispensable, et cela dès le plus jeune âge, si l’on veut éradiquer ce fléau des violences, notamment à l’égard des femmes. Romain Rolland le disait avec force : « Tout commence sur les bancs de l’école ». Il avait raison !
Il suffirait, mes chers collègues, d’appliquer cette disposition qui figure dans la loi de 2010, ce qui n’a pas été fait jusqu’à présent, aucune instruction en ce sens n’ayant été donnée aux chefs d’établissements scolaires.
Cela dit, l’urgence commandait de combler dans les plus brefs délais le vide juridique créé par la décision du Conseil constitutionnel. C’est d’ailleurs parce que j’estimais que ce vide juridique ne devait pas perdurer davantage que j’ai pris l’initiative de déposer, comme certains de mes collègues, une proposition de loi dès le 15 mai.
Qu’il me soit permis de préciser que la décision du Conseil constitutionnel est bienvenue. En revanche, son application immédiate a des conséquences très douloureuses pour les victimes de faits de harcèlement sexuel. En effet, cette décision impose l’annulation de toutes les procédures judiciaires en cours et interdit d’engager de nouvelles poursuites sur le fondement du texte abrogé.
On mesure donc le désarroi et le sentiment d’injustice que ressentent toutes les victimes qui avaient eu le courage de prendre la décision, souvent difficile, de porter plainte pour harcèlement sexuel, et qui s’étaient engagées dans un long et inévitablement pénible parcours judiciaire dans l’espoir que justice leur soit rendue.
Quoi qu’il en soit, et pour reprendre l’expression du professeur Detraz, en abrogeant, avec effet immédiat, l’article 222-33 du code pénal, c’est un remède de cheval qui a été administré par le Conseil constitutionnel au texte jugé malade.
Je partage tout à fait l’analyse de Mme Dini, mais aussi de Stéphane Detraz que je viens de citer, notamment quand celui-ci affirme que de telles conséquences ne s’imposaient pourtant pas au Conseil constitutionnel, qui avait la possibilité de reporter dans le temps la prise d’effet de l’abrogation de la loi.

En effet, souligne-t-il, le fait « qu’une incrimination soit déclarée insuffisamment intelligible ne signifie pas que, dans chaque affaire, il ne soit pas certain que les faits poursuivis entrent dans ses prévisions ».
Il poursuit : « Le Conseil constitutionnel pouvait faire survivre l’article 222-33 du code pénal pendant quelque temps sans compromettre l’exigence d’intelligibilité, le juge pénal pouvant, dans l’intervalle, neutraliser le texte d’incrimination en opérant un contrôle de conventionalité ou, au contraire, l’appliquer, selon que les faits dont il était saisi entraient, sans hésitation, dans le “ noyau dur ” du délit, ou au contraire correspondaient à ses marges incertaines ».
Je ferai remarquer qu’en fait, et dès lors qu’il revient au Conseil constitutionnel de fixer la date et l’ampleur des effets de l’abrogation, une telle faculté peut avoir pour effet bénéfique de laisser subsister quelque temps la règle pénale créée par le législateur plutôt que de la faire disparaître.
Ces remarques étant faites et les choses étant ce qu’elles sont, l’urgence, je le répète, commande de réagir sans tarder face au vide juridique existant afin de réprimer des comportements inadmissibles. En effet, pour se reconstruire, les victimes ont besoin que soit reconnue la culpabilité de leur agresseur, surtout dans le domaine qui nous mobilise aujourd’hui.
On n’insistera jamais assez sur les ravages du harcèlement sexuel chez les victimes : les atteintes à la dignité, la perte de confiance en soi, la perte d’estime de soi. Certaines victimes vont jusqu’à évoquer des épisodes dépressifs à répétition, des troubles anxieux généralisés, des troubles de la personnalité, des maladies liées aux stress, entre autres. Oui, il y a bien dégradation des conditions de vie et de santé de la victime.
Pour conclure, je souhaite vous livrer le témoignage d’une femme qui a été victime durant de nombreux mois d’un harcèlement sexuel et qui m’écrivait ceci : « Aujourd’hui, je dis merci à mes amis. J’ai enfin décidé de me libérer et j’ai décidé de porter plainte ».
Elle ajoute : « Je ne pensais pas que ce que j’ai vécu aurait autant de répercussions sur ma vie personnelle et professionnelle. Aujourd’hui, je suis suivie par un psychiatre. Aujourd’hui, je suis en dépression et j’ai perdu mon travail. Aujourd’hui, j’ai tellement de souffrances en moi ! Alors, aujourd’hui, avec vos collègues sénateurs, aidez les femmes qui vivent de telles situations. Prenez les bonnes décisions ».

M. Roland Courteau. Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, à mon sens, on ne saurait mieux dire !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE, de l’UCR et de l’UMP.

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, les orateurs précédents l’ont déjà souligné, dans sa décision du 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel a considéré que la disposition du code pénal définissant le délit de harcèlement sexuel était contraire au principe de légalité des délits et des peines. Il a ainsi estimé que les éléments constitutifs de cette infraction n’étaient pas suffisamment précis pour exclure l’arbitraire conformément à ce principe.
En préambule, permettez-moi de souligner que, pour la première fois de son histoire, le Conseil constitutionnel s’est arrogé le droit de se substituer au législateur en abrogeant lui-même la loi.

Cette situation me conforte, ainsi que mes collègues du groupe CRC, dans l’idée qu’il est urgent de réformer à la fois le mode de nomination et les pouvoirs de cet organe.
Il est vrai que cet article méritait de faire l’objet d’un réexamen, ce que plusieurs associations de défense des droits des femmes réclamaient déjà. Toutefois, nous condamnons le choix qui a été fait d’une abrogation immédiate de l’article 222-33 du code pénal et déplorons très fortement les conséquences de cette décision.

En effet, ce constat a également été dressé par certains des orateurs précédents, du fait de cette décision, le délit de harcèlement sexuel a purement et simplement disparu du code pénal, créant un vide juridique et faisant tomber toutes les affaires de harcèlement sexuel actuellement pendantes devant les juridictions pénales.
Cette situation, nous le savons, a été douloureusement ressentie par les victimes de ces agissements – des femmes, dans la très grande majorité des cas – qui avaient eu le courage de les dénoncer.
Ces personnes étaient, pour beaucoup, en procédure depuis de nombreuses années. Elles se trouvent aujourd’hui contraintes de reprendre tout leur combat depuis le début, quand elles peuvent encore le faire. C’est un nouveau préjudice moral et financier.
Des solutions doivent, partant, être trouvées pour ces victimes.
Il était donc urgent qu’une nouvelle définition du délit de harcèlement sexuel soit adoptée et que les dispositions du code du travail, du code de procédure pénale et de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient adaptées en conséquence.
Au-delà des divergences politiques, le groupe de travail constitué au Sénat et coprésidé par la présidente de la délégation aux droits des femmes, par le président de la commission des lois et la présidente de la commission des affaires sociales, entendait – je tiens à le souligner, par un travail collectif rigoureux et studieux – répondre à la nécessité de parer à cette urgence.
Parallèlement, plusieurs propositions de loi ont été déposées, dont celle du groupe CRC. Le nouveau gouvernement s’est ensuite saisi du sujet pour présenter un projet de loi tenant compte de certaines recommandations du groupe de travail mais aussi de certaines des sept propositions de loi.
En déposant une proposition de loi dès le 25 mai, le groupe CRC avait pour but de proposer la définition du harcèlement sexuel la plus protectrice possible pour les victimes, dans la limite des exigences constitutionnelles, afin de ne pas encourir une nouvelle censure.
Nous disposons, certes, d’une définition européenne donnée par les directives du 23 septembre 2002 et du 5 juillet 2006, mais la reprise, mot pour mot, de cette définition ne va pas totalement de soi. En effet, le Sénat a fait valoir à deux reprises, pour certains de ces éléments, que cette définition, d’une part, paraissait difficilement compatible avec les principes qui fondent notre droit pénal ; d’autre part, qu’elle procède d’une approche différente de celle du droit interne en ce qu’elle assimile le harcèlement à une discrimination. Elle nous a néanmoins servi de base pour élaborer notre proposition de définition.
Nos interrogations ont porté sur l’élément matériel de l’infraction, sur l’élément intentionnel, sur la question de la peine et sur celle de la charge de la preuve.
Les éléments de réponse apportés nous ont permis d’aboutir à cette définition : « Constitue un harcèlement sexuel tout comportement à connotation sexuelle qui porte atteinte à la dignité d’une personne, ou crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, répété ou revêtant un caractère manifeste de gravité ».
Tout d’abord, concernant l’élément matériel de l’infraction, notre souci a été de ne pas nous livrer à une énumération des formes du harcèlement sexuel. De fait, une telle liste présenterait, au total, un caractère restrictif, puisqu’elle conduirait à considérer que « les actes harcelants » qui n’y figurent pas sont autorisés. De plus, on peut craindre que l’imagination des agresseurs ne la déborde rapidement.
Mme la ministre des droits des femmes acquiesce.

Ensuite, si le sens commun, guidé par la définition usuelle du verbe « harceler », conduit à considérer qu’un acte unique ne peut constituer un harcèlement, à l’évidence – sur ce point, les associations ont joué un rôle éclairant – un acte d’un certain degré de gravité relève bien du harcèlement sexuel, l’impact, tant physique que psychologique, d’un acte unique sur la victime pouvant se prolonger dans le temps.
On songe, par exemple, à une menace de représailles, si la victime ne cède pas à la sollicitation sexuelle qui lui a été adressée : ne s’épuisant pas dans le laps de temps où elle s’est exprimée, elle présente en fait un caractère permanent, faisant peser sur son destinataire une pression continue.
D’ailleurs, lors des débats parlementaires qui avaient précédé le vote de la loi du 2 novembre 1992, il avait été souligné que la jurisprudence « devrait saisir que le terme de “harcèlement sexuel” a un effet d’affiche mais que le texte permet que le délit soit constitué même en cas d’acte unique ».
Le ministre de l’époque avait ajouté : « La position du Gouvernement est claire : tel qu’il est défini, le harcèlement sexuel [...] peut se traduire par plusieurs actes, mais éventuellement par un seul acte d’une particulière gravité ». Cette déclaration faisait alors écho aux exigences de la Commission européenne qui précisait, dans l’une de ses recommandations, « qu’un seul incident de harcèlement peut constituer à lui seul le harcèlement sexuel, s’il est suffisamment grave. »
Toutefois, si, lors des débats de 1992, il avait été admis qu’un seul acte grave pouvait constituer un harcèlement, la jurisprudence n’était pas aussi claire quant à l’exigence de répétition. Ainsi, certaines décisions rejettent explicitement l’idée qu’un acte isolé puisse, à lui seul, caractériser un harcèlement sexuel au sens de l’article 222-33. Nombre de décisions d’appel font référence à la pluralité des actes accomplis ou à leur caractère habituel. Il nous a donc semblé utile de préciser l’obligation de réprimer un acte unique grave.
Concernant maintenant l’élément moral de l’infraction, il nous a semblé nécessaire, en premier lieu, de distinguer harcèlement sexuel et discrimination.
Pourquoi ? Dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, les actes de « harcèlement sexuel » ont toujours été appréhendés sous l’angle de la « discrimination sexuelle ». Cette approche du harcèlement comme forme de discrimination fondée sur le sexe, a eu des échos en Europe et s’est traduite dans le texte de la directive.
Au fondement de la logique communautaire figure une idée forte : le harcèlement sexuel fait obstacle à la bonne intégration des femmes sur le marché du travail, et le combat contre ce phénomène participe donc de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes. Or il ne s’agit pas simplement de cela !
L’approche adoptée par le législateur français pour établir la définition proposée aujourd’hui diffère par rapport aux précédentes. En effet, après hésitation, ce dernier a abandonné le projet de consacrer le « harcèlement » comme une simple « variété de discrimination » – passez-moi l’expression – en soutenant l’idée selon laquelle une personne peut être harcelée non seulement en raison de son sexe, mais aussi en raison de son aspect physique, de ses qualités morales ou intellectuelles, etc.
De plus, envisager le « harcèlement sexuel » sous l’angle de la discrimination aboutit à une impasse quand le harceleur s’attaque aussi bien à la gent masculine qu’à la gent féminine. Il faut donc dépasser le rapprochement opéré entre le « harcèlement sexuel » et « l’égalité entre les hommes et les femmes », même si ce sont les femmes qui restent les plus exposées.
Reste que, si le droit français ne semble pas placer sur le même plan les notions de harcèlement sexuel et de discrimination, il n’en institue pas moins le harcèlement sexuel comme motif de discrimination. L’intégration de la notion de harcèlement sexuel dans le code du travail s’est en effet accompagnée de la création d’un nouveau motif discriminatoire dès 1992. L’actuel projet de loi prévoit, quant à lui, par son article 2, d’intégrer ce motif discriminatoire dans le code pénal.
Pour éviter toute confusion, il faut encore distinguer clairement « harcèlement sexuel » et « harcèlement sexiste », ce dernier terme qualifiant des agissements sous-tendus par la mentalité éminemment sexiste de son ou de ses auteurs.
L’expression « harcèlement sexiste » est employée pour désigner des agissements dont la caractéristique est de porter atteinte à la dignité de la victime et qui trouvent leur raison dans le sexe de cette dernière. C’est donc ici le genre plutôt que la sexualité qui constitue l’objet du harcèlement. Dans cette hypothèse, on peut avancer que le harcèlement sexiste n’est qu’une forme de harcèlement moral. Et l’on se trouve même en présence de ce que l’on peut qualifier de « harcèlement moral discriminatoire ».
Cette approche a pour inconvénient de contribuer à effacer, à gommer le « caractère sexué » des agissements condamnés. Il pourrait donc être intéressant d’envisager, à l’avenir, la création d’un article spécifique pour ce type de harcèlement, malheureusement toujours très répandu.
Concernant l’élément moral, la loi française, à la différence du droit communautaire, fixait un but précis, à savoir « l’obtention de faveurs sexuelles ».
Cette approche a conduit à ne pas qualifier de « harcèlement sexuel » des actes ou des pratiques à connotation sexuelle qui instaurent ou créent un climat de travail malsain ou attentatoire à la dignité de la personne, des agissements qui, bien qu’ils puissent mettre mal à l’aise, ne sont pas sous-tendus par une intention sexuelle. Pourtant, la finalité apparaît, pour celles ou ceux qui ont subi un acte ou une pratique de cette nature comme une tentative de mainmise, de subordination, d’humiliation, d’exclusion. Il est donc, à notre sens, absolument nécessaire de réprimer « les harcèlements d’ambiance » ou, ce qui fait débat, « d’environnement hostile », ce que nous avons retenu en supprimant toute référence à l’obtention de faveurs sexuelles.
Le débat en séance public permettra, je l’espère, d’améliorer encore le texte proposé par la commission des lois, car plusieurs points posent encore problème.
D’abord, la question essentielle de « l’acte unique » de harcèlement.
Le projet assimile au « harcèlement sexuel », même en l’absence de répétition, « le fait d’user d’ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave » à l’égard d’une personne, « dans le but réel ou apparent d’obtenir une relation de nature sexuelle ».
Cette définition appelle plusieurs remarques.
Elle est très proche de la définition de l’agression sexuelle visée à l’article 222-22 du code pénal aux termes de laquelle « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Le risque existe donc de voir les agressions sexuelles requalifiées en harcèlement.
Ce risque de requalification était déjà inhérent à la précédente version de l’article 222-33 ; il continuera d’exister et pourra même être aggravé. Il faut donc l’éviter.
La notion de « chantage sexuel » est au cœur de cette définition de l’acte unique « grave » de harcèlement. À cet égard, je souhaite attirer votre attention sur une réelle difficulté de cohérence pénale.
En effet, en droit, « le chantage », tel que visé à l’article 312-10 du code pénal, relève d’une infraction contre les biens. Il est par ailleurs puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Or il serait créé un délit de « chantage sexuel », relevant des atteintes aux personnes et non plus des atteintes aux biens, qui ne serait puni, lui, que de deux ans, voire trois ans d’emprisonnement.
Cette question, vous le voyez, pose vraiment problème et doit faire l’objet d’un débat approfondi. C’est le sens des amendements que nous avons déposés sur cette définition.
Enfin, j’en viens aux derniers points de divergence sur les circonstances aggravantes, qui feront aussi l’objet de débats.
Le premier point de divergence porte sur la question de la vulnérabilité. Nous défendons l’introduction de la notion de « vulnérabilité économique ou sociale », mais nous ne resterons pas sourds aux éventuelles propositions qui pourront être formulées au cours des débats, notamment par le Gouvernement.
Le second a trait à la question de la minorité. Nous prônons de ne pas la limiter à la majorité sexuelle. Sur ce sujet, le critère pertinent doit être seulement celui de la vulnérabilité d’un mineur face à un adulte harceleur. De plus, comme ce texte vise à déconnecter le harcèlement de la recherche d’une relation sexuelle, le critère de majorité sexuelle nous semble tout à fait inopportun.
Si notre priorité est et reste l’adoption d’un texte, celui-ci doit être – Brigitte Gonthier-Maurin l’a dit tout à l’heure – le plus juste et le plus efficace possible, conforme aux réalités subies au quotidien par les victimes. C’est le sens des amendements que nous avons déposés bien évidemment avec l’objectif d’y parvenir.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du groupe écologiste et du RDSE.

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, je partage le constat dressé par mes collègues quant à l’urgence de statuer sur des comportements intolérables dans le fonctionnement d’une société comme la nôtre.
Je pense, en premier lieu, à l’ensemble des victimes qui n’ont jamais osé déposer plainte contre leur harceleur. Je pense à toutes celles qui ont franchi ce pas difficile et dont la procédure, faute de preuves suffisantes souvent, n’a pu aboutir à une condamnation des auteurs des faits. Je pense aussi à celles dont la procédure était en cours lorsque, en mai dernier, le Conseil constitutionnel a décidé d’abroger purement et simplement cette loi, sans prévoir de délai. Je pense également aux victimes actuelles, qui n’ont plus de possibilités de déposer plainte.
Mais je pense aussi aux auteurs, qui sont renforcés dans leur toute-puissance et risquent de récidiver, faute d’avoir eu l’occasion de prendre conscience des conséquences de leurs actes.
Car il ne s’agit pas ici de réprimer des rapports de séduction entre deux personnes consentantes. Non, il ne s’agit pas de cela. Le harcèlement sexuel, quel que soit le lieu où il est pratiqué, vise à utiliser la victime comme un objet sexuel à des fins de satisfaction personnelle.
Le harcèlement sexuel est sournois, indicible et donc difficilement mesurable ; il n’en est pas moins important. Les associations évoquent le chiffre de centaines de victimes chaque jour. C’est dire si le nombre de plaintes annuelles est minime par rapport aux situations vécues par les victimes.
Les violences de ce type, on le sait, ont des répercussions sociales importantes en termes de difficultés psychologiques, de santé, de pertes d’emploi. Elles ont également un coût financier évident.
Il est donc nécessaire de combattre ces pratiques de « chasseur », de « prédateur », pour faire accéder notre société au véritable statut de démocratie où l’égalité entre les femmes et les hommes sera complète.
Ce qui caractérise les violences envers les femmes est à la fois leur continuum dans le temps et entre les différentes sphères de la vie des femmes : vie personnelle, vie familiale, vie sociale et vie professionnelle. C’est pour cela qu’il n’y a pas des violences plus ou moins graves ; la loi doit pouvoir les sanctionner toutes, de manière graduée, mesurée, en recherchant des réponses pénales adaptées, le législateur ayant conscience d’agir ainsi pour prévenir et empêcher des passages à l’acte plus graves.
Mais les violences subies par les femmes présentent aussi comme caractéristique commune la difficulté pour les victimes d’apporter des preuves tangibles, car ces violences se déroulent le plus souvent hors du regard d’autrui, démontrant ainsi, s’il en était besoin, que l’auteur des faits, en prenant cette précaution, a pleinement conscience de transgresser la loi.
Je souhaite ici insister sur plusieurs points.
Tout d’abord, les harceleurs, sauf quelques exceptions, sont des hommes et leurs victimes, des femmes. Cette habitude, que d’aucuns trouvent tout à fait normale, révèle l’état de nos rapports sociaux de sexe. Ces rapports sociaux inégalitaires se déclinent dans toutes les sphères de notre vie : inégalités professionnelles et salariales, rôles différents face aux tâches domestiques et dans l’éducation des enfants, violences envers les femmes, monoparentalité... De surcroît, ces comportements habituels, intégrés par les femmes elles-mêmes comme « normaux », compliquent la transformation des rôles assignés aux unes et aux autres.
Toutefois, nous le savons, les comportements ont évolué en la matière au cours des dernières décennies sous le double mouvement de la loi et de l’implication des femmes dans la vie économique et politique. Cette évolution des mentalités doit nous inciter à aller toujours plus en avant pour placer les femmes en parfaite égalité de droits et être ainsi en accord avec cette belle citation de Stendhal que vous avez faite en début de séance, madame la ministre.
Leur état d’infériorité sociale place les femmes en situation de vulnérabilité. Cela a été abordé plusieurs fois et je suis favorable, pour ma part, à la reconnaissance de la précarité économique comme circonstance aggravante du harcèlement sexuel. Particulièrement dans le milieu du travail, le risque de perdre son emploi fournit l’occasion d’un chantage explicite ou implicite lorsque le harcèlement est le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’un collègue. Il nous faut donc reconnaître cette vulnérabilité afin de faire savoir aux femmes exposées qu’elles peuvent se défendre et aux auteurs que leur comportement sera sanctionné. Il faut ainsi les contraindre au respect.
Une campagne de communication devrait pouvoir accompagner favorablement la promulgation de la présente loi auprès des employeurs, des syndicats, des associations d’aide aux victimes, des maisons des avocats, pour ne citer que ces exemples.
Par ailleurs, il est nécessaire, me semble-t-il, de compléter la loi sur les discriminations et de modifier l’article 225-1 du code pénal en ajoutant aux discriminations la notion d’identité sexuelle. En effet, notre société est fortement normée en matière de sexualité. Le modèle dominant reste celui du couple hétérosexuel. Toute personne qui, de manière évidente, s’en éloigne s’expose à la critique, aux railleries, voire à des agissements agressifs répréhensibles.
Les personnes transsexuelles ou transgenres nous ont fait part de la fréquence importante des harcèlements et des agressions qu’elles subissent, notamment dans la période dite de « transformation », qui peut durer plusieurs années. Il est nécessaire, me semble-t-il, de compléter la loi sur les discriminations et d’y ajouter une reconnaissance de la « transphobie ».
Seule une évolution des comportements fera véritablement rempart contre la bêtise et la méchanceté. Aussi, il me paraît important, comme certains l’ont souligné ici, d’éduquer les jeunes à la question large des sexualités lors de leur scolarité et de développer des campagnes de sensibilisation tout public pour mieux lutter ainsi contre les discriminations.
Enfin, une loi, c’est bien, mais une loi appliquée, c’est mieux !
C’est la raison pour laquelle je souhaite un rapport annuel sur l’application de la loi et sur le croisement avec les autres violences subies par les femmes françaises, de métropole et d’outre-mer. Je propose que ce rapport fasse l’objet d’une communication grand public à l’occasion du 25 novembre, date devenue, au fil des ans, le rendez-vous annuel qui permet de faire le point sur les violences envers les femmes et qui a été inscrite comme tel dans la loi de 2010 sur les violences conjugales. Car observer, rendre compte, c’est déjà agir.
La coordination des acteurs départementaux pourrait, par exemple, être privilégiée pour que les réponses s’élaborent au plus près des victimes, sous la conduite méthodologique générale du ministère des droits des femmes. Cette démarche pragmatique nous conduira à faire les croisements nécessaires entre les différentes formes de violences subies par les femmes.
En effet, pour lutter contre les violences faites aux femmes, les violences faites aux filles, il faut pouvoir mesurer régulièrement l’ampleur du phénomène, la nature et l’effet des réponses apportées et les axes de prévention à privilégier pour modifier durablement les comportements.
Volonté, ténacité, solidarité, telles sont les qualités requises pour faire parvenir les femmes à plus de dignité. Nul doute que notre Haute Assemblée, à l’occasion de la discussion de ce projet de loi, inscrira fortement sa volonté à l’égard de nos concitoyennes, qui comptent sur nous !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE et de l’UCR.

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, le 4 mai dernier, les dispositions de notre code pénal relatives au harcèlement sexuel, dans leur rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, ont été déclarées non conformes par le Conseil constitutionnel. Leur abrogation étant immédiate, nous nous devons de légiférer dans l’urgence, dès lors que les victimes sont aujourd’hui laissées sans protection. C’est bien là la condamnation que nous émettons depuis cette tribune envers ceux qui ont pris cette décision ce que je m’associe à vous, madame Dini, pour regretter.
Nous nous devons aussi de faire en sorte que le délit de harcèlement sexuel, qui existe dans notre droit depuis 1994, puisse trouver une définition répondant aux exigences constitutionnelles d’intelligibilité et de clarté.
Cette définition gagnerait aussi à être suffisamment large pour répondre à l’esprit, sinon à la lettre, des directives européennes du 23 septembre 2002 et du 5 juillet 2006, de telle sorte que la justice puisse passer lorsque des faits relevant du harcèlement sexuel se produisent. Nous le savons, en matière de harcèlement sexuel, les poursuites pénales étaient jusqu’à présent aussi rares que leur issue était incertaine. Des chiffres viennent d’ailleurs d’être communiqués à cette tribune.
Le texte que nous examinons, mes chers collègues, enrichi notamment par les contributions de plusieurs d’entre vous, vise à satisfaire ces exigences. Il doit permettre la poursuite de faits relevant spécifiquement de ce qui caractérise le harcèlement, c’est-à-dire d’actes qui, du fait même de leur accumulation, portent atteinte à la dignité de celles et de ceux qui en sont l’objet. Il innove aussi en ouvrant la possibilité de poursuivre des faits, même uniques, accomplis dans des circonstances bien particulières, sans que les infractions plus graves soient abandonnées.
Mes chers collègues, nous ne légiférons pas ici pour adoucir les peines encourues par les auteurs d’atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne !
Notre objectif ne doit pas se limiter à mieux définir pour seulement mieux réprimer. Notre ambition est plus forte : modifier enfin des comportements qui, trop longtemps, ont été minimisés, au prétexte qu’ils relèveraient d’une gauloiserie bien nationale.

Certains vont même jusqu’à dire qu’ils structureraient les relations entre les hommes et les femmes, notamment sur le lieu de travail. Les mêmes arguments sont encore avancés pour défendre les pratiques de bizutage les plus humiliantes !
L’on sait parfaitement que le harcèlement sexuel est un phénomène de mieux en mieux étudié par les sciences sociales. Il est désormais intégré dans le champ de l’expertise en psychopathologie du travail. On connaît l’enquête pionnière – elle a été évoquée dans cet hémicycle – menée en Seine-Saint-Denis sur les violences sexuelles faites aux femmes au travail ou encore celle, plus récente, relative à la situation et à l’intégration des femmes dans une unité combattante de l’armée...
Ces études sont éclairantes, même si l’on peut regretter qu’elles restent trop limitées. Je forme le vœu qu’elles soient développées, parallèlement à la prévention des risques psychosociaux au travail. Mais il faut aller au-delà, puisque le harcèlement est un comportement qui se manifeste partout.
Mes chers collègues, au-delà de ces considérations, permettez-moi d’évoquer mon expérience. Au sein du conseil régional du Languedoc-Roussillon, une délégation aux droits des femmes a été créée dès 2004, sous la présidence de mon prédécesseur. L’objectif était alors de « créer un 8 mars permanent » en mettant l’accent sur la formation professionnelle et la lutte contre les violences faites aux femmes. Dans le même ordre d’idées, la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale a été signée. Ce sont là deux actes symboliques que j’ai souhaité à mon tour prolonger par de nouvelles réalisations opérationnelles. C’est la raison pour laquelle je travaille actuellement à la mise en place d’un observatoire régional des violences faites aux femmes, destiné à collecter des données tant quantitatives que qualitatives – il verra très bientôt le jour.

Nous projetons aussi de montrer l’exemple à l’échelle de notre institution en obtenant la certification « égalité professionnelle hommes-femmes » décernée aux collectivités. Bien entendu, nous sommes vigilants pour que les femmes soient en première ligne dans les postes de direction. Ce n’est qu’un début, mais c’est absolument nécessaire.
Et pourquoi, madame la ministre, ne pas généraliser ce type d’initiatives, qui visent à promouvoir l’égalité en traitant de front les phénomènes que tous les féministes, c’est-à-dire les femmes et les hommes de progrès, veulent combattre ?
Avant de conclure, madame la garde des sceaux, j’aimerais évoquer un aspect du projet de loi.
Le texte issu des travaux de la commission opère une distinction entre deux formes de harcèlement sexuel. Si la nouvelle définition du harcèlement stricto sensu me semble relever d’une atteinte à la dignité de la personne, celle du harcèlement « assimilé » remplit pleinement les conditions caractérisant une agression sexuelle inscrites dans notre code pénal, qu’il s’agisse des moyens employés ou de la finalité poursuivie.
C’est précisément la confusion possible entre le nouveau délit « assimilé au harcèlement sexuel » et celui d’agression sexuelle qui m’inquiète. La question du chantage sexuel aurait mérité en elle-même un débat dans cet hémicycle. Le sujet est éminemment sensible et comporte de vrais enjeux pour les victimes. Nous l’avons tous affirmé : les victimes sont la priorité de nos travaux. Il ne faudrait pas, en éludant ce débat, ouvrir une brèche dans l’arsenal protecteur des victimes. Le risque n’est-il pas de voir des faits relevant de l’agression sexuelle sous-qualifiés en harcèlement ?
Je sais bien, madame la ministre de la justice, que les procureurs garderont la possibilité de retenir l’une ou l’autre qualification, et qu’ils n’hésiteront sans doute pas à citer les deux chefs de poursuite.
Je tiens aussi, madame la garde des sceaux, à saluer votre engagement de respecter le principe de séparation des pouvoirs, dans le prolongement des déclarations du Président de la République François Hollande, et du Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Aucun ordre individuel ne devrait donc venir perturber les procédures. Aujourd’hui, soit, mais qu’en sera-t-il à l’avenir ? Je m’éloigne quelques instants du sujet pour vous dire, madame la garde des sceaux, que j’ai eu à subir un ordre individuel… J’en ai donc la lamentable expérience.
Aussi, je crois qu’il est de la responsabilité du législateur de rester vigilant. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé un amendement de suppression de la disposition du projet de loi créant le délit « assimilé » au harcèlement sexuel. J’ai en effet été convaincu par les arguments de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, laquelle estime que le risque de voir des actes relevant de la tentative d’agression sexuelle sous-qualifiés est bien plus grave que celui d’attendre encore pour voir le délit de chantage sexuel inscrit dans notre droit.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, mesdames les ministres, cette difficulté que je me devais de soulever ne conditionne en aucune façon le soutien que j’apporte à ce texte. Je voterai donc ce projet de loi, tout comme mon groupe, le RDSE.
Applaudissements sur les travées du RDSE, de l’Union centriste, du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons tous été étonnés, et même choqués, par la décision du Conseil constitutionnel, non tant d’ailleurs par l’abrogation de la loi que par le choix délibéré de ne pas accorder de délai pour rebâtir rapidement un nouveau texte.
Les juristes ont justifié cette décision par la nature pénale de la loi. Pour autant, derrière le caractère quelque peu contraignant des règles de droit, il y a des victimes, des femmes, parfois des hommes, et des victimes qui n’ont plus de recours, des victimes qui ont pris de gros risques, des victimes qui, au final, se retrouveront bafouées dans leur dignité et obligées d’assumer le coût d’une procédure avortée.
Je ne peux aussi m’empêcher de penser que cette décision témoigne du peu de considération accordée à la question du harcèlement sexuel et des violences faites aux femmes en général. Les chiffres ont été rappelés, et ils sont tristement éloquents. D’après l’enquête européenne, 40 % des femmes environ s’estimaient, à un moment ou à un autre, victimes de harcèlement sexuel. Or, aujourd’hui, seules 1 000 procédures environ sont engagées chaque année, dont 80 aboutissent à une condamnation – des chiffres beaucoup plus précis ont été communiqués tout à l’heure.
Nous connaissons les raisons de cette situation.
Premièrement, il était très difficile pour la victime d’apporter la preuve du harcèlement sexuel, notamment parce qu’il lui fallait prouver l’intention de l’auteur d’obtenir une relation de nature sexuelle.
Deuxièmement, il est extrêmement difficile de franchir le pas, comme nous l’avons souligné d’ailleurs dans tous nos débats sur la question générale des violences faites aux femmes. Le harcèlement aboutit en effet à ce que la victime elle-même porte le poids d’une certaine culpabilité. Franchir le pas, prendre le risque de perdre son travail ou d’être mise de côté, c’est extrêmement difficile.
Troisièmement, nous nous trompons parfois d’approche à force d’assimiler le harcèlement sexuel à une version un peu dégradée de l’agression sexuelle. Certes, dans le harcèlement sexuel, conformément à la directive européenne, il faut qu’il y ait un acte à connotation sexuelle comme moteur, comme source du harcèlement. Toutefois, le but de l’auteur généralement est non pas d’obtenir une relation de nature sexuelle, quelle qu’elle soit, mais de détruire la personne, de l’humilier jusqu’à aboutir à sa destruction psychologique.
Le harcèlement sexuel n’est donc pas une version dégradée de l’agression sexuelle ; c’est proprement et simplement une atteinte à la dignité, et même une tentative de destruction de la personne humaine. Si nous partons de ce principe, nous pouvons effectivement réécrire le texte.
Face à cette violence silencieuse, je veux vraiment dire que les sénatrices et les sénateurs, tous bords confondus, ont eu le souci de la dignité politique.
Je veux remercier le président du groupe de travail, Jean-Pierre Sueur, ainsi que Mme Demontès, Mme Gonthier-Maurin, M. Anziani et tous les sénateurs qui ont eu à cœur de prendre à bras-le-corps ce sujet. Sept propositions de loi ont été déposées, et il n’existe pas de divergences de fond entre les différents groupes politiques. Il peut certes y avoir des clivages, mais ils transcendent les groupes et concernent des points particuliers du texte.
Nous avons tous refusé de politiser ce débat. Nous avons tous refusé de récupérer ce texte à notre profit et de faire de la communication à l’occasion de sa discussion.
Permettez-moi toutefois de regretter, une nouvelle fois, la méthode choisie par le Gouvernement – vous n’êtes pas directement en cause, madame la ministre, car vous n’étiez pas nécessairement favorable à cette voie. Il aurait en effet été nettement préférable de s’appuyer sur le travail sénatorial très profond, très précis et consensuel qui avait été mené, et de reprendre la proposition de loi à laquelle avait abouti le groupe de travail.
Vous ne pouviez pas arguer de l’urgence, car, si vous aviez repris le texte de la proposition de loi, nous n’aurions pas eu à réécrire le projet de loi et à examiner aujourd’hui une soixantaine d’amendements.
Vous ne pouviez pas non plus arguer de la concertation, puisque celle-ci avait déjà eu lieu au sein du Sénat.
J’ai été membre d’un gouvernement avant vous, et je sais le souci d’affichage qui peut parfois motiver certaines décisions, mais, dans cet hémicycle, sur toutes les travées, nous ne souhaitons pas que ce débat soit politisé, car le harcèlement ne relève pas d’un jeu politique.
Le résultat est un texte qui, sur certains points, se situe en retrait par rapport à celui qui a été discuté au sein du groupe de travail. Je pense notamment à un point tout particulier, qui sera largement débattu dans cet hémicycle : l’exigence, dans l’article 1er, d’un acte répété. Elle ne correspond pas à la directive européenne, qui ne fait pas de distinction entre acte répété ou acte unique. D’ailleurs, les Espagnols ont, dans leur loi pénale, repris la définition européenne.
Certains se sont émus – sans exprimer leur préoccupation de manière officielle – que l’on puisse condamner à une peine de prison une personne ayant mis la main aux fesses. Combien de fois avons-nous entendu de tels propos, qui nous ont parfois fait bondir ! C’est une question de bon sens : combien de femmes seraient prêtes à engager une procédure coûteuse et à risquer de perdre leur travail pour une main aux fesses ? Combien de juges seraient disposés à condamner à la prison l’auteur d’un tel acte ?
Prenons également garde, avec le II du texte présenté par l’article 1er pour l’article 222-33 du code pénal, que je juge extrêmement dangereux, à ne pas tomber dans une autre dérive. En effet, ce paragraphe assimile un acte unique accompagné d’ordres, de menaces ou de contraintes dans le but d’obtenir une relation de nature sexuelle à un harcèlement sexuel, alors qu’un tel acte est extrêmement proche d’une agression sexuelle. Le risque est fort de voir des agressions sexuelles requalifiées en harcèlements sexuels, d’autant qu’il faudra prouver l’intention de l’auteur. Or c’est précisément ce qui posait problème dans la précédente loi. Des agressions sexuelles pourraient ainsi rester impunies.
Madame la garde des sceaux, vous avez indiqué que vous aviez vous aussi des doutes quant à la pertinence de la rédaction de ce projet de loi. Si le harcèlement est l’expression d’une régression du corps social, le droit est en soi une expression de la culture. À cet égard, il nous appartient de faire sauter certains verrous culturels.
Ces deux points essentiels ayant été soulignés, je proposerai trois améliorations, qui ont d’ailleurs déjà été présentées par plusieurs de mes collègues.
Tout d’abord, il convient de prendre en compte la vulnérabilité économique des victimes en tant que circonstance aggravante. Je pense ici tout particulièrement aux femmes qui élèvent seules leurs enfants, sachant qu’un tiers des familles monoparentales sont pauvres. Ces femmes, plus encore que d’autres, doivent être protégées.
Ensuite, je suis réservée sur l’inscription parmi les circonstances aggravantes de la minorité de 15 ans, âge de la majorité sexuelle, parce que je ne veux pas de continuum entre agression sexuelle et harcèlement sexuel : tout ce qui permettrait de les assimiler est à mes yeux dangereux.
Enfin, cela a été évoqué tout à l'heure, il faut ouvrir le débat sur les transsexuels. Ces personnes doivent être visées dans les cas de discrimination. Je présenterai un amendement en ce sens.
Vous l’aurez compris, madame la garde des sceaux, je suis choquée par la méthode et je ne vous concèderai rien sur le sujet. D’ailleurs, je ne doute pas que certains collègues, siégeant sur d’autres travées, le soient aussi, mais ils sont tenus par un devoir de solidarité avec le Gouvernement, situation que nous avons nous aussi connue par le passé…
Notre groupe a fait le choix d’une opposition « constructive » sur ce texte. Il est hors de question pour nous d’ouvrir un front sur un tel sujet, aussi voterons-nous le projet de loi. Nous aurons l’occasion, dans les jours qui viennent, d’avoir des débats beaucoup plus politiques !

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, le délit de harcèlement sexuel a été introduit dans notre droit par deux lois adoptées en 1992.
Afin d’apporter une meilleure protection aux victimes, la définition de ce délit a fait l’objet de plusieurs extensions successives. L’extension introduite par la loi du 17 janvier 2002 a conduit à la suppression des principaux éléments constitutifs du délit de harcèlement sexuel. Dès lors, fragilisée, la définition du harcèlement sexuel était à la merci d’une censure du Conseil constitutionnel.
Cette censure est malheureusement intervenue le 4 mai dernier, au motif que la rédaction de l’article 222-33 du code pénal était imprécise. Cette abrogation a conduit à l’abandon de toutes les procédures qui n’étaient pas définitivement jugées à cette date.
Ce véritable déni de justice n’ayant pas manqué de susciter un vif émoi au sein de l’opinion publique, il était primordial d’apporter une réponse rapide à cette censure.
La Haute Assemblée a su une nouvelle fois démontrer sa capacité d’initiative. Plusieurs parlementaires ont souhaité lancer le débat sans tarder. Après avoir consulté plusieurs associations de lutte contre les violences faites aux femmes, j’ai moi-même déposé, le 11 mai dernier, une proposition de loi tendant à qualifier le délit de harcèlement sexuel, en m’appuyant fortement sur la directive européenne. Au total, ce sont sept propositions de loi qui ont été déposées sur le bureau du Sénat.
Contrairement à ce qu’a affirmé à l’instant Mme Jouanno, Mme la garde des sceaux et Mme la ministre des droits des femmes ont rapidement témoigné un grand intérêt pour les travaux du Sénat, ce dont je les remercie.
De concert, comme l’a souhaité M. le Premier ministre, le Gouvernement et le Sénat se sont employés à élaborer une réponse adaptée ; je me félicite de cette étroite collaboration. Il ne s’agit pas de tirer la couverture à soi ou d’obtenir je ne sais quel effet d’affichage : l’objectif est d’être efficaces, en travaillant main dans la main. C’est dans cet esprit que débute le quinquennat de François Hollande, le présent projet de loi illustrant la volonté commune du Gouvernement et de la majorité parlementaire d’œuvrer ainsi.
Au cours des cinq dernières années, le Parlement avait trop souvent été ignoré. Son rôle a été négligé, en dépit d’une réforme constitutionnelle censée le renforcer.
Sur ce dossier, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif font de nouveau montre de leur complémentarité et du respect mutuel qu’ils doivent se témoigner.
Je suis très heureux de constater que le projet de loi présenté aujourd'hui par Mme Taubira, au nom du Gouvernement, est le fruit de ce travail commun. Moins de soixante-dix jours après la décision du Conseil constitutionnel, ce texte vient combler un vide juridique inacceptable.
À cet égard, je tiens à saluer la rapidité et la rigueur avec lesquelles le président de la commission des lois, Jean-Pierre Sueur, la présidente de la commission des affaires sociales, Annie David, et la présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, Brigitte Gonthier-Maurin, ont mis sur pied le groupe de travail sur le harcèlement sexuel. Une cinquantaine de personnes ont été auditionnées. Leurs témoignages et leur expertise ont permis de mettre en exergue les écueils que nous devions éviter.
En effet, il fallait tout à la fois fournir une définition du harcèlement sexuel assez précise pour ne pas contrevenir aux exigences du principe de légalité des délits et des peines et offrir aux victimes une protection suffisamment large pour prendre en compte toute la réalité actuelle du phénomène du harcèlement sexuel. Ce nouvel arsenal législatif doit permettre à la justice de lutter plus efficacement contre ces agissements.
Si nous avons su nous mobiliser sur toutes les travées pour offrir une meilleure protection aux victimes, je déplore la situation difficile dans laquelle se trouvent, du fait de la non-rétroactivité de la loi, les personnes qui ont vu annuler le 4 mai dernier les procédures qu’elles avaient engagées.
À cet égard, je tiens à remercier Mme la garde des sceaux d’avoir demandé aux parquets, par le biais d’une circulaire, de requalifier les faits ayant donné lieu à ces procédures en violences volontaires, en harcèlement moral ou en agression sexuelle. Toutefois, nous savons que, malheureusement, cette circulaire ne répondra pas à toutes les situations difficiles créées par la décision du Conseil constitutionnel.
Ce vide juridique soudain, qui a laissé beaucoup de victimes dépourvues face à leurs agresseurs présumés, n’a pas manqué de surprendre nos concitoyens. La décision du Conseil constitutionnel a été critiquée, en particulier à cette tribune par notre collègue Muguette Dini. On peut estimer que le Conseil constitutionnel aurait dû laisser un délai avant l’abrogation de la loi, mais les avis des plus éminents juristes divergent sur ce point.
En tout état de cause, il serait bon que le législateur se remette aussi en question : comment a-t-il pu laisser planer durant dix ans un tel risque de censure sur la définition pénale du harcèlement sexuel, sans intervenir ? Pourquoi un tel attentisme jusqu’à l’issue prévisible, à savoir l’abrogation de la loi ?
Sans vouloir entrer dans une polémique politicienne, je note que ce n’était pas l’actuelle majorité qui était aux affaires entre 2002 et 2012, ni au Gouvernement, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Une situation profondément scandaleuse aurait pu être évitée si le précédent gouvernement avait saisi l’occasion qui lui avait été donnée en 2010 de modifier la définition du harcèlement sexuel, rendue imprécise par l’extension introduite par la loi de 2002.
Je pense ici à la proposition de loi de 2009 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, dont l’article 19 prévoyait que « tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel ».
Cet article avait été voté à l’unanimité par l’Assemblée nationale, mais, lors de l’examen du texte en commission au Sénat, le rapporteur, membre du groupe UMP, avait déposé un amendement visant à supprimer cette nouvelle proposition de définition du harcèlement sexuel, amendement d’ailleurs fortement soutenu par Mme Morano, alors secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité, et adopté par la Haute Assemblée le 24 juin 2010.
Sans cette lourde erreur d’appréciation, la censure du Conseil constitutionnel ne serait certainement pas intervenue, et nous n’en serions pas à débattre du présent projet de loi dans l’urgence.
Aujourd'hui, nous étudions une nouvelle définition du harcèlement sexuel, qui doit permettre d’offrir une meilleure protection aux victimes et, plus largement, de modifier l’approche par notre société, dans son ensemble, de ce délit.
En effet, ce qui touche aussi les victimes, c’est sûrement le manque de prise en compte et de reconnaissance de leurs souffrances. Il faut donc faire évoluer les mentalités.
Cela a été rappelé par de nombreux orateurs, chaque année, environ quatre-vingts affaires de harcèlement sexuel donnent lieu à une condamnation. Même si l’extrême faiblesse de ce chiffre s’explique par l’ancienne définition pénale de ce délit, qui a pu conduire le juge à en faire un simple levier pour déqualifier certaines violences sexuelles, on constate que la réalité du phénomène du harcèlement sexuel est très sous-évaluée en France.
L’enquête réalisée en 2000 sur les violences faites aux femmes, allant au-delà de la stricte définition pénale du harcèlement sexuel, a révélé que ce phénomène avait une ampleur bien plus significative que ce que pouvait laisser supposer le nombre de condamnations prononcées annuellement.
Au demeurant, je profite de cette occasion pour demander une actualisation de cette enquête. Il me semble indispensable de créer un observatoire national des violences faites aux femmes.
Longtemps, la notion de harcèlement sexuel n’a pas été prise au sérieux. Elle continue parfois, malheureusement, à être un objet de moquerie : pour certains, le harcèlement sexuel ne serait en fait qu’une forme de séduction appuyée, voire d’humour déplacé. Ce sujet a parfois été abordé avec une grande légèreté, hélas ! qui a conduit à une banalisation des faits.
Toujours selon l’enquête précitée, 2 % des femmes ont déclaré avoir subi un harcèlement sexuel au cours des douze derniers mois, ce qui représente plus de 200 000 femmes. Ce chiffre témoigne de l’ampleur du phénomène.
Cette enquête nous a aussi permis de constater que le harcèlement sexuel était encore moins rapporté par les femmes que les autres formes d’agression sexuelle, ce qui rend très difficile d’appréhender son étendue. Ce silence est notamment dû au fait que la société n’a pas encore abordé avec le sérieux qui s’impose ce phénomène, pourtant source de profonds traumatismes.
En élaborant ce nouveau projet de loi et en menant un travail approfondi qui a permis à tous les acteurs concernés de s’exprimer, le Gouvernement et le Sénat ont voulu démontrer que la France entend prendre pleinement conscience de l’étendue du harcèlement sexuel et des conséquences de celui-ci pour les victimes.
En matière de prévention, il faut, cela a été dit, miser sur l’éducation, mais également mettre l’accent sur le rôle que peut jouer la médecine du travail. Ce point est souligné dans l’excellent rapport de Mme Gonthier-Maurin.
En effet, il est important que les souffrances psychologiques au travail puissent désormais être mieux détectées et prises en compte. Pendant longtemps, la médecine du travail s’est essentiellement intéressée aux seules affections physiques liées à l’exercice d’une profession. Cependant, on voit aujourd’hui les ravages que causent les souffrances psychiques provoquées par le harcèlement moral ou sexuel au travail. C’est pourquoi il est essentiel d’envisager de davantage sensibiliser les médecins du travail au fléau du harcèlement sexuel.
Avec ce nouvel arsenal législatif, c’est la société dans son ensemble qui doit maintenant se mobiliser. J’espère que nos travaux auront permis d’attirer l’attention des Français sur un phénomène qui mérite toute notre vigilance. Une telle prise de conscience serait sans doute le seul effet bénéfique découlant de la décision du Conseil constitutionnel.
Le projet de loi qui est soumis aujourd’hui à notre assemblée est un texte complet, qui répond aux attentes des victimes. Il était nécessaire d’aller vite pour établir une nouvelle définition du harcèlement sexuel. Il fallait traiter la question de l’acte unique et alourdir les peines. Toutes ces dimensions ont bien été prises en compte dans le texte du Gouvernement, que le groupe socialiste votera avec enthousiasme.
En ce qui concerne les amendements étudiés ce matin en commission des lois, je rappelle que le groupe socialiste est favorable au maintien du terme « environnement », préférable au mot « situation », ainsi qu’à l’intégration de la notion de chantage sexuel, assimilé à du harcèlement, et de l’idée de vulnérabilité due à la situation économique et sociale des victimes.
Enfin, il faut bien sûr prendre en compte l’orientation sexuelle des victimes en tant que circonstance aggravante, comme c’est le cas pour le viol ou l’agression sexuelle. Concernant les transsexuels, M. le rapporteur l’a expliqué ce matin en commission, cela permettra de leur assurer une protection renforcée.
En conclusion, c’est avec fierté que le groupe socialiste votera ce texte. §

Madame la présidente, mesdames les ministres, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, l’inquiétude de nos concitoyens face à la violence, qui ne cesse d’essaimer ses métastases dans le corps social, nous a conduits en de nombreuses occasions, depuis plusieurs années, à réfléchir, à débattre et à légiférer, en somme à réagir.
Ce fut le cas, il y a peu, pour renforcer la lutte contre les violences de groupe et la protection des personnes chargées d’une mission de service public.
Ce fut le cas pour renforcer la protection des victimes et la répression des violences faites aux femmes.
Ce fut le cas, plus généralement, pour renforcer la lutte contre les violences au sein des couples et leurs incidences sur les enfants.
Nous poursuivons aujourd’hui notre travail, notre mission, en organisant la répression des agissements de harcèlement sexuel.
Le harcèlement sexuel est un drame humain mal compris, trop souvent méprisé. Si ce constat nous paraît évident, il est fondamental que nous tentions d’apprécier la souffrance, réelle et profonde, mais relativement méconnue, des victimes.
Il s’agit de bien plus que d’un banal fait de société représentant, d’après la Chancellerie, moins de cent cas annuels. En effet, ce chiffre ne recouvre que les décisions rendues par les juridictions, et ne reflète certainement pas la réalité du nombre de vies déstructurées du fait du harcèlement, encore trop rarement dénoncé et réprimé.
Notre responsabilité, vous l’aurez compris, mes chers collègues, est donc aujourd’hui importante, et je forme le vœu que notre travail législatif encouragera des victimes à sortir du silence.
Il s’avère donc à nos yeux absolument nécessaire de réprimer toutes les formes de harcèlement sexuel, y compris celles qui sont commises dans des circonstances particulières –à l’occasion d’un entretien d’embauche ou de l’attribution d’un logement, par exemple –, de définir l’infraction dans des termes suffisamment précis pour sécuriser les procédures, enfin d’alourdir les peines en cas de circonstances aggravantes, en particulier lorsque l’auteur des faits exerce une autorité hiérarchique sur la victime.
Près de deux mois après l’abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel, jugée trop floue par le Conseil constitutionnel, le Gouvernement a décidé de présenter un projet de loi, relativement critiqué.
Au-delà de la méthode employée, sur laquelle je ne reviendrai pas, votre texte, madame la garde des sceaux, présentait une structure compliquée, qui, pour autant, ne méritait pas les propos ou qualificatifs excessifs, en tout cas peu soucieux des impératifs propres à un État de droit, formulés par certaines associations.
Je disais que votre texte était compliqué ; en effet, les conditions de la première forme de harcèlement sexuel que vous aviez définies pouvaient paraître cumulatives avec celles de la seconde.
Il était non seulement compliqué, mais également peu opérationnel, dans la mesure où la victime devait prouver une succession d’éléments matériels afin de voir retenue l’infraction la plus sévèrement réprimée.
Enfin, votre texte constituait un signal dramatique pour la dignité de la personne humaine, car la forme la plus grave de harcèlement sexuel aurait été moins punie que le délit de vol simple, ce qui maintenait dans notre droit pénal une illégitime sous-pénalisation des atteintes aux personnes par rapport aux atteintes aux biens.
Par conséquent, mes chers collègues, je salue, comme l’a fait précédemment Jean-Jacques Hyest, le travail effectué par Alain Anziani, qui a su reprendre judicieusement les éléments de réflexion élaborés par le groupe de travail auquel nous avons participé.
Alors que la transposition à l’identique de la directive européenne aurait été un mauvais choix juridique, car celle-ci couvre un champ plus vaste, concerne exclusivement le droit du travail et pose en outre des problèmes de traduction, la manière dont le rapporteur a, en quelque sorte, objectivé les éléments matériels du délit me paraît constituer, sur le plan juridique, du très bon travail.
De même, le rapporteur a tenu à renforcer la portée et l’efficacité du texte en évitant que le ressenti de la victime soit considéré comme un élément matériel : s’il l’avait été, cela aurait fragilisé le dispositif. Nous devons avoir à l’esprit que toute situation doit être analysée de la manière la plus objective possible : la juxtaposition d’éléments subjectifs ne suffit pas à définir une infraction pénale. Le droit pénal repose sur un principe de légalité strict. À poursuivre des faits qui ne seraient pas précisément décrits, nous risquerions une nouvelle fois d’encourir la sanction du Conseil constitutionnel.

Les comportements qui relèvent du harcèlement sexuel sont nombreux et divers. De fait, la perversité que peut receler l’imagination humaine n’a pas de limite en ce domaine. Vouloir établir une liste me paraît donc complètement irréaliste.
Alors que prévoir une seule rédaction pour les multiples hypothèses de harcèlement sexuel était impossible, la solution de l’assimilation retenue pour « raccrocher » au harcèlement les faits uniques de « chantage sexuel » constitue, là encore, un excellent travail, compréhensible par tous les citoyens.
De plus, comme nous l’a démontré le Défenseur des droits, des agissements relativement bénins peuvent constituer une réelle agression lorsqu’ils sont répétés, tandis qu’un acte isolé doit pouvoir être incriminé lorsqu’il revêt une gravité certaine, sans pour autant avoir été réitéré. Il eût donc été aberrant d’indiquer que le harcèlement sexuel n’était pas répétitif. C’est pourquoi la formule que vous proposez, monsieur le rapporteur, évite cet écueil.
Votre travail est donc de nature à susciter le consensus, même si le groupe UMP a déposé deux amendements, que je qualifierais d’amendements de clarification.
Le premier a trait au I de la rédaction présentée par l’article 1er pour l’article 222-33 du code pénal, paragraphe dont nous avons longuement débattu, aussi bien au sein du groupe de travail qu’en commission des lois. Nous devons être très vigilants sur le choix des mots. Je fais ici référence au terme « environnement », issu de la directive européenne, qui n’est que la traduction d’un mot anglophone.
Nous proposons donc, pour améliorer la lisibilité de la loi, de remplacer ce terme par le mot « situation », qui permettrait de rendre compte de façon plus objective du climat particulier d’ostracisme dans lequel est souvent placée la victime de harcèlement sexuel. En tant que législateur, mais aussi en qualité de praticien du droit, je dirais que nous devons tout faire pour faciliter la preuve dans ce type d’affaires. La loi doit décrire les actes positifs qui font tomber leur auteur sous le coup de l’incrimination. Je dois dire, rejoignant ainsi des propos qui ont été tenus précédemment, que la transversalité des idées au sein de la commission a permis à certains de nos collègues, en particulier Esther Benbassaet Alain Richard, de se rallier à notre amendement, lequel a été adopté par la commission.
Si j’en crois vos propos, monsieur le rapporteur, notre second amendement ne posera pas beaucoup de difficultés, puisqu’il a également pour objet d’améliorer la lisibilité de la loi. Nous souhaitons remplacer les mots « comportements ou tous autres actes » par le terme « agissements ».
En conclusion, hormis ses conséquences immédiates, choquantes et graves pour les victimes ayant saisi la justice, la décision du Conseil constitutionnel était juridiquement bienvenue. Nous avons ici une occasion exceptionnelle de produire une nouvelle définition du harcèlement sexuel, qui ne soit ni si vague qu’elle englobe d’autres infractions, ni si précise qu’elle conduise systématiquement à la relaxe.
Cette définition, que le Conseil constitutionnel nous a justement contraints à récrire, devra être plus protectrice des victimes et assurer une répression plus efficace. Il nous appartient à tous d’éviter la censure du juge constitutionnel sur d’autres aspects du texte.
Applaudissements sur les travées de l'UMP. – M. le président de la commission des lois et Mme Esther Benbassa applaudissent également.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, beaucoup a déjà été dit sur le vide juridique qu’a brutalement créé la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai dernier. Nous sommes tous convaincus de la nécessité de combler rapidement et efficacement ce vide.
Le harcèlement sexuel fait aujourd’hui l’objet d’environ mille dépôts de plainte et quatre-vingts condamnations par an, mais les faits condamnés relèvent souvent de l’agression sexuelle plutôt que du harcèlement. Cela étant, nous sommes tous ici persuadés que ces chiffres sont loin de rendre compte de l’importance réelle du phénomène.
Plus du quart des personnes mariées et environ un tiers de celles qui vivent en couple se sont rencontrées sur leur lieu de travail. Ce pourcentage peut même aller jusqu’à près de 80 % pour certaines professions, notamment celle d’ingénieur.
Tous ces éléments montrent bien la complexité des situations et la nécessité d’élaborer rapidement un tel texte, qui doit absolument permettre d’établir une distinction très nette entre les comportements sociaux valorisants et enrichissants et ceux qui sont clairement inacceptables.
Chaque mot du présent projet de loi revêt donc une extrême importance, mais il était néanmoins nécessaire d’aller vite. Chaque terme doit être soigneusement pesé, de façon que le droit soit efficace. En la matière, il convenait en premier lieu de définir très précisément ce qui est susceptible de relever du harcèlement sexuel.
Madame la garde des sceaux, vous m’avez fait l’honneur de citer ma description du harcèlement, sexuel ou moral, que j’ai comparé au supplice de la goutte d’eau. Il s’agit d’un délit à part entière, et je partage sur ce point l’analyse de ma collègue Chantal Jouanno, qui affirmait tout à l’heure que le harcèlement sexuel n’est pas un « sous-délit » ou la déqualification d’une agression sexuelle.
Le supplice de la goutte d’eau, en l’occurrence, c’est le supplice infligé par chaque mot, par chaque phrase intentionnellement délivrés par le harceleur pour frapper, pour blesser, pour humilier celui ou celle à qui il s’adresse, en accompagnant souvent ses paroles de gestes et d’attitudes visant au même objectif et aggravant encore la situation.
Ces mots, ces phrases, ces gestes, ces attitudes caractérisent le harceleur, certes, mais avant tout un comportement : le harceleur considère autrui non pas comme une personne, mais comme un objet dénué de tout droit, destiné à son seul usage, à son seul désir d’emprise, de possession, parfois ultime.
C’est ce comportement qu’il importe, aujourd’hui, de redéfinir pour pouvoir lutter contre un phénomène extrêmement violent, le harcèlement consistant en actes de violence psychologique, pouvant aller jusqu’à la violence physique et sexuelle.
Je me félicite – cette fois, je suis en désaccord avec ma collègue Chantal Jouanno – de l’assimilation au harcèlement sexuel de faits que nous qualifions, dans la vie courante, de « chantage sexuel ». En effet, l’auteur d’un chantage sexuel manifeste le même type de comportement que le harceleur au quotidien : lui aussi considère l’autre comme un objet dont il peut faire usage. Un harceleur, même s’il n’a commis qu’un acte unique contre une victime donnée, réitérera son comportement avec d’autres dans des circonstances identiques.
La victime d’un chantage sexuel subira exactement les mêmes pressions et les mêmes dommages dans sa vie quotidienne, qu’elle ait cédé ou non. Elle sera en plus sous la menace du chantage, au strict sens pénal du terme, celle de se voir établir une réputation de femme facile, par exemple. Sa situation, au travail et ailleurs, sera forcément fragilisée par les agissements de son harceleur, que celui-ci pourra toujours réitérer.
Le comportement de l’auteur d’un chantage sexuel est du même type que celui d’un harceleur au quotidien. Pour sa victime, les conséquences sont les mêmes.
Dans les deux cas, des personnes souvent heureuses de vivre, entretenant des relations sociales riches, finissent petit à petit, sous l’effet du harcèlement sexuel, par avoir du mal à simplement trouver les mots pour exprimer à quel point elles sont poursuivies, traquées, humiliées, comment le malaise a progressivement envahi leur vie au quotidien pour se transformer en mal-être, en anxiété, en angoisse parfois, jusqu’à les amener à s’isoler, à se replier complètement sur elles-mêmes, ayant perdu toute confiance en elles et en les autres. Il est extrêmement important d’avoir ces réalités à l’esprit, d’autant que de telles situations de détresse peuvent conduire à commettre un geste définitif. Voilà contre quoi nous devons aujourd’hui nous redonner les moyens de lutter.
S’est aussi posée la question de la preuve, ardemment débattue. J’ai même entendu évoquer l’hypothèse d’une inversion de la charge de la preuve en matière de harcèlement sexuel.
D’une façon générale, je me suis demandée pourquoi un tel délit suscitait autant de discussions sur le choix des termes.
En fait, dès qu’il y a dépôt de plainte pour harcèlement sexuel, il y a forcément un auteur et une victime, même quand la plainte n’est pas fondée, ce qui peut arriver.
Si la plainte est fondée, les choses sont très claires pour tout le monde : la victime est la personne – la plupart du temps une femme – qui a déposé plainte, l’auteur des faits est la personne visée par la plainte.
Si la plainte n’est pas fondée, il y a aussi une victime, une personne dont la vie familiale, professionnelle, privée peut être bouleversée : il s’agit cette fois de l’auteur présumé des faits.
Dans les deux cas, l’auteur des faits et la victime se connaissent, ont des relations sociales quotidiennes, au travail ou ailleurs. Dans l’hypothèse où la plainte n’est pas traitée, l’est avec retard ou fait l’objet d’un classement sans suite, on laisse face à face l’auteur et la victime, quels qu’ils soient, liés par les mêmes relations qu’auparavant. Autrement dit, on laisse perdurer la situation, qu’il s’agisse de harcèlement ou de dénonciation calomnieuse, laquelle peut très bien s’apparenter à du harcèlement moral. Cela est totalement inacceptable pour la victime, quelle qu’elle soit.
Voilà ce qui fait toute la complexité et toute la particularité du débat que nous avons aujourd’hui : auteur des faits et victime se connaissent et restent unis par les mêmes relations qu’avant le dépôt de la plainte pendant le temps de l’enquête.
Pour autant, cette situation particulière justifie-t-elle d’ouvrir une brèche dans le principe de la présomption d’innocence prévu par notre droit ? Je ne le crois pas.
Madame la garde des sceaux, madame la ministre, vous nous avez montré la détermination du Gouvernement à lutter contre ce fléau. J’ai confiance en l’efficacité des actes que pourra poser le Gouvernement, en adressant des circulaires aux parquets, aux tribunaux de prud’hommes, aux tribunaux administratifs, en affichant des priorités, en donnant des instructions pour que jamais une plainte pour harcèlement sexuel ou pour harcèlement moral ne soit classée sans qu’une enquête rapide et approfondie ait été menée pour déterminer précisément qui est la victime et qui est l’auteur des faits. On ne doit pas laisser les choses en l’état.
Le Gouvernement doit aussi, sans doute, développer des moyens de formation interinstitutionnelle. Le comportement du harceleur étant parfois pathologique, n’ayons pas peur d’intégrer dans des groupes pluridisciplinaires des psychiatres ou des psychologues qui sauront aider les enquêteurs et les magistrats à identifier ce type de comportement, à mieux faire la part des choses et à déterminer plus rapidement qui est la victime.
Pour toutes ces raisons, et parce que je crois que le texte fait vraiment consensus, hormis sur quelques points pouvant sans doute être réglés par d’autres voies, je voterai bien évidemment ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Esther Benbassa applaudit également.

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, le harcèlement sexuel est une véritable plaie – je reprends ce mot à mon compte –, sur laquelle la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes s’est longuement penchée et dont elle a précisé les contours à partir des études disponibles et des nombreuses auditions qu’elle a organisées.
Nous sommes tous mobilisés par la nécessité d’agir rapidement à la suite de la décision prise par le Conseil constitutionnel le 4 mai dernier. Se prononçant dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, celui-ci a en effet abrogé l’article 222-33 du code pénal, relatif au harcèlement sexuel. Il était hors de question de laisser plus longtemps les victimes sans recours devant le juge pénal.
Avant toute autre chose, je souhaite dire combien nous entendons la colère et mesurons le désarroi des victimes, qui, à la suite de cette décision du Conseil constitutionnel, se sont trouvées dessaisies, pour nombre d’entre elles, de leurs poursuites. J’ai encore en mémoire le témoignage, entendu à la radio, d’une femme en pleurs à la sortie du tribunal qui l’avait en quelque sorte congédiée…
La Chancellerie a certes recommandé aux parquets, lorsque les affaires en étaient au stade des poursuites, d’examiner si les faits initialement qualifiés de harcèlement sexuel pouvaient être poursuivis sous d’autres qualifications. Lorsque la juridiction correctionnelle était malheureusement déjà saisie et les poursuites engagées sur le fondement de l’article 222-33 du code pénal, la Chancellerie recommandait aux parquets de requérir la nullité de la qualification juridique retenue, la poursuite étant désormais dépourvue de base légale.
Nous avons tous notre part de responsabilité dans cette situation, même si, à l’époque de l’élaboration de la loi désormais abrogée, les deux assemblées parlementaires avaient, en toute bonne foi, cru bien faire.
Compte tenu de l’émotion suscitée, il n’est pas cependant inutile de souligner que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a rappelé, au cours de son audition devant le groupe de travail, que « même si les faits sont poursuivis sous la seule qualification de harcèlement sexuel, le juge pénal, saisi in rem, n’est jamais lié par la qualification retenue par le ministère public. Il a seulement l’obligation de respecter le principe du contradictoire : toutes les parties doivent être en mesure de livrer leurs observations sur la nouvelle qualification. Des faits de harcèlement sexuel peuvent ainsi être requalifiés en tant que violences volontaires, notamment psychologiques. »
Si la décision du Conseil constitutionnel était lourde de conséquences, elle n’entraînait pas pour autant une annulation juridique pour toutes les poursuites en cours. Il n’en reste pas moins que, en visant l’insuffisance de la définition des éléments constitutifs de l’infraction de l’article en cause, le Conseil constitutionnel a pointé du doigt un manque de vigilance du Parlement et du gouvernement en place à l’époque.
La notion de harcèlement sexuel est assez récente en droit français. Elle a été introduite par deux lois votées en 1992 et a fait l’objet de plusieurs modifications tendant à son extension, afin de mieux protéger les victimes de ces agissements intolérables.
Le harcèlement sexuel fut défini à l’article 222-33 du nouveau code pénal comme « le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ». Ce délit était puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Ce volet pénal a été complété la même année par un volet social introduit dans le code du travail et dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La définition retenue du harcèlement sexuel était voisine de celle figurant dans le code pénal.
En 1992, le harcèlement sexuel comportait trois éléments constitutifs.
Il s’agissait, premièrement, d’éléments matériels, autrement dit d’actes fautifs : ordres, menaces, contraintes, voire pressions de toute nature.
Il s’agissait, deuxièmement, d’un abus d’autorité : pour être constitué, le harcèlement sexuel devait émaner d’une personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions. Ce point est très important, nous allons y revenir.
Il s’agissait, troisièmement, d’un élément intentionnel : l’obtention de faveurs de nature sexuelle.
Quelques années plus tard, en 1998, la loi relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs a retouché à la marge la définition du harcèlement sexuel donnée par l’article 222-33 du code pénal, pour la rapprocher de celle du code du travail. Le harceleur était défini non plus comme une personne « usant d’ordres, de menaces ou de contraintes », mais comme une personne « donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves ». C’était se faire un peu plus précis dans la description de ses agissements.
Jusque-là, tout allait bien. C’est avec la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, que, voulant bien faire, nous avons manqué de vigilance. Sachons reconnaître nos erreurs, surtout quand il s’agit de qualifier des actes fautifs.
Nous avons, à l’Assemblée nationale et au Sénat, mal mesuré qu’en élargissant le champ de la notion de harcèlement sexuel, nous finissions par vider celle-ci de sa substance.
Sur une initiative parlementaire du groupe communiste, cette loi de modernisation sociale a introduit en droit français l’interdiction du « harcèlement moral ».
La première définition proposée s’inspirait de la définition en vigueur du harcèlement sexuel, pour lequel l’abus d’autorité était un élément constitutif du délit.
Ayant considéré, lors des étapes ultérieures de la discussion parlementaire, que des actions de harcèlement moral pouvaient également intervenir en dehors de toute subordination hiérarchique, le Parlement a supprimé cet élément constitutif.
Par contrecoup, la loi de modernisation sociale a également élargi la définition du harcèlement sexuel en procédant à la suppression de deux de ses trois composantes : l’abus d’autorité, le harcèlement sexuel pouvant dorénavant être constitué en dehors de toute relation hiérarchique ; les éléments matériels, à savoir les actes fautifs propres au registre de l’abus d’autorité, tels que ordres, pressions, menaces, contraintes, pressions graves.
Cet élargissement s’est opéré en deux temps.
L’Assemblée nationale a tout d’abord adopté, en deuxième lecture, un amendement du Gouvernement tendant à supprimer, dans le code du travail, la référence à l’abus d’autorité et aux actes fautifs.
Puis le Sénat, par souci de cohérence et avec l’avis favorable du Gouvernement, a également supprimé, dans l’article 222-33 du code pénal, sur l’initiative de sa commission des affaires sociales, les références à l’abus d’autorité et aux actes fautifs.
Je rappelle quels étaient les trois éléments constitutifs du harcèlement sexuel prévus par la loi de 1992 : les éléments matériels, l’abus d’autorité et l’élément intentionnel, à savoir l’obtention de faveurs de nature sexuelle.
En passant du code du travail au code pénal, en étendant la notion de harcèlement moral à des agissements commis en dehors de tout rapport hiérarchique, en voulant, en quelque sorte, calquer le champ du harcèlement sexuel sur celui du harcèlement moral, nous avons fini par ne définir le harcèlement sexuel que par le troisième de ces éléments constitutifs, c’est-à-dire l’intention.
En 2002, l’article 222-33 se trouvait ainsi rédigé : « Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Le harcèlement sexuel n’était plus défini que par sa finalité : l’obtention de « faveurs de nature sexuelle ». Le législateur, soucieux d’apporter une protection plus étendue aux victimes de harcèlement sexuel, avait cru bien faire. En élargissant le champ de la notion, il en limitait la compréhension. On assista alors à un doublement du nombre de condamnations prononcées chaque année et, dix ans après, à l’abrogation du dispositif par le Conseil constitutionnel.
La commission des lois, celle des affaires sociales, la Délégation aux droits des femmes, notre groupe de travail et les auteurs des différentes propositions de loi ont accompli un travail tout à fait remarquable, que je tiens à saluer. Dès que nous avons appris la censure du Conseil constitutionnel, nous avons réagi pour réparer une faute aujourd’hui vieille de dix ans.
Comme le rapporteur a bien voulu le dire, voilà quelques années que je consacre une partie de mon action à la défense des femmes. C’est donc avec bonheur que je voterai ce texte. §

Madame la présidente, mesdames les ministres, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, nous avons le devoir et la responsabilité de légiférer en urgence pour combler le vide juridique résultant de l’abrogation par le Conseil constitutionnel de la loi sur le harcèlement sexuel, considérée non conforme à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen prévoyant l’obligation de définir les crimes et délits en des termes suffisamment clairs et précis.
En effet, en mai dernier, à la suite du dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité, l’incrimination de harcèlement sexuel prévue à l’article 222-33 du code pénal a été déclarée trop floue et comportant de nombreuses imprécisions quant à la qualification du délit.
Les conséquences de ce vide juridique sont dramatiques : tous les plaignants – il s’agit majoritairement de plaignantes – se retrouvent dans une situation impossible puisqu’aucune qualification pénale de remplacement, celle d’agression sexuelle, par exemple, n’est envisageable au vu des faits dénoncés. Cette abrogation a provoqué l’incompréhension et plongé dans une détresse plus grande encore des femmes ayant porté plainte pour harcèlement sexuel et osé parler, bravant ainsi, souvent au prix d’efforts extrêmes, les pressions et la honte.
En Martinique, et de manière générale dans les départements d’outre-mer, les femmes commencent à peine à oser dénoncer de tels actes. Le contexte économique difficile et le taux de chômage important favorisent, par ailleurs, ce silence des victimes. Les difficultés qu’elles rencontrent, la peur qui les habite, les effets catastrophiques du harcèlement sur elles et l’impunité dont bénéficient les harceleurs représentent autant de barrières difficiles à franchir…
L’urgence de légiférer est d’autant plus grande que l’article L. 1153-1 du code du travail, qui interdit « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers », est dès lors susceptible de faire l’objet, à son tour, d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Oui, mes chers collègues, depuis dix ans, l’impérieuse nécessité de réformer cette loi, de mieux définir et encadrer un délit créé il y a vingt ans à la suite de l’adoption d’un amendement de la députée socialiste Yvette Roudy a régulièrement été soulignée, mais en vain ! Ce dossier majeur pour des milliers de femmes et d’hommes victimes de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail ou dans leur vie quotidienne n’a pas été traité.
J’évoquerai un exemple d’occasion manquée.
Lors du débat sur la proposition de loi relative aux violences faites aux femmes, en février 2010, l’Assemblée nationale avait adopté à l’unanimité une définition plus précise du harcèlement sexuel. En effet, celui-ci avait alors été défini par l’article 19 de cette proposition de loi comme « tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
Malheureusement, le 16 juin 2010, lors de l’examen de la proposition de loi par le Sénat, la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité a soutenu, devant la commission des lois, un amendement déposé par un sénateur visant à supprimer cet article 19. C’est ainsi que, le 24 juin 2010, le Sénat a entériné sans aucune discussion cet amendement de suppression, ce qui a conduit à la censure du 4 mai dernier et à la situation d’aujourd’hui.
Dans mon action politique, j’ai toujours affirmé mon engagement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

C’est pourquoi je soutiendrai et voterai ce projet de loi issu des travaux de la commission créant deux infractions distinctes : le harcèlement par répétition et le harcèlement par chantage sexuel, sanctionné d’une peine plus sévère.
Ce texte, que nous allons sans plus tarder enrichir de quelques amendements, a le mérite d’être juste et efficace pour les dizaines de milliers de personnes qui sont chaque année touchées par les violences sexistes. Il sera inattaquable sur le plan juridique.
Je tiens donc à saluer le travail du Gouvernement, qui, dès le lendemain de sa nomination, s’est attelé à la rédaction d’un projet de loi après avoir engagé plusieurs entretiens et consultations avec les associations de défense du droit des femmes et les professionnels de la justice. §

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
J’ai écouté avec beaucoup d’attention tous les sénateurs qui ont pris part à ce débat de très haute tenue, et relevé une convergence de vues sur le texte issu des travaux de la commission des lois. Je voudrais maintenant répondre à chacun.
Voilà quelques semaines que nous travaillons ensemble et je tiens à vous remercier de la qualité de votre réflexion. Le Gouvernement, qui a dû œuvrer dans l’urgence, à peine nommé, a fait son miel de vos contributions.
Je voudrais saluer, en particulier, la grande valeur du travail accompli par la présidente de la Délégation aux droits des femmes et par les rapporteurs, avec qui nos échanges ont d’emblée été tout à fait fructueux.
Je rends également hommage à l’implication personnelle de M. le président de la commission des lois, qui a su apporter une touche toute particulière à la préparation de ce débat.
Nous sommes à l’évidence tous animés par la volonté de produire une bonne et belle loi, qui certes ne compensera pas les souffrances psychologiques et les préjudices financiers subis par les victimes en raison du vide juridique brutalement survenu, mais qui représentera une œuvre législative utile pour l’avenir.
Mme Jouanno a regretté que le Gouvernement ait présenté un projet de loi. Sur ce point, des éléments de réponse ont déjà été apportés, notamment par M. Kaltenbach. Le dépôt de ce texte est la preuve de l’engagement du Gouvernement sur ce sujet et de sa mobilisation pour assurer le « service après-vote », au travers notamment de la rédaction de la circulaire d’application de la loi et de l’appréciation de la mise en œuvre de celle-ci.
Dans le même esprit, j’ai demandé par circulaire aux parquets de me faire remonter les réquisitions et les décisions. À ce propos, je souligne, pour répondre à une observation qui m’a été faite, qu’il s’agit d’éléments techniques et juridiques, et non pas personnels. Je suis en mesure de vous dire que, sur 130 procédures, 50 ont fait l’objet d’une requalification, soit environ 40 % du total.
Les parquets ont fait du mieux possible en la matière. Évidemment, la situation est frustrante pour les personnes dont les plaintes n’ont pas été requalifiées, mais l’action publique n’est donc pas éteinte dans tous les cas.
M. Pillet a estimé que prévoir des sanctions moins lourdes que pour les atteintes aux biens risquait de porter atteinte à la dignité des victimes. S’il y a un problème de cohérence dans notre code pénal, monsieur le sénateur, c’est parce que, ces dernières années, l’adoption d’une profusion de lois souvent circonstancielles a abouti à pénaliser plus fortement les atteintes aux biens. Ce fut le cas, en particulier, en mars 2011, avec l’inscription, à l’article 311-5 du code pénal, d’une peine de sept ans d’emprisonnement pour sanctionner des vols commis dans des locaux contenant des fonds.
Par ailleurs, depuis juillet 2008, l’article 311-4-2 du code pénal dispose que le vol est puni de sept ans d’emprisonnement, au lieu de trois ans auparavant, lorsqu’il porte sur un objet classé.
Vous posez un vrai problème, celui de la cohérence des quanta de peines applicables aux délits ou aux crimes prévus par le code pénal, et, plus généralement, de l’échelle des valeurs dans la société. N’est-il pas plus grave de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique des personnes que de s’en prendre aux biens ? Un grand désordre règne aujourd’hui dans le code pénal en matière d’échelle des peines. Nous avons paré au plus pressé en veillant à la cohérence des peines encourues pour les infractions à caractère sexuel.
Il est exact, monsieur Anziani, que des viols ou des agressions sexuelles ont pu être requalifiés en harcèlement sexuel, et que le fait d’élargir le champ de cette dernière incrimination fait ressurgir la crainte de telles requalifications.
Je vous ferai une première réponse de principe : il convient de faire confiance aux magistrats, qui apprécieront les situations. Cela étant, il est vrai que l’on correctionnalise certaines affaires, en raison de la longueur des délais de traitement.
C’est tout à fait exact !
Nous devons donc faire un travail de fond, afin que les juridictions puissent fonctionner dans des conditions normales et n’en soient pas réduites à des pis-aller, car transformer des crimes en délits revient à atténuer la gravité des faits commis. Dans ce domaine, il nous faut agir très rapidement.
Il appartient certes aux magistrats d’apprécier les situations, mais, comme je l’ai dit dans mon intervention liminaire, la circulaire générale d’application de la loi indiquera très précisément que l’élargissement du champ de l’incrimination de harcèlement sexuel ne saurait conduire à une atténuation et à une requalification des agressions sexuelles et des viols.
En ce qui concerne le cas des mineurs de 15 à 18 ans, dans l’hypothèse où l’amendement qui sera examiné tout à l’heure ne serait pas adopté, la circulaire pourra également inciter à ce que l’abus d’autorité soit volontiers retenu comme caractère aggravant dans les réquisitions. Cela étant, je ne veux pas préjuger du vote du Sénat !
J’ai relancé, voilà une dizaine de jours, le numéro d’urgence « 08victimes », qui avait été quelque peu délaissé ces derniers temps. Or ce numéro d’urgence, lorsqu’il est bien géré, rend un service de qualité pour les victimes de harcèlement sexuel. Il convient simplement d’assurer la pérennisation de son financement.
Pour l’essentiel, les autres points qui ont été abordés sont liés aux articles et aux amendements ; je répondrai donc plus précisément lors de l’examen de ces derniers.
Je tiens à vous remercier encore une fois très chaleureusement, mesdames, messieurs les sénateurs, de la qualité de votre travail. En cette circonstance, j’éprouve très fortement et profondément le sentiment que nous faisons œuvre utile, grâce à votre action déterminée. §
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je serai brève car, à l’instar de Mme la garde des sceaux, je répondrai lors de la discussion des articles sur les points qui font l’objet d’amendements.
Je tiens à saluer la qualité de ce débat et à remercier l’ensemble des intervenants de leur engagement unanime pour améliorer ce texte.
Je remercie en particulier Mme Gonthier-Maurin d’avoir rappelé un certain nombre d’éléments essentiels. La création d’un observatoire des violences faites aux femmes nous semble, à nous aussi, importante.
Mme Gonthier-Maurin et Mme Benbassa ont insisté sur la nécessité de renforcer le dispositif de sanctions à l’université : nous sommes d’accord avec elles. Ce sujet fera l’objet d’un travail commun avec ma collègue Geneviève Fioraso, ministre de l’enseignement supérieur ; nous y reviendrons.
La médecine du travail doit effectivement être associée à l’indispensable action de prévention, de détection des cas de harcèlement sexuel et de soutien aux victimes.
Vous souhaiteriez en outre que le milieu du sport soit sensibilisé à cette problématique. Sachez que ma collègue Valérie Fourneyron, ministre des sports, s’y attache.
Il convient de garder à l’esprit que la campagne de sensibilisation et de communication sur le harcèlement sexuel que nous entendons lancer à l’automne sera très large et touchera aussi l’université et les milieux sportifs.
J’ai apprécié, madame Dini, vos propos. Étant du même département, nous savons bien, vous et moi, ce qui a été à l’origine de cette fameuse question prioritaire de constitutionnalité !
Comme vous l’avez dit, la prévention et la lutte contre le harcèlement commencent dès le plus jeune âge. Le combat contre les stéréotypes sera, bien sûr, l’une des priorités de mon ministère, dont je souligne qu’il est de plein exercice. En outre, dans chaque ministère et dans chaque administration, un haut fonctionnaire est désormais chargé du dossier de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette mesure décidée par le Gouvernement revêt une importance toute particulière s’agissant de l’éducation nationale, car elle me permettra d’organiser avec mon collègue Vincent Peillon la lutte contre les stéréotypes dès le plus jeune âge.
Vous avez également évoqué le cas des élus. Il s’agit d’une question importante, sur laquelle nous aurons sans doute l’occasion de revenir ultérieurement. Comme vous le savez, des circonstances aggravantes sont prévues, ainsi que des peines complémentaires, telles que la privation du droit de vote ou l’inéligibilité. Il appartiendra aux magistrats d’apprécier au cas par cas.
Madame Benbassa, je vous remercie pour votre témoignage, plus qu’éloquent, sur les instances disciplinaires. Il est vrai que, parfois, on a le sentiment que le droit y est ignoré. C’est là un sujet important, dont le Gouvernement va s’emparer. Comme je l’ai dit dans mon propos liminaire, j’y travaillerai en particulier avec ma collègue Geneviève Fioraso.
Monsieur Courteau, je tiens à saluer le travail que vous accomplissez depuis longtemps déjà. Vous aussi avez souhaité la création d’un observatoire des violences faites aux femmes. Cette idée semble décidément faire l’unanimité, ce qui me conforte dans mon intention de mettre en place une telle instance !
Vous avez rapporté le témoignage d’une femme détruite tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. De telles situations doivent nous inciter à tous nous mobiliser. Je crois que le texte que nous sommes en train de bâtir ensemble apportera une réponse à la hauteur des enjeux.
Mme Assassi a rappelé que le harcèlement sexuel est une atteinte à l’égalité entre les femmes et les hommes et souligné la nécessité de le réprimer y compris en l’absence d’intention d’obtenir des faveurs de nature sexuelle. Le présent texte marque, à cet égard, un véritable progrès.
Vous appelez de vos vœux une loi efficace pour les victimes. C’est également notre objectif. Outre que l’on n’a jamais autant parlé du harcèlement sexuel que depuis le 4 mai dernier, ce qui a contribué à libérer la parole de nombreuses victimes, la décision du Conseil constitutionnel nous donne au moins l’occasion d’élaborer un texte qui sera, je l’espère, de bien meilleure qualité que la loi abrogée.
Madame Meunier, vous aussi avez rappelé que le harcèlement sexuel est une manifestation d’une société fondée sur l’inégalité entre les femmes et les hommes. Nous sommes d’accord ! Pour cette raison, toutes les questions liées aux droits des femmes et à l’égalité entre les sexes doivent être envisagées globalement : un travail d’ensemble est à accomplir pour déconstruire un certain nombre de codes et de clichés. J’espère, madame la sénatrice, que vous nous y aiderez.
Vous avez dit également, à très juste titre, que la loi ne fait pas tout. C’est pourquoi nous l’accompagnerons d’un effort de communication et de lutte contre les représentations, ainsi que d’approfondissement de la connaissance des phénomènes de violence. Nous y reviendrons lors de la discussion des articles.
Monsieur Bourquin, vous avez souligné avec raison l’importance du rôle des collectivités territoriales dans le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Cela m’offre l’occasion de répéter devant la Haute Assemblée, représentante des collectivités territoriales, que l’action pour l’égalité entre les sexes doit être menée par tous. Il existe une véritable complémentarité entre la politique conduite à l’échelon national et les expérimentations mises en place par les collectivités territoriales, qui souvent méritent d’être généralisées.
Mme Jouanno, comme Mme Meunier, a soulevé la question des transsexuels. Nous l’aborderons lors de la discussion des articles, mais je tiens d’ores et déjà à souligner qu’elle est prise en compte dans les textes actuels. Cela étant, nous avons sûrement à le faire davantage savoir.
Mme Jouanno a mentionné son rapport sur l’hypersexualisation des enfants. Qu’elle sache que je l’ai bien lu et qu’il alimentera évidemment la réflexion interministérielle sur les représentations dès le plus jeune âge qu’il me tient à cœur de conduire, notamment avec l’administration de l’éducation nationale.
Monsieur Kaltenbach, je vous remercie de l’appréciation positive que vous avez portée sur le texte. Vous avez eu raison de souligner qu’une loi doit être accompagnée d’actions structurelles. C’est bien ainsi que nous comptons agir.
Monsieur Pillet, je suis d’accord avec vous : nous aboutissons à un texte équilibré, grâce au travail des commissions et de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Madame Klès, monsieur Antiste, sachez que je suis très sensible à votre engagement dans le temps. Vous avez rappelé à juste titre que l’élaboration de la loi du 9 juillet 2010 fut une occasion manquée : en discutant un amendement à une heure tardive et en petit comité, on peut faire beaucoup de bêtises… S’agissant aujourd’hui du harcèlement, demain des violences faites aux femmes, nous devons continuer à construire et à renforcer notre droit, pour mieux protéger les victimes.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE . –Mme Muguette Dini et M. Yves Détraigne applaudissent également.

M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le mercredi 11 juillet 2012, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2012-276 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.
Acte est donné de cette communication.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt-et-une heures cinquante.

Conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010, relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, et conformément aux termes de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, M. le Premier ministre, par lettre en date du 11 juillet 2012, a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître l'avis de la commission de la Haute Assemblée compétente en matière d'activités financières sur le projet de nomination de M. Gérard Rameix en tant que président de l'Autorité des marchés financiers.
Cette demande d'avis a été transmise à la commission des finances.
Acte est donné de cette communication.

En application de l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l'examen du projet de loi autorisant la ratification du traité d'amitié et de coopération entre la République française et la République islamique d'Afghanistan, déposé sur le bureau de notre assemblée.

Nous reprenons la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif au harcèlement sexuel.
Nous en sommes parvenus à la discussion des articles.

L'amendement n° 11, présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Cohen, Assassi, Borvo Cohen-Seat et David, M. Favier, Mme Beaufils, MM. Bocquet et Billout, Mmes Cukierman, Demessine et Didier, MM. Fischer, Foucaud, Hue, Le Cam et Le Scouarnec, Mmes Pasquet et Schurch et MM. Vergès et Watrin, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2012, un rapport sur la création d'un Observatoire national des violences envers les femmes ayant pour mission de réaliser les études nécessaires au pilotage et à l'évaluation des politiques publiques, de constituer une plateforme de collaboration entre les différents acteurs engagés dans la lutte contre ces violences et d'être le correspondant naturel des observatoires présents aux différents échelons territoriaux.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

La deuxième recommandation de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, qui a été adoptée à l'unanimité, vise à demander la création d'un observatoire national des violences envers les femmes.
Cette structure aurait pour mission de réaliser les études nécessaires au pilotage et à l'évaluation des politiques publiques et de constituer une plate-forme de collaboration entre les différents acteurs engagés dans la lutte contre ces violences. Elle pourrait en outre constituer le correspondant naturel d'observatoires locaux, tel l'observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, qui effectue un remarquable travail de terrain, dont il faut s'inspirer.
Lors d'un déplacement auquel m'avait convié le président du Sénat, à l'occasion de la journée du 8 mars, j'ai pu assister à la célébration du dixième anniversaire de l'observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis. Cet établissement pionnier, animé par Ernestine Ronai, a démontré son utilité, au point que d'autres collectivités envisagent de se doter de structures du même type. C'est le cas de la région d'Île-de-France, qui en a voté le principe.
Lors d'une table ronde organisée par la Délégation aux droits des femmes le 11 janvier dernier, les membres de cette dernière avaient été très attentifs à la suggestion, formulée par Mme Ronai, de créer un réseau national d'observatoires travaillant en partenariat avec les délégations régionales aux droits des femmes. L'idée d'une telle mise en synergie, dès l'échelon local, en vue de déployer tout un réseau d'acteurs mobilisés pour faire reculer les violences subies par les femmes, est tout à fait stimulante.
Le principe de la mise en place de cet observatoire avait été évoqué lors de la discussion de la loi de 2010 ; il avait finalement été décidé qu'un rapport sur ce sujet serait remis au Parlement avant le 31 décembre 2010. En définitive, il ne l'a été qu'en février dernier, à la veille de la discussion de la proposition de résolution de notre collègue Roland Courteau relative à l'application de la loi de 2010.
Ce rapport succinct a écarté sans argumenter la création d'un tel observatoire et préconisé de confier le suivi statistique des violences envers les femmes à l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, sans préciser de quels moyens celui-ci serait doté à cette fin.
Au cours de votre audition du 26 juin 2012, vous nous avez indiqué, madame la ministre des droits des femmes, que vous étiez, à titre personnel, favorable à la création d'une telle instance. J'ignore dans quelle mesure il vous sera possible de nous préciser dès maintenant l'état de la réflexion du Gouvernement sur ce que pourraient être sa composition, son organisation et ses missions. Aussi demandons-nous, au travers du présent amendement, que ces éléments fassent l'objet d'un rapport à remettre par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l'année 2012.

La commission a émis ce matin un avis défavorable. Nous ne sommes pas opposés, sur le fond, à la création d'un tel observatoire, mais nous remarquons que celui-ci peut être institué sans recourir à la loi.

Une telle mesure pourra être prise par Mme la ministre si elle le souhaite.
Madame Gonthier-Maurin, la création d'un observatoire national des violences envers les femmes me tient à cœur. J'ai eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises, en particulier lors de mon audition par la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Depuis ma prise de fonctions, j'ai pu prendre conscience du dénuement dans lequel nous nous trouvons en matière de données statistiques et de la nécessité de mieux coordonner nos actions pour répondre aux attentes des victimes.
L'idée de créer une telle instance se trouvait déjà dans le rapport de la mission préalable à l'adoption de la loi du 9 juillet 2010, rédigé par les députés Danielle Bousquet et Guy Geoffroy. Vous l'avez rappelé, l'article 29 de cette loi avait prévu la remise d'un rapport au Parlement à la fin de l'année 2010, mais ce document n'a pas été déposé en temps utile par le précédent gouvernement. En outre, les projets en cours dans les services, tels que je les ai trouvés en prenant mes fonctions, rejetaient la création de cet observatoire. Sachez, madame la sénatrice, que la position du présent gouvernement est différente : mon intention, conformément aux engagements pris par le Président de la République, est de le mettre en place, car cela correspond à un véritable besoin, comme vous le soulignez.
Il s'agit tout d'abord d'un besoin de connaissance des phénomènes de violences faites aux femmes. En effet, il ne faut pas s'y tromper : l'absence de données est coupable, car elle entretient le tabou, en particulier sur les violences conjugales, qui sont inacceptables, et empêche de guider l'action publique utilement. Par conséquent, comme je vous l'ai indiqué, j'avancerai sur cette question des études et des recherches relatives aux violences faites aux femmes.
Il s'agit ensuite d'un besoin de coordination de l'action publique, celle de l'État, bien sûr, mais aussi celle des collectivités territoriales. À cet égard, vous avez évoqué à juste titre l'initiative très riche qui a été prise par la Seine-Saint-Denis. Je partage l'idée que cet observatoire doit faire davantage que simplement collecter des données : il doit être aussi une plate-forme d'action, respectant bien sûr le dynamisme des territoires et s'appuyant parfois même sur eux.
Le Gouvernement, sachez-le, s'engage à mettre en place une telle instance. Il le fera par le biais d'un texte qui abordera de façon plus large l'ensemble des violences faites aux femmes et qui traitera en particulier des améliorations à apporter à la loi du 9 juillet 2010. Je travaille d'ores et déjà au bilan de cette loi et du plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes, afin d'être prête à l'automne prochain.
Il faut simplifier et revoir ce plan, dont les actions me semblent quelque peu dispersées. Nous prendrons le temps de la concertation avec les collectivités territoriales, pour articuler notre dispositif avec les observatoires locaux. Si vous l'acceptez, j'associerai les membres de la délégation que vous présidez à cette réflexion.
Considérant qu'un texte de loi vaut mieux qu'un rapport, je vous invite, madame Gonthier-Maurin, à retirer cet amendement.

Madame la ministre, je me félicite de votre écoute et de l'attention que vous avez accordée à la recommandation adoptée à l'unanimité par la Délégation aux droits des femmes.
Je constate que nous sommes d'accord sur la nécessité de créer un tel observatoire, afin de pouvoir disposer de données utiles à l'évaluation de l'étendue d'un fléau aujourd'hui largement sous-estimé, parce que méconnu.
Par ailleurs, je note que nous partageons les mêmes conceptions quant aux missions de cette instance : nous entendons qu'elle ne se borne pas à collecter des données, mais qu'elle contribue à la mise en place d'une synergie entre acteurs locaux, départementaux, régionaux et nationaux.
Compte tenu de l'engagement très fort que vous avez pris, j'accepte de retirer cet amendement.
Le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par un article 222-33 ainsi rétabli :
« Art. 222-33. – I. – Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son égard un environnement intimidant, hostile ou offensant.
« II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user d'ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d'obtenir une relation de nature sexuelle, que celle-ci soit recherchée au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
« III. – Les faits visés au I et au II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :
« 1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Sur un mineur de quinze ans ;
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. »

Madame la présidente, mesdames les ministres, mes chers collègues, je souhaite, à cet instant, rappeler la définition du harcèlement sexuel que les membres du groupe CRC ont retenue dans la proposition de loi qu'ils ont déposée le 25 mai dernier.
Nous avons tenté d'établir une définition du harcèlement sexuel qui protège le plus possible les victimes, tout en satisfaisant aux exigences constitutionnelles. C'est la recherche de cet équilibre difficile qui a guidé notre réflexion.
Notre préoccupation a donc été, tout d'abord, de ne pas procéder à une énumération des moyens du harcèlement sexuel : Éliane Assassi l'a souligné, une liste limitative serait trop restrictive et conduirait à considérer comme autorisés les actes et comportements n'y figurant pas.
Si la définition du verbe « harceler » est sous-tendue par la notion de répétition, les nombreux échanges que nous avons pu avoir avec différentes associations de défense des droits des femmes, ainsi qu'avec les associations représentant les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres, nous ont convaincus, s'il en était besoin, qu'un seul acte unique grave peut constituer un harcèlement sexuel. Toute la difficulté a été de qualifier ce caractère de gravité tout en respectant les principes constitutionnels de clarté et de précision de la loi.
Je voudrais également revenir sur l'élément moral, intentionnel, de l'infraction.
Il nous est apparu que l'obtention de « faveurs sexuelles », élément intentionnel retenu dans les définitions données en 1992, en 1998 et en 2002, n'était pas une notion satisfaisante. En effet, elle exclut les agissements, pourtant à connotation sexuelle, à seule fin d'humilier, d'exercer une emprise, de porter atteinte à la dignité, qui relèvent du harcèlement sexuel.
De plus, il est difficile, pour les victimes, de prouver l'obtention de « faveurs sexuelles ». De ce fait, l'action qu'elles ont intentée débouche souvent sur la relaxe de la personne incriminée.
Enfin, d'un point de vue sémantique, l'expression « faveurs sexuelles », outre son caractère désuet, peut prêter à confusion, dans la mesure où le terme « faveurs » a une connotation positive et n'implique pas forcément un désaccord : il peut même laisser supposer un consentement.
C'est pourquoi nous proposons, dans notre définition du harcèlement sexuel, de retenir comme élément intentionnel, à la fois pour des actes répétés et pour un acte unique grave, l'atteinte à la dignité ou la création d'un « environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
Les amendements de repli que nous avons déposés portent sur l'alinéa 3 de l'article 1er. Nous pensons que la notion de « chantage sexuel » ne recouvre pas l'ensemble des actes uniques graves pouvant constituer un harcèlement sexuel, s'agissant notamment des personnes transgenres, pour lesquelles une humiliation, une atteinte à la dignité relèvent de cette incrimination.

Je voudrais profiter de ce débat pour évoquer la situation des personnes dites « trans », c'est-à-dire transsexuelles ou transgenres.
Il me paraît quelque peu surprenant qu'un projet de loi affichant parmi ses finalités la lutte contre les discriminations se trouve être discriminatoire par omission.
Si la prise en compte de ces personnes dans le texte que nous examinons pouvait apparaître à certains, au premier regard, dépourvue d'intérêt au motif que le harcèlement sexuel s'étend à leurs yeux à toute situation de harcèlement à connotation sexuelle, tant le débat démocratique que les réalités de la vie nous imposent de nous pencher sur leur situation, car elles sont des cibles privilégiées du harcèlement sexuel.
Les transsexuels inspirent à beaucoup des fantasmes, dans le très mauvais sens du terme, ce qui suscite des comportements néfastes, voire prédateurs, liés à une incompréhension ou à une haine de la différence. En effet, quoi de plus différent qu'une personne « trans » ?
La transsexualité existe depuis l'aube des temps, dans toutes les cultures. Nul ne sait aujourd'hui en expliquer l'origine. L'unique nouveauté apportée par la modernité est la possibilité médicale d'opérer une transformation physique, seul choix ouvert aux personnes concernées pour sortir de leur souffrance et pouvoir faire abstraction du genre qui leur a été assigné à la naissance, sur la base de constatations visuelles.
Au-delà de cette particularité et des étiquettes trompeuses, il s'agit avant tout de personnes, de citoyens et de citoyennes à part entière, qui essaient, en dépit de grandes difficultés, de mener une vie normale, de travailler, d'étudier, de rester auprès de leurs enfants. Ils essaient, tant bien que mal, de remplir les mêmes obligations que tous leurs concitoyens et doivent, par conséquent, pouvoir bénéficier de la même protection et des mêmes droits.
Notre rôle de parlementaires est de protéger l'ensemble de nos concitoyens, et surtout les plus vulnérables d'entre eux. Or les transsexuels sont bien des personnes vulnérables, notamment lors de leur transition.
Force est de constater que le taux de harcèlement sexuel au sein de cette population est extrêmement élevé : la moitié des adultes « trans » ont été victimes de harcèlement, y compris sexuel. Chez les jeunes, cette proportion atteint 80 %. De plus, 6 % des adultes et jusqu'à 12 % des mineurs ont subi des agressions sexuelles. Le harcèlement sexuel vise le plus souvent à les humilier.
Cette situation est d'autant plus préoccupante que le harcèlement marque souvent le début d'un engrenage de grande marginalisation et d'exclusion sociale. Les personnes « trans » harcelées au travail perdent trois fois plus souvent leur emploi que les autres, et elles deviennent alors des SDF dans 40 % des cas.
Les mineurs ayant subi des actes de harcèlement sont trop souvent déscolarisés, la moitié d'entre eux se retrouvant à la rue. En effet, l'avenir de ces jeunes, dépourvus de qualification, sans expérience, vulnérables, pour une grande partie d'entre eux rejetés par leur famille, est assez prévisible…
Le harcèlement sexuel met directement en jeu la vie des personnes « trans » : au sein de cette population, le fait d'avoir été harcelé induit une augmentation de 74 % de la probabilité de commettre une tentative de suicide. La perte du travail, la déscolarisation, les agressions sexuelles entraînent également une hausse significative du taux de tentatives de suicide. Ainsi, pour les « trans » ayant été victimes d'une agression sexuelle alors qu'ils étaient mineurs, ce taux est environ deux fois plus élevé que celui que l'on constate parmi les autres transsexuels.
Fermer les yeux sur un tel état de choses n'est plus possible ! Quand ces personnes souffrent, leur entourage souffre aussi, affectivement et financièrement. En France, de 5 000 à 10 000 enfants sont issus de parents « trans », de 3 000 à 5 000 personnes sont conjoints ou ex-conjoints de « trans ». En incluant les parents, les frères et sœurs, les collègues, les amis, c'est tout un tissu social comportant entre 50 000 et 75 000 personnes qui est fragilisé par la vulnérabilité exacerbée des personnes « trans ».
Permettez-moi de citer à mon tour l'article 3 de la directive 2006/54/CE : « La Cour de justice a considéré que le champ d'application du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes ne saurait être réduit aux seules discriminations fondées sur l'appartenance à l'un ou l'autre sexe. Eu égard à son objet et à la nature des droits qu'il tend à sauvegarder, ce principe s'applique également aux discriminations qui trouvent leur origine dans le changement de sexe d'une personne. »
Nous avons donc l'obligation, me semble-t-il, par respect pour la dignité et la vie de l'ensemble de nos concitoyens, par respect pour nos valeurs, par respect pour nos obligations internationales, de remédier à la situation présente des personnes « trans ».

Madame la présidente, mesdames les ministres, madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, ce projet de loi particulièrement bienvenu permettra de combler un vide juridique découlant de la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai dernier.
Comme mes collègues, je me félicite à la fois de la célérité du travail du Gouvernement et du contenu du présent texte, qui vise à instaurer une définition de l'incrimination de harcèlement sexuel et une échelle des sanctions clarifiée et opérationnelle.
Pour autant, le vote, absolument indispensable, de ce texte n'épuisera pas le sujet. Je souhaite, mesdames les ministres, attirer votre attention sur trois points qui, à mon sens, devront faire l'objet du travail de fond à mener en vue d'éradiquer le harcèlement sexuel : l'information et la prévention, le suivi des victimes, celui des personnes condamnées.
Au préalable, je voudrais saluer le travail de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Dans son rapport, elle rappelle en particulier que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et protéger leur santé physique et mentale.
À côté de la nécessaire sanction, la prévention et l'information ont un rôle primordial à jouer.
Conformément à la loi du 2 novembre 1992, le code du travail contient des dispositions applicables en la matière aux entreprises et aux établissements comptant au moins vingt salariés. Ces mesures portent sur les actions d'information et de sensibilisation, sur les procédures internes et sur le rôle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Je préconise que le point soit fait avec les partenaires sociaux sur leur application.
Des dispositifs équivalents doivent également être développés dans l'ensemble du monde professionnel, en particulier dans les différentes fonctions publiques. Il conviendrait donc qu'une disposition législative prévoie expressément l'obligation, pour l'État et les collectivités, de prendre les mesures nécessaires à la prévention du harcèlement sexuel dans le secteur public. De même, la formation initiale et continue dans les différentes fonctions publiques devrait davantage prendre en compte ces questions, de façon que le personnel d'encadrement soit mieux à même de prévenir et de détecter les situations de harcèlement sexuel.
Les actions de prévention doivent être renforcées par le biais de campagnes d'information dans les médias. Une attention toute particulière devrait être portée au milieu scolaire et universitaire. Ce sont les mentalités qu'il faut faire évoluer, ce qui passe par une action éducative dès le plus jeune âge, le discours devant naturellement être adapté aux publics visés. Cette dimension de l'apprentissage du respect de l'autre, des notions clés du vivre-ensemble dans la cité et dans la vie professionnelle devrait être prise en considération dans les programmes d'éducation civique, qui relèvent de la compétence de l'éducation nationale. L'université jouant un rôle tout particulier dans la formation des cadres du pays, plus particulièrement dans celle de nos enseignants, la prévention du harcèlement sexuel doit y avoir toute sa place.
À mes yeux, le soutien aux victimes doit être une priorité absolue. Ces dernières ont eu le courage non seulement de dire « non », mais aussi de faire respecter leurs droits et de refuser la loi du silence.
Des dispositifs de soutien aux victimes existent déjà, à l'instar de celui que les hôpitaux de Paris viennent de mettre en place, avec un numéro vert et une cellule de prise en charge psychologique. La généralisation progressive de tels dispositifs, sur l'ensemble du territoire, constituerait un message fort adressé aux victimes, qui n'auraient plus le sentiment de se trouver isolées et de subir, en quelque sorte, une double peine.
Enfin, il faut poser la question du suivi des harceleurs.
Le harcèlement sexuel est aujourd'hui hors du champ du suivi socio-judiciaire. Le suivi de l'auteur de tels faits ne peut donc être décidé par une juridiction.
Il ne s'agit ni de stigmatiser, ni de nier la valeur d'exemplarité des peines et sanctions prévues à l'article 1er du présent projet de loi. Je souligne seulement que la grande majorité des peines d'emprisonnement prononcées sous le régime des précédents textes étaient assorties d'un sursis, souvent total. Je n'entends pas présager que les tribunaux adopteront une approche identique pour l'application du texte que nous allons adopter, mais faut-il pour autant exclure la possibilité, pour les juridictions, de mettre en œuvre un suivi socio-judiciaire en cas de récidive ?
Mesdames les ministres, tout en apportant un soutien enthousiaste à ce projet de loi, j'ai souhaité vous soumettre ces quelques réflexions sur les moyens de mieux prévenir et combattre le harcèlement sexuel, qui constitue aujourd'hui un fléau, une discrimination inadmissible à l'encontre des femmes.

L'amendement n° 44, présenté par Mme Klès, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Après la section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré une section 3 ter A ainsi rédigée :
« Section 3 ter A : Du harcèlement sexuel
II. - En conséquence, au début de l'alinéa 2
Remplacer la référence :
« Art. 222-33
par la référence :
« Art. 222-33-2-2
La parole est à Mme Virginie Klès.

Cet amendement vise simplement à créer dans le code pénal une section relative au harcèlement sexuel et à la placer après la section consacrée au harcèlement moral, le harcèlement sexuel constituant une forme de harcèlement moral. D'ailleurs, à l'heure actuelle, le harcèlement sexuel n'existant plus dans la loi, on requalifie, autant qu'il est possible, les faits qui en relèvent en faits de harcèlement moral.
L'adoption de cet amendement, très simple sur le principe, induira un lourd travail de coordination et de toilettage. Cela étant, je ne doute pas que mes collègues parlementaires sauront le mener à bien !

L'avis est défavorable.
Mme Klès propose de créer dans le code pénal une nouvelle section consacrée au harcèlement sexuel et de la placer après celle qui est relative au harcèlement moral. L'idée est intellectuellement séduisante, mais un tel déplacement pourrait entraîner des effets pervers en termes de coordination. Il nous semble donc que procéder à cette modification par voie d'amendement, sans avoir mené d'abord une étude beaucoup plus exhaustive de la question, comporterait plus de dangers que d'avantages.
Il est également défavorable.
Madame Klès, j'entends bien vos observations et, comme l'a dit le rapporteur, il y a une cohérence dans votre proposition, mais, au-delà des dangers que celle-ci présente en termes de coordination, sa mise en œuvre conduirait à un classement différent : en traitant dans des sections de même niveau du harcèlement sexuel et du harcèlement moral, vous extrayez le harcèlement sexuel de l'ensemble des infractions sexuelles.
Le harcèlement moral fait l'objet d'une section qui suit, dans le code pénal, la section consacrée aux agressions sexuelles, au sein de laquelle le paragraphe relatif au harcèlement sexuel vient après les paragraphes consacrés au viol et aux autres agressions sexuelles. Si nous suivions votre proposition, nous éloignerions plus encore les dispositions relatives au harcèlement sexuel des dispositions relatives au viol.
Le Gouvernement vous invite donc à retirer votre amendement.
Je répète cependant que je comprends parfaitement votre vœu d'un affichage plus clair, d'une singularisation d'un délit qui, tous les orateurs l'ont souligné cet après-midi, est cause de souffrances et de graves conséquences sur le plan professionnel.

J'accepte de le retirer, madame la présidente. Néanmoins, je persisterai à travailler sur le sujet et ferai d'autres propositions.

L'amendement n° 44 est retiré.
L'amendement n° 36 rectifié ter, présenté par Mmes Jouanno et Duchêne, MM. Milon et Cardoux, Mmes Deroche et Farreyrol, M. Bourdin, Mmes Lamure et Bruguière, MM. Doligé, Duvernois et B. Fournier, Mmes Troendle et Kammermann, M. Fleming, Mme Sittler, MM. Bécot, Gilles et Grosdidier et Mmes Mélot et Keller, et MM. Savary, Portelli et P. André, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, de façon répétée,
La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Il convient de supprimer la répétition des agissements visés à l'alinéa 2 comme critère de harcèlement sexuel. Cela serait conforme à l'esprit de la définition retenue dans la directive européenne, qui a été reprise dans le code pénal espagnol.
Cette position a été recommandée par des associations et par certains magistrats, qui estiment indispensable de prévoir qu'un acte unique puisse constituer un harcèlement sexuel.
En outre, suivre notre proposition permettrait d'éviter que ne figurent dans le texte deux définitions du harcèlement sexuel, situation dont j'ai souligné les dangers lors de la discussion générale.

Le groupe de travail, après de longues heures de concertation, a considéré qu'il fallait retenir une architecture à deux niveaux : celui du harcèlement par répétition et celui du harcèlement par acte unique. Afin de respecter la logique de cette démarche, que je ne vais pas retracer ici, la commission a émis ce matin un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est lui aussi défavorable à cet amendement.
La réitération, madame la sénatrice, est le propre du harcèlement. La particularité du présent texte tient précisément à ce qu'il prévoit qu'un acte unique puisse, sous certaines conditions, suffire à constituer le délit de harcèlement sexuel. Vous avez d'ailleurs contesté ce point, en arguant du risque que des agressions sexuelles soient requalifiées en simples faits de harcèlement sexuel.
Je rappelle que la jurisprudence concernant le délit de menace indique très clairement que la répétition peut se produire dans un laps de temps très court, bien inférieur à une journée.
Si nous éliminons complètement le critère de la répétition, un seul propos pourra constituer un harcèlement sexuel. Ainsi que je l'ai expliqué cet après-midi, nous avons tenu à définir deux critères d'objectivation du caractère de gravité justifiant qu'un acte unique soit qualifié de harcèlement sexuel : la pression grave et l'intention d'établir une relation de nature sexuelle.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 10 rectifié, présenté par M. Hyest, Mme Jouanno et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
, comportements ou tous autres actes
par les mots :
ou agissements
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

… car, je tiens à le répéter, nous sommes tout à fait d'accord avec les conclusions de la commission des lois.
Voici le premier d'entre eux : outre qu'il répond à un souci de simplification, il nous est apparu que le terme « agissements » recouvrait beaucoup mieux les faits visés.
D'ailleurs, on voit bien qu'il y a eu hésitation sur ce point de rédaction, puisque, tandis que le texte du Gouvernement visait des « gestes, propos ou tous autres actes », la commission a choisi de faire référence à des « propos, comportements ou tous autres actes à connotation sexuelle ».

La commission est favorable à cet amendement, considérant qu'il apporte de la précision à la définition du délit de harcèlement. La rédaction proposée satisfait davantage aux exigences constitutionnelles sans compromettre la possibilité, pour la victime, d'apporter une preuve.
Nous entendons bien les arguments présentés par M. Hyest et l'avis favorable de la commission. Le Gouvernement est disposé à donner lui aussi un avis favorable.
J'attire cependant l'attention de la Haute Assemblée sur le fait que remplacer les mots « comportements ou tous autres actes » par le mot « agissements » me semble restrictif.
En effet, le terme « agissements » ne recouvre pas nécessairement les comportements. Cet amendement tend donc à réduire le champ d'application de l'incrimination.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Hyest, Mme Jouanno et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
un environnement intimidant, hostile ou offensant
par les mots :
une situation intimidante, hostile ou offensante
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

De mon point de vue, conforté par une de ces recherches linguistiques chères au président Sueur, le mot « environnement » ne convient absolument pas dans le cas précis. S'il figure dans la directive, c'est par influence de son acception anglo-saxonne, mais on ne le trouve nulle part dans notre droit pénal. En revanche, le mot « situation » me paraît tout à fait adéquat.
Tel est l'objet du second amendement déposé par le groupe UMP ; pour le reste, nous suivrons la commission.

En tant que rapporteur, j'ai l'obligation de préciser que la commission, ce matin, a émis un avis favorable sur cet amendement et se prononce donc pour la substitution du terme de « situation » au terme d'« environnement ».
On me permettra cependant de considérer, à titre personnel, que la notion d'« environnement » a du sens dans un tel contexte. Elle est d'ailleurs déjà employée en droit français et figure dans cinq des sept propositions de loi.
Vaut-il mieux parler d'« environnement » ou de « situation » ? Au cours des nombreuses discussions que nous avons eues sur ce sujet, d'autres termes encore ont été proposés : « contexte », « climat », …
Sourires.
… et j'en passe.
Il faut le reconnaître, il n'existe pas d'arguments purement juridiques justifiant que l'on privilégie un terme plutôt qu'un autre. Je sais les réserves qu'inspire à certains d'entre vous le mot « environnement », considéré en effet comme anglo-saxon ou étranger au droit français, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait vrai.
Les échanges qui ont eu lieu au sein du groupe de travail du Sénat et les auditions complémentaires qui ont été réalisées par le rapporteur ont toutefois mis en évidence l'intérêt que pouvait offrir cette notion d'« environnement » pour l'appréhension des phénomènes de harcèlement.
(À suivre)