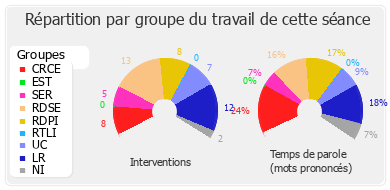Séance en hémicycle du 6 novembre 2013 à 14h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire
- Saisine du conseil constitutionnel
- Économie sociale et solidaire (voir le dossier)
- Communication relative à une commission mixte paritaire
- Demande d'avis sur un projet de nomination
- Communication du conseil constitutionnel
La séance
La séance est ouverte à quatorze heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire sur les dispositions du projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
En conséquence, les nominations intervenues lors de notre séance du 5 novembre prennent effet.

M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat que le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 novembre 2013, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, par plus de soixante sénateurs, d’une demande d’examen de la conformité à la Constitution de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
Le texte de la saisine du Conseil constitutionnel est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire (projet n° 805 [2012-2013], texte de la commission n° 85, rapport n° 84, avis n° 69, 70 et 106).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre délégué. §
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires économiques, madame, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que j’ai l’honneur de présenter au nom du Gouvernement constitue un acte fondateur pour la reconnaissance d’une part importante de notre économie nationale et de ses acteurs. Il exprime la volonté du Gouvernement de soutenir un mode spécifique d’entreprendre et de souligner la contribution décisive de l’économie sociale et solidaire à l’existence de solidarités bien ancrées dans la vie sociale de notre pays, ainsi qu’à la création de richesses en France.
Cet engagement du Gouvernement en faveur de l’économie sociale et solidaire est tout d’abord le fruit d’un constat : la crise économique est aussi une crise du modèle entrepreneurial. La financiarisation de l’économie mondiale implique en effet une dépossession de la gouvernance économique, au détriment tant de la sphère politique que des organisations sociales. Pour les salariés et les citoyens, le pouvoir qui régit la vie économique n’a jamais été plus abstrait.
Certains magnifient l’entreprise comme collectif humain. Cela correspond souvent à une réalité, mais le pouvoir dans l’entreprise n’appartient plus aux salariés. Bon nombre de nos compatriotes ont aujourd'hui le sentiment que la décision dans le champ économique relève de moins en moins des États souverains, des collectifs humains, et de plus en plus de sphères qui leur apparaissent lointaines et abstraites.
Plus que jamais, savoir à qui appartient le pouvoir de décider de nos vies est une question fondamentale, dont aucun citoyen ni aucun gouvernement ne peuvent s’affranchir.
Décider, ce n’est pas seulement voter dans le cadre d’élections politiques démocratiques. Décider, c’est conserver la maîtrise de sa vie, qu’il s’agisse des grandes affaires du monde et de la nation ou de celles qui touchent au quotidien, en commençant par le travail.
Si beaucoup ont aujourd’hui le sentiment, et même la crainte, que la maîtrise de nos vies nous échappe, c’est parce que nous perdons de vue l’horizon de nos décisions et que nous abandonnons parfois l’ambition de décider collectivement.
Chacun prime sur le collectif. Franklin Roosevelt disait : « Chacun de nous a appris les gloires de l’indépendance. Que chacun de nous apprenne les gloires de l’interdépendance. » Nous devons reprendre le goût, l’habitude de l’interdépendance, qui est une nécessité.
Force est de constater, hélas ! que, dans les dix dernières années, le moteur de l’économie mondiale, de l’économie européenne, de l’économie nationale a davantage reposé sur l’appât individuel du gain que sur les choix économiques collectifs de long terme.
La finalité même de l’action tend à s’effacer derrière la satisfaction immédiate de celle-ci. « La morale commence où finit l’intérêt », écrivait Kant. Après la crise financière que nous venons de vivre, quelle est la morale de notre époque ?
C’est l’appât du gain qui motive la diffusion massive des produits financiers dérivés.
C’est l’appât du gain qui plonge dans le surendettement des millions de ménages manipulés par des vendeurs de crédit sans scrupules.
C’est l’appât du gain qui transforme tout cela en bulle spéculative, puis en crise financière mondialisée.
Enfin, c’est l’appât du gain qui, au bout de la réaction en chaîne, impose des politiques publiques d’austérité pour financer les dettes privées.
À la lumière de cette crise, je doute qu’une aspiration morale ait pu freiner la recherche effrénée de l’intérêt privé. Je vois bien, en revanche, en quoi l’« aléa moral » a trouvé à s’illustrer ! Jamais la définition qu’en a donné Adam Smith n’a sonné aussi juste : l’aléa moral est la maximisation de l’intérêt individuel sans prise en compte des conséquences défavorables de la décision sur l’utilité collective.
S’il faut donc conserver le pessimisme de la raison, il ne faut surtout pas abandonner l’optimisme de la volonté. A contrario – c’est bien ce qui nous intéresse aujourd'hui –, il faut observer que les constructions économiques qui ont su préserver leur dimension collective, qui n’ont pas érigé le lucre en principe absolu et qui ont maintenu leurs exigences en matière de responsabilité sociale ont montré une résilience particulière dans la crise économique.
Qui mieux est, ces entreprises sont aujourd’hui celles qui proposent le plus souvent des réponses à des besoins sociaux qui ne sont satisfaits ni par le marché ni par le secteur public, besoins sociaux d’autant plus impérieux que la crise est venue frapper nos compatriotes.
Pourquoi cette résistance ?
Parce que ces organismes sont, pour l’essentiel, des sociétés de personnes libérées de la pression des capitaux investis, grâce à l’égalité des apports de leurs membres.
Parce que ces organismes sont les héritiers d’une longue histoire économique et sociale, à certains égards antérieure et aujourd’hui parallèle à l’autre économie, c'est-à-dire l’économie capitaliste.
Parce que ces organismes ont su demeurer des « personnes morales » au sens plein du terme.
Certes, les entreprises de capitaux sont aussi des collectivités humaines, et l’épanouissement au travail, la responsabilité sociale, l’efficacité dans la réponse aux besoins n’y sont pas nécessairement moindres que dans les sociétés de personnes. Mais il est une spécificité des sociétés de personnes qui ne peut leur être contestée : c’est l’égalité qui règne entre leurs membres, indépendamment de leur apport financier. Cela ne fait pas tout, mais cela signifie que la prise de décision ne peut y être motivée par le seul intérêt financier. En ces temps de financiarisation extrême de l’économie, cela compte !
C’est d’ailleurs ce qui a fait la force de l’économie sociale tout au long de sa patiente maturation. En effet, il ne s’agit pas d’une mode économique liée aux temps de crise. Il ne s’agit pas non plus de la remettre dans l’air du temps avant qu’elle ne soit promise à une disparition rapide, une fois la croissance revenue.
L’économie sociale et solidaire est une économie à part entière, qui innove et se développe.
Les principes fondamentaux de l’économie sociale et solidaire sont au cœur de l’activité économique depuis son origine et ils trouvent à s’illustrer sur tous les continents, quel que soit le niveau de développement des pays considérés.
En France et dans bien d’autres pays européens, les acteurs de l’économie sociale que sont les mutuelles, les coopératives et les associations ont bien souvent précédé la création de services marchands ou de services publics, parce qu’ils ont su, avant d’autres, identifier de nouveaux besoins, parce qu’ils ont su, mieux que d’autres, définir les conditions d’une réponse collective et mutualisée, parce qu’ils ont su, plus efficacement que d’autres, organiser la solvabilisation de cette réponse.
Monsieur le président, permettez-moi de saluer les représentants de ces grandes familles de l’économie sociale et solidaire qui me font l’honneur d’être présents aujourd'hui en tribune, à l’occasion de l’examen en première lecture de ce projet de loi par la Haute Assemblée. §
Les moteurs de cette histoire n’ont rien de spécifique à la France, même si, dans notre pays, l’économie sociale a épousé de façon originale les structures économiques et sociales. La recherche scientifique atteste en effet que, sur tous les continents, on trouve une économie différente de l’économie capitaliste, qui coexiste avec elle et se fonde toujours sur au moins deux exigences fondamentales : premièrement, la gestion en commun de la structure en associant ses participants selon le principe « une personne, une voix », et non pas selon celui de la proportionnalité des droits de vote à la part de capital détenu ; deuxièmement, le consentement volontaire à une limitation de la dimension lucrative de l’activité, au nom d’objectifs sociaux, de prévoyance et de mutualisation.
Parce que cette économie s’est naturellement investie dans les activités solidaires, au service des personnes vulnérables et des territoires délaissés, elle est parfois réduite à une « économie de la réparation ».
Rien n’est pourtant plus faux ! Des pans entiers de notre économie ne seraient pas ce qu’ils sont aujourd’hui s’ils n’avaient pas été fondés sur les principes de l’économie sociale et solidaire : protection sociale, accès au crédit, aide à domicile, production agricole, tourisme de masse, grande distribution, recyclage, services aux entreprises, action sanitaire et sociale… La contribution des entreprises et organismes appliquant les principes de l’économie sociale et solidaire est constitutive du modèle social et républicain français.
Notre économie ne serait tout simplement pas ce qu’elle est sans les entrepreneurs collectifs qui ont créé les mutuelles et les coopératives que nous connaissons tous dans notre vie quotidienne, sans que nous identifiions toujours leur spécificité d’organisation.
Cet esprit d’entreprise ne s’est pas essoufflé. À bien des égards, l’action des entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire demeure fidèle à l’exhortation de Charles Gide, l’un des principaux inspirateurs du mouvement coopératif. En 1885, il écrivait, dans le journal L’Émancipation, le premier d’une série de 600 articles, intitulé « Ni révoltés ni satisfaits ». Son programme était de créer par la coopération « un ordre supérieur qui ne serait pas le résultat spontané de lois naturelles et, comme telles, amorales, mais le résultat d’efforts coordonnés et inlassables vers un idéal qu’il faut montrer au peuple ». Ces mots ont du souffle. Ils nous inspirent. Ils exaltent l’esprit d’entreprendre, mais d’entreprendre collectivement.
Je regrette parfois – souvent, même – que le grand public, les médias, les pouvoirs publics eux-mêmes et surtout certaines organisations patronales valorisent l’idée qu’il n’y aurait de vrais entrepreneurs qu’individuels.
Pourtant, les entrepreneurs collectifs que sont les sociétés de personnes sont solides, robustes. Ils innovent. Ils recrutent. Ils forment. Ils tissent le lien social. Mieux encore, ils inventent un autre monde et une autre façon d’agir en économie. Joseph Schumpeter écrivait : « Entreprendre consiste à changer un ordre existant. » Incontestablement, l’économie sociale et solidaire participe de cette œuvre de changement.
Je l’ai déjà dit et je le répète devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs : je ne souhaite pas opposer un modèle à un autre, une « bonne » économie à une « mauvaise » économie. Je n’ai jamais cru que l’économie sociale et solidaire serait préservée de toutes turpitudes, quand le reste de l’activité économique serait ouvert à tous les maux.
Cela étant, l’économie sociale et solidaire est trop longtemps restée à la marge des politiques publiques, son rôle et son originalité ont trop longtemps été méconnus, alors qu’elle est capable d’associer performance économique, utilité sociale et impact environnemental positif.
Mme Aline Archimbaud applaudit.
C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité, avec Jean-Marc Ayraultet le Président de la République, permettre à l’économie sociale et solidaire de changer d’échelle et lui en donner les moyens.
Je veux bien sûr parler de ces entrepreneurs qui, en dépit des difficultés quotidiennes et de la concurrence acharnée, maintiennent l’esprit des origines dans leurs organismes ou entreprises de l’économie sociale. Je veux aussi parler de ceux qui se lancent dans la création d’activité, en faisant le choix de partir de pas grand-chose, peut-être, mais avec des valeurs et des principes.
Je veux donc inclure dans notre ambition collective ce foisonnement d’« entreprises sociales », dont les modes de production et de redistribution des bénéfices empruntent aux principes de l’économie sociale et solidaire. Leurs fondateurs revendiquent la dénomination d’« entreprises sociales », au nom de la priorité donnée à leur activité sociale dans la définition de leur entreprise, et adoptent, dans l’immense majorité des cas, les règles qui caractérisent l’économie sociale et solidaire.
Cette évolution illustre l’importante créativité du secteur, qui sait associer principes de gestion, principes de gouvernance et utilité sociale, tout en incarnant les formes d’entreprendre les plus innovantes, dans un souci constant du bien commun. L’apparition de ces nouveaux acteurs reflète le mouvement permanent de l’économie sociale et solidaire. Celle-ci est aujourd’hui mûre pour changer d’échelle.
C’est donc l’ambition du Gouvernement que de l’accompagner dans ce changement d’échelle, car ses caractéristiques contribueront naturellement à la co-construction d’une stratégie de croissance plus robuste, plus riche en emplois, plus durable et plus juste socialement. Elle s’appuiera sur la formidable diversité et la richesse d’une économie aux principes authentiquement populaires.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’en viens à présent au contenu du texte et à sa méthode d’élaboration. Il est le fruit d’une large et intense concertation.
Conformément à la volonté du Président de la République de promouvoir le dialogue social et civil, une ample consultation des acteurs de l’économie sociale et solidaire a été conduite pour l’élaboration du présent projet de loi.
J’ai sollicité les acteurs eux-mêmes et leurs fédérations professionnelles, qui ont fait preuve d’une inlassable disponibilité, ce dont je les remercie sincèrement. J’ai aussi mis à contribution les instances consultatives, notamment le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire et les institutions représentatives du secteur, en particulier le Conseil des entreprises et groupements d’employeurs de l’économie sociale, le CEGES.
J’ai également associé volontairement à la consultation les organisations syndicales de salariés, qui avaient logiquement leur mot à dire quant à la vigueur de la mise en œuvre des principes dans la réalité sociale des entreprises et organismes de l’économie sociale et solidaire.
Par ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental a fait l’objet d’une saisine du Gouvernement ; son avis a notamment été repris d’une manière assez exhaustive concernant la modernisation du droit coopératif et la territorialisation des politiques de développement de l’économie sociale et solidaire.
Enfin, le présent projet de loi s’inscrit dans le cadre de l’initiative de la Commission européenne pour promouvoir ce secteur en tant qu’acteur à part entière d’une « économie sociale de marché hautement compétitive ».
Plus généralement, ce texte vise à faire de l’économie sociale et solidaire un modèle solide et conquérant. Il tend à conforter sa place au sein d’une économie plurielle, en synergie avec les initiatives européennes, à lever les obstacles à son développement et à prévoir les dispositifs visant à assurer le déploiement et la croissance de ces structures sur les territoires.
Sans m’attarder sur le détail du contenu du texte, je voudrais à présent resituer les principaux débats ouverts par l’élaboration de ce projet de loi, ainsi que les contributions de vos rapporteurs et de vos groupes.
Les acteurs de l’économie sociale souhaitaient une reconnaissance publique de ce qu’ils font.
Cette volonté de reconnaissance de leur apport à l’histoire économique et sociale française, comme à la prospérité et à la cohésion sociale du pays, est au cœur de l’organisation représentative qu’ils se sont donnée.
Faute d’une définition légale les englobant tous, ces acteurs ont progressivement sélectionné par eux-mêmes les déterminants d’une définition politique.
Faute d’une administration d’appui qui soit pérenne, ils ont construit les outils dont ils ont besoin, en matière tant d’expertise que de financement.
La création d’un ministère « délégué à l’économie sociale et solidaire » placé auprès du ministre chargé de l’économie et des finances constitue donc un tournant important pour l’organisation politico-administrative du secteur, mais aussi pour sa reconnaissance publique.
Ce sont avant tout les caractéristiques économiques des entreprises et organismes concernés qui justifient le choix d’une reconnaissance ministérielle, même si elles ne suffisent pas à en définir l’identité ni l’utilité sociale.
Les acteurs de l’économie sociale avaient besoin d’une définition de ce qu’ils sont.
Les débats sur la définition de l’économie sociale et solidaire, qui constitue l’article 1er du projet de loi, auront été denses entre nous, ainsi qu’avec les acteurs, pendant la phase de préparation de ce texte. Ils le seront encore cet après-midi et ce soir, mais cela est parfaitement compréhensible quand il s’agit de définir une identité en s’appuyant tant sur des considérations philosophiques que sur des réalités juridiques.
À ce titre, le projet de loi entend affirmer que l’économie sociale et solidaire se définit de façon incontournable par l’intégration, dans les statuts des entreprises et organismes concernés, des principes communs suivants : un but autre que le seul partage des bénéfices, une gouvernance démocratique ou participative définie par des statuts et incluant les parties prenantes, enfin une gestion mettant en œuvre les modalités d’une recherche du lucre limitée ou encadrée.
La mise en œuvre de ces principes permet aux entreprises de l’économie sociale et solidaire de démontrer qu’il est possible, à contre-courant de l’économie financiarisée, de se développer librement en s’appliquant des règles contraignantes qui n’ont d’autre finalité que de replacer l’homme au cœur de l’économie.
Ainsi définie, l’économie sociale et solidaire intégrera donc aussi bien les organismes historiques se caractérisant par leurs statuts que les entreprises nouvelles faisant le choix d’appliquer les principes communs de l’ESS. Avec cette définition inclusive, c’est toute l’économie sociale et solidaire qui se trouve mise en mouvement.
Souhaitant que ce mouvement soit compréhensible du grand public, j’ai proposé aux acteurs de souscrire à une déclaration de principe de l’économie sociale et solidaire. Rédigée par le Conseil supérieur, mise en œuvre et contrôlée par les acteurs eux-mêmes, cette déclaration sera l’illustration que le mode d’entreprendre commun à toutes les familles de l’ESS se traduit par des pratiques différentes de celles de l’économie de capitaux.
Je suis convaincu que cette déclaration sera une chance pour les entreprises et organismes de l’ESS, qui doivent à nouveau, me semble-t-il, jouer un rôle moteur en matière de relations sociales et dont le fonctionnement doit reposer sur des exigences fortes.
La définition de l’économie sociale appelait celle de l’utilité sociale. C’était un sujet fondamental de nos travaux préparatoires.
En effet, l’appartenance à l’économie sociale et solidaire au titre de la définition que nous en donnons à l’article 1er, ainsi qu’au regard de la réalité des entreprises et organismes qui la composent, ne suffit pas à qualifier l’utilité sociale de ceux-ci. La spécificité du mode d’entreprendre ne préjuge pas nécessairement de la finalité de l’action.
C’est pourquoi nous avons fait le choix d’adopter une démarche qui, par la définition de l’utilité sociale, justifiera des droits nouveaux, notamment en matière de financement, d’une part, et de nous reposer sur un agrément existant – l’agrément solidaire – en l’adaptant, plutôt que d’en créer un nouveau, d’autre part.
Le travail de fond de la commission des affaires économiques a permis d’affiner la rédaction du Gouvernement pour que les conditions futures de mise en œuvre de l’agrément solidaire soient parfaitement adaptées aux entreprises qui ont vocation à en relever. Cet agrément pourra donc être ciblé sur les entreprises à forte utilité sociale qui éprouvent le plus de difficultés à accéder à des financements de marché.
La commission des affaires économiques du Sénat a également fait le choix d’introduire une définition de l’innovation sociale. Il s’agit d’une avancée majeure, répondant pleinement aux initiatives du Gouvernement, puisque cette définition permettra demain au futur fonds national d’innovation sociale d’identifier les projets innovants sur le plan social, qui pourront être financés grâce à la double contribution de la Banque publique d’investissement, Bpifrance, et des régions. Il était essentiel que nous avancions dans la définition de l’innovation sociale. L’apport du Sénat et de sa commission des affaires économiques est, à ce titre, tout à fait décisive.
Par ailleurs, la structuration de l’ESS était nécessaire afin d’organiser le dialogue avec l’État.
Le Gouvernement a donc fait le choix de reconnaître l’utilité publique des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, les CRESS. Il a confié aux représentants territoriaux de l’État la charge de contractualiser avec elles, afin qu’elles assument plusieurs missions publiques qui font aujourd’hui défaut.
Les CRESS se verront donc demain chargées non seulement de promouvoir l’économie sociale et solidaire, d’apporter un appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises, mais aussi d’assurer le suivi statistique des entreprises qui se réclament de l’économie sociale et solidaire, ce pour quoi elles disposent déjà d’une capacité d’expertise incontournable. En leur donnant la capacité d’ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter aux entreprises commerciales les conditions prévues à l’article 1er, vous les renforcez dans leur légitimité et dans leur mission fédératrice. C’est une excellente initiative.
Vous avez également choisi de confier au Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, le CSESS, la mission de rédiger et de faire vivre une déclaration de principe de l’économie sociale et solidaire. Les entreprises et organismes y adhéreront librement, mais cette déclaration de principe permettra assurément de répondre à certaines interrogations, voire à certaines exigences légitimes, de nos concitoyens quant à la plus-value spécifique de l’économie sociale, y compris en matière d’« exemplarité sociale ».
Le renforcement de l’ancrage territorial et l’articulation de l’économie sociale et solidaire avec les politiques publiques locales constituent un autre vecteur indispensable de la réussite du changement d’échelle de cette économie.
Les dispositions du présent projet de loi ont donc également pour objet de renforcer la capacité des acteurs locaux à coopérer. Pour autant, les pouvoirs publics ne doivent pas en prendre prétexte pour se désengager, mais au contraire chercher les convergences les plus fécondes avec la société civile. Le Gouvernement n’a pas fait le choix de privilégier un échelon de collectivités territoriales plutôt qu’un autre.
Il est indéniable que les collectivités territoriales ont vingt ans d’avance sur l’État en matière de développement de l’ESS. Je connais et salue l’action menée par les régions, en cohérence avec leur compétence en matière de développement économique, mais d’autres collectivités agissent aussi, et le Gouvernement ne souhaite pas faire le tri entre elles alors même qu’il est souhaitable que la mobilisation en faveur de l’économie sociale soit le fait de tous. Je pense notamment au rôle déterminant des départements dans le financement de l’insertion par l’activité économique.
Les conférences régionales que vous avez instituées par voie d’amendement seront le bon niveau pour évaluer les efforts de chacun et clarifier ce qui devra l’être ultérieurement dans la répartition des compétences.
Par ailleurs, la commission des affaires économiques du Sénat a décidé de permettre au Parlement de se prononcer sur des points qui pouvaient apparaître au Conseil d’État comme de nature infra-législative mais qui, eu égard aux enjeux qui les sous-tendent, devaient être inscrits dans ce projet de loi.
Il en va ainsi de l’accompagnement et de la professionnalisation des entreprises de l’économie sociale et solidaire, notamment des associations, par la reconnaissance législative des dispositifs locaux d’accompagnement, les DLA, qui se voient donc intégrés à un dispositif global de soutien à l’économie sociale et solidaire, sans préjudice de leur action auprès des associations. Ces DLA ont fait leurs preuves au moment de la mise en œuvre des emplois-jeunes, et ils sont aujourd’hui encore très sollicités au titre des emplois d’avenir, ce qui atteste de leur efficacité et de leur légitimité.
Il en ira demain de même pour la commande publique responsable, avec la possibilité, pour les préfets, de recourir aux facilitateurs de clauses sociales que sont notamment les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les PLIE, et les maisons de l’emploi. Sur ce même sujet de la commande publique, vous avez souhaité ajouter un article traitant des « marchés réservés », en opérant une transposition anticipée d’une directive européenne relative aux marchés publics dont l’adoption est imminente à l’échelon communautaire ; c’est un débat que nous aurons. Cette directive est une sorte de Social Business Act, pour parler…
Cette directive n’est pas encore transposable dans le droit français, mais vous avez souhaité le faire par anticipation. Le Gouvernement souhaite que l’on étende, à moyen terme, le principe de ces « marchés réservés » aux acteurs de l’insertion par l’activité économique.
Le Gouvernement vous propose également une sécurisation de la subvention.
C’est un sujet fondamental à l’heure de la raréfaction de la ressource publique et de la tendance lourde à la mise en concurrence, même lorsqu’elle est disproportionnée au regard de l’objectif visé. C’est une demande ancienne du secteur associatif, notamment de la Conférence permanente des coordinations associatives, la CPCA. Ma collègue Valérie Fourneyron pourrait en témoigner, d’autant qu’elle travaille à une nouvelle « charte des engagements réciproques », avec le concours du sénateur Claude Dilain. Cela fait plus de dix ans que le monde associatif attend cette précision juridique.
Je veux saluer le travail effectué par la commission des affaires sociales sur les dispositions relatives à l’emploi. Les propositions qu’elle a faites, sous la houlette de Mme Christiane Demontès, témoignent d’une excellente compréhension des enjeux liés à ce projet de loi en matière de développement de l’emploi.
Ainsi, la réintroduction de la disposition relative à la facilitation des clauses sociales donnera un réel coup de pouce aux structures d’insertion. Les dispositions visant à sécuriser juridiquement les coopératives d’activités et d’emploi permettront à ces dernières de se développer sans risque, et la commission des affaires sociales propose une alternative, un complément au statut d’auto-entrepreneur. En permettant aux sociétés coopératives d’intérêt collectif, les SCIC, d’embaucher des jeunes au titre d’emplois d’avenir, elle soutient l’ambition prioritaire du Gouvernement de développer l’emploi des jeunes.
J’en viens maintenant aux dispositions qui ont fait couler le plus d’encre : celles qui sont relatives à la facilitation de la reprise d’entreprises par les salariés.
Je tiens tout d’abord à saluer la présence dans les tribunes de Jean Auroux, ministre du travail de François Mitterrand, qui nous fait l’honneur d’assister à ce débat. §Je crois pouvoir dire que, humblement, modestement, la majorité et le Gouvernement essaient de s’inscrire dans le sillage qu’il a tracé au travers des lois qui portent son nom. Ces lois ont apporté un authentique progrès social aux salariés de ce pays, sans que cela nuise à la performance et à la croissance économiques. Nous allons tenter de faire de même par le biais de ce projet de loi.
Les dispositions relatives à la facilitation de la reprise d’entreprises par les salariés ont naturellement leur place dans ce texte, puisqu’elles visent à promouvoir l’entrepreneuriat collectif, le cas échéant sous la forme coopérative.
Ces dispositions se justifient par le fait que, chaque année, au moins 50 000 emplois disparaissent dans des entreprises saines, qu’il n’y a aucune raison de fermer, mais au sein desquelles la succession du chef d’entreprise a été mal préparée ou ne l’a pas été du tout. En clair, il s’agit de PME en bonne santé, qui ferment parce qu’aucun repreneur ne s’est manifesté. Leurs salariés se retrouvent au chômage et sont parfois amenés à quitter la région avec leurs familles. Chacun d’entre vous a été confronté à cette réalité économique dans son territoire.
Le Gouvernement ne veut pas se résigner à cette situation. Nous ne nous résignons pas au gâchis que représente la destruction de 50 000 emplois par an dans un pays qui connaît un chômage de masse et les difficultés de la crise. Il est insupportable que 50 000 emplois soient perdus chaque année parce que des entreprises en bonne santé ont dû mettre la clé sous la porte, faute de repreneur. Le Gouvernement est donc déterminé à agir pour préserver ces entreprises qui comptent tant pour la cohésion territoriale du pays. C’est pourquoi il souhaite permettre aux salariés de proposer, le cas échéant, une offre de reprise, en leur donnant le temps et les informations nécessaires pour qu’ils puissent le faire, moyennant des contreparties évidentes en matière de confidentialité.
Le projet de loi tout entier réhabilite l’entrepreneuriat collectif, et il n’y a donc pas de raison valable de le combattre dans les circonstances que j’ai décrites. Notre ambition est de placer les salariés en situation d’être des repreneurs potentiels, forts de leur compétence et de leur connaissance de l’outil de production ; ni plus ni moins.
Le droit de propriété n’est pas remis en question : la liberté du cédant reste intacte. Il n’y a pas de préférence accordée à l’offre des salariés, car nous avons jugé qu’il serait difficile de définir les conditions d’équivalence entre plusieurs offres. Nous allons en débattre ensemble, mais l’objectif du Gouvernement est de faire en sorte que ce progrès social, à forte incidence économique pour nos territoires, ne soit pas censuré par le Conseil constitutionnel, au motif qu’il porterait atteinte au droit de propriété ou à la liberté de commerce. Nous débattrons de ces aspects, je le répète, mais je souhaite que votre assemblée retienne que la volonté du Gouvernement s’exprime tant dans l’ambition sociale que dans le pragmatisme économique de nos propositions.
Ces propositions complètent le « trident » que nous avons conçu pour soutenir le « choc coopératif ».
La première pointe de ce trident est le droit d’information pour les salariés : ils doivent savoir que leur entreprise est à vendre, ne serait-ce que pour avoir le temps de formuler une offre.
La deuxième pointe est la création du nouveau statut de société coopérative de production – SCOP – d’amorçage, qui permettra de limiter la prise de risque initiale des salariés. Le texte ne préjuge pas la forme juridique que choisiront les salariés s’ils se portent candidats à la reprise de leur entreprise, mais, s'agissant d’un projet de loi relatif à l’ESS, il était légitime que le Gouvernement propose une formule facilitant la reprise par le biais d’une SCOP. Le monde des SCOP nous a indiqué que l’obligation, pour les salariés, de détenir au moins 50 % du capital était parfois un obstacle à la reprise d’entreprises en bonne santé.
Enfin, la troisième pointe est la mise en place, en lien avec Bpifrance et la Confédération générale des SCOP, d’un fonds d’aide à la transmission d’entreprise.
Ce trident sera donc complété par les mesures de formation, d’aide et d’accompagnement qui mobiliseront, au côté des salariés candidats à la reprise de leur entreprise, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, les chambres de commerce et d’industrie, les unions régionales des SCOP. Plusieurs groupes ont déposé des amendements à ce sujet ; le Gouvernement sera ouvert au débat sur les conditions de l’accompagnement de la transmission d’entreprise.
Ce dispositif est universel au sens où il a aussi vocation à transformer des entreprises de l’économie classique en entreprises relevant de l’ESS. Je n’ai jamais pensé que la SCOP était le moyen de transformer le plomb en or, c'est-à-dire une entreprise en difficulté en une entreprise florissante. Je constate seulement que, parce que nous n’avons pas suffisamment travaillé sur la transmission d’entreprise, ce pays accepte aujourd'hui que l’or – des PME saines – se change en plomb. Permettre de prolonger la vie des entreprises en favorisant leur reprise par leurs salariés : telle est l’ambition du Gouvernement. §
Je salue la contribution décisive de la commission des affaires économiques, de son rapporteur, Marc Daunis, et de son président avisé
Sourires.
J’évoquerai enfin les nombreuses mesures de modernisation relatives aux différents statuts mutualistes et coopératifs que comporte le projet de loi.
Si les entreprises et organismes de l’ESS ont démontré leur résilience face à la crise, il n’en demeure pas moins qu’ils se trouvent souvent confrontés, en raison de leurs caractéristiques propres et des principes régissant leur action, à des difficultés qui freinent leur développement et entravent la croissance du secteur. Des modernisations et des adaptations étaient donc absolument nécessaires.
Sans citer l’intégralité de ces mesures, je retiens que nous ferons évoluer le statut coopératif comme il n’avait jamais évolué depuis la loi de 1947. Je mentionnerai notamment l’extension du champ d’application de la révision coopérative, qui est une innovation majeure. Elle confortera ceux qui veulent que le modèle coopératif devienne demain une voie alternative pour entreprendre.
Je veux aussi souligner que les mutuelles disposeront de nouveaux outils financiers et de développement, via les certificats mutualistes, les dispositions relatives à la coassurance ou les nouvelles unions, sans que soit pour autant dénaturée la spécificité de la gouvernance mutualiste ; je sais que Jean Germain, rapporteur pour avis de la commission des finances, y a été très attentif.
Le droit relatif aux associations et fondations intègre lui-même des avancées qui étaient attendues de longue date, avec la rénovation des titres associatifs ou les dispositions relatives aux fusions d’associations.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que j’ai l’honneur de vous présenter vise donc plusieurs objectifs. Il définit le champ des entreprises et structures relevant de modèles de développement fondés sur des principes qui en guident l’action et les finalités. Il affirme l’engagement de l’État en faveur de la promotion, de la valorisation, de l’organisation et du développement de l’ESS. Ses dispositions tendent à organiser et à planifier l’action des services de l’État, en lien avec les collectivités territoriales. Il détermine enfin les modalités de représentation de ce secteur socioéconomique auprès des pouvoirs publics.
C’est la première fois qu’un projet de loi décline ces ambitions au service d’une économie qui se veut tout entière au service de l’homme. Je nous souhaite de fructueux débats. Pour paraphraser le célèbre écrivain irlandais, par ailleurs socialiste, George Bernard Shaw, je dirai que, dans la vie, il y a deux catégories d’individus : ceux qui regardent l’économie telle qu’elle est et se demandent : pourquoi ? Et ceux qui imaginent l’économie telle qu’elle devrait être et se disent : pourquoi pas ? §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des affaires économiques soumet à l’examen du Sénat le texte qu’elle a adopté le 16 octobre dernier.
Intervenant au nom de cette commission, je m’astreindrai à juguler ma passion naturelle pour l’économie, et particulièrement pour l’économie sociale et solidaire, afin de conserver le ton qui sied à la fonction de rapporteur.
Sourires.

L’économie sociale et solidaire n’est pas une idée neuve. Dès les années 1840, des tisserands anglais se sont rendu compte qu’ils pouvaient, en se réunissant, se fournir à moindre coût et gagner leur indépendance. C’est ainsi, en partant des besoins de chacun, que l’économie sociale et solidaire a peu à peu élaboré, par des voies diverses, certaines des réponses qui sont aujourd’hui au cœur de notre économie et de notre société : protection sociale, production agricole, grande distribution, action sanitaire et sociale… L’économie sociale et solidaire est toujours à l’avant-garde de secteurs tels que celui de la gestion des déchets, qui seront demain les moteurs de l’économie dite circulaire.
L’économie sociale et solidaire relève donc d’une attitude pragmatique. Par la coopération ou la mutualisation, ses acteurs recherchent la solution la plus efficace et la plus équitable. Or cette solution ne passe pas forcément par le modèle de l’entreprise capitalistique, qui sépare les apporteurs de capitaux de ceux qui, par leur force de travail, participent plus directement à la production. La crise financière l’a bien montré : l’entreprise capitalistique et son corollaire, l’intermédiation financière, ne constituent pas le seul modèle pour réaliser un projet entrepreneurial.
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire ne relèvent pas pour autant de l’assistanat. Elles recherchent l’équilibre économique et sont parfois plus efficaces que d’autres entreprises. En effet, au lieu de consacrer leurs bénéfices à la rémunération d’intermédiaires tels que les apporteurs de capitaux, elles les utilisent, autant que possible, pour satisfaire à leur objet social, que celui-ci soit la production ouvrière, l’assurance de risques ou l’aide aux personnes défavorisées.
M. le ministre vient de le rappeler, il ne s’agit pas d’opposer les deux modèles. L’économie sociale et solidaire ne se substitue pas à l’économie capitalistique, même si elle est capable de la côtoyer efficacement dans certains secteurs, mais elle apportera de plus en plus souvent une réponse originale dans les domaines où le modèle capitalistique ne trouve pas de rentabilité suffisante ou ne correspond pas ou plus aux aspirations profondes de nos concitoyens, voire aux enjeux humains, économiques, sociaux, environnementaux auxquels sont confrontées notre planète et nos sociétés.
Le présent projet de loi a d’abord pour ambition d’apporter une visibilité à un secteur par essence divers, mais proche des territoires : 75 % des lieux de décision des coopératives sont situés en région, alors que quatre-vingt-dix des cent premières entreprises françaises ont leur siège en Île-de-France.
Ce texte permettra à l’économie sociale et solidaire de franchir une nouvelle étape. De 2001 à 2009, le taux de croissance de l’emploi a été de 2, 6 % pour les entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire, contre 1, 1 % pour les autres entreprises du secteur privé.
Je me réjouis que le Gouvernement ait décidé de soumettre ce projet de loi en premier lieu à la Haute Assemblée. Monsieur le ministre, soyez-en remercié !
Le travail effectué par la commission des affaires économiques, mais aussi par les trois commissions qui se sont saisies pour avis, montre l’intérêt du Sénat pour ce texte, malgré un calendrier parlementaire très chargé.
Ce projet de loi n’a pas été écrit dans le secret des cabinets et des administrations. Il résulte d’une longue concertation avec l’ensemble des acteurs du secteur. À cet égard, monsieur le ministre, je tiens à saluer votre engagement personnel dans la préparation de ce texte d’équilibre, que vous avez présenté le 24 juillet dernier. Il concilie une vision d’ensemble avec des réponses concrètes s’adressant à chacune des grandes familles de l’économie sociale et solidaire.
Le projet de loi définit d’abord, pour la première fois – il était temps ! –, le périmètre de l’économie sociale et solidaire, en retenant, dans son article 1er, une approche inclusive. Celle-ci n’allait pas de soi, tant peut être fort l’attachement de nombreux acteurs de l’économie sociale et solidaire à des statuts qui, par ailleurs, ont fait leurs preuves.
Au-delà des coopératives, des associations, des mutuelles et fondations, le champ de l’économie sociale et solidaire comprendra donc officiellement des sociétés qui partagent et inscrivent dans leurs statuts, j’y insiste, les grands principes de « lucrativité limitée », de participation et d’ « impartageabilité » des réserves.
En effet, l’économie sociale et solidaire se définit d’abord comme une certaine manière d’entreprendre, plus que comme un statut ou un secteur d’activité donné. Elle a vocation à concerner un pan de plus en plus vaste de l’économie.
La commission a approuvé cette ouverture : elle respecte en effet les grands principes et permet de diffuser dans l’économie les principes de l’économie sociale et solidaire, afin de montrer à des entrepreneurs qui ne sont pas forcément prêts à adopter d’emblée des statuts contraignants tout l’intérêt que pourraient présenter ces derniers pour leur activité.
À l’article 2 est définie l’utilité sociale, requise aussi bien des sociétés commerciales admises dans l’ESS que de celles qui demandent un agrément « entreprise solidaire ». La commission a procédé à une réécriture de cet article dans un souci de clarification. Elle a aussi instauré, sur ma suggestion, une « déclaration de principes » par laquelle les entreprises volontaires pourront signifier leur intention de tenir des engagements, notamment en matière sociale, allant au-delà des principes fondamentaux de l’économie sociale et solidaire.
Le projet de loi consacre également l’existence de grandes institutions transversales de l’ESS : Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, chambres régionales et conseil national de l’économie sociale et solidaire. Dans son volet territorial, il favorise le lien avec l’économie classique au travers des pôles territoriaux de coopération économique. Le texte tend également à prévoir la prise en compte de l’ESS dans les contrats de développement territorial mis en place dans le cadre du Grand Paris. La commission a étendu cette mesure aux schémas régionaux de développement économique.
À l’article 7, le projet de loi vise à réformer l’agrément « entreprise solidaire ». Les dispositions actuelles, insuffisamment précises, font l’objet d’interprétations diverses selon les régions. La commission a donc complété la règle prévue par le texte en matière d’échelle des rémunérations au sein de l’entreprise.
À l’article 10 est définie la notion de subvention, laquelle est aujourd’hui essentiellement jurisprudentielle, ce qui est source d’insécurité juridique. Souvent, les administrations locales préfèrent recourir à la procédure lourde du marché public, alors que la subvention aurait permis d’atteindre le même objectif plus rapidement.
La commission a par ailleurs complété le titre Ier en prévoyant, en cohérence avec les évolutions du droit européen, la possibilité de passer des marchés réservés à des organismes employant des personnes handicapées ou défavorisées. Elle a aussi inscrit dans le texte le dispositif local d’accompagnement, qui, dans bien des territoires, est un instrument puissant de développement de l’économie sociale et solidaire.
Sur ma proposition, la commission a aussi proposé une définition de la notion d’innovation sociale. M. le ministre ayant développé ce point, je n’y reviens pas.
J’en viens au fameux titre II, qui a bénéficié d’une certaine médiatisation, donnant souvent lieu à caricature.
Les articles 11 et 12 instaurent simplement une obligation d’information des salariés avant la cession d’une entreprise, afin de leur permettre de présenter une offre de reprise. La reprise d’une entreprise par ses salariés demeure l’un des meilleurs moyens de préserver l’emploi, de transmettre les talents et de poursuivre le projet entrepreneurial.
On nous a dit que le délai de deux mois était insuffisant : c’est la raison pour laquelle je me suis permis de proposer l’instauration d’un dispositif souple, simple, d’information des salariés, tout au long de la vie de l’entreprise, sur les possibilités et les modalités de reprise. Ce dispositif, qui a été inscrit à l’article 11 A, sera léger pour les entreprises et visera à faire émerger, sur le long terme, les vocations et les compétences parmi les salariés. Les études le montrent : souvent, ni le chef d’entreprise ni les salariés eux-mêmes ne pensent à cette possibilité, ou bien elle ne leur apparaît que de manière trop abstraite, sans qu’ils en perçoivent les avantages et les limites.
Malgré tout, force est de constater que le dispositif des articles 11 et 12 a été source d’incompréhension, certains l’ayant présenté comme une menace grave pour les transmissions d’entreprise, voire une atteinte au droit de propriété.
En fait, nous nous sommes efforcés de faire en sorte qu’il présente des garanties fortes en termes de confidentialité et élargisse l’offre des possibilités offertes au chef d’entreprise en matière de transmission. Ce travail, réalisé par voie d’amendements, contribue, me semble-t-il, à la sécurisation d’un dispositif ô combien important pour la préservation des emplois. Cela a été dit, on s’accorde à estimer à quelque 50 000 le nombre d’emplois détruits chaque année faute d’une solution de reprise.
Le texte comprend ensuite des dispositions à destination de chacune des familles de l’économie sociale et solidaire, tout particulièrement les coopératives, mais aussi le monde mutualiste, les associations, les fondations.
Les coopératives font l’objet d’un volet majeur du texte. Il est vrai qu’elles représentent plus de 70 % du chiffre d’affaires global du secteur de l’ESS. Le mouvement coopératif français est l’un des plus importants du monde, avec 21 000 entreprises coopératives qui emploient, directement ou indirectement, près d’un million de personnes. Dans notre pays, une personne sur deux est membre d’une ou de plusieurs coopératives.
Les coopératives constituent bien un « atout pour le redressement économique », un véritable « pilier de l’ESS », pour paraphraser le titre du rapport d’information de notre collègue Marie-Noëlle Lienemann présenté en 2012 au nom du groupe de travail sur l’économie sociale et solidaire que j’ai eu l’honneur de présider. Bon nombre des dispositions du projet de loi sont d’ailleurs issues de ce rapport : je vous sais gré, monsieur le ministre, de l’avoir autant pris en considération.
Votre texte vise à conforter le développement du secteur coopératif, à la fois en modernisant les statuts et en assouplissant les règles qui régissent le fonctionnement de ces entreprises.
La définition de l’entreprise coopérative est réaffirmée, à l’article 13, par le rappel et l’actualisation de ses principes fondateurs. La commission y a intégré d’autres principes coopératifs reconnus au niveau international, afin de bien marquer dans la loi la spécificité de ce type d’entreprises. Il me semble que nous sommes parvenus à un bon équilibre dans la rédaction de cet article.
L’article 14 tend à réformer et à généraliser à toutes les familles la procédure dite de « révision coopérative ». Il sera peut-être possible d’aller plus loin encore, en permettant au réviseur d’assister les entreprises dans la mise en œuvre des mesures correctrices.
Le texte vise précisément à développer les sociétés coopératives de production, avec la création, à l’article 15, d’un statut de « SCOP d’amorçage ».
L’article 17 a pour objet d’autoriser la constitution de groupements de SCOP, ce qui représente un autre point important pour les coopératives. L’idée est de favoriser la création de grandes unions, où les salariés d’une SCOP seraient également associés d’autres SCOP. Là aussi, il sera possible de faire évoluer le texte en permettant à des SCOP détenant des filiales sous forme de sociétés de les transformer à leur tour en SCOP, sans pour autant en perdre le contrôle.
Dans un même esprit, à l’article 29, la commission a permis aux entreprises artisanales regroupées en coopératives de réaliser des politiques commerciales communes, pouvant passer par l’établissement de prix communs.
Les articles 21 et 22 du projet de loi visent par ailleurs à conforter les sociétés coopératives d’intérêt collectif, les SCIC. Les collectivités locales seront notamment autorisées à détenir jusqu’à 50 % de leur capital, contre 20 % aujourd’hui, afin de les pérenniser et de les dynamiser.
Je passerai plus rapidement sur les autres dispositions relatives aux coopératives, en soulignant toutefois que le texte traite d’une majorité des familles existantes.
Le titre IV comprend des dispositions relatives à la famille des mutuelles. Ainsi, aux articles 34 et 35, sont levés des verrous juridiques qui rendent aujourd’hui plus difficile la conclusion de contrats de coassurance entre des mutuelles, des assurances et des institutions de prévoyance, ainsi que de contrats collectifs d’une manière générale. Or ce type de contrats est appelé à se développer, avec la généralisation de l’assurance complémentaire dans les entreprises.
Le projet de loi institue aussi, à l’article 36, des certificats mutualistes et des titres paritaires.
Les titres V et VI concernent, respectivement, les associations et les fondations. Le titre associatif, qui a rencontré peu de succès depuis sa création, est réformé et étendu aux fondations.
Le titre VII ne comprend qu’une disposition, à l’article 49, qui tend à favoriser le recours aux entreprises solidaires par les éco-organismes, dont le champ d’action est particulièrement approprié à ces entreprises. Cette disposition, elle aussi, a fait l’objet d’une présentation déformée : non, elle ne représente pas une menace pour l’emploi, puisqu’elle favorise au contraire des entreprises qui sont créatrices d’emplois, tout particulièrement d’emplois locaux !
Enfin, le titre VIII comprend des dispositions diverses et finales, concernant notamment la mise en œuvre de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » et de l’obligation d’information.
Mes chers collègues, c’est un texte enrichi que vous propose la commission des affaires économiques, sans bouleverser les équilibres obtenus au cours de la remarquable concertation qui s’est poursuivie tout au long de l’élaboration de ce projet de loi.
J’espère que nos débats permettront de faire avancer l’idée selon laquelle l’économie sociale et solidaire ne représente ni un bouleversement redoutable ni une pratique utopique et marginale : ce secteur est porteur d’emplois et de développement, mais il s’agit ici d’emplois et d’un développement plus riches de sens pour les producteurs comme pour les consommateurs, c’est-à-dire pour nos concitoyens. Il est nécessaire de développer une économie au service de l’humain et de replacer l’humain au cœur de l’économie.

Monsieur le ministre, le dialogue entre nous a été franc et fructueux ; il se poursuit, mais le Parlement jouera son rôle de législateur.
Que l’on me permette, en conclusion, de remercier les rapporteurs pour avis et chacun des membres de notre assemblée de la qualité du travail que nous avons effectué ensemble. J’espère que ce travail a été efficace et qu’il pourra contribuer à éclairer nos débats. Le secteur de l’économie sociale et solidaire a besoin de notre reconnaissance et de notre soutien.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

M. le président. La parole est à Mme Christiane Demontès, rapporteur pour avis.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le président de la commission des affaires économiques, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd’hui marquera l’histoire de l’économie sociale et solidaire dans notre pays, car c’est la première fois qu’une loi est consacrée à celle-ci. La commission des affaires sociales a donc souhaité émettre un avis sur ce projet de loi.
Compte tenu de la densité de ce texte, rappelée à l’instant par M. le ministre et par notre collègue rapporteur Marc Daunis, nous avons restreint notre avis aux articles ayant un lien direct ou indirect avec le code du travail, soit une dizaine d’articles au total.
La commission des affaires sociales a adopté la vingtaine d’amendements que je lui ai présentés le 15 octobre dernier. Presque tous ont été adoptés le lendemain par la commission des affaires économiques. Je voudrais rapidement vous en présenter les principaux.
À l’article 7, nous avons ajouté les acteurs du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées dans la liste des bénéficiaires de plein droit du nouvel agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».
Nous avons également porté, à l’article 52, de un à deux ans la période minimale pendant laquelle les entreprises bénéficiant de l’agrément solidaire seront réputées bénéficier de plein droit du nouvel agrément. Ce délai supplémentaire permettra aux entités concernées de s’approprier les dispositions de la nouvelle loi et de modifier leurs statuts sans avoir à convoquer une assemblée générale extraordinaire.
À l’article 9, nous avons rendu obligatoire la conclusion de conventions dans toutes les régions entre les préfets, d’une part, et les maisons de l’emploi et les gestionnaires des plans locaux pour l’insertion et l’emploi, d’autre part, afin de favoriser le recours aux clauses sociales. Ces conventions permettront de repérer les marchés pertinents et les publics à insérer, de guider la rédaction des clauses d’insertion et d’accompagner les entreprises titulaires des lots dans la mise en œuvre des clauses sociales.
La généralisation de ces conventions présente un double intérêt : elle relancera le recours aux clauses sociales pour les marchés publics de l’État, qui accuse un retard certain en la matière ; elle fournira un cadre, sur la base du volontariat, aux grandes collectivités territoriales qui devront mettre en place les schémas de promotion des achats publics socialement responsables prévus, justement, à l’article 9.
Nous avons enfin souhaité sécuriser les dispositions de l’article 33, relatif aux entrepreneurs salariés associés des coopératives d’activité et d’emploi, les CAE. Nées au milieu des années quatre-vingt-dix pour permettre à des porteurs de projets de créer et de développer leurs activités dans un cadre coopératif, autonome et sécurisé, ces coopératives remplissent deux grandes missions : elles accompagnent les entrepreneurs dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets ; elles mettent à leur disposition des services mutualisés qui comprennent, notamment, la gestion financière, sociale et administrative. Elles offrent donc une véritable alternative à l’auto-entreprenariat, aux couveuses d’activité et aux sociétés de portage salarial.
Selon la Confédération générale des SCOP, on comptait, au 31 décembre 2012, quatre-vingt-onze entreprises autonomes et quarante-quatre établissements secondaires, qui rassemblaient 5 000 salariés, leur nombre augmentant de 15 % à 20 % par an.
Il s’est toutefois avéré que les critères classiques du contrat de travail ne convenaient pas aux spécificités de ces coopératives, compte tenu de l’absence de lien de subordination entre la direction et les entrepreneurs et des modalités de calcul de la rémunération, fondée sur le chiffre d’affaires réalisé par ces derniers.
C’est pourquoi l’article 33 crée un nouveau contrat dans le code du travail, distinct du contrat de travail de droit commun, au profit des entrepreneurs salariés associés des coopératives d’activité et d’emploi.
Par souci de lisibilité, nous avons clairement distingué les règles du contrat des entrepreneurs salariés associés de celles qui sont applicables aux entrepreneurs salariés n’étant pas encore devenus associés de la coopérative à l’issue de la période de test de trente-six mois de leurs projets.
Compte tenu du principe d’assimilation présenté à l’article L. 7331-1 du code du travail, nous avons également supprimé les dispositions redondantes pour éviter tout risque d’interprétation a contrario. Le développement de ces coopératives originales pourrait entraîner, toujours selon la Confédération générale des SCOP, plus de 10 000 créations nettes d’emploi dans les cinq années à venir. Avec un cadre juridique ainsi sécurisé, nous donnons tous les moyens à ces coopératives pour se développer.
Trois amendements votés par la commission des affaires sociales n’ont pas été adoptés par la commission des affaires économiques. Compte tenu de l’importance qu’ils revêtent à mes yeux, je les ai présentés à nouveau, mercredi dernier, moyennant quelques adaptations, à la commission, qui les a adoptés. Je voudrais les évoquer brièvement.
Le premier amendement concerne la fourchette des rémunérations dans les entreprises qui demandent à bénéficier du nouvel agrément solidaire prévu à l’article 7. Le texte de la commission des affaires économiques prévoit que la moyenne des sommes versées aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés doit être inférieure à un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle d’un salarié à temps complet qui perçoit le SMIC, ou le salaire minimum de branche si celui-ci est supérieur. Nous avons souhaité maintenir cette disposition, mais en remplaçant la référence au salaire minimum par la moyenne des cinq rémunérations les plus faibles dans l’entité considérée. Nous rendons ainsi le dispositif plus dynamique et vertueux : d’une part, en renforçant l’attractivité du secteur de l’économie sociale et solidaire pour certains profils techniques très recherchés ; d’autre part, en tirant vers le haut les salaires les plus faibles dans l’entité considérée, afin de lutter contre les « trappes à pauvreté ».
Nous aurons l’occasion de débattre de cette question lorsque je présenterai cet amendement ; je m’en réjouis, car nous sommes plus forts quand nous réfléchissons et prenons des décisions collectivement.
Le deuxième amendement porte sur l’information préalable des salariés lors d’une transmission d’entreprise, prévue à l’article 11 du projet de loi. Je rappelle que le dispositif de cet article concerne toutes les entreprises, et pas seulement celles de l’économie sociale et solidaire. La rédaction actuelle du texte ne prévoit aucun délai précis pour l’information préalable des salariés en cas de cession d’un fonds de commerce dans les entreprises employant entre cinquante et deux cent quarante-neuf salariés. Nous avons souhaité, par souci d’efficacité et de simplicité, instaurer un délai de deux mois en cas de carence du comité d’entreprise coïncidant avec une absence de délégués du personnel, en reprenant ainsi la règle prévue pour les entreprises employant moins de cinquante salariés.
Les études de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, montrent en effet qu’il ne s’agit pas d’une hypothèse d’école puisque, selon une publication datée d’avril 2013, 6 % des établissements de plus de cinquante salariés ne disposaient d’aucune institution représentative du personnel en 2010-2011.
Nous avons également adopté un amendement similaire à l’article 12, concernant les cas de cession des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui emploient entre cinquante et deux cent quarante-neuf salariés.
Enfin, outre ces trois amendements, la commission des affaires sociales a adopté un amendement à l’article 33, afin de poursuivre la sécurisation du dispositif, en précisant notamment que tous les entrepreneurs salariés, qu’ils soient ou non associés, jouissent des mêmes droits, sont soumis aux mêmes sujétions et doivent être affiliés aux assurances sociales du régime général.
Tel est, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le fruit des travaux de la commission des affaires sociales.
Nous aurons l’occasion, au cours du débat, d’aborder des questions qui dépassent le strict cadre de l’avis de la commission des affaires sociales, mais auxquels nous attachons une grande importance. Je pense, par exemple, à la place des structures d’insertion par l’activité économique dans le projet de loi, ou encore à la définition de l’utilité sociale et de l’innovation sociale. Sur tous ces sujets, vos explications et précisions, monsieur le ministre, sont attendues et permettront de répondre à certaines de nos interrogations, mais surtout à celles des personnes que j’ai pu auditionner.
Je voudrais, pour conclure, rappeler ces mots empreints de sagesse de Léon Bourgeois, prix Nobel de la paix et ancien sénateur, extraits de son ouvrage Solidarité : « la loi de solidarité des actions individuelles finit par apparaître, entre les hommes, […] non comme une nécessité extérieurement et arbitrairement imposée, mais comme une loi d’organisation intérieure à la vie […], un moyen de libération ».
Je souhaite que le développement des associations, des fondations, des mutuelles, des coopératives et des sociétés commerciales relevant du champ de l’économie sociale et solidaire ou aspirant à y entrer permette de promouvoir les valeurs humanistes, la solidarité et la démocratie participative, qui sont parfois mises à mal dans notre société.
Tel est l’objectif de ce projet de loi, que je soutiens avec enthousiasme.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire a pour ambition d’encourager un changement d’échelle de l’économie sociale et solidaire dans tous ses aspects, afin de construire avec les entreprises relevant de ce secteur une stratégie de croissance plus robuste, plus riche en emplois, plus durable et plus juste socialement.
À cet égard, la question du financement des organismes composant le secteur de l’économie sociale et solidaire est fondamentale. Le présent projet de loi tend à créer ou à rénover des dispositifs destinés à renforcer les capitaux propres des organismes d’assurance mutualistes et paritaires, des associations et des fondations. La commission des finances a souhaité limiter le champ de sa saisine à ces dispositions, qui relèvent clairement de sa compétence.
J’évoquerai d’abord les dispositions relatives aux sociétés d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance.
Ces organismes sont des sociétés de personnes sans capital social. Leurs fonds propres résultent non du capital versé par des actionnaires, mais de la mise en réserve de leurs résultats.
Ce principe fondamental du mutualisme et du paritarisme présente l’inconvénient de fermer l’accès aux marchés de capitaux pour le renforcement de ces fonds propres. Seuls des titres de dette peuvent être émis par ces organismes, sous des formes variées.
Cette restriction n’a pas empêché jusqu’ici le développement des acteurs mutualistes et paritaires dans le secteur de l’assurance, au sein duquel ils occupent une place majeure : 53 % du marché de l’assurance automobile, 50 % de celui de l’assurance habitation et l’essentiel du secteur des complémentaires santé.
Le monde mutualiste et paritaire a même fait preuve d’une remarquable résilience durant la crise financière qui a profondément ébranlé certaines des sociétés de structure capitaliste classique que l’on présentait pourtant comme les mieux adaptées à une économie de plus en plus financiarisée.
On observe cependant un double mouvement qui pourrait placer certains de ces organismes dans une situation difficile : d’une part, l’accroissement de la concurrence sur le marché de l’assurance, qui conduit à une réduction des marges, et donc de la possibilité d’accumuler des bénéfices ; d’autre part, le renforcement des exigences de solvabilité imposées aux assureurs, en particulier au travers de la directive européenne « Solvabilité II », dont on peut d’ailleurs se demander si elle tient suffisamment compte des spécificités et des points forts du modèle mutualiste.
Ces règles obligent les assureurs à disposer de plus de fonds propres pour assurer la couverture de leurs engagements et imposent aussi une définition de plus en plus restrictive des instruments de financement admis dans la catégorie des fonds propres de la meilleure qualité.
Il ne faut pas que ce souci légitime de garantir la solidité des assureurs conduise indirectement à imposer comme standard la société de capitaux, au détriment du modèle mutualiste, qui a justement fait la preuve de sa robustesse.
Dans cette perspective, le présent projet de loi prévoit la création de titres spécifiques, dénommés certificats mutualistes s’ils sont émis par des sociétés d’assurance mutuelle ou par des mutuelles, qui relèvent respectivement du code des assurances et du code de la mutualité, et certificats paritaires s’ils sont émis par des institutions de prévoyance, qui relèvent du code de la sécurité sociale.
Le régime de ces certificats répond à une triple contrainte : premièrement, le respect des principes mutualistes ; deuxièmement, la satisfaction des critères prudentiels permettant de classer les fonds recueillis parmi les capitaux propres de la meilleure qualité ; troisièmement, la protection des épargnants.
S’agissant du respect des principes mutualistes, je souligne que les certificats ne donnent ni droits de vote supplémentaires en assemblée générale, ni droit sur l’actif net de l’émetteur.
Les organismes mutualistes se sont développés sur un fondement affinitaire qui conserve aujourd’hui toute sa force et constitue l’un des moteurs essentiels de leur action. Le dispositif proposé permet de préserver cette spécificité si précieuse.
Le périmètre des souscripteurs des certificats est ainsi restreint aux personnes liées par une affectio societatis directe ou indirecte avec l’émetteur. La commission des finances a adopté sur ce point un amendement d’harmonisation entre les différents types de certificats, amendement intégré par la commission des affaires économiques dans le texte qui vous est soumis.
Enfin, comme la logique de souscription doit, avant d’être économique, répondre à la volonté du souscripteur de soutenir l’action et le développement de l’organisme auquel il est lié, la rémunération des certificats est plafonnée à une fraction des résultats de l’émetteur.
S’agissant de l’aspect prudentiel, tous les fonds propres ne sont pas logés à la même enseigne. Pour pouvoir être pris intégralement en compte au titre de la couverture des engagements de l’assureur, les fonds doivent présenter certaines caractéristiques tenant à leur « permanence », à leur capacité à absorber les pertes enregistrées par l’émetteur et à la flexibilité de leur rémunération.
C’est le cas des certificats : la rémunération est fixée discrétionnairement et chaque année par l’assemblée générale de l’émetteur ; ils sont susceptibles d’absorber les pertes de celui-ci ; il n’y a pas de remboursement possible, sauf liquidation de l’émetteur, et seulement après désintéressement de l’ensemble des créanciers ; les rachats sont mis en place de façon facultative par l’émetteur, de manière contingentée et sous le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR. Le projet de loi définit un ordre de priorité, sur lequel la commission des finances a proposé un amendement d’harmonisation, adopté par la commission des affaires économiques.
S’agissant, enfin, de la protection de l’épargnant, le présent projet de loi renvoie aux obligations d’information et de conseil déjà prévues pour certaines opérations de capitalisation organisées par le code des assurances et le code de la sécurité sociale. La commission des finances a adopté un amendement visant à clarifier et à compléter ces obligations, amendement qui a été intégré au texte établi par la commission des affaires économiques.
Il me semble que, avec ces amendements, le dispositif proposé est équilibré, étant entendu que la souscription de ces titres trouve sa justification dans la volonté de soutenir l’émetteur et d’accompagner son développement. La commission des finances a ainsi émis un avis favorable à l’adoption de l’article 36.
Parmi les dispositions relatives aux organismes d’assurance, j’ai également souhaité examiner celles qui tendent à favoriser le développement de la coassurance en matière d’assurance de personnes.
En effet, interviennent dans ce domaine des organismes d’assurance régis par des corpus de règles différents. L’objet de l’article 34 du présent projet de loi est de permettre la réalisation de telles opérations. Pour cela, il procède à une mise en cohérence des dispositions des trois codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale. Il faut souligner que l’alignement s’opère sur les dispositions les plus protectrices des assurés.
Cette harmonisation est particulièrement nécessaire aux mutuelles, dont la taille et le champ géographique ne correspondent pas toujours à l’ampleur des contrats de branche.
Là encore, le dispositif proposé veille au respect des principes de gouvernance propres au secteur mutualiste : les salariés couverts par de tels contrats bénéficient du statut de sociétaire et d’adhérent de chacune des sociétés d’assurance mutuelles et des mutuelles participant à l’opération de coassurance. Je considère donc que ce dispositif constitue un progrès. La commission des finances a approuvé cet article.
L’autre volet du champ de la saisine de la commission des finances concerne les dispositions relatives au financement au sens large des associations, des fondations et des fonds de dotation, regroupées au sein des titres V et VI de ce projet de loi.
Il s’agit d’un sujet de grande importance. En effet, comme le souligne l’étude d’impact annexée au projet de loi, la France a un vivier de plus d’un million d’associations, qui comptent plus de 21 millions d’adhérents et environ 13 millions de bénévoles. En termes d’emplois, comme le rappelle l’étude d’impact, l’effectif salarié total des associations s’élève à près de 1, 8 million de personnes, soit un peu moins de 80 % du total de l’économie sociale et solidaire.
Notre capacité à conforter le modèle associatif et à renforcer les canaux de financement des associations représente donc, pour notre pays, un véritable enjeu, y compris économique.
Tel est l’objet de l’article 40 du projet de loi, relatif à la réforme des titres associatifs. Comme vous le savez, les associations sont autorisées à émettre des obligations depuis 1985. Certaines d’entre elles, dénommées « titres associatifs », présentent la particularité de n’être remboursables que sur la seule initiative de l’émetteur ; ce sont donc des « quasi-fonds propres ». En outre, quand il n’est pas fait appel public à l’épargne, les obligations émises par les associations sont rémunérées à un taux plafonné, qui est la somme du taux moyen du marché obligataire du trimestre précédent et d’une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l’économie, laquelle ne peut excéder trois points.
Cependant, aujourd’hui, les associations ne font que peu usage de ces titres, qui restent par ailleurs mal connus des investisseurs.
L’article 40 du projet de loi vise à donner un nouveau souffle à ce mode de financement, en faisant des titres associatifs des instruments plus conformes aux pratiques du marché.
À cette fin, il est proposé de mieux borner l’horizon de remboursement des titres associatifs en permettant que les contrats d’émission de titres associatifs puissent stipuler que le remboursement aura lieu à une échéance déterminée d’au moins sept ans, dès lors que les excédents constitués depuis l’émission, déduction faite des éventuels déficits constatés durant la même période, dépassent le montant nominal de l’émission.
De plus, ces nouveaux titres « à durée déterminée » pourront faire bénéficier leurs souscripteurs d’une rémunération additionnelle, à définir par arrêté, dans la limite de 2, 5 %. Ainsi, le taux maximal de ces dernières opérations pourrait s’établir au niveau du taux moyen du marché obligataire plus 5 %, soit, dans les conditions actuelles de taux, à 7, 30 %.
La commission des finances a exprimé son accord avec ce système, tout en adoptant un amendement destiné à renforcer l’encadrement des émissions, lequel a été intégré dans le texte de la commission des affaires économiques. Elle a également approuvé l’article 47 du projet de loi, qui donne aux fondations le droit d’émettre de tels titres.
De même, la commission des finances a approuvé l’article 46, relatif aux fondations d’entreprise, qui permettra aux mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l’entreprise fondatrice d’effectuer des dons à ces structures, à l’instar de leurs salariés.
Enfin, est proposée, à l’article 48, une légère modification des conditions de création des fonds de dotation, qui sont des structures issues de la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie de 2008. Comme vous le savez, ces outils se caractérisent par leur grande simplicité de fonctionnement par rapport aux traditionnelles fondations reconnues d’utilité publique. Sans remettre en cause cet atout, cet article vise à éviter que ne se multiplient des « fonds dormants », en prévoyant l’instauration, au moment de la création d’un fonds, d’une « dotation plancher » dont le montant serait fixé par décret. L’étude d’impact précise que le montant de 25 000 euros est envisagé par le Gouvernement. La commission des finances a soutenu cette démarche, moyennant l’adoption d’un amendement destiné à mieux encadrer le pouvoir réglementaire. Cet amendement a, lui aussi, été intégré dans le texte de la commission des affaires économiques.
Je terminerai en évoquant les articles 41 et 42 du projet de loi.
Il s’agit ici de définir le droit applicable en cas de fusion ou de scission d’associations. L’inscription de telles dispositions dans ce texte est une initiative très heureuse du Gouvernement, car le vide juridique actuel pénalise fortement la rationalisation du paysage associatif et les rapprochements d’associations.
En termes fiscaux – aspect qui intéresse au premier chef la commission des finances –, ce texte ne comporte pas de dispositions normatives. Pourtant, selon les éléments recueillis auprès de Bercy, la mise en œuvre des articles 41 et 42 aura des conséquences fiscales, la définition du régime des fusions étant une condition sine qua non pour que l’administration fiscale soit en mesure de préciser que le régime de sursis d’imposition et les droits de mutation forfaitaires applicables aux fusions de sociétés s’appliquent également à ces opérations. Il faudra donc veiller à ce que la direction de la législation fiscale s’empare bien du sujet après la promulgation de la loi. Sur la base de ces éléments, la commission des finances a approuvé l’adoption de ces articles.
En conclusion, monsieur le ministre, je suis heureux de pouvoir vous dire que la commission des finances s’est prononcée en faveur de l’adoption par le Sénat de ce projet de loi très riche. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, sur l’ensemble de nos travées, chacun a conscience des limites de ce que j’appellerai « l’économie traditionnelle ».

Nous avons tous appris que, même dans une période de forte croissance, la seule recherche du profit ne permet de satisfaire ni l’ensemble des besoins collectifs ni la demande d’emploi, en particulier dans les zones connaissant de grandes difficultés. Il existe donc un consensus sur la nécessité de se doter de nouveaux outils, parmi lesquels l’économie sociale et solidaire.
Bien sûr, l’économie sociale et solidaire ne résoudra pas à elle seule le problème du chômage, de la désertification de certains territoires et de la désindustrialisation de notre pays. Elle n’est d’ailleurs pas un outil irréprochable ; elle peut encore progresser.
Pourquoi fait-elle cependant consensus ? Selon moi, ce consensus repose non pas sur une idéologie, mais sur l’expérience. Chacun d’entre nous connaît en effet une entreprise de l’économie sociale et solidaire ayant offert une alternative au modèle classique de l’entreprise là où l’on pensait que rien n’était possible.
Le projet de loi que vous nous présentez, monsieur le ministre, a une grande ambition. L’économie sociale et solidaire représente une autre façon d’entreprendre, que je vous sais gré d’avoir évoquée en employant des mots de philosophe. Ce faisant, vous avez placé le débat au niveau où il doit se situer.
Entreprendre sans recherche du lucre : dans le monde actuel, voilà une grande audace, que nous approuvons avec enthousiasme !
Votre texte présente un autre mérite, celui d’apporter des réponses concrètes aux questions suivantes : comment mieux définir les entreprises de l’économie sociale et solidaire ? Comment faciliter leur création ? Comment améliorer leur financement et assurer leur pérennité ?
Quant aux réflexions formulées par la commission des lois, elles pourraient se résumer en une seule interrogation : comment favoriser le développement de l’économie sociale et solidaire ?
Le projet de loi traite cette question sous plusieurs angles : la définition de l’économie sociale et solidaire – comme l’a dit M. le rapporteur, il était temps d’en donner une –, le financement public, l’accès aux marchés publics et, plus globalement, la dynamique de l’entreprise.
Le financement public peut prendre différentes formes. Sur ce point, comme sur d’autres, l’étude d’impact me paraît d’excellente qualité.
La première forme de financement public est la subvention publique, laquelle est devenue un objet juridique dangereux, pour une raison très simple : il est parfois difficile de la distinguer du marché public lui-même. Un juge peut ainsi requalifier une subvention publique en un acte qui aurait dû relever d’un marché ou d’une délégation de service public. Lorsque cela se produit, c’est la catastrophe, car l’entreprise doit alors rembourser les sommes perçues, ce qui peut la conduire à la faillite ou à la liquidation judiciaire. Il était donc grand temps de sécuriser la notion de subvention, en lui donnant pour la première fois une définition, que la commission des lois propose de simplifier.
En matière de financement public, l’accès aux marchés publics constitue un deuxième volet. Aujourd’hui, seulement 5 % des marchés publics des collectivités territoriales et 2, 5 % de ceux de l’État comportent une clause d’insertion : nous sommes très loin des objectifs que nous cherchons à atteindre !
Au travers du schéma de promotion des achats publics socialement responsables, le présent texte nous invite, dans un esprit de pragmatisme, à une prise de conscience. Il vise à provoquer un débat, et non à imposer. Il s’agit d’un choix excellent, qui aura des vertus pédagogiques, mais il faudra peut-être, un jour, aller plus loin.
La commission des lois propose, quant à elle, de retenir, pour l’application obligatoire de ce schéma, un seuil démographique, et non de montant annuel d’achats. Ce seuil démographique reste à préciser, mais ce serait plus clair.
J’ajouterai que si les collectivités territoriales sont invitées à passer davantage de marchés publics comportant des clauses d’insertion, l’État, qui recourt deux fois moins qu’elles à ces dernières, doit aussi consentir un effort de ce point de vue. Je sais que tel est votre souhait, monsieur le ministre.
Le troisième point, en matière de financement public, a trait à cette idée remarquable de transposer à l’économie sociale et solidaire ce qui marche bien dans l’économie classique, en créant, à l’image des sociétés d’amorçage, des SCOP d’amorçage, avec des règles souples devant faciliter l’apport de capitaux.
Il est une autre façon de favoriser ce développement, qui consiste à donner aux salariés la possibilité de reprendre leur entreprise en cas de cession.
Sur ce point, je vais vous faire part de l’avis non pas unanime, mais majoritaire, de la commission des lois.
Je trouve, pour ma part, qu’il y a trop de discussions sur la question du droit prioritaire des salariés à l’information. Pourquoi le simple fait d’accorder aux salariés une priorité d’information fait-il autant débat ? Ne dramatisons pas les choses !
Prenons l’exemple, très concret, d’un boulanger qui part à la retraite : il en informe ses salariés, qui ont deux mois pour décider ou non de reprendre l’entreprise. Pense-t-on vraiment que, pendant ce délai, les banquiers vont refuser leur aide, les fournisseurs se désengager et les clients aller voir ailleurs ?
Je rappellerai d’abord que s’applique en principe une clause de discrétion. On nous objectera sans doute qu’elle ne sera pas respectée, mais je ferai tout de même observer qu’une telle clause s’impose déjà en cas de cession d’entreprise, sans que l’on constate de débordements particuliers ou d’effets pervers en termes de divulgation de l’information donnée au comité d’entreprise. Il faut, je crois, se fonder sur cette expérience.
En la matière, nous devons faire confiance, me semble-t-il, aux règles bien connues de l’économie de marché. Ce qui déterminera l’attitude d’un repreneur, d’un banquier ou d’un fournisseur, ce sera non pas l’information préalable donnée aux salariés, mais l’état financier, économique et social de l’entreprise. Si la situation de l’entreprise est bonne, les banquiers, les fournisseurs et les clients ne lui tourneront pas le dos. Revenons donc aux règles de l’économie de marché, qui doivent permettre – paradoxalement, peut-être ! – de répondre aux inquiétudes exprimées ici ou là.
À l’inverse, doit-on aller plus loin et créer un droit préférentiel de rachat de l’entreprise par les salariés ? J’attire l’attention sur un point : comment justifier juridiquement qu’une offre de reprise puisse s’imposer au propriétaire de l’entreprise, qui se trouvera alors privé de tout choix ? Comment, d’ailleurs, mettre en œuvre un tel droit préférentiel ? Par exemple, le montant de l’offre des salariés devra-t-il être aligné sur celui de l’offre la plus élevée présentée par des repreneurs extérieurs à l’entreprise ? Si oui, nous voyons quel mauvais cadeau pourrait être fait aux salariés ; si non, nous serons confrontés à une difficile question de constitutionnalité. Nous nous heurterions alors, en effet, au droit de propriété et surtout au principe de liberté contractuelle, que le Conseil constitutionnel a invoqué dans son arrêt du 13 juin 2013.
Reste que le présent texte peut être amélioré. La commission des lois souhaiterait notamment que le délai d’information de deux mois s’applique également aux entreprises de plus de cinquante salariés.
Je tiens à saluer la partie du projet de loi relative au droit associatif. Elle apporte des précisions très utiles et offre aux associations davantage de possibilités pour acquérir, administrer et, parfois, vendre des biens et des immeubles. C’est là une perspective tout à fait intéressante. La commission des lois a approuvé l’ensemble de ces dispositions. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la semaine dernière, en Bretagne, plusieurs milliers de travailleurs sont descendus dans la rue pour crier leur colère et leur désarroi, alors que le chômage augmente et que la liste des entreprises en difficulté s’allonge : Gad, Doux, Tilly-Sabco, Marine Harvest… En 2013, 900 emplois ont déjà été supprimés dans notre région, et plus de 5 000 autres sont menacés.
Un autre gros point noir tient à la situation du site rennais de PSA Peugeot Citroën : 1 400 départs volontaires sont prévus d’ici à la fin de décembre, ce qui entraînera des effets en cascade sur les sous-traitants.
Ce désespoir, qui tourne parfois à la violence, n’est pas propre à ma région. Il touche la France entière.

Attentives aux seuls signaux du marché, les entreprises se livrent, au cœur de la crise, à la plus farouche concurrence, entraînant le coût du travail et les cours agricoles vers le bas !
La lutte emblématique des « Conti » contre la puissance financière de Continental, qui, en 2009, tirant prétexte de la crise, a rayé de la carte une usine rentable et 700 emplois, a permis de dénoncer la criminalité financière d’actionnaires invoquant la nécessité de procéder à des licenciements économiques quand la valeur de leurs actions doublait en 2012 et le chiffre d’affaires progressait de 17 %. Il faut aussi évoquer le combat des « Fralib » pour faire vivre un outil industriel de qualité, alors qu’Unilever décide de délocaliser en Pologne la production du thé « Éléphant », créé à Marseille et vendu exclusivement en France !
Telle est la réalité économique ; elle appelle un changement de cap radical dans la politique économique du Gouvernement et dans la gestion des entreprises.
C’est pourquoi, même si vous avez bien précisé, monsieur le ministre, que le champ du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire est volontairement limité aux entreprises dites saines et repose sur le pari d’une « pollinisation vertueuse » de l’économie classique, nous ne pouvons ignorer l’urgence sociale et économique que connaît notre pays.
Nous sommes convaincus que les salariés doivent être associés plus étroitement à la gestion de leur entreprise pour cerner les évolutions, connaître en amont les difficultés pouvant survenir, proposer un meilleur partage des richesses créées et des évolutions techniques dans la production, intervenir sur la stratégie globale, nationale et internationale, ainsi que sur la définition des segments d’activité de l’entreprise. Les expériences menées en ce sens ont été positives pour l’outil industriel comme pour l’emploi.
Dans ce contexte, vous comprendrez que je m’arrête dès à présent sur les articles 11, 12 et 15. Emblématiques du projet de loi, ils visent à étendre le droit d’information à l’ensemble des salariés en cas de cession de l’entreprise ou du fonds de commerce et à instaurer les SCOP d’amorçage. Ces dispositions constituent sans aucun doute des avancées très positives, mais elles nous semblent bien isolées, hélas !
Les articles 11 et 12, qui suscitent la fronde du MEDEF et l’émoi de la droite, ne vont pas assez loin pour garantir une localisation des emplois et de l’activité économique, pour protéger les titres de propriété intellectuelle, les brevets, les marques.
Je vais vous livrer un exemple qui illustre nos craintes. Dans le Nord, l’entreprise de chimie Calaire a été vendue. Au moment de l’opération, l’État a retiré 192 millions d’euros de la cession de ses parts. Les salariés ont proposé de reprendre l’entreprise en maintenant 117 emplois, mais le projet a échoué car il leur manquait 9 millions d’euros. En définitive, le groupe Axyntis va reprendre le site, mais il ne conservera que 80 salariés. De telles situations se multiplient sur nos territoires !
Demain, le présent texte, s’il est adopté, ne garantira pas que le projet des salariés soit retenu en priorité, même s’il maintient davantage d’emplois. C’est sur ce point que nous devons travailler.
Dans cette perspective, nous présenterons des amendements tendant à enrichir le dispositif proposé en matière d’accompagnement des salariés, ainsi qu’à reconnaître à ceux-ci un droit de préemption.
Vous l’avez dit, monsieur le ministre, 50 000 emplois sont perdus chaque année parce que des entreprises saines mettent la clef sous la porte, faute de repreneur. D’autres emplois sont détruits, à l’occasion des cessions d’entreprise, au nom de la rentabilité financière. Il est temps de donner aux salariés qui le souhaitent les outils leur permettant de reprendre leur entreprise et de défendre leurs emplois.
Ainsi, nous souhaitons, comme le préconisait d’ailleurs le Conseil économique, social et environnemental, instaurer un droit de reprise dans un délai raisonnable, prévoir un véritable droit de préférence au profit des salariés, renforcer le rôle des banques coopératives dans l’octroi des prêts et garanties en appui aux projets de ces derniers.
Nous reviendrons sur cette question lors de l’examen des articles 11 et 12 : à cette occasion, nous ferons la démonstration qu’aucun argument juridique – ou politique – ne justifie que l’on renonce à l’instauration d’un droit de préférence au bénéfice des salariés.
S’agissant du droit d’information stricto sensu, nous saluons les avancées qui, sur l’initiative du rapporteur, Marc Daunis, ont été entérinées par la commission des affaires économiques. L’article 11 A, qui tend à instaurer un dispositif d’information des salariés, tout au long de la vie de l’entreprise, sur les possibilités de reprise, est essentiel pour garantir l’effectivité du projet gouvernemental.
Dans cet esprit, nous présenterons des amendements visant à permettre aux salariés ayant fait part au cédant de leur volonté de présenter une offre de rachat de se faire assister par une personne qu’ils auront désignée, dans des conditions définies par décret. À leur demande, cette personne pourra se faire communiquer les documents comptables et financiers de l’entreprise dans les mêmes conditions que le comité d’entreprise, en application des articles L. 2323-8 et L. 2323-9 du code du travail.
Nous proposerons également que les salariés puissent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et d’industrie régionale, de la chambre régionale d’agriculture ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat territorialement compétentes, en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire.
Nous proposerons en outre de compléter l’article 4, qui vise à définir les missions des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, afin, comme cela se pratique dans certaines structures, que celles-ci animent un espace régional de dialogue social associant les organisations syndicales de salariés et d’employeurs.
Nous pensons que l’introduction de ces précisions conditionne fortement l’efficacité du droit d’information et l’appréciation de sa pertinence, d’autant que les autres dispositions du projet de loi suscitent des critiques, sinon des interrogations.
Nous soutenons le projet du Gouvernement de structurer l’économie sociale et solidaire à travers une loi réaffirmant ses principes fondateurs : la liberté d’adhésion, la gestion démocratique, la non-lucrativité individuelle, l’utilité collective ou l’utilité sociale du projet, la mixité des ressources.
La diversité des acteurs de l’économie sociale et solidaire est un premier obstacle qui apparaît lorsque l’on veut rassembler cette grande famille ; le respect à géométrie variable des valeurs affichées en est un autre. Mais le projet de loi va plus loin encore dans la difficulté, puisqu’il tend, par une démarche inclusive, à intégrer les sociétés commerciales dans l’économie sociale et solidaire. Si nous comprenons la dynamique guidant ce choix, nous attirons l’attention sur les dangers d’une pollinisation qui pourrait se muer en pollution du secteur de l’économie sociale et solidaire…
Pour essayer de se prémunir contre un tel risque, nous vous proposerons, mes chers collègues, de renforcer les conditions, posées à l’article 1er du projet de loi, qui encadrent la définition de l’économie sociale et solidaire.
D’une part, nous souhaitons préciser la notion de gouvernance démocratique. En effet, s’il est vrai que le principe « une personne, une voix » ne régit pas la gouvernance de tous les acteurs historiques, il n’en reste pas moins que, en l’état, le projet de loi est trop flou sur ce point. La gouvernance démocratique est naturellement incompatible avec le dogme de la primauté actionnariale, mais on peut essayer de l’infléchir en précisant que la gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoit la participation, non strictement proportionnelle à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés et parties prenantes aux réalisations de l’entreprise. Nous vous ferons une proposition en ce sens.
D’autre part, nous proposerons de renforcer le caractère limité de la lucrativité. Pour que les sociétés commerciales puissent bénéficier du label « économie sociale et solidaire », il nous semble important qu’elles jouent le jeu et, par conséquent, qu’elles changent certaines de leurs pratiques en matière de gestion de leurs bénéfices. C’est pourquoi il est nécessaire d’augmenter les réserves statutaires et d’encadrer plus fortement les bénéfices distribuables.
Par ailleurs, l’article 2 bis du projet de loi, ayant pour objet d’instaurer une déclaration de principe par laquelle les entreprises de l’économie sociale et solidaire peuvent signifier leur volonté d’atteindre des objectifs plus volontaristes, peut être considéré, par les plus sceptiques d’entre nous, comme un merveilleux exemple de « droit mou » ou de « droit souple », pour reprendre la terminologie du Conseil d’État. Les plus optimistes y verront, quant à eux, un instrument non dépourvu d’intérêt, permettant un contrôle démocratique de la politique affichée par l’entreprise. Ayant retenu cette dernière analyse, nous proposerons de mettre l’exemplarité sociale au cœur du texte et d’y inscrire l’objectif de parité entre les hommes et les femmes dans les instances décisionnelles.
Enfin, nous demandons que la liste des entreprises ayant adhéré à cette déclaration de principe soit publiée selon des modalités prévues par décret et que ces entreprises en informent leurs salariés par voie d’affichage, en portant à leur connaissance, par le même moyen, la teneur de la déclaration.
Afin que les principes vertueux imprègnent les plus hautes instances de l’économie sociale et solidaire, nous souhaitons aussi que la composition du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire soit précisée, pour garantir une représentation de l’ensemble des parties prenantes, notamment des salariés, ainsi qu’une réelle parité entre hommes et femmes.
L’article 7, tendant à définir l’agrément « entreprise solidaire d’utilité publique », nous incite à la plus grande prudence.
En effet, cet agrément ouvre actuellement droit à deux contreparties : l’accès des « entreprises solidaires » aux dispositifs de soutien fiscal dits « ISF-PME », qui ouvre droit à une réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune, et « Madelin », qui offre une réduction d’impôt sur le revenu en cas de souscription au capital de PME se consacrant à des activités technologiques ou présentant un potentiel important de croissance. Un volet « solidaire » vient donc se greffer sur ces deux dispositifs.
Le champ de cet agrément se trouve potentiellement élargi par le projet de loi, notamment au profit des sociétés commerciales qui rempliraient les conditions posées aux articles 1er et 2. C’est pourquoi il nous semble primordial, afin que de grands groupes ne bénéficient pas d’aides publiques payées par la collectivité, d’encadrer très précisément les conditions d’octroi de l’agrément, en particulier dans le cas des sociétés commerciales. En outre, les primes devraient être prises en compte dans le calcul de l’écart maximal de rémunération à respecter dans ce cadre.
Nous pensons que l’agrément accordé de plein droit ouvre une brèche dans le dispositif d’accès aux aides publiques. En ce sens, nous partageons les inquiétudes de la majorité des acteurs du secteur des entreprises solidaires d’utilité sociale, qui considèrent que cet agrément pourrait engendrer une instrumentalisation du conventionnement « insertion par l’activité économique » par des sociétés commerciales y voyant un moyen de contourner les conditions d’obtention de l’agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale. De plus, on comprend mal pourquoi le fait de mener une mission d’utilité sociale permettrait de s’affranchir du respect de principes fondateurs du secteur.
Je voudrais, pour conclure, faire quelques remarques sur les dispositions particulières concernant les acteurs historiques du secteur.
Tout d’abord, nous sommes très favorables à la révision coopérative, qui consiste à vérifier, tous les deux ou trois ans, si l’entreprise respecte toujours les conditions de son statut de coopérative, eu égard à tous les avantages et à toutes les aides que ce label offre dans le cadre de l’économie sociale et solidaire.
En revanche, concernant les mutuelles, les dispositions du projet de loi ne nous semblent pas aller dans le bon sens. Nous sommes très attachés à la forme juridique mutualiste, caractérisée notamment par une gestion à but non lucratif et solidaire, qui permet de prendre en charge des risques sociaux, alors même que les États abaissent le niveau de la protection sociale obligatoire. Le principe de démocratie, qui devrait régir la gouvernance des mutuelles, devrait également permettre d’impliquer les citoyens dans les décisions les concernant. L’article 35 du projet de loi, sous couvert d’efficacité, va à l’encontre de cette règle.
Alors qu’il faudrait sortir les mutuelles du champ de la réglementation européenne en matière d’assurances et de complémentaires santé, et limiter les obligations en termes de réserves prudentielles, dans l’attente du remboursement à 100 % par la sécurité sociale, le projet de loi tend à créer un nouvel instrument financier pour répondre aux contraintes européennes, par ailleurs dénoncées. Ce faisant, il entérine les décisions de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, qui ne reconnaît pas la spécificité du risque santé et veut imposer aux organismes proposant des complémentaires santé de constituer des réserves prudentielles largement surdimensionnées. Ces exigences, excessives et inflationnistes, conduisent à des fusions sous contraintes mettant à mal le système mutualiste.
D’autres dispositions appellent des réserves de notre part ; nous y reviendrons lors de l’examen des articles. Je pense au statut d’entrepreneur salarié associé, qui écarte dangereusement un certain nombre de travailleurs de la législation du travail, ainsi qu’aux dispositions sur les fondations et au nouveau titre fondatif. Ce dernier ne nous convainc pas, et nous proposerons de le limiter aux fondations reconnues d’utilité publique.
Le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire est largement perfectible. Nous espérons pouvoir aboutir, au terme des débats en séance publique, à un texte plus ambitieux, constituant une première étape vers la pérennisation de nos emplois et de nos savoir-faire, garantissant le renforcement des principes fondateurs de l’économie sociale et solidaire et permettant que s’impose réellement une autre forme d’appropriation des moyens de production et d’échanges.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, aujourd’hui, quelque 21 000 coopératives, plus d’un million d’associations et de mutuelles, ainsi qu’un nombre croissant d’entreprises solidaires, irriguent la vie économique et sociale de notre pays. Elles contribuent au développement de nos territoires, à la réduction des inégalités, sociales ou territoriales. L’économie sociale et solidaire représente en effet plus de 2 millions d’emplois et 10 % du PIB.
Favoriser l’essor de ce secteur par le biais d’un ensemble de mesures structurantes, conférant un cadre juridique simple et protecteur, facilitant l’accès au financement de ses acteurs, constitue donc un enjeu essentiel pour l’emploi et la croissance dans notre pays, mais aussi pour la solidarité, la justice et l’équité, entre les citoyens et entre les territoires.
C’est pourquoi nous accueillons favorablement le fait que le Gouvernement présente aujourd’hui, en première lecture au Sénat, un projet de loi ayant pour objet de permettre ce « changement d’échelle » de l’économie sociale et solidaire.
Mon collègue Stéphane Mazars détaillera tout à l’heure la position générale de mon groupe, ainsi que la logique qui sous-tend les amendements que nous avons déposés sur le projet de loi. Pour ma part, je me concentrerai sur deux articles, qui – au regard du nombre d’amendements déposés – semblent avoir retenu l’attention de plusieurs de nos collègues... Je veux parler des articles 11 et 12, qui visent à instaurer un dispositif d’information des salariés en cas de cession de leur entreprise.
Rappelons l’objectif poursuivi par ces articles : permettre de sauvegarder des emplois et maintenir l’activité économique, en particulier dans les territoires ruraux, où la transmission d’entreprises est souvent un problème très préoccupant. Dans ces territoires fragiles, souvent délaissés, il convient d’anticiper et de mieux préparer l’éventuelle cession de l’entreprise avec le concours, quand cela est possible, des salariés.
Quel est le dispositif proposé pour parvenir à un tel objectif ?
Tout d’abord, les articles 11 et 12 prévoient d’informer les salariés lorsque le dirigeant décide de céder l’entreprise. C’est bien normal, et c’est d’ailleurs ce que prévoit la directive européenne du 12 mars 2001, que la France n’a toujours pas transposée.
Ensuite, il s’agit de permettre aux salariés, parallèlement à l’information qui leur est donnée, de proposer, s’ils le souhaitent, une offre de reprise. Nous le savons tous, lorsqu’une entreprise est reprise par les salariés, elle a souvent plus de chances de perdurer que lorsqu’elle est reprise par un tiers. Je rappelle les chiffres figurant dans le rapport : 75 % des entreprises reprises par les salariés existent toujours cinq ans après la cession, contre 60 % des entreprises transmises à un tiers.
Les dispositions du titre II visent donc à faciliter la reprise par les salariés en les informant et en les associant en amont, afin, notamment, de leur laisser le temps de formuler une offre de reprise solide et crédible. Ce dispositif est d’ailleurs complété par l’article 11 A, introduit par le rapporteur, qui vise plus généralement à informer les salariés des possibilités de reprise de leur entreprise tout au long de leur vie professionnelle.
Concrètement, ces trois articles devraient conduire à davantage de reprises d’entreprises par les salariés et, donc, permettre non seulement de réduire significativement le nombre de fermetures d’entreprises en « bonne santé » – une aberration ! – dues à l’absence de repreneur, mais aussi de favoriser le maintien de l’activité et des emplois sur le long terme. Ces mesures peuvent constituer une avancée. Toutefois, il me semble qu’il reste encore beaucoup à faire pour permettre aux salariés d’être en mesure de reprendre efficacement une entreprise.
Pour résumer, l’information, c’est bien ; la formation, c’est encore mieux ! Il y a sur la question de la formation professionnelle, de l’encadrement et de la préparation des salariés à une possible reprise de leur entreprise un véritable chantier à développer. Nous souhaitons, monsieur le ministre, que vous avanciez dans cette direction.
Les membres du groupe du RDSE sont favorables au « droit d’information » instauré par le projet de loi, qui constitue à leurs yeux un progrès. Pour autant, la rédaction de ces articles a suscité chez nous de vives interrogations. Une expression, en particulier, nous semble présenter un risque non négligeable du point de vue de la sécurité juridique. Je veux parler de l’« intention de cession ». Nous avons donc cherché à proposer une nouvelle rédaction afin de sécuriser le dispositif.
Par tradition, nous avons l’habitude, sur le terrain, dans le cadre de nos mandats locaux, auxquels nous sommes attachés, de rechercher des solutions équilibrées, respectueuses des intérêts de chacune des parties. Ce texte constituera un progrès économique et social s’il est considéré comme un instrument facilitateur et non comme une contrainte par le chef d’entreprise. La France se singularise en Europe par sa difficulté à sortir de blocages idéologiques souvent stériles freinant un indispensable dialogue social constructif.
Monsieur le ministre, nous avons compris que vous étiez prêt à prendre en considération nos observations et nos propositions. De ce fait, notre groupe votera unanimement en faveur de ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite moi aussi saluer l’excellent travail de concertation mené par le rapporteur Marc Daunis et le remercier de son écoute attentive. Je souhaite également remercier l’ensemble des rapporteurs pour avis.
À ces remerciements, s’ajoutent ceux que j’adresse à M. le ministre et aux membres de son cabinet pour leur souci permanent d’accomplir un travail constructif et leur disponibilité, malgré l’ampleur de ce texte.
Permettez-moi de saluer M. Guy Hascoët, secrétaire d’État à l’économie solidaire jusqu’en 2002, qui a tenu à nous honorer de sa présence en tribune.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Cette loi, la première à définir et encadrer le secteur de l’économie sociale et solidaire, est attendue par les acteurs de terrain depuis de nombreuses années. En effet, depuis plus de trente ans, de nombreux citoyens – progressivement soutenus par les collectivités territoriales – créent des réseaux d’épargne solidaire, d’accompagnement et de soutien à des porteurs de projets d’entreprise d’économie solidaire, ce qui contribue à prolonger et à renouveler la belle tradition de l’économie sociale née au XIXe siècle au cœur des mobilisations contre la misère sociale.
N’ayons pas peur de le dire, ce texte est une très bonne loi, et le groupe écologiste souhaite lui apporter tout son soutien, particulièrement en ce mois de novembre, mois de l’économie sociale et solidaire ! Bien sûr, il n’est pas parfait, et c’est la raison pour laquelle notre groupe a déposé des amendements. Toutefois, nous avons conscience de la complexité d’allier la vision d’un idéal et la réalité du terrain, ainsi que de concilier des intérêts et des conceptions parfois divergents. Nous ne pouvons donc que nous féliciter du pragmatisme mêlé d’exigence du travail qui a été mené ici.
Lors de l’examen du projet de loi par la commission le 16 octobre dernier, nous avons pu apporter notre pierre à l’édifice sur plusieurs sujets : la gouvernance démocratique, la parité, l’affectation de la rentabilité financière des entreprises, la possibilité pour les sociétés commerciales à capital variable de racheter leurs parts sous certaines conditions et la faculté d’autosaisine du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire. Mais c’est au niveau des territoires, cet échelon si cher aux écologistes et dans lequel ils s’investissent depuis de nombreuses années, aussi bien en tant qu’acteurs économiques que militants ou élus locaux, que nous nous réjouissons d’avoir obtenu des avancées telles que l’élaboration par la région d’une stratégie régionale de l’économie sociale et solidaire intégrée au schéma régional de développement économique et d’innovation, l’organisation tous les deux ans d’une conférence régionale de l’économie sociale et solidaire ou encore le renforcement du rôle des collectivités territoriales dans les pôles territoriaux de coopération économique.
Les articles 1er et 2 répondent bien à la difficile tâche de définir le périmètre protéiforme de l’économie sociale et solidaire, ainsi que celui de l’utilité sociale, plusieurs orateurs ont insisté sur ce point. Nous sommes satisfaits de voir que le développement durable y figure à sa juste place. À ce titre, je veux souligner que, à nos yeux, l’économie sociale et solidaire ne peut pas seulement se définir par un statut juridique. L’essentiel, c’est que le périmètre regroupe tous ceux qui fournissent des produits et des services utiles, socialement et écologiquement, faisant l’effort volontaire d’internaliser en amont des coûts sociaux et environnementaux trop souvent payés en aval par notre société.
Un autre point important, qui a déjà été évoqué, concerne les critères de fonctionnement et de gouvernance démocratique.
Ainsi, si nous saluons le renforcement des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire à l’article 4, nous déplorons néanmoins l’absence de mention dans le texte des structures assimilées, telles que les agences régionales de développement de l’économie sociale et solidaire. Le groupe écologiste a donc déposé un amendement visant à réparer un tel oubli.
Concernant les marchés publics, sujet ô combien important pour l’avenir de ce secteur, nous nous réjouissons que l’article 9 mette en place un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Néanmoins, il nous semble important de mentionner que ces achats doivent également être environnementalement responsables et de fixer un objectif chiffré. Ainsi, 20 % des achats publics pourraient concerner l’économie sociale et solidaire. Le groupe écologiste défendra des amendements en ce sens.
La réintroduction de la partie concernant l’innovation sociale par M. le rapporteur à l’article 10 ter nous satisfait grandement, mais il nous paraît pertinent d’accorder aux entreprises de ce secteur le droit au crédit d’impôt recherche. Car ces dernières ont souvent l’ambition de viser aussi l’excellence technologique, loin des visions misérabilistes parfois colportées ! Notre groupe a déposé un amendement visant à ouvrir ce droit.
J’en viens à présent aux articles sensibles, souvent au cœur des débats de ces dernières semaines, à savoir les articles 11 A, 11 et 12 concernant le droit d’information des salariés.
L’article 11 A, introduit par M. le rapporteur, marque une étape supplémentaire très importante vers une véritable possibilité pour les salariés de reprendre leur entreprise ; nous nous en félicitons.
Nous approuvons également l’introduction, par les articles 11 et 12, d’un délai d’information des salariés de deux mois avant toute cession. Nous nous félicitons aussi des autres mesures relatives aux droits des salariés, déjà expliquées par les orateurs précédents. Ces dispositions, justifiées à nos yeux par les très nombreux exemples auxquels nous avons été confrontés dans nos territoires, sont très importantes si nous voulons que le droit à la reprise ne soit pas simplement formel et que des moyens concrets soient donnés pour qu’il devienne une réalité.
Néanmoins, il nous paraît nécessaire d’aller plus loin. C’est la raison pour laquelle nous apporterons tout notre soutien à notre collègue Marie-Noëlle Lienemann et que le groupe écologiste a lui aussi déposé des amendements, ne serait-ce que pour pouvoir débattre, visant à mettre en place une mesure de rachat préférentiel, à offre égale, en faveur des salariés. Rappelons-le, il s’agit d’une promesse de campagne du Président de la République ! Si j’ai bien entendu les propos de M. le rapporteur pour avis de la commission des lois, il paraît cependant urgent d’approfondir la réflexion et de regarder de près la façon dont les choses se passent, pour essayer de lever les obstacles. Il y a là, vous avez très probablement tous en tête des exemples, un gisement colossal d’emplois locaux et de redynamisation du tissu économique.
En cette période de crise, en cette heure où il devient urgent de répondre à l’aspiration démocratique exprimée par nos concitoyens, l’économie sociale et solidaire démontre qu’il est possible de faire autrement et d’avoir des entreprises économiquement viables, tout en mettant en œuvre des valeurs de solidarité et de fonctionnement démocratique. La crise économique, sociale, écologique est là, d’une ampleur terrible. Plus de 8, 6 millions de personnes vivent en France avec un revenu mensuel de moins de 964 euros, dont 4, 5 millions avec un revenu inférieur à 716 euros par mois. Parallèlement, nous avons à l’esprit la cascade de fermetures d’entreprises qui touche, en ce moment même, notre pays.
Devant de tels défis sociaux et environnementaux, il n’est pas possible de refuser l’innovation économique et sociale. Il serait irresponsable que le Gouvernement et le Parlement ne saisissent pas l’opportunité et les solutions que lui proposent les acteurs, les entreprises et les réseaux de l’économie sociale et solidaire.
L’économie sociale et solidaire, en mobilisant citoyens, épargnants et réseaux d’accompagnement dans l’entreprise, développe la vigilance démocratique et le lien social. C’est déjà un atout précieux pour notre pays. C’est aussi un secteur créateur d’un nombre considérable d’emplois, les chiffres ont été rappelés. Enfin, c’est un secteur d’avenir sur le plan économique, propre à nous aider à relocaliser l’économie, à la relever de ses difficultés dans de nombreux secteurs : services à la personne, petite enfance, création culturelle, travaux publics – je pense notamment à l’isolation énergétique –, production et distribution de produits agricoles et alimentaires sains, industrie, commerce équitable, recyclage, circuits courts en général, services aux entreprises, … La liste est longue !
Il est temps que, à côté des deux autres secteurs économiques que sont le secteur public et le secteur privé classique, la loi reconnaisse à sa juste valeur ce troisième secteur qu’est l’économie sociale et solidaire. Compte tenu de ce qu’elle apporte à la nation, des valeurs de solidarité et de démocratie qu’elle ne se contente pas de proclamer, mais qu’elle met concrètement jour après jour en action – c’est plus difficile –, elle doit être soutenue par les pouvoirs publics.
Étant donné les enjeux, l’économie sociale et solidaire doit changer de dimension, sortir des seules expérimentations ou des petites réalisations. Ce qui doit être à l’ordre du jour, c’est l’essaimage des réalisations, des savoir-faire déjà accumulés depuis des décennies. La loi doit rendre possible le développement de projets à grande échelle !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi de commencer mon intervention par une remarque : ce n’est pas chose aisée que de survivre à l’avalanche d’expressions dignes de M. de La Palice qu’il nous a été donné d’entendre. Si l’on ajoute à cela le traditionnel verbiage autour des nouvelles pratiques solidaires ou d’utilité sociale, je dirai même que cette discussion générale tourne à l’épreuve d’endurance.
Malheureusement, si je me réfère à la rédaction de l’exposé des motifs du projet de loi, cela n’a rien de très surprenant. En effet, les premières lignes ne sont pas sans rappeler ces manuels du type « l’économie expliquée aux enfants ». Plus inquiétants encore sont les postulats idéologiques qui se manifestent à chaque ligne et à chaque disposition. Je ne remets pas en cause le droit du Gouvernement à présenter un projet de loi inspiré par les thèses socialistes…

Mes chers collègues, je vous ai écoutés avec beaucoup d’attention sans vous interrompre. Je vous demande de laisser l’opposition s’exprimer !

Vous dénoncez le modèle capitalistique dit « classique », basé sur la maximisation des profits et donc sur la dimension lucrative d’une activité. Vous oubliez trop vite que l’enrichissement est un moteur puissant pour l’homme et pour les peuples, et que les Français ont le droit d’avoir une ambition individuelle, celle d’améliorer leur condition. Cela passe nécessairement par l’argent.
Aussi, pour montrer en quoi votre projet de loi relève d’une idéologie dépassée, même s’il se complaît dans des sophistications du type « nouveaux référentiels économiques », je concentrerai mon intervention sur deux de ses aspects, qu’ont soulignés tous les intervenants : d’une part, les dispositions déterminant le champ de l’économie sociale et solidaire qui serviront de base à l’obtention de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » ; d’autre part, les fameuses dispositions afférentes au droit d’information des salariés.

En ce qui concerne la détermination du champ de l’économie sociale et solidaire, le projet de loi s’adresse directement à l’économie des services à la personne. Nous admettons sans réserve que ce secteur d’activité mérite la réflexion que nous allons lui consacrer. Nous connaissons tous les chiffres : 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires, près de deux millions de salariés. Surtout, ce secteur est idéal pour lutter contre le chômage de longue durée en s’adressant aux populations les plus sensibles. En effet, nous le savons, 82 % des employés du secteur n’ont pas le bac et 40 % des salariés déclarent qu’ils n’avaient pas d’emploi auparavant.
Mieux encore, les effectifs salariés ont progressé en 2011 de 16 %. Ce secteur est effectivement un réservoir d’emplois et de croissance. La situation du secteur des services à la personne est donc la suivante : une offre en pleine croissance, mais la croissance de cette offre ne saurait couvrir totalement la croissance de la demande.
Des occasions sans précédent s’offrent à notre économie. Il convient donc de stimuler l’offre en matière de services à la personne. Malheureusement, si l’on regarde dans le détail les dispositions déterminant le champ de l’économie sociale et solidaire, j’en viens à me demander si votre cadeau, monsieur le ministre, n’est pas empoisonné. Pour rappel, ces dispositions qui permettent à une entreprise ou à une association d’intégrer l’économie sociale et solidaire sont primordiales, car elles rendent éligibles aux prêts de la Banque publique d’investissement et détermineront ultérieurement l’obtention de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », celui-là même qui rend éligible aux dispositifs de soutien fiscal dits « ISF-PME » et « Madelin ».
Si nous ne nous opposons pas, par principe, à votre dispositif de soutien fiscal rendu possible par l’obtention de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », en revanche, nous nous opposons fermement aux conditions d’obtention de cet agrément ainsi qu’aux conditions d’intégration dans l’économie sociale et solidaire.
Que dit l’article 1er sur ces conditions d’intégration ? Il dispose que les sociétés commerciales souhaitant intégrer l’économie sociale et solidaire doivent prévoir le prélèvement d’une fraction au moins égale à 15 % des bénéfices affecté à la formation d’un fonds de réserve dit « réserve statutaire », le prélèvement d’une fraction au moins égale à 50 % des bénéfices affecté au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires et, enfin, l’interdiction du rachat par la société d’actions ou de parts sociales. En plus de ces restrictions propres aux sociétés commerciales, ces dernières devront viser un but « autre que le seul partage des bénéfices », exigence vague et surtout invérifiable.
Quel est le but de ces restrictions ? Sans doute empêcher que les groupes les plus importants entrent dans le champ de l’économie sociale et solidaire et puissent bénéficier du soutien fiscal. Nous comprenons votre inquiétude, mais la rédaction de l’article 1er est comme un filet aux mailles trop étroites qui empêchera l’immense majorité des entreprises commerciales du secteur d’intégrer l’économie sociale et solidaire.
Quelles sont ces entreprises ? C’est très simple : 65 % des entreprises évoluant dans le secteur des services à la personne comptent moins de cinq salariés. Or même ces très petites entreprises seront prises dans les mailles de votre filet. Par exemple, même un auto-entrepreneur, qui n’est pourtant pas un danger pour les acteurs non commerciaux du secteur, ne pourra pas entrer dans l’économie sociale et solidaire du fait de ces exigences irréalistes. Par comparaison, les réserves légales d’une entreprise, seules réserves obligatoires par défaut pour une entreprise, s’élèvent à 5 % du bénéfice de l’exercice, diminué de l’éventuel report à nouveau débiteur. Nous sommes bien loin des exigences gouvernementales pour entrer dans l’économie sociale et solidaire.
Que dit l’article 7 sur l’obtention de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » ? Il faut pour cela que l’entreprise fasse la preuve que « la charge induite par son objectif d’utilité sociale affecte de manière significative [son] compte de résultat ou [sa] rentabilité financière ».
Cette disposition me paraît pour le moins incertaine. En effet, selon que l’on a une conception étroite ou souple de l’impact financier de ces charges, l’essentiel des sociétés commerciales du secteur pourront être soit exclues du dispositif, soit intégrées.
Aussi, l’addition des dispositions visées à l’article 1er et de celles qui sont visées à l’article 7 conduira à exclure la majorité des entreprises du secteur des services à la personne de l’économie sociale et solidaire et de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Pour remédier à cette lacune, le groupe UMP présentera des amendements qui auront pour objet d’assurer l’intégration des sociétés commerciales du secteur dans ce dispositif, auquel elles peuvent légitimement prétendre.
Pourquoi soutenons-nous cette position ? Tout simplement parce que le projet de loi, s’il venait à être adopté en l’état, créerait une distorsion de concurrence au détriment des sociétés commerciales évoluant dans le secteur des services à la personne. Celles-ci seront privées du soutien fiscal dont leurs principaux concurrents, associations ou organismes d’insertion, pourront bénéficier. Or ces petites sociétés commerciales n’ont pas les moyens d’évoluer sur le même marché que des agents économiques, sans but lucratif certes, mais qui bénéficient d’avantages fiscaux importants.
Autre point de ce projet de loi, qui soulève de vives interrogations : le droit d’information des salariés.
Les articles 11 et 12 créent un droit d’information préalable des salariés en cas de transmission d’une entreprise saine. Quelle est la finalité de ces dispositions ? L’exposé des motifs explique qu’il s’agit de « préserver la viabilité de l’entreprise et [d’]assurer la pérennité de l’activité et de l’emploi ». Vous expliquez également que ce nouvel outil doit permettre le recours aux sociétés coopératives et participatives. Cependant, il nous semble que ce dispositif est assis sur un mécanisme dont les contours sont encore très incertains. En effet, l’article 11 dispose que « la cession d’un fonds de commerce par son propriétaire ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de son intention de vendre » – des amendements ont été présentés en commission visant à relever ce délai à trois mois, six mois, un an, etc.
Vous l’aurez compris, nous sommes, dans le meilleur des cas, dubitatifs à l’endroit de cette disposition, notamment en ce qui concerne l’utilisation de l’expression « intention de vendre ». Le terme « intention » nous semble source de profondes confusions. Il n’est pas question ici d’une démarche proactive de recherche de repreneurs qui peut se manifester formellement, mais il est simplement question d’intention. Or je ne vois pas quel acte formel peut être rattaché à l’intention de vendre. Soit il s’agit d’une décision, et dans ce cas l’arsenal législatif existe déjà, soit il s’agit d’une interrogation, et dans ce cas les questionnements des propriétaires n’ont pas vocation à être publics.
Dans un souci de bien faire, le projet de loi prévoit que « les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées ». Si la précaution me semble bienvenue, je ne vois pas comment elle pourrait s’appliquer concrètement.
Autre source d’inquiétude, la baisse d’attractivité que cette disposition entraînera. Ces petites entreprises, souvent intégrées à un tissu économique complexe, seront exposées à des tentatives de déstabilisation. Mais, au-delà de ce risque direct, le droit d’information rendra la reprise de nos entreprises moins attractive pour les repreneurs étrangers, qui, dans leur grande majorité, soutiennent un vrai projet industriel.
Ensuite vient la question de l’offre de rachat que les salariés peuvent présenter une fois l’intention de vendre communiquée. Nous ne pouvons que regretter que le texte ne prévoie pas de dispositions visant à prévenir tout risque de proposition de rachat qui viserait uniquement à ralentir d’éventuelles cessions.
Aussi, nous estimons que ce droit d’information préalable des salariés en cas de transmission d’une entreprise saine est superflu, dans le meilleur des cas, voire dangereux pour la viabilité d’une activité économique en exacerbant les craintes des salariés, même si celles-ci sont justifiées.
En ce qui concerne le reste du projet de loi, nous admettons que nombre de dispositions que vous introduisez relèvent du bon sens, monsieur le ministre. Vous le voyez, certains de ses aspects peuvent être positifs ! Il y est en effet question de sécuriser juridiquement et de simplifier la vie des acteurs de l’économie sociale et solidaire, entreprises, associations, coopératives, assureurs.
Permettre aux coopératives exploitées sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée de bénéficier du statut de société par actions simplifiée, permettre la constitution d’une coopérative sous forme de SARL à capital variable entre au moins quatre associés et assouplir le régime des SCOP : nous souscrivons à la majorité de ces dispositions.
Malheureusement, les griefs que nous formulons quant à la détermination du champ de l’économie sociale et solidaire, qui servira de base à l’obtention de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » et aux dispositions afférentes au droit d’information des salariés, nous semblent insurmontables pour que nous puissions voter favorablement ce projet de loi. Plus inquiétant encore, ce texte témoigne de la défiance du Gouvernement à l’endroit du monde de l’entreprise. Une chose est certaine : on ne peut pas stimuler la croissance d’un secteur d’activité comme celle de l’économie tout entière en ignorant ostensiblement le monde de l’entreprise ou, pis encore, en faisant croire qu’il est le problème et non la solution.
Pour conclure mon intervention, j’ajoute que ce n’est pas en complexifiant les reprises d’entreprises que l’on protégera leurs employés. Nos 3, 3 millions de chômeurs attendent autre chose qu’un surplus de pesanteur législative.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la crise que traverse notre pays depuis l’automne 2008 a accéléré la reconnaissance et le développement du secteur de l’économie sociale et solidaire. Longtemps considéré comme marginal, ce secteur constitue aujourd’hui un renouveau de l’économie fondé sur des principes de solidarité et de proximité auxquels aspirent en particulier les jeunes.
En promouvant des pratiques nouvelles non seulement plus humaines et respectueuses, mais aussi soucieuses de l’environnement, l’ESS est sans aucun doute l’un des outils qui permettra aux nouvelles générations de redonner du sens à l’économie et de la vie à nos territoires, notamment les plus ruraux.
Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.

Faire « changer d’échelle » ce secteur, tel est l’objectif sur lequel vous avez insisté, monsieur le ministre. Nous le partageons. Veillons cependant à ne pas créer de nouvelles barrières ou sortir du sujet en voulant trop bien faire.
J’attaque d’emblée sur les articles 11 et 12.

Ces articles, s’ils ne constituent pas le cœur du projet de loi, sont ceux qui ont le plus retenu l’attention des commentateurs, ainsi que celle des sénateurs, si j’en juge par le nombre d’amendements déposés.
L’instauration d’un droit d’information préalable des salariés en cas de transmission d’entreprise de moins de 250 salariés a en effet provoqué des réactions négatives gâchant le nouvel élan de cette loi. Cette mesure semble a priori utile pour faciliter la transmission d’entreprise. Ses défenseurs affirment qu’elle crée une opportunité supplémentaire pour les chefs d’entreprise, qui vendent in fine à qui bon leur semble. Pourtant, loin de rassurer, l’information préalable des salariés peut contribuer à générer l’effet inverse de celui qui est recherché, en créant un climat anxiogène tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise. En effet, dans les TPE et PME, la notion de dirigeant est très importante. L’information selon laquelle ce dernier quitte la tête de son entreprise peut être, dans certains cas, un facteur de réelle déstabilisation et fragiliser l’entreprise dans ses relations non seulement avec ses partenaires commerciaux et financiers, mais également avec ses concurrents. Plus la période est longue, plus l’instabilité peut gagner parmi les salariés.
Sur le terrain, la transmission d’une entreprise est une opération délicate et la recherche d’un repreneur est souvent longue et difficile, même lorsqu’il existe des repreneurs potentiels. Cela peut prendre des mois, voire des années. La confidentialité du processus est un facteur clé du succès de la transmission. On aurait donc pu concevoir autrement cette mesure, en la ciblant davantage afin d’adresser l’information aux salariés et aux cadres responsables au lieu de la divulguer à tous les salariés.
Pour ces raisons, je pense qu’un délai incompressible de deux mois pour informer les salariés conduit à multiplier très en amont les risques de divulgation de la cession et peut, par conséquent, déstabiliser la structure concernée. Cette obligation, dans certains cas, est nuisible à la santé de l’entreprise. Il faudrait donc laisser à l’appréciation du dirigeant l’initiative de divulguer cette information et le délai qui lui semble le plus adapté. J’ai déposé des amendements en ce sens, en proposant également de préciser le point de départ de l’action en nullité afin de limiter la durée de l’ouverture des recours qui pourraient naître de ce nouveau droit.
Je ne peux m’empêcher de penser qu’un chef d’entreprise de moins de 250 salariés qui souhaite transmettre son entreprise se donnera la possibilité et les moyens d’encourager la reprise par les salariés, si celle-ci est envisageable. L’information circulera donc.

En revanche, dans des situations plus délicates, le dirigeant doit avoir le choix de protéger la bonne marche de son entreprise.
La réaction des structures patronales contre ces articles est unanime. Je ne crois pas que ce soit simplement une posture politique de la part de leurs dirigeants nationaux.

Il s’agit bien de la traduction d’une crainte réelle et légitime ressentie sur le terrain.
La situation des entreprises au moment de leur transmission varie beaucoup d’un cas à l’autre. Il me semblerait beaucoup plus utile d’associer davantage les salariés au fonctionnement des entreprises plutôt que d’imposer des règles d’information inopérantes. L’extension de l’ESS recherchée à travers ce droit d’information me semble donc inappropriée. Je crois, monsieur le ministre, que, dans votre trident, il faudrait enlever une dent.
Sourires.

En revanche, il faut se féliciter des mesures inscrites dans le texte qui permettent de remédier à des rigidités ou à des insuffisances statutaires des acteurs de l’ESS grâce à l’adaptation de certains des statuts en vigueur. Je salue, à ce titre, la création du statut transitoire de SCOP d’amorçage, qui, lui, constituera un outil précieux pour la transmission d’entreprise au sein du personnel. Vous dites, monsieur le ministre, que cette mesure est complémentaire de l’information des salariés en cas de cession. J’estime qu’elle se suffit à elle-même, et nous la soutenons. Preuve que la reprise d’une entreprise par ses salariés n’est pas un problème politique pour nous !
La création du statut de SCOP d’amorçage est une mesure positive qui permet d’apporter de la souplesse. Le statut transitoire de montée en puissance devrait convaincre les porteurs de capitaux non coopérateurs d’investir dans la société durant la période d’amorçage, et donc de maximiser ses chances de pérennisation.
Jusqu’à présent, les salariés qui voulaient fonder une SCOP devaient d’emblée détenir la majorité du capital social, ce qui est parfois compliqué ; il sera désormais possible de dissocier, durant une période transitoire, la majorité en capital de la majorité en voix, ce qui laissera aux salariés le temps de renforcer leur part au capital de la SCOP. Ce dispositif pourra ainsi prospérer, je l’espère, grâce au mouvement positif lié aux moyens qui pourront être mis à leur disposition par les établissements financiers spécialisés dans la constitution de fonds solidaires. L’association de ces deux outils sera, je le crois, très efficace.
Comme je l’ai rappelé au début de mon intervention, le secteur de l’ESS a la particularité, très précieuse à l’époque actuelle, de créer des entreprises ainsi que des emplois non délocalisables et de bénéficier d’un solide ancrage territorial. Pour organiser et promouvoir cet élan, le projet de loi reconnaît plusieurs structures sur le plan législatif, telles que les chambres régionales de l’ESS, en définissant leurs missions et prérogatives, ce qui est bien.
En revanche, les mesures relatives au fonctionnement, à la composition et aux modalités de désignation des pôles territoriaux de coopération économique et du Conseil supérieur de l’ESS ne sont aucunement détaillées. Il semble important de faire figurer dans la composition de ce dernier la notion de territoire afin que leur représentation puisse assurer une certaine diversité des points de vue.
De trop nombreuses mesures, dont les grandes lignes nécessitent d’être affinées, sont actuellement renvoyées à des décrets. On n’en compte pas moins de vingt-deux dans tout le texte, ce qui me paraît beaucoup ! En tant que législateur, le Sénat vous propose, monsieur le ministre, de retravailler certains points d’ici à la deuxième lecture. Cela serait de bon augure et nous permettrait de ne pas voter des mesures sans en connaître précisément la portée.

J’ai également examiné avec une attention particulière les dispositions relatives au droit des coopératives. En tant qu’acteurs incontournables de l’ESS, elles ont besoin d’un cadre qui puisse s’adapter aux évolutions de leur mode d’activité. C’est pourquoi j’ai souhaité déposer quelques amendements visant à ne pas alourdir les normes qui pèsent déjà sur leur fonctionnement.
Ainsi, laisser la liberté de décision aux coopérateurs quant à l’affectation des résultats de la coopérative permettrait de conserver la philosophie coopérative. Je propose également une mesure, de moindre ampleur, visant à permettre aux coopératives d’utilisation de matériel agricole, ou CUMA, de répondre aux demandes de travaux agricoles ou d’aménagement des EPCI dont au moins un tiers des communes ne dépasse pas 3 500 habitants. Or l’article 31 du texte réserve cette possibilité aux EPCI dont toutes les communes ont moins de 3 500 habitants, ce qui me semble restrictif, voire bloquant et inefficace pour les CUMA elles-mêmes et pour les territoires très ruraux visés par cette opportunité. En effet, des intercommunalités très importantes comprennent des territoires très ruraux.
Les structures de l’ESS et les entreprises classiques sont complémentaires et participent collectivement à l’essor des bassins économiques locaux, aussi convient-il également de rassurer aujourd’hui les petites entreprises en revenant sur les mesures de l’article 49. Certes, l’ESS a une vocation sociale importante ; elle permet notamment de favoriser l’insertion des travailleurs. N’oublions pas pour autant la santé de notre tissu économique !
Cet article favorisera le recours aux entreprises solidaires dans le secteur des éco-organismes et du traitement local des déchets. Voilà encore une mesure difficile pour les TPE et PME du secteur de la gestion des déchets, qui risquent par conséquent, lors des appels d’offres, d’être pris en tenaille entre, d’une part, les entreprises de l’ESS et, d’autre part, les grandes entreprises, qui, elles, auront les moyens de s’organiser en interne afin de ne pas être défavorisées sur les marchés qu’elles souhaiteront obtenir.
Nous devons exercer notre vigilance sur l'article 49 afin de ne pas encourager la tentation d’opposer l’ESS et l’économie dite « classique ». Ce n’est pas le moment, et ce serait très mal compris. Je préférerais qu’il y ait plus de ponts, plus de relations entre ces deux économies. On sait d’ailleurs que les entreprises du recyclage entretiennent des liens étroits avec les entreprises de réinsertion et qu’elles constituent un débouché naturel pour bon nombre de leurs employés.
Avant de conclure, j’aimerais saluer l’ouverture d’esprit et le travail de la commission, qui ont permis d’adopter de nombreux amendements. Je m’exprime ici en mon nom et en celui de ma collègue Valérie Létard, dont un amendement présenté en commun avec Mme Dominique Gillot a été adopté en commission. Cet amendement tendait à corriger une erreur qui s’était glissée dans la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. Il s’agit désormais de l’article 40 A, qui nous satisfait en l’état.
En conclusion, force est de constater qu’il est difficile de légiférer dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. En effet, nous ne devons pas opposer une ESS qui serait vertueuse et une autre économie, qui, au contraire, serait spéculative. Le projet de loi permettra à l’économie solidaire de conforter son rôle d’acteur économique et solidaire des territoires. Je regrette cependant que certaines dispositions du texte s’écartent des enjeux essentiels et viennent en perturber la lisibilité. J’ai aussi quelques craintes quant à leur inscription dans la réalité. C’est pourquoi le vote de ce projet de loi par mes collègues centristes et moi-même reste conditionné à son examen, qui permettra – je l’espère vivement – d’apporter au texte certains aménagements essentiels qui nous tiennent à cœur.
Monsieur le ministre, vous savez qu’en novembre tout prend racine. Je souhaite quand même bon vent à votre texte.
Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC, ainsi que sur certaines travées de l'UMP et du groupe socialiste.

Votre loi, monsieur le ministre, va faire date : elle représente une nouvelle étape et, vous l’avez dit, un changement d’échelle pour l’économie sociale et solidaire. Elle s’inscrit dans la lignée des lois de 1901 sur les associations, de 1947 sur les coopératives ou d’autres encore. Elle présente en effet l’énorme avantage d’être structurante, globale et de porter une vision d’avenir.
Le groupe socialiste attache une grande importance au fait que l’économie sociale et solidaire ne soit pas simplement considérée comme un supplément d’âme, comme une petite économie que l’on cultiverait tranquillement sous cloche. Selon nous, elle fait partie des trois grands piliers de l’économie contemporaine, de l’économie plurielle. À côté de l’économie classique des entreprises capitalistes et du service public – il existe encore –, l’économie solidaire forme ce que Jacques Delors appelait le « tiers secteur », un secteur coopératif, mutualiste, d’économie sociale. C’est pourquoi nous pensons que c’est en articulant ces trois piliers que nous pourrons développer une croissance créatrice d’emplois, répondre aux besoins de nos concitoyens et relever les défis énergétiques et écologiques.
L’économie sociale et solidaire revient souvent à la mode en temps de crise, parce qu’elle a fait la preuve de sa robustesse. À partir du moment où une partie des bénéfices sert d’abord à assurer la pérennité de l’entreprise, celle-ci résiste mieux. On la trouve donc plutôt attractive, mais, une fois que les choses vont mieux, on a tendance à considérer que, finalement, l’économie classique dite de marché doit à nouveau dominer.
Il est donc très important d’installer dans la durée, de manière forte et structurée, de nouveaux moyens juridiques et financiers pour assurer le développement de l’économie sociale et solidaire, tout en affirmant avec exigence les valeurs qui fondent sa légitimité. Deux dérives doivent cependant être évitées : d’un côté, la marginalisation, qui ferait de l’économie sociale et solidaire une économie à part, et, de l’autre, la banalisation, qui consisterait à dire que, face aux contraintes économiques sociales du marché – car on est quand même dans le secteur de la concurrence –, il faut parfois passer légèrement outre l’exigence de gouvernance démocratique ou d’autres éléments importants.
Voilà pourquoi le projet de loi doit réaffirmer l’identité et le contour de l’économie sociale et solidaire, les exigences à son égard et les forces que l’on veut valoriser en son sein. Tel est l’objet de l’article 1er.
Au sein du groupe socialiste, nous sommes très attachés à la réaffirmation de l’importance du statut de l’économie sociale et solidaire, qui ne dit pas tout mais doit être consolidé. De ce point de vue, il convient de rappeler que l’économie sociale est composée de sociétés de personnes et non de sociétés de capitaux. Je ne redirai pas à quel point ce changement structurel est essentiel.
Nous sommes également très attachés à la démocratie : « un homme, une voix », dit-on un peu rapidement. L’économie sociale et solidaire est une économie plutôt pérenne et elle partage des objectifs communs souvent fortement liés à l’intérêt général. C’est en raison de l’existence de cette dynamique que l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » est fondamental.
Monsieur le ministre, vous avez eu raison de déposer ce texte sur le bureau du Sénat pour son examen en première lecture. Le développement de l’économie sociale et solidaire est de plus en plus lié à un ancrage territorial.
À une époque où tout est mondialisé, où nos entreprises se délocalisent si facilement, où notre production industrielle est si vulnérable, il est très important de compter dans notre tissu économique des entreprises qui, parce qu’elles associent les salariés et sont liées à des initiatives locales, auront à cœur de produire dans les territoires, pour eux et en lien avec eux.

Cela ne signifie pas que la capacité de ces entreprises est restreinte ; en effet, de très grandes entreprises et coopératives françaises exportent. On peut être ancré dans son territoire, attaché à l’emploi local, au sort des travailleurs, défendre une cause et des valeurs et, dans le même temps, être leader mondial dans son secteur.
Derrière cet enjeu se pose la question de l’économie locale. Mais l’entreprise coopérative ou mutualiste n’est pas la seule qui puisse apporter ce genre de réponse : les associations ont joué un rôle majeur dans le développement local. Je pense à l’économie circulaire, que M. le rapporteur a évoquée. Qui aurait cru qu’en récupérant de vieux vêtements ou des objets usagés les chiffonniers d’Emmaüs deviendraient les pionniers d’une nouvelle vision du monde où la récupération des matières premières est essentielle ?

Cet argument vaut également pour l’accueil des enfants, l’éducation populaire, le handicap, les services à la personne. L’économie classique peut évidemment s’emparer de ces domaines, mais il est tout à fait essentiel que des secteurs restent attachés à la finalité première de leur action et non aux profits qu’ils pourront tirer de cette activité pour verser des dividendes.
Oui, l’économie sociale et solidaire est une richesse, un soutien à la croissance durable ! C’est aussi une façon de faire vivre l’idéal républicain. On parle beaucoup de crise de l’engagement, mais la plupart de ceux qui œuvrent dans ces associations s’engagent de façon bénévole, militante, civique, tout en faisant preuve d’un réel professionnalisme et en s’ingéniant à être inventifs. Cette richesse n’est pas donc seulement économique, elle est aussi humaine ; elle allie responsabilité, solidarité, performance et efficacité.
Je dois tout de même reconnaître que l’économie sociale et solidaire n’est pas le monde des Bisounours. Elle est également confrontée à des contraintes économiques et financières, ce qui nous oblige à trouver des réponses nouvelles pour y faire face. Ce monde peut aussi être confronté à l’usure du temps, aux difficultés et aux habitudes, au point d’oublier une partie de ses valeurs. De ce point de vue, tout ce qui tourne autour de la gouvernance démocratique est fondamental.
Pour ma part, et nombre de mes collègues socialistes partagent mon opinion, j’estime que la question des banques coopératives et mutualistes aurait mérité un travail spécifique. Nous avons essayé de l’entamer au moment de l’examen de la loi bancaire. Vous nous aviez alors donné rendez-vous à l’occasion du présent projet de loi. Or, aujourd’hui, nous ne retrouvons pas tout à fait nos petits.
Nous souhaitons alerter le Gouvernement sur la nécessité de garantir aux sociétaires ou aux coopérateurs, qui font la richesse de la banque mutualiste, l’accès à toutes les informations et de leur donner l’assurance de rester des acteurs déterminants dans les choix de la banque. D’autres logiques, notamment financières, ne doivent pas prendre le dessus. Je ne citerai pas les dérives qui se sont produites en ce domaine, mais chacun les a en tête. D’ailleurs, dans le monde des banques coopératives et mutualistes, cette préoccupation commence à être prise en compte par les sociétaires et les banques elles-mêmes. J’ai un petit regret à cet égard, mais nous aurons l’occasion d’en débattre.
Monsieur le ministre, vous ouvrez une piste nouvelle avec une vision que vous appelez « inclusive » : l’entrepreneuriat social. Le groupe socialiste y est favorable. Reste que les bornes ne doivent pas trop enfermées, sinon l’émergence de l’entrepreneuriat social sera impossible. Pour autant, l’élargissement ne doit pas être l’affadissement : gardons-nous, par référence à une expression anglo-saxonne, du « social washing ». C’est pourquoi nous présenterons des amendements sur le suivi et le contrôle des immatriculations, ainsi que sur le principe de « lucrativité limitée ». Un certain nombre d’éléments ont déjà été pris en compte par M. le rapporteur, mais certaines précisions s’imposent pour que nous soyons d’accord à ce sujet.
J’en viens aux dispositions concrètes les plus essentielles que nous voulons soutenir.
Je commencerai par les fameux articles 11 et 12, à savoir le droit offert aux salariés d’être informés au moment de la transmission de l’entreprise. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi ce sujet, qui me paraît...

… évident, fait l’objet de telles crispations.
D’abord, j’observe – et cela compte pour le groupe socialiste, monsieur le ministre – que les cinq organisations syndicales sont favorables à ce projet de loi. Toutes l’ont approuvé, même celles des cadres. En effet, les cadres sont des acteurs déterminants en cas de reprise. Ils ont besoin, ils le savent, d’être en possession d’éléments d’information.
Ensuite, j’entends partout, au sein du patronat comme dans les rangs de l’opposition, mettre en avant le dialogue social, de surcroît au sein de l’entreprise. Or, s’il est bien un moment où le dialogue social doit s’instaurer, c’est lors du changement de propriétaire de l’entreprise. Car ceux qui ont le plus intérêt à la survie de l’entreprise, ce sont les salariés ! Il est donc fondamental de les informer. D’ailleurs, dans le modèle allemand, qu’on nous cite toujours en exemple, toutes les entreprises – je ne parle pas des entreprises de cogestion –, en tout cas toutes celles qui comptent au moins cinq salariés, et dans ce pays la plupart des entreprises sont plutôt de grosses PME, ont l’obligation d’informer les salariés en amont de la reprise.
Honnêtement, je ne comprends pas ce blocage. Quoi qu’il en soit, monsieur le ministre, vous aurez le plein et entier soutien du groupe socialiste.
Le temps m’étant compté, je n’engagerai pas maintenant le débat sur un amendement que je porte à titre personnel concernant la reprise privilégiée par les salariés. Il répond à un engagement du Président de la République, mais M. Anziani a évoqué ce qu’il pensait être un obstacle constitutionnel. Pour ma part, j’ai déposé une proposition de loi, et je transmettrai à mon collègue les arguments contraires. Pour l’heure, je retiens l’avancée considérable que constituent, d’une part, votre texte, monsieur le ministre, et, d’autre part, l’idée de notre excellent rapporteur d’informer régulièrement les salariés afin de préparer la reprise de l’entreprise.
Un autre élément important, tout le monde l’a souligné, porte sur les nouveaux outils en faveur du monde coopératif, notamment le dispositif d’amorçage. Toutefois, nous souhaiterions disposer d’un délai un peu plus long pour en favoriser l’efficacité. Quant à la révision coopérative, nous présenterons des amendements afin d’éviter qu’elle ne devienne standardisée à cause d’acteurs prêts à vendre clés en main une pseudo-révision coopérative. Aujourd’hui, qu’il s’agisse des coopératives d’HLM, agricoles ou des SCOP, la dynamique de révision coopérative doit être diversifiée et renforcée.
Je terminerai en évoquant brièvement deux points.
Le premier concerne l’outillage territorial. Il est très important d’institutionnaliser le rôle des CRESS et des pôles territoriaux de coopération économique. Il nous faut des outils favorisant une action efficace.
Le second point a trait aux outils financiers. Ce texte n’est certes pas une loi de finances. Néanmoins, il doit créer des outils à l’instar de ceux que notre collègue Germain a cités.

À cet égard, je voudrais rappeler à nos collègues ayant tendance à dénoncer les grands avantages fiscaux que la Cour de justice des communautés européennes a toujours affirmé qu’il était légitime que l’économie sociale et solidaire puisse bénéficier d’aides fiscales et financières particulières, afin de compenser son handicap, celui de ne pas appartenir à l’économie de marché et de ne pas avoir accès aux marchés financiers.
Pour nous, l’essentiel n’est pas là. L’essentiel, c’est l’aspect humain de l’économie sociale et solidaire !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, décidément, novembre est bien le mois de l’économie sociale et solidaire, qui en est, cette année, à sa sixième édition. En effet, depuis 2008, sur l’initiative des chambres régionales, de multiples événements valorisent durant ce mois une autre manière d’entreprendre. L’examen de ce texte contribuera lui aussi, à sa façon, à sensibiliser le plus grand nombre à la création d’activités dans nos territoires.
En dépit d’un développement important depuis plusieurs années, le domaine de l’économie sociale et solidaire demeure parfois encore peu connu. Il faut dire que, jusqu’à présent, ce monde, avec ses entreprises, ses structures, ses dénominations et ses périmètres d’action très diversifiés, n’était pas simple à appréhender. Pourtant, l’économie sociale et solidaire enregistre une croissance régulière de 2 % à 3 % chaque année et, depuis dix ans, crée plus d’emplois que le secteur purement marchand. C’est aussi une alternative à la financiarisation de notre économie, car ces structures répondent à des besoins humains et sociaux plutôt qu’à des perspectives de rentabilité et de profit. L’économie sociale et solidaire joue donc un rôle d’amortisseur dans la crise en préservant des emplois et en favorisant les innovations sociales.
Le premier acte fort du Président de la République visant à encourager le développement d’une économie responsable et soucieuse de l’intérêt général fut bien d’élever au rang de ministère à part entière le domaine de l’économie sociale et solidaire. Nous saluons d’ailleurs le travail de qualité que vous avez effectué, monsieur le ministre, ainsi que le projet de loi dont nous débattons aujourd’hui. Ce travail est le fruit d’un haut niveau de concertation, cela a été rappelé, qui a permis d’aboutir à un texte équilibré, que nos talentueux rapporteurs, particulièrement Marc Daunis, ont contribué à enrichir. Vous offrez ainsi à l’ensemble des acteurs de l’économie sociale et solidaire un texte qui fera date, en ce sens que, pour la première fois, la loi consacre à ce secteur la reconnaissance qui lui manquait.
Les mesures proposées visent aussi à donner une véritable impulsion à cette économie grâce à une meilleure structuration et à l’accès à un ensemble de leviers accompagnant son déploiement.
Il s’agit d’abord de reconnaître une communauté de principes pour les entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire, en proposant une définition claire de son périmètre, en modernisant ses statuts et en suggérant de l’élargir aux sociétés qui choisissent de respecter ces mêmes principes communs en introduisant une démarche inclusive pour celles qui n’appartiennent pas à l’une des familles traditionnelles que sont les coopératives, les associations, les mutuelles et les fondations.
Je salue par ailleurs un autre axe essentiel de votre réforme consacré à la structuration, tant au niveau national par une refonte du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, qu’à l’échelon territorial par un renforcement des attributions des chambres régionales. Ces mesures permettront l’élaboration de stratégies plus cohérentes contribuant au développement de ces entreprises et à leur ancrage territorial. Dans cette perspective, les modifications apportées par le Sénat en direction des collectivités sont les bienvenues.
Le projet de loi prévoit également de nouvelles sources de financement pour soutenir le développement de ces structures, qui sont, il faut bien le souligner, moins aidées par les finances publiques que les grands groupes.
Enfin, je veux souligner l’importance de cette réforme en matière d’emploi. Celle-ci facilitera notamment la transmission d’entreprise grâce à un triptyque comportant l’extension d’un droit d’information des salariés, la création de SCOP d’amorçage permettant aux salariés souhaitant reprendre leur entreprise de limiter la prise de risque initiale et surtout, un fonds d’aide de 100 millions d’euros auprès de la Banque publique d’investissement pour investir.
Le droit d’information préalable des salariés, étendu en commission, est essentiel pour faciliter la reprise d’entreprises saines par leurs propres salariés et éviter ainsi la destruction massive d’emplois. Les contestations qui s’élèvent actuellement contre ce droit apparaissent comme un combat d’arrière-garde, mené contre un projet de loi ambitieux et qui recueille un large consensus. Même si celui-ci répond déjà parfaitement aux enjeux de reconnaissance et de développement sur le long terme de l’économie sociale et solidaire dans toutes ses dimensions, nous présenterons quelques amendements d’amélioration qui ne remettent pas en cause l’équilibre général du texte.
Aujourd’hui, nous réaffirmons que l’économie sociale et solidaire porte des valeurs auxquelles nous sommes attachés et qu’il existe différentes manières d’entreprendre qui ne s’opposent pas à celles de l’économie classique mais viennent la compléter utilement.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lorsque l’on entend parler d’économie sociale et solidaire, on pense d’abord à ces structures qui se sont développées au cours du XIXe siècle en réaction au modèle de l’entreprise capitaliste fondé sur la recherche exclusive ou quasi exclusive du profit : il s’agissait de sociétés de secours mutuel, de caisses d’épargne ou encore de coopératives. Elles avaient pour objectif de venir en aide aux catégories les plus fragiles de la population, en raison de leurs ressources, de leur âge ou de leur état de santé.
Au XXe siècle, ces structures se sont multipliées et diversifiées, au point qu’on les retrouve désormais dans presque tous les domaines de l’activité humaine : agriculture, action sociale, banque et assurance, éducation ou encore industrie. En outre, nous avons assisté ces dernières années à l’essor de l’entrepreneuriat social, qui prend la forme de sociétés traditionnelles telles que les SA ou les SARL, mais se distingue par une finalité sociale ou environnementale et par le respect de certains principes de l’économie sociale et solidaire tels que la « lucrativité limitée ».
Nous avons tous une idée de ce qu’est l’économie sociale et solidaire. Pourtant, qui peut dire précisément ce qu’elle recouvre ? Comment définir exactement son périmètre ? C’est une question déjà posée, en creux, mais non résolue, au moment de la loi du 19 février 2001 sur l’épargne salariale, qui a créé l’agrément « entreprise solidaire ».

Malgré l’existence de lois sectorielles concernant certains acteurs traditionnels de l’économie sociale et solidaire, comme celle du 10 septembre 1947 sur les coopératives, et l’introduction de la notion d’« économie sociale » dans la loi depuis 1983, il manquait encore une grande loi-cadre pour définir le périmètre de l’économie sociale et solidaire et proposer des mesures transversales pour l’ensemble de ce secteur. C’est tout l’enjeu du projet de loi que nous examinons aujourd’hui. Il s’agit d’un texte essentiel au regard de l’importance de ce secteur pour notre économie et notre société. Faut-il rappeler que l’économie sociale et solidaire représente environ 10 % du PIB et 12, 5 % des emplois privés dans notre pays ? Faut-il également rappeler qu’elle contribue activement à réduire les inégalités sociales et territoriales ?
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire ont également fait preuve d’une résilience plus élevée que les autres face à la crise et se caractérisent par une progression plus soutenue de l’emploi, comme l’a rappelé M. le rapporteur. Dès lors, il me semble que nous devons attacher la plus grande importance au développement d’un cadre juridique clair qui permettra à ce secteur de prendre un véritable essor. Tel est l’objectif poursuivi par le projet de loi, tel est votre objectif, monsieur le ministre, et je m’en réjouis.
Permettre avec cette loi le « changement d’échelle » de l’économie sociale et solidaire, comme vous le préconisez, c’est aussi un enjeu essentiel pour nos territoires, car les acteurs de l’économie sociale et solidaire, contrairement aux grandes entreprises « traditionnelles », sont majoritairement implantés en dehors de l’Île-de-France. C’est le cas, par exemple, de 75 % des entreprises coopératives.
Plus généralement, les acteurs de l’économie sociale et solidaire contribuent au renforcement du lien social et au développement de l’activité et de l’emploi sur l’ensemble du territoire. Permettre à l’économie sociale et solidaire de se développer, c’est donc également permettre de réduire l’inadmissible « fracture territoriale » que les membres du groupe du RDSE n’ont de cesse de dénoncer ; c’est là un enjeu d’égalité et de justice entre les territoires.
Je me réjouis donc que le Gouvernement ait déposé ce projet de loi, qui revêt une importance essentielle pour le développement des territoires, sur le bureau du Sénat, représentant constitutionnel des collectivités territoriales. Par ce geste fort, il reconnaît également le rôle de précurseur joué par la Haute Assemblée sur cette question de l’économie sociale et solidaire, avec le groupe d’études présidé par notre collègue rapporteur Marc Daunis ainsi que le rapport de Marie-Noëlle Lienemann sur les coopératives.
J’ajoute que le projet de loi a le mérite de donner enfin une définition de l’économie sociale et solidaire. Il est heureux que cette définition permette d’inclure une vaste catégorie d’acteurs : non seulement les organismes traditionnels de l’économie sociale et solidaire que sont les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations, mais également les sociétés commerciales dès lors qu’elles respectent un certain nombre de critères, critères que nous aimerions d’ailleurs voir davantage correspondre aux grands principes de l’économie sociale et solidaire ; j’y reviendrai.
Malgré cette définition inclusive donnée à l’article 1er et l’intitulé du titre Ier censé contenir des « dispositions communes », nous regrettons que ce texte demeure assez peu transversal, puisqu’il contient peu de mesures concernant l’ensemble des acteurs de l’économie sociale et solidaire. En fait, il se subdivise en plusieurs titres spécifiques pour chaque catégorie : coopératives, associations, mutuelles, fondations.
Une autre remarque concerne justement ces quatre « familles traditionnelles » de l’économie sociale et solidaire concernées par les titres III à VI du projet de loi : nous constatons l’existence dans le texte d’un déséquilibre au profit des coopératives et au détriment des associations. Il est vrai que les coopératives représentent la majeure partie du chiffre d’affaires et des emplois du secteur de l’économie sociale et solidaire, mais cela ne nous semble pas justifier la disproportion flagrante entre les mesures les concernant et celles qui portent sur les autres catégories, en particulier les associations. Certes, l’article 10 constitue une avancée majeure pour les associations…

… puisqu’il donne une définition de la subvention qui était jusqu’alors absente des textes de loi. Cette définition permettra de sécuriser l’octroi des subventions par les collectivités locales aux associations. Il y a bien sûr une grande attente en ce sens.
De plus, la réforme du « titre associatif », afin d’en améliorer l’attractivité pour diversifier et sécuriser le financement des associations, est également bienvenue. Nous proposerons toutefois, par un amendement, de mieux encadrer encore cette évolution pour éviter toute dérive.
Même si nous regrettons que le titre V relatif aux associations soit moins développé que le titre III relatif aux coopératives, nous soutenons les avancées du titre III, qui comprend des dispositions importantes comme la création du statut de SCOP d’amorçage.
Le groupe du RDSE est donc favorable à ce texte, qui constitue une loi nécessaire et attendue pour permettre le développement de l’économie sociale et solidaire dans notre pays. Néanmoins, notre groupe défendra un certain nombre d’amendements visant à améliorer quelques points. Nos préoccupations sont de deux ordres.
Premièrement, nous souhaitons être assurés que les principes fondateurs de l’économie sociale et solidaire seront bien respectés par l’ensemble des acteurs qui auront vocation à appartenir à ce secteur économique. Ainsi, il nous semble essentiel de rappeler l’importance de la gouvernance démocratique, de la propriété collective et de la lucrativité nulle ou limitée, qui constituent à nos yeux les caractéristiques consubstantielles de l’économie sociale et solidaire.
Deuxièmement, notre préoccupation est de sécuriser le dispositif et de lever certains doutes qui peuvent résulter d’imprécisions présentes dans le texte actuel.
Le président de notre groupe, Jacques Mézard, a abordé tout à l’heure la notion d’« intention de cession » présente dans les articles 11 et 12, qui nous semble beaucoup trop imprécise et vecteur d’une grande insécurité juridique. Nous proposerons donc de revoir le dispositif avec pour objectif de trouver une rédaction de ces articles plus précise et plus sûre. Nous ne doutons pas, monsieur le ministre, que vous serez attentif à nos propositions. D’autres amendements poursuivent le même objectif de précision et de clarification dans d’autres dispositions du projet de loi.
Enfin, une dernière série d’amendements propose de compléter le projet de loi par des dispositions essentielles, comme la création d’un régime des groupes et des filiales de l’économie sociale et solidaire ou encore des mesures relatives au commerce équitable.
Conscient des avancées que représente le projet de loi non seulement pour l’économie sociale et solidaire, mais aussi pour l’économie et l’emploi en général, le groupe du RDSE, tout en espérant que ses propositions d’amendements pour sécuriser et enrichir le texte trouveront une issue favorable, devrait lui apporter son soutien unanime. Je tiens à souligner que la position de notre groupe, conforme à la tradition radicale, s’inscrit dans le sillage de la réflexion menée par notre chef de file en la matière, Thierry Jeantet, présent aujourd’hui dans les tribunes, et dont je tiens à saluer la compétence et l’expérience. Il a apporté une aide très précieuse à notre groupe lors du travail sur le présent texte.
Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste et du groupe CRC. – M. François Trucy applaudit également.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire dont nous discutons est le troisième texte économique majeur que présente le Gouvernement depuis le début de la session extraordinaire de septembre 2013, c’est-à-dire en quelques semaines seulement.
Comme le projet de loi relatif à la consommation ou le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, le présent texte aborde une pluralité de sujets, si bien que le spectre qu’il couvre laisse parfois perplexe. Je suis ainsi peu convaincue par la cohabitation, au sein d’un même texte, des dispositions relatives à la détermination du champ de l’économie sociale et solidaire avec celles portant sur le droit d’information préalable des salariés.

Ces deux sujets sont suffisamment vastes pour mériter d’être examinés de façon distincte.
Sur le fond, comme mon collègue Gérard César, je m’arrêterai sur la détermination du champ de l’économie sociale et solidaire qui figure à l’article 1er, sur l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » prévu par l’article 7, ainsi que sur les articles 11 et 12 concernant le droit d’information des salariés.
Monsieur le ministre, ma principale préoccupation porte sur la place réservée aux sociétés commerciales dans votre nomenclature. Naturellement, vous faites entrer dans celle-ci de nombreux acteurs non commerciaux, qui y ont toute leur place compte tenu de la part qu’ils occupent dans le secteur de l’économie sociale et solidaire et de leur expérience, mais qu’en est-il des entreprises ?
Eh bien, que ce soit avec l’article 1er, qui prévoit le prélèvement d’une fraction au moins égale à 50 % du bénéfice de l’exercice, ou avec l’article 7, qui prévoit que la charge induite par son objectif d’utilité sociale affecte de manière significative le compte de résultat ou la rentabilité financière de l’entreprise, il semble bien que la majorité des entreprises ne pourront pas prétendre à intégrer l’économie sociale et solidaire ni même à bénéficier de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».
Je crois que cela vous a été dit pendant l’élaboration du projet de loi : vous consacrez une définition de l’économie sociale et solidaire beaucoup plus stricte que celle souhaitée par de nombreux acteurs. Par comparaison, si l’on reprend la définition de l’entrepreneuriat social présentée à la fin de 2011 par la Commission européenne lors de l’initiative pour l’entrepreneuriat social, on voit bien que la définition du caractère social d’une entreprise, au niveau européen, n’exclut pas d’emblée l’essentiel des entreprises des secteurs de l’aide à la personne ou en lien avec l’environnement. Pourtant, la définition de la Commission n’est pas si éloignée de la vôtre, puisqu’elle prévoit que ces entreprises ont pour « principal objectif […] d’avoir une incidence sociale plutôt que de générer du profit pour ses propriétaires ou ses partenaires ». Simplement, la Commission n’envisage pas de prélèvement sur les bénéfices ou de réserves obligatoires aussi imposantes que celles prévus par le texte qui est aujourd’hui soumis à notre examen.
Toujours dans le but de montrer la singularité de la définition française de l’économie sociale et solidaire, je note que l’OCDE plaide en faveur d’un dépassement de l’opposition classique entre profit et utilité sociale. Cette volonté de ne pas opposer dimension sociale et rentabilité se retrouve également dans la définition de l’entrepreneuriat social proposée par le Centre d’analyse stratégique, qui explique que « les entrepreneurs sociaux cherchent à conjuguer efficacité économique et finalité sociale ».
Ces précisions, ces définitions doivent retenir notre attention, car c’est d’elles dont va dépendre l’essor de ces secteurs d’activité socialement utiles. À cet égard, mon inquiétude porte sur les entreprises évoluant dans le secteur des services à la personne. Chacun sait que ce secteur est un important vivier d’emplois, sous-exploité en France. Or il est l’objet d’un paradoxe qui doit tous nous interpeller : tandis que la demande de services ne fait que croître, nous assistons dans le même temps à une diminution de l’offre. Pour preuve, nous constatons une baisse du volume d’heures déclarées, avec un passage certain vers le travail dissimulé. Ce fait montre que, contrairement aux craintes exprimées par certains, il n’y a pas de lien de causalité entre la progression du privé et la baisse d’activité des associations, puisque ces deux types d’acteurs peuvent voir leur activité ou diminuer ou progresser dans le même temps.
Il ne faut pas que le projet de loi laisse croire que l’essor des sociétés commerciales nuira au développement du secteur associatif. Intégrer les entreprises au dispositif, ce n’est pas le dénaturer. C’est au contraire lui permettre d’acquérir une autre dimension.
Que vous aidiez le monde associatif sans fixer de conditions, à la rigueur… Mais pourquoi empêcher les entreprises, le plus souvent très petites et donc plutôt précarisées, d’apporter leur pierre à votre édifice ?
Monsieur le ministre, vous partez du postulat que le droit d’information préalable des salariés en cas de transmission d’une entreprise saine permettra de prévenir les démontages d’usines et autres dépeçages d’entreprises. Si la cause est louable, cette disposition me paraît à la fois risquée et pour le moins injuste.
Premièrement, cette mesure est risquée, car, malgré les précautions que vous introduisez quant au devoir de confidentialité, il ne s’agit que de précautions, et elles ne tiendront pas.

La cession sera mise sur la place publique, des négociations qui nécessitent de la discrétion et du calme se feront sous le regard amusé de la concurrence et sous les yeux inquiets des salariés.

Songez notamment à la sécurité des entreprises françaises évoluant dans des secteurs stratégiques où la confidentialité est un impératif !
Deuxièmement, cette mesure est injuste, car elle restreint le droit de propriété. Certes, elle n’est pas applicable aux cessions familiales, mais le présent texte confère une situation préférentielle aux salariés, qui pourront constituer une SCOP.
Si on peut suivre le cheminement qui vous a conduit à élaborer cette disposition, on ne peut pas rester silencieux face à l’atteinte qui sera portée à la liberté du propriétaire d’attendre l’offre la plus satisfaisante.
J’ajoute que ces dispositions relatives à l’information des salariés témoignent d’une méconnaissance du monde de l’entreprise : comment pouvez-vous croire que, dans les petites entreprises, où tout le monde se connaît, se parle et travaille ensemble, une éventuelle cession puisse être cachée aux salariés ?
Ainsi, le Gouvernement veut, une fois de plus, légiférer pour répondre à des situations extrêmes, peu significatives de la réalité courante de la vie économique. Et pour ces quelques cas particuliers, les entrepreneurs se verront confisquer le droit de décider de leurs successeurs ! Dans ces conditions, monsieur le ministre, si vous n’acceptez pas d’assouplir ces éléments du texte, vous comprendrez que nous aurons bien du mal à le voter.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans la lutte contre le chômage, pour la création et la préservation des emplois, nous avons le devoir de ne négliger aucune piste et de ne laisser de côté aucun acteur économique sous prétexte d’idéologie. À cet égard, le présent texte a un immense mérite : il réaffirme que l’économie sociale et solidaire n’est pas une économie marginale et qu’en cela toute politique en faveur de l’emploi doit s’appuyer pleinement sur ses structures, ses salariés et ses réseaux.
Il était temps que cette réforme intervienne. Il était temps que tous les acteurs de l’économie sociale et solidaire soient pleinement reconnus et mobilisés. Je sais que c’est le souci du Gouvernement. Il s’agit là d’un enjeu absolument nécessaire pour gagner la bataille de l’emploi.
Monsieur le ministre, vous partez du principe qu’il ne faut négliger aucune piste. Tel est bien le sens du droit d’information des salariés, dont la formulation a été modifiée par la commission. Je salue d’ailleurs l’intense travail accompli par notre rapporteur, Marc Daunis.

Cette rédaction me semble non seulement la plus juste mais aussi la plus efficace.
La reprise et la transmission d’entreprises sont un problème chronique et dévastateur, qui coûte, chaque année, 50 000 emplois à la France.

Ce dysfonctionnement mine notre économie, notre compétitivité et l’équilibre économique de nos territoires.
J’entends ici ou là que le droit à l’information menacerait le secret des affaires. Mais jamais les droits des salariés n’ont porté atteinte à l’efficacité économique !

À trop vouloir préserver les secrets, on risque de ne pas préserver les affaires. À ce titre, le projet de loi propose une véritable innovation. Or toute innovation passe par trois stades, pour citer Schopenhauer : tout d’abord elle paraît ridicule, ensuite elle est violemment combattue et, enfin, on considère qu’elle a toujours été évidente. Dès lors, on se dit même : pourquoi ne pas l’avoir mise en œuvre plus tôt ?
Je le répète, le droit à l’information des salariés est une bonne chose. Il permettra de sauver de nombreuses entreprises au sein de nos territoires.
Parallèlement, ne négligeons pas les différents acteurs de ce domaine. Il faut le dire, dans cette maison des collectivités qu’est le Sénat, les régions sont les acteurs historiques et efficaces de l’économie sociale et solidaire.
Mes chers collègues, jugez-en. En Franche-Comté, la région de Proudhon, qui est un enfant de Besançon, l’économie sociale et solidaire représente 45 548 emplois, 11 % de l’emploi régional salarié, 15 % de l’emploi général privé, 660 coopératives, 3 801 structures et associations. La région de Franche-Comté consacre 5, 3 millions d’euros à ces dossiers de qualité et dispose d’un savoir-faire appréciable en la matière.
L’économie sociale et solidaire, c’est aussi l’innovation. Dans le cadre des pôles de compétitivité, les régions, comme l’ensemble des collectivités territoriales, veulent faire en sorte que l’innovation sociale soit placée au même niveau que l’innovation technologique, …

… via l’organisation d’écosystèmes favorables au recensement des besoins, au montage des projets et à leur finalisation. C’est à cette fin que j’ai déposé, aux articles 4 et 5, des amendements qui tendent à associer plus étroitement les exécutifs régionaux à la définition des projets dans ce domaine.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, je sais que vous êtes à l’écoute sur ces dossiers. Je sais également que nous ne serons pas de trop pour les défendre. S’il est indispensable d’aider les petits organismes de l’insertion par le vecteur économique, il faut également veiller à ne pas handicaper, sérieusement ou douloureusement, les plus grandes structures. Là encore, nous ne serons pas de trop !
Une croissance durable et riche en emplois passe par un développement inédit de l’économie sociale et solidaire. Monsieur le ministre, votre loi y contribuera !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste – M. Jean-Claude Requier applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire que le Gouvernement nous présente aujourd’hui opère d’importantes avancées économiques, sociales, démocratiques et citoyennes.
À ce jour, l’économie sociale et solidaire n’est pas légalement définie. Elle se définit elle-même par son histoire, ses acteurs et ses expérimentations. Reste que, pour se développer, elle a besoin d’un cadre législatif clair et ambitieux.
L’économie sociale et solidaire, c’est avant tout l’histoire de l’organisation collective des individus au service de projets de société permettant d’échapper au modèle dominant. À cet égard, je pourrais faire appel à la notion de « socialisme utopique »…

… ou évoquer la « république coopérative » théorisée par Charles Gide, qui fait appel au développement des coopératives de consommation, l’objectif étant de permettre la solidarité et l’émancipation des individus au travers de leur investissement dans un acte désintéressé.
Aujourd’hui, l’économie sociale et solidaire se revendique de cet héritage et s’inscrit dans cette lignée. Elle englobe le champ des associations, des coopératives, des mutuelles et des fondations. Elle se caractérise également par ses valeurs, la transformation sociale permettant l’organisation collective désintéressée, notamment à travers la participation démocratique des individus, selon le principe « un homme ou une femme, une voix ».
Monsieur le ministre, ce sont ces valeurs qui sont reprises dans le texte que vous nous présentez.
Depuis l’époque de l’industrialisation, nous avons peu à peu assisté à la séparation des sphères économique et politique, et ce au point d’entendre parler du « pouvoir de la finance » au même titre que du « pouvoir politique ». Qui plus est, nous sommes aujourd’hui face à une crise globale, une crise de système conduisant chacun à imaginer quelle solution nouvelle peut être mise en œuvre par l’action politique.
Par son esprit, le présent texte est un moyen de permettre à nos concitoyens de se réapproprier le pacte social républicain.
C’est dans ce contexte que l’économie sociale et solidaire prend, à mes yeux, toute son importance. En effet, celle-ci permet à chaque individu de s’approprier les enjeux économiques de manière collective, ce qui suscite la participation des individus au développement des territoires, avec des emplois non délocalisables.
Je salue, dans le présent texte, les avancées facilitant cette organisation collective. Je songe notamment au droit d’information pour les salariés en cas de cession de leur entreprise – nous y reviendrons –, à la création des SCOP d’amorçage – sujet important ! –, à la reconnaissance juridique des pôles territoriaux de coopération économique – enjeu tout aussi important ! – ou encore à celle des coopératives d’activité et d’emploi.
Avant de conclure, j’évoquerai l’un des aspects fondamentaux de ce projet de loi : la diffusion des valeurs et des modes de fonctionnement de l’économie sociale et solidaire au sein de l’économie classique. En effet, au vu du contexte économique, social et politique actuel, nous nous devons de proposer une autre voie. Cette dernière peut, en partie, figurer dans l’inclusion des principes de l’économie sociale et solidaire au sein de l’économie classique. À mon sens, il s’agit là d’un point fondamental : grâce à la philosophie qui a guidé l’élaboration de ce texte, nous pouvons penser que l’économie sociale et solidaire est susceptible d’ouvrir de nouveaux horizons.
Ce projet de loi, qui sera certainement amendé à la marge avec l’assentiment du Gouvernement, est un texte ambitieux auquel j’adhère bien sûr pleinement, comme tous mes camarades du groupe socialiste.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cinq ans après son commencement, la crise systémique de 2008 continue d’imprimer sa marque sur notre pays comme sur le reste du monde. Les soubassements d’une économie excessivement financiarisée et déconnectée de l’économie réelle se sont fissurés et parfois effondrés. Les gouvernements se sont pliés à la nécessité de mettre en œuvre, dans l’urgence, des réponses hâtives qu’il a parfois fallu corriger par d’autres politiques. Ces dernières commencent à porter leurs fruits : si la situation reste bien entendu fragile, nous en sommes arrivés au moment décisif de la reconstruction.
Dans ce contexte, le présent projet de loi acte, avec lucidité, la nécessité de promouvoir une économie plus humaine. C’est une étape importante, et je tiens à saluer le travail des différents rapporteurs. Je songe en particulier à M. Marc Daunis, …

… qui a permis, avec pragmatisme, de renforcer ce texte dans le souci d’une efficacité encore plus grande.
L’économie sociale et solidaire traduit une belle ambition, fondée sur une approche différente des rapports de force sociaux. De plus, comme M. le ministre l’a souligné, l’économie sociale et solidaire crée ou consolide souvent des emplois qui ne sont pas délocalisables et qui, à ce titre, renforcent les territoires et le tissu socioéconomique du pays tout entier.
Pour ma part, j’insisterai particulièrement sur un aspect important du texte, que nombre d’orateurs ont déjà évoqué, à savoir la transmission d’entreprises. Les dispositions spécifiques en la matière ont pour but de lutter contre l’hémorragie d’emplois occasionnée par le fait que, chaque année, des milliers d’entreprises viables et solides ne trouvent pas de repreneur. Nous en connaissons la conséquence : la perte de 50 000 emplois par an et la fragilisation, voire la dévitalisation de bassins de vie.

En conséquence, l’une des mesures phares du projet de loi vise à faciliter la transmission des TPE et PME à leurs salariés, avec une obligation préalable d’information, deux mois avant tout projet de cession. Cette disposition permettra que soit formulée, dans de bonnes conditions, une offre éventuelle de rachat par les salariés.
Un important travail coopératif a été accompli entre le Gouvernement et le Sénat, afin de garantir la plus grande sécurité juridique dans ce domaine. Ce dispositif bénéficiera aussi bien aux chefs d’entreprise qu’aux salariés. Une obligation de discrétion – nous pourrions même dire de confidentialité – est définie. Par ailleurs, le chef d’entreprise conservera la liberté de choisir son ou ses successeurs.
Dans un contexte dont nous connaissons tous l’âpre difficulté, nous avons, par ce dispositif, les moyens de mettre en place un outil encore inédit dans notre pays. Ce système devrait nous permettre de conforter les emplois et les activités de centaines de PME, et tout particulièrement des TPE lorsqu’elles sont en mal de successeur.
Dans ces conditions, et en tenant compte des garde-fous que je viens d’évoquer, comment expliquer l’attitude résolument hostile à cette perspective du MEDEF, si ce n’est par un positionnement irrationnel, conforme à l’inadmissible carton jaune que cette organisation a adressé au Gouvernement à l’occasion du projet de budget pour 2014 ?
Après tous les efforts faits en direction des entreprises, notamment les 20 milliards d’euros accordés par le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, on croit rêver ! Cracher ainsi dans la soupe, après avoir exigé qu’elle fût chaude et bien servie, est un comportement inadmissible, qui, lui, mérite un carton rouge !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

M. Yannick Vaugrenard. Aujourd’hui, tout ce qui peut être fait pour maintenir l’emploi et l’activité sur nos territoires doit l’être. C’est une obligation qui s’impose à nous, par-delà les clivages politiques et idéologiques. C’est pourquoi, monsieur le ministre, nous soutenons pleinement cette mesure ambitieuse et, plus globalement, la mise en œuvre de la politique en faveur de l’économie sociale et solidaire, dont vous êtes le promoteur. Tenez bon ! Le temps est à l’initiative et au courage, et vous n’en manquez pas. Sachez que vous pouvez compter sur nous.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lorsque l’on évoque l’économie aujourd’hui, on pense généralement au profit, à la mondialisation, aux licenciements, aux délocalisations. L’économie a mauvaise presse, parce qu’elle est systématiquement associée à la spéculation ou à l’individualisme narcissique. Si cette perception peut, certes, paraître caricaturale, elle habite néanmoins l’imaginaire collectif, comme l’actualité le démontre chaque jour. On ne peut ni blâmer cette tendance ni l’empêcher.
La crise actuelle du système capitaliste dans notre pays et, plus globalement, dans le monde a eu des répercussions catastrophiques sur l’ensemble de l’économie, y compris en Martinique. C’est pourquoi nous ne pouvons nous contenter d’une économie axée sur le court terme ou sur la satisfaction de quelques-uns ; nous devons plutôt nous orienter vers une économie morale. Néanmoins, nous ne saurions céder au manichéisme, car il existe des côtés positifs à l’économie, peut-être trop souvent passés sous silence par les adversaires du « tout-économique » : la créativité, le sens de l’initiative individuelle, le dynamisme.
L’économie sociale et solidaire a le mérite d’introduire des considérations humaines, sans pour autant nier la légitimité de l’entreprise privée et de l’initiative individuelle : le profit n’est pas oublié, il ne constitue simplement plus la seule finalité. La mise en place, en mai 2012, d’un ministère délégué à l’économie sociale et solidaire, porteur de ce projet de loi, démontre que le Gouvernement a bien compris cela.
Le texte que nous examinons aujourd’hui pose pour la première fois une définition du périmètre de l’économie sociale et solidaire, et il permettra d’intégrer, en plus des acteurs historiques, les SA, SARL ou SAS qui le souhaiteront, à condition que soient respectés les critères et les principes définis par la présente loi.
Les acteurs de l’économie sociale et solidaire bénéficieront, de plus, d’un accès facilité aux dispositifs de soutien à leur activité, non seulement sur le plan fiscal mais aussi en termes de possibilités de financement, à travers les 500 millions d’euros alloués à la Banque publique d’investissement.
Je connais, pour m’y être très sérieusement intéressé, la vitalité des secteurs de l’économie sociale et solidaire, notamment en Martinique. Je sais qu’alors que les chiffres du chômage s’aggravent partout, en France comme en outre-mer, notamment pour les jeunes, l’économie sociale et solidaire, au contraire, se développe et offre un gage d’avenir. Ainsi, en Martinique, ce secteur rassemble plus de 12 000 emplois, représentant 11 % de l’ensemble des emplois du département au sein d’environ 942 établissements employeurs.
Force est de constater que l’économie sociale et solidaire connaît une croissance soutenue, supérieure à celle des entreprises traditionnelles comme du secteur public. C’est pourquoi toutes les initiatives économiques, de métropole et d’outre-mer, ont besoin, plus que jamais, d’être accompagnées pour faire face à la crise. L’économie sociale et solidaire ne constitue en effet pas, à elle seule, une alternative crédible à l’économie traditionnelle, mais elle offre un complément indispensable, loin d’être incompatible avec l’existence d’une économie prospère plus centrée sur le profit.
En France, à la fin de 2011, les acteurs de l’économie sociale et solidaire rassemblaient 217 000 établissements employant 1, 9 million de salariés et comptant pour 10 % du PIB. Ce secteur joue donc, et jouera, un rôle non négligeable dans notre économie, en continuant à recruter dans les années à venir. Les prévisions évaluent à plus de 600 000 les postes à pourvoir d’ici à 2020. Le temps est donc venu de soumettre l’économie à l’exigence démocratique et à celle de l’intérêt général, en favorisant ce secteur, porteur de cette volonté.
L’économie évoque souvent l’austérité ou la précarité, elle peut toutefois devenir à nouveau synonyme de prospérité et d’épanouissement. Il ne s’agit pas de nier sa légitimité, mais de l’orienter vers des finalités plus hautes, plus nobles, dirais-je, à savoir le service de la personne humaine.
Je souhaite encourager l’économie sociale et solidaire, car il faut mettre l’homme au centre de tout. Nous ne pourrons plus, dès lors, désespérer de l’économie, tout simplement parce que nous ne devons jamais désespérer de l’homme. Ainsi que le disait si bien Aimé Césaire : « Gardez-vous de vous croiser les bras en l’attitude stérile du spectateur, car la vie n’est pas un spectacle, car une mer de douleurs n’est pas un proscenium, car un homme qui crie n’est pas un ours qui danse... »
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Mesdames, messieurs les sénateurs, avant de vous répondre – je ne serai d’ailleurs pas très long, car vous avez tous dit, avec des mots différents, votre attachement à l’économie sociale et solidaire, ce dont je vous remercie –, je tiens à saluer l’intervention de M. Antiste et sa citation très appropriée d’Aimé Césaire.
Le projet de loi, monsieur César, n’est pas un manuel pour expliquer l’économie aux enfants. Notre approche de l’économie sociale et solidaire est au contraire très sérieuse puisque nous souhaitons aider ce secteur à changer d’échelle.
Je veux dire quelques mots du droit d’information, ne serait-ce que pour ramener cette disposition à la juste place qu’elle occupe dans le texte. Certes, il s’agit d’une disposition importante, dans la mesure où elle concernera des millions de salariés, mais les articles 11 et 12 ne doivent pas masquer ce qui fait la force du texte : répondre enfin aux demandes des acteurs de l’économie sociale et solidaire, qui étaient ignorées ou peu entendues jusqu’à présent, à savoir reconnaître ce secteur, le définir et proposer des outils pour l’aider à se développer.
J’insiste sur ce point, car il ne faut pas aborder le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire en oubliant les dispositions que nous avons prises en matière de fiscalité, notamment avec l’abattement sur la taxe sur les salaires, et en matière de financement, je pense à la mobilisation de Bpifrance en faveur de l’économie sociale et solidaire à hauteur de 500 millions d’euros qui s’ajoute à la création du fonds pour l’innovation sociale. Toutes ces politiques concourent aujourd’hui à mettre en œuvre le changement d’échelle.
Je reviens rapidement sur la question de la transmission. Je le dis avec beaucoup de force : il y a une forme d’archaïsme à considérer que les salariés ne peuvent pas être les alliés des chefs d’entreprise. Les salariés ne sont pas un obstacle au maintien de leurs propres emplois, au contraire. Il est légitime que celui qui souhaite céder son entreprise, car c’est sa propriété, réalise une plus-value. Mais, je le répète, nous considérons les salariés comme des alliés dans ce processus. C’est pourquoi nous leur conférons à tous un droit utile, important et nouveau.
Sachez que je suis ouvert à toute amélioration du texte. Je suis donc tout entier disposé à écouter vos arguments. Cependant, sachez également que je défends une option politique : développer l’économie sociale et solidaire, M. Vaugrenard vient de l’évoquer, comme l’un des moyens de sortir de la crise économique et financière que nous venons de vivre et de construire une stratégie de croissance pour la France.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles du texte de la commission.
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier
Principes et champ de l’économie sociale et solidaire
I. – L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
2° Une gouvernance démocratique ou participative prévoyant la participation des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise définie et organisée par les statuts ;
3° Une gestion conforme aux principes suivants :
a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ;
b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. En cas de liquidation ou le cas échéant en cas de dissolution, l’ensemble de l’actif net est dévolu soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens du présent article, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la personne morale de droit privé faisant l’objet de la liquidation ou de la dissolution.
II. – L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production de biens ou de services mises en œuvre :
1° Par les personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes :
a) Elles respectent les conditions fixées au I et poursuivent un objectif d’utilité sociale, telle que définie à l’article 2 ;
b) Elles prévoient :
– le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 15 % des bénéfices de l’exercice diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, affecté à la formation d’un fonds de réserve dit « réserve statutaire » ;
– le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, affecté au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires ;
– l’interdiction du rachat par la société d’actions ou de parts sociales, sauf lorsque ce rachat intervient dans des situations ou selon des conditions prévues par décret.
III. – §(Non modifié) Peuvent faire publiquement état de leur qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire et bénéficier des droits qui s’y attachent les personnes morales de droit privé qui :
1° Répondent aux conditions mentionnées au présent article ;
2° Pour les entreprises mentionnées au 2° du II, se sont valablement immatriculées auprès de l’autorité compétente en tant qu’entreprises de l’économie sociale et solidaire.
IV. – §(Non modifié) Un décret précise les conditions d’application du présent article, et notamment les règles applicables aux statuts des sociétés mentionnées au 2° du II.

Je souscris bien sûr à l’ensemble des propos tenus par mes collègues sur les bienfaits de l’économie sociale et solidaire. Reste que, à mes yeux, ce projet de loi pose un problème d’équité.
Monsieur le ministre, vous avez déclaré vouloir éviter que des entreprises d’insertion sous statut commercial, qui seraient trop souvent des filiales de grands groupes, puissent bénéficier de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », ou ESUS, dans l’objectif de sécuriser l’utilisation des fonds de la finance solidaire.
Je comprends cette intention, elle est louable. Elle conduit cependant, en raison de trois contre-exemples, à légiférer pour l’ensemble des 1 260 entreprises d’insertion du territoire et de leurs 65 000 salariés à travers le prisme de quelques exceptions, représentant au maximum 2, 5 % des entreprises. Nous remarquerons que cette proportion marginale met fin au doute sur l’éventuelle aubaine que représenterait ce modèle d’entreprise pour de grands groupes guettant çà et là des opportunités.
À l’article 1er, vous avez choisi de définir le périmètre de l’économie sociale et solidaire sur des critères propres aux acteurs statutaires, dits historiques, de l’économie sociale et solidaire que sont les coopératives, les mutuelles, les fondations et les associations, sans considération pour la spécificité et le poids historique, sinon numéraire, de l’insertion par l’activité économique, ou IAE. Les acteurs de l’insertion, qui, depuis trente ans, salarient et accompagnent vers l’emploi des personnes qui en sont éloignées, nourrissent le sentiment que leur appartenance engagée à l’économie sociale et solidaire et la spécificité de leur modèle n’ont pas été prises en compte dans le projet de loi.
Les amendements que je vous propose visent à pallier cet oubli en soumettant les acteurs de l’IAE conventionnés par l’État pour leur mission d’insertion aux mêmes conditions que les autres acteurs historiques que sont les coopératives, les mutuelles, les fondations ou les associations. En effet, les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, les ETTI, dont plusieurs centaines en France sont constituées sous forme de sociétés commerciales, seraient exclues de l’agrément ESUS non parce qu’elles font mal leur travail, ou parce que leur activité ne répond pas à la définition de la solidarité, mais parce qu’elles n’ont pas la bonne couleur juridique. Cela fait pourtant vingt-cinq ans que les entreprises d’insertion sont des entreprises solidaires, ainsi que l’indique le code du travail.
Ce refus d’intégrer de droit dans le périmètre de l’économie sociale et solidaire ces entreprises, déjà agréées comme entreprises solidaires, au prétexte qu’elles ont un statut commercial, persiste. Pour rester entreprises solidaires, monsieur le ministre, ces entreprises devraient accepter des conditions d’encadrement administratif de leur fonctionnement. Il leur serait, par exemple, impossible d’acquérir des parts sociales ou des actions d’une autre société. Quel investisseur privé acceptera de créer une entreprise d’insertion dans de telles conditions ?
Il n’y aura plus de place pour les PME du secteur marchand dans l’insertion par l’activité économique. En conséquence, il restera trois types d’entreprises solidaires dans ce secteur : celles qui sont capitalisées par l’argent public via des associations, celles qui sont capitalisées par de grandes entreprises, directement ou par le biais de leurs fondations, ces dernières réalisant alors des opérations de mécénat et de communication, et les coopératives.
Le fil conducteur de la loi, qui consiste à définir la notion de « solidarité » ou de « social » en se reposant sur la forme juridique des structures plutôt que sur la nature et la qualité de leur travail, aboutit à des situations ubuesques. Ainsi, les banques mutualistes, la Caisse d’épargne, le Crédit agricole ou la Banque populaire, seront de droit et sans autres conditions des structures de l’économie sociale et solidaire. Il y va de même pour toutes les mutuelles, les grandes coopératives et les associations. Un club d’investissement en bourse entrera donc de droit dans ce périmètre, mais pas une entreprise d’insertion sous forme de société commerciale installée dans une zone urbaine sensible.
Pourtant, les entreprises de travail temporaire d’insertion sous forme commerciale, que l’on rejette du premier périmètre de l’économie sociale et solidaire, n’ont pas la même réalité économique et financière que les mammouths de l’économie sociale et solidaire qui figurent dans ce périmètre. Je vous rappelle quelques-unes des rémunérations annuelles de ces patrons de l’économie sociale pour 2011 : à la MAIF, 350 000 euros ; à la MACIF, 370 000 euros ; à la Caisse d’épargne, 691 000 euros ; à la CNP, 1 million d’euros.
Les PME commerciales de l’insertion par l’économique, qui ne sont pas envieuses de la rémunération des autres acteurs de l’économie sociale et solidaire, ne demandent rien d’autre que la reconnaissance de leur action solidaire, en étant intégrées de droit dans le périmètre, d’autant que, en vertu de la loi, elles sont déjà conventionnées par l’État au titre de l’insertion par l’économique et qu’elles étaient historiquement des entreprises solidaires, conformément au code du travail.
Dans un monde aussi complexe, on ne saurait se satisfaire d’une nouvelle maxime selon laquelle « l’habit fait le moine » pour définir ce qui relève de l’action sociale et solidaire. En un mot, les ETTI ne veulent entrer dans l’économie sociale et solidaire non par la filière, mais par la gouvernance parce que leur histoire et leur action montrent qu’elles peuvent y adhérer.

L’article 1er du projet de loi définit les cadres et les buts de l’économie sociale et solidaire. Il s’agit d’une économie qui concilie à la fois performance économique et utilité sociale dans des secteurs comme les services à la personne, la petite enfance, la transition énergétique ou le recyclage.
Dans nos territoires reculés, où le tissu associatif occupe une place importante et où la solidarité vient pallier des difficultés économiques et sociales plus marquées que dans l’Hexagone, l’essor de ce type d’économie représente, il est vrai, une solution de développement viable.
Vous le savez, monsieur le ministre, l’« assistanat » dont profiteraient les outre-mer relève d’une vision profondément injuste de la réalité à laquelle ils sont confrontés. En effet, les économies ultramarines sont fragiles et présentent des handicaps structurels importants tels que l’éloignement, l’insularité, des reliefs et des climats difficiles ou encore l’étroitesse des marchés, des handicaps reconnus tant par l’État que par les institutions européennes. De plus, le taux de chômage y est beaucoup plus élevé qu’en métropole, et il touche majoritairement les jeunes.
C’est parce qu’elle présente une source d’activités non délocalisables à forte utilité sociale et créatrices d’emplois locaux que l’économie sociale et solidaire occupe aujourd’hui en outre-mer une place prépondérante et qu’elle joue pleinement son rôle de pourvoyeur d’emplois.
À Mayotte, la mise en œuvre d’une politique favorisant l’économie sociale et solidaire en est encore au stade des balbutiements, mais les bases sont d’ores et déjà posées. En effet, par courrier du 9 octobre dernier, vous avez souhaité qu’un correspondant régional à l’économie sociale et solidaire soit désigné à Mayotte. Il a été nommé quelques jours plus tard par le préfet et aura pour rôle de faire l’interface entre, d’un côté, les services déconcentrés de l’État et, de l’autre, les responsables régionaux ainsi que les acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire. De façon générale, il animera et coordonnera le développement régional de l’économie sociale et solidaire.
J’ai également entamé des démarches pour mettre en place une chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, car il était impensable que Mayotte soit la seule région de France à ne pas être dotée de cet outil indispensable à la consolidation et au développement de l’économie sociale et solidaire.
Par ailleurs, je souhaite appeler votre attention, monsieur le ministre, sur le caractère central de l’accompagnement dans le développement de l’emploi des associations, des structures de l’insertion par l’activité économique et des coopératives à finalité sociale.
Le ministre des outre-mer élabore en ce moment même un projet de loi relatif au développement et à la modernisation de l’économie des outre-mer. Le Gouvernement entend-il profiter de ce texte en préparation pour proposer une aide financière aux personnes publiques et privées qui engagent outre-mer des projets relevant de l’économie sociale et solidaire ?
Monsieur le ministre, aux termes de l’article 51, vous aurez à prendre, dans un délai de neuf mois après la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables dans les outre-mer les dispositions qu’elle contient, en tenant compte des spécificités de nos territoires. Nous aurons l’occasion de revenir ultérieurement sur ce point lors de l’examen de cet article, mais je souhaite dès à présent vous inviter à venir vous rendre compte par vous-même, lors d’un prochain déplacement, de la particularité de Mayotte.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Force est de constater que l’économie sociale et solidaire reste encore trop méconnue. Elle souffre en outre d’un manque de reconnaissance dû au fait qu’elle n’avait jusqu’à aujourd’hui, jusqu’à votre projet de loi, monsieur le ministre, ni définition précise ni reconnaissance officielle. Voilà une lacune qui sera bientôt comblée !
J’avoue ne pas comprendre certaines prises de position dans cette enceinte. Mais c’est ainsi… Non, mes chers collègues, l’économie sociale et solidaire n’est pas, comme l’a souligné Martial Bourquin, une économie marginale : elle représente 2, 6 millions de salariés, soit un emploi privé sur 8 !
En dépit de la conjoncture, ce secteur demeure créateur d’emplois. Au cours des dix dernières années, il a créé 440 000 emplois, soit une augmentation de 23 %, quand le nombre des emplois n’augmentait que de 7 % dans le reste du secteur privé. De plus, ce secteur fédère 10 % du PIB de la France. Bref, il s’agit d’un secteur à haute utilité publique et sociale.
J’apprécie, monsieur le ministre, que vous vous soyez saisi de cette question pour apporter à ce secteur toute la reconnaissance et la légitimité qu’il mérite.
Avec l’article 1er, nous allons définir de manière inclusive l’économie sociale et solidaire. En fait, nous voulons inscrire cette politique publique de l’économie sociale et solidaire dans la durée et lui donner les moyens de fonctionner de manière optimale. À cet effet, les structures et les acteurs de l’économie sociale solidaire pour lesquels nous allons définir le périmètre d’action seront désormais clairement identifiables, tant par les organismes de financement que par les pouvoirs publics et les citoyens. Ainsi, les quatre grandes familles historiques et fondatrices de ce secteur que sont les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations voient leur statut conforté par le projet de loi.
Cependant, il existe des entreprises qui, bien que n’appartenant à aucune de ces familles, adhèrent à cette philosophie par leur mode d’entreprendre et l’utilité sociale qu’elles visent. Aussi doivent-elles trouver leur place au sein de l’économie sociale et solidaire. C’est pourquoi il était primordial de définir des critères fondés sur les valeurs traditionnelles de l’économie sociale et solidaire et adaptés au modèle d’entreprendre des sociétés commerciales à « lucrativité limitée » qui souhaitent intégrer ce périmètre.
En proposant trois critères, tels que la poursuite d’un but social autre que le seul partage des bénéfices, une gouvernance démocratique, avec participation des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise, et une lucrativité encadrée, avec le réinvestissement de la majorité des bénéfices pour le développement de l’entreprise et l’« impartageabilité » des réserves obligatoires, vous permettez à ces sociétés commerciales à « lucrativité limitée », qui recherchent un objectif d’utilité sociale, d’intégrer une grande famille, tout en encadrant les conditions de cette intégration. Toutefois, il conviendra à l’avenir de vérifier le respect de ces critères par ces entreprises.
Il s’agit bien sûr d’une démarche volontaire, qui implique obligatoirement une modification des statuts. Votre approche rejoint ainsi le choc de simplification engagé par le Président de la République.
Les chiffres prévisionnels nous donnent à penser que 5 000 entreprises pourraient prétendre à ce statut, ce qui n’est nullement négligeable. Au vu des principes et des valeurs défendus par l’économie sociale et solidaire, je suis heureux que nous leur donnions cette perspective.
Monsieur le ministre, la définition de l’économie sociale et solidaire est une bonne chose. D’ailleurs, elle me semble tellement évidente que je m’étonne que personne auparavant n’ait pensé à l’inscrire dans la loi. Avec ce texte, nous menons la bataille de l’emploi souhaitée par le Président de la République et le Gouvernement. Nous allons contribuer à créer des emplois et participer à la relance de la croissance. Pour ma part, je n’y vois que des avantages. C’est donc avec détermination et conviction que je soutiendrai l’article 1er et le projet de loi dans son ensemble.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Je me félicite de ce moment consacré à l’examen du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, qui restera, quoi qu’il arrive, un marqueur dans ce quinquennat. Rappelons que ce chantier avait été stoppé net consécutivement à l’alternance voilà un peu plus de dix ans, alors qu’un secrétariat d’État à l’économie solidaire avait été créé par le gouvernement de Lionel Jospin.
L’examen de ce projet de loi en est la preuve, s’il en était besoin, la droite et la gauche, ce n’est pas pareil !

En clair, si la droite l’avait emporté en juin 2012, serions-nous là aujourd'hui à débattre de l’économie sociale et solidaire ?

La réponse est bien évidemment non ! Mon collègue Gérard César nous l’a expliqué précédemment, et son point de vue sur cette question est sans équivoque.
L’économie sociale et solidaire est un précieux élément du changement. Le texte qui nous est soumis vise à définir le secteur d’activité de l’économie sociale et solidaire, à le structurer pour faciliter le dialogue entre les acteurs eux-mêmes et avec les autorités publiques et à le développer. Cela a été souligné, le cadre législatif est sécurisant. L’avancée est donc incontestable.
Ce texte constitue plus encore pour les outre-mer une véritable opportunité pour l’emploi. Tous les efforts en faveur du seul secteur économique classique dans les outre-mer ont largement montré leurs limites au cours des dernières décennies. Ils n’ont jamais suffi à juguler la gangrène du chômage, qui déstructure des générations entières et affaiblit toujours plus la cohésion sociale. Un taux de chômage insoutenable et récurrent de 25 % à 30 %, une pression démographique constante, un solde migratoire positif, 45 % de chômeurs pas ou peu diplômés, 60 % des jeunes âgés de quinze à vingt-quatre ans frappés par le chômage à La Réunion : tous ces éléments attestent de l’urgente nécessité d’agir autrement sur nos territoires.
Les outils qui seront reconnus demain à l’économie sociale et solidaire – nouvelles structures, statuts actualisés, mesures fiscales spécifiques et adaptées, intervention de la BPI – permettront bel et bien de constituer l’autre économie, qu’il nous faudra faire vivre d’une manière responsable aux côtés de l’économie marchande classique.
Même si la tâche apparaît plus difficile encore en outre-mer à cause du poids de l’histoire, qui s’est construite sur une économie marchande verrouillée au profit de quelques-uns, nos efforts devront chaque fois porter sur l’impérieuse nécessité de faire – enfin ! – marcher nos économies ultramarines sur deux jambes : l’économie privée classique et l’économie sociale et solidaire. Quoi de plus naturel, me direz-vous, si l’on veut efficacement avancer !
Je me réjouis de ce pas historique, qui vient enrichir la boîte à outils dont nous disposons déjà avec la loi de régulation économique adoptée en novembre 2012, dont l’article 1er ouvre dans tous les secteurs d’activité économique des collectivités ultramarines le champ de la concurrence, la loi visant à garantir la qualité de l’offre alimentaire adoptée en mai 2013, dont l’article 4 ouvre les appels d’offres dans nos collectivités à la petite entreprise agricole, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ou encore la BPI. Nous disposons incontestablement de plus de moyens pour être offensif dans les domaines du développement et de l’emploi dans nos territoires ultramarins. Il nous faut à présent livrer la bataille de la communication pour gagner la bataille, impérieuse, de l’explication. Ce n’est pas une mince affaire, mais c’est là une tout autre histoire qui commence.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai conscience que, en prenant la parole à cet instant, je m’expose au risque de répéter les propos des orateurs précédents. Toutefois, je tiens à souligner que ce projet de loi procède d’une démarche éminemment politique : il n’est pas, comme certains pourraient le penser, un texte de circonstance.
M. le ministre et M. le rapporteur ont rappelé que l’économie sociale et solidaire était apparue au XIXe siècle ; elle s’est construite peu à peu, selon une méthode qu’il faut bien qualifier d’empirique. En lui accordant une consécration législative, ce projet de loi donne à l’économie sociale et solidaire ses lettres de noblesse : c’est une étape heureuse et importante.
L’article 1er du projet de loi précise clairement que cette économie ne vise pas à dégager des bénéfices à tout prix, dans un but uniquement lucratif. Monsieur César, on mesure la distance qui la sépare d’autres types d’économie, dans lesquels la recherche frénétique des bénéfices n’a eu d’autre but que d’assouvir la soif d’un certain nombre d’actionnaires.
Murmures sur les travées de l’UMP.

Parmi les principes fondamentaux de l’économie sociale et solidaire énoncés par cet article figure le caractère démocratique de la gouvernance. On peut espérer que les travailleurs qui ne sont pas associés au choix des orientations, lesquelles sont parfois fatales à l’entreprise, auront désormais leur mot à dire.
L’affectation systématique des bénéfices vers le maintien des emplois et le développement de l’entreprise n’est pas non plus un principe négligeable.
Tous les orateurs qui se sont exprimés cet après-midi, du moins ceux de la majorité, ont pris la précaution de préciser que la démarche n’était pas manichéenne ; nous ne considérons pas qu’il y a, d’un côté, la vertu, et, de l’autre, le diable. C’est vous, monsieur César, …
Sourires.
Nouveaux sourires.

… qui avez pris le risque de tenter de disqualifier, par un discours pour le moins schématique, un projet de loi dont la crédibilité va être peu à peu affermie.
Mes chers collègues, comment pourrions-nous ignorer le chiffre que nombre d’orateurs ont déjà cité : 50 000 emplois sont perdus chaque année. Dans ces conditions, nous n’avons pas le droit de ne pas tout essayer !

Incontestablement, ce projet de loi puissamment novateur permettra de lever un verrou et d’ouvrir de nouveaux horizons.
Il répond à une triple exigence : une exigence sociale, une exigence économique et une exigence citoyenne. Toutes trois figurent parmi les principes fondamentaux énoncés à l’article 1er ; Jean-Pierre Godefroy a eu raison de souligner, dans la discussion générale, qu’elles sont au cœur du pacte républicain.
M. Henri de Raincourt s’exclame.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous pensez bien que nous soutenons pleinement cette démarche remarquablement cohérente.
Marques d’ironie sur les travées de l’UMP.

Enfin, il faut signaler l’importance que le projet de loi accorde aux collectivités territoriales, singulièrement aux régions. Qu’il soit examiné en premier lieu par le Sénat renforce la crédibilité de notre assemblée et permet de lui apporter une plus-value.
Monsieur le ministre, nous souhaitons le succès de ce projet de loi, qui est inspiré par une volonté politique. Dans nos départements, nous en assurerons, en quelque sorte, le service après-vente : ainsi l’économie sociale et solidaire, en se développant dans les territoires, permettra-t-elle de lutter efficacement contre le chômage !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.
Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 213 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – L’économie sociale et solidaire est une forme d’organisation d’activités économiques, fondée sur la solidarité collective, qui assure la production, la distribution, l’échange et la consommation de biens et de services. Elle contribue et participe au développement économique, social ou environnemental et peut intervenir dans tous les domaines de l’activité humaine. En font partie des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions suivantes :
La parole est à M. Jacques Mézard.

Monsieur le président, si vous le voulez bien, je présenterai en même temps l'amendement n° 259 rectifié.
L’article 1er du projet de loi est important, dans la mesure où il définit le périmètre de l’économie sociale et solidaire. La définition qu’il en donne est inclusive : elle englobe les acteurs traditionnels de cette économie, c’est-à-dire les coopératives, les associations, les mutuelles et les fondations, mais aussi des sociétés commerciales, dès lors que celles-ci répondent à un certain nombre de critères.
Une telle définition est à la fois nécessaire et attendue ; il s’agit de permettre le développement de l’économie sociale et solidaire dans tous les secteurs et sur tout le territoire.
L’amendement n° 213 rectifié vise simplement à étoffer cette définition, car nous la trouvons particulièrement succincte. Notre proposition est inspirée de la définition donnée par le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, dans son avis de janvier 2013 intitulé : « Entreprendre autrement : l’économie sociale et solidaire ».
Permettez-moi, mes chers collègues, de vous en donner lecture : « L’économie sociale et solidaire est une forme d’organisation d’activités humaines, fondée sur la solidarité collective et la démocratie, s’appuyant sur l’efficience économique de ses moyens, qui assure la production, la distribution, l’échange et la consommation des biens et des services. Elle contribue à l’expression d’une citoyenneté active et participe à la prospérité individuelle et collective. Elle intervient dans tous les domaines économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux ».
Les amendements n° 213 rectifié et 259 rectifié visent principalement à préciser que l’économie sociale et solidaire peut intervenir dans tous les domaines de l’activité humaine. Le second est un amendement de repli, dont les dispositions se bornent à ajouter cette précision à l’alinéa 1 de l’article 1er.

L'amendement n° 259 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après le mot :
entreprendre
insérer les mots :
adapté à tous les domaines de l’activité humaine
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?

Les auteurs de l’amendement n° 213 rectifié proposent une définition générale de l’économie sociale et solidaire, ainsi que de ses principes et objectifs fondamentaux. Or la commission a considéré que nombre des précisions que cette définition comporte ne relèvent pas vraiment de la loi : elles forment plutôt une déclaration générale, une sorte d’exposé des motifs.
Monsieur Mézard, comme je souscris malgré tout à l’esprit de la définition que vous proposez, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement au profit de l’amendement n° 132, que nous examinerons plus tard et qui vise à en reprendre la teneur tout en évitant un certain nombre de redondances.
Par ailleurs, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 259 rectifié.
Monsieur Mézard, l’article 1er du projet de loi a fait l’objet de discussions et de négociations intenses, non seulement avec les groupes politiques du Sénat, mais aussi, en amont, avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire.
Après avoir entendu l’avis du CESE, auquel vous avez fait référence, et les points de vue de tous les acteurs concernés, nous sommes arrivés à une définition qui ne correspond pas forcément à la position de chaque famille de l’économie sociale et solidaire, mais que le Gouvernement considère comme un point d’équilibre. En effet, elle sert notre ambition de promouvoir une vision inclusive de l’ESS et de favoriser la pollinisation par celle-ci de l’économie classique.
À nos yeux, monsieur le sénateur, votre proposition de remplacer, à l’alinéa 1, l’expression : « un mode d’entreprendre » par les mots : « une forme d’organisation d’activités économiques » rompt cet équilibre. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 213 rectifié ; s’il est maintenu, le Gouvernement y sera défavorable.
En revanche, le Gouvernement est favorable, à l’instar de la commission, à l’amendement n° 259 rectifié. En effet, la précision que celui-ci vise à introduire rejoint notre volonté de faire entendre que l’économie sociale et solidaire n’est pas seulement une économie de la réparation.
À la vérité, cette économie couvre un champ d’activités bien plus large, même si toutes les forces économiques et politiques n’en sont pas convaincues, comme l’ont bien montré les interventions de certains orateurs dans la discussion générale.

Comme j’ai précisé que mon amendement n° 259 rectifié était un amendement de repli, je consens à retirer à son profit l’amendement n° 213 rectifié, monsieur le président.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 214 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Un but non lucratif ou une lucrativité limitée qui consiste à utiliser leurs bénéfices en priorité pour atteindre leur objet principal, et à mettre en place des procédures et des règles prédéfinies pour toutes les situations exceptionnelles où des bénéfices sont distribués aux actionnaires et aux propriétaires, garantissant qu’une telle distribution de bénéfices ne dessert aucunement leur objet principal ;
La parole est à M. Jacques Mézard.

Au travers de cette série d’amendements à l’article 1er du projet de loi, nous cherchons à préciser les caractéristiques fondamentales de l’économie sociale et solidaire et à nous assurer du respect de celles-ci par l’ensemble des acteurs concernés.
L’amendement n° 214 rectifié vise à définir plus précisément l’un des piliers de l’économie sociale et solidaire : la notion de lucrativité nulle ou limitée.
Donner de cette économie une définition inclusive, c’est très bien ; mais, selon nous, cette intention ne doit pas conduire à abaisser les exigences constitutives de ce secteur. C’est pourquoi nous proposons d’insister sur l’importance du critère de lucrativité nulle ou limitée.

La commission souscrit à l’idée de lucrativité nulle ou limitée, mais considère que cet amendement est satisfait par le projet de loi.
En effet, l’alinéa 5 de l’article 1er prévoit l’affectation majoritaire des bénéfices à l’activité de l’entreprise et l’ « impartageabilité » des réserves est inscrite à l’alinéa 6, dont la rédaction s’inspire de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
Dans ces conditions, je demande aux auteurs de l’amendement n° 214 rectifié de bien vouloir le retirer.
Monsieur Mézard, vous voulez vous assurer que les bénéfices seront redistribués aux sociétaires, sous forme de participation, de manière exceptionnelle.
Le président de la SCOP Chèque Déjeuner, l’un des leaders mondiaux en matière de titres de restauration, a rapporté que 45 % des bénéfices de l’exercice 2011 ont été directement distribués aux salariés, selon un partage égalitaire : de l’hôtesse d’accueil au président, chacun a reçu 20 000 euros, ce qui est considérable. Une part identique des bénéfices a servi de provision pour investissement, le reste étant de 10 %.
Cet exemple montre que, dans le fonctionnement actuel du modèle coopératif, une part des bénéfices est, de manière régulière, distribuée aux sociétaires.
Il me semble que l’adoption de l’amendement n° 214 rectifié mettrait en cause le fonctionnement actuel de certaines coopératives dans le secteur marchand : dans un environnement très fortement concurrentiel, celles-ci aspirent, sans abandonner le principe coopératif, à redistribuer une partie des bénéfices aux sociétaires.
C’est pourquoi je demande à M. Mézard de bien vouloir retirer son amendement ; s’il est maintenu, le Gouvernement y sera défavorable.

L'amendement n° 214 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 74, présenté par M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant la participation, non strictement proportionnelle à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés et parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ;
La parole est à M. Gérard Le Cam.

L’article 1er du projet de loi définit le champ de l’économie sociale et solidaire en en rappelant les principes fondateurs. Parmi ces principes communs aux différents acteurs du secteur, quelle que soit leur forme juridique, se trouve l’exigence de gouvernance démocratique.
Cette modalité de gouvernance implique le respect du principe « un homme, une voix ». Ainsi, quels que soient sa taille, son poids économique ou encore le montant des parts sociales qu’il détient, chaque individu impliqué dans la structure dispose d’un droit de vote identique.
Ce principe n’est pas complètement transposable à tous les acteurs historiques du secteur. Certains aménagements existent, qui ne remettent pas en cause la gouvernance démocratique.
Ainsi, dans les sociétés coopératives d’intérêt collectif, les SCIC, ce principe est respecté lors des assemblées générales. Il est toutefois possible de pondérer ce vote en prévoyant, dans les statuts, la mise en place de collèges : dans ce cas, il faut au minimum trois collèges, sans qu’aucun puisse détenir plus de 50 % des droits de vote, ni moins de 10 %. Cette règle oblige à une réflexion collective sur le partage du pouvoir et à l’acceptation par l’ensemble des associés des modalités de pondération de voix propres à chaque société coopérative d’intérêt collectif.
En faisant entrer les sociétés commerciales à capitaux dans la famille de l’économie sociale et solidaire, ce principe est d’autant plus délicat à adapter qu’il s’oppose au mode de gouvernance proportionnelle à la détention des parts du capital. On prend donc le risque d’affaiblir ce principe démocratique historique.
Selon nous, tel qu’il est rédigé, le projet de loi définit la notion de gouvernance démocratique de façon trop floue et laisse les entreprises libres d’intégrer dans leurs statuts, sous la forme et avec l’intensité qu’elles souhaitent, le moyen de mettre en œuvre une telle gouvernance.
Il faut pourtant que, dans les sociétés commerciales concernées, une solution soit trouvée, pour que la gouvernance dote chaque membre de l’entreprise d’un seul et même poids dans la prise des décisions concernant la vie de l’entreprise. Nous savons tous que, au bout du compte, ceux qui détiennent le capital seront les ultimes décisionnaires.
Même pour de telles entreprises, ce principe de gouvernance démocratique a son intérêt. Il représente aussi une garantie que le projet de l’entreprise sera co-construit par une pluralité d’acteurs, représentant différentes sensibilités.
En conséquence, si le projet de loi entend défendre les principes fondateurs de l’économie sociale et solidaire, il doit être éducatif et politique, comme le furent à l’origine les mouvements associatifs, mutualistes et coopératifs.
C'est la raison pour laquelle nous proposons de récrire l’alinéa 3 de l'article 1er.

Le sous-amendement n° 298, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Amendement n° 74, alinéa 3
Remplacer les mots :
non strictement proportionnelle
par les mots :
dont l'expression n'est pas seulement liée
La parole est à M. le rapporteur.

Les dispositions de l’amendement n° 74 nous paraissent opportunes et nous comprenons la volonté qui les sous-tend. Il convient cependant de sous-amender ce texte. En effet, il semble délicat de déterminer comment une participation aux réalisations de l'entreprise peut être « proportionnelle » à l'apport financier.
C'est pourquoi nous proposons ce sous-amendement rédactionnel.

L'amendement n° 133, présenté par M. Godefroy, Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mmes Claireaux et Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
ou participative
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

L’article 1er porte en lui l’essence même de la philosophie de ce projet de loi, à savoir définir l’économie sociale et solidaire d’une manière inclusive. Cela suppose deux éléments : d’une part, définir pour la première fois l’économie sociale et solidaire et la reconnaître comme une économie à part entière ; d’autre part, mettre en place les systèmes permettant de partager les modes de fonctionnement et les valeurs de l’économie sociale et solidaire au sein de l’économie classique.
Pour ce faire, l’article 1er comprend trois parties : la première revient sur les piliers fondateurs de l’économie sociale et solidaire, la deuxième définit les organisations de l’économie sociale et solidaire, la troisième définit les organisations de l’économie classique pouvant, sous conditions, adhérer à l’économie sociale et solidaire.
Cette articulation permet au texte de ne pas dévoyer les principes fondateurs de l’économie sociale et solidaire tout en permettant la définition inclusive profondément souhaitée.
L’objet de cet amendement concerne un élément de la première partie, qui dispose que les personnes morales de droit privé remplissant la condition de l’exercice d’une gouvernance démocratique ou participative peuvent adhérer à l’économie sociale et solidaire, sous réserve de remplir les autres conditions.
Je souhaite revenir sur ce point. En effet, les deux notions ne recouvrent pas les mêmes réalités. Nous pourrions dire que la gouvernance démocratique fonde la démocratie selon le principe « un homme – ou une femme –, une voix » au sein de la même entité, à l’instar, par exemple, d’un vote organisé par une association à l’occasion de son assemblée générale. La gouvernance participative fait, quant à elle, davantage allusion à la participation d’entités n’appartenant pas à l’organisation d’origine, comme une collectivité territoriale pourrait le faire au travers d’une consultation citoyenne.
Monsieur le ministre, notre objectif n’est pas d’ôter toute légitimité à la gouvernance participative. Je pense même que nous devrions la développer, notamment chez les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Cependant, j’y insiste, la gouvernance démocratique est l’un des principes fondateurs de l’action collective engagée par les acteurs de l’économie sociale et solidaire. En effet, les parties prenantes sont non pas des partenaires de l’organisation agissants, mais des adhérents de l’organisation agissants. La nuance est de taille !
Ainsi, en demandant la suppression des mots « ou participative », nous nous fixons un double objectif : ne pas dévoyer la pratique de la démocratie ayant actuellement cours dans les organisations de l’économie sociale et solidaire, partager des objectifs ambitieux avec les acteurs de l’économie classique. La rédaction actuelle ne nous semble pas suffisamment contraignante.

La commission est favorable à l’amendement n° 74, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 298, car il tend à offrir une vision plus complète que l’amendement n° 133.
Par ailleurs, si l'amendement n° 74 ainsi modifié est adopté, l'amendement n° 133 n’aura plus d’objet. C'est la raison pour laquelle commission en demande le retrait.
En ce qui concerne la gouvernance démocratique, le Gouvernement partage le souci qui vient d’être exprimé. Il s’agit bien de lester ce principe et de lui donner de la force, tout en conservant l’ambition inclusive et la volonté d’intégrer les sociétés commerciales, pour qui, par définition, les parts sont à due proportion du capital investi et détenu par les différents actionnaires.
Pour le Gouvernement, il convient également d’associer les parties prenantes. La commission a souhaité ajouter le principe participatif. L’adoption de l'amendement n° 74 modifié, dont les dispositions vont encore plus loin, permettra, du reste, de répondre à la préoccupation exprimée par M. Godefroy.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 74, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 298, et demande le retrait de l'amendement n° 133.

Je regrette que M. Mézard ait retiré tout à l'heure l’amendement n° 214 rectifié avant que j’aie pu m’exprimer. Je souhaite y revenir et, plus généralement, donner mon sentiment sur ce projet de loi, puisque je ne suis pas intervenu dans la discussion générale.
J’ai bien conscience qu’il existe des figures imposées, mais tout de même ! Il y a des préjugés qui semblent bien difficiles à extirper de l’inconscient de certains de nos collègues…
J’en veux pour preuve l’alinéa 2 de l'article 1er, qui mentionne des entreprises dont le « but poursuivi [est] autre que le seul partage des bénéfices ». Mes chers collègues, connaissez-vous ne serait-ce qu’une entreprise qui ait ce seul objectif ? Comment imaginer une telle chose ? C’est impensable, même pour les entreprises du CAC 40, qui cherchent pourtant aussi à rémunérer le capital détenu par leurs actionnaires : l’objectif de Total, par exemple, est de trouver du pétrole et d’assurer sa compétitivité !
Je ne connais pas une seule entreprise qui réponde à la définition proposée. D’ailleurs, dans ces conditions, les petites et moyennes entreprises, en particulier les entreprises familiales, sont quasiment d’ores et déjà des entreprises sociales et solidaires, puisqu’elles visent non pas à distribuer des bénéfices, mais bel et bien à prospérer et à faire vivre leurs salariés !
Par conséquent, soit l’on considère que toutes les entreprises sont sociales et solidaires, soit l’on ne vote pas cet article 1er. En effet, ce serait faire offense aux entreprises qui ne sont pas sociales et solidaires et qui n’ont pas, pour autant, pour seul objectif de distribuer leurs bénéfices.
Monsieur le sénateur, il n’y a là nul préjugé, ou alors le code civil en regorge, puisque nous avons repris la définition de l’entreprise qui y figure.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Nous nous en sommes tenus aux textes en vigueur, mais peut-être les ignoriez-vous.
Sourires
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 215 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ni incorporées au capital
La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Avec cet amendement, il ne s’agit pas de remettre en cause les dispositions du code civil.
Sourires.

Nous travaillons sous l’ombre de Portalis, ce qui doit nous appeler à la sagesse...
L’amendement n° 215 rectifié tend à préciser la notion d’ « impartageabilité » de la propriété collective, qui est l’une des trois caractéristiques fondamentales de l’économie sociale et solidaire. Ainsi, les réserves obligatoires impartageables ne peuvent être ni distribuées ni « incorporées au capital ».
Sans cet ajout, la notion d’ « impartageabilité » perdrait tout son sens.

L’article 1er intègre ce que l’on appelle les « familles traditionnelles » – nous y reviendrons à l’occasion de l’examen d’un autre amendement –, parmi lesquelles se trouvent les coopératives. Or l’article 16 de la loi du 10 septembre 1947 permet aux coopératives d’incorporer une partie des réserves au capital, dans certaines conditions.
L’adoption de cet amendement pourrait donc poser des difficultés pour les coopératives ou pour des entreprises sociales qui souhaiteraient rapprocher leur statut de celui des coopératives, ce qui est contraire à l’objectif de ce projet de loi. Ce point a sans doute échappé à la vigilance des auteurs de cet amendement, animés qu’ils étaient du souci, tout à fait louable, d’éviter des dérives en la matière.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
La définition des réserves impartageables proposée paraît trop stricte, même si la loi de 1947 fixe aux coopératives des contraintes assez proches, mais de manière partielle pour certaines d’entre elles.
Ainsi, dans la loi de 1947, les cas où cette incorporation est envisagée ou interdite font l’objet de dispositions beaucoup plus précises et détaillées. Les situations dans lesquelles la corporation n’est pas possible sont prévues et, quand c’est possible, les conditions exactes d’application de cette incorporation sont mentionnées : modalités dans lesquelles l’assemblée générale autorise une telle incorporation, portée exacte de cette incorporation, etc.
Cet amendement vise une interdiction trop stricte et trop générale pour être applicable en tant que telle. Comme la commission, le Gouvernement en demande donc le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Non, même si je ne suis pas totalement convaincu, je le retire, monsieur le président.

L'amendement n° 215 rectifié est retiré.
L'amendement n° 216 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 6, seconde phrase
Remplacer les mots :
de l’actif net
par les mots :
du boni
La parole est à M. Jacques Mézard.

Il s’agit de prévoir que l’ensemble « du boni », et non « de l’actif net », est dévolu en cas de liquidation ou de dissolution d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire.
Cette dévolution doit en effet concerner les bénéfices qui n’ont pas été distribués au cours de la vie de l’entreprise, à savoir le boni de liquidation, c’est-à-dire l’actif net diminué du remboursement des dettes de l’entreprise.

Le sous-amendement n° 299, présenté par M. Daunis, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Amendement n° 216 rectifié, alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
de liquidation
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 216 rectifié.

L’amendement n° 216 rectifié est particulièrement bienvenu. Il tend à améliorer la rédaction du texte.
En effet, il est légitime que les détenteurs de parts récupèrent leurs apports à la part, comme c’est d’ailleurs le cas dans les coopératives. Il est préférable de prévoir la dévolution du boni de liquidation calculé après que chacun aura récupéré ses parts.
Quant au sous-amendement n° 299, qui est rédactionnel, il vise à préciser qu’il s’agit bien d’un boni « de liquidation ».
Je me permets de revenir sur l’intervention de M. Sido. En effet, au-delà de la définition du code civil, il est vrai que la plupart des entrepreneurs, en créant des entreprises de bâtiment ou de services, veulent évidemment réaliser des bénéfices.
Monsieur Sido, vous avez raison, si l’on crée une entreprise, c’est certes pour essayer de gagner sa vie, mais cela s’insère surtout dans un projet personnel qui dépasse le but purement lucratif. Cependant, la définition de l’article 1832 du code civil est bien celle que j’ai mentionnée.
J’ai bien compris vos propos. L’immense majorité des chefs d’entreprise, si l’on met à part quelques traders et prédateurs, a pour objectif de réaliser des bénéfices, mais aussi de remplir une mission plus large que celle de leur simple enrichissement, lequel n’est d’ailleurs pas systématique, à la fin du mois.
Pour en revenir aux amendements en discussion, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 216 rectifié de M. Mézard, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 299 de la commission, qui vise à ajouter une précision utile.

Monsieur le ministre, je vous remercie de vos précisions. Vous avez bien compris le sens de mes propos.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 132, présenté par M. Godefroy, Mmes Lienemann et Bataille, M. Courteau, Mmes Claireaux et Nicoux, M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après le mot :
production
insérer les mots :
, de distribution, d’échange et de consommation
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.

L’article 1er de ce projet de loi définit l’économie sociale et solidaire, la seconde partie de l’article précisant quelles organisations peuvent y adhérer.
Cette seconde partie les décrit comme telles : « L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production de biens ou de services mises en œuvre ». Cette description de l’économie sociale et solidaire se limite donc aux activités de production de biens ou de services. Aussi, je m’interroge.
Si j’ai bien compris vos interventions, monsieur le ministre, l’économie sociale et solidaire fait partie intégrante de l’économie. Cette notion s’oppose à l’idée selon laquelle l’économie sociale et solidaire ne serait qu’une économie réparatrice.
Or l’économie ne regroupe pas uniquement les activités de production de biens ou de services. Elle regroupe les activités de production, certes, mais également les activités de distribution, d’échange et de consommation.
Par ailleurs, à l’ensemble de ces notions, j’ajouterai celle de « circulation » au sens où, à la suite de la consommation, l’économie doit imaginer les nouveaux processus permettant d’utiliser une nouvelle fois les déchets. Or cette notion relative à l’économie circulaire ne figure pas dans notre amendement.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, en ne faisant référence qu’à la notion de production, je me demande si nous ne risquons pas de restreindre le champ de l’économie sociale et solidaire que ce texte a pour philosophie d’étendre, à juste titre, à l’ensemble de l’économie.
Tel est l'objet de cet amendement.

Les dispositions de cet amendement nous ont paru utiles.
En effet, la rédaction actuelle inclut les activités de production de biens ou de services, ce qui est très large si l’on retient une définition extensive des biens et des services. On peut toutefois se demander si elle englobe certaines formes d’activité telles que les coopératives de consommateurs, qui constituent pourtant l’une des formes les plus anciennes de l’économie sociale, avec la Société des équitables pionniers de Rochdale de 1844, notamment.
La commission est donc favorable à cet amendement du groupe socialiste, qui vise à préciser utilement le périmètre de l’économie sociale et solidaire.
Je n’aurais pas mieux dit ! L’avis du Gouvernement est également favorable.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 244 rectifié bis, présenté par MM. C. Bourquin, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Après le mot :
les
insérer les mots :
organismes de l’économie sociale et solidaire,
II. – Alinéa 9
Après la première occurrence du mot :
les
insérer les mots :
entreprises de l’économie sociale et solidaire,
III. – Alinéa 15
Après le mot :
qualité
insérer les mots :
d’organisme ou
La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 1er, qui distingue deux catégories d’acteurs appartenant à l’économie sociale et solidaire. Nous proposons de donner une appellation distincte à chacune de ces catégories dans l’ensemble de cet article.
Afin de renforcer la sécurité juridique, nous proposons donc de distinguer les « organismes » de l’économie sociale et solidaire, qui sont les coopératives, les mutuelles, les associations et les fondations visées à l’alinéa 8, des « entreprises » de l’ESS, qui sont les sociétés commerciales visées aux alinéas 9 à 17.
Actuellement, la rédaction du projet de loi nous semble insuffisamment claire, puisqu’elle distingue dans un premier temps deux catégories d’acteurs, qu’elle regroupe par la suite sous la seule dénomination d’« entreprises de l’économie sociale et solidaire ».
Afin de préciser et de sécuriser la rédaction de cet article, nous vous proposons donc, mes chers collègues, avec cet amendement, de distinguer clairement les « organismes » – associations, mutuelles, fondations, coopératives – et les « entreprises » – sociétés commerciales – de l’ESS.

Pour bien prouver la bonne foi du ministre et la qualité du débat, nous allons le poursuivre de façon interposée.
Monsieur Requier, votre amendement tend à distinguer un organisme d’une entreprise, quel que soit son type d’activité. Or une entreprise est simplement un organisme qui mène une action économique. C’est un terme aujourd’hui consacré qui n’implique pas un but lucratif. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article indique bien que l’économie sociale et solidaire est un « mode d’entreprendre ».
Distinguer les deux termes n’aurait pas d’impact juridique et risquerait de compliquer la rédaction et la compréhension du dispositif.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
J’ajouterai un argument supplémentaire pour répondre à M. Requier.
Nous ne souhaitons pas laisser entendre qu’il y aurait une fragmentation entre deux types d’acteurs de l’ESS : les organismes, d’une part, et les entreprises de l’ESS, de l’autre. Quand on constitue une association, on peut penser que, la plupart du temps, ce n’est pas d'abord pour exercer une activité économique. On comprend dès lors qu’une association rechigne à se faire appeler entreprise.
Cependant, la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, dans un arrêt Höfner et Elser du 23 avril 1991, a précisé que la notion d’entreprise s’étendait à toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Selon cette définition, les associations, les coopératives et les mutuelles sont des entreprises, ce qui nous conduit à considérer que la présente rédaction de l’article est la bonne.
Monsieur Requier, je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement, qui, à défaut, recevra un avis défavorable.

L’amendement n° 244 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 231 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Après le mot :
fondations
insérer les mots :
respectant une gouvernance démocratique
La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Plusieurs de nos amendements à l’article 1er visent à préciser les trois caractéristiques fondamentales de l’ESS, qui sont la lucrativité nulle ou limitée, la gouvernance démocratique et la propriété collective.
Les dispositions du présent amendement s’inscrivent dans cette logique, afin de préciser que les fondations qui appartiennent à l’ESS doivent respecter les règles de la gouvernance démocratique.

Cet amendement tend à cibler lui aussi les fondations et leur respect de la gouvernance démocratique, dans le cadre de l’économie sociale et solidaire.
Je comprends l’intention des auteurs de cet amendement. Nous pourrions faire des observations sur le mode de gouvernance de certaines fondations, mais aussi de certaines coopératives, associations ou mutuelles. Notre logique est la suivante : tout ce qui est aujourd’hui intégré au secteur de l’économie sociale et solidaire y demeure.
Si nous nous écartons de cette logique en introduisant des distinctions, nous rouvrons un débat extrêmement dangereux.
Ce projet de loi d’équilibre crée une charpente forte. D’une part, les acteurs traditionnels de l’économie sociale et solidaire sont reconnus de droit. D’autre part, les entrepreneurs sociaux ou à finalité sociale sont reconnus membres de l’économie sociale et solidaire s’ils respectent une série de critères. Comme l’a rappelé notre collègue Jean-Jacques Mirassou, nous avons défini le périmètre selon cette méthode.
Je comprends votre préoccupation, monsieur Requier, mais nous ne pouvons remettre en cause l’équilibre du texte. C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement.

L'amendement n° 231 rectifié est retiré.
L'amendement n° 217 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour ces personnes morales, la gouvernance démocratique, dans le respect des dispositions légales spécifiques à chaque type d'organisation, est fondée sur des instances statutaires dont les membres sont élus ou désignés par et parmi les personnes composant l'organisation ;
La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Dans la lignée de l’amendement précédent, celui-ci vise à définir l’une des trois caractéristiques fondamentales de l’ESS, à savoir la gouvernance démocratique. Cette dernière implique que les personnes siégeant dans les instances statutaires soient élues « par et parmi » les personnes composant l’organisation, qu’il s’agisse d’une coopérative, d’une mutuelle, d’une association ou d’une fondation.

La logique est la même que pour l’amendement précédent. Sans entrer dans les détails, la précision que vous demandez, monsieur Requier, risquerait d’introduire une instabilité juridique.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Tout à l'heure, l’adoption de l’amendement n° 74 modifié de M. Le Cam nous a offert une définition transversale, englobant l’ensemble des familles de l’ESS, les « statutaires » comme les « néo-entrants », ce qui répond d'ailleurs à votre souci, monsieur Requier.
Cette approche me paraît préférable à celle qui consisterait à segmenter les familles de l’ESS par tiers, en fonction de leur type de gouvernance.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

L’amendement n° 217 rectifié est retiré.
L'amendement n° 130 rectifié, présenté par MM. Patriat et M. Bourquin, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Par les personnes morales de droit privé qui, au titre de l’article L. 5132-4 du code du travail, ont pour objet l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs défavorisés ;
La parole est à M. François Patriat.

J’ai entendu à l’instant M. le rapporteur, pour lequel j’ai de l’amitié et de l’admiration, affirmer que l’ESS était un mode d’entreprendre. À l’origine, ce dernier était promu par des travailleurs sociaux convaincus que le travail est le premier vecteur d’insertion des personnes en difficulté.
Depuis trente-cinq ans, les entreprises d’insertion et de travail temporaire sont les acteurs historiques et fondateurs de l’ESS. Aujourd'hui, elles demeurent le dernier guichet social dans beaucoup de territoires délaissés, et sont à ce titre reconnues comme des entreprises solidaires de droit. Au fil du temps, elles ont associé la performance économique à l’utilité sociale et sont devenues, sous différents statuts juridiques, de véritables entreprises, qui salarient et accompagnent, dans des conditions de droit commun, des personnes très éloignées de l’emploi.
Le présent amendement vise à entériner cette réalité historique et de terrain, en la traduisant dans le projet de loi, qui, pour le moment, n’intègre pas le versant solidaire de l’ESS. Cette lacune l’empêche de construire une ESS inclusive et cohérente.
Il existe 1 260 entreprises d’insertion et de travail temporaire conventionnées par l’État, qui emploient 65 000 salariés. Elles appartiennent au périmètre de l’ESS au même titre que les coopératives, les mutuelles et les associations. Vous allez les humilier !
Elles ne comprennent pas – je reçois leurs représentants depuis deux semaines – qu’on les fasse entrer dans l’ESS par la petite porte et non par la porte légale, comme tout le monde, au motif que leur intégration au dispositif risquerait de profiter à deux ou trois entreprises nationales. Or ce ne sont pas ces entreprises nationales, mais leurs filiales, qui profiteront du dispositif.
Monsieur le ministre, on ne peut pas dire que les entreprises d’insertion ne faisaient pas partie du premier périmètre, historique, de l’ESS. En effet, il n’existait pas de texte législatif en la matière – d’où le présent projet de loi, d'ailleurs –, mais le droit reconnaissait des entreprises solidaires, dont les entreprises d’insertion faisaient partie.
Tel est l'objet de cet amendement.

Mon avis ne peut être que défavorable, et je le regrette. Mon cher collègue, je regrette même que nous ayons cet échange. Je vais m’exprimer de la manière la plus délicate possible.
Nous avons tous un immense respect pour l’ensemble des personnes et structures qui travaillent dans le secteur de l’insertion. Je le dis d’autant plus facilement que, très modestement, j’ai créé de telles structures ; je crois d'ailleurs que nous sommes nombreux dans cet hémicycle à avoir agi de la sorte.
Le projet de loi définit l’ESS comme « un mode d’entreprendre auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
« 2° Une gouvernance démocratique ou participative prévoyant la participation des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise définie et organisée par les statuts ;
« 3° Une gestion conforme aux principes suivants :
« a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ;
« b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. »
Le projet de loi précise également que l’ESS « est composée des activités de production de biens ou de services mises en œuvre :
« 1° Par les personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle – ce sont les « quatre familles traditionnelles ».
« 2° Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes :
« a) Elles respectent les conditions » – il s'agit de conditions minimales – fixées au I et poursuivent un objectif d’utilité sociale, telle que définie à l’article 2 ;
« b) Elles prévoient :
« - le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 15 % des bénéfices de l’exercice diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, affecté à la formation d’un fonds de réserve dit « réserve statutaire » ; »
Je ne cite pas les autres conditions, car François Patriat les a rappelées.
L’article 1er du projet de loi définit donc ce qui distingue une entreprise traditionnelle, dans son mode de gouvernance et de gestion, d’une entreprise de l’ESS. Toutes les entreprises – elles représentent l’immense majorité des 1 260 entreprises d’insertion – qui remplissent ces conditions seront directement incluses dans l’ESS.
Le texte prévoit seulement une protection pour éviter un affadissement progressif de la notion d’ESS, car, alors, ce ne serait plus l’ESS qui polliniserait l’économie classique, mais l’économie classique qui – je reprends l’expression d’un collègue – polluerait l’ESS. Nous ne pouvons intégrer des secteurs d’activité entiers dans l’ESS, parce que cela reviendrait à enlever à cette dernière certains de ses éléments fondamentaux, qui ont trait à la gouvernance – elle doit être démocratique – et aux modes de gestion.
Mon cher collègue, même si je comprends votre préoccupation, je souhaiterais vraiment que vous retiriez votre amendement. À défaut, je l’ai dit, l’avis de la commission ne pourra qu’être défavorable.
J’apporterai quelques éléments de réponse à la préoccupation de François Patriat, qui me semble légitime. J’essayerai de lui expliquer mon désaccord de manière argumentée.
Monsieur Patriat, vous soulignez que les entreprises travaillant dans le secteur de l’insertion par l’activité économique, par exemple dans le secteur du recyclage, ont pour objet social de remettre au travail, grâce à un parcours d’insertion, des salariés cabossés par la vie.
Le champ de l’insertion par l’activité économique comporte quatre familles : les ateliers et chantiers d’insertion, les ACI, les associations intermédiaires, les entreprises de travail temporaire d’insertion, les ETTI, et les entreprises d’insertion. Ce sont essentiellement les entreprises d’insertion qui sont concernées par votre demande, dans la mesure où 40 % d’entre elles sont des sociétés commerciales.
Qu’il me soit permis de rappeler que le secteur de l’insertion par l’activité économique vient de bénéficier d’une réforme en profondeur de son financement, qui était attendue depuis 1999. Sous l’égide de la présidente du Conseil de l’insertion par l’activité économique, qui n’est autre que Christiane Demontès, nous sommes parvenus à organiser une rationalisation du financement, puisque nous sommes passés de quatre modes de financement à un seul. Par ailleurs, nous venons de revaloriser l’aide au poste et de permettre sa modulation en fonction du travail d’insertion accompli par les structures.
Le présent projet de loi concerne des structures définies non par leur objet social – c’était le sens de la remarque de Bruno Sido, qui soulignait qu’un grand groupe pouvait se fixer un objectif d’utilité sociale sans pour autant être une entreprise de l’ESS – mais par leur mode d’entreprendre.
Revenons aux 40 % d’entreprises d’insertion qui sont des sociétés commerciales. Bon nombre d’entre elles vont se transformer en entreprises de l’ESS.
De quelles entreprises parlez-vous, monsieur Patriat ? De ces sociétés commerciales qui remontent une partie de leurs bénéfices vers la holding de tête. À nos yeux, leur situation ne justifie pas qu’elles bénéficient des fonds d’épargne salariale solidaire et des crédits de Bpifrance. Elles n’en ont pas besoin aujourd'hui.
Non, le Crédit agricole n’y aura pas droit.
Non, monsieur le sénateur, je vous assure que ce ne sera pas le cas.
Nous ne sommes pas dans une démarche d’exclusion. Je vais prendre un autre exemple. Une entreprise adaptée intègre au processus de production des salariés atteints d’un handicap plus léger que celui des personnes exerçant leur activité dans un établissement et service d’aide par le travail, un ESAT. Certaines de ces entreprises adaptées sont des sociétés commerciales et ne chercheront donc pas à devenir des entreprises de l’ESS. D’autres choisiront le modèle de gouvernance de l’économie sociale et solidaire et décideront de mettre une partie de leurs bénéfices en réserves impartageables.
Nous ne voulons pas préjuger de l’objet social des entreprises. Le projet de loi distingue un modèle entrepreneurial fondé sur des principes. À mes yeux, les acteurs de l’insertion par l’activité économique ont par nature vocation à intégrer l’ESS ; ils le feront pour l’immense majorité d’entre eux.
J’ajoute que ce n’est pas parce que certaines sociétés commerciales travaillant dans le secteur de l’insertion par l’activité économique remontent des dividendes vers la holding de tête que nous les dénoncerons ou que nous les montrerons du doigt. Au contraire, je les félicite du travail qu’elles accomplissent. Je dis seulement que le projet de loi vise à développer le modèle privé non lucratif et que les sociétés commerciales n’ont pas besoin des financements de l’ESS dans la mesure où elles ne sont pas non lucratives.
Oui à ces entreprises qui s’engagent fortement dans l’insertion ! Nous en sommes tellement persuadés que le Gouvernement a revalorisé l’aide au poste – il finance également davantage de postes – et rationalisé le financement du secteur de l’insertion par l’activité économique. Nous soutenons donc ce secteur. L’immense majorité des entreprises concernées font partie de l’ESS, mais nous ne considérons pas pour autant que les entreprises qui n’en font pas partie sont moins bonnes que les autres en termes d’objet social.
Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.

Je ne suis absolument pas convaincu par l’argumentation qui vient d’être développée. Je ne vois pas en quoi la gouvernance serait plus noble dans les grandes entreprises que j’ai citées que dans les petites entreprises d’insertion. À mon avis, la gouvernance de ces petites entreprises est bien plus sociale et paritaire.
Cependant, je suis prêt à rectifier mon amendement, qui viserait désormais à insérer un alinéa ainsi rédigé : « …°Par les personnes morales de droit privé désignées à l’article L. 5132–4 du code du travail qui ont pour objet l’insertion sociale et professionnelle » – je réponds ainsi à votre question, monsieur le ministre – « de personnes sans emploi, dès lors que leur capital n’est pas détenu à plus de 50 %, directement ou indirectement, par une autre personne morale de droit privé dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. » Cela permettrait d’éviter que les grandes entreprises – celles que vous redoutez, les trois que l’on cite toujours et dont je ne rappellerai pas les noms – ne soient incluses dans l’ESS.

Monsieur Patriat, je vous propose de revenir sur cette question lors de la deuxième lecture de ce projet de loi, car nous ne pouvons pas examiner votre nouvelle proposition dans ces conditions.

Ce ne serait pas la première fois que l’on rectifierait un amendement en séance !

Compte tenu de la nature de votre rectification, la commission devrait se réunir. C'est pourquoi il me semble préférable d’attendre la deuxième lecture.

J’entends bien les propos de François Patriat, car j’ai été sollicitée de la même manière que lui, en ma qualité de présidente du Conseil de l’insertion par l’activité économique.
Toutefois, je veux dire qu’il n’y a pas un article 1er qui affiche des lettres de noblesse et un article 7 qui désigne des sous-structures de l’ESS. Il faut très prudent : il ne s’agit pas d’établir une hiérarchie entre les diverses structures qui appartiennent à l’ESS. Je renvoie mon collègue et ami François Patriat à l’article 7, qui prévoit que les entreprises d’insertion, quel que soit leur statut, sont reconnues comme parties intégrantes de l’ESS dès lors qu’elles ont reçu l’agrément.
Je ne voterai donc pas cet amendement.
L’explication de Mme la rapporteur pour avis est très bonne.
J’ajouterai un autre élément : une entreprise de l’ESS n’a pas forcément d’utilité sociale. S’il se crée un jour une SCOP dans le secteur du tabac, quelle sera son utilité sociale ? En choisissant ce mode d’entreprendre, ses fondateurs placeraient leur entreprise dans le cadre de l’ESS. Je serais enclin à considérer que l’utilité sociale de cette structure tient au fait que l’entreprise appartienne aux salariés, même si, en termes de service rendu à la population, il faut bien admettre que l’utilité sociale d’une SCOP qui vendrait des cigarettes est assez faible.
Comme certains l’ont très bien dit, il existe des entreprises qui peuvent s’inscrire dans un marché concurrentiel tout en s’assignant une mission sociale. C’est d’ailleurs tout le sens de ce que l’on appelle le social business aujourd’hui, même s’il faut être très attentif à ce que ce ne soit pas un paravent et que cela ne serve pas surtout d’argument, en termes de communication financière, au moment où l’on se préoccupe de la cotation en bourse des actions.
Je suis favorable à ce que nous retravaillions la proposition de M. Patriat. En effet, si son amendement, qui vise à exclure les « trois grands », comme il dit, est adopté, je me demande combien d’entreprises seront finalement concernées par ce dispositif parmi les petites sociétés commerciales et les entreprises d’insertion. Je crains qu’elles ne se comptent sur les doigts de la main…
Non, monsieur Patriat, vous évoquez là les entreprises d’insertion. Je le répète, il y a beaucoup de sociétés, notamment les petites, qui pourront parfaitement s’intégrer dans le cadre de cette loi si elle est votée en l’état. C’est le cas notamment de bon nombre d’entreprises d’insertion.
À mon sens, la sagesse serait donc de suivre la proposition de M. le rapporteur et d’attendre la deuxième lecture.
Mme la rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales acquiesce.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le ministre et M. le rapporteur ont énormément travaillé sur ce texte, qu’ils connaissent par cœur, et, parfois, leurs explications sont quelque peu compliquées.
Pour ma part, j’ai peu travaillé sur ce projet de loi, mais, si j’ai bien compris, l’ESS est définie par le I de l’article 1er : c’est non pas parce que l’on a une activité sociale, mais parce que l’on respecte cette définition que l’on s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire.

Aussi, je ne comprends pas pourquoi M. Patriat s’obstine. Il importe d’entrer dans les canons du I de l’article 1er, quelle que soit l’activité concernée, car ce n’est pas l’objet social qui définit l’ESS.
Monsieur Patriat, j’en suis désolé, mais je ne voterai pas votre amendement.

Monsieur Patriat, qu’en est-il finalement de l’amendement n° 130 rectifié ?
L'amendement n'est pas adopté.

M. le président. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.
Exclamations.

Conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, M. le Premier ministre, par lettre en date du 5 novembre 2013, a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître l’avis de la commission du Sénat compétente sur le projet de nomination de M. Jean-Marc Lacave aux fonctions de président-directeur général de Météo France.
Cette demande d’avis a été renvoyée à la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire.
Acte est donné de cette communication.

M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le mercredi 6 novembre 2013, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil d’État avait adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du c) du 1° de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée (décision n° 371189 du 6 novembre 2013) (Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision) (2013 362 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.
Acte est donné de cette communication.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente-cinq.