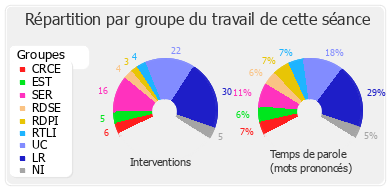Séance en hémicycle du 25 mai 2021 à 14h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Candidatures à des commissions
- Usages dangereux du protoxyde d'azote (voir le dossier)
- Suivi des condamnés terroristes sortant de détention (voir le dossier)
- Rappel au règlement (voir le dossier)
- Irresponsabilité pénale (voir le dossier)
- Ordre du jour (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à quatorze heures trente.

Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 20 mai 2021 a été publié sur le site internet du Sénat.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté.

J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication et de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale ont été publiées.
Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe Union Centriste, les explications de vote et le vote sur la deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote (proposition n° 488, texte de la commission n° 600, rapport n° 599).
La conférence des présidents a décidé que ce texte serait discuté selon la procédure de législation en commission prévue au chapitre XIV bis du règlement du Sénat.
Au cours de cette procédure, le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission, la séance plénière étant réservée aux explications de vote et au vote sur l’ensemble du texte adopté par la commission.
(Conforme)
Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« LIVRE VI
« LUTTE CONTRE LES USAGES DÉTOURNÉS ET DANGEREUX DE PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE
« TITRE IER
« LUTTE CONTRE LES USAGES DÉTOURNÉS ET DANGEREUX
« CHAPITRE UNIQUE
« Dispositions générales
« Art. L. 3611-1. – Le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d ’ un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 € d ’ amende.
« Art. L. 3611-2. – Une quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers de chaque produit mentionné à l ’ article L. 3611 -1 peut être fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l ’ économie.
« Art. L. 3611-3. – Il est interdit de vendre ou d ’ offrir à un mineur du protoxyde d ’ azote, quel qu ’ en soit le conditionnement. La personne qui cède un produit contenant un tel gaz exige du cessionnaire qu ’ il établisse la preuve de sa majorité. Les sites de commerce électronique doivent spécifier l ’ interdiction de la vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne de ce produit, quel que soit son conditionnement.
« Il est interdit de vendre ou d ’ offrir du protoxyde d ’ azote, y compris à une personne majeure, dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331 -1, L. 3334 -1 et L. 3334 -2 ainsi que dans les débits de tabac.
« Il est également interdit de vendre et de distribuer tout produit spécifiquement destiné à faciliter l ’ extraction de protoxyde d ’ azote afin d ’ en obtenir des effets psychoactifs.
« La violation des interdictions prévues au présent article est punie de 3 750 € d ’ amende.
« TITRE II
« PRÉVENTION DES USAGES DÉTOURNÉS ET DANGEREUX
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3621-1. – Une mention indiquant la dangerosité de l ’ usage détourné du protoxyde d ’ azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque unité de conditionnement des produits contenant ce gaz, qui ne peuvent être commercialisés sans cette mention.
« TITRE III
« CONTRÔLES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3631-1. – Les agents mentionnés à l ’ article L. 1312 -1 veillent au respect des articles L. 3611 -1 à L. 3611 -3 et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux mêmes articles L. 3611 -1 à L. 3611 -3.
« Ils disposent à cet effet des prérogatives qui leur sont reconnues par l ’ article L. 1312 -1 et par les textes pris pour son application.
« Ces agents peuvent, pour constater une infraction prévue aux articles L. 3611 -1 et L. 3611 -3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d ’ une photographie.
« Art. L. 3631-2. – Les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris ainsi que les agents de la Ville de Paris chargés d ’ un service de police, mentionnés respectivement aux articles L. 511 -1, L. 521 -1, L. 523 -1 et L. 531 -1 du code de la sécurité intérieure, peuvent constater par procès -verbal les infractions aux articles L. 3611 -2 et L. 3611 -3 du présent code et aux règlements pris pour leur application, lorsqu ’ elles sont commises sur le territoire communal, sur le territoire de la Ville de Paris ou sur le territoire pour lequel ils sont assermentés et lorsqu ’ elles ne nécessitent pas d ’ actes d ’ enquête de leur part.
« Ces agents peuvent, pour constater une infraction à l ’ article L. 3611 -3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d ’ une photographie. »
(Suppression conforme)
(Conforme)
La section 10 du chapitre II du titre I er du livre III du code de l ’ éducation est ainsi modifiée :
1° L ’ intitulé est complété par les mots : « et les conduites addictives » ;
2° À la première phrase de l ’ article L. 312 -18, les mots : « les conséquences de la consommation de drogues sur la santé » sont remplacés par les mots : « les conduites addictives et leurs risques ».
(Conforme)
Le livre VIII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le chapitre III du titre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Lutte contre les usages détournés et dangereux de produits de consommation courante
« Art. L. 3823-4. – Le livre VI de la présente partie, à l ’ exception du titre III, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 3823-5. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au deuxième alinéa de l ’ article L. 3611 -3, les mots : “dans les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331 -1, L. 3334 -1 et L. 3334 -2” sont remplacés par les mots : “dans des lieux de consommation de boissons soumis à la réglementation locale”.
« Art. L. 3823-6. – Les infractions aux prescriptions des articles L. 3611 -1 à L. 3611 -3 et aux règlements pris pour leur application sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément au code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés à l ’ article L. 1421 -1 du présent code.
« À cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévues aux articles L. 1421 -2 et L. 1421 -3.
« Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3611 -1 et L. 3611 -3, exiger que le cessionnaire établisse la preuve de sa majorité par la production de tout document officiel muni d ’ une photographie. » ;
2° (Supprimé)

Avant de mettre aux voix l’ensemble du texte adopté par la commission, je vais donner la parole, conformément à l’article 47 quinquies de notre règlement, au Gouvernement, puis au rapporteur de la commission, pendant sept minutes, et, enfin, à un représentant par groupe pendant cinq minutes.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Madame la présidente, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, chère Jocelyne Guidez, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureux de clore avec vous aujourd’hui le chapitre parlementaire concernant cette proposition de loi tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote.
Je souhaite avant tout remercier chaleureusement son auteure, la sénatrice Valérie Létard, dont l’engagement et la maîtrise auront permis de mettre ce sujet sur la table, d’en faire un véritable objet politique et d’aboutir à un texte qui, rapidement, pourra produire de pleins et utiles effets.
Je me permets également de saluer la présence en tribune de la députée Valérie Six, qui a aussi travaillé sur ce texte. Il m’importe de souligner l’intelligence collective, la collaboration importante, utile, efficace, entre le Sénat et l’Assemblée nationale à cette occasion.
Je sais que les habitants des régions les plus touchées par le phénomène d’usage détourné du protoxyde d’azote sont nombreux à attendre avec impatience l’entrée en vigueur de cette loi. À Tourcoing et dans d’autres villes, on ne connaît que trop bien les ravages que peut causer ce geste d’apparence anodine, qui consiste à aspirer une petite quantité de gaz issu d’un banal contenant. Un geste, qui, reproduit deux, trois, dix, parfois des douzaines de fois peut en effet causer chez son auteur des problèmes physiques et neurologiques extrêmement graves.
Ce produit de consommation courante, utile à certains professionnels ou à certains cuisiniers amateurs, souffre aujourd’hui d’une bien mauvaise réputation. Il faut dire que la documentation est étoffée sur ses détournements. On l’a vu utilisé dans des bars, dans des soirées étudiantes, dans des fêtes foraines ; on l’a vu vendu par des buralistes ou facilement accessible sur internet, dans des emballages dont le marketing ne laissait pas de place au doute quant à l’usage qui en serait fait ; on a vu des mineurs en consommer, parfois encouragés par des adultes inconscients des risques ou à l’insouciance qui frôle la mise en danger d’autrui.
Il était devenu insupportable pour les responsables politiques et pour les autorités sanitaires de constater une telle déconnexion entre les comportements des individus et les risques avérés.
Je rappelle que le ministère de la santé avait publié deux communiqués de presse qui alertaient sur les risques liés à cet usage détourné, en novembre 2019 puis en juillet 2020, à l’occasion de la publication des données de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).
Une campagne d’information et de réduction des risques avait par ailleurs été lancée pour toucher directement non seulement les consommateurs, y compris les plus jeunes, mais aussi les acteurs de terrain : associations, collectivités locales, encadrants et personnes en lien avec les jeunes.
Bien sûr, il fallait que cela s’accompagne d’un changement législatif. En ce sens, cette proposition de loi a été plus que bienvenue, à un moment important. Tout son parcours plaide d’ailleurs en sa faveur. Si le temps a pu paraître long depuis son premier examen, ici même au Sénat, la faute n’est pas à chercher, une fois n’est pas coutume, du côté d’éventuelles dissensions politiques. Les avis, au contraire, ont été très largement partagés sur l’opportunité d’avancer et, globalement, sur les termes des mesures à mettre en œuvre.
Sénat et Assemblée nationale ont chacun apporté leur contribution à ce texte, contribution que le Gouvernement a estimée parfaitement utile et cohérente : des délits précis ont été créés ; des peines adaptées, prévues ; des situations et des lieux déterminés, ciblés. Ce texte est aujourd’hui équilibré, et ce à double titre, comme j’ai eu l’occasion de le dire en commission la semaine passée.
D’une part, il maintient évidemment l’autorisation de consommation de ce produit, qui n’est ni un stupéfiant ni un produit toxique, mais un produit d’usage courant. En même temps, il enjoint les pouvoirs publics de contrôler précisément les usages détournés qui peuvent en être faits.
D’autre part, il porte un message puissant de prévention et de protection des mineurs, et accorde en même temps une attention particulière à la responsabilisation des majeurs.
Ce volet de prévention est évidemment incontournable. Nombre d’entre vous, en commission des affaires sociales, la semaine dernière, avaient soulevé ce sujet. Avec des acteurs comme la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca), l’ANSM, l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, des travaux fondamentaux sont menés pour sensibiliser les publics les plus jeunes aux risques éventuels auxquels ils s’exposent avec de telles pratiques. Parents, amis, équipes éducatives : toutes et tous doivent également en être informés.
Cette prévention doit aussi se faire à l’égard d’autres produits, car les mésusages se déplacent régulièrement vers d’autres substances, par effet de mode ou du fait de l’interdiction d’une pratique particulière, comme c’est justement le cas en l’espèce.
Les pouvoirs publics sont et resteront pleinement mobilisés sur ces enjeux, autour du ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, et à travers un réseau puissant, structuré, notamment par les agences régionales de santé (ARS).
Je rappellerai, pour conclure, que des dispositifs d’aide sont à disposition des jeunes, de leurs entourages et du public en général, car la loi n’est jamais stigmatisante. Elle est faite avant tout pour protéger et accompagner les publics à risque. Il ne faut donc pas hésiter à se saisir de ces différents outils en cas de questions ou de difficultés liées à la consommation de produits ou de drogues. Je pense évidemment aux consultations jeunes consommateurs (CJC), qui proposent un service d’accueil, d’écoute, de conseil et d’orientation. Ce service, assuré par des professionnels des addictions, est dédié aux jeunes ; il est entièrement gratuit et confidentiel.
Je pense également à des dispositifs d’aide à distance, en l’espèce à drogues-info-service.fr, qui est devenu un site de référence à cet égard, ou encore à des démarches locales, évidemment, que vous êtes nombreux à connaître, à encourager, quand vous n’en avez pas été à l’origine.
Mesdames, messieurs les sénateurs, c’est en agissant par cette pluralité de canaux que nous arriverons à véritablement protéger nos concitoyens de dangers, que, trop souvent, ils ignorent ou minimisent.
Ne relâchons pas notre vigilance, à l’instar de Mme la sénatrice Valérie Létard, que je remercie de son action. Je remercie enfin l’ensemble de la représentation nationale d’avoir apporté son soutien à ce texte, qui va maintenant pouvoir entrer rapidement et pleinement en vigueur.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, c’est en grande partie grâce à Valérie Létard que tout le monde le sait désormais : l’usage détourné du protoxyde d’azote à des fins récréatives est une pratique dangereuse, au succès inquiétant. Elle est d’autant plus dangereuse que ceux qui s’y livrent ignorent sa dangerosité, et son succès est d’autant plus inquiétant qu’il concerne essentiellement les mineurs et les jeunes majeurs.
La proposition de loi tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote, ainsi que les députés l’ont rebaptisée, n’a jamais été si proche de son entrée en vigueur, et je suis convaincue qu’elle permettra de lutter efficacement contre ce fléau.
D’abord, la vente de ce produit sera mieux encadrée, puisqu’elle sera interdite aux mineurs ainsi qu’aux majeurs dans les débits de boissons et les débits de tabac. La vente des ustensiles liés à l’usage récréatif du gaz sera également interdite, et une quantité maximale de vente aux particuliers sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la santé.
Ensuite, la prévention sera renforcée par la mention obligatoire, sur les contenants du gaz, de la dangerosité de son usage détourné, et par le renforcement des modules de prévention aux conduites addictives organisés dans le cadre scolaire.
Enfin, parce qu’il faut enrayer la propagation de ce qui est vu, bien à tort, comme un loisir anodin, la provocation d’un mineur à faire un usage détourné du protoxyde d’azote, et plus largement de tout produit pour en obtenir des effets psychoactifs, sera pénalisée.
Nous pouvons sans doute regretter que l’Assemblée nationale ait renoncé à la mise à contribution des intermédiaires numériques dans la prévention des usages dangereux en supprimant un article jugé ambigu.
Nous pouvons aussi déplorer que le Gouvernement n’ait pas souhaité étendre le délit de provocation aux majeurs.
Nous pourrions enfin désapprouver le fait que l’interdiction de vente n’ait pas été étendue aux stations-services, comme cela avait été proposé en séance publique par les députés, ou que la question de la consommation de protoxyde d’azote au volant n’ait pas été abordée.
À cela s’opposaient des arguments juridiques, pratiques ou politiques, mais, au fond, ne dit-on pas que le mieux est l’ennemi du bien ?
Pour bien faire, il est grand temps que ces premières dispositions s’appliquent. Ce texte a en effet été déposé au Sénat en avril 2019. Nous l’avons adopté à l’unanimité en décembre 2019, tandis que l’Assemblée nationale l’a voté, à l’unanimité encore, en mars 2021, avant qu’il ne nous revienne deux mois plus tard. Il aura ainsi fallu plus de deux ans, mes chers collègues, pour que l’encadrement minimal d’un produit à la dangerosité avérée puisse entrer en vigueur. Il faudra encore un peu de temps avant que la Commission européenne ne donne son autorisation à de telles restrictions d’échange d’un produit de consommation courante.
Cela se comprend, et je ne plaide assurément pas contre le temps de la réflexion parlementaire ; mais peut-être aurions-nous pu tirer plus tôt ou plus vite les conséquences qui s’imposaient de l’observation d’un phénomène de mode que les Britanniques, notamment, connaissent bien depuis de nombreuses années déjà. En attendant, l’usage récréatif de ce gaz est à présent devenu un segment comme un autre de l’économie des stupéfiants, avec ses grossistes avisés, ses intermédiaires spécialisés et son marketing agressif.
Quoi qu’il en soit, ce texte permettra de lui porter les premiers coups. Réjouissons-nous que le Gouvernement se soit rangé à l’analyse clairvoyante de Valérie Létard ; remercions Valérie Six et nos collègues députés de leur remarquable contribution à l’efficacité du dispositif, et saluons le travail des élus locaux, qui restent en première ligne dans le maintien de l’ordre public.
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la satisfaction l’emporte donc sur les regrets, mais c’est encore une satisfaction inquiète : alors que nous sortons péniblement d’une situation de crise sanitaire sans précédent, et que les alertes sur la santé mentale des jeunes se multiplient, nous pouvons sans doute les empêcher, dans une certaine mesure, de se détruire en altérant leur santé. Contribuer à leur bonheur reste un défi d’une autre ampleur.
Applaudissements.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, quel maire, quel membre des forces de l’ordre, quel enseignant n’a pas entendu parler des cartouches dites de gaz hilarant, qui, une fois utilisées, jonchent l’espace public de certains quartiers ?
Originellement utilisé comme gaz de pressurisation d’aérosol alimentaire, le protoxyde d’azote, aux effets euphorisants, est aujourd’hui massivement utilisé comme drogue récréative par les jeunes.
Cette nouvelle mode constitue un réel danger pour leur santé. L’évolution de ces pratiques s’accompagne, en effet, d’une augmentation du nombre de signalements d’effets sanitaires graves, avec des atteintes du système nerveux central et de la moelle épinière, comme l’ont souligné les experts de l’ANSM.
L’Occitanie figure parmi les trois régions qui comptent le plus d’intoxications au gaz hilarant.
L’été dernier, dans mon département de l’Hérault, des communes, en particulier littorales, ont connu durant la saison touristique une vague de violences graves et une hausse importante des incivilités, des comportements intolérables souvent causés par cet usage détourné du protoxyde d’azote. Un certain nombre de maires ont ainsi dû prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs de police, des arrêtés municipaux interdisant l’utilisation de ce gaz dans l’espace public.
Afin d’apporter une réponse concrète à cette réalité de terrain, qui alerte de plus en plus les acteurs locaux, élus, professionnels de la santé, mais aussi les forces de l’ordre, nous avons adopté à l’unanimité, le 11 décembre 2019, la proposition de loi présentée par notre excellente collègue Valérie Létard et plusieurs autres sénateurs de groupes politiques différents, tendant à protéger les mineurs des usages dangereux de cette drogue – car c’est ainsi qu’il faut l’appeler – qu’est le protoxyde d’azote.
J’avais à l’époque proposé deux amendements, qui avaient été adoptés par la commission des affaires sociales. J’en profite pour vous en remercier de nouveau, madame la présidente de la commission.
D’une part, il s’agissait d’interdire la vente de protoxyde d’azote par les sites de commerce électronique. D’autre part, je souhaitais que soit dispensée une information sur les risques pour la santé de son usage détourné dans les établissements scolaires.
L’Assemblée nationale a adopté cette proposition de loi à l’unanimité le 25 mars dernier, preuve d’un large consensus sur ce sujet.
Ce texte va donc modifier le code de la santé publique, en prévoyant que le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante, tel que le protoxyde d’azote, pour en obtenir des effets psychoactifs, sera désormais puni de 15 000 euros d’amende.
De même, il sera interdit de vendre ou d’offrir à un mineur du protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement. Les sites de commerce en ligne devront spécifier l’interdiction de la vente aux mineurs de ce produit sur les pages permettant de procéder à un achat en ligne.
Par ailleurs, une mention indiquant la dangerosité de l’usage détourné du protoxyde d’azote sera apposée sur chaque unité de conditionnement.
Je me félicite de ce que le texte conserve la mesure de renforcement de la prévention dans le cadre scolaire. L’information dispensée dans les établissements scolaires, déjà prévue pour la consommation de drogues, devra ainsi inclure les dangers de l’usage détourné du protoxyde d’azote.
Enfin, à l’instar de Mme la rapporteure au nom de la commission, dont je tiens à saluer le travail, je regrette l’absence d’obligation d’information des internautes au moment de l’achat de ces produits. Monsieur le secrétaire d’État, je forme le vœu qu’une réponse puisse être apportée dans un avenir proche.
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, face au double problème que pose l’usage détourné de ce gaz hilarant, en matière à la fois de santé publique et de maintien de l’ordre, nous ne pouvons que nous féliciter de ce que cette proposition de loi puisse être adoptée définitivement, aujourd’hui, par notre assemblée. Vous l’aurez compris, le groupe Les Républicains votera en faveur de ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Valérie Létard applaudit également.

La parole est à M. Alain Marc, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, notre assemblée examine en nouvelle lecture la proposition de loi, présentée par Valérie Létard, visant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote.
Ce produit peut être acheté, pour une somme modique, par n’importe qui, en supermarché, bureau de tabac ou sur internet. Sa facilité d’accès, ajoutée à la publicité sur ses effets hilarants diffusée sur les réseaux sociaux, a popularisé son usage détourné comme un produit récréatif et festif chez des mineurs de plus en plus jeunes.
Si la proposition de loi cible plus particulièrement les mineurs, la moyenne d’âge des consommateurs est de 21 ans. Sa consommation, souvent en groupe, peut aller jusqu’à 200 capsules par jour. Le gaz a une action immédiate et agit sur une courte durée. La plupart des consommateurs ignorent les conséquences de cette drogue, souvent prise en association avec de l’alcool ou d’autres stupéfiants. Les centres antipoison rapportent des risques d’asphyxie, de coma et d’atteintes neurologiques et neuromusculaires graves.
Le principal problème est la facilité avec laquelle les jeunes consommateurs ont la possibilité de se procurer ce gaz en achetant des siphons à chantilly commercialisés librement en magasin et sur internet. En effet, son utilisation n’est soumise à aucune restriction, en dehors de quelques arrêtés municipaux dont la portée reste limitée.
Le texte que nous examinons entend combler ce vide juridique pour protéger le jeune public des intoxications au protoxyde d’azote. Le cœur du texte vise à interdire la vente de gaz hilarant aux mineurs et à pénaliser l’incitation d’un mineur à en faire un usage détourné. Des éléments d’information sur la dangerosité du produit seront désormais obligatoirement visibles sur les emballages, ainsi que sur chaque siphon. Par ailleurs, la proposition de loi prévoit une campagne de sensibilisation spécifique en milieu scolaire, étendue à l’ensemble des pratiques addictives.
L’Assemblée nationale a contribué à enrichir les dispositions du texte en étendant l’interdiction de vendre du protoxyde d’azote aux mineurs à tous les lieux. Elle a aussi visé les ballons et les objets dédiés à cette consommation détournée.
Ces dispositions vont permettre de protéger une partie des consommateurs des risques liés à la consommation de cette substance. Je rappellerai néanmoins que la moyenne d’âge des consommateurs est de 21 ans. Aussi, cette proposition de loi ne sera pas suffisante pour réduire les usages et prévenir les risques, notamment chez les jeunes majeurs. L’interdiction du produit se heurterait au droit européen, mais nous pouvons utilement limiter le nombre de cartouches que peut acheter un particulier, comme l’a fait le Danemark, confronté au même problème.
Parallèlement, nous devons renforcer nos moyens de lutte contre le commerce illégal. Ces derniers mois, deux réseaux de trafic de gaz hilarant ont ainsi été démantelés en Seine-Saint-Denis.
Comme nous l’avons souligné en commission, la prévention des addictions reste un volet essentiel pour protéger les mineurs et les jeunes adultes de pratiques dangereuses. Elle doit se faire en lien avec les associations de terrain.
Enfin, face au développement de la vente de produits stupéfiants sur les réseaux sociaux et sur les messageries privées, nous devons mettre en œuvre un accompagnement à la parentalité à travers le numérique.
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants – République et Territoires soutient pleinement cette démarche et votera en faveur de cette proposition de loi.
Mme Valérie Létard applaudit.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, bien que centrée sur la prévention des usages dangereux du protoxyde d’azote, cette proposition de loi s’avère en fait générique et pourra s’appliquer à tout mésusage d’un produit de consommation courante pour la recherche d’effets psychoactifs.
Adoptée à l’unanimité par nos deux assemblées en première lecture, elle marque des avancées certaines quant à la prévention de cette conduite addictive qui a tendance à progresser, quelquefois parallèlement à la consommation d’autres produits, en raison de sa facilité d’accès, de son faible coût et de sa prétendue innocuité.
Ce phénomène inquiète les professionnels de santé, les pouvoirs publics et les élus locaux, d’autant qu’il touche un public de plus en plus jeune.
En 2018, l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies nous alertait, car la consommation se banalisait, en parfaite méconnaissance des risques associés en matière de santé : effets immédiats, comme des pertes de connaissance, chutes ou asphyxies, et, en cas de consommation récurrente, des complications neurologiques ou des carences en vitamine B12.
Les élus et les associations observent la banalisation de cet usage récréatif, que révèle notamment la présence de déchets de capsules métalliques après des rencontres festives, des festivals et même des soirées d’étudiants en médecine à Lyon, Bordeaux ou Paris.
Il n’est pas rare de voir des « bars à proto », où les jeunes achètent directement des ballons, à côté de débits de boissons.
En février, le centre d’addictovigilance de Lyon et l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes appelaient à une nouvelle campagne de sensibilisation sur les risques encourus par les jeunes consommateurs, ayant constaté « la [récente] recrudescence, au niveau de la métropole lyonnaise, des signalements d’atteinte neurologique, ainsi que la présence visible de bonbonnes dans l’espace public ». Pour le centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues de Lyon, l’usage, installé depuis longtemps, est aujourd’hui plus fréquent. Originellement festif, il est devenu solitaire ou se fait en petit groupe, et les étudiants pris en charge étaient, pour la plupart, déjà consommateurs au lycée, voire au collège.
Cette situation appelait donc une régulation. Tel est l’objet de ce texte.
En encadrant la vente de ce gaz, y compris pour les publics majeurs, cette proposition de loi apporte une réponse aux élus locaux, démunis face à ce problème de santé publique. Il ne sera ainsi plus nécessaire que des maires prennent des arrêtés d’interdiction qui ne relevaient pas de leur compétence et qui, dès lors, ne pouvaient être efficaces.
Néanmoins, précisons que les interdictions ne font pas tout. Le texte, heureusement, ne s’y limite pas.
L’usage de ce produit n’est pas que ponctuel. Ainsi, chez certains s’est installée une véritable dépendance. D’ailleurs, la progression des signalements sanitaires durant la crise du covid-19 sonne comme une alerte sur une conduite devenue addictive pour une partie des usagers.
Pour ceux-là, il est essentiel de traiter la relation qu’ils entretiennent avec le produit, au-delà du produit lui-même, qui peut être remplacé par un substitut.
Notre action doit s’inscrire dans une politique ambitieuse de prévention et de réduction des risques, qui doit notamment prendre en compte les conséquences sur la santé mentale de la crise sanitaire.
Le Portugal, qui a décriminalisé en 2000 la consommation individuelle de toutes les drogues et privilégié l’accompagnement à la sanction, a obtenu des résultats concluants. Cette politique s’avère être un succès.
Les associations de terrain appellent à multiplier les solutions de prévention et d’accompagnement des consommateurs, avec notamment la mise en place de structures spécialisées et un suivi social renforcé. Aussi, nous saluons l’équilibre de ce texte, qui appuie sur la prévention et l’information, via l’étiquetage, et sur des actions de sensibilisation en milieu scolaire sur les risques de ces consommations. Néanmoins, nous resterons attentifs aux moyens accordés à la politique de prévention et de réduction des risques.
Considérant qu’il s’agit d’une réponse nécessaire et équilibrée à un problème de santé publique, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – Mme Valérie Létard et M. Bernard Jomier applaudissent également.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Duranton, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
M. François Patriat applaudit.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, j’adresse un grand merci à Valérie Létard de s’être emparée de ce sujet essentiel. Beaucoup de choses ont déjà été dites et je risque d’être dans la répétition.
Le protoxyde d’azote est, à l’origine, un gaz à usage médical, utilisé pour ses propriétés analgésiques. Il sert également comme propulseur pour les siphons à chantilly. Ce produit bon marché est en vente libre sur internet et dans le commerce.
Cependant, le protoxyde d’azote, ou N2O, est surtout connu de nos jeunes comme le « proto », un gaz hilarant à effet euphorisant. Son usage détourné consiste à inhaler le gaz par le biais d’un ballon, après avoir « craqué » la cartouche pour l’ouvrir.
Malheureusement, cette consommation n’est pas sans risque : l’inhalation du protoxyde d’azote peut provoquer des brûlures, une asphyxie, voire une perte de connaissance, des intoxications, des effets cliniques, principalement neurologiques, allant jusqu’à des atteintes de la moelle épinière, mais aussi cardiaques et psychiatriques.
L’arrêté du 17 août 2001 l’inscrit sur la liste I des substances vénéneuses ; il est ensuite soumis à une réglementation stricte par l’arrêté du 21 décembre 2001.
Pour lutter contre ce fléau, les pouvoirs publics français pointent la nécessité de conduire des actions de sensibilisation. Actuellement, seul le détournement du protoxyde d’azote à usage médical est encadré par la loi. En revanche, celui à usage domestique n’est soumis à aucune restriction. Le texte que nous examinons aujourd’hui vise à corriger ce vide juridique.
Depuis 2017, de nombreuses petites cartouches grises contenant ce gaz sont retrouvées dans l’espace public, comme le souligne l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies dans son rapport publié en décembre 2018. Ce phénomène traduit une banalisation de sa consommation, qui, selon une étude de la mutuelle SMEREP, serait le troisième produit psychoactif le plus consommé chez les jeunes.
Les collectivités locales s’investissent déjà fortement dans la prévention. Par exemple, dans mon département de l’Eure, le maire de Vernon, François Ouzilleau, a pris en 2020 un arrêté municipal interdisant la vente ou le don de cartouche ou de tout autre récipient contenant du protoxyde d’azote à une personne mineure non accompagnée d’un adulte. Une amende de 68 euros est prévue pour la détention, l’utilisation et le dépôt de cartouche dans l’espace public. Cela faisait plusieurs mois que la police municipale de Vernon, les services de la voirie et de la propreté urbaine constataient l’augmentation du nombre de cartouches au sol dans certains endroits de la ville. Au-delà du risque pour la santé publique, elles constituent également une pollution environnementale critique.
Cette proposition de loi issue du Sénat a été votée à l’unanimité en première lecture à l’Assemblée nationale, qui en a adopté les éléments essentiels, notamment l’interdiction de vente aux mineurs de produits contenant du protoxyde d’azote et la pénalisation de l’incitation d’un mineur à en faire un usage détourné.
L’Assemblée nationale a adopté, en commission des affaires sociales, puis en séance, plusieurs amendements tendant à renforcer les mesures présentes dans le texte initial. Je pense à la vente de crackers, à l’étiquetage « danger » sur le produit et aux précisions apportées pour la mise en œuvre du texte à Wallis-et-Futuna. D’autres amendements adoptés avaient pour objet de mobiliser les agents de police municipale pour les actions de prévention.
Depuis juillet 2019, sous l’impulsion conjointe du ministère de la santé et de celui de l’éducation nationale, l’ensemble des collèges et lycées de France met progressivement en place des partenariats avec des consultations jeunes consommateurs, qui offrent aux jeunes et à leur entourage un service d’écoute et d’orientation totalement gratuit et confidentiel.
Une campagne d’information de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) vise pour sa part à doter les acteurs de terrain – associations et collectivités locales – de supports de sensibilisation clairs et adaptés.
La présente proposition de loi a aussi pour objet de renforcer la prévention et la meilleure information des jeunes fréquentant les établissements scolaires sur les risques de l’usage détourné du N2O.
La Mildeca a lancé en juin 2020 une campagne sur les réseaux sociaux. Monsieur le secrétaire d’État, quelles mesures supplémentaires le Gouvernement envisage-t-il de prendre sur internet pour informer les jeunes des risques de l’usage détourné du N2O sur leur santé ?
En conclusion, je souligne que le protoxyde d’azote représente, sous des airs légers, un véritable danger pour nos jeunes. Ce texte englobe l’ensemble des aspects d’une prévention efficiente et d’une dissuasion nécessaire pour protéger les mineurs. L’importance de cette proposition de loi est reconnue de tous ; plusieurs sénateurs de mon groupe et moi-même étions d’ailleurs cosignataires de ce texte.
Compte tenu de ces éléments et du souhait partagé d’une mise en œuvre rapide des dispositifs prévus dans cette proposition de loi, le groupe RDPI votera en faveur du texte issu des travaux de la commission, de manière à en assurer l’adoption définitive.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Mme Valérie Létard applaudit également.

La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, alors que, depuis 2017, les mésusages du protoxyde d’azote connaissent une recrudescence dans notre pays, nous voici réunis afin d’examiner en deuxième lecture une proposition de loi plus que jamais nécessaire. Je voudrais avant tout saluer son auteure, Valérie Létard.
Le confinement a accru la prévalence des comportements addictifs dans leur ensemble, y compris l’usage détourné du protoxyde d’azote, comme le relève l’Association française des centres d’addictovigilance dans son bulletin de novembre 2020.
Le déconfinement a quant à lui eu pour effet de rendre cet usage plus visible, dans la mesure où il occasionne divers troubles à l’ordre public, à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité. Ces troubles se manifestent par le bruit et par l’abandon de cartouches et de ballons dans les rues ; on peut encore relever, tout récemment, l’explosion d’une voiture occupée par cinq adolescents qui consommaient du protoxyde d’azote.
De nombreux maires nous alertent régulièrement sur cette situation ; certains d’entre eux ont pris des arrêtés interdisant la consommation ou la vente de protoxyde d’azote sur le territoire de leur commune, sans véritable effet.
L’Assemblée nationale a souscrit à l’économie générale du texte et a décidé de maintenir en grande partie les éléments introduits par le Sénat ; avec le groupe du RDSE, je m’en réjouis.
Elle a toutefois adopté plusieurs modifications à l’article 2, notamment en introduisant un plafonnement de la quantité maximale de protoxyde d’azote pouvant être vendue aux particuliers, plafond qui sera fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’économie. Cette mesure va certes dans le bon sens.
Il convient toutefois de s’assurer que la restriction posée n’est pas excessive au regard de l’objectif recherché. Comme l’a rappelé notre rapporteure Jocelyne Guidez, cet arrêté ministériel ne pourra être pris qu’après avis de la Commission européenne. Le plafond sera par ailleurs déterminé au terme d’une réflexion conjointe avec les acteurs concernés. Ces éléments nous semblent de nature à garantir que ce plafonnement sera raisonnable.
L’Assemblée nationale a également élargi aux débits de boissons temporaires l’interdiction de vente ou d’offre de protoxyde d’azote aux personnes majeures. Cette extension de l’interdiction au-delà des débits de boissons initialement visés nous semble pertinente et conforme à l’esprit du texte, tout comme l’interdiction de la vente et de la distribution de tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en recevoir des effets psychoactifs.
L’article 2 apporte en outre une clarification : c’est bien la dangerosité de l’usage détourné du protoxyde d’azote et non l’usage du gaz en lui-même qui doit faire l’objet d’un étiquetage dédié sur chaque unité de conditionnement. En effet, dans des conditions normales d’utilisation, le gaz est employé à des usages médicaux, culinaires et industriels qu’il convient bien évidemment de préserver.
Ce même article prévoit que la constatation des infractions aux interdictions de vente pourra être aussi réalisée par les agents de police municipale, les gardes champêtres, ainsi que les agents de surveillance de la Ville de Paris. Cette extension va dans le bon sens ; encore faut-il que les forces de l’ordre soient présentes en effectifs suffisants, ce qui n’est pas le cas dans bon nombre de nos territoires.
L’article 2 bis permettait de renforcer les obligations applicables aux intermédiaires numériques d’informer sur les interdictions de vente aux mineurs de certains produits. Il a été supprimé par les députés. Nous le déplorons, car l’information et la responsabilisation des usagers restent, en matière de santé, les premières des priorités.
Enfin, les députés ont modifié l’intitulé du texte : cette proposition de loi tendait auparavant « à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d’azote » ; elle tend désormais « à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote ». En effet, cet intitulé élargi permettra aussi de mieux protéger les jeunes majeurs : nous ne pouvons qu’accueillir favorablement ce progrès.
Cette proposition de loi constitue une belle avancée, que nous saluons sans réserve. Elle contribue à la sensibilisation des jeunes sur les conduites addictives ; elle permet d’informer sur la dangerosité de ce produit détourné de son usage ; elle punit la provocation d’un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ; enfin, elle interdit sa vente et son offre à des mineurs, dans les commerces physiques comme en ligne.
Détourner un produit de consommation de son usage est une pratique qui ne concerne pas seulement le protoxyde d’azote. Malheureusement, l’innovation en la matière est sans limites ! Nous ne pouvons qu’appeler le Gouvernement à aller encore plus loin dans les domaines de la prévention, de l’aide à la parentalité et de la sensibilisation dès le plus jeune âge.
Pour l’heure, au regard de l’équilibre trouvé dans ce texte, le groupe du RDSE votera en faveur de cette proposition de loi, avec enthousiasme et sans réserve.
Mme Valérie Létard, M. François Patriat et Mme la rapporteure applaudissent. – M. Jean-Pierre Grand approuve.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’usage détourné du protoxyde d’azote, autrefois limité à certains milieux, notamment les facultés de médecine, est devenu une triste banalité : nombreuses sont les villes à voir des cartouches joncher les trottoirs. Ce phénomène touche particulièrement la région des Hauts-de-France, mais il concerne l’ensemble du territoire national et un public de plus en plus jeune.
La consommation se banalise. Il nous faut donc, plus que jamais, alerter dès le plus jeune âge. Nous savons que l’expérimentation peut, dans un second temps, se transformer chez ces jeunes en une solution à leur mal-être et devenir le moyen de supporter une période difficile. Or nous venons justement de vivre une telle période, propice à de tels phénomènes, et ce dans tous les milieux, à l’évidence. Plus que jamais, il nous faut donc favoriser la prévention.
Aujourd’hui, des sites de commerces en ligne, en proposant des lots de bonbonnes de grande capacité, ne font même plus semblant de destiner ces cartouches à la fabrication de crème chantilly.
Faites comme moi l’expérience d’effectuer une recherche sur internet ; quand j’ai tapé « gaz hilarant », une alerte publicitaire s’est affichée indiquant : « Oubliez les soirées ennuyeuses, essayez le gaz hilarant ! Livraison à domicile en 30 minutes ! Notre épicerie vous garantit une soirée pleine de fou rire ! » Parmi les produits proposés, on trouve des tanks de 4 litres, pour 150 euros !
Alors, que pouvons-nous faire, en tant que parlementaires, face à ce détournement d’un produit de consommation alimentaire ?
Notre collègue Valérie Létard, dont je tiens à saluer l’engagement sur ce sujet, a proposé d’agir en interdisant la vente de protoxyde d’azote aux mineurs et en créant un délit de provocation des mineurs à cet usage.
Nous sommes favorables à ces mesures de répression si un équilibre est maintenu avec des mesures de prévention.
Les mesures restrictives sont nécessaires, mais peuvent se révéler inefficaces si elles ne sont pas accompagnées d’une politique de prévention offensive.
L’outil le plus efficace pour sensibiliser les jeunes sur les effets de cet usage du gaz hilarant demeure un discours de santé publique qui informe sur les risques posés par la consommation de ce gaz. On pourrait faire appel à des jeunes formés sur les risques du protoxyde d’azote, qui iraient à la rencontre d’autres jeunes sur les lieux de consommation connus. Des jeunes qui s’adressent à d’autres jeunes, avec un message d’information sur les risques, sans stigmatisation : ce modèle a fait ses preuves, par exemple, sur le VIH.
C’est la raison pour laquelle nous demandons au Gouvernement de soutenir cette proposition de loi en créant, dès le prochain projet de loi de finances rectificative pour 2021, une ligne budgétaire venant financer une campagne nationale de prévention contre l’usage du protoxyde d’azote.
Si une impulsion nationale n’était pas portée par les ministères de la santé et de l’éducation nationale, le Gouvernement ferait la démonstration du peu d’intérêt qu’il porte pour nos jeunes.
En conclusion, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera pour cette proposition de loi, comme nous l’avions fait en première lecture.
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST. – Mme Valérie Létard applaudit également.

La parole est à M. Bernard Jomier, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, à ce stade de notre discussion, je commencerai mon intervention en vous annonçant que je souscris aux propos qui ont été tenus par les précédents orateurs. Je veux à mon tour remercier Valérie Létard d’avoir déposé ce texte utile, pour lequel nous avions déjà voté en première lecture. Il n’y a pas de suspense : nous le voterons de nouveau en deuxième lecture !
Oui, le protoxyde d’azote est un problème. J’ai été très marqué par l’étude réalisée à l’université de Bordeaux auprès de plus de 10 000 étudiants : on y apprend que 13 % d’entre eux sont des consommateurs actifs de protoxyde d’azote et que plus de 25 % en ont déjà consommé. Cela dit bien l’ampleur du problème.
Une deuxième donnée, encore plus récente, vient confirmer ce diagnostic : il y a quinze jours, à Rosny-sous-Bois, on a saisi 1 218 bouteilles de protoxyde d’azote. Cela aussi dit l’ampleur du problème. Des réseaux très bien organisés trouvent là une source de revenus bien moins risquée pénalement que le trafic d’autres substances.
Il faut donc commencer à encadrer plus strictement le protoxyde d’azote. Ce n’est pas simple, car ce produit n’est pas illégal ; il est autorisé. Je remercie donc encore une fois Valérie Létard de s’être attelée à cette tâche.
En revanche, comme j’ai eu l’occasion de le dire lors des travaux de notre commission, tout le monde conviendra qu’une approche par le produit ne peut être satisfaisante à elle seule. Cette proposition de loi est nécessaire et utile, elle ne peut être suffisante.
C’est bien la politique de notre pays sur les addictions qui est mise en question. Écoutons les dernières déclarations gouvernementales en la matière : le dernier ministre que j’ai entendu s’exprimer à ce sujet est le ministre de l’intérieur, qui a déclaré : « La drogue, c’est de la merde. » On le remercie pour sa contribution à la résolution du problème !
Rires sur plusieurs travées.

Le ministre de la santé est actuellement très occupé ; il ne s’est donc pas exprimé récemment à ce sujet. En revanche, quand il siégeait à l’Assemblée nationale, il était un député actif sur ces questions, qui a su porter des dispositifs intéressants.
Par ailleurs, nous vivons actuellement le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022, dont l’application est, dirons-nous, inégale. Je me rappelle que l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (Anpaa), devenue depuis Addictions France, avait jugé lors de sa publication que c’était un bon plan quant à ses intentions, mais qu’il n’avait malheureusement ni calendrier, ni financement, ni outil d’évaluation. Si ma mémoire est bonne, tels étaient les propos exacts de cette grande association de lutte contre les addictions.
Malheureusement, ce jugement est en train de se confirmer, notamment dans le domaine extrêmement important du lien de la politique des addictions avec la politique de santé mentale. Nous avons plusieurs fois, depuis un an, évoqué ce thème majeur et la nécessité de renforcer la politique de notre pays en la matière : les dispositifs de santé mentale sont largement insuffisants et partiellement inopérants en matière de lutte contre les addictions. C’est une interrogation qui nous est adressée collectivement.
Ainsi, quand je regarde la situation dans mon département de Paris, plus précisément dans le nord-est parisien, grande zone de consommation de crack, force est de constater que le dispositif fonctionne mal. Il a fallu que les riverains excédés tirent à coups de mortier sur les usagers de drogues présents dans la rue pour que le préfet de police décide de réagir et de déplacer les usagers de drogues dans un jardin public un peu plus loin. De fait, tant que nous n’aurons pas ces dispositifs de santé mentale et d’accompagnement social, nous ne résoudrons rien du tout !
Je crains que la situation que connaît ce quartier de Paris ne soit quelque peu à l’image de notre politique nationale en la matière : nous avons une connaissance théorique du problème, nous avons des outils que nous pouvons plus ou moins utiliser, mais, occupés que nous sommes peut-être à autre chose, nous n’y consacrons pas l’énergie nécessaire.
Merci donc pour ce premier pas énergique : nous voterons ce texte !
Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE, GEST, RDPI, RDSE et UC.

Mme la présidente. La parole est à Mme Valérie Létard, pour le groupe Union Centriste.
Applaudissements sur les travées des groupes UC, RDSE et RDPI. – Mme la rapporteure applaudit également.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à vous faire part du plaisir et de la satisfaction que j’éprouve aujourd’hui à voir aboutir notre travail, qui a été véritablement collectif !
Ce travail aboutit à la mise en place d’un dispositif apte à permettre la lutte contre les effets néfastes de l’usage détourné du protoxyde d’azote, ou « gaz hilarant ».
Un long chemin a été parcouru depuis notre première alerte, le 5 février 2019, à l’occasion d’une question d’actualité au Gouvernement à laquelle vous aviez répondu, monsieur le secrétaire d’État. Cette alerte nous venait des maires : de nombreux élus du département du Nord avaient alors attiré mon attention sur cette question, au travers de leur association. En effet, on commençait à trouver ces capsules en tous points du territoire départemental, non seulement dans la métropole de Lille, mais aussi dans de petites communes périurbaines. C’est bien cette réalité concrète de terrain et l’impuissance des élus locaux qui nous ont poussés à débattre de ce problème.
Au début, quelques interrogations se posaient sur la nécessité de légiférer et la portée d’un tel texte, parce qu’il s’agissait alors encore d’un sujet confidentiel et plus territorialisé qu’aujourd’hui. On s’est ensuite rendu compte que la consommation de protoxyde d’azote a flambé, jusqu’à s’étendre sur tout le territoire national. Elle est encore montée en puissance avec l’instauration du confinement, comme en témoignent les récentes enquêtes citées par M. Jomier, effectuées notamment auprès de nombreux étudiants en université. Au-delà, nos remontées de terrain nous apprennent que des collèges, des lycées et d’autres sphères encore sont touchés, ce qui montre bien combien il est maintenant urgent de légiférer.
À ce propos, monsieur le secrétaire d’État, je me permettrai de rappeler combien nous pourrions, si nous avions un peu plus d’espace d’initiative parlementaire, avancer plus vite sur des sujets comme celui-ci.
Le Sénat a adopté ce texte en première lecture en décembre 2019 ; il aura fallu attendre mars dernier pour que l’Assemblée nationale en fasse de même ; aujourd’hui, on aboutit enfin, grâce à la procédure de législation en commission et au travail mené en commun. Je veux en remercier Valérie Six, rapporteure du texte à l’Assemblée nationale, et les députés de toutes sensibilités qui se sont mobilisés.
Enfin, nous avons réussi à venir à bout de ce travail parlementaire : il prend un certain temps, mais le résultat est au rendez-vous !
Les orateurs qui m’ont précédée ont déjà rappelé que notre rédaction initiale a formé le socle du texte que nous examinons aujourd’hui. Je veux remercier notre rapporteure, Jocelyne Guidez, qui a introduit dans cette rédaction une notion nouvelle, dont je pense qu’elle servira à l’avenir : un délit d’incitation d’un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante. Comme cela a été rappelé, sa portée n’est pas limitée au protoxyde d’azote, mais peut englober bien d’autres produits qui seront peut-être, un jour, offerts ainsi sur le marché de façon détournée. Nous disposerons alors d’une première série d’outils pour commencer à traiter cette question.
On trouve encore dans ce texte des interdictions de vente et de cession, l’obligation d’étiquetage de la dangerosité, ou encore l’information offerte en milieu scolaire. Comme on l’a rappelé, travailler et sanctionner, c’est bien, mais il faut encore prendre toute une série de dispositions visant à informer, prévenir et accompagner, y compris en ligne – vous y avez contribué, monsieur Grand –, sans quoi tout cela ne constituerait pas un arsenal suffisant pour mener la lutte de manière efficace.
L’Assemblée nationale a nourri ce travail en étendant aux jeunes majeurs la protection apportée, en interdisant la vente de produits facilitant l’extraction du gaz, ou encore en limitant la quantité maximale ouverte à la vente. En effet, on voit bien que, quand on achète un nombre significatif de capsules, ce n’est certainement pas pour en faire de la crème chantilly ! Ce n’est pas non plus l’objectif quand on achète un cracker ou des ballons de baudruche ! Alors, interdire tout cela, c’est du bon sens, c’est indispensable !
Ce travail est ce qui nous permet aujourd’hui de voter un texte qui, dans sa formule aboutie et définitive, offre une base législative adaptée à la prévention des comportements dangereux des mineurs et des jeunes adultes, même si l’on aimerait aller plus loin encore. Comme cela a été dit, les jeunes adultes sont les personnes frappées par les troubles les plus sévères et importants ; c’est pourquoi il était important de les inclure dans le dispositif.
Je ne saurais saluer et remercier tous ceux qui, parmi vous, mes chers collègues, ont contribué à ce travail, mais je veux citer M. Jean-Pierre Grand, Mme Corinne Imbert, ou encore Mme Chantal Deseyne : ils sont venus conforter le travail de notre rapporteure, qui a été d’une efficacité absolue. Je remercie enfin les 94 cosignataires de cette proposition de loi dans notre assemblée, qui ont été autant de porte-voix et de défenseurs de ce texte.
Aujourd’hui, monsieur le secrétaire d’État, nous sommes très heureux de vous retrouver et de nous dire que, autour d’une question de santé publique, nous avons pu trouver un consensus. De part et d’autre, avec le sens de l’intérêt général, nous avons trouvé le moyen de faire aboutir cette proposition de loi. Nous comptons sur vous, monsieur le secrétaire d’État, pour que les quelques dispositions relevant du domaine réglementaire soient rapidement mises en place.
En tout cas, nous pouvons être très heureux d’avoir fait en sorte que nos élus et tous les acteurs de terrain disposent, dès demain, d’un arsenal législatif opérant, qui leur permettra enfin de n’avoir plus recours à des arrêtés municipaux, lesquels n’étaient à vrai dire qu’un cataplasme sur une jambe de bois. Il y a deux jours encore, la presse quotidienne régionale nous informait que quelques communes prenaient de tels arrêtés : ce texte est attendu, il ne reste plus qu’à l’adopter définitivement, puis à l’appliquer.
Encore une fois, mes chers collègues, merci à vous tous pour ce travail collectif, et bravo !
Applaudissements.

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d’azote.
La proposition de loi est adoptée définitivement.

Mme la présidente. Je constate que cette proposition de loi très attendue a été adoptée à l’unanimité.
Applaudissements.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à quinze heures vingt-cinq, est reprise à quinze heures trente.

L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe Les Républicains, la discussion de la proposition de loi renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention, présentée par M. François-Noël Buffet et plusieurs de ses collègues (proposition n° 469, texte de la commission n° 573, rapport n° 572).
Dans la discussion générale, la parole est à M. François-Noël Buffet, auteur de la proposition de loi.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je viens à cette tribune soutenir la proposition de loi, que j’ai moi-même déposée, renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention.
Dans les prochaines années, plus de 500 détenus condamnés pour des faits en lien avec le terrorisme islamo-djihadiste sortiront de prison. Face au risque que présente leur sortie de détention, le Parlement, à la suite d’initiatives convergentes du Sénat et de l’Assemblée nationale, a adopté le 27 juillet dernier la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine.
Compte tenu de la particulière dangerosité et du risque élevé de récidive de la part de tels individus une fois leur peine d’emprisonnement accomplie, nous avions jugé nécessaire que des mesures de surveillance adaptées puissent leur être appliquées après leur sortie de détention.
Dans sa décision du 7 août 2020, le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause le principe même d’une mesure de sûreté à l’égard de personnes condamnées pour terrorisme ayant purgé leur peine. Toutefois, en dépit des nombreuses garanties que le législateur avait prévues, le Conseil constitutionnel a considéré que le dispositif retenu portait une atteinte ni adaptée ni proportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis.
Malgré cette appréciation du juge constitutionnel, demeure l’impérieuse nécessité d’un dispositif permettant d’assurer le suivi de personnes qui, libérées à l’issue de leur peine, peuvent continuer à constituer une grave menace pour la sécurité publique.
Les mesures de police administrative, plus connues sous l’acronyme de Micas (mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance), aujourd’hui privilégiées, n’offrent pas, au regard de leur durée, un cadre de surveillance suffisant. Le renforcement des dispositifs de suivi judiciaire apparaît, en conséquence, comme la voie juridiquement la plus adaptée pour répondre à l’enjeu que représente, en termes de sécurité publique, la sortie de détention des condamnés terroristes, tout en offrant des garanties de réinsertion renforcées.
Dans cette perspective, la présente proposition de loi, prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel, reprend le principe du dispositif adopté en juillet 2020 – celui d’un suivi judiciaire prononcé au stade postsentenciel, d’une durée décorrélée des crédits de réduction de peine et d’un prononcé conditionné à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité appréciée en fin de peine –, tout en y apportant les aménagements destinés à le rendre pleinement compatible avec les motifs de cette décision.
En premier lieu, l’article 1er réduit la durée maximale de la mesure de sûreté, en la fixant, pour les personnes condamnées à moins de dix ans d’emprisonnement, à trois ans au lieu de cinq, et, au-delà, à cinq ans au lieu de dix. Serait également maintenue une atténuation en cas de minorité, avec des durées ne pouvant excéder respectivement deux et trois ans. En outre, l’article fixe la durée maximale de la mesure en fonction non pas de la peine encourue, mais du quantum de la peine effectivement prononcée.
En deuxième lieu, la proposition de loi exclut l’application de la mesure de sûreté aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire. Elle limite, par ailleurs, le cumul de la mesure de sûreté avec une peine assortie d’un sursis simple.
En troisième lieu, le texte prévoit que la mesure ne pourra être prononcée que lorsque l’individu concerné aura pu suivre un programme de réinsertion en détention, à l’instar d’autres mesures de surveillance judiciaire existantes.
En quatrième lieu, même si cette précision était sous-entendue dans la rédaction adoptée par le législateur, le texte dispose explicitement que le renouvellement de la mesure ne pourra être prononcé qu’à l’issue d’une évaluation établissant la dangerosité, sur la base d’éléments actuels et circonstanciés.
En cinquième lieu, enfin, la proposition de loi introduit une gradation dans le prononcé des obligations susceptibles d’être imposées à la personne sortant de détention, afin de garantir que ne seront prononcées que des obligations strictement nécessaires et proportionnées à sa situation personnelle.
Ainsi, dans le cadre du dispositif prévu, la juridiction pourra imposer aux personnes concernées le suivi d’un certain nombre d’obligations déjà applicables dans le cadre d’autres mesures de suivi judiciaire et qui relèvent, pour la plupart, d’un suivi social et d’un accompagnement personnalisé à la réinsertion.
En revanche, le prononcé des obligations les plus attentatoires aux libertés individuelles – obligation de pointage, interdiction de paraître dans certains lieux et interdiction de fréquenter certaines personnes – serait réservé aux personnes pour lesquelles les premières obligations se révéleraient insuffisantes, compte tenu de leur situation, de leur personnalité ou de leur niveau de dangerosité.
Cette proposition de loi a pour objectif de réaffirmer et de remettre en place une procédure à l’origine souhaitée par le Sénat et l’Assemblée nationale.
En outre, nous devons tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel – naturellement, nous essayons, par ce texte, de nous caler sur elle.
Par ailleurs, lorsqu’un détenu sort de détention et qu’il a purgé sa peine – car c’est bien de ce cas-là qu’il s’agit –, des mesures administratives telles que les Micas peuvent être appliquées. À ce jour, elles sont limitées dans le temps, à une année. Mais, dès lors que l’on veut contrôler plus longtemps et de façon plus contraignante, nous devons passer par la voie judiciaire : seul le juge peut décider de mesures restrictives de liberté postsentencielles, une fois la peine exécutée. C’est là toute la discussion.
Rien n’empêche que les deux mesures se cumulent pendant une certaine période, raison pour laquelle je propose ce texte. J’espère, mes chers collègues, qu’il recevra votre approbation.
Applaudissements sur les travées d u groupe Les Républicains. – MM. Yves Détraigne, Franck Menonville et Alain Richard applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Franck Menonville applaudit également.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, cette proposition de loi du président Buffet a donc pour but de répondre à un enjeu de sécurité publique majeur : la sortie de détention des terroristes qui présenteraient toujours un caractère de dangerosité.
Cette question n’est pas seulement théorique, elle va se poser avec une certaine acuité : à ce jour, 469 personnes se trouvent en détention pour des faits de terrorisme en lien avec la mouvance islamiste ; parmi elles, 253 ont reçu une condamnation définitive ; et, début mai, on en dénombrait 162 qui sortiront de prison dans les quatre prochaines années.
Comme l’a expliqué le président Buffet, notre arsenal juridique n’est pas dépourvu de mesures dédiées au suivi des personnes sortant de détention et qui présentent toujours un caractère de dangerosité s’agissant de la commission d’actes terroristes islamistes.
Je vais vous brosser rapidement un tableau de ces mesures afin que vous rendiez compte des raisons pour lesquelles elles sont en réalité insuffisantes et de la nécessité d’une telle proposition de loi.
Premièrement, il existe la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, que l’on a coutume d’appeler la Micas. Instaurée par la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite loi SILT, cette mesure est intéressante en ce qu’elle s’accompagne d’obligations de surveillance à l’égard des individus qui sortent de détention.
Mais la Micas demeure une mesure administrative, prononcée par le ministre de l’intérieur. De ce fait, parce qu’elle est attentatoire aux libertés individuelles, elle ne peut être appliquée que dans un cadre extrêmement restrictif.
Ainsi, sa mise en œuvre ne peut excéder douze mois. C’est précisément sur le fondement de cette durée réduite que le Conseil constitutionnel a validé la Micas lorsque la loi SILT lui a été déférée. Toutefois, cette durée est trop courte pour permettre un suivi raisonnable.
Deuxièmement, il existe la peine de suivi sociojudiciaire. Elle peut être prononcée en même temps qu’est condamné l’auteur de faits en lien avec le terrorisme. Malheureusement, elle n’est obligatoire que depuis le mois d’août 2020 : elle n’a donc été que rarement prononcée.
Troisièmement, les mesures d’application des peines offrent un panel d’obligations pouvant être imposées aux terroristes lorsqu’ils sortent de détention, dont la durée est calquée sur la réduction de peine. Or, en juillet 2016, nous avons décidé de supprimer toute réduction de peine automatique pour les individus ayant commis une infraction de nature terroriste. La durée de ces mesures s’en trouve donc extrêmement restreinte.
Quatrièmement, d’autres mesures de sûreté spécifiques existent, destinées à s’imposer uniquement aux délinquants sexuels à leur sortie de détention – elles concernent des peines longues. Ici, la dangerosité de l’individu est appréciée au titre d’une expertise psychiatrique, laquelle ne peut servir à mesurer la dangerosité des terroristes islamistes. Ces mesures ne sont donc pas d’une grande utilité vis-à-vis de ces derniers.
Cinquièmement, enfin, il existe l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (Fijait). Parmi tous les dispositifs que j’ai évoqués, c’est le seul qui est spécifiquement dédié à la lutte contre le terrorisme islamiste : bien qu’il soit intéressant, il demeure assez faible en ce qu’il ne prévoit que des obligations déclaratives.
Des mesures diverses, tant administratives que judiciaires, existent donc bel et bien. À y regarder de plus près, force est de constater que, pour les faits commis entre juillet 2016 – à ce moment, les suivis calqués sur la durée de réduction des peines deviennent extrêmement brefs faute de réduction automatique des peines – et août 2020, date à laquelle un suivi sociojudiciaire obligatoire peut être enfin prononcé, nous ne disposions, sur ce laps de temps relativement long, que de peu de moyens.
Sur l’ensemble des individus actuellement suivis pour des faits en lien avec le terrorisme islamiste par le juge de l’application des peines antiterroriste, 75 % de ceux qui s’apprêtent à sortir de détention seront soumis à un suivi calqué sur la réduction des peines, dont la durée, je viens de l’indiquer, est relativement faible.
Malgré l’arsenal existant, nous avons besoin de nouvelles mesures.
Cette prise de conscience est relativement ancienne : après l’évaluation de la loi SILT par le Sénat et l’Assemblée nationale, les présidents des commissions des lois des deux assemblées ont chacun déposé une proposition de loi visant à mettre en œuvre une mesure de sûreté qui assujettit les terroristes islamistes sortant de détention à des obligations à la fois de surveillance et de réinsertion. C’est bien sur ces deux piliers que repose une telle mesure de sûreté.
Un accord fut trouvé à l’issue d’une commission mixte paritaire et un texte a été voté en juillet 2020, mais le Conseil constitutionnel l’a partiellement invalidé. C’est pour tirer les conséquences d’une telle décision que nous sommes réunis aujourd’hui.
Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel a énoncé des choses tout à fait positives. Je ne crois pas trahir sa pensée en disant qu’il a décidé que le législateur était légitime à mettre en œuvre une mesure de nature à prévenir les troubles à l’ordre public et, partant, à décider d’une mesure de sûreté. Celle-ci est fondée non pas sur l’infraction commise, mais bien sur la dangerosité persistante de la personne qui sort de détention. Autrement, le président Buffet l’a très bien expliqué, elle constituerait une double peine.
Nous savons d’ores et déjà que le dispositif que nous allons mettre en place présente bien le caractère d’une mesure de sûreté, d’application immédiate. Elle peut donc s’appliquer aux terroristes qui s’apprêtent à sortir de détention.
Voilà donc l’élément positif important que le Conseil constitutionnel a exprimé.
Il a également énoncé des choses moins positives. Sur le texte issu de l’accord trouvé en commission mixte paritaire. Le Conseil constitutionnel a ainsi estimé que n’était pas correctement assuré l’équilibre entre l’objectif à valeur constitutionnelle de prévention des troubles à l’ordre public et l’atteinte aux libertés constitutionnellement reconnues.
C’est donc sur ces éléments que le président Buffet a dû se pencher pour rééquilibrer ce texte ; la commission des lois ne l’a que très peu modifié car il paraissait répondre en tous points à la décision et à la censure du Conseil constitutionnel.
Désormais, l’application de la mesure de sûreté, qui s’apparente à un dispositif de surveillance et de réinsertion, est décidée comme suit : une évaluation du détenu est réalisée avant sa sortie de détention ; sur requête du parquet antiterroriste, la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris est saisie ; l’avis du juge de l’application des peines antiterroriste est requis ; un débat contradictoire a lieu en présence du détenu, assisté d’un avocat ; une décision est prise.
La mesure de sûreté ne peut être prononcée si le détenu n’a pu suivre un parcours de réinsertion ou des activités de réinsertion lors de sa détention. De même, elle ne peut l’être si le détenu a fait l’objet d’une condamnation à une peine de prison avec sursis. Enfin, elle ne peut être prononcée, ou peut être réformée, s’il existe d’autres mesures moins attentatoires qui satisfont aux objectifs de surveillance et de réinsertion.
Cette mesure sera prononcée pour une durée limitée, de trois à cinq ans maximum, et les autres mesures existantes ne pourront être prononcées ensemble. Il conviendra de mettre en œuvre la gradation dont le président Buffet est l’auteur et qu’il a présentée. Le système est le suivant : plus le détenu est dangereux à sa sortie de détention, plus les mesures auxquelles il est soumis seront importantes. La proposition de loi permettra d’inscrire au fichier des personnes recherchées les différentes obligations imposées aux détenus qui sortent de prison.
Voilà, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, brossée à grands traits l’architecture de cette nouvelle mesure de sûreté. Nous espérons, cette fois-ci, qu’elle obtiendra les faveurs du Conseil constitutionnel.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Franck Menonville applaudit également.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui va dans le bon sens. Monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, je veux saluer la qualité de votre réflexion et de votre travail.
Ce texte s’inscrit pleinement dans l’objectif que s’est fixé le Gouvernement, celui de réduire au maximum une menace nouvelle et terrifiante : la possible récidive des personnes condamnées pour des actes de terrorisme qui, alors que leur peine arrive à terme, présenteraient toujours des signes de dangerosité.
Depuis 2017, la lutte contre le terrorisme est la priorité du Gouvernement. Il a déployé, à cette fin, des moyens sans précédent pour renforcer la réponse de nos services de sécurité et équiper la justice de tous les outils nécessaires au traitement de cette menace.
Dois-je rappeler la création de 10 000 postes supplémentaires de gendarmes et de policiers, l’augmentation du budget de la justice, la création du parquet national antiterroriste, l’augmentation du nombre de quartiers d’évaluation de la radicalisation (QER), l’augmentation du personnel affecté au renseignement pénitentiaire ?
Depuis 2017, 36 attentats terroristes liés à la mouvance islamistes ont été déjoués par nos services de renseignement. J’ai, à cet instant, une pensée appuyée pour toutes les victimes des actes de terrorisme qui ont endeuillé notre pays.
L’impérieuse nécessité d’agir face à cette nouvelle menace s’inscrit dans un contexte que je souhaite, comme vous, rappeler : d’ici à la fin de l’année 2024, 163 personnes actuellement détenues pour des actes de terrorisme en lien avec la mouvance islamiste auront purgé leur peine. Or, à l’approche de cette échéance, certaines d’entre elles présentent et présenteront sans doute encore des signes de radicalisation.
En 2016, alors que la France affrontait une effroyable série d’actions terroristes, le régime d’aménagement de peine en matière de terrorisme a été durci afin de répondre à la crainte que des personnes radicalisées et potentiellement dangereuses soient remises en liberté.
Aujourd’hui, ce sont précisément ces mêmes détenus, dont la sortie ne peut plus être aménagée, qui s’apprêtent à quitter la détention. Or un certain nombre d’entre eux ne pourront bénéficier d’une mesure de surveillance judiciaire et seront libérés, selon l’expression convenue, en « sortie sèche », c’est-à-dire sans suivi ni accompagnement.
Je tiens ici à saluer avec force l’important travail réalisé dans nos établissements pénitentiaires pour prévenir la radicalisation des détenus et de freiner tout prosélytisme délétère. Les services de mon ministère travaillent sans répit pour améliorer l’évaluation et la prise en charge des personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou présentant des signes de radicalisation.
Aujourd’hui, ces détenus sont systématiquement évalués durant seize semaines au sein des QER. Nous disposons de 121 places sur le plan national et un quartier réservé aux femmes incarcérées ouvrira à la fin de l’année 2021 au centre pénitentiaire de Fresnes.
Par ailleurs, nous disposons de 188 places de quartiers de prise en charge de la radicalisation à l’échelon national. Les détenus évalués comme étant en capacité de se soumettre à une prise en charge y bénéficient de programmes de désengagement, grâce à l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire, composée de médiateurs du fait religieux, de psychologues et de personnels pénitentiaires. Un quartier de ce type, réservé aux femmes détenues, ouvrira dans le courant de l’été 2021 au centre pénitentiaire de Rennes.
Enfin, le Service national du renseignement pénitentiaire, dont nous avons augmenté les effectifs de 100 personnes en trois ans, assure un suivi très poussé de ces condamnés à leur libération, en lien très étroit avec les services partenaires du renseignement.
C’est un constat partagé : la remise en liberté de détenus condamnés pour des faits de nature terroriste, potentiellement toujours radicalisés en dépit du travail réalisé, appelle une réponse forte et efficace. Il est de notre devoir de mettre tout en œuvre pour garantir, dans le respect de notre État de droit, la sécurité de nos concitoyens.
Le Gouvernement s’y est déjà attaché dans le cadre du dispositif issu de la loi SILT du 30 octobre 2017, qui a ouvert la possibilité de soumettre les individus sortant de détention à une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (Micas). Le projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, dit SILT 2 – il est actuellement en débat à l’Assemblée nationale et votre assemblée en discutera prochainement –, prévoit ainsi de pérenniser ces mesures administratives qui ont fait la preuve irréfutable de leur efficacité.
Pour autant, les conditions de la soumission à un nouveau régime judiciaire restrictif de liberté des personnes qui ont déjà purgé leur peine doit appeler à la plus grande vigilance. C’est le sens de la décision du Conseil constitutionnel, rendue en août dernier, portant sur la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine.
Nul besoin de rappeler que ce texte s’inscrivait déjà dans la volonté commune qui nous réunit aujourd’hui d’apporter une solution à la nouvelle menace des sortants de prison condamnés pour terrorisme.
Si, à la suite de cette censure, le travail de réécriture du Sénat doit être salué, il ne nous paraît pas suffisant pour parer à toutes les critiques alors formulées par le Conseil constitutionnel.
Il ne saurait en effet être question d’instaurer ou de laisser penser que nous sommes prêts à instaurer une quelconque forme de justice prédictive : celle-ci est la négation de l’idée même de justice puisqu’elle revient à condamner sur un simple soupçon. Le respect de nos valeurs impose, à mon sens, que le régime applicable aux détenus terroristes neutralise leur éventuelle dangerosité.
C’est à l’aune de ces considérations que le Gouvernement souhaite la création, au sein du projet de loi SILT 2, d’une « mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion ». Celle-ci permettra d’assujettir le condamné à un suivi au moyen d’obligations et d’interdictions à vocation essentiellement sociale.
Le projet défendu par le Gouvernement, qui sera bientôt examiné au Sénat, assure l’articulation entre le dispositif administratif – la surveillance – et le dispositif judiciaire.
En ce qu’elle prévoit la création d’une mesure de sûreté judiciaire, la proposition de loi du président Buffet vise des objectifs comparables. Toutefois, certaines des obligations et interdictions auxquelles peuvent être astreintes les personnes concernées sont similaires ou voisines de celles qui sont prévues par les Micas, comme l’interdiction de paraître dans certains lieux ou de fréquenter certaines personnes.
Une telle superposition paraît de nature à fragiliser la légalité des Micas prononcées à l’encontre des mêmes personnes, alors que ces mesures permettent précisément le prononcé d’obligations plus rigoureuses encore.
D’une manière générale, le Gouvernement considère que la superposition de dispositifs de sûreté différents, sous la responsabilité d’autorités différentes, susceptibles d’être appliqués à des mêmes fins et aux mêmes personnes, en prévoyant des prescriptions similaires ou identiques, crée une complexité qui nuit à l’efficacité de l’action de l’État pris dans ses fonctions administratives et judiciaires.
Enfin, il convient de rappeler que les mesures de sûreté doivent respecter le principe résultant de l’article IX de la Déclaration de 1789, selon lequel la liberté ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties.
Comme je l’ai indiqué, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 7 août 2020, a rappelé la vigilance qui doit être celle du législateur sur le caractère adapté, nécessaire et proportionné de mesures restrictives de liberté lorsqu’elles sont imposées à des personnes ayant purgé leur peine.
Or, précisément, certaines des dispositions de la présente proposition de loi, en particulier les conditions de renouvellement de la mesure de sûreté, ne semblent pas répondre aux exigences constitutionnelles rappelées par le Conseil constitutionnel. Elles laissent craindre une nouvelle censure, qui doit absolument être évitée pour qu’enfin puisse être mis en place le nécessaire suivi des sortants de prison condamnés pour terrorisme.
Nous sommes juridiquement sur une ligne de crête. Il appartient ainsi au législateur de prendre des mesures qui permettent d’assurer la protection des Français, tout en veillant à ne pas adopter des mesures qui ne seraient pas strictement nécessaires. C’est cette proposition qu’a formulée le Gouvernement à l’article 5 du projet de loi SILT 2.
En conclusion, je ne peux, mesdames, messieurs les sénateurs, que saluer l’objectif de cette proposition de loi en ce qu’il rejoint l’engagement du Gouvernement dans la lutte contre le terrorisme ; il confirme la détermination du Sénat en la matière.
Je luis préfère toutefois la version gouvernementale qui vous sera présentée le mois prochain : elle sera plus à même de répondre aux exigences constitutionnelles désormais clairement établies.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.
Applaudissements sur les travées des groupes INDEP et UC.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le climat de déconfinement ne doit pas nous faire oublier le danger permanent qui plane sur notre pays et qui est lié au terrorisme. Les faits sont simples : 469 personnes sont actuellement détenues dans les prisons françaises pour des actes de terrorisme islamiste ; 253 sont condamnées et purgent leur peine ; 163 devraient être libérées dans les quatre prochaines années et présentent un risque réel de réitération des faits.
Je crois important de revenir sur ces chiffres, qui figurent dans le rapport de Muriel Jourda. Ce risque n’est pas théorique : de trop nombreux attentats ont été commis sur notre sol, jusque dans nos centres pénitentiaires. La question des sortants de prison illustre de façon emblématique l’évolution d’une menace de plus en plus endogène dans notre pays.
Nous éprouvons « plus qu’une inquiétude, une vraie peur » s’agissant « des dizaines de personnes qui vont sortir de prison, qui sont très dangereuses et dont les convictions sont absolues. Elles constituent la menace prioritaire aujourd’hui ». Ainsi s’exprime Jean-François Ricard, procureur de la République antiterroriste. Son constat est partagé par tous les acteurs concernés et nous dit l’urgence d’agir pour mieux protéger les Français.
Aussi, le 27 juillet dernier a été adoptée la loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine. En effet, la remise en liberté de détenus condamnés, potentiellement toujours radicalisés en dépit de l’accomplissement de leur peine et du travail réalisé, appelle des mesures spécifiques afin de prévenir la récidive. Il est donc de notre devoir de mettre tout en œuvre pour garantir la sûreté de nos concitoyens.
Dans sa décision du 7 août dernier, le Conseil constitutionnel a toutefois considéré que le dispositif retenu par le Parlement portait une atteinte qui n’était ni adaptée ni proportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Plusieurs articles de la loi ont été jugés contraires à la Constitution. En dépit de cette censure, le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause le principe de la mesure de sûreté.
La proposition de loi que nous examinons cet après-midi est essentielle. En effet, elle répond à l’enjeu que représente la sortie de détention de ces personnes qui ne bénéficieront pas de mesures d’accompagnement.
Tout en reprenant le principe du dispositif adopté par le Parlement au mois de juillet dernier, ce texte y apporte des aménagements qui prennent en compte les objections formulées par le Conseil constitutionnel. Il a d’ailleurs été conforté par l’adoption de plusieurs amendements en commission.
Je pense notamment à la possibilité de prononcer une mesure de sûreté, lorsque le sursis probatoire est révoqué, et à l’impossibilité de cumuler une peine de sûreté avec une peine assortie d’un sursis simple.
Je pense aussi à l’ajout d’un avis systématique du juge de l’application des peines pour éclairer utilement les décisions prises dans le cadre des mesures de sûreté.
Avant de conclure, je tiens à remercier François-Noël Buffet de son initiative. Malgré une actualité qui pourrait nous laisser penser que ce sujet n’est pas une priorité, c’en est une !
Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les Français attendent de l’État qu’il les protège et c’est bien normal. La sécurité est l’un des fondements de notre contrat social. Si une menace existe, elle doit être prise en compte ; s’il existe un vide juridique, il doit être comblé. Tel est l’objectif de ce texte.
Le combat contre le terrorisme est aussi et surtout un combat collectif : il exige la mobilisation de chacun – services de renseignement, forces de sécurité, magistrats et responsables politiques.
En conclusion, le groupe Les Indépendants votera sans réserve ce texte, qui ajoute une arme à notre arsenal. Cet arsenal est celui de l’État de droit.
Applaudissements sur les travées des groupes INDEP, UC et RDSE. – M. Gérard Longuet applaudit également.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la sécurité des Français et l’intégrité du territoire national sont des préoccupations communes à tous les membres de la Haute Assemblée, je puis l’affirmer sans grande crainte.
Toutefois, étant donné ce que nous savons de la radicalisation, il nous semble que le Sénat a une approche bien réductrice de la prise en charge des personnes condamnées pour terrorisme. On pourrait la résumer ainsi : toujours plus de répression judiciaire et pas assez de réflexion quant aux causes des problèmes que l’on entend traiter.
En effet, le premier écueil de cette proposition de loi est d’ignorer la situation des prisonniers de droit commun qui se radicalisent lors de leur détention. Il convient d’objectiver le phénomène de radicalisation en prison et de mettre en œuvre un programme de réinsertion adapté et stable à ce type d’individus, pour qu’ils ne se retrouvent pas sans aucun accompagnement à la fin de la détention.
Ensuite, cette proposition de loi ne pousse pas plus avant la réflexion sur les pratiques sociojudiciaires en matière de réintégration en milieu ouvert ou semi-ouvert des personnes radicalisées. Elle se contente de mettre en place des dispositifs judiciaires de suivi de ces personnes.
C’est tout le système de suivi des radicalisés qu’il nous faut peut-être revoir. Aujourd’hui, la stratégie de la France est celle du désamorçage, sans aller plus loin. Catherine Troendlé, ancienne sénatrice du groupe Les Républicains, et moi-même avons rendu un rapport d’information sur la radicalisation et nous avons visité longuement les prisons et les structures de prise en charge de la radicalisation. Plutôt que « déradicalisation », je préfère parler de « désengagement » ou de « désembrigadement ». Celle-ci implique des modifications du système de croyances conduisant à rejeter l’idéologie extrémiste au profit de nouvelles valeurs. Toutefois, elle est réductrice, car il s’agit encore une fois d’une approche confrontationnelle, qui porte difficilement ses fruits.
Peut-être devrions-nous envisager de faire évoluer la conception de la prise en charge de ces personnes en France vers la notion de désengagement, qui, elle, s’inscrit dans la perspective d’un renoncement à la violence. Le Danemark a été un précurseur en la matière : dès 2007, il a employé une méthode basée sur le tutorat et l’accompagnement pour faire face à la radicalisation.
En France, il y a eu le programme « Recherches et intervention contre les violences extrémistes », ou RIVE, expérience inédite pour tenter de gérer la réinsertion des personnes radicalisées et leur suivi sous le contrôle des services pénitentiaires d’insertion et de probation. Elle a été interrompue pour laisser place à l’association Artemis, Atelier de recherche, traitement et médiation interculturelle et sociale, dont nous n’avons pour l’heure aucun retour d’expérience.

Comment les individus sortis de prison perçoivent-ils leur propre réintégration ? Quelle est l’importance de l’implication des familles, des proches, des communautés dans la réintégration ? Comment les professionnels du travail social, de la justice et de la police adaptent-ils leurs outils et leurs pratiques à l’hétérogénéité des trajectoires et des besoins ? Malheureusement, à l’heure actuelle, peu de travaux portent sur la situation française permettant de croiser ces différentes dimensions dans l’analyse du processus de réintégration. Or il s’agit bien là d’un enjeu social et scientifique majeur.
Ce texte est donc une occasion manquée de faire évoluer la stratégie de suivi des condamnés pour terrorisme à la sortie de détention. C’est pourquoi le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera contre.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous écrivons un nouveau chapitre de l’histoire de l’adaptation de notre droit pénal à une criminalité particulière. C’est une histoire à épisodes. Avec l’aggravation de la criminalité terroriste, qui commence en 2012 dans notre pays et, bien vite, dans le reste de l’Europe, notre législation se renforce à la fois pour mieux caractériser et rendre punissables les crimes et délits qui constituent ce mouvement et pour adapter les procédures en prévenant les risques de prolongation excessive des jugements comme, il faut bien dire, le risque de l’intimidation de ceux qui instruisent et de ceux qui sanctionnent.
Les règles de ce droit rénové, qui vise à combattre le terrorisme, sont maintenant à l’œuvre. Le moment est opportun pour affirmer notre respect et notre soutien à tous les agents publics qui le mettent en œuvre : magistrats, policiers, agents des services, personnel pénitentiaire et personnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation.
Toutefois, à mesure que ce dispositif répressif s’est déployé, un problème est apparu qui surplombe notre discussion d’aujourd’hui : l’idéologie meurtrière qui a conduit à l’acte terroriste, notamment pour ceux qui sont condamnés pour complicité et sont détenus moins longtemps, ne disparaît pas avec l’exécution de la peine.
Depuis quatre ou cinq ans se développe donc une discussion sur la déradicalisation, que Mme Esther Benbassa vient d’analyser de façon très juste. Si elle présente un réel intérêt, elle ne clôt cependant pas le sujet, car les anciens condamnés ne présentent pas tous, tant s’en faut, la disponibilité mentale et la capacité de retour dans la norme, qui en sont la première condition.
La dangerosité des anciens condamnés qui subsiste nous adresse une sorte de double défi : rester fidèles aux principes d’une justice humaniste, écarter la menace vitale d’individus restant enclins à combattre la société par le meurtre.
Le 27 juillet dernier, nous avons adopté une loi habilitant le juge à prendre, après l’exécution de la peine, un ensemble de mesures de sûreté à l’encontre des anciens condamnés pour terrorisme, dans le but de prévenir et, déjà, de détecter les agissements qui révéleraient leur tendance à vouloir de nouveau attenter au sort de nos concitoyens.
Le Conseil constitutionnel a déclaré cet ensemble de mesures contraire aux articles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui protègent la liberté individuelle contre les sentences abusives. Il a critiqué le cumul de ces mesures de sûreté aboutissant, si on les appliquait toutes, à priver l’individu d’une part essentielle de sa liberté. Il en a également dénoncé la durée maximale d’application, puisqu’elles étaient susceptibles, dans le texte adopté, de poursuivre leurs effets sur une période pouvant aller jusqu’à dix ans.
Pourtant, cette loi avait reçu l’approbation des deux assemblées, avec une majorité assez large dans les deux cas et après un travail approfondi de leurs commissions des lois respectives. Beaucoup d’entre nous s’y étaient associés et je m’étais personnellement réjoui de vous entendre, monsieur le garde des sceaux, peu après votre entrée en fonction, apporter votre appui à ce dispositif.
À présent, il faut reprendre la plume, puisque, d’une part, le risque à combattre est toujours aussi présent et que, d’autre part, le Conseil constitutionnel a au moins reconnu – j’appelle aussi votre attention sur ce point, monsieur le garde des sceaux – la conformité au droit constitutionnel de mesures individuelles de sûreté en pareille situation. Il est donc souhaitable d’adapter un système de suivi sous le contrôle du juge judiciaire et d’une rigueur moins serrée que la panoplie trop large que nous avions fixée l’été dernier. Observons que des mesures comparables appliquées aux anciens délinquants sexuels condamnés, qui constituent un précédent, sont, quant à elles, jugées parfaitement conformes aux principes supérieurs du droit.
La proposition de loi de François-Noël Buffet tire très logiquement les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel et retient les trois principales mesures de contrainte qui était incluses dans l’ensemble plus vaste de 2020, à savoir l’obligation pour l’ancien détenu condamné pour terrorisme sortant de prison de faire connaître son lieu de résidence, l’interdiction de paraître dans certains lieux et l’interdiction d’entrer en contact avec certains individus. Un tel dispositif figure dans le code pénal de longue date et s’applique à nombre de situations.
Cette fois, la durée d’application de ces mesures est plus limitée. En outre, chaque mesure est décidée par un juge judiciaire après application des droits de la défense.
Nous trouvons ce dispositif équilibré et adapté au danger qu’il faut combattre et nous espérons, rationnellement, qu’il sera cette fois jugé conforme aux exigences supérieures du droit. Nous savons que, de son côté, le Gouvernement a en préparation une réponse légale à ce vide de législation que nous ne pouvons laisser subsister. Nous souhaitons vivement qu’un rapprochement entre les deux démarches ait lieu, comme cela avait été le cas dans le débat précédent.
Ainsi que vous l’avez souligné, monsieur le garde des sceaux, il faut veiller au risque du cumul entre les mesures administratives de contrôle et des mesures judiciaires. Pour autant, nous pensons qu’il faut poursuivre le débat. Je me permets donc d’insister pour qu’avant la fin de la préparation du projet de loi vous incorporiez certaines des mesures qui sont prévues par la proposition de loi que nous sommes en train d’examiner et que vous demandiez au Conseil d’État d’apprécier la compatibilité de l’ensemble de ces mesures, celles que vous avez en projet et celles dont nous délibérons aujourd’hui.
Dans ces conditions, nous souhaitons que le débat se poursuive. C’est pourquoi, sur ce texte, nous avons fait le choix d’une abstention compréhensive.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les chiffres avancés suscitent une vive inquiétude : presque 500 personnes seraient détenues en France pour des actes de terrorisme en lien avec la mouvance islamiste, parmi lesquelles un nombre significatif devrait sortir de détention ces prochaines années.
Notre société fait donc face à un double défi : d’une part, celui de la réinsertion d’individus ayant déjà fait acte de leur dangerosité, de leur radicalité et du rejet de notre société ; d’autre part, celui de parvenir à les réinsérer sans renier la philosophie de notre État de droit, laquelle ne doit en aucune manière transiger et céder sur le respect des libertés fondamentales.
Le 27 juillet 2020, le Parlement a donc adopté un texte déposé dans le prolongement de la loi SILT, proposant un dispositif de suivi et de surveillance postsentencielle pour les individus condamnés pour des faits de terrorisme à leur sortie de détention. Il a été rappelé les motifs pour lesquels le Conseil constitutionnel a été contraint d’en censurer des éléments principaux, considérant qu’en l’état étaient imposées des obligations et interdictions portant une atteinte trop importante à la liberté d’aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale.
Toutefois, nous nous réjouissons que le Conseil constitutionnel n’ait pas rejeté le principe de la mise en place de cette mesure. Il nous revient donc de trouver l’équilibre et la justesse qui permettront à ce mécanisme d’être définitivement adopté dans le respect de nos principes essentiels et tout en conservant l’espoir d’une efficacité en vue de la réinsertion des personnes condamnées pour des actes de terrorisme.
Aussi les ajustements proposés par les auteurs de cette proposition de loi paraissent-ils de nature à satisfaire ces diverses exigences. Qu’il s’agisse de la durée de la mesure ou bien de l’encadrement des possibilités de cumul avec les mesures de sursis, ces éléments devraient permettre au dispositif de passer le stade du contrôle de constitutionnalité et, par conséquent, d’entrer en vigueur le plus tôt possible.
De la même façon, je salue les ajustements répondant à la nécessité d’éléments nouveaux et complémentaires pour le renouvellement de la mesure de suivi. La censure constitutionnelle aura ainsi permis d’introduire une nouvelle évaluation établissant la dangerosité sur la base d’éléments actuels et circonstanciés. Il en va de même de la gradation introduite dans le prononcé des obligations susceptibles d’être imposées.
J’ai l’espoir, à l’image de la position de la commission des lois, que la réponse apportée par cette proposition de loi sera de nature à permettre la constitutionnalité du dispositif, lequel prendra mieux en compte la situation, la personnalité ou le niveau de dangerosité de la personne visée par la mesure.
Je souligne enfin un point particulier. Cette proposition de loi intègre le principe suivant lequel la mesure de sûreté ne peut intervenir à l’issue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement que si la personne a pu, pendant l’exécution de cette peine, bénéficier de mesures de nature à favoriser sa réinsertion. Cela est évidemment bienvenu et nous permet d’aborder un sujet fondamental, celui du rôle de l’institution carcérale dans notre société. En effet, je crains qu’il ne faille voir ici l’aveu d’une forme d’échec.

Certes, la prison punit, mais elle ne prépare pas suffisamment à la sortie. Elle joue son rôle de répression, mais ne prépare pas efficacement à la réinsertion, alors même que ce devrait être son rôle principal. De cette manière, nous en sommes réduits à une forme de fuite en avant : après les peines, nous voilà à instituer des mesures post-carcérales avec l’espoir qu’elles seront efficaces, alors même que la prison a failli à sa mission.
Qu’adviendra-t-il si celles-ci se révélaient à leur tour inefficaces ? Faudra-t-il travailler sur un nouveau dispositif qui permettrait un suivi encore plus étendu à l’issue de ces mesures ? Ce n’est évidemment pas la solution, mais cela nous alerte sur une forme de précarité face à laquelle nous devrons nous montrer vigilants dans les années à venir.
Ce dernier point n’empêchera toutefois pas le groupe du RDSE de voter en faveur de cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le 21 juillet 2020 a été discutée au Sénat la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine, après son adoption par l’Assemblée nationale. Le groupe CRCE s’était alors fortement opposé au texte et aux objectifs visés.
Dans sa décision du 7 août 2020, le Conseil constitutionnel a considéré que le dispositif retenu portait, en l’état de sa rédaction, une attaque qui n’était ni adaptée ni proportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Pourtant, les auteurs et défenseurs des propositions de loi initiales continuent à considérer que les mesures de police administrative, notamment les Micas, aujourd’hui privilégiées par les autorités pour assurer le suivi des personnes libérées, représentent toujours une menace grave pour la sécurité publique et n’offrent pas un cadre de surveillance suffisant. Aussi proposent-ils de nouveau un renforcement du suivi judiciaire en proposant des garanties de réinsertion renforcées.
C’est donc en toute cohérence que la commission des lois a approuvé le dispositif proposé par François-Noël Buffet en n’apportant que quelques ajustements mineurs. La position de mon groupe reste la même depuis le mois de juillet 2020 et les censures du Conseil constitutionnel n’ont fait que la conforter : de telles mesures sont contraires, dans leur logique même, à plusieurs droits fondamentaux. Nous avons toujours été opposés aux mesures de sûreté en général, considérant qu’un individu ayant purgé sa peine avait le droit d’être réinséré dans notre société.
Rappelons que, lors de l’adoption de la rétention de sûreté, le sénateur Robert Badinter avait dénoncé « une période sombre » pour la justice. Il avait insisté sur « le brouillard » dans lequel cette « détention pour dangerosité, hors toute commission d’infraction », allait plonger la justice dont les fondements étaient atteints.
Ces mesures induisent un bouleversement de la logique même du droit pénal. En effet, les mesures de sûreté ne sont pas relatives à une infraction commise. Elles ne visent que les « états dangereux ». Il n’existe donc pas de faute, le but de ces mesures étant seulement de protéger la société par des dispositions spécifiques permettant ainsi d’éviter notamment la récidive. On parle donc non pas de punition, mais de prévention. Il s’agit notamment – et dans la plupart des cas – d’utiliser ce genre de procédure pour réadapter des délinquants à la société par le biais d’une cure de désintoxication ou d’un internement, ce qui pose déjà grandement question.
Présentées comme de simples moyens prophylactiques, ces mesures peuvent présenter un danger de dérive totalitaire. Or, en adaptant les mesures de sûreté aux personnes condamnées pour des actes terroristes, quel message envoyons-nous ? En pointant avec force la récidive probable, on envoie aux condamnés qui ont purgé leur peine le signal qu’ils sont suspectés à vie et, en quelque sorte, rejetés de la République. Ne nous leurrons pas : cette justice d’exception ne se bornera pas au seul cas des détenus terroristes, elle fera tache d’huile. N’est-ce pas déjà le cas au regard des lois votées à l’encontre des auteurs de délits et crimes sexuels, par exemple ?
Pourtant, en creux, ce que révèlent notamment les mesures proposées, ce sont l’échec du temps pénitentiaire et l’épuisement d’un système basé sur le tout carcéral. Les vraies questions auxquelles cette proposition de loi ne répond pas sont nombreuses : quels moyens pour nos services de renseignements pour prévenir les actes de terrorisme ? Comment réinsérer dans notre société des individus condamnés pour de tels faits ? Les obliger, pendant plusieurs années, à se rendre jusqu’à trois fois par semaine dans un commissariat pour justifier de leur présence est un obstacle évident à la reprise d’une vie active et socialisante. Autant de questions auxquelles la nouvelle mouture de la loi SILT du Gouvernement que nous examinerons à la fin du mois de juin prochain ne s’attache pas à répondre non plus.
Mes chers collègues, au regard des conséquences désastreuses de cette incessante surenchère pénale sur notre ordonnancement juridique, je me demande s’il ne serait pas sage, un an avant l’élection présidentielle, de sanctuariser au maximum notre code pénal. Quoi qu’il en soit, nous nous opposerons de nouveau à ce texte, qui continue, selon nous, malgré des aménagements à la marge, à aller à l’encontre des principes fondamentaux de notre État de droit, en instaurant en substance une peine après la peine.
Comment faire en sorte que la prison ouvre, à la libération, la voie à une véritable réinsertion ? Voilà la question essentielle qui devrait être posée, et non comment poursuivre la logique carcérale punitive de réclusion en dehors des murs ?
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.

Mme Nathalie Goulet. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je mets d’emblée fin au suspens : nous voterons le texte qui nous est soumis et suivrons évidemment la décision de notre commission.
Sourires.

Une question demeure toutefois, monsieur le garde des sceaux : pour quoi faire ? En réalité, aucun texte ne nous donnera jamais suffisamment de garanties face à un virus mutant. La question de la radicalisation se pose depuis longtemps et j’y travaille moi-même depuis très longtemps. D’ailleurs, vous gardez sûrement le souvenir ému de la première question d’actualité qui vous a été posée dans cet hémicycle.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. (La main palpitant sur la poitrine.) J’en ai encore le cœur qui bat !
Sourires.
Nouveaux sourires.

J’en étais l’auteur et elle portait précisément sur le suivi des détenus radicalisés, puisque j’ai l’honneur et le privilège d’être le sénateur du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, qui connaît de nombreux problèmes avec les détenus radicalisés. Imbibée des travaux de Farhad Khosrokhavar, je sais que la question de la prison demeure un véritable sujet. Si nous nous y étions penchés durant toutes ces années, nous n’en serions peut-être pas là.
Comme beaucoup, monsieur le garde des sceaux, je vous rappellerai que la prison est un incubateur, mais vous le savez. Il faut donc plus de moyens pour les prisons, plus de moyens pour la justice, plus de moyens pour la prévention.
À ce stade, je tiens évidemment à rendre hommage à nos services de sécurité, aux services pénitentiaires, aux services de renseignement, qui accomplissent un travail tout à fait remarquable, mais en aval. Votre collègue ministre Gérald Darmanin a déclaré cette semaine que l’une des raisons du problème de la sécurité, c’était le manque de moyens de la justice. Vous avez obtenu un budget substantiel, mais ce navire amiral prend néanmoins l’eau et il va falloir faire mieux.
J’ai tendance à penser que le « quoi qu’il en coûte » devrait être appliqué à votre ministère lors du prochain projet de loi de finances ! Nous vous soutiendrons sur ce sujet.

Qu’en est-il du plan national de prévention de la radicalisation annoncé par Édouard Philippe, le 13 juillet 2018 ? Nous n’en avons aucune évaluation !
La problématique à laquelle nous tentons de répondre en ce moment même va percuter le débat qui suivra l’examen de cette proposition de loi et qui porte sur l’irresponsabilité pénale. En effet, nous le savons, de nombreux détenus reconnus comme radicalisés n’ont pas leur place en prison, mais doivent être placés dans des hôpitaux psychiatriques ; or ces établissements n’ont déjà pas les moyens de prendre soin de leurs malades.
On a psychiatrisé le terrorisme avec des effets en cascade : des terroristes dangereux plongés dans le bouillon carcéral sortent plus délinquants qu’ils ne sont entrés. Les médecins experts, peu nombreux, ne peuvent jouer leur rôle.
Quant à la prévention, elle brille par son inefficacité !
Monsieur le garde des sceaux, je souhaite adresser ici, pour la énième fois, un réquisitoire contre le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, le CIPDR. Projets de loi de finances rectificative après projets de loi de finances, nous demandons des évaluations de son action. Il serait temps ! Nous n’avons ni stratégie, ni statistiques, ni suivi. Or c’est extrêmement important, cela a été rappelé à plusieurs reprises au Sénat. Ainsi, la mission d’information conduite par Esther Benbassa et Catherine Troendlé sur les outils de la déradicalisation ou de la lutte contre la radicalisation ou de la reconstruction du lien citoyen – appelons cela comme on veut ! – a montré que ce maillon-là aussi était manquant, ce qui nous conduit à de très nombreuses incertitudes.
Je vous renvoie aussi, mes chers collègues, au travail de la commission des lois et de la commission des affaires sociales sur les failles et les faiblesses de l’expertise psychiatrique – manque d’experts, surcharge de travail, rémunération ridicule…
D’ici au projet de loi de finances, monsieur le garde des sceaux, nous devrons nous pencher très attentivement sur la lutte contre la radicalisation. Nous pourrons évidemment voter ex post, comme d’habitude, de très nombreuses mesures d’ordre répressif. Il n’en demeure pas moins que la prévention est une sécurité qu’il nous faut absolument développer et évaluer. Sinon, nous n’aurons jamais les outils nécessaires pour lutter contre le terrorisme.
Enfin, d’ici à l’examen du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, que vous portez actuellement à l’Assemblée nationale, nous pourrions procéder à une évaluation de l’article 729-2 du code de procédure pénale, qui permet des libérations conditionnelles sous condition d’expulsion. Combien de détenus, dangereux ou non, pourraient-ils se voir appliquer cette disposition ? Cette mesure est-elle susceptible de déplacer le curseur ? Il serait intéressant de le savoir.
Sur ces questions, le Sénat a toujours été aux côtés des ministres de l’intérieur et de la justice qui se sont succédé depuis 2015. Nous avons conscience de l’importance de l’unité nationale dans la lutte contre le terrorisme et dans la prévention, qui doit être placée au cœur du débat, et non « à côté ».
Nous voterons donc le texte proposé, même si, comme d’autres avant lui, celui-ci manquera de moyens humains et financiers. C’est pourquoi j’insiste sur les questions d’évaluation, monsieur le ministre, et j’espère que nous pourrons vous soutenir dans les textes, notamment financiers, à venir.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, selon les chiffres qui nous ont été communiqués lors des auditions menées par Muriel Jourda, 469 personnes sont actuellement incarcérées pour des infractions terroristes, et 162 devraient sortir dans les quatre prochaines années après avoir purgé leur peine. Comment répondre à ce défi alors que, nous le savons, la prison ne permet généralement pas de sortir de l’idéologie qui peut conduire au risque terroriste ?
L’enjeu est majeur, mais nous ne pensons pas que cette proposition de loi, très proche finalement de celle qui a été censurée l’été dernier, soit la bonne réponse.
Le risque est multiplié pour les sorties « sèches », ce qui sera le cas de 75 % environ des prochaines libérations. Rappelons qu’en 2016, à l’occasion d’une prorogation de l’état d’urgence et sur l’initiative de la majorité sénatoriale, les personnes condamnées pour terrorisme ont été exclues des crédits de réduction de peine.
Le rapporteur de la commission des lois, Muriel Jourda, a fait tout son possible pour adapter le texte aux exigences de la décision du Conseil constitutionnel du 7 août 2020 et éviter qu’il n’entre en concurrence avec les Micas, en supprimant notamment l’obligation de pointage. Malheureusement, à notre sens, ses efforts ne suffisent pas à rendre acceptable cette proposition de loi.
Peut-on parler de proportionnalité lorsqu’une mesure de contrainte est susceptible de durer pendant un temps égal à la moitié de la peine déjà effectuée ?
En l’absence d’infraction, la responsabilité de la lutte contre le terrorisme doit relever du seul pouvoir exécutif, qui doit pouvoir prendre les mesures administratives adéquates. En revanche, dès qu’un crime ou un délit est commis, il revient au parquet national antiterroriste de conduire les opérations.
Le groupe socialiste est opposé à ce texte pour des raisons de principe et d’efficacité.
Par principe, nous refusons la rétroactivité du droit et affirmons qu’il ne saurait y avoir de peine après la peine. Par ailleurs, une personne ne peut être condamnée que sur le fondement de ses actes, et non pour ce qu’elle est.
La liste des contraintes autorisées par cette proposition de loi donne le sentiment d’une sorte de mélange avec les mesures de sûreté, par ailleurs vivement critiquées, prises à l’encontre des anciens délinquants sexuels sur le fondement de l’article 132-45 du code pénal. C’est aussi la juridiction de la rétention de sûreté qui se prononcera, mais, pour les anciens délinquants sexuels, elle statue sur la base d’expertises médicales totalement inadéquates pour les anciens condamnés terroristes.
On a l’impression que, pour répondre à une inquiétude, on est allé chercher dans le code pénal des dispositions qui ne sont pas vraiment adaptées.
Nous sommes également opposés au texte pour des raisons d’efficacité. Pourquoi traiter différemment une personne dangereuse selon qu’elle sort ou non de prison ? Si des dispositions sont utiles en matière de prévention, elles doivent pouvoir s’appliquer à tous.
Vous avez évoqué, monsieur le garde des sceaux, une sorte de compétition entre la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRRS), qui se prononcerait sur ces nouvelles mesures, et la justice administrative, qui pourrait notamment se prononcer sur la justification d’un pointage décidé par l’autorité administrative. Ce télescopage pose problème et fragilise l’ensemble du dispositif.
Si la justice judiciaire se prononce contre des mesures de sûreté, peut-on imaginer que l’autorité administrative prenne ensuite des Micas ? C’est un problème au regard de notre capacité à prévenir les actes terroristes.
Il n’est pas souhaitable d’instaurer la moindre confusion ni la moindre compétition entre la JRRS et les juridictions administratives. Il n’est pas souhaitable non plus de partager la responsabilité de la prévention des actes terroristes. C’est pourquoi nous sommes opposés à ce texte, dont les dispositions trouveraient d’ailleurs mieux à s’insérer dans le code de la sécurité intérieure que dans le code pénal.

Pour faire face à cet enjeu majeur de sécurité pour nos concitoyens, il faut avant tout de la clarté entre les peines, qui relèvent de la justice, et les mesures préventives : il ne doit pas y avoir de mélange de responsabilités en matière de prévention des actes et en matière d’instruction sur les infractions et les crimes commis. Si nous ne respectons pas les grands principes de notre droit – pas de peine après la peine, pas de rétroactivité, pas de condamnation d’une personne pour ce qu’elle est –, nous ne pourrons pas relever le défi.
Nous devons cette clarté et cette constance de nos principes à tous ceux qui luttent contre le terrorisme, en France et à l’étranger, dans la police, l’armée, la gendarmerie ou les services, dans la magistrature ou l’administration pénitentiaire, au nom du respect du rôle de chacun. Nous les devons aussi aux Français, au nom de leur sécurité.
C’est pourquoi nous sommes opposés à cette proposition de loi, tout en sachant qu’un certain nombre de dispositions provisoires, utiles, devront de nouveau être examinées par le Parlement d’ici à l’été. Nous aurons alors un débat fondamental sur les outils administratifs et de renseignement qu’il convient de mettre en œuvre pour lutter contre le terrorisme et protéger les Français.
Pour l’heure, nous voterons contre cette proposition de loi inefficace et contraire à nos principes.
Applaudissements sur les travées du groupe SER. – Mme Esther Benbassa applaudit également.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, 62 condamnés pour des crimes ou délits terroristes islamistes sortiront des prisons françaises à l’issue de leur peine en 2021.
Aujourd’hui, en France, il y a 469 personnes détenues en lien avec la mouvance islamiste, dont 162 qui seront remises en liberté dans les quatre prochaines années.
Ces chiffres font froid dans le dos quand on sait à quel point certains de ces individus, que d’aucuns ont pu qualifier de « chances pour la France », demeurent endoctrinés, haineux et imperméables à toute réinsertion sociale. De véritables bombes à retardement que notre modèle juridique est incapable de désamorcer !
Le risque de récidive est sous-estimé, parce que nous ne sommes qu’au début du processus de libération de ces ennemis de la France.
Que notre code pénal puisse donner les moyens à la justice de mettre hors d’état de nuire ces fanatiques, cela devrait être une évidence.
Or, nous étions déjà là, il y a moins d’un an, pour débattre des mesures de suivi des terroristes sortis de prison. Nous y voici de nouveau, après censure du Conseil constitutionnel pour atteinte à certaines libertés fondamentales !
Les libertés fondamentales accordées à des fondamentalistes de la haine des libertés… Cela ressemble à une mauvaise plaisanterie.
De toute évidence, et d’expérience, on fait moins de cas des restrictions de liberté imposées par ce gouvernement aux honnêtes citoyens qu’aux ennemis de la Nation, coupables d’avoir financé des meurtres de masse, d’en avoir perpétrés, d’en avoir fait l’apologie, ou d’avoir tenté de rejoindre le théâtre d’opérations de pays en guerre. Ils bénéficient, eux, d’une protection juridictionnelle constitutionnelle.
Les familles des victimes passées et à venir apprécieront…
La première des libertés, c’est la sécurité. Or, la sécurité des Français exige des restrictions de liberté à l’encontre de ceux qui leur ont déclaré la guerre.
Débarrassons-nous de ces métastases du terrorisme, notamment par des mesures de déchéance de nationalité pour les binationaux, et d’expulsion pour les étrangers qui se seraient rendus coupables d’actes terroristes ou de complicité.
On nous a souvent dit par ailleurs que les auteurs d’actes terroristes ou de menaces islamistes étaient des malades ou des déséquilibrés. L’appréciation médicale de la dangerosité est bien un critère opérant pour la rétention et la surveillance de sûreté, depuis la loi du 25 février 2008, mais il n’a jamais été mis en œuvre en treize ans. Il semblerait que ce soit aussi la volonté et la fermeté qui manquent pour éradiquer la menace islamiste, pas uniquement les outils juridiques.
Quoi qu’il en soit, il ne servira à rien d’étendre perpétuellement les mesures de sûreté et de suivi des condamnés terroristes sortant de détention sans lutter efficacement contre l’origine de ce phénomène, dont la cause principale est l’immigration de masse, qui entraîne le communautarisme, lui-même terreau de l’islamisme.
Combattons sans faiblesse les influences étrangères, les relais islamo-gauchistes, l’islam politique affiché ou dissimulé ! Restaurons l’autorité de l’État et réapprenons à être fiers de notre pays, de son histoire, de son identité.
Il convient, mes chers collègues, d’ajouter aux solutions techniques et juridiques une vision, une action politique globale et déterminée reposant sur un postulat : la sécurité des Français avant les libertés des ennemis de la France !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, « il faut terroriser les terroristes », disait déjà notre cher et regretté Charles Pasqua en 1986, avant le vote des lois qui portaient son nom, des lois courageuses et efficaces, malheureusement immédiatement torpillées par ses successeurs.
Nous sommes loin, si loin, de cette époque où tous les responsables agissaient en harmonie pour combattre l’insécurité.
Ce regretté ministre de l’intérieur disait aussi que l’insécurité devait changer de camp et que, entre nous et les terroristes, la guerre était engagée.
Oui, l’insécurité doit changer de camp ! Oui, il faut relever la police que l’on a mise à terre. Elle peut, soyez-en assurés, mes chers collègues, se tenir définitivement debout contre les terroristes, à condition de lui en donner les moyens légaux.
Cette proposition de loi, que j’ai cosignée, n’est pas révolutionnaire, mais elle constitue un pas, un petit pas nécessaire pour apporter un début de solution à cette gangrène qu’est le terrorisme pour notre pays.
Instaurer une nouvelle mesure judiciaire de suivi et de surveillance postsentencielle visant à prévenir la récidive et à accompagner la réinsertion des individus condamnés pour des faits de terrorisme est une nécessité absolue.
Je voudrais vous rappeler quelques chiffres, mes chers collègues. Sur les 269 condamnés pour terrorisme en lien avec la mouvance islamique suivis par le service de l’application des peines, 20 % seront suivis à leur libération dans le cadre sociojudiciaire, et 5 % dans le cadre d’un sursis probatoire. Cela signifie donc que 75 % d’entre eux pourront bénéficier de mesures d’accompagnement sur la durée des réductions de peine éventuellement octroyées.
Le 27 juillet 2020, le Parlement adoptait une loi introduisant une nouvelle mesure judiciaire de suivi et de surveillance postsentencielle envers les condamnés pour faits de terrorisme, avec deux objectifs : prévenir la récidive et accompagner la réinsertion.
Cette mesure de sûreté a curieusement été censurée par le Conseil constitutionnel : il a jugé qu’elle n’était ni adaptée ni proportionnée à l’objectif et l’a déclarée contraire à la Constitution.
La proposition de loi portée par François-Noël Buffet reprend l’esprit du texte adopté en juillet 2020 tout en y apportant des aménagements destinés à répondre aux cinq objections du Conseil constitutionnel.
Je ne reviendrai pas ici sur ces points techniques, le rapporteur Muriel Jourda l’ayant fait avec clarté. Je voudrais en revanche apporter deux précisions fondamentales.
La première, c’est que cette proposition de loi est indispensable à notre arsenal judiciaire pour lutter contre le fléau que représente la sortie de détention des terroristes.
La seconde est républicaine. Je veux lancer un appel, un cri d’alarme au Président de la République, aux ministres et à vous tous, mes chers collègues.
L’État de droit, enfant légitime de notre histoire, est ce que nous avons de plus noble et de plus grand en France. Nous y sommes tous ici profondément attachés ; nous le respectons, il coule dans nos veines. Mais, aujourd’hui, n’en avons-nous pas une conception obsolète et naïve, qui coûte des vies ?
Régulièrement, le Conseil constitutionnel censure des lois qui n’ont rien d’excessif et qui auraient pu sauver des vies, parce qu’elles sont en adéquation avec l’extrême violence qui prospère sans conteste dans notre société.
Je vous le dis haut et fort, mes chers collègues, la loi doit être conforme à la Constitution, mais encore faut-il que la Constitution soit conforme à la gravité du terrorisme. Est-ce bien le cas aujourd’hui ?
Mesdames, messieurs les membres du Gouvernement, proposer un référendum dont le seul objet serait d’ajouter le mot « développement durable » dans notre Constitution est superfétatoire. Ayez l’ambition et le courage de proposer un vrai référendum, un référendum utile pour la France et les Français, un référendum qui porte sur les moyens donnés à nos forces de sécurité et à notre système pénal pour lutter efficacement contre le terrorisme. L’urgence est indéniable !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. - MM. Yves Détraigne et Franck Menonville applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, indéniablement, la question de la sortie de prison, dans les prochaines années, de condamnés pour des faits de terrorisme constitue l’un des principaux enjeux sécuritaires d’aujourd’hui. En effet, comme vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, ce ne sont pas moins de 162 détenus qui devraient être libérés dans les quatre prochaines années, condamnés, pour la plupart d’entre eux, à des peines inférieures à sept ans, très inférieures à celles qui sont désormais prononcées.
Certains de ces détenus sont probablement dangereux, et leur séjour en prison n’a sans doute nullement permis de mettre fin à leur engagement terroriste.
Toutefois, nous n’avons pas la possibilité, alors qu’une peine a été prononcée et purgée, de prononcer une nouvelle peine pour les mêmes faits ; c’est la règle non bis in idem, qui est un principe fondamental de notre code pénal. Aussi, la protection de la société ne peut être recherchée que par des mesures de surveillance et d’accompagnement, qui peuvent comporter une part de contrainte, à l’instar des mesures de police administrative qui restreignent les libertés.
En votant, au mois de juillet dernier, une proposition de loi visant à instaurer ce nouveau régime de mesures de sûreté, nous savions que nous nous étions engagés sur un chemin de crête. Pour autant, ce texte visait à répondre au problème des sorties « sèches » des condamnés pour terrorisme, ce qui sera le cas de la plupart de ceux qui sortiront de prison d’ici à 2024. Souvent condamnés à des peines sans aménagement, ces individus n’ont pas systématiquement été contraints à un suivi sociojudiciaire, la loi de 2016 n’étant pas rétroactive.
Et même si certaines dispositions de la loi de juillet dernier ont été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 août 2020, ce dernier a lui-même ouvert la porte à un texte de remplacement en précisant, de manière très pédagogique, les motifs l’ayant conduit à juger le texte déséquilibré.
Nous disposions ainsi d’un cadre de référence pour avancer dans le respect de la Constitution, avec la plus grande prudence, mais en restant conscients de la dangerosité de certains individus.
C’est tout l’objet de la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui, qui s’inscrit dans la droite ligne des dispositions antérieures. Rappelons que le Conseil constitutionnel ne s’est pas opposé au principe même de l’établissement de mesures de sûreté dans le cas de la sortie de prison des détenus terroristes, et qu’il a admis la légitimité de la mesure au regard de l’objectif à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public. Il a confirmé ainsi que la mesure de sûreté n’était pas une sanction pénale dès lors qu’elle respectait un certain nombre de critères rappelés, déjà, dans sa décision du 21 février 2008.
François-Noël Buffet, auteur de la présente proposition de loi, a d’ailleurs souhaité reprendre l’idée d’un suivi judiciaire postsentenciel conditionné à une évaluation de la dangerosité du condamné, et dont la durée serait fixée indépendamment de la durée des réductions de peine accordées au condamné.
En définitive, c’est cet équilibre entre la nécessité de protéger la société et de respecter les principes juridiques fondamentaux que vous vous êtes efforcés, monsieur le président de la commission, madame le rapporteur, de renforcer, en déplaçant quelque peu le centre de gravité de certaines dispositions pour prendre en compte les observations du Conseil constitutionnel.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi de saluer la constance et la technicité de nos commissaires aux lois, qui symbolisent l’esprit d’équilibre et de responsabilité propre au Sénat.
Je le dis à cette tribune, sous le regard de Michel de L’Hospital et de Henri François d’Aguesseau, dont la rigueur n’avait d’égal que l’esprit de tolérance.
C’est parce que nous veillons à l’exécution de peines proportionnées que nous mettons un point d’honneur à parfaire le droit ou à combler des carences observées.
Je renverserai un célèbre adage pour vous dire ce que nous refusons tous ici en matière antiterroriste : agiter une main de velours dans un gant de fer.
C’est dans cet esprit, exigeant et proactif, que nous traitons ce jour d’une problématique sécuritaire aux atours de défi civilisationnel.
Je veux bien sûr saluer le travail de mes collègues Muriel Jourda et François-Noël Buffet, qui, animés par les exigences de l’État de droit, sont parvenus à corriger un vide juridique particulièrement inquiétant pour la sécurité des Français. Nous connaissons tous ici les chiffres qui nous conduisent à anticiper des sorties « sèches » qui nous inquiètent, mais nous partageons également la conviction qu’il faut aller plus loin et imaginer une réforme de structure proportionnée à un phénomène que nous ne pouvons ignorer.
Je le dis à cette tribune comme représentante d’un département meurtri par l’islamisme.
En effet, si nous débattons avec une telle acuité du suivi des condamnés pour terrorisme, c’est aux fins d’apporter un palliatif aux deux enjeux qui défient l’autorité de l’État et qu’il faudra tôt ou tard affronter : le sens de la peine et sa proportionnalité, d’une part ; la physionomie du milieu carcéral, d’autre part.
C’est au Sénat que nous devons l’instauration d’une peine incompressible de trente ans et la limitation drastique des conditions d’aménagement de peine. Il nous faut désormais aller beaucoup plus loin, ne serait-ce qu’au regard des nouveaux profils auxquels nous avons affaire. Le terrorisme est de plus en plus juvénile, et son traitement pénal ne peut l’ignorer.
Nous savons que les crédits de réduction automatique seront supprimés si le projet de loi Dupond-Moretti est adopté en l’état. Malgré tout, c’est la question de la perpétuité réelle que nous devons aborder. Ne nous y trompons pas, en effet : incompressibilité ne rime pas avec enfermement à vie.
Je rappelle que le droit interne britannique, pourtant inspiré par l’Habeas Corpus, et dont personne n’oserait dire qu’il piétine les droits de la défense, ne permettait ni élargissement ni réexamen des peines de perpétuité réelle jusqu’à ce que le juge européen n’exige la clarification d’un droit pourtant souverain. Les juridictions ne doivent pas être contraintes à offrir au condamné une perspective de libération dangereuse pour la société.
La physionomie du milieu carcéral constitue le deuxième mal à traiter. L’instauration de cette perpétuité réelle dès le prononcé paraît d’autant plus nécessaire que la prison est marquée par une spécificité démographique notable. Selon le dernier numéro des Cahiers d ’ études pénitentiaires, l’âge moyen des personnes détenues était en France d’environ 35 ans, soit 13 ans de moins que celle de la population générale.
Les condamnés pour terrorisme n’échappent pas à cette réalité, bien au contraire. Il n’est que de rappeler l’âge des cinq derniers terroristes ayant frappé en France pour comprendre le défi générationnel qui est le nôtre : 36, 33 et 30 ans pour ceux de Rambouillet, Charlie Hebdo et Colombes, 21 ans pour l’assaillant de Nice et seulement 18 ans pour le terroriste de Conflans.
Mes chers collègues, c’est aussi le « djihadisme d’atmosphère », décrit par Gilles Kepel, que nous devons aujourd’hui défier. Or, sans suivi des détenus terroristes, relais potentiels d’une idéologie qui croît souvent en prison, c’est notre jeunesse que nous exposons.
Cette proposition de loi s’attaque donc courageusement aux dommages collatéraux d’un phénomène qui constitue un défi pour notre civilisation. Nous traitons aujourd’hui les conséquences d’un mal dont il faudra très vite arracher les racines. Le travail sera long, car celles-ci se propagent pernicieusement jusque dans nos prisons.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. - MM. Yves Détraigne et Franck Menonville applaudissent également.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : «, du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article 706-16, la référence : « à l’article 706-25-7 » est remplacée par les références : « aux articles 706-25-7 et 706-25-19 » ;
3° L’article 706-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de sûreté prévues à la section 5 du présent titre sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 706-22-1, après la référence : « 706-17 », sont insérés les mots : « et les personnes astreintes aux obligations prévues à l’article 726-25-16 » ;
5° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Mesure de sûreté applicable aux auteurs d’infractions terroristes
« Art. 706 -25 -16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, qu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République et dans les conditions prévues à la présente section, ordonner à son encontre une mesure de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 132-44 du code pénal et aux 1°, 12°, 13°, 14° et 20° de l’article 132-45 du même code.
« II. – Lorsque les obligations mentionnées au I susceptibles d’être imposées à la personne faisant l’objet d’une mesure de sûreté en application du même I apparaissent insuffisantes pour prévenir sa récidive, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, par une décision spécialement motivée au regard de sa situation, de sa personnalité et de son extrême dangerosité, la soumettre à une ou plusieurs des obligations prévues aux 2°, 8°, 9° et 19° de l’article 132-45 du code pénal.
« III. –
Supprimé
« IV. – La mesure de sûreté prévue au I ne peut pas être ordonnée à l’encontre des personnes libérées avant la publication de la loi n° … du … renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention.
« V. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que :
« 1° Si les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du même I ;
« 2° Et si cette mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive.
« La mesure de sûreté prévue audit I n’est pas applicable si la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis simple en application de l’article 132-29 du code pénal, à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire en application de l’article 132-40 du même code, sauf si le sursis probatoire a été révoqué en totalité en application de l’article 132-47 dudit code, à un suivi sociojudiciaire en application de l’article 421-8 du même code ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723-29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706-53-19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706-53-13.
« Art. 706 -25 -17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure de sûreté prévue à l’article 706-25-16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité.
« À cette fin, la commission demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.
« À l’issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706-25-16 au vu des critères définis au I du même article 706-25-16.
« Art. 706 -25 -18. – La mesure de sûreté prévue à l’article 706-25-16 est prononcée, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La décision doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706-25-17, ainsi que des conditions mentionnées au V de l’article 706-25-16.
« La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer la mesure prévue au même article 706-25-16 qu’après avoir vérifié que la personne a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée à sa personnalité et à sa situation, de nature à favoriser sa réinsertion.
« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles-ci.
« La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération.
« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706-53-17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté ou ordonner leur mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations de la mesure de sûreté.
« Art. 706 -25 -19. – La mesure de sûreté prévue à l’article 706-25-16 est prononcée pour une durée maximale d’un an.
« À l’issue de cette période, elle peut être renouvelée pour la même durée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, sur réquisitions du procureur de la République et après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dès lors que des éléments actuels et circonstanciés permettent d’établir que les conditions prévues au premier alinéa du I du même article 706-25-16 continuent d’être réunies.
« La durée totale de la mesure ne peut excéder trois ans ou, lorsque le condamné est mineur, deux ans. Cette limite est portée à cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, à trois ans, lorsque la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à dix ans.
« Art. 706 -25 -20. – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du premier alinéa de l’article 706-22-1. Elles peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706-53-15.
« Art. 706 -25 -21. – La mesure prévue à l’article 706-25-16 et les obligations y afférentes sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.
« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la mesure et d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706-25-16 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.
« Art. 706 -25 -22. – Le fait pour la personne soumise à une mesure de sûreté en application de l’article 706-25-16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Art. 706 -25 -23. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »

J’ai écouté avec attention la discussion générale, en particulier l’intervention du garde des sceaux et de notre collègue Alain Richard, grand spécialiste du sujet.
L’année dernière, j’avais soulevé le problème du suivi des terroristes sortant de prison comme rapporteur du projet de loi visant à prolonger plusieurs dispositions expérimentales de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, dite loi « SILT ».
À cette occasion, Philippe Bas et moi-même avions élaboré, avec plusieurs collègues, une proposition de loi dont l’essentiel avait été repris par l’Assemblée nationale avant d’être censuré par le Conseil constitutionnel. Néanmoins, comme l’a souligné Stéphane Le Rudulier, ce dernier a validé le principe des mesures de sûreté et tracé le périmètre d’une solution constitutionnellement acceptable, présentant de nouvelles durées et de nouvelles garanties que nous retrouvons dans l’article 1er de la présente proposition de loi.
On peut légitimement s’interroger sur l’efficacité des Micas prises à l’égard des individus condamnés pour des faits de terrorisme à leur sortie de détention.
Certes, le ministère de l’intérieur prononce désormais systématiquement de telles mesures, alors qu’il ne le faisait que pour un tiers des personnes ciblées il y a encore deux ans.
Si elles offrent des possibilités de surveillance renforcée, les Micas présentent aussi à nos yeux des garanties insuffisantes, des motivations difficiles à exprimer, et surtout une durée très limitée.
Dans l’article 3 du projet de loi qui sera présenté prochainement, les restrictions de liberté devraient être singulièrement renforcées dans les Micas. En refusant ainsi de suivre l’avis du Conseil d’État, le Gouvernement s’expose à une censure du Conseil constitutionnel.
Il y avait alors deux solutions : celle que propose François-Noël Buffet, à savoir prononcer une mesure de sûreté qui réponde aux exigences du Conseil constitutionnel en termes de garanties et de champ d’application, ou prévoir une mesure de suivi judiciaire.
Monsieur le garde des sceaux, vous avez eu raison de dire que nous sommes sur une ligne de crête juridique et qu’il faut éviter la superposition des mesures, sauf que le Gouvernement propose lui-même, dans le projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement que nous examinerons à la fin du mois de juin, un dispositif de Micas aux effets étendus accompagné d’une mesure de suivi judiciaire.
En ce qui nous concerne, nous pensons que la voie choisie hier par Philippe Bas, aujourd’hui par François-Noël Buffet, est infiniment plus sûre, plus forte et plus efficace. Surtout, elle évite le risque d’une nouvelle censure par le Conseil constitutionnel. Or, je le redis, ce risque existe au sujet de l’article 3 du projet de loi que je viens de citer, ce que n’a pas manqué de relever Alain Richard dans son intervention en discussion générale.
Je soutiens donc pleinement la logique de la proposition de loi déposée par François-Noël Buffet : la durée me paraît bonne, …

Monsieur le garde des sceaux, nous aurons l’occasion de reprendre ce débat dans un mois, mais, comme l’indiquait Alain Richard, il me semble souhaitable que nous trouvions les voies d’un compromis entre les parlementaires et le Gouvernement.

L’amendement n° 12, présenté par Mme M. Jourda, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer la référence :
par la référence :
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. Parigi, Dantec et Dossus, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Gontard, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Après le mot :
exclusion
insérer les mots :
des infractions n’induisant que des atteintes aux biens matériels et non à l’intégrité physique des personnes,
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

Cette proposition de loi est présentée comme s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamiste.
Si les auteurs de cet amendement peuvent souscrire de manière générale à la mise en œuvre de mesures pour combattre ce fléau, ils émettent de très grandes réserves sur les dispositions exorbitantes du droit commun, désormais trop nombreuses, qui dépassent bien souvent leur but premier.
En l’état, le renforcement des mesures de sûreté à destination des terroristes islamistes à l’issue de leur peine est trop général, tout comme l’étaient certaines dispositions de la loi SILT et antérieurement la création du Fijait qui englobe d’autres individus que les terroristes islamistes.
Les auteurs de l’amendement craignent que ce régime ad hoc ne s’applique aussi, de facto, à des militants politiques – écologistes, altermondialistes, animalistes, corses, basques, etc. –, ce qui s’avérerait totalement disproportionné par rapport à l’action militante pour laquelle ils ont été condamnés.
Dans ces situations, les dispositions pénales de droit commun sont amplement suffisantes et ces mesures de sûreté à l’issue de la peine apparaîtraient trop sévères pour bon nombre de ces militants, comme l’est déjà aujourd’hui d’ailleurs l’inscription au Fijait.
C’est la raison pour laquelle, tout en réaffirmant leur réserve de principe à ce texte, les auteurs de l’amendement appellent a minima à l’introduction d’une distinction entre les destructions matérielles de biens et l’atteinte volontaire à la vie humaine.
Ainsi, cet amendement propose que les individus condamnés pour des atteintes aux biens soient exclus du dispositif prévu par le présent texte, conformément au principe général de proportionnalité de la peine qui prévaut en droit pénal.

Je ne porterai pas de jugement sur la valeur du militantisme violent.
Je voudrais simplement indiquer que, si nous adoptions cet amendement, nous ferions perdre beaucoup d’efficacité au dispositif prévu dans cette proposition de loi, puisque ne seraient plus concernées les infractions relatives au financement du terrorisme ou les associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.
Or ce sont sur ces bases qu’ont été prononcées nombre de condamnations concernées par la proposition de loi. Je vous propose donc, mes chers collègues, de nous en tenir à la rédaction du texte de la commission.
L’avis est défavorable sur cet amendement.
J’ai exactement la même analyse que celle que vient de présenter Mme la rapporteure. Quid de l’association de malfaiteurs ? Il est compliqué de distinguer en droit entre toutes les causes que vous avez avancées – les animalistes, etc. En tout cas, le texte perdrait en efficacité.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 11, présenté par M. Levi, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer la troisième occurrence du mot :
et
par le mot :
ou
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.

Les trois amendements que j’ai déposés à l’article 1er de ce texte visent à étendre un peu le champ d’application des mesures de sûreté. Ces mesures me semblent très positives, mais les trop nombreuses conditions imposées pour leur application risquent à mon sens de rendre ce dispositif inopérant ou inapplicable dans les faits. Il y a pourtant une réelle urgence et l’intérêt sécuritaire de ces mesures est évident.
Cet amendement vise à supprimer la double condition – probabilité très élevée de récidive et adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme – et à prévoir que l’une de ces conditions suffit pour mettre en œuvre une mesure de sûreté.
Il s’agit donc d’étendre le champ d’application du dispositif.

La proposition de loi prévoit que la mesure de sûreté dont nous débattons n’est applicable que si l’individu présente une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme. Cet amendement vise à transformer ce cumul de conditions en une alternative.
Dans l’objet de votre amendement, vous évoquez, mon cher collègue, le terrorisme islamiste, mais il me semble que, de quelque nature qu’il soit, le terrorisme est de toute façon sous-tendu par une théorie – celle-ci sera donc nécessairement présente.
De surcroît, je rappelle que le Conseil constitutionnel a considéré que les critères permettant de prononcer la mesure étaient adaptés. Par conséquent, je propose de nous y tenir.
C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.
Si nous retenions cet amendement, la seule adhésion à une idéologie constituerait un critère suffisant, ce qui ne manquerait pas de nous faire encourir la censure du Conseil constitutionnel. J’y suis donc défavorable.


Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 15 de cet article, qui prévoit qu’une mesure de sûreté ne peut être ordonnée que si les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission de nouvelles infractions.
L’expérience de ces dernières années nous a malheureusement démontré que, trop souvent, des personnes étaient inscrites dans des fichiers, mais avec peu d’informations, et qu’elles pouvaient par conséquent être considérées comme non dangereuses, alors qu’elles présentent en réalité une dangerosité certaine.

Il s’avère que l’une des conditions posées par le Conseil constitutionnel est que la mesure de sûreté ne soit que subsidiaire par rapport aux autres mesures qui existent. C’est pourquoi cet alinéa prévoit effectivement que la mesure de sûreté ne peut pas être ordonnée, si les obligations déjà imposées sont appropriées.
Il me paraît difficile, sans encourir de nouveau les foudres du Conseil constitutionnel, de nous passer de cette condition qui affirme le caractère subsidiaire de la mesure de sûreté.
C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

L’amendement n° 10 est retiré.
L’amendement n° 1 rectifié ter, présenté par Mme Borchio Fontimp, MM. Bascher, Bonhomme et Bonne, Mmes Boulay-Espéronnier et V. Boyer, MM. Burgoa, Boré, Cadec et Charon, Mmes Demas, Deromedi et Dumont, MM. Favreau et B. Fournier, Mmes Garnier et Garriaud-Maylam, M. Genet, Mmes Goy-Chavent et Gruny, MM. Laménie, Le Rudulier, Lefèvre et Meurant, Mmes Micouleau et Muller-Bronn, MM. Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mme Raimond-Pavero et MM. Savin, C. Vial et Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
et leur probabilité de récidive
La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp.

Le niveau de risque de récidive est à la fois le corollaire et la conséquence de la dangerosité des individus condamnés pour actes de terrorisme. Devant cette haine meurtrière envers ce que nous sommes, des citoyens libres et éclairés, la plus grande rigueur doit être de mise.
La proposition de loi marque une avancée indéniable dans la reconquête de fermeté et de crédibilité. Dans cette droite ligne, cet amendement propose de compléter l’alinéa 18, en introduisant une référence explicite au niveau de risque de récidive.

Les choses vont sans dire ; elles vont encore mieux en les disant ! Cet amendement de précision me paraît utile.
Avis favorable.
Je sollicite le rejet de cet amendement, parce que je pense que l’objet en est déjà satisfait. En effet, il tend à préciser que la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté doit également évaluer le niveau de risque de la personne, outre sa dangerosité.
Je rappelle que la mesure de sûreté ne sera applicable qu’à des personnes qui présentent une particulière dangerosité ; le texte précise que cette dernière devra être caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme.
Il est par conséquent inutile de préciser de nouveau que l’évaluation de la personne devra permettre de définir le niveau de ce risque.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 2 rectifié bis, présenté par Mme Borchio Fontimp, MM. Bascher, Bonhomme et Bonne, Mmes Boulay-Espéronnier et V. Boyer, MM. Burgoa, Boré, Cadec et Charon, Mmes Demas, Deromedi et Dumont, MM. Favreau et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mmes Goy-Chavent et Gruny, MM. Laménie, Le Rudulier, Lefèvre et Meurant, Mmes Micouleau et Muller-Bronn, MM. Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mme Raimond-Pavero et MM. Savin, C. Vial et Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Remplacer le mot :
six
par le mot :
huit
La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp.

Cette proposition de loi expose clairement son objectif : garantir la sécurité de nos concitoyens, en permettant à la justice de mieux surveiller certains individus et d’adapter en conséquence les sanctions en fonction de l’importante dangerosité qui les caractérise.
Cet amendement vise à porter à huit semaines le placement du détenu dans le service spécialisé chargé de son observation. Face aux risques indéniables de récidive de ces individus, il est impérieux de permettre aux agents de ce service de bénéficier d’un temps d’observation et d’étude plus long, afin de mener leur travail d’expertise dans les meilleures conditions.
Il vise donc à garantir que la période d’observation soit d’une durée raisonnable afin que nos institutions puissent protéger au mieux les Français des désirs meurtriers de ces individus.

Nous sommes évidemment d’accord sur la nécessité d’évaluer efficacement la dangerosité des détenus qui vont sortir de détention.
Néanmoins, je ferai observer que la durée de six semaines est une durée minimale, et non maximale, de sorte que, dans les faits, elle peut être supérieure. De surcroît, lors de nos auditions, nous n’avons entendu personne déplorer la durée qui avait été fixée par le texte. C’est pourquoi je vous propose de nous en tenir à cette rédaction.
Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Madame Alexandra Borchio Fontimp, l’amendement n° 2 rectifié bis est-il maintenu ?

L’amendement n° 2 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 9, présenté par M. Levi, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.

Cet amendement vise à supprimer la condition d’application des mesures de sûreté liée au fait que le détenu ait pu bénéficier de façon effective de mesures de réinsertion dans le cadre de sa détention.
Cette limitation supplémentaire peut avoir in fine des conséquences sécuritaires, car il peut arriver que, par défaillance due à un manque de moyens ou de personnel, l’administration pénitentiaire ne puisse pas offrir un programme de réinsertion à tous les détenus.
Il convient donc de supprimer cette condition supplémentaire.

J’entends bien le souci d’efficacité qui vous anime, mon cher collègue, mais je crains fort de ne pouvoir vous être agréable. C’est en effet le Conseil constitutionnel qui a fixé comme condition à la mise en œuvre de la mesure de sûreté le fait que le détenu ait pu bénéficier de mesures de réinsertion.
Je me suis posé les mêmes questions que vous. J’ai par conséquent interrogé les services compétents : il n’y a pas aujourd’hui de difficultés pour mettre en œuvre, pendant la détention, des mesures de réinsertion. Cette disposition est donc aisément applicable actuellement.
De surcroît, je le répète, elle correspond à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à laquelle nous devons bien évidemment nous conformer.
C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Comme je l’indiquais dans mon intervention en discussion générale, il existe aujourd’hui des quartiers d’évaluation de la radicalisation et des quartiers de prise en charge. Des programmes tendant à la réinsertion y sont mis en œuvre, en particulier dès qu’une dangerosité ou une radicalisation potentielle est décelée.
Je rappelle par ailleurs que l’alinéa en question correspond à une condition posée par le Conseil constitutionnel. De ce fait, si cet amendement était retenu, nous repartirions pour un tour, si vous me permettez cette expression, et nous perdrions par conséquent beaucoup de temps.

L’amendement n° 9 est retiré.
L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par Mme Borchio Fontimp, MM. Bascher, Bonhomme, Bonne, Burgoa, Boré, J.M. Boyer et Charon, Mmes Demas, Deromedi et Dumont, M. Favreau, Mme Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier et Genet, Mmes Goy-Chavent et Gruny, MM. Laménie et Meurant, Mmes Micouleau et Muller-Bronn, MM. Lefèvre, Le Rudulier, Pellevat et Piednoir, Mme Raimond-Pavero et MM. Savin, C. Vial et Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de deux ans
La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp.

Cet amendement vise à permettre d’ordonner la mise en place de la mesure de sûreté pour une durée maximale de deux ans.
Ces individus ont commis des actes visant à détruire la République, faire tomber nos institutions et assassiner lâchement nos concitoyens. Des académiques et des journalistes ont mené des enquêtes pour comprendre les phénomènes de radicalisation et de déradicalisation : beaucoup ont attesté du caractère presque irréversible de la radicalisation et prévenu des difficultés induites par la déradicalisation.
L’une des difficultés mises ainsi en avant est liée à la durée d’observation et de surveillance. Dans ces conditions, bien que la mesure initiale d’une durée maximale d’un an puisse être renouvelée, cette durée demeure en l’état difficilement comprise et acceptée par une majorité de nos concitoyens.

Nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen du texte dont Jacqueline Eustache-Brinio était rapporteur et qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Un accord a été trouvé avec l’Assemblée nationale pour fixer la durée de la mesure de sûreté à un an.
Dans la mesure où le texte qui a été déposé a pour but de répondre à la censure du Conseil constitutionnel, pas de modifier l’architecture de ce qui avait été mis en place, je vous propose de retirer cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Madame Alexandra Borchio Fontimp, l’amendement n° 3 rectifié bis est-il maintenu ?

L’amendement n° 3 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 4 rectifié bis, présenté par Mme Borchio Fontimp, MM. Bascher, Bonhomme, Bonne, Burgoa et Boré, Mme V. Boyer, M. Charon, Mmes Demas, Deromedi et Dumont, MM. Favreau et B. Fournier, Mmes Garnier et Garriaud-Maylam, M. Genet, Mmes Goy-Chavent et Gruny, MM. Laménie, Le Rudulier, Lefèvre et Meurant, Mmes Micouleau et Muller-Bronn, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Raimond-Pavero et MM. Savin et Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 31
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
six
La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp.

Malgré le travail titanesque abattu, les magistrats ne peuvent pas toujours tenir les délais prévus par les textes. Cet amendement propose donc d’étendre le délai initial de trois à six mois afin que la juridiction régionale de la rétention de sûreté bénéficie d’un délai raisonnable pour confirmer ou non le maintien des obligations prévues.

Les alinéas visés par cet amendement concernent des situations dans lesquelles, durant la période d’exécution d’une mesure de sûreté, la personne en question est détenue pour une raison autre que celle qui est liée à cette mesure. Dans ce cas, la mesure de sûreté est suspendue.
Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la mesure de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.
Porter ce délai à six mois me semble difficile, car les mesures dont nous parlons sont attentatoires aux libertés, si bien qu’une juridiction doit statuer le plus rapidement possible.
C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Madame Alexandra Borchio Fontimp, l’amendement n° 4 rectifié bis est-il maintenu ?
L ’ article 1 er est adopté.
L’article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Les obligations ou interdictions prévues au 5° de l’article 132-44 du code pénal et aux 8°, 9°, 12° à 14° et 19° de l’article 132-45 du même code prononcées dans le cadre d’une mesure de sûreté applicable aux auteurs d’infractions terroristes prévue à l’article 706-25-16 du code de procédure pénale. » –
Adopté.
Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ». –
Adopté.

L’amendement n° 5, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’accès aux activités de réinsertion des personnes détenues mises en cause dans des affaires de terrorisme islamiste ou celles, écrouées pour des faits de droit commun, repérées par l’administration et par les services de renseignement comme étant « susceptibles de radicalisation ».
La parole est à Mme Esther Benbassa.

Il est fondamental, pour garantir la sûreté et la sécurité des citoyens, de prévenir toute sortie sèche de détenus radicalisés.
Or aucune mesure relative à la prévention n’est présente dans cette proposition de loi, qui contient surtout une série de mesures de sûreté dont l’utilité n’aura que peu d’effets sur le degré de radicalité de la personne au cours des prochaines années.
Nous estimons qu’en matière de lutte contre la radicalisation islamiste il est important de ne pas avoir une approche fondée uniquement sur la surveillance. Le temps de la détention doit être mis à profit pour prévenir la récidive et accompagner vers la déradicalisation, voire le désengagement.
Ainsi, pour faire écho au rapport sénatorial sur la radicalisation, qui a été publié en 2017 et que j’ai eu l’honneur de corédiger avec Mme Catherine Troendlé, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’accès aux activités de réinsertion des personnes détenues mises en cause dans des affaires de terrorisme islamiste et de celles qui sont écrouées pour des faits de droit commun et repérées par l’administration et les services de renseignement comme étant susceptibles de radicalisation.

Madame Benbassa, vous connaissez la position traditionnelle, juridiquement étayée, de la commission des lois sur les demandes de rapport. Non seulement le Parlement ne peut pas donner d’instructions au Gouvernement, mais de surcroît nous disposons nous-mêmes de moyens d’évaluation qui nous permettent de présenter des rapports. C’est d’ailleurs le rapport que vous avez présenté avec Mme Troendlé que vous citez pour justifier votre demande.
Par conséquent, il me semble – je parle sous le contrôle de M. le président de la commission des lois – qu’il est toujours possible pour la commission de travailler sur un tel rapport.
J’ajoute qu’un organisme indépendant, l’Institut français des relations internationales (IFRI), a publié en février 2021 une étude sur le sujet qui vous intéresse, madame Benbassa – je note au passage qu’il cite votre propre rapport…
En tout état de cause, au regard de la jurisprudence habituelle de la commission des lois, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Pour tout vous dire, madame la sénatrice, le Gouvernement n’est pas très favorable à la multiplication des rapports. Il me semble que le Parlement dispose déjà de multiples moyens d’information et de contrôle de l’activité du Gouvernement.
Dans ces conditions, je suis contraint de vous dire que je suis défavorable à cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention.
La proposition de loi est adoptée.

Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux pour trente minutes.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures vingt, est reprise à dix-sept heures cinquante-neuf.

Mes chers collègues, je tiens à vous informer que M. le garde des sceaux, ministre de la justice est retenu plus longtemps que prévu à l’Assemblée nationale, l’examen du texte pour lequel il était requis s’étant prolongé. C’est en raison de ce retard que nous n’avons pas pu reprendre nos travaux à dix-sept heures cinquante, ainsi que le Gouvernement l’avait demandé.
Nous n’avons d’autre choix que d’attendre le retour du garde des sceaux, car le ministre chargé des relations avec le Parlement n’est pas en mesure de le remplacer dans l’immédiat.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures, est reprise à dix-huit heures quinze.

Monsieur le garde des sceaux, cela fait maintenant près d’une heure que nous vous attendons.
Même si nous comprenons parfaitement vos impératifs, puisque vous deviez, je crois, vous rendre à l’Assemblée nationale pour assister au vote solennel sur un texte important, l’agenda du Sénat – comme celui de l’Assemblée nationale d’ailleurs – est très serré. De fait, le Gouvernement aurait peut-être pu prévoir qu’un autre membre du Gouvernement prenne le relais.
Si je le dis, c’est pour que vous parveniez à une meilleure coordination à l’avenir et que nous perdions le moins de temps possible même si, encore une fois, je comprends les raisons de votre absence dans cet hémicycle.

Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.
Monsieur le garde des sceaux, puisqu’il semblerait que vous souhaitiez présenter des excuses, je vous donne la parole à titre exceptionnel.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice. Je vous remercie, madame la présidente.
M. le garde des sceaux est essoufflé.
Je tiens à présenter, malgré l’essoufflement qui est encore le mien, mes plus plates excuses à l’ensemble des sénatrices et des sénateurs.
Je suis contre le rappel à la loi, parce que je pense qu’il ne sert à rien, mais sachez que j’entends votre rappel au règlement, monsieur le président Retailleau.
M. Bruno Retailleau rit puis applaudit.
Une fois encore, je vous prie de bien vouloir m’excuser de vous avoir fait attendre. Un ministre, même de bonne volonté, n’a pas le don d’ubiquité : c’est un défi trop difficile à relever.

L’ordre du jour appelle, à la demande respective du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains, la discussion de la proposition de loi tendant à revoir les conditions d’application de l’article 122-1 du code pénal sur la responsabilité pénale des auteurs de crimes et délits, présentée par Mme Nathalie Goulet et plusieurs de ses collègues (proposition n° 232 [2019-2020]), et de la proposition de loi relative aux causes de l’irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l’expertise en matière pénale, présentée par MM. Jean Sol, Jean-Yves Roux, Mme Catherine Deroche, MM. François-Noël Buffet, Philippe Bas, Bruno Retailleau, Mme Nathalie Delattre et plusieurs de leurs collègues (proposition n° 486) (texte de la commission n° 603, rapport n° 602, avis n° 598).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme Nathalie Goulet, auteur de la proposition de loi et rapporteur.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les textes que nous examinons portent sur la question de l’irresponsabilité pénale et de la place du fait fautif de l’auteur. Ce sujet est extrêmement délicat, car il est aux confins du droit, de la médecine et de la santé.
Nous avons beaucoup travaillé au Sénat sur le terrorisme, et sur cette tendance – on l’a vu lors du précédent débat – à « psychiatriser » les actes terroristes. C’est d’ailleurs à la suite des multiples attaques au couteau survenues en janvier 2020, et des déclarations d’irresponsabilité pénale de leurs auteurs, que j’ai déposé ma proposition de loi, et non à cause de l’arrêt de la cour d’appel de Paris de décembre 2019 sur l’affaire Sarah Halimi.
À l’époque, j’avais pensé dupliquer sottement la règle bien connue nemo auditur, considérant que les auteurs de ces actes, qui se seraient rendus eux-mêmes irresponsables par l’absorption d’alcool ou de stupéfiants, ne pourraient invoquer leur consommation pour se dégager de leur propre responsabilité.
Mais, finalement, j’ai changé d’avis, et pas seulement en raison de l’excellentissime travail de l’avocate générale près la Cour de cassation, Mme Zientara.
M. le garde des sceaux acquiesce.

Je conseille d’ailleurs à ceux qui ne l’auraient pas encore fait de lire les 87 pages de l’avis qu’elle a rendu. C’est un travail de dentelle, d’un niveau tel que l’on a rarement l’occasion d’y être confronté, même dans une institution comme la nôtre. Le rapport de la commission des lois lui consacre du reste un encadré pour en souligner l’excellence.
J’ajoute que les attaques personnelles dont elle a fait l’objet à cette occasion sont tout à fait honteuses.
Cela étant, si j’ai changé d’avis, ce n’est pas tant en raison de l’excellence de ce travail, disais-je, qu’à cause d’une critique très virulente parue dans le recueil Dalloz, intitulée La turpitude du fou, et dans laquelle la transposition de la règle nemo auditur que je viens de mentionner n’avait pas reçu l’accueil chaleureux que j’escomptais.
Si l’on ne touche pas aux principes de la responsabilité pénale découlant de l’application de l’article 122-1 du code pénal, quelle place accordera-t-on et quelle réponse fera-t-on aux familles des victimes, placées dans une situation très difficile ? Que faire des auteurs de crimes et de délits pour lesquels des doutes subsistent ? Comment règlera-t-on cette question ?
Le débat devant la chambre de l’instruction a montré ses limites, car il ne s’agit en aucune façon d’une juridiction de jugement. En effet, elle ne prononce pas de peines ; les audiences d’irresponsabilité, même si elles peuvent être longues – ce fut le cas pour l’affaire Sarah Halimi, dont l’audience a duré huit heures –, peuvent se tenir en l’absence de la personne mise en examen ; enfin, les victimes n’en sortent ni apaisées ni satisfaites.
Ce genre de procès finit toujours par être celui de la justice. C’est la raison pour laquelle notre commission des lois a adopté un texte qui ne modifie pas le dispositif de l’article 122-1, mais qui, en quelque sorte, dans le continuum de la loi Dati de 2008, va ouvrir aux victimes le droit à un procès, dans les cas où le fait fautif de l’auteur a partiellement aboli son discernement. Selon une jurisprudence constante, c’est dans pareil cas que les difficultés surgissent.
Il ne s’agit pas de juger les fous, mais de savoir qui et comment on juge de l’existence d’un trouble psychiatrique exonératoire de responsabilité. Il ne s’agit donc pas de juger la folie, mais de repenser, dans les rares cas où la responsabilité pénale est contestée, l’accès au juge au sens l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
Je vous renvoie d’ailleurs, monsieur le garde des sceaux, ainsi que vos services, à un article très intéressant de Mme Dervieux, présidente de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris – elle est bien placée pour connaître son fait –, sur le besoin du procès tel qu’elle l’expose : elle est assez convaincante dans sa démonstration.
En tous les cas, si vous ne modifiez pas l’article 122-1 du code pénal, monsieur le garde des sceaux, il faudra malgré tout trouver une solution. Je vous invite à cet égard à suivre la position que notre commission a adoptée.
Nous devons trouver le moyen le plus juste d’appréhender les effets du fait fautif sur l’irresponsabilité de l’auteur d’un acte criminel ou délictuel. C’est bien au juge qu’il appartient de décider de l’irresponsabilité pénale et, singulièrement, du lien entre le fait fautif et l’irresponsabilité.
Dans le prolongement de la réforme Dati de 2008, la commission des lois a donc choisi un renvoi par le juge d’instruction vers le juge du fond, à savoir le tribunal correctionnel ou la cour d’assises, lorsque le fait fautif de l’auteur a causé, au moins partiellement, l’abolition temporaire de son discernement.
La cause est nécessairement au moins partielle, car les causes exclusives ne se rencontrent presque jamais. L’abolition du discernement doit être temporaire, car l’abolition définitive du discernement doit continuer d’empêcher tout procès.
En modifiant non pas l’article 122-1 du code pénal, mais, au contraire, le code de procédure pénale, nous apportons deux innovations majeures dans notre droit : la première est la prise en compte du fait fautif antérieur sur l’abolition du discernement ; la seconde est que, dans le cas d’un fait fautif, l’abolition du discernement entraîne non pas l’irresponsabilité, mais le renvoi vers le juge du fond, qui, lui, se prononce sur l’irresponsabilité et pourra ne pas la reconnaître.
On nous reproche que les tribunaux correctionnels, et, surtout, certaines cours d’assises ne prononceront pas l’irresponsabilité pénale en cas de fait fautif. Je rejette totalement cette idée qui suppose que les jurés populaires des cours d’assises seraient incapables de juger au cas par cas, ce qui est leur mission. Au contraire, qui mieux que le juge du fond saura placer correctement le délicat curseur entre responsabilité en raison d’un fait fautif et irresponsabilité partielle du fait de l’abolition du discernement.
Cette solution, qui permettra de décider de l’application de l’article 122-1 du code pénal, est celle qui nous paraît offrir les garanties les plus importantes au regard des principes de notre droit, répondre aux interrogations légitimes de l’opinion publique et donner satisfaction aux victimes.
En 2018, on a dénombré 326 non-lieux pour abolition du discernement et 13 495 classements sans suite, soit un doublement des cas motivés par l’irresponsabilité pénale pour troubles mentaux de la personne mise en cause. Le nombre de cas a doublé entre 2012 et 2018. Alors, certes, ils ne constituent que 0, 7 % de l’activité des parquets, mais ils représentent tout de même près de 14 000 affaires. C’est beaucoup !
Une autre option aurait été de créer une infraction spécifique en cas d’homicide en situation d’abolition du discernement, comme cela existe en Suisse ou en Espagne.
Dès janvier 2020, après un débat de contrôle sur le sujet avec Mme Belloubet, nous avions demandé aux services du Sénat de réaliser une étude de législation comparée pour tenter d’identifier quelle pourrait être la meilleure solution. Nous n’en avons pas trouvé, et il nous a paru totalement inopportun de créer un nouveau délit. Tout cela pour dire que la solution que la commission a adoptée semble être la plus claire et la plus lisible.
Par cohérence, la commission des lois a cependant choisi de prévoir que l’intoxication alcoolique ou par stupéfiant constitue un cas d’aggravation systématique des peines et délits inscrits au code pénal. On sait en effet très bien que ces intoxications sont très souvent la cause de l’irresponsabilité.
Je laisserai mon collègue Jean Sol développer l’importante question de l’expertise psychiatrique, qui se fonde sur le très important travail qu’il a conduit au nom de la commission des affaires sociales et de la commission des lois. Il vous interpellera, monsieur le garde des sceaux, sur l’état de l’expertise psychiatrique, son manque de personnel et de moyens, et les difficultés des conditions d’exercice de cette mission essentielle à tous les niveaux de l’instruction et du jugement.
La commission des lois a cherché, sur la question complexe de l’irresponsabilité, à trouver une solution équilibrée, conforme à nos principes et permettant, nous l’espérons, de progresser ensemble.
Nous savons que vous êtes en train d’élaborer un texte en la matière. Nous savons aussi que la commission des lois de l’Assemblée nationale a lancé une mission « flash » sur la question, même si elle ne m’a malheureusement pas auditionnée. Nous attendons donc de connaître votre position sur ce sujet précis.
Nous avons sollicité notre collègue Antoine Lefèvre, rapporteur spécial de la commission des finances sur les crédits de la mission « Justice », pour mener un travail spécifique sur le budget de votre ministère en ce qui concerne l’expertise psychiatrique.
Nous sommes également déterminés à engager un travail en profondeur sur l’indemnisation des victimes.
Le texte de la commission des lois est, je le répète, clair et lisible. Quelques amendements ont été déposés. J’espère, monsieur le garde des sceaux, que vous pourrez le soutenir ou, en tous les cas, que vous nous donnerez votre point de vue sur ce dossier important, car, voyez-vous, au-delà de l’affaire Halimi, ce sont des centaines de victimes qui attendent que nous réglions le problème de l’irresponsabilité liée à la faute de l’auteur des faits incriminés.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Sol, auteur de la proposition de loi et rapporteur pour avis.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Dominique Vérien applaudit également.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui une proposition de loi relative à la responsabilité pénale et à l’expertise psychiatrique.
Deux textes ont été examinés conjointement par la commission des lois : l’un, déposé par notre collègue Nathalie Goulet, visait à modifier l’article 122-1 du code pénal ; le second, dont je suis l’auteur, prévoyait également de modifier cet article, mais visait aussi, et surtout, les conditions de l’expertise psychiatrique en matière pénale.
C’est en tant qu’auteur que j’interviens donc aujourd’hui, mais – et je sais que ce n’est pas la règle habituelle dans notre assemblée – également en tant que rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales.
Ces deux propositions de loi concernent un sujet grave : l’appréciation portée sur l’état mental d’une personne au moment des faits qu’elle est accusée d’avoir commis.
Elles ont en partie été pensées en réaction à certaines affaires tragiques que nous avons encore malheureusement tous à l’esprit. Je pense ici particulièrement à l’assassinat de Sarah Halimi et à l’émotion que cet acte antisémite a suscitée dans notre pays.
En tant que législateur, il nous appartient cependant d’écrire le droit non pas en réaction aux horreurs commises, mais bien pour le temps long.
Concernant la rédaction de l’article 122-1 du code pénal, que l’article unique de la proposition de loi de Mme Goulet et l’article 1er de ma proposition de loi entendaient modifier, la commission des affaires sociales ne s’est pas prononcée, se montrant ouverte aux intentions exprimées par le rapporteur de la commission des lois.
L’article 122-1 du code pénal pose un principe d’irresponsabilité pénale en cas d’abolition du discernement au moment des faits en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique. Il prévoit en outre le cas d’une altération du discernement.
Mme Goulet souhaitait lever l’application des dispositions de cet article en cas de faute de l’auteur. Je souhaitais, pour ma part, inscrire que l’abolition du discernement ne pouvait résulter que d’un état pathologique ou d’une exposition contrainte aux effets d’une substance psychoactive. J’insiste sur la notion de « contrainte » que l’article 1er tendait à introduire.
Comme plusieurs de nos collègues l’ont très justement fait remarquer en commission, il est parfois délicat, voire impossible de prévoir l’ensemble des cas possibles lorsque l’on légifère. C’est bien au juge qu’il appartient de décider : nous devons donc faire preuve de prudence quand nous modifions les instruments du droit dont il dispose.
Je constate que, sur l’initiative de son rapporteur, dont je salue le travail, la commission des lois a retenu un autre dispositif que ceux qui étaient proposés. Nous allons en discuter dans quelques minutes.
J’en viens maintenant aux articles relatifs à l’expertise.
Ces dispositions sont, je le rappelle, issues des conclusions des travaux menés avec notre collègue Jean-Yves Roux au nom de la commission des affaires sociales et de la commission des lois sur l’expertise psychiatrique et psychologique.
Ce rapport et les vingt préconisations qu’il formule étaient le fruit de plus d’un an de travail sur la mission peu connue des experts psychiatres ou psychologues, entre justice et santé.
J’avais alors insisté sur les conditions de réalisation des expertises et les modalités d’exercice des experts, en soulignant un manque criant de moyens. Je tiens à profiter de cette tribune pour interpeller M. le garde des sceaux, ministre de la justice, et le Gouvernement sur cette question.
Les conditions dans lesquelles les expertises sont diligentées et réalisées ne sont parfois pas à la hauteur des enjeux que ces expertises peuvent soulever. Quant au travail des experts, force est de constater que les critères de rémunération ne correspondent pas à la complexité de certaines affaires.
Je le sais, ce sujet est pour partie réglementaire et budgétaire, et il est du ressort du Gouvernement d’y travailler et d’y répondre.
La proposition de loi relative aux causes de l’irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l’expertise en matière pénale reprend les recommandations d’ordre législatif figurant dans ce rapport d’information.
Neuf articles portent sur l’expertise ; cinq concernent l’expertise présentencielle. Nous avons ainsi souhaité concentrer l’expertise sur les seules causes d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale – c’est l’objet de l’article 2 –, mais aussi prévoir à l’article 3 un délai maximal de deux mois après l’incarcération pour la réalisation de la première expertise. Sur ce second sujet, je connais les réticences, mais, là encore, j’estime qu’il s’agit pour l’essentiel d’une question de moyens.
Toujours en ce qui concerne l’expertise présentencielle, nous avons tenu, à l’article 4, à exclure l’expertise psychiatrique de l’examen clinique de garde à vue.
Pour ce qui est des moyens des experts pour réaliser leur mission, nous avons proposé d’intégrer le dossier médical aux scellés : tel est l’objet de l’article 5.
Enfin, à l’article 6, nous avons souhaité mieux encadrer la possibilité pour les parties de solliciter une contre-expertise.
Les trois articles suivants ont trait à l’expertise postsentencielle.
Nous avons voulu inscrire la communication systématique par le juge d’application des peines des résultats des expertises aux experts chargés de l’examen des détenus et aux conseillers des services pénitentiaires d’insertion et de probation : c’est l’objet de l’article 7.
À l’article 8, nous avons jugé nécessaire de prévoir une meilleure répartition des missions entre l’équipe chargée de l’évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité et l’expert postsentenciel.
Nous avons enfin prévu la possibilité pour l’expert psychiatre postsentenciel d’assurer les fonctions de médecin coordonnateur du détenu lors de sa sortie d’incarcération : tel est le sens de l’article 9.
Enfin, le dernier article de la proposition de loi, l’article 10, vise à renforcer les obligations déontologiques des experts et prévoit une déclaration d’intérêts obligatoire.
La commission des affaires sociales a adopté trois amendements qui ont également été présentés par le rapporteur de la commission des lois.
Le premier, à l’article 4, tend à préserver l’obligation légale d’expertise psychiatrique dans le cas des infractions sexuelles. Le deuxième vise à modifier l’article 5 pour prévoir une transmission obligatoire du dossier médical sans passer par le juge. Le dernier, qui porte sur l’article 10, a pour objet de contraindre les experts à un devoir de réserve sur les affaires en cours.
Pour finir, en tant que rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, et en tant qu’auteur de l’une des deux propositions de loi, je tiens à souligner deux principes fondamentaux en matière de justice concernant l’état de la personne jugée.
Nous devons garder à l’esprit dans ce débat que c’est bien de l’état de la personne, et de son état mental, en l’occurrence, que nous parlons. Le principe d’irresponsabilité pénale doit être regardé comme un principe fondamental de notre droit pénal. Il s’inscrit dans la tradition humaniste de notre pays et le principe selon lequel « on ne juge pas les fous ».
Enfin, je rappelle que le droit à un procès équitable est garanti par la Convention européenne des droits de l’homme et que nous devons toujours avoir à l’esprit que n’ont vocation à comparaître et à être jugées que des personnes en capacité de l’être au regard de leur état médical.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, la décision de la Cour de cassation du 14 avril 2021, qui a confirmé l’irresponsabilité pénale du meurtrier de Mme Sarah Halimi-Attal, n’a pas été comprise. Elle a suscité une très forte et très légitime émotion.
Les pouvoirs publics doivent y répondre, sur le fondement d’une analyse claire et partagée des améliorations souhaitables et possibles de notre droit.
À cet égard, il me semble que deux éléments doivent d’emblée être soulignés. D’une part, l’abolition du discernement de l’auteur d’un homicide peut aujourd’hui résulter de son intoxication volontaire, notamment après l’absorption de substances stupéfiantes. D’autre part, la haute juridiction de l’ordre judiciaire n’a fait qu’appliquer le droit actuel, dans ce dossier douloureux, en dressant le constat, par les mots de son avocat général, « que les dispositions de l’article 122-1, premier alinéa, du code pénal ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition de ce discernement ».
Je voudrais d’ailleurs me joindre à votre hommage, madame la rapporteure : Mme l’avocat général Zientara-Logeay a effectivement réalisé un travail absolument remarquable. Comme vous, je ne peux qu’inviter chacun à lire ce texte, d’une grande précision, d’un grand intérêt et tout à fait éclairant sur l’état de notre droit.
Le moment me semble venu de faire évoluer ce droit, comme la Cour de cassation, elle-même, y invite le législateur. En effet, ainsi que ma prédécesseure l’avait indiqué dans cette enceinte, lors d’un débat organisé sur l’initiative de votre groupe, madame la rapporteure, il était nécessaire d’attendre l’énoncé de la Cour de cassation. Celle-ci a désormais dit les choses clairement : le juge ne peut distinguer là où le législateur ne le fait pas.
Comme je l’ai annoncé voilà quelques semaines, j’ai mené à la suite de la prise de parole du Président de la République une large consultation sur la modification du régime de l’irresponsabilité pénale. J’ai reçu les représentants des cultes, des magistrats, des experts psychiatres, des professeurs de droit.
Il s’agit d’un sujet éminemment complexe et vous-même, madame la rapporteure, avez pu évoluer dans votre appréhension de la réponse à apporter, dans un sens que, d’ailleurs, je salue.
Fort de ces consultations, et des avis concordants qui en sont issus, je vous rejoins sur le fait que l’article 122-1 du code pénal ne doit pas être modifié.
Article fondamental de notre droit positif, il est et doit rester le garant du principe essentiel posé par l’article 121-3 du même code : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. »
Dans notre pays, comme dans toutes les démocraties dignes de ce nom, on ne juge pas les fous. Revenir sur ce principe serait une régression insupportable, une ligne rouge qui ne doit pas être franchie et, bien sûr, ne le sera pas.
Cette cause traditionnelle d’irresponsabilité pénale répond à une exigence juridique, constitutionnelle et conventionnelle, qui est essentielle dans tout État de droit respectueux des libertés individuelles et de la personne humaine, et qu’il n’est nullement question de remettre en cause.
Je le dis et le redis, il n’est pas envisageable de condamner une personne pour un acte commis alors qu’elle ne disposait pas de son libre arbitre.
Nos débats nous permettront néanmoins d’échanger sur le contenu de l’article 1er de la proposition de loi, tendant à prévoir l’organisation systématique d’un débat devant la juridiction de jugement lorsque l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en cause résulte au moins partiellement de son fait fautif.
Mais, du fait de la sensibilité toute particulière du sujet qui nous réunit aujourd’hui, il me semble indispensable de bénéficier des éclairages du Conseil d’État. J’ai donc souhaité disposer de son avis éclairé avant toute modification éventuelle du régime d’irresponsabilité pénale.
C’est pourquoi, comme je m’y étais engagé, le Gouvernement vient de soumettre à l’examen de celui-ci un projet de loi qui permettra de limiter l’irresponsabilité pénale lorsque l’abolition du discernement résulte d’une intoxication volontaire.
Vous comprendrez donc, mesdames, messieurs les sénateurs, que dans l’attente de cet avis du Conseil d’État, je me borne aujourd’hui aux quelques observations suivantes sur le texte proposé par votre commission.
Je tiens d’abord à saluer l’important travail réalisé par ses soins et les modifications apportées au projet initial. Nous nous rejoignons désormais sur la nécessité de ne pas modifier les règles posées par l’article 122-1 du code pénal et de maintenir l’irresponsabilité pénale en cas de disparition du libre arbitre.
Mais pourquoi, comme prévu dans la proposition de loi, saisir la juridiction de jugement, notamment la cour d’assises ?
Est-ce pour permettre aux jurés d’écarter l’article 122-1, car ils estimeraient que le discernement de la personne était simplement altéré, et non aboli ? Si les experts et le juge d’instruction ont conclu à l’absence de doute sur l’abolition du discernement, ce renvoi ne me semble pas justifié.
Est-ce pour permettre aux jurés de considérer que les dispositions de l’article 122-1 ne devraient pas s’appliquer, au motif que la disparition du libre arbitre résulte d’une consommation illicite, et donc fautive, de stupéfiants ? Il faudrait alors que cette exception soit explicitement prévue par la loi !
Je suis par ailleurs très réservé sur les dispositions de l’article 2 de cette proposition de loi, tendant à insérer une disposition générale d’aggravation des peines en cas d’infraction commise « en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de stupéfiants ». Cette aggravation existe déjà dans de nombreux cas, comme les violences, le viol ou les agressions sexuelles. Elle pourrait sans doute être prévue pour d’autres infractions comme le meurtre. Mais la généralisation souhaitée ne va-t-elle pas à l’encontre de l’objectif visé, en banalisant pour toutes les infractions, même les moins graves, les consommations de substances psychotropes ?
S’agissant des dispositions relatives aux expertises, prévues aux articles 3 à 9 de la proposition de loi, elles sont le fruit d’un important travail des sénateurs Jean Sol et Jean-Yves Roux, que je tiens ici à saluer.
Après analyse, certaines ne me semblent pas relever de la loi et peuvent susciter des interrogations.
S’il est évident qu’une expertise psychiatrique doit intervenir aussi rapidement que possible, faut-il impérativement prévoir sa réalisation dans les deux mois du placement en détention provisoire de la personne ? Quelles seront les conséquences du non-respect d’un tel délai ? La nullité de l’expertise réalisée au-delà de ce délai ? L’impossibilité de procéder, hors délai, à cette expertise ? Et si la personne n’est arrêtée que plusieurs mois, voire plusieurs années après les faits, ce délai de deux mois a-t-il encore un sens ?
J’en viens à l’article 10 et aux obligations déontologiques des experts. Je tiens à préciser que celles-ci rejoignent pleinement les projets d’amélioration sur lesquels j’ai demandé aux services de la Chancellerie de travailler.
Il importe effectivement d’éviter des conflits d’intérêts lorsqu’une personne est chargée d’une expertise, et cette question dépasse évidemment la seule hypothèse des expertises psychiatriques.
L’expert doit donc faire connaître ses activités professionnelles ou bénévoles, ainsi que ses fonctions ou mandats électifs, passés ou en cours, susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts. Mais il ne me semble pas pertinent, comme proposé à l’article 10, d’imposer à l’expert des déclarations avant chacune de ses expertises, pas plus qu’on ne demande une déclaration d’intérêts aux magistrats avant chaque décision, ou aux parlementaires avant chaque vote.
Mesdames, messieurs les sénateurs, comme pour le texte précédent sur les sortants de prison, j’observe que nous travaillons sur des projets parallèles et, en réalité, très complémentaires. J’y vois un nouveau témoignage de l’implication conjointe du Sénat et du Gouvernement sur les sujets d’importance pour nos concitoyens. Je rappelle, pour être complet, que la commission des lois de l’Assemblée nationale a lancé de son côté une mission « flash » sur le sujet de l’irresponsabilité pénale.
L’occasion m’est donc à nouveau donnée de saluer la mobilisation des deux chambres du Parlement.
Toutefois, le travail engagé par le Gouvernement sur la question de l’irresponsabilité pénale, désormais soumis à l’avis du Conseil d’État, me semble mieux à même de répondre à la problématique posée par la décision de la Cour de cassation. Il permettra également de garantir la sécurité juridique des dispositions, lesquelles, en tout état de cause, seront examinées par le Parlement, à qui il reviendra de les modifier et de les compléter.
Je n’en doute pas, les propositions concrètes formulées aujourd’hui par le Sénat viendront utilement nourrir le projet de loi qui vous sera présenté prochainement.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, certains nous reprocheront de légiférer sous le coup de l’émotion et d’autres salueront la volonté du législateur de se saisir de sujets complexes mis en avant par l’actualité.
Sans nier l’émotion de ces derniers mois suscitée l’affaire Sarah Halimi, je regrette que notre chambre n’ait su éviter certains écueils dans le travail accompli sur la proposition de loi que nous discutons aujourd’hui. Certes, le sujet et son traitement sont délicats.
Le questionnement au cœur des débats est bien celui de la prise en compte, ou non, du fait fautif entraînant l’abolition du discernement, bien sûr sous-tendue par l’envie, le besoin même des victimes de voir l’affaire jugée publiquement.
L’article 1er de la présente proposition de loi tente de répondre du mieux possible, mais, me semble-t-il, de manière incomplète, à cette problématique. Il introduit la recherche du fait fautif dans l’abolition du discernement, mais seulement au niveau du code de procédure pénale, dans le seul but de renvoyer au juge du fond la tâche de déclarer, ou non, le mis en cause responsable pénalement.
Si le but était d’enjoindre le juge à exclure l’irresponsabilité pénale en cas de fait fautif, la disposition n’y répond pas et ne fait que déplacer vers le juge du fond l’application de l’article 122-1 du code pénal sur l’irresponsabilité.
Cette position est évidemment à saluer, car elle a l’avantage, selon moi, de ne pas toucher à l’article 122-1. Néanmoins, son utilité demeure incertaine.
Venons-en au besoin d’un procès, que nous devons prendre en considération. L’audience en chambre de l’instruction, qui se concentre sur la question de la responsabilité pénale du mis en cause, est déjà publique et contradictoire, en présence des victimes et avocats des parties civiles. Collégialité de la décision et possibilité d’expertise créent une configuration qui paraît respectueuse de notre système pénal.
Nous devons toutefois, en tant que législateur, rester d’une extrême vigilance pour manier et différencier les notions et les règles d’imputabilité et de responsabilité. Clairement, la notion que le doute doit bénéficier au mis en cause est fondamentale dans notre système pénal, mais ne peut s’appliquer qu’à l’accomplissement même des faits, donc à l’imputabilité.
La question de la responsabilité pénale atténuée, abolie, ou pleine et entière, est d’une tout autre nature. Loin de nier qu’il existe des degrés entre la responsabilité et l’irresponsabilité, comment juger ? C’est à l’aune de cette capacité d’en juger que se pose la question du fait fautif antérieur.
Oserons-nous cheminer, sur le plan philosophique et technique, vers ce que certains appelleraient le concept de « folie volontaire » ?
Certes, un comportement volontaire peut directement contribuer au déclenchement de l’abolition du discernement, mais ce trouble fort a-t-il été envisagé ou souhaité ?
Le juge, faisant appel aux expertises psychiatriques, est celui qui jugera de l’engagement de la responsabilité et de son atténuation. Ne compliquons pas son magistère en lui imposant de renvoyer au juge du fond, dès qu’il y a un fait fautif – je dirais même : dès qu’il « estime » qu’il y a un fait fautif.
Cette responsabilité du mis en cause devient bien trop complexe. Il connaîtrait précisément le risque et l’aurait volontairement pris dans un dessein criminel… Comment, réellement, scientifiquement, sûrement, connaître les risques et conséquences d’une toxicologie qui est différente selon les personnes, les moments, les associations de substances ? Qui, ici, pourrait affirmer qu’il est toujours possible de constater et d’évaluer la part de la cause endogène ou exogène du trouble ayant conduit à l’abolition du discernement ?
Cette ligne de crête entre altération et abolition est le domaine des experts. C’est en s’appuyant sur ces expertises, qui, nous le savons, divergent parfois tant la difficulté est grande d’appréhender un moment passé, que le juge doit décider.
L’article 2 de la proposition de loi vise, lui, à augmenter les peines pour les crimes et délits commis en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise de stupéfiants.
Là encore, j’entends l’idée de punir plus sévèrement ce que nous pouvons percevoir comme un fait fautif : l’absorption de stupéfiants ou d’alcool. C’est déjà, souvent, ce que font les juges – on estime que, pour la moitié des faits de violences conjugales, l’alcool ou les stupéfiants sont impliqués.
Mais je reste prudent sur ce point, redoutant une tendance à privilégier de plus en plus la pénalisation des addictions sur une prise en compte plus globale en termes de santé publique.
Je salue, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur pour avis, l’ensemble des autres articles qui s’attachent au problème récurrent de notre système judiciaire : il nous faut donner de vrais moyens pour les expertises psychiatriques.
De la lenteur pour effectuer les expertises aux dysfonctionnements des barèmes de paiement, à la facilitation du secret médical partagé : il était urgent d’agir.
Le temps passe et je souhaite conclure en appelant notre assemblée à une très grande prudence : nous nous devons de prendre du recul sur l’émotion, justifiée, de l’opinion publique. Nous devons préserver la notion d’irresponsabilité pénale, même si celle-ci devient de plus en plus insupportable pour la population, acceptant mal que certaines personnes ne puissent être jugées et condamnées pénalement pour leurs crimes. Pour autant, le mis en cause passe devant la justice et il est soumis aux décisions des juges, notamment via l’hospitalisation sous contrainte.
Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ne votera pas ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.
M. Roger Karoutchi remplace Mme Nathalie Delattre au fauteuil de la présidence.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd’hui s’inscrit dans la continuité des travaux du Sénat sur le sujet complexe et important de l’irresponsabilité pénale, un sujet à la frontière du monde juridique et du monde médical.
J’ai notamment en mémoire le débat qui s’était tenu dans cet hémicycle au début de l’année dernière, sur l’initiative de notre rapporteur, dont nous connaissons et saluons l’engagement sur cette question, sur laquelle elle a mené une réflexion approfondie.
Je pense aussi à la mission d’information pluraliste de la commission des lois et de la commission des affaires sociales, dont notre rapporteur pour avis était l’un des rapporteurs, qui s’est en grande partie concentrée sur l’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale. Elle a formulé, en mars dernier, des propositions intéressantes afin d’améliorer les conditions de réalisation de l’expertise, ainsi que sur la déontologie des experts.
C’est donc dans une certaine continuité et avec cohérence que le Sénat se saisit aujourd’hui de la question de l’irresponsabilité pénale au travers de deux points : son régime, d’une part, et l’expertise psychiatrique qui s’y rattache, d’autre part.
Cette continuité ne saurait, bien sûr, s’abstraire des décisions rendues à la suite du meurtre, d’une violence saisissante et inacceptable, de notre concitoyenne Mme Attal-Halimi.
Notre détermination doit être totale pour lutter contre les surgissements de l’antisémitisme, dont Mme Attal-Halimi a été la victime, comme l’a d’ailleurs établi la chambre de l’instruction, et que nous ne pouvons tolérer sous aucune des formes dans lesquelles il se manifeste.
Le travail du législateur, après l’arrêt de la Cour de cassation et les évolutions du droit que ce dernier semble appeler, n’est pas simple.
Il nous faut réfléchir au dispositif le mieux à même de persévérer dans notre État de droit juste, fraternel et protecteur.
Nous nous trouvons à l’intersection d’impératifs distincts, d’égale importance et parfois difficilement conciliables : protéger la société ; ne pas soumettre à un procès ceux qui ne sont pas en état de se défendre ; permettre, bien sûr, aux parties civiles de voir la justice rendue.
Sur le fondement de cette recherche d’équilibre, notre assemblée, tout comme le Gouvernement, a réaffirmé son intention d’apporter une réponse à l’étonnement légitime face aux situations auxquelles le droit en vigueur peut conduire. Ce cheminement n’est pas un tâtonnement, tiède ou feint ; il est la marque d’un travail approfondi et nécessaire au regard de l’enjeu.
La dernière grande réforme, qui permet à la chambre de l’instruction de se prononcer sur la matérialité des faits à l’issue d’un débat public et contradictoire, y compris lorsque ceux-ci s’appuient sur des représentations de haine telles que l’antisémitisme, tout en retenant l’irresponsabilité pénale de leur auteur, montre bien toute la complexité du régime de l’irresponsabilité et des actions entreprises pour le faire évoluer.
À ce titre, le choix de nos rapporteurs de ne pas conserver la révision de l’article 122-1 du code pénal initialement envisagée – dans une rédaction d’ailleurs différente de celle que proposait, un mois plus tôt, la mission d’information du Sénat – s’entend.
Désormais, l’article 1er prévoit donc que, lorsque le juge d’instruction estime que l’abolition temporaire du discernement résulte au moins partiellement du fait fautif, il renvoie devant la juridiction de jugement, qui statuera sur l’irresponsabilité pénale et, le cas échéant, sur la culpabilité.
Des interrogations ont pu être exprimées en commission sur la portée de cette réécriture.
Il faut rappeler que la compétence des juges du fond pour statuer sur l’irresponsabilité de l’auteur des faits, notamment la compétence des cours d’assises et de leur jury, est déjà prévue par le droit en vigueur dans le cas où les juges d’instruction ont considéré que l’auteur était responsable pénalement.
L’article 1er viserait donc à faire intervenir la juridiction de jugement en amont, lorsque le juge d’instruction estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne résulte au moins partiellement de son fait fautif.
L’objet serait ainsi de garantir un « vrai procès aux victimes », pour reprendre les mots de Mme la rapporteure, tout en ne renvoyant devant la juridiction de jugement que les personnes en état de comparaître.
Deux points peuvent être relevés, avec toute la prudence que la complexité du sujet implique.
D’une part, peut-on continuer de se poser la question de l’appréciation du fait fautif par la chambre de l’instruction ? C’est une question importante, car la portée du dispositif en dépend. S’il est difficilement compréhensible pour la société qu’une personne puisse être exonérée de sa responsabilité pour un état résultant d’une attitude délibérée, comment qualifier l’addiction ? Est-elle une faute ou devient-elle, dans la durée qui lui est inhérente, une contrainte subie ? Le sujet est d’autant plus délicat qu’il déborde la matière pénale et intègre à la réflexion les politiques de santé publique et de prévention.
D’autre part, on pourrait envisager d’autres voies pour répondre au besoin des victimes d’avoir un « vrai procès ». Je pense, par exemple, à une modification des modalités de l’audience publique devant la chambre de l’instruction, instituée en 2008, pour en renforcer le caractère contradictoire. Le rapport de la mission menée par Philippe Houillon et Dominique Raimbourg sur l’irresponsabilité pénale a d’ailleurs préconisé plusieurs ajustements de cette réforme.
Une autre difficulté réside dans le placement du curseur entre l’abolition et l’altération du discernement, notion finalement assez récente dans le régime de l’irresponsabilité puisqu’elle a été introduite en 1994 seulement.
En tout état de cause, le choix de Mme la rapporteure d’entrer par la voie d’une révision de la procédure contribuera au cheminement entrepris pour aboutir à une solution dont les différentes parties entendent aujourd’hui la nécessité.
À ce titre, le groupe RDPI s’abstiendra, tout en se ralliant à la démarche entreprise.
Applaudissement sur les travées du groupe RDPI.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le 14 avril dernier, la Cour de cassation tranchait : le procès du meurtrier de Sarah Halimi n’aura pas lieu. Elle n’est pas revenue sur la décision de la cour d’appel de Paris, marquant certes une continuité jurisprudentielle, mais suscitant une colère, une indignation et des interrogations qu’il est aisé de comprendre.
Toutefois, la lecture de cet arrêt est riche d’enseignements, car elle met au jour deux thèses radicalement opposées.
D’un côté, la thèse retenue par les juges, appuyée sur les expertises psychiatriques et appliquant la mécanique de la responsabilité pénale, conclut à l’irresponsabilité pénale de M. Kobili Traoré. Ainsi, au regard de la vérité judiciaire, ce dernier demeurera sujet à des bouffées délirantes. À ce titre, l’arrêt précise : « […] Aucun élément du dossier d’information n’indique que la consommation de cannabis par l’intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une telle manifestation. »
De l’autre côté, la thèse des auteurs du pourvoi, la famille de Sarah Halimi, fait valoir que le seul fait de consommer des stupéfiants, même sans avoir la conscience de leurs effets potentiels sur le discernement, devrait exclure la prise en considération de l’abolition du discernement. À l’inverse, l’acte volontaire de consommation de stupéfiants devrait être constitutif d’un comportement fautif excluant l’irresponsabilité.
Cette seconde solution est bien sûr compréhensible ; est-elle trop radicale pour qu’un juge la retienne ? Sans doute.
Si l’on ne peut laisser à une juridiction la responsabilité d’un tel revirement, c’est au législateur de se pencher sur la question. Il revient donc au Parlement de déterminer comment exclure du champ d’application de l’irresponsabilité pénale les cas dans lesquels la faute de l’auteur est à l’origine de son état d’irresponsabilité.
La proposition de loi élaborée par notre collègue rapporteur Nathalie Goulet et celle cosignée par nos collègues membres des commissions des lois et des affaires sociales inaugurent cette réflexion. Je me réjouis que le Sénat soit à l’initiative de ce travail. Les premiers échanges auxquels il a donné lieu en révèlent toute la complexité.
La solution la plus instinctive serait de modifier l’article 122-1 du code pénal, qui édicte le principe de l’irresponsabilité pénale d’une personne atteinte, « au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».
Seulement, l’article 122-1 pose un principe fondamental de notre droit sur lequel il pourrait être imprudent de revenir, même avec mesure. En effet, on ne saurait pas véritablement dans quelle voie nous engagerait un tel changement.
De ce point de vue, je tiens à saluer le travail effectué par la commission des lois : cette dernière a retenu une solution alternative plus respectueuse de nos principes. La procédure proposée pourrait effectivement permettre d’éviter certaines incompréhensions, dans des cas aussi dramatiques que le meurtre de Sarah Halimi.
En outre, ce texte reprend certaines propositions figurant dans le rapport d’information intitulé Expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale : mieux organiser pour mieux juger. Ce rapport a été rendu par nos collègues Jean Sol et Jean-Yves Roux à la suite des auditions menées par un groupe de travail dont j’approuve entièrement l’initiative.
En effet, ce groupe de travail a été constitué lors de la précédente mandature, à ma demande, alors que j’étais membre du bureau de la commission des lois, et avec l’appui de son président d’alors, Philippe Bas. Aussi, je remercie sincèrement Jean Sol de m’avoir associée à la signature de la proposition de loi issue de ses travaux, qui étaient très attendus.
Cette proposition de loi reprend près de la moitié des préconisations que nous avons formulées et que je cite pêle-mêle : lever les blocages dans la communication des dossiers médicaux ; mieux encadrer la possibilité pour les parties de solliciter un complément d’expertise ; renforcer l’information des experts ; ou encore renforcer les obligations déontologiques de ces derniers.
Ces évolutions sont vivement espérées. Nous saluons donc l’ensemble des propositions retenues : au regard de ces dernières, le groupe RDSE, très impliqué dans ces questions, se prononcera avec force et conviction pour le présent texte !
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE et au banc des commissions.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, des affaires tragiques – le meurtre de Mohamed El Makouli en janvier 2015 et, plus récemment, celui de Sarah Halimi le 3 avril 2017 – ont suscité beaucoup d’émoi dans l’opinion publique. Nos concitoyens ont manifesté leur incompréhension à la suite des décisions de justice ayant conclu, pour les deux meurtriers, à une irresponsabilité pénale.
Dans les deux cas, les avocats des parties civiles ont invoqué la prise antérieure de stupéfiants pour contester l’abolition du discernement au moment des faits et donc l’irresponsabilité pénale.
En application de l’article 122-1 du code pénal, cette détermination relève de l’appréciation souveraine des juges. Toutefois, celle-ci est contestée sur un point précis : la prise en compte du fait fautif de l’auteur de l’acte, autrement dit la consommation de stupéfiants ou d’alcool antérieurement à la commission de l’infraction.
En la matière, la jurisprudence est constante. Elle montre que ce fait fautif n’a jamais été reconnu, puisque l’intention de l’auteur s’apprécie au moment des faits. Mais il s’agit là d’un vieux sujet de controverses en doctrine et, surtout, dans l’opinion publique.
C’est dans ce contexte que la commission des lois a souhaité mettre à l’ordre du jour la question de l’irresponsabilité pénale en examinant deux propositions de loi en une.
Les dispositifs issus du texte proposé par Jean Sol restant en discussion, à savoir les articles 3 à 10 de cette proposition de loi, vont selon nous dans le bon sens. Je pense notamment à l’article 4, qui restreint le champ de l’examen clinique prévu en garde à vue à la compatibilité de santé de la personne avec la mesure.
En revanche, nous sommes vertement opposés au principal dispositif proposé. Certes, nous pouvons nous réjouir que l’article 122-1 du code pénal reste finalement intact, comme le préconisait d’ailleurs le rapport de MM. Raimbourg et Houillon. Mais la rapporteure n’a pas abandonné l’idée selon laquelle, lorsque l’auteur d’un crime ou d’un délit a commis préalablement à son acte une infraction qui a entraîné l’abolition de son discernement, sa responsabilité pénale doit pouvoir, dans certains cas, être reconnue.
Ce mécanisme emporte deux conséquences non négligeables et même, selon nous, déplorables.
Premièrement, il vise à instaurer, dans certains cas, un véritable procès d’abolition du discernement, alors même qu’une audience publique est prévue par la loi de 2008. À nos yeux, ce procès symbolise le rapport disciplinaire entre justice et folie. Pis, il exhiberait la souffrance de toutes les parties sans permettre la « consolation » parfois espérée. D’ailleurs, on peut déjà le constater lors des audiences publiques.
Aussi, je m’interroge : cette forme de procès pour les personnes qui relèvent de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne ferait-elle pas fléchir l’institution vers une justice que je qualifierai d’outrancière ?
En outre, malgré les précautions prises avec la notion d’abolition temporaire, les garanties du procès équitable, qu’exige notamment le droit international, ne sont pas observées.
Deuxièmement, avec ce mécanisme de fait fautif, l’irresponsabilité pénale ne sera plus automatique lorsqu’on sera face à une abolition du discernement.
S’ajoute donc, aux notions d’altération du discernement et d’abolition, la notion d’abolition temporaire liée à un fait fautif. Légiférer en ce sens, ce serait oublier que ces comportements ne sont pas nécessairement fautifs et qu’ils peuvent être, non pas la cause de l’abolition du discernement, mais sa conséquence.
Certes, la peur irraisonnée de la folie est un fait : on l’observe dans la population. Mais la responsabilité du politique, c’est-à-dire de nous tous ici présents, ne serait-elle pas de dépassionner le débat judiciaire, de mettre en place des pare-feux juridiques pour protéger les plus faibles au lieu d’alimenter ce débat judiciaire de commentaires politiques opportunistes, voire de propositions de loi de circonstance ?
Pourtant, contrairement au soin, la peine a une fin. L’univers d’une unité pour malades difficiles est aussi privatif de liberté que l’univers carcéral. L’unique différence est que le personnel qui y exerce est spécifiquement formé.
Finalement, à l’heure où l’équilibre entre sécurité et liberté n’a jamais été aussi fragile, nous voyons à l’œuvre un courant d’utilitarisme pénal qui se mue, depuis des années, en populisme pénal. Ce texte en est l’énième illustration, bien que les doutes profonds exprimés par la commission des lois et l’ensemble des juristes qui y siègent soient le reflet de la difficulté majeure à surmonter en la matière : depuis le droit romain et le Talmud, « on ne juge pas les fous ».
Mes chers collègues, vous l’avez compris : si certains articles, que j’ai cités précédemment, suscitent notre intérêt, cette proposition de loi dans son économie générale traduit une vision de la société qui n’est pas la nôtre. C’est la raison pour laquelle nous la rejetterons !
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.
Mme Nathalie Delattre remplace M. Roger Karoutchi au fauteuil de la présidence.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le crime terrible, abominable, barbare dont a été victime Mme Sarah Halimi a provoqué l’émotion de toute la Nation. Nous l’éprouvons encore aujourd’hui. Il a également donné lieu à deux décisions de justice, qualifiant le crime d’antisémite et certifiant que son auteur est irresponsable.
En résulte une question que chacun se pose : comment un acte irresponsable peut-il être antisémite ? S’il y a volonté, il ne peut y avoir d’irresponsabilité.
Monsieur le garde des sceaux, telle est la situation dans laquelle nous sommes. Elle va nous conduire à réfléchir longuement sur ce sujet, puisque plusieurs initiatives ont été prises, dont celle-ci, au Sénat.
Désormais, l’accord est quasi général pour maintenir en l’état l’article 122-1 du code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. »
Vous avez rappelé le fondement de ces dispositions, à savoir l’article 121-3 du code pénal : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. »
Telle est l’origine de ces deux propositions de loi, dont la commission des lois a décidé de modifier certaines dispositions. Elle propose notamment que le juge d’instruction puisse transférer ce sujet à la juridiction de jugement.
A priori, l’idée peut paraître judicieuse, mais elle nous inspire de fortes réserves, pour deux raisons.
Premièrement, on avance qu’il n’y a pas de procès. Mais, en l’espèce, l’examen des faits par la chambre de l’instruction s’est déroulé pendant huit heures, en public, en présence des parties et de l’auteur du crime, et en plein respect du contradictoire. On ne peut donc pas dire qu’il n’y a pas eu de procès.
Deuxièmement, nous avons largement consulté le rapport Raimbourg-Houillon et Dominique Raimbourg, que nous avons entendu, nous a confirmé en particulier ce que nous avaient dit un certain nombre de magistrats et de représentants de la magistrature : la juridiction de jugement peut être le tribunal correctionnel ou la cour d’assises et, en pareil cas, elle serait en difficulté s’il s’agissait de décider de l’irresponsabilité.
Elle pourrait le faire, nous a-t-on dit. Certes ! C’est juridiquement exact. Mais, concrètement, un juré populaire décidera-t-il souvent l’irresponsabilité ? Finalement, il est là pour condamner, pour décider de la condamnation ; et, dans l’économie de notre justice, il est juste que la chambre de l’instruction intervienne de manière préalable. Elle a précisément pour mission de procéder aux expertises et de prendre position sur la question de l’irresponsabilité.
Ainsi, nous craignons qu’il ne s’agisse d’une fausse solution. Toutefois, dans cette affaire, nous avons décidé d’être résolument constructifs. Voilà pourquoi nous avons déposé un amendement de repli dans l’hypothèse où le Sénat persisterait dans cette proposition.
En vertu de cet amendement, la juridiction de jugement statuerait sur la question de la responsabilité avant l’examen au fond. Il s’agirait en quelque sorte d’une question préalable, qui serait en tout état de cause posée. Néanmoins, cette solution n’a pas notre préférence, tant s’en faut.
Nous avons également pris le risque de formuler trois propositions concrètes, que nous versons au débat et au dossier.
Tout d’abord, en nous inspirant de la législation espagnole, nous proposons un amendement tendant à ajouter après l’article 122-9 du code pénal un article ainsi rédigé : « Est pénalement responsable la personne qui a volontairement provoqué une perte de discernement aux fins de commettre l’infraction, notamment par la consommation de boissons alcooliques, de drogues toxiques, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de substances ayant des effets similaires. »
Tout en maintenant l’article L. 122-1, nous prévoyons donc une disposition permettant de réprimer le fait de décider, en toute conscience, de devenir irresponsable ou de perdre son discernement.
Ensuite – cette proposition n’est pas exclusive –, nous suggérons de définir dans la loi ce que l’on appelle discernement. Monsieur le garde des sceaux, vous savez que cette définition n’existe pas dans notre droit : elle ne figure nulle part. À l’article 122-1 du code pénal, nous proposons ainsi ajouter un alinéa ainsi rédigé : « Le discernement est la conscience de l’acte commis, de ses conséquences et la capacité à en apprécier la nature et la portée. » Cette précision nous paraît utile.
Enfin – les élus de notre groupe ont beaucoup travaillé sur ce point et je salue tout particulièrement l’apport de Marie-Pierre de La Gontrie –, nous proposons de compléter ainsi l’article 158 du code de procédure pénale, au sujet des expertises psychiatriques : « Il est ajouté aux questions techniques mentionnées au premier alinéa une question spécifique destinée à identifier une participation active à la perte de discernement. »
Mes chers collègues, telles sont nos propositions : vous constatez qu’elles sont concrètes.
Je souscris en partie à ce qu’ont dit plusieurs orateurs et oratrices, notamment Mme Assassi : n’oublions jamais que la toxicomanie relève d’abord du ministère de la santé, car il s’agit d’un problème de santé. Ce serait une erreur de le méconnaître au bénéfice d’une sorte de « tout judiciaire ».
Néanmoins – en résumé –, nous pensons, premièrement, qu’il faut conserver en l’état l’article 122-1 du code pénal et, deuxièmement, que le statu quo n’est pas possible, eu égard à ce qui s’est passé. C’est pourquoi nous présentons ces trois propositions concrètes, modestes, mais solides, car nous entendons contribuer au débat. En effet, nous devons avancer avec réalisme et pragmatisme afin que la loi soit comprise par nos concitoyens !
Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il y a de grands principes qui fondent notre droit et qui se confrontent : on ne soumet pas à un procès les individus n’étant pas en capacité de présenter personnellement leur défense ; on ne juge pas les fous. Cependant, on a le devoir de mettre hors d’état de nuire les individus dangereux et celui d’assurer aux parties civiles que justice soit faite quand le mal est fait.
L’irresponsabilité pénale ne doit être invoquée qu’en cas d’extrême nécessité, car la justice et la sécurité doivent être assurées. Mais depuis dix ans le nombre d’ordonnances d’irresponsabilité a fortement augmenté. Ce terme et, surtout, sa signification ne doivent pas être dévoyés. Or il semble que la culture de l’excuse soit aussi florissante que la culture du cannabis.
Je pense tout spécialement à la douleur de la famille de Sarah Halimi le 14 avril dernier, jour où les juges de la Cour de cassation ont confirmé que le meurtrier était pénalement irresponsable au moment des faits ; qu’il était en proie à une « bouffée délirante » lorsqu’il a tué sa voisine, après la consommation de stupéfiants.
Ce criminel ne sera pas jugé, car les juges ont estimé que fumer du cannabis en quantité et tuer une personne juive aux cris d’« Allah Akbar » n’était que la « bouffée délirante » passagère d’une personne tout à fait normale, refusant de voir qu’il était activement en proie à des bouffées islamistes, antisémites et criminelles.
Résultat : ni prison ni hôpital psychiatrique pour Kobili Traoré ; une bouffée de haine de plus dans la nature. Que se passera-t-il s’il récidive ?
Il y a la séparation des pouvoirs, mais nous sommes là aussi pour exprimer la colère d’une famille et de la famille nationale, pour faire en sorte que le code pénal et le code de procédure pénale ne légitiment pas la culture de l’excuse.
Abolir volontairement son discernement par la consommation volontaire de drogues, n’est-ce pas déjà avoir fauté ? La tolérance croissante de notre société face aux substances psychoactives et aux drogues nous expose à ces excès, à ces drames et à ces injustices.
Alors que le débat sur la légalisation du cannabis s’est invité au Parlement, au point que l’on a pu voir un député brandir un joint dans l’hémicycle du Palais-Bourbon – à croire qu’il venait d’en fumer un… –, les parlementaires doivent considérer l’expression de la responsabilité dans le droit en questionnant d’abord leur propre qualité de responsable politique.
Au-delà des évolutions législatives, il est bon que le sentiment d’injustice né de l’absence de procès et de jugement se fasse entendre par l’institution judiciaire elle-même : car c’est elle qui voit, entend, touche et doit comprendre le pays réel.
Il convient ensuite de donner aux juges, dans leur appréciation souveraine, les moyens financiers et humains nécessaires pour rendre la justice et mieux éclairer leur jugement.
Il y a une dernière condition pour que la justice soit rendue : son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, qui plus est lorsque le ministre de tutelle se vante d’être le ministre des délinquants !
M. le garde des sceaux se gausse.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, comme nous tous, j’ai une pensée émue pour Sarah Halimi et les membres de sa famille. Son meurtre est une tragédie. La proposition de loi que nous examinons dépasse le cadre de cette affaire : pourtant, c’est bien ce meurtre qui a mis l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental au centre de l’actualité.
Mal comprise, l’irresponsabilité pénale choque parfois. Certains y voient une forme d’immunité, voire une incitation au crime. Or la réalité est bien différente. Il faut admettre que les troubles psychiques, même dangereux, ne se traitent pas avec une sanction pénale. La place de ceux qui en sont atteints est à l’hôpital et non pas en prison.
Cela ne signifie pas pour autant qu’ils doivent être remis en liberté. Quand le meurtrier de Mme Halimi a été déclaré irresponsable, la juridiction a « ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ainsi que des mesures de sûreté ».
L’objectif principal des auteurs de cette proposition de loi était de restreindre le champ d’application de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Nos collègues souhaitaient empêcher que puissent être déclarés irresponsables ceux dont le comportement est à l’origine du trouble mental.
Leur initiative s’inscrit dans le sillage d’autres réflexions. Un projet de loi sur la question sera prochainement présenté et une mission flash est en cours sur le sujet à l’Assemblée nationale – les précédents orateurs l’ont déjà rappelé.
Le travail en commission, notamment les auditions menées dans le cadre de l’examen du présent texte, a montré toute la difficulté qu’il y a à tenter de rendre quelqu’un responsable de son irresponsabilité.
Nos collègues n’ont eu d’autre choix que de renoncer à modifier la règle de l’irresponsabilité pénale : aucune rédaction ne permettait d’éviter une atteinte aux principes fondamentaux de notre droit.
À ce titre, je salue la décision de la commission. C’est une décision de sagesse, qui ne laisse pas l’émotion, même légitime, prendre le pas sur l’intérêt général.
Avec sa rédaction, la commission nous propose d’améliorer plusieurs points de procédure du domaine de l’expertise judiciaire. Ces améliorations sont les bienvenues. Celle qui permet d’écarter tout conflit d’intérêts de la part de l’expert nous semble particulièrement pertinente.
En outre, le texte de la commission contient une disposition visant à ce qu’un procès pénal se tienne lorsque l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte de son fait fautif. La responsabilité pénale serait déterminée lors de ce procès afin de faire droit au besoin de procès des victimes.
Bien entendu, l’objectif est louable et nous tenons à ce que la place des victimes soit respectée. Toutefois, nous craignons que cette solution n’entraîne encore davantage de frustration : tenir un procès pour finalement déclarer l’auteur irresponsable ne sera pas plus facile pour la partie civile.
Par ailleurs, il semblerait que des doutes persistent quant à la solidité juridique de la rédaction proposée. Cette disposition nous inspire donc quelques réserves.
Enfin, le texte entend préciser pour l’ensemble des infractions que la consommation d’alcool ou de stupéfiants est une circonstance aggravante. Cette précision nous semble fondamentale. Nous nous étonnons d’ailleurs qu’elle ne soit pas systématique : pour certaines infractions, cette circonstance aggravante est déjà explicitement mentionnée, mais la rapporteure a pu constater qu’elle n’était pas prévue pour certains crimes pourtant particulièrement graves, comme la torture et les actes de barbarie.
Il nous paraît indispensable de l’étendre à l’ensemble des crimes et délits. Ainsi, le message sera clair : la consommation d’alcool ou de stupéfiants, loin d’excuser le comportement de l’auteur, renforce la peine qu’il encourt.
Ainsi, ce texte contribue à l’amélioration de notre droit pénal. Si nous ne souscrivons pas à l’ensemble de ses mesures, nous sommes particulièrement favorables à un renforcement des sanctions à l’encontre de ceux qui commettent des infractions sous l’influence de stupéfiants ou d’alcool. Nous soutiendrons donc l’adoption de cette proposition de loi !

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le meurtre de Sarah Halimi nous a tous choqués.
Nombreux, nous attendions le procès de son meurtrier pour mieux comprendre comment s’est développé et comment se développe encore cet antisémitisme qui touche certains de nos jeunes ; mieux le comprendre pour mieux le combattre, en donnant un signal fort grâce à un vrai procès.
Le racisme n’a pas de raison d’être, l’antisémitisme n’a pas de fondement et nous nous devons de lutter contre ces fléaux afin de préserver notre unité et de faire Nation.
Nous attendions ce procès pour montrer que la bêtise peut se transformer en haine, la haine en violence meurtrière, et que la violence est punie par la loi.
Nous attendions ce procès pour dire la justice : la justice pour Sarah, la justice pour sa famille, la justice pour nous tous.
Or, de procès, il n’y a pas eu ; enfin, pas un vrai procès d’assises avec des jurés, en présence de l’accusé.
Le meurtrier, en plus d’être antisémite, était drogué et c’est bien la somme de tout cela qui l’a conduit à tuer Sarah Halimi. Mais, au moment des faits, une bouffée délirante lui a ôté son discernement : et si l’on peut juger les imbéciles, les méchants et les violents, on ne juge pas les fous.
Aucun des experts qui se sont prononcés dans cette affaire n’a remis en question la folie du meurtrier au moment de son crime. Mais aucun des experts n’a mis en doute le fait que le cannabis à haute dose consommé par le meurtrier y était pour quelque chose.
La seule question était : une maladie mentale a-t-elle été exacerbée par la drogue ou est-ce la drogue qui a conduit à la maladie mentale ? Il s’agit là d’un débat seulement médical.
S’agissant de la justice, une seule chose à retenir : le meurtrier n’avait plus de discernement au moment des faits, celui-ci ayant été aboli par sa consommation volontaire de cannabis, c’est-à-dire de son propre fait, en l’occurrence fautif.
Nous voici donc au point qui nous préoccupe. L’article 122-1 du code pénal, qui permet de déclarer un auteur pénalement irresponsable, devait-il s’appliquer à une personne dont le discernement a été altéré de son propre fait ? Que ce soit de son fait ou non, l’auteur était irresponsable au moment du meurtre et cela, nous ne pouvons rien y faire. Devrait-on le juger pour des faits qu’il n’a pas commis en toute conscience ?
Jusqu’à présent, notre droit et notre justice s’y sont toujours refusés, malgré les propositions faites en ce sens par certains spécialistes. Notre rapporteur nous propose de rester sur cette ligne. Malgré l’émoi suscité, nous nous devons de légiférer avec le recul nécessaire, en laissant de côté notre émotion légitime.
Pour autant, cela ne doit pas nous empêcher de nous poser des questions et, en particulier, de nous demander si l’approche mise en œuvre ne devrait pas être différenciée entre un auteur rendu meurtrier par sa propre faute et un auteur que le libre arbitre a quitté sans qu’il ait rien fait pour. Le premier ne pouvait ignorer que son comportement pouvait le pousser à ne plus se maîtriser ; le second est une victime collatérale de son propre état.
Cela change tout pour l’auteur, mais aussi pour les victimes, pour lesquelles entendre que quelqu’un s’est mis dans un état second volontairement et que cela l’exonère de responsabilité est particulièrement difficile. On sait que la justice est réparatrice pour les victimes, même si, dans le cas présent, elle ne ramènera pas une mère.
Le fait que la culpabilité de l’auteur soit reconnue permet de conférer aux personnes qui ont subi ses actes le statut de victime ; c’est pour cela que le jugement est important. Tel est l’objet de cette proposition de loi. Il s’agit de permettre que le jugement ne se limite pas à la décision de la chambre de l’instruction, comme c’est le cas en l’espèce, ou à l’ordonnance du juge d’instruction, mais que, lorsque l’auteur est à l’origine de l’abolition de son propre discernement, on rende tout de même justice aux victimes par un procès public.
Dans le cas Halimi, que se serait-il passé ? Un procès public aurait eu lieu, durant lequel l’auteur aurait, comme il l’a fait devant la chambre de l’instruction, reconnu son crime et présenté ses excuses aux victimes. Il aurait, très probablement, été déclaré irresponsable de la même façon.
Les victimes, elles, auraient été reconnues publiquement et la cour aurait pu rappeler, également publiquement, avec un écho plus large que celui de la chambre de l’instruction, que l’antisémitisme est pénalement répréhensible.
Pour la suite, l’auteur est en hôpital psychiatrique et sa seule sanction est de ne plus apparaître dans le périmètre géographique de son crime pendant vingt ans. Pourrait-il sortir libre dès demain, sans obligation de soins, sans être contraint de ne jamais retoucher à une quelconque drogue ? Ce sont les médecins, et non plus le tribunal, qui devront y répondre, alors que, à mon sens, le juge devrait pouvoir intervenir à ce moment, afin de prendre en compte la dangerosité potentielle de la personne que l’on aura à libérer un jour, si elle va mieux.
On ne juge pas les fous, c’est juste, mais savoir mesurer leur dangerosité et s’en protéger, c’est également justice.
Notre groupe salue l’initiative de nos deux collègues Nathalie Goulet et Jean Sol, qui nous donne l’occasion d’avoir aujourd’hui un débat nécessaire sur l’évolution de l’irresponsabilité pénale, mais également sur ce qui permet de la caractériser : l’expertise psychiatrique du prévenu ou de l’accusé.
Grâce à leurs travaux, nous aboutissons aujourd’hui à un texte équilibré que notre groupe soutiendra, en espérant, monsieur le garde des sceaux, que le Gouvernement saura s’en inspirer, comme il a su le faire au cours des derniers mois pour d’autres propositions de loi sénatoriales, et je salue ici notre collègue Annick Billon.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en tant que législateur, il est des combats que nous pouvons mener, des réponses que nous pouvons apporter, des besoins que nous pouvons satisfaire ; il en est d’autres pour lesquels la réponse est plus malaisée. La question de l’irresponsabilité pénale des malades psychiatriques exige ainsi beaucoup d’humilité.
Affaire après affaire, nous sommes collectivement choqués, meurtris, horrifiés par l’atrocité de faits commis, lesquels échappent parfois même à notre capacité à les nommer. En sympathie avec les proches des victimes, nous percevons le caractère incommensurable de leur douleur ; nous partageons leur besoin de comprendre, leur soif de justice, leur volonté d’obtenir réparation.
Comme les leurs, nos questionnements et nos exigences restent insatisfaits, car, si la justice commande qu’un auteur réponde de ses actes devant la société, l’irresponsable, au sens étymologique du terme, n’en a pas la capacité et laisse la société, comme les victimes, sans réponse.
Je n’oublierai ainsi jamais, parce que cela s’est passé sur le territoire de la commune dont j’étais le maire, ces deux familles détruites après qu’un jeune homme atteint de schizophrénie a tué sa petite amie. L’irresponsabilité n’efface pas l’horreur du crime, elle y ajoute l’incompréhension face au « crime du fou ».
Ces histoires dramatiques nourrissent une insatisfaction profonde et un débat public sur ce qui pourrait changer. Or la voie est étroite et l’on peut envisager les choses d’un tout autre point de vue.
Ainsi que l’a rappelé Jean Sol, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, les travaux communs de nos deux commissions étaient, à l’origine, d’une autre nature. Il s’agissait, à la demande de notre collègue Nathalie Delattre, d’examiner les conditions de l’expertise psychiatrique en matière pénale sur la base du constat que la santé mentale de nombreuses personnes incarcérées est défaillante, que ces dernières aient été atteintes de troubles mentaux avant leur procès ou qu’elles en aient développé par la suite. L’angle de départ était plutôt que ces malades mentaux n’avaient pas forcément leur place en prison.
Au-delà de la misère de la psychiatrie en France, déjà bien documentée par de nombreuses analyses, les travaux de nos commissions ont mis en lumière les grandes difficultés de l’expertise psychiatrique, laquelle s’appuie sur une ressource de plus en plus rare, et néanmoins plutôt peu et mal pilotée.
C’est ce à quoi l’essentiel de la proposition de loi de Jean Sol s’efforçait de remédier. Je ne voudrais pas, monsieur le garde des sceaux, que le débat sur l’irresponsabilité pénale occulte totalement cette partie du texte. Dans cette matière, certes moins noble et plus concrète, il est évident que le ministère de la justice doit progresser. Nous partons de loin : la commission a, par exemple, réalisé, il y a peu, que le dossier du travail des experts ne semblait tout simplement pas géré par la Chancellerie.
S’agissant de l’irresponsabilité pénale, nous recherchons un équilibre fragile entre le besoin de réparation des victimes et le fait que l’incarcération d’une personne malade ne saurait en aucune manière le satisfaire.
Avec Jean Sol, nous avons considéré que la question de l’intoxication volontaire par des substances psychoactives devait être posée. L’irresponsabilité ne doit pouvoir être retenue que lorsqu’elle n’a pas été expressément recherchée. C’est pourquoi la rédaction proposée dans la proposition de loi retenait la notion « d’exposition contrainte aux substances psychoactives », seule susceptible d’entraîner une abolition du discernement.
Cette rédaction préservait également la capacité du juge à apprécier les circonstances de l’espèce, ce qui me semble indispensable, le législateur ne pouvant tout prévoir, énumérer tous les cas de figure dans la loi et encore moins se substituer au juge ou à l’expert, même si, sous le coup de l’émotion, il peut en éprouver le besoin.
Il est, en revanche, une responsabilité qu’il porte, celle de créer les conditions d’une prise en charge correcte de la santé mentale dans notre pays et, même si je connais moins bien ce domaine, les conditions d’une administration correcte de la justice.
Nos réponses face aux crimes des personnes psychotiques resteront forcément insatisfaisantes, comme le sera peut-être notre débat d’aujourd’hui. Il est pourtant de notre responsabilité de les traduire dans des politiques publiques plus efficaces. Je forme le vœu que notre débat d’aujourd’hui puisse y contribuer.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il y a dix-huit mois, j’interpellais Édouard Philippe, alors Premier ministre, dans cet hémicycle à la suite de la décision de la cour d’appel en ces termes : « Le droit, certes, mais la décision est-elle juste ? » Le Premier ministre, très embarrassé, m’a fait une réponse mi-figue mi-raisin d’où il ressortait que, certes, le droit était respecté, mais que la décision n’était pas juste.
Nous avons tous attendu avec beaucoup d’espoir la décision de la Cour de cassation, considérant que, si celle-ci décidait d’un procès, nous n’aurions peut-être pas à dire que la loi devait être modifiée, alors que l’émotion avait saisi tout le pays – et pas seulement la communauté juive, comme je l’ai entendu – après le massacre de Mme Halimi. Une telle décision aurait peut-être pu calmer le jeu, permettre aux victimes de faire leur deuil et faire en sorte qu’il puisse y avoir un vrai procès, après bien des erreurs dans la conduite de cette affaire.
Malheureusement, la Cour de cassation n’en a pas décidé ainsi, avec tout le respect que j’ai pour les magistrats. Ceux-ci se sont eux-mêmes légitimement défendus en indiquant qu’ils appliquaient la loi, laquelle ne permettait pas de distinguer ce qui provoque l’irresponsabilité provisoire. Dans ces conditions, ils considéraient qu’il ne leur revenait pas de déterminer si le meurtrier était ou non responsable de son irresponsabilité et renvoyaient, à raison, la question au législateur.
Et nous voilà avec ce texte mal ficelé.
J’entends bien que l’on ne légifère pas dans l’émotion, mais légiférer sur la demande des magistrats de la Cour de cassation, ce n’est pas légiférer dans l’émotion : c’est répondre à une demande de la magistrature pour lui permettre de mieux juger. Dans ces conditions, il me paraît tout à fait normal que le législateur fasse son travail.
Il ne s’agit pas de dire que l’on va juger les fous. Personne n’imagine qu’on en revienne au Moyen Âge, quand les fous étaient présentés avec capuchon et oreilles d’âne, encore que la justice du Moyen Âge n’était pas aussi caricaturale qu’on le dit parfois et faisait des distinctions sur le jugement des fous.
On évoque des cas de schizophrènes, mais dans ces cas-là, personne ne peut mettre en cause, ni de près ni de loin, la responsabilité de ces gens ; il est évident que, si vous souffrez d’une maladie mentale, quelle qu’elle soit, il n’y a pas lieu de mettre en cause votre responsabilité et il faut trouver des solutions acceptables pour les victimes comme pour la société.
Lorsque, cependant, le meurtrier ou le délinquant – peu importe la gravité de l’acte – est dans un état qu’il a lui-même provoqué, comment avancer que, peut-être, ce serait la société ou son entourage qui aurait provoqué une situation qui l’aurait poussé, parce qu’il ne se sentait pas en état, vers la drogue, l’alcool, ou je ne sais quel élément qui lui aurait fait perdre sa responsabilité ?
Dans ce cas, à mon sens, le législateur doit faire la balance entre la liberté et les droits individuels, que les magistrats défendent très bien, je compte sur eux pour cela, et la défense de la société, la défense de ce que nous voulons incarner collectivement, quelles que soient nos opinions : de gauche, de droite ou du centre, là n’est pas le sujet.
Le sujet, c’est de savoir comment la société traite ses victimes, l’ensemble de ceux qui subissent, d’une manière ou d’une autre. Si vous vous contentez de leur dire, « vous comprenez, l’article 122-1 ne le permet pas », pardon de vous dire que vous êtes déconnecté des gens et des réalités !
Il y a des familles, servez-les !
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – M. Christian Bilhac applaudit également.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Chapitre Ier
Des causes de l’irresponsabilité pénale
Après le premier alinéa de l’article 706-120 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge d’instruction au moment du règlement de son information estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait fautif, il renvoie devant la juridiction de jugement compétente qui statuera sur l’application de l’article 122-1 du code pénal et, le cas échéant, sur la culpabilité. »

Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 5 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 7 est présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 5.

Alors qu’une majorité semble se dégager pour que nous ne touchions à l’article 122-1 du code pénal, ma crainte est que cet article 1er ne conduise à le faire tomber.
C’est la raison pour laquelle nous en demandons la suppression.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 7.

J’ai présenté cet amendement lors de la discussion générale. Il nous semble que la solution imaginée par la commission des lois, in fine, n’est pas réaliste.
D’une part, la chambre de l’instruction a procédé et procède à de vraies audiences avec contradictoire et publicité ; d’autre part, nous considérons que ce n’est pas fondamentalement le rôle d’un tribunal correctionnel ou, singulièrement, d’une cour d’assises, que de déclarer l’irresponsabilité ou l’hospitalisation sous contrainte, même si le droit le permet. Une cour d’assises est beaucoup plus habituée à condamner, tout simplement. Par conséquent, on modifie l’équilibre de notre processus judiciaire.
Il faut que la chambre de l’instruction fasse son travail, ce qui n’est pas du tout exclusif des amendements que nous présenterons et qui visent à prendre en compte les cas où l’auteur, en toute responsabilité, organise en quelque sorte son irresponsabilité.

Madame Assassi, monsieur Sueur, vous ne serez pas étonnés que l’avis de la commission soit défavorable.
Madame Assassi, j’ai bien entendu vos propos lors de la discussion générale, mais ce texte n’emporte pas de contournement de la procédure de l’article 122-1, qui va rester intégralement en l’état ; il est seulement prévu un renvoi devant les juridictions du fond en cas de fait fautif ayant causé l’abolition temporaire du discernement. Nous n’avons donc aucune volonté de contourner les dispositions de l’article 122-1, l’ensemble du bloc de l’instruction tel qu’il existe aujourd’hui, avec les expertises, sera maintenu, y compris le débat issu de la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, dite loi « Dati » dans le cadre de la procédure d’instruction. C’est en cas de fait fautif, et dans ce cas-là seulement, qu’il y aura renvoi devant la juridiction de jugement.
J’ajoute, à l’attention de M. Sueur, que la chambre de l’instruction n’est pas une juridiction de jugement, elle ne prononce pas de peine et elle peut parfaitement se réunir en l’absence de la personne responsable de la mise en examen. En tous les cas, elle ne propose un sursis à statuer que lorsque les personnes ne sont pas en état d’être jugées.
Je m’en remets à la sagesse du Sénat sur ces deux amendements, parce que je veux exprimer la nécessité de débattre de ces questions.
Je suis évidemment défavorable à l’article 1er dans cette rédaction et, comme je l’ai indiqué, je suis défavorable au texte, mais il me semble important que nous puissions débattre et je suis très attaché à m’enrichir du débat lorsque celui-ci est constructif.
Les amendements ne sont pas adoptés.

L’amendement n° 4 rectifié bis, présenté par Mme Eustache-Brinio, MM. Retailleau, Allizard, Anglars, Bascher, Bazin et Belin, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonne, Mme Borchio Fontimp, MM. Boré et Bouchet, Mmes Boulay-Espéronnier, Bourrat et V. Boyer, MM. Burgoa, Cadec et Calvet, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mmes Chauvin et de Cidrac, M. Cuypers, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mmes Demas, Deromedi, Deseyne, Drexler, Dumas, Dumont et Estrosi Sassone, MM. B. Fournier et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Goy-Chavent, MM. Grand et Gremillet, Mme Gruny, MM. Guené, Gueret, Houpert, Hugonet et Husson, Mmes Imbert, Jacques et Joseph, MM. Klinger et Laménie, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Le Rudulier et Longuet, Mmes Lopez et Micouleau, M. Milon, Mme Muller-Bronn, M. de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Piednoir et Pointereau, Mme Raimond-Pavero, MM. Regnard, Rojouan, Saury, Sautarel et Savary, Mme Schalck, MM. Sido et Tabarot, Mmes Thomas et Ventalon et MM. C. Vial et Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer le mot :
temporaire
La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio.

Nous avons souhaité déposer deux amendements afin de préciser davantage la portée de l’article 1er élaboré par Mme le rapporteur.
Cet article ne fait référence qu’à l’hypothèse dans laquelle le lien causal entre comportement et abolition du discernement a conduit à une abolition temporaire du discernement.
Par cet amendement, nous souhaitons permettre au juge du fond de décider, lorsque l’origine de l’absence de discernement résulte du comportement du mis en cause, qu’un procès ait lieu, que cette absence de discernement soit définitive ou temporaire.
L’objet du présent amendement est donc de renvoyer au juge du fond le soin de statuer sur le caractère temporaire ou non de l’abolition de discernement.

Votre amendement est totalement contraire à l’esprit du texte que nous avons voté en commission. Précisément, l’idée n’est pas de transférer toutes les personnes irresponsables devant la juridiction de jugement, mais seulement celles dont un fait fautif a causé l’abolition temporaire.
Si l’on enlève « temporaire » du dispositif, celui-ci devient totalement déséquilibré. Dès lors, autant supprimer l’article 122-1 !
La commission a fort bien fait d’émettre un avis défavorable sur votre amendement, dont l’adoption déséquilibrerait le texte. Je vous propose donc de le retirer.
Je suis évidemment sur la même ligne que Mme la rapporteure. Si l’abolition du discernement n’est pas temporaire, alors elle est encore en cours dans la phase de jugement. Cela signifie donc que l’on juge un fou, ce qui est contraire à ce que nous souhaitons.
L’accusé doit être à même de comprendre le procès. Si nous ne sommes pas dans cette situation, alors nous sommes, au regard des règles qui sont les nôtres, dans une forme de régression. Tout le monde sera d’accord là-dessus.
L’avis est donc défavorable.

Madame Jacqueline Eustache-Brinio, l’amendement n° 4 rectifié bis est-il maintenu ?

L’amendement n° 4 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par Mme Eustache-Brinio, MM. Retailleau, Allizard, Anglars, Bas, Bascher, Bazin et Belin, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonne, Mme Borchio Fontimp, MM. Boré et Bouchet, Mmes Boulay-Espéronnier, Bourrat et V. Boyer, MM. Burgoa, Cadec et Calvet, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mmes Chauvin et de Cidrac, M. Cuypers, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mmes Demas, Deromedi, Deseyne, Drexler, Dumas, Dumont et Estrosi Sassone, MM. B. Fournier et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Goy-Chavent, MM. Grand et Gremillet, Mme Gruny, MM. Guené, Gueret, Houpert, Hugonet et Husson, Mmes Imbert, Jacques et Joseph, MM. Klinger et Laménie, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Le Rudulier et Longuet, Mmes Lopez et Micouleau, M. Milon, Mme Muller-Bronn, M. de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Piednoir et Pointereau, Mme Raimond-Pavero, MM. Regnard, Rojouan, Saury, Sautarel et Savary, Mme Schalck, MM. Sido et Tabarot, Mmes Thomas et Ventalon et MM. C. Vial et Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer le mot :
fautif
La parole est à Mme Jacqueline Eustache-Brinio.

Cet article concerne la notion de « fait fautif », laquelle nous semble complexe à circonscrire et susceptible d’ouvrir la voie à de multiples interprétations juridiques non dépourvues de conséquences.
Cette formulation pourrait ainsi être entendue comme renvoyant nécessairement à une infraction pénale ; or la loi pénale étant d’interprétation stricte, cela risquerait de poser quelques difficultés.
Une consommation excessive d’alcool à son domicile, par exemple, ne constitue pas en soi une infraction pénale, pas plus que la non-prise d’un traitement médicamenteux consécutif à une pathologie psychiatrique qui ne serait pas imposé par une autorité judiciaire au titre d’une obligation de soins.
Pour l’ensemble de ces raisons, il nous paraît indispensable de supprimer l’adjectif « fautif » de l’article 1er, afin de ne pas limiter la caractérisation des cas dans lequel le comportement du mis en cause a contribué à l’abolition de son discernement, quand bien même ce comportement n’est pas constitutif, en soi, d’une infraction pénale.
Tel est l’objet de cet amendement, qui nous semble essentiel pour conforter cet article.
Compte tenu de mes réserves sur l’article 1er, je ne peux être favorable à un amendement qui en élargit encore le champ d’application.
L’avis est donc défavorable.

Un mot d’explication de vote en soutien de cet amendement.
Nous l’avons constaté lors de nos différents échanges, nous nous accordons tous sur quelques points, parmi lesquels le sacro-saint principe selon lequel on ne peut pas juger les fous. C’est la raison pour laquelle Jacqueline Eustache-Brinio vient de retirer, après les explications du rapporteur et du garde des sceaux, son amendement n° 4 rectifié bis.
Il s’agit ici d’autre chose : si nous ne voulons pas juger les fous, nous entendons apporter un remède à un texte, qui nécessite quelques explications.
Comme l’a dit Jean-Pierre Sueur, le statu quo n’est pas possible. Nous avons d’ailleurs rejoint l’analyse de la commission des lois et du rapporteur afin que les familles des victimes, voire les victimes, si elles sont encore en vie, puissent bénéficier d’un procès, qui est un moment important, pour la victime, pour sa famille ou pour ses proches.
À ce titre, la ligne de crête dégagée par la commission est la bonne, qui consiste à cibler les situations dans lesquelles une sorte de choix volontaire a présidé, chez celui qui a commis le délit ou le crime, à l’abolition de son discernement.
Cet amendement vise à retirer du texte la mention d’un « fait fautif ». Que cherchons-nous ? Nous voulons savoir si le fait générateur est la volonté de celui qui, par la prise immodérée d’alcool ou de stupéfiants, a aboli son discernement. Peu importe la cause, que le fait soit fautif ou non, que sa volonté soit liée ou non à une infraction.
Or « fait fautif » renvoie directement à une infraction pénale ; c’est ce que nous ne voulons pas. Les exemples avancés par Jacqueline Eustache-Brinio me semblent probants, cette notion atténue le dispositif que nous proposent Mme le rapporteur et la commission des lois.
C’est la raison pour laquelle nous soutiendrons cet amendement.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 8, présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
statuera
insérer les mots :
, avant l’examen au fond,
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Nous l’avons dit, nous sommes défavorables à l’article 1er ; pour autant, nous proposons ici une précision procédurale : qu’il soit procédé à l’examen de l’irresponsabilité éventuelle par la juridiction de jugement avant l’examen de l’affaire au fond.
C’est toujours le cas pour les exceptions de procédure, mais il me semble qu’il est très important de le rappeler et de le préciser. Lorsqu’une cour d’assises va être saisie de ce cas de figure, il faudra traiter d’emblée la question de l’irresponsabilité, avant que ne s’ouvre le débat sur les faits.
À défaut, notre crainte que des jurés populaires ne puissent finalement pas prononcer l’irresponsabilité serait renforcée.
En toute logique, nous souhaitons donc que l’examen de cette irresponsabilité pénale éventuelle ait lieu avant celui de l’affaire au fond.

La commission a émis un avis de sagesse sur votre amendement, madame de La Gontrie, dans la mesure où vous avez parfaitement compris le dispositif. Il consiste, premièrement, à conserver le bloc de l’article 122-1 du code pénal, deuxièmement, à ne déférer que les personnes dont le discernement a été aboli temporairement. Le fait que l’examen de l’irresponsabilité intervienne in limine litis ne me semble pas être un problème.
L’avis de sagesse – positive, ajouterai-je – de la commission se justifie par le fait que celle-ci n’a pas pu évaluer ce dispositif.
Je suis défavorable à cet amendement, car comment pourrait-on dissocier l’examen de l’irresponsabilité pour cause de trouble mental et l’examen au fond du dossier ? J’ai du mal à concevoir la mise en œuvre pratique de cet amendement.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Monsieur le garde des sceaux, c’est pourtant précisément ce que fait la chambre de l’instruction ! Je suis intriguée par votre argument, car la chambre de l’instruction examine la question de l’irresponsabilité pénale, alors même qu’elle ne statuera pas sur le fond. Votre argument ne me semble donc pas recevable…

La réponse de Mme de La Gontrie ne me satisfait pas et je suis totalement d’accord avec ce qu’a dit le garde des sceaux. En effet, je ne sais pas comment l’on peut juger de l’irresponsabilité d’une personne sans parler du fond du dossier.
Selon vous, madame de La Gontrie, c’est ce que fait la chambre de l’instruction. Certes, mais nous parlons d’un renvoi en jugement, car c’est là le but de tout le dispositif.
La solution que la commission des lois propose pour régler le problème de l’irresponsabilité pénale dans un contexte déterminé, c’est de renvoyer l’affaire en audience de jugement. Or vous proposez de dissocier la question de la responsabilité pour la traiter en premier. C’est incompréhensible, car à partir du moment où l’on renvoie l’affaire en audience de jugement, il est impossible de séparer la question de la responsabilité et le fond du dossier.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 1 er est adopté.

L’amendement n° 10, présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 122-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le discernement est la conscience de l’acte commis, de ses conséquences et la capacité à en apprécier la nature et la portée. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Le discernement est nécessaire à l’établissement de l’imputabilité, élément indispensable pour répondre pénalement des conséquences de ses actes. Il est ensuite une composante essentielle de la capacité pénale, l’aptitude à la sanction supposant d’en comprendre le sens.
C’est pourquoi il nous est apparu utile et opportun d’inscrire dans le code pénal une définition du discernement.

Aucune définition du discernement ne figure, effectivement, dans le code pénal.
C’est pourquoi la commission a souhaité avoir l’avis du Gouvernement sur cet amendement.
Exercer son discernement, c’est tout simplement savoir ce que l’on fait. Pourquoi ajouter une définition qui complexifiera la notion ? D’autant que l’on pourra ensuite faire la définition de la définition ! Ce qui est compliqué, c’est de savoir si le discernement est totalement aboli ou s’il est simplement altéré.
Dans la loi ratifiant l’ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, qui a été votée il y a peu de temps, la notion du discernement du mineur a été introduite, alors qu’elle n’existait pas dans l’ordonnance de 1945 : « Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet. »
Pour le reste, je rappelle que la notion de discernement, qui est utilisée depuis la loi du 22 juillet 1992, n’a jamais posé aucun problème, à ma connaissance. Personne n’a jugé nécessaire de s’interroger pour savoir ce qu’était le discernement, car chacun sent bien de quoi il s’agit. Voilà pourquoi je suis défavorable à cet amendement.

Nous suivrons le Gouvernement : l’avis de la commission est donc défavorable.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Au détour de cet amendement, nous abordons un point fondamental, à savoir la précision que nous voulons désormais introduire dans le traitement de ce type d’affaires.
La notion de discernement, à laquelle on a beaucoup recours en droit pénal, n’était pas définie jusqu’à présent. M. le garde des sceaux a d’ailleurs utilement rappelé que nous avions éprouvé le besoin de le faire s’agissant des mineurs ; ne pas le faire pour les personnes majeures serait étrange.
Ce que nous proposons dans cet amendement, c’est d’appliquer aux personnes majeures la définition que donne du discernement le code de la justice pénale des mineurs.
Les appréciations variées qui ont pu être portées sur l’état des personnes devant être jugées s’expliquent sans doute, en partie, par un manque de précision dans la définition du discernement. Voilà pourquoi nous proposons cette clarification.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 9, présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal est complété par un article 122-… ainsi rédigé :
« Art. 122 -…. – Est pénalement responsable la personne qui a volontairement provoqué une perte de discernement aux fins de commettre l’infraction, notamment par la consommation de boissons alcooliques, de drogues toxiques, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de substances ayant des effets similaires. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Cet amendement prévoit la possibilité d’imputer la responsabilité de l’auteur d’une infraction, pour lequel l’abolition du discernement serait la cause exclusive de la prise volontaire de toxiques.
Cette rédaction s’inspire de l’article 20 de la loi organique du 23 novembre 1995 du code pénal espagnol, qui prévoit ainsi l’établissement de la responsabilité pénale d’une personne, dès lors que celle-ci a volontairement recherché l’intoxication, en vue de se mettre dans un état où il n’y a plus de responsabilité ni de discernement.
Si nous ne voulons pas en rester au statu quo, des formulations de ce type sont absolument nécessaires.

Une étude de la division de législation comparée du Sénat a donné un aperçu exhaustif de l’ensemble des codes européens, y compris le code espagnol, que vous citez, lequel introduit une exception à ce qui est notre article 122-1 de notre code pénal, ce que nous ne souhaitons évidemment pas.
En outre, le cas visé dans cet amendement fait déjà l’objet d’une jurisprudence qui est largement appliquée et de manière constante, dès lors qu’une personne s’intoxique pour se donner le courage de commettre son crime.
Adopter cet amendement reviendrait à amender l’article 122-1 du code pénal. Or c’est précisément ce que la commission ne souhaite pas faire. C’est la raison pour laquelle elle a émis un avis défavorable.
Monsieur le sénateur Sueur, vous posez dans votre amendement une question importante à laquelle je ne suis pas insensible.
La folie peut être endogène, ou bien avoir des causes exogènes, notamment la prise de psychotropes ou d’alcool. Vous suggérez de pénaliser ceux qui absorbent volontairement des produits psychotropes ou de l’alcool en très ou trop grande quantité, et qui, perdant ainsi la raison, commettent une infraction.
C’est une piste sur laquelle je travaille et qui a nourri ma réflexion. J’ai préparé un texte qui vient d’être soumis au Conseil d’État. Pour l’instant, je vous demande donc de retirer cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Je suis sensible à l’intérêt que M. le garde des sceaux porte à notre amendement. Vous comprendrez cependant que nous ne le retirions pas, car l’argument selon lequel le Gouvernement a préparé, de son côté, un texte qu’il a soumis au Conseil d’État ne saurait justifier le retrait de notre proposition dans le cadre du présent texte.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 2, présenté par M. Benarroche, Mme Benbassa et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l’article 706-136 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Une obligation de soins. »
La parole est à M. Guy Benarroche.

Les personnes déclarées irresponsables peuvent, au titre des mesures prévues à l’article 706-135 du code de procédure pénale, par décision motivée, être admises en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur le modèle des soins sans consentement.
Le présent amendement prévoit la possibilité nouvelle pour le juge du fond, conformément à la recommandation n° 10 du rapport de la mission sur l’irresponsabilité pénale rendu en février 2021, de prononcer, en complément de cette hospitalisation, une mesure de sûreté d’obligation de soins dont la durée pourra aller jusqu’à vingt ans.
De nombreuses mesures essentielles au bon fonctionnement du système judiciaire, notamment celle sur la revalorisation du travail des experts, sont d’ordre réglementaire, de sorte qu’elles relèvent uniquement de l’action du Gouvernement.
Or il me paraît essentiel d’intégrer dans notre arsenal législatif cette proposition d’une obligation de soins comme mesure de sûreté. En effet, en plus de l’admission en hôpital de soins psychiatriques prévue dans le cadre d’une décision d’irresponsabilité, le rapport commandé par Mme Belloubet suggère de manière judicieuse que les juges puissent aussi prononcer une peine de sûreté liée à l’obligation de soins. Il est logique de vouloir éviter ce qui pourrait être assimilé à des sorties sèches, et de soumettre les personnes dont le discernement a été aboli, de manière temporaire ou non, à un suivi post-hospitalisation.
Le juge c’est le juge ; le médecin, c’est le médecin.
Il faut être clair sur ce point qui est pour moi une ligne rouge infranchissable.
Je suis totalement défavorable à cet amendement, dont les dispositions auront pour conséquence de judiciariser ce qui relève de la psychiatrie. Le procédé est assez curieux et même tout à fait inquiétant.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.
Après l’article 132-80 du code pénal, il est inséré un article 132-81 ainsi rédigé :
« Art. 132 -81. – Lorsqu’un crime ou un délit est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de stupéfiants, le maximum de la peine privative de liberté est relevé ainsi qu’il suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;
« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;
« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;
« 7° Le maximum de la peine privative de liberté et d’amende sont portés au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus. »

L’amendement n° 6, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.

Cet article prévoit de créer une aggravation des peines pour les crimes et délits commis en état d’intoxication.
Les questions de prise de stupéfiants ou de consommation d’alcool devraient d’abord être mieux traitées d’un point de vue sanitaire, plutôt qu’être constamment envisagées d’un point de vue pénal.
En outre, la commission indique dans son rapport qu’elle a constaté « qu’une part prédominante des cas d’irresponsabilité pénale comporte la consommation de stupéfiants et d’alcool » et qu’elle a « en conséquence estimé nécessaire d’agir sur les facteurs déterminants de l’irresponsabilité, en faisant de l’état d’ivresse alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants une circonstance aggravante pour l’ensemble des crimes et délits ».
Légiférer en ce sens, ce serait oublier que la prise de drogue ou d’alcool ne constitue pas nécessairement un comportement fautif, et qu’elle peut être non pas la cause, mais la conséquence de l’abolition du discernement. Une mauvaise observance des soins, un arrêt du traitement, une consommation excessive d’alcool ou de stupéfiants peuvent faire partie de la maladie plutôt qu’en être la cause.
Ces situations sont d’ailleurs très fréquentes dans le cas des psychoses où les traitements administrés peuvent avoir des effets inhibiteurs qui minent toute activité quotidienne, de sorte qu’on peut leur substituer, à tort pour nous, mais à raison pour les patients, des toxiques qui soulagent sur le moment.
Quoi qu’il en soit, il n’apparaît pas concevable de revoir l’échelle des peines au détour d’une proposition de loi que je qualifie encore « de circonstance ».

C’est un avis défavorable. En effet, une étude attentive de la jurisprudence sur le sujet de l’irresponsabilité montre que l’alcool et les stupéfiants sont très souvent en cause.
En outre, la commission a examiné avec une très grande attention les dispositions du code pénal, et elle a constaté qu’il existait au moins sept délits et crimes qui ne donnaient pas lieu à une aggravation des peines en cas de prise d’alcool et de stupéfiants. Parmi ceux-ci, l’on trouve les actes de barbarie et de torture, le meurtre, les coups et blessures ayant entraîné la mort, les violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, l’homicide involontaire et les blessures involontaires.
Les dispositions prévues à cet article permettent, de manière globale, d’aggraver les peines encourues pour l’ensemble des délits lorsque la personne qui les commet agit en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de stupéfiants.

Nous allons soutenir cet amendement n° 6 de Mme Assassi.
Premièrement, j’ai souvent eu l’occasion de dire que l’application de l’article 45, ici comme à l’Assemblée nationale, relevait de l’aléatoire, et nous en avons quelque exemple puisque, dans le cas présent, elle porte bien au-delà de l’objet du texte.
Deuxièmement, nous devons veiller à ne pas mélanger ce qui concerne la médecine et la santé, et ce qui relève ou doit relever du tout judiciaire.
Il y a là une double confusion. C’est la raison pour laquelle nous soutenons cet amendement. S’il n’était pas adopté, nous voterions contre l’article 2.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 2 est adopté.

L’amendement n° 1 rectifié, présenté par Mmes V. Boyer et Billon, MM. Pellevat et Frassa, Mmes Garriaud-Maylam et Belrhiti, MM. Charon et Savary, Mmes Borchio Fontimp et Micouleau, MM. Sido et Laménie, Mmes Garnier et Imbert, MM. J.M. Boyer, H. Leroy et Milon, Mme Gosselin et MM. D. Laurent, Savin et Bouchet, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’impact de ces violences sur la victime est pris en compte pour l’application des articles 122-1, 122-2 et 122-5 lorsque sa responsabilité pénale est engagée. »
La parole est à Mme Valérie Boyer.

Je remercie les membres de la commission d’avoir émis un avis favorable sur cet amendement. Il s’inscrit dans un contexte particulièrement dramatique que vit notre pays. Je veux, en effet, parler de l’assassinat de Stéphanie, à Hayange, à l’âge de 22 ans. Cette jeune femme a été abattue lâchement, en pleine rue, par son conjoint violent. La victime avait pourtant précédemment porté plainte. J’ajoute que quarante-trois femmes ont déjà été assassinées par leur conjoint depuis le début de l’année.
La lutte contre les violences conjugales est un combat qui concerne toute la société. C’est un combat universel. Un certain nombre d’associations, de parlementaires et de juristes mènent ce combat depuis plusieurs années, mais celui-ci ne progresse jamais assez vite.
Permettez-moi de saluer l’engagement de maître Nathalie Tomasini, avec qui je travaille depuis plusieurs années. Elle est notamment l’avocate de Valérie Bacot, qui est accusée d’avoir tué son mari, en 2016, au terme de plusieurs années d’horreurs, sur lesquelles je ne vais pas revenir. Ce qui importe, en effet, et c’est la raison pour laquelle je présente cet amendement, c’est que cette personne encourt désormais une peine de prison à perpétuité.
Mes chers collègues, il ne s’agit pas de s’ériger en juges, mais de poser la question suivante : Valérie Bacot est-elle une meurtrière ou une victime ? Sur ce point, l’expert psychiatre a reconnu, pour la première fois dans une expertise requise par un parquet en France, que l’accusée était atteinte, au moment des faits, du syndrome de la femme battue.
Je rappelle que le Canada reconnaît ce syndrome depuis 1990. Concrètement, la personne qui en est atteinte ne peut plus prendre de décision raisonnable et raisonnée. Toutes les attaques du conjoint violent touchent à l’intégrité psychique de la victime, qui devient alors prisonnière de la situation qu’elle subit.
Cet état de soumission et de danger de mort permanent, vécu pendant des années, peut entraîner un comportement extrême. Cela aboutit, malheureusement, dans la plupart des cas au suicide de la victime de violences.
Dans certains cas extrêmement rares, la victime se retourne contre le conjoint, car il n’y a pas d’autre issue que de le tuer pour ne pas mourir : « C’est lui ou moi ! »
Aussi, mes chers collègues, je vous propose de voter un amendement qui n’a pas pour objet de délivrer un permis de tuer, mais de reconnaître l’impact des violences conjugales sur l’état psychique de la personne qui en est victime, et de prévoir une irresponsabilité pénale étendue.

Cet amendement ayant été rectifié à la suite de son examen en commission, celle-ci émet un avis favorable.
Je suis totalement défavorable à cet amendement, non pas que j’ignore la cause que vous portez, ou que je la considère comme illégitime, mais la rédaction de votre proposition pose un grave problème de droit et je ne la comprends pas.
En plus d’être irrecevable, cet amendement me paraît dangereux. En effet, tel qu’il est rédigé, il vise à introduire une disposition qui n’est pas normative et qui n’a donc pas vocation à s’inscrire, comme vous le souhaitez, dans la loi.
Je comprends votre objectif, madame la sénatrice, mais le droit, en particulier en matière pénale, est infiniment précis, comme le rappelait encore tout à l’heure l’une de vos collègues.

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Cet amendement est quelque peu gênant. L’exposé des motifs de Valérie Boyer est très efficace à cet égard, et nous sommes tous, j’en suis certaine, convaincus de la nécessité de lutter contre les violences conjugales.
Cependant, notre travail reste de faire la loi, et dans cet amendement, madame Boyer, vous ne faites que reprendre le principe même de l’appréciation d’éventuelles circonstances atténuantes. Lorsque l’on juge une affaire potentiellement criminelle, les circonstances dans lesquelles elle s’inscrit et les personnalités de la victime et de l’auteur du crime doivent bien évidemment être étudiées et examinées. Or vous restreignez le champ de cette possibilité à un seul type d’infraction.
Il reste problématique et gênant de traiter d’un sujet aussi lourd au détour d’un texte qui n’y est pas précisément consacré, puisqu’il porte sur l’irresponsabilité pénale. Le travail serait trop rapide et incomplet.
Précédemment, déjà, vous avez tenté de modifier d’un trait de plume l’échelle des peines. À présent, vous proposez un amendement dont la rédaction n’est guère compréhensible, comme l’a dit le garde des sceaux, et qui vise à introduire une forme de circonstance atténuante. Nous ne le voterons pas, car il n’est pas abouti.

Je crois que tout le monde comprend mon objectif. Si je soulève cette question à l’occasion de l’examen de ce texte de loi, c’est justement parce que nous parlons des difficultés que peuvent rencontrer certaines personnes lorsqu’elles sont dans des situations extrêmes, notamment de violences conjugales.
Il y a une forme d’altération du jugement, la victime de violences se sentant en danger de mort permanent. Ce stress a été décrit, et je ne vais pas revenir sur l’exposé des motifs, qui reprend des dires d’experts mandatés par les tribunaux. Ces femmes sont l’objet d’une torture mentale qui les place dans un état de stress total.
J’ai retravaillé cet amendement, bien évidemment, à la demande de la commission. Il n’y a aucune précipitation, car j’étudie ce problème depuis de nombreuses années, que ce soit à l’Assemblée nationale ou ici.
Le sujet, c’est l’altération du jugement. En l’espèce, il est causé non pas par la drogue ou l’alcool, mais par un stress extrême, la victime qui vient d’être battue étant toujours dans l’attente de la prochaine occasion où son conjoint va de nouveau la torturer.
Je ne vois pas pourquoi cet amendement ne trouverait pas sa place dans ce texte, d’autant que, je le répète, je l’ai retravaillé à la demande de la commission et qu’il a reçu un avis favorable. À mon sens, il n’est absolument pas imprécis. Mieux, il répond à une attente qui dure depuis plusieurs années.

Les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes alimentent régulièrement, hélas, l’actualité : deux féminicides ont encore eu lieu ces derniers jours. L’emprise, c’est véritablement une stratégie implacable qui est mise en œuvre par les agresseurs, par les prédateurs sexuels. L’emprise, c’est le moyen d’isoler sa victime pour poursuivre impunément ces actes de barbarie.
Cet amendement, déposé par notre collègue Valérie Boyer, permet d’apporter enfin une réponse à cette situation en prenant en compte la réalité des victimes qui ont traversé, en silence souvent, des années de violences, d’agressions sexuelles, de viols, de tortures psychologiques. Des victimes qui ne se sont jamais vu reconnaître ce statut. Grâce à cet amendement, ce serait enfin le cas, et, bien entendu, je le soutiens, en remerciant Valérie Boyer de l’avoir déposé.

Je pense qu’il y a peut-être un problème de rédaction avec cet amendement. En effet, il parle de prise en compte de l’impact de ces violences sur la victime, alors que l’on parle bien de l’auteur, qui, préalablement aurait été victime de violences. Or l’article 122-1 du code pénal s’applique non pas à des victimes, mais à des auteurs…

Mme Dominique Vérien. Oui, mais ce n’est pas ce qui est écrit. Il parle de la responsabilité pénale de la victime, alors qu’il faudrait parler, si je vous ai bien comprise, d’un auteur, le plus souvent d’une auteure, qui aurait agi alors qu’elle était sous emprise et préalablement victime.
M. le garde des sceaux renchérit.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2.
L’amendement n° 11, présenté par M. Sueur, Mme de La Gontrie, MM. Kanner, Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 158 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est ajouté aux questions techniques mentionnées au premier alinéa une question spécifique destinée à identifier une participation active à la perte de discernement. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

L’une des raisons des divergences entre les experts ou les collèges d’experts, dans les situations où le passage à l’acte pénalement incriminé a eu lieu sous toxiques, tient au fait que certains d’entre eux prennent en compte la position psychique du sujet au moment de la prise de la substance psychoactive pour rejeter l’atteinte au discernement, tandis que d’autres se limitent strictement à la question posée et à la caractérisation de l’état psychique au moment de l’acte.
Les experts pourraient poser la question suivante – laquelle s’inscrirait dans une nomenclature – : décrire les conditions, les motivations et les conséquences, dans l’hypothèse où des circonstances telles que la prise de toxiques ou un arrêt d’un traitement médical peuvent avoir provoqué ou accentué un état pathologique altérant ou abolissant le discernement, entravant ou abolissant le contrôle des actes.
Tel est l’objet de cet amendement.

Si j’ai bien compris, il s’agit d’instituer l’obligation pour les experts de se prononcer sur la participation active à la perte du discernement. La commission a émis un avis de sagesse négative, car cela nous semble relever du domaine réglementaire. Néanmoins, nous attendons l’avis du Gouvernement.
Je suis d’accord, cela relève du réglementaire. Avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Chapitre II
Des conditions de réalisation de l’expertise d’irresponsabilité pénale
Après le deuxième alinéa de l’article 161 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’expert est commis pour se prononcer sur la détermination du discernement mentionnée à l’article 122-1 du code pénal, la première expertise ne peut avoir lieu dans un délai excédant deux mois après le placement en détention de la personne concernée. » –
Adopté.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 63-3 est complété par les mots : «, aux mêmes fins que celles mentionnées au premier alinéa ou au troisième alinéa de l’article 706-47-1 » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa de l’article 706-88 est complétée par les mots : « aux seules fins mentionnées au premier alinéa de l’article 63-3 ou au troisième alinéa de l’article 706-47-1 » ;
3° La première phrase du troisième alinéa de l’article 706-88-1 est complétée par les mots : « aux seules fins mentionnées au premier alinéa de l’article 63-3 ou au troisième alinéa de l’article 706-47-1 ».

J’en ai dit deux mots lors de la discussion générale, mais je voudrais préciser une nouvelle fois que cet article 4 vise en fait à compléter plusieurs articles du code de procédure pénale afin de restreindre le champ de l’examen clinique de garde à vue à la seule compatibilité de l’état de santé de la personne avec la mesure, en excluant expressément les expertises psychiatriques ou psychologiques requises par l’instruction judiciaire.
Pour y avoir beaucoup travaillé, nous pensons que cet article, à l’instar des articles 3 à 10, va dans le bon sens. C’est la raison pour laquelle nous voterons pour, même si, pour être tout à fait honnête et sincère, les deux premiers articles de la proposition de loi, qui sont quand même la raison principale pour laquelle nous légiférons aujourd’hui, ne nous conviennent pas. Voilà, je voulais juste dire que nous voterons cet article 4, ce qui ne vaut pas approbation de l’ensemble de la proposition de loi.
L ’ article 4 est adopté.
L’article 164 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins psychiatres chargés de l’examen d’une personne obtiennent directement sur leur simple demande des médecins ou établissements les détenant les documents médicaux nécessaires à l’accomplissement de leur mission sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé. » –
Adopté.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article 167, les mots : « Dans tous les cas » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il n’a pas déjà été fait application du premier alinéa de l’article 161-1 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 186, après la référence : « 148 », est insérée la référence : «, 156, deuxième alinéa » ;
3° Après la référence : « 82-3 », la fin du premier alinéa de l’article 186-1 est supprimée. –
Adopté.
Chapitre III
Des conditions de réalisation de l’expertise de prévention de la récidive
Le septième alinéa de l’article 717-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même sixième alinéa est applicable aux personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation, ainsi qu’aux professionnels chargés des expertises mentionnées aux articles 706-53-14, 723-31-1 et 730-2. » –
Adopté.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 706-53-14 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « psychiatres ou par un expert psychiatre et un expert psychologue titulaire d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. Avant leur transmission à la commission, les conclusions de l’évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et de l’expertise sont mutuellement portées à la connaissance de leurs auteurs respectifs. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 723-31-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « psychiatres ou par un expert psychiatre et un expert psychologue titulaire d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. Avant leur transmission au juge de l’application des peines ou au procureur de la République, les conclusions de l’évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et de l’expertise sont mutuellement portées à la connaissance de leurs auteurs respectifs. » ;
3° Le 2° de l’article 730-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant leur transmission au tribunal de l’application des peines, les conclusions de l’évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et de l’expertise sont mutuellement portées à la connaissance de leurs auteurs respectifs. » –
Adopté.
L’article L. 3711-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’expert mentionné au troisième alinéa de l’article 706-47-1 du même code peut exercer les fonctions de médecin coordonnateur. » –
Adopté.
Chapitre IV
Des obligations déontologiques de l’expert
L’article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque commission d’expert donne lieu à la transmission par ce dernier, dans un délai maximal de sept jours, au premier président de la cour d’appel concernée d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts, où figure toute activité professionnelle ou bénévole et toute fonction ou mandat électif, passés ou en cours, susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts. Cette déclaration peut être consultée par les parties intéressées ainsi que par leurs conseils. L’expert s’abstient de toute expression publique liée au contenu de son expertise avant qu’une décision prononcée ne soit devenue définitive. » –
Adopté.

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

Je suis, comme tous les membres de mon groupe, bien conscient du trouble, de l’émoi, de la colère exprimés par les personnes qui ont trop souvent l’impression que l’irresponsabilité pénale signifie que le mis en cause échappe à la justice. Aussi violent que cela puisse paraître, tel n’est pas le cas : la justice s’intéresse aux faits et, lors d’une audience contradictoire qui peut durer des heures, où la parole est donnée aux victimes et aux parties civiles, elle se prononce sur la responsabilité du mis en cause.
Il convient également de rappeler que l’irresponsabilité pénale ne signifie pas que l’individu déclaré irresponsable sera remis en liberté : il est placé en hospitalisation sous contrainte et des mesures de sûreté, pouvant aller jusqu’à 20 ans, peuvent être prononcées à son égard. Ces mesures, en plus de soigner l’individu, ont pour objet d’évaluer sa dangerosité et d’empêcher la récidive.
Je crains qu’en l’état cette proposition de loi ne puisse améliorer la situation, et l’amendement retenu à l’article 1er pour supprimer le qualificatif « fautif » n’est pas de nature à améliorer son équilibre. Au contraire, ce texte risque d’introduire un déséquilibre.
Aujourd’hui, notre système judiciaire fonctionne. Certains juges, s’appuyant sur des expertises, ont déjà retenu la responsabilité de personnes, qui, du fait de l’ingestion d’alcool ou de stupéfiants, plaidaient l’irresponsabilité. C’est pourquoi, soucieux de préserver l’équilibre de l’article 122-1 du code pénal, de renouveler notre confiance dans la capacité des juges à évaluer l’abolition du discernement des mis en cause en s’appuyant sur les expertises psychiatriques, et prudent quant à la possibilité pratique de se prononcer sur un fait fautif exclusif ayant mené à l’abolition du discernement, notre groupe ne votera pas ce texte.

Nous constatons malheureusement qu’aucune des trois propositions concrètes que nous avons faites en vue d’améliorer les choses, de créer des dispositifs utiles, n’a été retenue.
Nous constatons, par ailleurs, que nos arguments pour dire que le recours à la juridiction de fond était une mesure fallacieuse qui risquait d’avoir des conséquences indésirables n’ont pas été pris en compte.
Même si notre assemblée a retenu un amendement, défendu par Mme de La Gontrie, pour préciser les choses dans le cas où l’hypothèse, que nous rejetions, serait validée, à savoir une bipartition entre, premièrement, l’examen de l’irresponsabilité éventuelle, et, deuxièmement, l’examen au fond par la juridiction du fond, nous trouvons que le bilan est assez faible au regard du travail que nous avons produit.
Nous nous abstiendrons sur ce texte. Pourquoi ?
Par ce vote, nous voulons montrer que, pour nous, le statu quo est impossible. Nous sommes tous d’accord, il faut garder l’article 122-1 du code pénal, mais, j’y insiste, le statu quo n’est pas une option. Il faut donc continuer le travail, car le résultat, aujourd’hui, ne nous satisfait pas. C’est dans cet esprit que nous ne voulons pas voter contre, même si nous sommes assez déçus du sort réservé à nos amendements.
Mes chers collègues, je vous l’annonce, il sera nécessairement de nouveau question de nos propositions dans nos prochains débats sur le sujet de l’irresponsabilité.

Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi relative aux causes de l’irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l’expertise en matière pénale.
La proposition de loi est adoptée.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 26 mai 2021 :
À quinze heures :
Questions d’actualités au Gouvernement.
De seize heures trente à vingt heures trente :
Proposition de loi d’urgence visant à apporter une réponse solidaire et juste face à la crise, présentée par Mmes Raymonde Poncet Monge, Sophie Taillé-Polian et plusieurs de leurs collègues (texte n° 531, 2020-2021) ;
Proposition de loi pour un élevage éthique, juste socialement et soucieux du bien-être animal, présentée par Mme Esther Benbassa et plusieurs de ses collègues (texte n° 530 rectifié, 2020-2021).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt heures quarante.
Le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants a présenté une candidature pour la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai prévu par l ’ article 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : M. François Patriat est proclamé membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, en remplacement de M. Ludovic Haye.
Le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants a présenté une candidature pour la commission de la culture, de l ’ éducation et de la communication.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai prévu par l ’ article 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : M. Mikaele Kulimoetoke est proclamé membre de la commission de la culture, de l ’ éducation et de la communication, en remplacement de M. François Patriat.
Le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants a présenté une candidature pour la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d ’ administration générale.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai prévu par l ’ article 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : M. Ludovic Haye est proclamé membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d ’ administration générale, en remplacement de M. Mikaele Kulimoetoke.