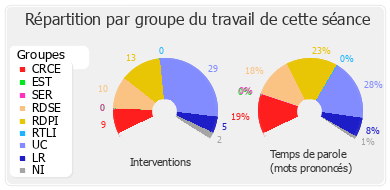Séance en hémicycle du 11 février 2009 à 15h00
Sommaire
- Souhaits de bienvenue à une délégation polonaise
- Candidatures à une commission mixte paritaire (voir le dossier)
- Rappels au règlement (voir le dossier)
- Exécution des décisions de justice (voir le dossier)
- Nomination de membres d'une commission mixte paritaire (voir le dossier)
- Suppression des conditions de nationalité pour certaines professions (voir le dossier)
La séance
La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures cinq, sous la présidence de M. Roland du Luart.

La séance est reprise.

M. le président. Mes chers collègues, j’ai le plaisir et l’honneur de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d’une délégation polonaise comprenant, notamment, le vice-ministre de l’économie, le vice-maréchal du Sénat et le président du groupe d’amitié Pologne-France du Sénat de Pologne.
Mme le garde des sceaux, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.

Cette délégation est reçue au Sénat à l’invitation du groupe d’amitié sénatorial France-Pologne, présidé par notre collègue Yann Gaillard, en association avec le groupe de travail sur le « paquet énergie », présidé par notre collègue Ladislas Poniatowski.
Cette visite a, en effet, pour objet l’étude du système nucléaire civil français, le gouvernement polonais ayant annoncé récemment son intention de construire une ou deux centrales nucléaires.
Je formule le vœu que cette visite contribue, s’il en était besoin, aux relations anciennes d’amitié qui lient nos deux pays, engagés dans un destin commun au sein de l’Union européenne.
Applaudissements

J’informe le Sénat que la commission des affaires économiques m’a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

Monsieur le président, notre collègue Bernard Frimat a fait hier soir un rappel au règlement dans lequel il demandait que soit pris l’engagement de n’afficher la liste des candidats à cette commission mixte paritaire qu’après la conférence des présidents qui doit se tenir ce soir.
Ce matin, n’ayant pas lu le compte rendu analytique de cette nuit, j’ai accepté, lors de la réunion de la commission des affaires économiques, la composition qui est affichée, mais il est clair que cette acceptation est assortie d’une condition : que la répartition des sièges au sein de la commission mixte paritaire intervienne pour la dernière fois selon cette procédure.
En effet, notre groupe demande l’application de la stricte représentation proportionnelle, ce qui conduirait à désigner quatre représentants de la majorité et trois de l’opposition : en claire, c’est essentiellement l’octroi d’un siège au groupe CRC-SPG qui est en jeu. Je n’ai donné mon accord que sous la réserve expresse que cet engagement soit pris pour le futur.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Mon cher collègue, je vous donne acte de votre rappel au règlement qui reprend une observation émise, lors de la dernière réunion de la conférence des présidents, par M. Jean-Pierre Bel, président du groupe socialiste, et approuvée par Mme Catherine Tasca.
Comme vous le savez, la composition politique de la commission mixte paritaire repose sur un équilibre réservant cinq sièges à la majorité et deux à l’opposition, répartition qui date de 1981 et n’a jamais varié malgré l’évolution du rapport des forces politiques au sein du Sénat.
Comme M. le président du Sénat me l’a confirmé, un contact a été pris avec le président de l’Assemblée nationale pour engager une réflexion sur cette question.
Il nous faut attendre le résultat de la concertation avec le président de l’Assemblée nationale, étant entendu que les présidents des groupes et les présidents des commissions devront être associés à la recherche d’une solution qui tienne compte des effectifs des groupes dans les deux assemblées.
La réunion de la conférence des présidents qui aura lieu ce soir, à dix-huit heures, sera, si votre groupe le souhaite, l’occasion de revenir sur cette question pour l’approfondir.

Si vous me le permettez, monsieur le président, je souhaiterais ajouter deux remarques.
Premièrement, je ne vois pas en quoi la réflexion de l’Assemblée nationale, dont la composition politique est différente de celle du Sénat devrait intervenir dans la décision que celui-ci prendra sur la composition de ses propres délégations aux commissions mixtes paritaires.
Deuxièmement, je sais que ce point doit être effectivement à l’ordre du jour de la conférence des présidents ; nous y tenons fermement. Nous considérons que le non-respect des engagements pris constituerait un casus belli dans le cadre de la révision en cours de notre règlement.

Mon cher collègue, vous le savez, je suis un homme de paix !
Je voulais simplement vous rappeler qu’une négociation a été menée en 1981 entre les présidents des deux assemblées. Comme la commission mixte paritaire est un organe délibérant réunissant les deux assemblées, il est nécessaire qu’une discussion intervienne entre les deux présidents. Au demeurant, M. le président du Sénat sera tout à fait prêt, si M. Jean-Pierre Bel ou Mme Catherine Tasca le lui demandent, de répondre dans le détail à leurs questions.
La parole est à Mme Odette Terrade pour un rappel au règlement.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, mon rappel au règlement concerne l’organisation de nos travaux.
Membre de la commission des affaires économiques, j’aurais dû, comme l’ensemble des commissaires de cette commission permanente, auditionner dès la semaine dernière le secrétaire d’État chargé de l’outre-mer, M. Jégo, audition reportée à cet après-midi même avant d’être annulée.
Cette absence et la modification de l’emploi du temps qui en résulte sont parfaitement compréhensibles puisque, depuis plusieurs semaines, et sans que cela ait provoqué pour l’heure de réaction du Président de la République, pourtant si prompt à donner son avis sur toute question touchant notre pays, la population guadeloupéenne, avec ses organisations syndicales, ses élus et toutes ses forces vives, manifeste de façon déterminée son refus d’une situation sociale et économique devenue insupportable, qu’elle dénonce sous le mode d’ordre « Liyannaj kont pwofitasyon », qui signifie, en bon français, « ensemble contre l’exploitation outrancière ».
Que, face à cette situation, M. Jégo ait cru de son devoir de s’éclipser, dimanche soir, pour venir rendre compte à Paris de l’état de la situation, laissant en plan ses interlocuteurs locaux, et qu’il soit revenu ensuite, cette nuit, porteur de l’indifférence gouvernementale, ne change que peu de choses à l’affaire !
De notre point de vue, la prise en compte des fortes aspirations de cette population relève de la responsabilité gouvernementale, car le mouvement gagne aujourd’hui, pour des motifs identiques, la Martinique et la Guyane. Nous souhaitons donc que la situation soit envisagée autrement qu’en renvoyant dos à dos les partenaires sociaux.
Il est également évident que la représentation nationale sortirait grandie si s’engageait au plus tôt un véritable débat conduisant à des changements profonds des politiques suivies, politiques que nous n’osons qualifier de publiques en raison des limites d’ores et déjà dépassées de la défiscalisation à outrance, qui ne profite manifestement pas aux économies ni aux sociétés locales !
La France, par ses choix gouvernementaux, par l’intervention du Parlement, gagnerait à traiter, enfin, de manière juste et équitable les départements et collectivités d’outre-mer, en valorisant leurs atouts et en leur permettant de résoudre les difficultés qu’ils rencontrent.
Notre groupe est solidaire du puissant mouvement social en cours dans la Caraïbe, qui mérite bien autre chose que le coupable silence observé jusqu’à ce jour par le Gouvernement.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.
(Ordre du jour réservé)

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion des conclusions de la commission des lois sur la proposition de loi, présentée par M. Laurent Béteille, relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées (nos 31, 161).
Je rappelle que la discussion générale a été close lors de la dernière séance mensuelle réservée, le mercredi 20 janvier 2009.
Nous passons à la discussion des articles.

L'amendement n° 1, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Avant le chapitre 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase de l'article 88 du code de procédure pénale, après les mots : « par ordonnance, », sont insérés les mots : « dans un délai de 30 jours, ».
II. - Après la première phrase de l'article 88 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le non-respect de ce délai entraînera la caducité de la plainte. ».
La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Madame la ministre, j’ai bien conscience que cet amendement est légèrement décalé par rapport au texte qui nous est proposé, mais je voulais quand même profiter de ce débat sur l’exécution des décisions de justice pour attirer votre attention sur le problème des dépôts de plaintes, qui fait l’objet de mon amendement.
Actuellement, aucun délai contraignant n’est fixé au doyen des juges d’instruction pour rendre une ordonnance de consignation.
Prenons l’exemple d’une plainte déposée en avril 2007 ; l’ordonnance de consignation a été rendue le 1er juillet, une consignation a été payée le 1er août et un juge d’instruction désigné le 1er octobre. Cela fait beaucoup de temps, madame la ministre, pour instruire un dossier, d’autant que notre société a souvent l’habitude de médiatiser terriblement les choses.
Donc, je pense qu’il n’est ni de l’intérêt de la victime ni de l’intérêt d’un coupable ou d’un prévenu éventuel qu’aucun délai ne soit assigné au doyen des juges d’instruction pour rendre l’ordonnance de consignation, qui va permettre d’engager réellement la procédure.
C'est pourquoi mon amendement - que j’avais déjà déposé, puis retiré - prévoit que le doyen des juges d’instruction disposera d’un délai de trente jours pour fixer la consignation. À défaut de respect de ce délai, la plainte sera considérée comme caduque.

La question soulevée par Mme Goulet me paraît tout à fait importante. En effet, fixer un délai pour le versement de la consignation dans le cadre d’une constitution de partie civile est une disposition intéressante.
D’une part, cela protégerait les personnes qui sont éventuellement visées par la plainte, car il est souvent aisé d’en deviner l’identité, même quand la plainte est déposée contre X. D’autre part, cela renforcerait aussi les droits de la partie civile, car il n’y a rien de pire pour une partie civile que d’attendre éternellement que le juge veuille bien rendre l’ordonnance de consignation, qui va permettre d’engager l’examen du dossier.
Ce sujet mérite d’être étudié avec beaucoup d’attention. Néanmoins, il n’a pas échappé à Mme Goulet que cette proposition de loi ne traitait que du droit civil et de la procédure civile. Son amendement n’a donc pas place aujourd'hui dans nos débats.
Je me permets de vous suggérer, madame Goulet, de présenter de nouveau cet amendement lors de l’examen de la proposition de loi visant à simplifier le droit, qui devrait nous être transmise par l’Assemblée nationale au mois de mars. Donc, au nom de la commission, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.
Madame le sénateur, le Gouvernement n’est évidemment pas favorable à votre amendement, non pas sur le fond, mais sur la forme, dans la mesure où il n’a aucun lien avec le texte dont nous débattons cet après-midi. Je fais donc miens les arguments qui ont été développés par M. le rapporteur. J’ajoute que, depuis vingt ans, le code de procédure pénale a souvent fait l’objet d’ajustements sans que soit totalement remise à plat la procédure pénale. Dès lors, la réforme à venir du code pénal et du code de procédure pénale constitue une chance qu’il ne faut absolument pas manquer.
La commission présidée par l’avocat général Philippe Léger rendra un pré-rapport sur la réforme de l’instruction à la fin de février et le rapport définitif sur la réforme du code pénal et du code de procédure pénale au début de juin. Cela nous permettra de débattre de tous les sujets relatifs à la procédure pénale de manière à avoir une procédure pénale moderne, adaptée, équilibrée, proportionnée et respectueuse des droits de la victime mais aussi des droits de la défense.
Par conséquent, au-delà même du fait que cet amendement est sans lien avec le texte dont nous débattons cet après-midi, son adoption nous priverait d’un débat de fond au sein de la réforme du code de procédure pénale.
Je vous demande donc de bien vouloir le retirer.

Avant de le retirer, je souligne qu’il existe quand même un lien ténu entre les procédures d’exécution forcée des poursuites en diffamation et le débat qui nous occupe.
Cela étant, je retire cet amendement.
Après l'article L. 141-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5. - Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »

L'amendement n° 24 rectifié ter, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. Rédiger comme suit cet article :
Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de l'alinéa suivant, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
« Un décret en Conseil d'État fixe les cas et conditions dans lesquels les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement sont mis partiellement à la charge des créanciers. Dans ces cas, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du débiteur, mettre à sa charge tout ou partie de ces droits proportionnels lors du prononcé de la condamnation. »
II. En conséquence, dans l'intitulé du chapitre Ier, supprimer les mots :
en droit de la consommation
La parole est à M. Jacques Mézard.

Il s’agit, dans le cadre de l’exécution des décisions de justice, de savoir s’il est normal que celui qui gagne un procès soit de fait condamné à en assumer en partie la charge.
Les dispositions prévues à l’article 1er de la proposition de loi vont dans le bon sens. Elles visent le droit de la consommation et prévoient de mettre à la charge du débiteur, dans certains cas, les droits de recouvrement que peuvent percevoir les huissiers. Mais nous souhaitons que cette disposition soit étendue à l’ensemble des litiges.
Il ne s’agit aucunement de remettre en cause ou de réduire le montant des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement des huissiers. Notre amendement a simplement pour objet de donner au magistrat qui rend la décision de justice la possibilité de mettre, totalement ou partiellement, ces frais à la charge du débiteur
Aujourd'hui, il faut le savoir, tout créancier qui est obligé de passer par la phase de recouvrement forcée - dans la mesure d’ailleurs où le créancier récupère quelque chose sur le débiteur - a à sa charge la quasi-totalité du droit de recouvrement.
Il n’est pas juste, me semble-t-il, que ces frais soient exclusivement à la charge du créancier dans tous les cas, la partie perdante pouvant, par exemple, être un débiteur très solvable ; je pense à des établissements de crédit, des banques, à certaines sociétés commerciales, notamment de téléphonie. Il arrive fréquemment que des créanciers aient des moyens financiers équivalents ou inférieurs à ceux de leurs débiteurs.
Les dispositions légales en vigueur imposent aux juridictions de statuer sur les dépens. Ces juridictions ont aussi la capacité d’apprécier l’application ou la non-application de l’article 700 du code de procédure civile ou même de l’article 475-1 du code de procédure pénale, relatif aux frais et honoraires non inclus dans les dépens. Je ne puis penser que les huissiers manifestent une quelconque défiance à l’égard des magistrats, lesquels, avec sagesse, ont la capacité de mesurer quels sont les créanciers ou les débiteurs qui devront assumer la charge de ces droits de recouvrement.
En résumé, il s’agit non pas de diminuer le montant de ces droits de recouvrement, mais de permettre, dans tous les litiges, qu’il y ait une appréciation du magistrat. Je rappelle d'ailleurs que, à l’origine, le décret du 8 mars 2001 a modifié le décret du 12 décembre 1996 qui avait fait l’objet d’une annulation par le Conseil d’État, à la demande de certains avocats.
Nous sommes donc aujourd'hui dans une situation qui n’est pas conforme à l’intention initiale du législateur, ce qui est d’ailleurs rappelé très précisément dans le rapport de notre excellent collègue François Zocchetto, à la page 23.
Par ailleurs, à la page 24 dudit rapport, sont rappelés les efforts du président Hyest, qui avait posé le 1er mars 2007 une question écrite, ayant, me semble-t-il, le même objet que l’amendement que j’ai eu l’honneur de déposer.

Le sous-amendement n° 32, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'amendement n° 24 rectifié ter.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.

La discussion générale ayant eu lieu le 20 janvier dernier, nous sommes donc un peu dans du « réchauffé », ce qui ne facilite pas l’examen du texte, mais nous essayons d’y voir clair.
Mon sous-amendement vise à revenir à la rédaction initiale, c'est-à-dire à limiter la portée de l’article 1er aux droits de la consommation.
En effet, il semble tout à fait hasardeux de déséquilibrer le texte tel qu’il est actuellement proposé, puisque, en fait, la stabilité économique des études d’huissiers de justice repose en grande partie sur 50 % des produits globaux et sur le droit proportionnel. Or l’amendement n°24 rectifié ter ne fait aucune distinction entre les deux.
En l'occurrence, il ne s’agit nullement de marquer une quelconque défiance à l’égard des magistrats ; il s’agit simplement de laisser payer aux créanciers la part proportionnelle qui revient aux huissiers pour service rendu et non pas d’imputer au débiteur des charges qui rendraient l’exécution de l’obligation encore plus difficile.
Je pense que l’équilibre posé dans le texte est justifié uniquement dans le cadre du droit de la consommation.
Enfin, je souligne que je n’ai pas du tout fait la même lecture que M. Mézard de la question qui avait été posée le 1er mars 2007 par le président Hyest à vous-même, madame le garde des sceaux, mais puisque ce dernier est présent, il ne m’appartient pas de parler à sa place.

La proposition de loi offre la possibilité nouvelle au juge, dans le cadre du code de la consommation, de mettre à la charge du débiteur, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de celui-ci, tout ou partie des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.
Cette mesure ne me semble pas soulever de discussion ; en tout cas, elle n’en a pas créé au sein de la commission.
M. Mézard a proposé d’aller plus loin en étendant cette possibilité à l’ensemble des contentieux civils. La commission, après s’être interrogée, a trouvé l’idée intéressante et, lors d’une deuxième réunion, a conclu que cet amendement, que pour ma part je voterai, était recevable.
Pour l’information complète de nos collègues, je me dois de dire que cet amendement, qui a donc été voté par la commission des lois, a suscité néanmoins un certain nombre de réactions, plusieurs d’entre nous s’étant interrogés sur les conséquences d’une telle disposition.
Il est certain qu’elle repose sur la foi absolue que nous avons dans le juge. Celui-ci est a priori bien placé pour déceler les situations de fortune des uns et des autres, du créancier ou du débiteur.
Chacun aura compris en outre qu’il serait totalement anormal qu’un créancier en situation difficile se voie imposer des frais de recouvrement face à un débiteur en situation aisée. Cela paraît effectivement, en première analyse, inéquitable. Mais, d’un autre côté, certains pensent que, dans la pratique, le dispositif prévu dans l’amendement pourrait aboutir à surcharger des débiteurs déjà en situation difficile.
Quant au sous-amendement n° 32 proposé par Mme Goulet, il m’a semblé quelque peu surprenant. En effet, il donne encore moins de souplesse que le texte actuel. Donc, il rigidifie le dispositif.
À titre personnel, j’émets donc, un avis défavorable sur ce sous-amendement, qui n’a pas été examiné par la commission.
Avec le sous-amendement n° 32, nous en reviendrions à la situation actuelle : le créancier doit avancer la totalité des frais pour récupérer sa créance. La proposition de loi réalise une avancée en donnant aux magistrats la possibilité de mettre à la charge du débiteur tout ou partie des frais de l’exécution forcée de la décision de justice, après appréciation de la solvabilité dudit débiteur, tout en circonscrivant le champ d’application de la mesure à la consommation.
L’amendement n° 24 rectifié ter vise à élargir cette possibilité à tous les contentieux civils. Sur le plan de l’équité, on peut comprendre que la charge ne repose pas uniquement sur le créancier. M. Mézard a fait observer tout à l’heure que le magistrat disposait d’assez d’éléments pour apprécier la solvabilité du débiteur. C’est en effet le cas en matière de consommation, mais pas forcément dans tous les domaines.
Le Gouvernement ne souhaite pas aller au-delà de la proposition de loi qui lui semble équilibrée. Il n’est en effet pas utile d’aggraver la dette des débiteurs, alors qu’ils sont déjà particulièrement touchés par le contexte de crise actuel.
Le Gouvernement est donc défavorable au sous-amendement n° 32 et à l'amendement n° 24 rectifié ter.

Je m’exprime ici à titre personnel. En effet, siégeant au groupe de travail sur la réforme du règlement, je n’ai pas pu assister à la réunion de la commission des lois – cela m’arrive très rarement ! – au cours de laquelle cet amendement a été discuté et approuvé.
Je m’étais toutefois penché sur la question antérieurement. J’en étais arrivé à penser que, dans les litiges de consommation, où des sociétés importantes peuvent être condamnées, il était tout à fait légitime de mettre les frais à la charge des débiteurs, d’autant que les créanciers ne recouvrent jamais l’argent – souvent des petites sommes – qui leur est dû.
On peut prendre l’exemple des litiges impliquant des opérateurs de téléphonie. Comme il n’y a jamais d’exécution des décisions de justice, certains en sont venus à se demander s’il n’était pas préférable de passer par une action de groupe !
La solution retenue me paraît donc satisfaisante. Pour autant, faut-il la systématiser ? En tant qu’ancien président d’un office d’HLM, je pense aux personnes qui ont des dettes de loyer alors qu’elles sont déjà en très grande difficulté. Va-t-on leur dire qu’en plus elles auront à payer les frais ?
Ce dispositif est d’une logique imparable : il fait confiance au juge. Mais ce dernier ne dispose pas toujours des moyens d’apprécier in concreto chaque affaire. Il faudrait pour cela que chaque intéressé ait un défenseur, ce qui n’est pas toujours le cas. Et, comme il s’agit de contentieux de masse, je doute qu’il y ait vraiment un examen de chaque situation particulière.
Je pense, pour ma part, qu’il faudrait approfondir la réflexion sur le sujet. Aujourd'hui, même si la commission l’a adoptée, je ne suis personnellement pas prêt à adopter cette solution. En revanche, j’y suis tout à fait favorable dans le cadre du droit de la consommation. En tout cas, je regrette vraiment de ne pas avoir pu assister au débat qui s’est tenu en commission.

Je ne comprenais pas très bien l’observation de M. le rapporteur jusqu’à ce que je relise la rédaction de mon amendement.
En réalité, il aurait fallu supprimer le II de l’amendement de M. Mézard. Mon souhait était de maintenir la limitation de la disposition au droit de la consommation pour qu’elle ne soit pas étendue à l’ensemble du contentieux civil.
Dans ces conditions, monsieur le président, je retire mon sous-amendement. Le texte me semble cohérent, à condition – je le répète – qu’il soit limité au domaine de la consommation, le reste pouvant éventuellement faire l’objet d’une renégociation tarifaire avec les huissiers, dans le cadre du travail plus global actuellement effectué par la chancellerie.

Le sous-amendement n° 32 est retiré.
La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour explication de vote sur l'amendement n° 24 rectifié ter.

L’amendement proposé par Jacques Mézard a pour objet de permettre à l’ensemble des juridictions civiles de mettre à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais de l’exécution forcée de leur décision.
Le groupe UMP considère que l’adoption d’un tel amendement serait très préjudiciable à la situation du débiteur, condamné à l’instance, qui devra donc supporter, dans leur totalité, les droits proportionnels aujourd’hui partagés entre les parties.
Si l’on peut admettre de mettre les droits de recouvrement à la charge d’un professionnel qui en a les moyens, il ne nous semble pas raisonnable d’étendre cette possibilité à tous les débiteurs.
En effet, si sa situation économique est correcte, un professionnel condamné peut supporter l’intégralité des droits de recouvrement ; il n’en est pas de même des personnes physiques qui ont du mal à payer leurs dettes.
Dans une période de crise économique et financière, la situation des débiteurs mérite une attention spéciale. On ne peut pas transposer aux particuliers l’intégralité des droits de recouvrement sous peine d’obérer leur situation en les plaçant dans l’impossibilité de payer, privant ainsi l’huissier d’une rémunération nécessaire à l’équilibre économique de son étude.
Enfin, il faut préciser que les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement ne sont pas une sanction à la charge de la partie qui a perdu le procès, mais bien un émolument lié au service d’un recouvrement efficace. Le bouleversement de la nature de ces droits serait dangereux pour l’équilibre social des procédures civiles d’exécution.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe UMP n’adoptera pas l’amendement n° 24 rectifié ter.

La proposition de loi limitait la disposition au droit de la consommation. Il s’agissait de faire en sorte que, lorsqu’un litige se conclut en défaveur d’un professionnel – il en a été cité de nombreux exemples tout à l’heure –, le créancier, qui a en général beaucoup moins de moyens, n’ait pas à assumer une partie des frais d’exécution.
Au moment de la rédaction de la proposition de loi, je m’étais d’ailleurs interrogé sur une éventuelle extension de cette disposition aux litiges entre particuliers, pour lesquels il peut y avoir un déséquilibre financier au profit du débiteur.
J’étais au départ plutôt favorable à l'amendement n° 24 rectifié ter. Mais il faut bien se rendre compte qu’il va très loin puisque, en réalité, il renverse le système. Il s’agit d’ailleurs de revenir à une disposition qui existait autrefois puisque l’article 32 de la loi de 1991, cela a été rappelé, tendait à mettre systématiquement à la charge du débiteur les frais de recouvrement. M. Mézard a néanmoins prévu une disposition qui permet au juge de faire obstacle à l’application de cette disposition générale.
Pour ma part, je proposais de conserver le système actuel, dans lequel les émoluments de l’huissier sont partagés entre le créancier et le débiteur, tout en permettant au juge, s’il n’était pas d’accord avec cette règle générale, de mettre la totalité des droits professionnels à la charge du débiteur.
L'amendement n° 24 rectifié ter propose donc, je le répète, un dispositif inverse du mien : si le juge ne prend pas de décision particulière, les frais seront systématiquement à la charge du débiteur. Il me semble que, dans les circonstances actuelles, cela pose un problème. Il ne serait pas raisonnable de voter cette disposition, même si elle reprend une solution traditionnelle.
En outre, il ne faut pas comparer le paiement de ces frais avec le paiement dû à un avocat. Lorsqu’on paye des émoluments à un avocat pour faire reconnaître ses droits, par définition, la créance n’est pas encore établie. Elle ne le sera qu’une fois le jugement rendu. Mais, une fois que la créance est reconnue, il n’est pas illogique de penser que le créancier peut toucher la totalité de la somme que le débiteur a été condamné à payer par le tribunal sans avoir à assumer de frais supplémentaires. Au demeurant, il faut tenir compte de la situation de certains débiteurs.
Dans ces conditions, il me semble plus raisonnable de ne pas adopter l’amendement de M. Mézard.

Il faut être clair : si un débiteur ne paye pas, ce n’est tout de même pas au créancier d’en supporter les conséquences ! Si l’on interrogeait n’importe quelle personne de bon sens, qu’elle soit de droite ou de gauche – ce n’est pas le problème ! –, pour savoir qui doit payer les frais d’huissier en cas de non-paiement d’une créance réelle incontestée, elle estimerait normal que ces frais soient supportés par celui qui est à l’origine de la faute, c'est-à-dire du non-paiement. Je suis bien de cet avis sauf, bien évidemment, cas particulier déterminé par le juge

Soyons clairs : il s’agit ici non pas de protéger les débiteurs, mais bien les huissiers ! Il est en effet plus facile de faire payer les créanciers qui ont une rentrée d’argent que les débiteurs. J’entends bien cet argument et je sais le rôle que jouent les huissiers et la difficulté de leur métier.
Mes chers collègues, on a évoqué l’équilibre qui caractérisait les dispositions du décret du 8 mars 2001. Je vous rappelle tout de même que celui-ci fixe les droits à la charge du débiteur à 0, 3 % au-delà de 1 525 euros et ceux à la charge du créancier à 4 %, soit quinze fois plus ! C’est un bien curieux équilibre !
On me dit que le juge n’a pas les moyens d’estimer la solvabilité du débiteur. Allons donc ! Après plus de trente-sept années d’expérience des tribunaux d’instance, je peux vous affirmer que le juge, particulièrement pour les petits litiges qui sont directement concernés par cette mesure, sait à quoi s’en tenir, il sait si le débiteur bénéficie ou non de l’aide juridictionnelle, il connaît les éléments du dossier, il a écouté les parties.
Madame le garde des sceaux, comment fait le juge lorsqu’il prend des décisions, par exemple au titre de l’article 700 du code de procédure civile ? Quelle est la différence entre les deux situations ? Il n’y en a aucune ! Cet argument ne saurait donc me convaincre.
Il faut le dire, cette disposition est passée en force à une certaine époque parce que les huissiers l’ont demandée, et je les comprends parfaitement. Il a d’ailleurs dû se passer la même chose depuis notre débat du 20 janvier dernier. Je ne doute pas que, si les articles avaient été examinés dans la foulée de la discussion générale, nous n’aurions pas entendu certaines interventions cet après-midi…
Cela dit, je ne voudrais pas passer pour celui qui veut écraser davantage les débiteurs parce que, si certains d’entre eux sont dans une situation économique tout à fait favorable, d’autres ne le sont pas et il ne s’agit aucunement d’aggraver leur sort. De toute façon, ceux qui n’en ont pas les moyens ne feront pas l’objet d’un recouvrement.

Je mets aux voix l'amendement n° 24 rectifié ter.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 113 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'article 1er.
L'article 1 er est adopté.
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire. »

Cet article vise à renforcer la portée des constats d’huissier. Cette disposition s’inscrit dans l’objectif de simplification de la vie juridique et administrative. Je reste cependant perplexe quant à sa portée en matière pénale.
En effet, nous connaissons tous des gens susceptibles d’être impressionnés par la visite d’un huissier à leur domicile. Une personne qui vit sa petite vie de tous les jours peut être, sinon traumatisée, du moins désarçonnée par cette situation. En matière pénale, il ne serait donc pas opportun d’empêcher toute observation a posteriori, car l’intéressé peut très bien avoir perdu tous ses moyens sur le moment.
Pour ma part, je suis favorable à cet article, mais avec cette réserve.

L'amendement n° 25 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Mézard.

Je puis vous assurer que je n’ai aucun compte à régler avec les huissiers, qui ne m’ont jamais saisi.
Sourires
Nouveaux sourires.

L’amendement que je présente est plutôt protecteur. En vertu de l’article 2, l’huissier de justice, qui peut être commis par voie de justice ou simplement à la requête d’un particulier, procède à des constatations qui font foi jusqu’à preuve contraire, sauf en matière pénale.
Je pense que cette mesure ne changera rien à leur rémunération. La question est juste de savoir si les constats dressés, y compris à la demande des particuliers, peuvent faire foi jusqu’à preuve contraire.
Lorsqu’un huissier agit à la demande d’un magistrat, cela me paraît tout à fait normal. En revanche, lorsque c’est à la requête d’un simple particulier, il existe un risque de déséquilibre entre les parties. En effet, tout le monde n’a pas les mêmes compétences en matière juridique et certains ne font pas appel à un avocat pour être conseillés. Si le particulier en question est une compagnie d’assurance ou un établissement financier, le simple consommateur qui est en face peut se retrouver en situation de faiblesse.
Nous le savons pertinemment, le procès-verbal de constat a pour objectif de fortifier une future action en justice. Nous parlions tout à l’heure de la protection du débiteur, qui avait bon dos. En l’occurrence, je parle de la protection du citoyen ordinaire, qui risque d’avoir les plus grandes difficultés à apporter la preuve contraire face à un adversaire qui n’a pas forcément raison, mais qui aura été plus avisé ou mieux conseillé.
En outre, un certain nombre de nos territoires ne comptent qu’une étude d’huissier. Je l’ai souvent constaté au cours de ma carrière, deux huissiers appartenant à la même étude peuvent dresser un procès-verbal de constat pour deux parties adverses. Comprenons-nous bien, il ne s’agit nullement de remettre en cause le sérieux et la bonne foi des huissiers. Je veux juste souligner que deux procès-verbaux de constat émanant de la même étude peuvent être présentés lors de l’instance.
On m’a rétorqué en commission que, dans ce cas de figure, le juge arbitrerait. Il est donc des cas où l’on est prêt à ce que juge soit en situation d’apprécier … En tout cas, en termes de responsabilité, cela placera plutôt les huissiers dans une situation difficile, et je ne pense pas, bien au contraire, que cela multipliera le nombre de procès-verbaux de constat.

L’article 2 de la proposition de loi a retenu toute l’attention de la commission.
Nous nous sommes émus de la situation de la personne qui voit débarquer chez elle un huissier. La plupart du temps, elle ne bénéficie pas de l’assistance d’un conseil et se retrouve donc en situation de faiblesse. L’huissier peut en effet avoir une capacité de persuasion, qui peut entraîner un certain déséquilibre entre les parties en présence.
C’est la raison pour laquelle la commission a décidé – M. Béteille n’y a pas émis d’objection majeure – de supprimer la dernière phrase de cet article, qui ne permettait pas à la partie en présence de laquelle avait été dressé le constat de faire valoir ses observations si elle y avait renoncé au moment de l’établissement de l’acte.
Mon cher collègue Mézard, vous proposez de supprimer tout l’article. Pourtant, il paraît logique qu’un constat dressé par un officier public et ministériel jouisse d’une plus grande force probante qu’un document établi par quelqu’un qui n’aurait pas de qualité au regard de la loi. D’ailleurs, les magistrats que nous avons auditionnés nous ont tous dit que, dans la pratique, ils accordaient systématiquement crédit aux constats dressés par les huissiers et qu’il était superflu pour eux de motiver leur décision.
Par ailleurs, je rappelle qu’il serait tout à fait possible à la partie qui veut mettre en cause le constat d’apporter la preuve contraire.

Enfin, il est évident que ces dispositions ne s’appliquent pas en matière pénale, monsieur Masson. Cela figure d’ailleurs noir sur blanc dans l’article ! Dans ce domaine, les constats d’huissiers n’ont valeur que de simples renseignements.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Comme vient de le rappeler M. le rapporteur, les constats d’huissiers en matière pénale n’ont valeur que de simples renseignements. En fait, ce document a exactement la même force qu’une déclaration sur l’honneur faite par un particulier.
Reste que les huissiers sont des officiers publics ministériels. Il est donc important de souligner la portée des actes qu’ils remettent aux magistrats, d’autant que l’on reconnaît ainsi dans le droit ce qui existe déjà dans les faits.
Cela étant, même si les constats d’huissiers ont force probante, rien n’empêche d’apporter la preuve contraire.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Cet amendement est très important, car il y a un grand saut qualitatif entre les constats qui sont effectués actuellement avec sérieux, sous l’appréciation des magistrats, et des constats effectués à la demande de particuliers ayant force probante jusqu’à preuve contraire.
On voit ce que cela pourra donner lors des constats d’adultère. Chacun connaît la procédure. D’abord, l’huissier débarque au petit matin, réveille tout le monde et fait des constatations : il y a deux brosses à dents dans la salle de bains, le matelas est incurvé, etc.
Ensuite, il demande aux parties présentes ce qu’elles en pensent. Bien entendu, elles n’en pensent rien. Ce constat fait donc foi jusqu’à preuve contraire. Où est la preuve contraire ?
Rires.

Qui peut l’apporter ? Il faut donc à tout prix supprimer cette disposition.
Mes chers collègues, permettez-moi d’ajouter que l’amendement n° 24 rectifié ter de M. Mézard, qui était très technique, et le sous-amendement n° 32 de Mme Goulet ont donné lieu à un débat qui a duré plus d’une demi-heure. Comment la conférence des présidents qui aurait eu à fixer un crédit-temps sur ce texte aurait-elle pu imaginer que nous passerions autant de temps sur ce sujet ? Voilà un bel exemple à retenir pour nos travaux à venir sur l’organisation de nos travaux !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Mme Nathalie Goulet. Ce qui donne la force probante au constat d’huissier, au-delà de la qualité d’officier public et ministériel de ce dernier, qui n’est absolument pas en cause – je n’ai rien contre cette profession bien que moi j’aie été saisie, mais je ne suis pas rancunière
Sourires

C’est comme si un employeur rétribuait un médecin pour contester un arrêt de maladie, madame le garde des sceaux. Seul un médecin neutre peut réaliser un contrôle.
Il ne s’agit nullement de faire montre de suspicion à l’égard de la profession d’huissiers, mais de garantir l’aspect contradictoire de la procédure. C'est la raison pour laquelle je voterai pour l’amendement de suppression de M. Mézard.
L'amendement est adopté.

En conséquence, l'article 2 est supprimé.
CHAPITRE III
SIGNIFICATION DES ACTES ET PROCÉDURES D'EXÉCUTION
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Accès des huissiers de justice aux dispositifs d'appel et aux boîtes aux lettres particulières
« Art. L. 111-6-4. - Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, prend les dispositions nécessaires afin de permettre aux huissiers de justice, pour l'accomplissement de leurs missions de signification, d'accéder aux dispositifs d'appel et aux boîtes aux lettres particulières des immeubles collectifs, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » –
Adopté.
I. - L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :
« Art. 39. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'État, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les régions, les départements et les communes, les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
« Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans que ces établissements puissent opposer le secret professionnel. »
II. - L'article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire et l'article 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée sont abrogés.
III. - Le troisième alinéa de l'article 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est supprimé.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 2 est présenté par M. Sutour et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 28 est présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Simon Sutour, pour présenter l’amendement n° 2.

Les articles 39 à 41 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution permettent à l’huissier de justice porteur d’un titre exécutoire et d’un relevé sincère des recherches infructueuses qu’il a tentées pour l’exécution de solliciter le procureur de la République afin que celui-ci interroge les administrations et les organes publics. Les communications portent sur l’adresse du débiteur, celle de son employeur et les organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
Cette solution avait paru logique à nos collègues en 1991. En effet, aux termes de l’article 11 de la loi précitée, il est énoncé que « le procureur de la République veille à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ».
La proposition de loi qui nous est soumise vise à permettre à l’huissier porteur d’un titre exécutoire de s’adresser directement aux tiers susceptibles de lui communiquer l’adresse et l’employeur du débiteur, sans avoir à requérir l’assistance du procureur de la République.
Le présent amendement tend à supprimer cet article, afin de maintenir le filtre du procureur de la République. En effet, nous craignons que l’accès direct des huissiers aux informations soit une source d’abus. Les administrations et organes publics, parfois mal informés, pourraient communiquer des informations plus larges, portant atteinte au secret bancaire par exemple.
Le filtre du parquet reste plus protecteur.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement n° 28.

Je vous avais déjà fait part, au cours de la discussion générale, de notre désaccord sur l’article 4 visant à permettre l’accès direct des huissiers aux informations nécessaires à l’exécution d’un titre exécutoire auprès des administrations et des organismes publics.
Le filtre actuel du procureur permet d’assurer le principe de protection de la vie privée, puisque le parquet contrôle les renseignements transmis par le détenteur de l’information. Le rapporteur considère que cette disposition est d’un intérêt limité, mais il s’agit tout de même d’une protection des données personnelles.
Actuellement, à titre d’exception, les huissiers peuvent avoir un accès direct à ces données personnelles dans le cadre du recouvrement des pensions alimentaires, le principe étant la protection des données. L’article 4 prévoit de généraliser cette exception en supprimant le filtre du procureur de la République, nous y sommes opposés. Restons-en à l’exception !

Ces deux amendements ont pour objet de maintenir le filtre du procureur de la République pour l’obtention par les huissiers de justice des informations nécessaires à l’exécution d’un titre exécutoire.
Je rappelle que l’un des objectifs de ce texte est d’améliorer l’exécution des décisions de justice, afin de satisfaire à un principe reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat a rappelé que le filtre du procureur de la République n’existait pas en matière de pension alimentaire. Or cela n’a jamais posé le moindre problème. Dans la pratique, ce filtre est purement théorique et aucun procureur n’étudie les demandes des huissiers, que les greffiers se contentent de viser sans vérification.
Il me paraît légitime de supprimer ce filtre, comme nous y invite notre collègue Béteille dans cette proposition de loi. Je vous rappelle qu’il n’existait que pour l’obtention de l’adresse du débiteur, celle de son employeur et des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, à l’exclusion de tout autre renseignement.
C’est pourquoi la commission est défavorable à ces deux amendements.
L’objet du texte est d’améliorer l’exécution des décisions de justice. Pour que celle-ci soit plus efficace, il convient d’alléger les tâches des magistrats.
Le système qui vous est proposé a déjà prouvé son efficacité pour les pensions alimentaires. Aujourd’hui, dans les autres cas, l’huissier est obligé de passer par le procureur de la République pour obtenir des renseignements. Il s’agit d’une simple « courroie de transmission », puisque, dans les faits, les procureurs font suite aux demandes des huissiers quasi systématiquement.
Le fait que les huissiers puissent avoir accès directement aux données concernées pour faire exécuter une décision améliore l’efficacité de la justice. Je rappelle que l’inexécution des décisions constitue une véritable situation d’impunité. Or il s’agit souvent, pour des créanciers modestes, de récupérer une dette de loyer ou des factures impayées. Une meilleure exécution des décisions de justice permet à chacun d’être restauré dans son droit.
C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à ces deux amendements.

Je partage bien entendu l’avis de M. le rapporteur et de Mme la ministre quant à la nécessité de faire exécuter les décisions de justice, notamment lorsqu’il s’agit de pensions alimentaires impayées. Vous avez cité un bon exemple, mais il ne s’agit pas toujours de récupérer des pensions alimentaires au profit de mères de famille abandonnées par des maris défaillants. Le texte concerne bien d’autres matières.
J’aurais aimé savoir si les associations d’élus, en particulier l’Association des maires de France et l’Association des maires ruraux de France, ont été consultées sur cet article. D’après les débats que nous avons eus avec nos collègues sénateurs maires, notamment en commission, les maires sont totalement hostiles à cette procédure.
Le fait de répondre à une demande du parquet, même si c’est par l’intermédiaire des greffiers, constitue une garantie pour le maire, qui pourra s’en prévaloir. Car, n’en doutons pas, il pourra toujours lui être reproché, et violemment, d’avoir fourni un renseignement. Le fait de répondre à une simple demande des huissiers de justice ne me semble vraiment pas suffisant. C’est en fait un pas supplémentaire vers la privatisation du service public de la justice : j’y suis totalement hostile !

En tant que président d’une association de maires, je voudrais simplement rappeler que le maire agit dans le cadre de l’exécution d’une décision prise par une juridiction.
Dès lors qu’un jugement a été rendu et que l’on fait confiance à la justice, je ne comprends pas vos réserves, et ce d’autant que le système fonctionne très bien dans d’autres domaines.

En effet, le jugement a été rendu : il ne s’agit pas de renseignements demandés a priori !

Je souligne à mon tour qu’il ne s’agit pas de satisfaire au bon plaisir d’un huissier mais d’exécuter des décisions de justice. L’huissier agit en tant qu’officier public et ministériel pour faire exécuter une décision qui a la force exécutoire d’un jugement rendu au nom du peuple français.
Il ne faut donc pas exagérer et déformer la portée de ce texte !
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 4 est adopté.
I. - L'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière est ratifiée.
II. - Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 2202 est complété par les mots : « à l'exclusion de la rescision pour lésion » ;
2° L'article 2213 est complété par les mots : «, à compter de la publication du titre de vente ».
III. - L'alinéa inséré par l'article 12 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 précitée après le deuxième alinéa de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire dans sa version en vigueur lors de la promulgation de ladite ordonnance, l'est également après le deuxième alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et la partie législative du code de procédure pénale. Cette disposition présente un caractère interprétatif.
IV. - L'article 800 du code de procédure civile local est abrogé. –
Adopté.
Après l'article 12 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. » –
Adopté.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGE DE L'EXÉCUTION
Après l'article L. 721-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 721-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 721-7. - Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :
« 1° Les meubles et les immeubles, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
« 2° Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;
« 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;
« 4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. » –
Adopté.
Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article 120, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;
2° Au premier alinéa de l'article 121, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
3° L'article 122 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
c) Au troisième alinéa, les mots « le tribunal dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « la juridiction dans le ressort de laquelle » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 123, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
5° L'article 124 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
b) Dans la seconde phrase, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;
6° L'article 125 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « de grande instance du ressort » ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » et les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
7° Au cinquième alinéa de l'article 127, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article 128, les mots : « dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera » sont remplacés par les mots : « attraire devant le juge de l'exécution » ;
9° Au deuxième et au troisième alinéas de l'article 130, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;
10° L'article 131 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;
b) Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du juge de l'exécution, le greffier ». –
Adopté.
Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Les articles L. 213-5 et L. 213-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 213-5. - Les fonctions de juge de l'exécution du tribunal de grande instance sont exercées par le président du tribunal de grande instance.
« Art. L. 213-6. - A moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance connaît de manière exclusive des mesures d'exécution forcée, des contestations qui s'élèvent à cette occasion et des demandes nées de celles-ci ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que de la distribution qui en découle, portant sur :
« 1° Les immeubles, dans les cas et conditions prévus par le code civil ;
« 2° Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;
« 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;
« 4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
« Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires sur les biens visés aux 1° à 4° et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
« Sous la même réserve, il connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires portant sur ces biens. » ;
2° Après l'article L. 221-3, il est inséré un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-3-1. - Au sein du tribunal d'instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge de l'exécution. » ;
3° L'article L. 221-8 est abrogé ;
4° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Compétence du juge de l'exécution
« Art. L. 221-11. - À moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le juge de l'exécution du tribunal d'instance connaît de manière exclusive des mesures d'exécution forcée, des difficultés relatives aux titres exécutoires, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, concernant les biens et droits autres que ceux visés à l'article L. 213-6.
« Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires portant sur les biens et droits concernés par le premier alinéa et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
« Il connaît, sous les mêmes réserves, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
« Art. L. 221-12. - Le juge de l'exécution du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
« Art. L. 221-13. - Le juge de l'exécution du tribunal d'instance connaît des demandes relatives aux astreintes dans les conditions prévues par les articles 33 et 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »
5° L'article L. 521-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1. - Les titres IV et VI du livre II ne sont pas applicables à Mayotte. »
6° Après l'article L. 532-6, il est inséré un article L. 532-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-6-1. - Les dispositions relatives au juge de l'exécution sont applicables à Wallis-et-Futuna. » –
Adopté.
L'article L. 3252-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3252-6. - Le juge de l'exécution du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations sous les réserves prévues à l'article L. 221-11 du code de l'organisation judiciaire. » –
Adopté.
À l'article 10 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les mots : « vente forcée des immeubles » sont remplacés par les mots : « saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ». –
Adopté.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE
Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les huissiers de justice peuvent également accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. »

La Chancellerie et la commission viennent de valoriser les officiers publics et ministériels que sont les huissiers de justice. Ceux-ci ont maintenant à peu près tous les droits, sans passer par le contrôle du tribunal.
J’aimerais que Mme le garde des sceaux ait l’obligeance de se pencher sur le statut des huissiers de justice lorsqu’ils sont en même temps agents d’assurance.
D’autres professions sont d’ailleurs concernées de la même manière. Ainsi, les notaires, qui sont également des officiers publics et ministériels, représentent la puissance publique tout en exerçant des activités purement libérales, commerciales.
Il peut ainsi y avoir conflits d’intérêts pour un huissier qui assure l’habitation d’une personne et qui doit opérer une saisie en exécution d’une décision de justice chez cette même personne.
Il conviendrait, me semble-t-il, de remettre un peu de clarté et de discipline dans ces professions.
L'article 12 est adopté.
Le premier alinéa de l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est complété par les mots : « ou une société d'exercice libéral ». –
Adopté.
Après l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée, sont insérés deux articles 3 bis et 3 ter ainsi rédigés :
« Art. 3 bis. - La formation continue est obligatoire pour les huissiers de justice en exercice.
« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. La Chambre nationale des huissiers de justice détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit.
« Art. 3 ter. - L'huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office d'huissier de justice.
« Une personne physique titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer plus d'un huissier de justice salarié. Une personne morale titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer un nombre d'huissiers de justice salariés supérieur à celui des huissiers de justice associés y exerçant la profession.
« En aucun cas le contrat de travail de l'huissier de justice salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'huissier de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l'huissier de justice salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public de l'huissier de justice salarié. » –
Adopté.
L'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
« 2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ; » ;
b) À la fin du cinquième alinéa (4°), les mots : «, et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu » sont supprimés.
2° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des études d'huissier de justice du ressort. » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, » sont supprimés ;
3° L'article 7 bis devient l'article 7 ter et l'article 7 bis est ainsi rétabli :
« Art. 7 bis. - La chambre régionale siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.
« Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres, de droit et désignés parmi les délégués à la chambre régionale.
« En sont membres de droit le président de la chambre régionale qui la préside, les présidents de chambre départementale ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambre interdépartementale.
« Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la formation disciplinaire est composée d'au moins trois membres.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;
4° A l'article 9, la référence : « article 3 » est remplacée par la référence : « article 7 ». –
Adopté.
L'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. » –
Adopté.
L'article 10 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Les huissiers de justice peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. » –
Adopté.
Le huitième alinéa de l'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est dressé par les parties contradictoirement, amiablement et sans frais pour le locataire. Si l'état des lieux ne peut être ainsi établi par les parties, il est dressé par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Toutefois, si l'huissier de justice est intervenu à la demande d'une seule partie sans l'accord de l'autre, le coût de l'état des lieux est intégralement supporté par le demandeur de l'acte. Lorsque l'état des lieux est établi par acte d'huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à son établissement. » –
Adopté.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION DE NOTAIRE
Après l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quater ainsi rédigé :
« Art 1 er quater. - La formation continue est obligatoire pour les notaires en exercice.
« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil supérieur du notariat détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. » –
Adopté.
À l'avant-dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « le fonctionnement des écoles de notariat existant dans le ressort, » sont supprimés. –
Adopté.
L'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. » –
Adopté.
L'article 7 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les notaires peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. » –
Adopté.
Le code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 348-3, les mots : « devant le greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l'article 345 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. » ;
3° À l'article 361, après les mots : « des articles 343 à 344 », sont insérés les mots : « du dernier alinéa de l'article 345 ».

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 29, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

L’article 23 reprend la recommandation n° 37 de la commission Guinchard, afin de décharger les greffiers en chef des tribunaux d’instance de leur tâche de recueil du consentement à l’adoption, qu’ils partagent actuellement, sur le territoire, avec les notaires.
L’argument invoqué pour justifier la déjudiciarisation du recueil du consentement à l’adoption est que leur rôle se limite à vérifier le consentement éclairé des personnes qui se présentent devant eux et qu’ils ne peuvent porter aucune appréciation sur les conditions de fond requises par les textes. Heureusement !
Le notaire bénéficierait donc à l’avenir d’une compétence exclusive en matière de recueil du consentement à l’adoption, l’auteur de la proposition de loi nous indiquant par ailleurs que le tarif de l’acte chez un notaire est modique puisqu’il s’élève à 25, 55 euros.
Comme je l’ai souligné dans la discussion générale, la déjudiciarisation du recueil du consentement à l’adoption pose plusieurs types de problèmes qui sont loin d’être anodins.
Il s’agit tout d’abord d’une question de principe. En effet, cette mission est aujourd’hui assurée par le service public de la justice, dont l’accès est libre et gratuit, ce qui n’est évidemment pas le cas des notaires !
Donner la possibilité de s’adresser au service public de la justice revient à garantir à tous l’égalité d’accès. En supprimant la compétence des greffiers en chef des tribunaux d’instance dans ce domaine pour la confier exclusivement aux notaires, vous faites du recueil du consentement à l’adoption une procédure exclusivement payante, ce qui est tout de même en contradiction avec l’idée que l’on est en droit d’avoir de l’accès à la justice.
Enfin, si le tarif de l’acte chez le notaire est aujourd’hui de 25, 55 euros, rien ne garantit qu’il n’augmentera pas.
Bref, il faut arrêter de croire que l’on peut simplifier le droit en se contentant de confier aux notaires l’établissement d’actes relevant des tribunaux.

L'amendement n° 26 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Supprimer le 1° de cet article.
La parole est à M. Jacques Mézard.

Le présent amendement a le même objet que l’amendement n° 29.
L’article 23 engage un processus de déjudiciarisation. Or, il ne nous paraît pas souhaitable d’empêcher les citoyens de faire établir par le greffe le consentement à l’adoption. Le choix de la procédure doit être laissé à nos compatriotes.
Je doute d’ailleurs que les notaires soient réellement demandeurs de ce surplus d’activité au regard du tarif praticable. Les notaires connaissent souvent un certain retard dans l’accomplissement de leurs charges, en particulier pour les actes qui sont passés pour les collectivités locales.
Pour ces deux raisons, je ne crois pas que les notaires souhaitent véritablement que leur soit totalement transféré ce type d’activités.
L’article pose en outre une question de principe : il témoigne d’une volonté d’exclure un nombre croissant d’activités de nos palais de justice.

Nous avons à examiner, dans le cadre de cette proposition de loi, les modalités de recueil du consentement dans deux domaines.
Il s’agissait, dans l’article précédent, du consentement pour la procréation médicalement assistée. Sur ce sujet, il nous est apparu qu’il n’était pas souhaitable de réserver aux notaires le recueil du consentement.
La plupart des couples souhaitent en effet pouvoir continuer à aller devant un juge, dans un palais de justice, pour déclarer leur intention de recourir à la procréation médicalement assistée. La commission a donc modifié en ce sens le texte de la proposition de loi. Je pense d’ailleurs que vous êtes tous d’accord sur ce sujet, puisqu’aucun amendement n’a été déposé pour revenir sur la décision de la commission.
Il faut également observer que la procréation médicalement assistée crée des circonstances évidemment irréversibles, ce qui n’est pas le cas de l’adoption.
La commission a donc pu se croire autorisée à maintenir, et même à soutenir, la disposition prévue par l’auteur de la proposition de loi, qui consiste à faire en sorte que les notaires soient seuls habilités à recueillir le consentement à l’adoption, compétence qu’ils partagent actuellement avec les greffiers en chef des tribunaux d’instance.
Je soulignerai d’abord que le greffier n’est pas un magistrat, ce qui confère une moindre solennité à l’acte. Il s’agit d’une formalité, contrairement à la procédure prévue pour la procréation médicalement assistée.
Ensuite, la majorité des couples se rendent directement chez un notaire pour effectuer cette démarche. À cet égard, et pour être complet, je rappelle que celle-ci, au tarif actuel des notaires, s’élève à 25, 55 euros. Toutes les personnes que nous avons entendues nous ont dit que le problème – à supposer toutefois qu’il y en ait un – ne résidait pas dans le coût.
Enfin, le père et la mère de l’enfant peuvent revenir sur le consentement qu’ils ont donné à son adoption pendant deux mois. La décision n’est donc pas irréversible. Par ailleurs, le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans est requis en cas d’adoption simple, comme en cas d’adoption plénière. En outre, le consentement peut être rétracté jusqu’au prononcé de l’adoption.
De notre point de vue, le fait que les notaires soient chargés de recueillir les consentements à adoption ne présente aucun risque. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur les amendements n° 29 et 26 rectifié bis.
Aujourd’hui, le recueil du consentement à l’adoption est une compétence partagée entre les greffiers en chef des tribunaux d’instance, les notaires et, le cas échéant, le service de l’aide sociale à l’enfance.
Le présent texte tend à décharger la juridiction de cette démarche en la confiant aux notaires.
Il faut aussi rappeler, pour compléter les observations que vient de faire M. le rapporteur que, pour les enfants ayant été confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, le recueil du consentement sera encore effectué par ce service.
Par conséquent, le seul changement réside dans le fait que les notaires ne partageront plus cette compétence avec les greffiers.
Comme vient de le rappeler M. le rapporteur, les greffiers en chef ne sont pas des magistrats. Il n’y a donc aucune difficulté de fond – par exemple en termes de fiabilité ou d’authenticité des actes – à confier cette tâche aux notaires.
C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 29 et 26 rectifié bis.

En ce qui me concerne, je voterai contre cette disposition du texte, car elle constitue un pas supplémentaire vers ce que notre collègue M. Mézard appelle pudiquement la « déjudiciarisation », et que je nomme quant à moi la privatisation du service public de la justice.

Ah bon ? Les notaires ne sont-ils pas des officiers publics et ministériels ?
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 23 est adopté.

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE
Le neuvième alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est supprimé. –
Adopté.
Après la section I du chapitre III du titre quatrième du livre septième du code de commerce, il est inséré une section I bis ainsi rédigée :
« Section I bis
« De la formation continue
« Art. L. 743-11-1. - La formation continue est obligatoire pour les greffiers des tribunaux de commerce en exercice.
« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. » –
Adopté.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l'article L. 743-12, après les mots : « à titre individuel, », sont insérés les mots : « en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce, » ;
2° Après l'article L. 743-12, il est inséré un article L. 743-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 743-12-1. - Une personne physique titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer plus d'un greffier de tribunal de commerce salarié. Une personne morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer un nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés supérieur à celui des greffiers de tribunal de commerce associés y exerçant la profession.
« En aucun cas le contrat de travail du greffier du tribunal de commerce salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de greffier de tribunal de commerce. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le greffier de tribunal de commerce salarié peut refuser à son employeur d'accomplir une mission lorsque celle-ci lui paraît contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, celles relatives au licenciement du greffier de tribunal de commerce salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public du greffier de tribunal de commerce salarié. » –
Adopté.

L'amendement n° 27 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 743-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. »
La parole est à M. Jacques Mézard.

L'amendement n° 27 rectifié bis est retiré.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION DE COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE
L'article 2 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est ainsi rétabli :
« Art. 2. - La formation continue est obligatoire pour les commissaires-priseurs judiciaires en exercice.
« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. La Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. » –
Adopté.
Les treizième, quatorzième, quinzième et seizième alinéas de l'article 8 de l'ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, règle toutes questions relatives aux œuvres sociales intéressant le personnel des études. » –
Adopté.
Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient les conventions et accords collectifs de travail.
« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études. » –
Adopté.
L'article 10 de l'ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail. » –
Adopté.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D'AVOCAT
I. - Après le titre XVI du livre troisième du code civil, il est inséré un titre XVII ainsi rédigé :
« Titre XVII
« De la convention de procédure participative
« Art. 2062. - La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
« Art. 2063. - La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :
« 1°) son terme ;
« 2°) l'objet du différend ;
« 3°) les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.
« Art. 2064. - Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition ; en conséquence, les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes ne peuvent faire l'objet d'une telle convention.
« Art. 2065. - Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour voir trancher le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise la partie qui s'en prévaut à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.
« En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.
« Art. 2066. - Les parties qui, au terme de la procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.
« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées du préalable de conciliation ou de médiation le cas échéant prévu.
« Art. 2067. - La procédure participative est régie par les dispositions du code de procédure civile. »
II. - L'article 2238 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »
III. - L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil. »
IV. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :
« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en de vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative. » ;
2° L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de rétribution des auxiliaires de justice prévues par les alinéas précédents en matière de transaction s'appliquent également en cas de procédure participative, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. ».

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 3 est présenté par M. Sutour et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 30 est présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Simon Sutour, pour présenter l’amendement n° 3.

Dans le cadre des conclusions qu’elle a présentées lors de l’examen de la proposition de loi qui nous est soumise, la commission des lois a institué la procédure participative de négociation assistée par un avocat.
Actuellement, les parties qui entendent régler à l’amiable le litige qui les oppose disposent de la conciliation et de la médiation. En cas d’échec de leurs pourparlers, la procédure judiciaire est conduite comme s’il n’y avait eu aucun échange préalable.
La commission sur la répartition des contentieux a proposé l’instauration d’une procédure participative en raison du rôle actif des parties à la résolution de leur différend ; celle-ci « prend la forme d’une convention de participation qui les engage à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution négociée du différend. »
La commission des lois propose de reprendre ce dispositif. Si, sur le principe, nous ne sommes pas opposés au règlement amiable des contentieux, nous aurions souhaité que cette nouvelle procédure soit introduite par le biais d’un projet de loi ou d’une proposition de loi qui lui serait spécifiquement consacrée.
Ainsi, nous aurions pu entendre les parties concernées. Nous aurions pu également réfléchir sur ce dispositif et proposer des modifications. La méthode retenue par la commission des lois ne nous permet pas cette étude approfondie. Telle est la raison de notre opposition.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 30.

L’article 31 crée une procédure participative de négociation assistée par avocat, ce qui suscite, sur le fond, des interrogations, ainsi qu’une critique sur les conditions dans lesquelles cette nouvelle procédure nous est présentée.
En effet, c’est la commission Guinchard, dont on attendait beaucoup, qui, dans sa recommandation n° 47, a suggéré l’introduction dans notre droit français d’une procédure participative, inspirée du droit collaboratif nord-américain.
Cette recommandation s’inscrivait dans une démarche d’ensemble de règlement des conflits. À cet égard, comme je l’ai déjà dit, nous regrettons ce morcellement du rapport Guinchard et l’approche partielle qu’adopte cette proposition de loi.
Cette procédure, à défaut d’être inscrite dans un projet de loi global reprenant – ou pas – les recommandations du rapport Guinchard, aurait dû prendre place dans un texte consacré aux procédures de conciliation.
Par ailleurs, et même si nous examinons les articles de la proposition de loi quelques semaines après le début de sa discussion, je rappelle que cette disposition a été introduite à la dernière minute, lors de la réunion de la commission des lois, alors qu’elle n’était pas prévue dans le texte originel de M. Béteille.
Cette méthode de travail aboutit à élaborer à la hâte une procédure qui ne reprend d’ailleurs même pas ce que prévoyait la commission Guinchard.
Par exemple, il n’est pas prévu que l’accord constatant le règlement consensuel du litige puisse être homologué par le juge compétent dans le cadre d’une procédure gracieuse, de sorte qu’il soit doté, au cas où ce serait nécessaire, de la force exécutoire, comme le prévoyait la commission Guinchard.
Dans le cas prévu par la proposition de loi, la décision d’accord est affaiblie par rapport à une décision rendue par un juge qui, quant à elle, est exécutoire.
De même, en cas d’accord partiel, il n’est pas non plus prévu que les parties puissent saisir la juridiction compétente par la seule remise au greffe de ce document, afin d’homologuer les points d’accord et de statuer sur les seuls points restant en désaccord, ce qui permettrait d’accélérer la procédure devant le juge compétent.
Enfin, le champ social est exclu de cette procédure participative, d’une part, parce qu’elle interdit le recours à la médiation et à la conciliation, et, d’autre part, parce que les parties sont exclusivement représentées par leurs avocats.
Qu’en est-il alors des défenseurs syndicaux, par exemple ? Nous voyons bien que la réflexion est loin d’être aboutie. On ne peut pas transposer aussi rapidement dans notre droit et dans nos pratiques des procédures nord-américaines. La réflexion menée n’a pas permis d’examiner tous les aspects de cette procédure qui font problème.
Sur le fond, la procédure participative de négociation assistée par avocat pose en effet des problèmes en raison de sa nature même. Il ne faut pas occulter le fait que cette procédure sera coûteuse, en raison du temps très important consacré par l’avocat à donner conseil ; elle sera donc, en réalité, réservée à ceux qui en auront les moyens.
La commission Guinchard soulevait d’ailleurs cette question à propos du droit collaboratif nord-américain, en soulignant que ceux qui n’auront pu aboutir à une solution négociée n’auront plus les moyens financiers de se lancer dans une procédure judiciaire.
Il s’agit d’ailleurs d’une des nombreuses critiques formulées à l’encontre de la procédure judiciaire anglo-saxonne, qui ne permet pas, le plus souvent pour des questions financières, que les droits des justiciables s’exercent à armes égales. On pourrait citer bien des exemples !
Cette procédure vient bouleverser le règlement amiable des conflits. Il n’est donc pas très sérieux de la présenter dans de telles conditions. Je pense qu’il faudrait reporter cette disposition.
C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de l’article 31.

Les dispositions concernant la procédure participative adoptées par la commission des lois sont le fruit d’une longue réflexion, menée aussi bien par les professionnels du droit que par notre commission, sans oublier, bien sûr, la commission Guinchard sur la répartition du contentieux.
Par conséquent, aucune personne de bonne foi ne peut se dire prise au dépourvu. Cette mesure fait partie des sujets que nous étudions depuis de nombreux mois, pour ne pas dire des années.
J’ajoute que la disposition fait l’objet d’un consensus. En outre, le texte que nous vous proposons d’adopter prévoit un certain nombre de garde-fous.
Premièrement, la procédure participative sera bien évidemment facultative. Les parties n’y auront recours que si elles le souhaitent. Si l’une de ces parties refuse, la justice suivra son cours ordinaire.
Deuxièmement, la commission des lois, après avoir longuement débattu, a souhaité exclure du champ d’application de la procédure participative tout ce qui concerne l’État et la capacité des personnes, en d’autres termes ce qui a trait pour l’essentiel au droit de la famille.
Par ailleurs, les parties pourront soumettre leur accord à l’homologation d’un juge, ce qui est une garantie supplémentaire.
Si les parties ne trouvent qu’un accord partiel, ou s’il n’y a pas d’accord, l’affaire sera renvoyée devant la juridiction. Mais cette dernière fera l’économie du début de la procédure, et notamment de l’échange de pièces et de la confrontation des arguments. La procédure ira donc plus vite.
Cela dit, mes chers collègues, si l’on veut interdire aux parlementaires de présenter des réformes substantielles par le biais de propositions de loi ou des travaux de commission, autant le dire ! Je considère pour ma part que cela reviendrait à nier le travail parlementaire.
Par ailleurs, puisque l’urgence n’a pas été déclarée sur cette proposition de loi, la navette permettra éventuellement d’améliorer les dispositions qu’il contient. Je ne suis d’ailleurs pas certain qu’il y ait beaucoup de points à améliorer en ce qui concerne la procédure participative, dans la mesure où la réflexion a été longuement mûrie.
La commission est donc défavorable aux deux amendements identiques n° 3 et 30.
La procédure instituée par l’article 31 permettra d’apaiser les tensions dans certains conflits. Le recours à la médiation ou à la conciliation avant passage devant le juge s’est révélé utile, voire nécessaire, en de nombreuses circonstances. Je pense notamment à certains conflits relatifs aux affaires familiales.
Cette procédure me semble extrêmement moderne et efficace. En effet, les décisions de justice sont souvent mal acceptées, non seulement par les parties perdantes, mais également parfois par les parties gagnantes. Elles peuvent s’interroger. Pourquoi n’y a-t-il pas eu plus de temps consacré aux explications ? Pourquoi les échanges ont-ils été si peu nombreux ?
La procédure participative, qui présente des garanties, du fait notamment de la présence d’avocats, permet d’apaiser les tensions et d’améliorer la compréhension du litige et de la solution retenue.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis très défavorable sur ces deux amendements de suppression.

Monsieur le rapporteur, je serai bien le dernier à penser que les parlementaires ne peuvent pas déposer de propositions de loi sur des sujets importants. Je l’ai moi-même fait dans une autre enceinte, et cela m’a d’ailleurs été reproché par vos amis. Mais passons…
Je voudrais formuler quelques remarques. Lorsque la commission des lois a été saisie de la présente proposition de loi, un certain nombre d’éléments posaient problème. Ainsi, le droit des personnes était inclus dans le champ de la procédure participative. Or ce n’est juridiquement pas possible puisque le droit des personnes est un droit public !

De même, aux termes de la version initiale de la proposition de loi, on aurait pu recourir à cette procédure sans juge pour un désaveu ou une recherche de paternité !
Fort heureusement, monsieur le rapporteur, à la suite des observations qui vous ont été adressées en commission, vous avez exclu toutes ces matières du champ d’application des procédures participatives.
Le dispositif permettra, nous dit-on, une meilleure application des décisions de justice. En réalité, de quoi s’agit-il ? Pour les petits litiges, comme les conflits conjugaux et les petites affaires familiales ou de voisinage, des procédures existent déjà. De même, la nouvelle procédure de divorce…

… permet d’aboutir à des accords.
Pour le reste, des procédures de médiation et de conciliation sont prévues par la loi-cadre présentée par M. Méhaignerie lorsqu’il était garde des sceaux.
Ainsi, il existe déjà un éventail de procédures qui ne nécessitent ni tribunal ni avocat pour régler ce type de petits litiges.
En outre, il faudra bien rétribuer les avocats-conseils. Or – réfléchissons un peu ! – qui pourra avoir recours à une telle procédure ? Ce seront les milieux d’affaires et les acteurs financiers, économiques ou commerciaux, c'est-à-dire des personnes qui disposent déjà d’un avocat, en l’occurrence celui de la société. Dans cette hypothèse, l’avocat concerné s’entendra avec son confrère de l’autre partie pour recourir à une procédure participative et éviter de passer devant le juge. Et c’est ainsi que des contentieux très importants échapperont à la justice civile !
C’est vraiment le bouquet ! C’est la privatisation totale de notre justice civile !
Certes, je veux bien que l’on recoure à des procédures de conciliation ou de médiation pour les petits litiges. Tant mieux si l’on parvient à s’entendre et, dans le cas contraire, on passe devant le juge. Mais, en l’occurrence, il s’agit de domaines de tout autre nature. Ce sont les matières visées par le rapport Guinchard et par les partisans d’une telle réforme au sein du monde judiciaire. Je pense qu’il faut refuser énergiquement une telle mesure.

Monsieur Michel, vous êtes très habile, mais je ne pense pas que nos collègues puissent se laisser abuser par vos propos.

Je voudrais vous préciser deux éléments.
Premièrement, la procédure participative ne peut pas s’appliquer en matière pénale.

Oui, mais vous laissez sous-entendre qu’on pourrait l’utiliser pour toutes les catégories d’affaires.
En l’occurrence, la procédure participative concerne seulement le droit civil. Il me paraît important de le préciser, parce que vous allez peut-être créer un trouble dans l’esprit de certains.

C’était sous-entendu.
Deuxièmement, il est vrai que la commission a passé du temps sur cette proposition de loi et qu’elle l’a légèrement modifiée. Mais nous l’avons plus complétée que transformée.
Par exemple, il n’a jamais été question que les affaires de filiation puissent être du ressort de la procédure participative. Le texte que je vous avais proposé à l’origine portait bien sur les droits dont la personne a la libre disposition. Ce sont seulement ces droits, et pas les autres, qui peuvent faire l’objet d’une telle procédure.
Enfin, dans un souci de compréhension du texte, au risque de l’alourdir un peu, nous avons ajouté ceci : « En conséquence, les questions relatives à l’état et à la capacité des personnes ne peuvent faire l’objet d’une telle convention. » Ce complément est destiné à permettre à chacun de bien comprendre ce dont il s’agit.

M. Simon Sutour. Monsieur le président, la longueur de la réponse du rapporteur montre, me semble-t-il, que l’intervention de notre collègue Jean-Pierre Michel a porté.
M. le président de la commission des lois proteste.

Indépendamment du problème de fond, j’aimerais rappeler un point.
À l’origine, la proposition de loi de M. Béteille ne contenait pas de telles dispositions. Le texte, qui comportait initialement vingt-six articles, en a à présent cinquante !
La proposition de loi contient un grand nombre de dispositions consensuelles. Comme nous l’avons vu, nombre d’articles ne font l’objet d’aucun amendement et ont été adoptés sans difficulté. Mais la commission a souhaité ajouter de nouvelles mesures, notamment l’instauration d’une procédure participative et la fusion des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle, dont nous discuterons tout à l’heure.
Pour ma part, je ne reprendrai pas les termes d’un de nos collègues qui évoquait en commission un « travail bâclé ». Mais je pense que, si nous voulons que le travail parlementaire soit pris au sérieux, il nous faut commencer par travailler sérieusement ! Ce n’est pas ce que nous faisons aujourd'hui.

Je ne partage pas du tout l’avis de notre collègue Simon Sutour. Je voudrais au contraire saluer la qualité du travail réalisé au sein de la commission de loi, sous l’autorité de son président, M. Jean-Jacques Hyest.
Personnellement, en tant que praticienne du droit, je pense que la procédure participative est très attractive.
L’intérêt principal d’une telle procédure, et c’est en ce sens qu’elle diffère des procédures judiciaires ou des autres modes de résolution des conflits, réside, me semble-t-il, dans la maîtrise du temps et du coût, même en cas d’échec, ce qui est extrêmement important à mes yeux.
La procédure judiciaire consécutive à la procédure participative gagnera en efficacité, car celle-ci s’apparente à une mise en état de fait, ce qui diminuera la durée du procès. C’est la grande différence avec les autres modes de résolution de conflits.
En réalité, il s’agit d’un « décentrement du procès » qui débute sous la responsabilité des parties et de leurs avocats.
Je rappelle également que les parties sont tout le temps assistées par leurs avocats. Tout cela s’effectue avant la saisine du juge dans un cadre conventionnel. Il s’agit donc d’un dispositif très novateur.
À mon sens, cela permettra aux auxiliaires de justice d’échanger tous les documents et les pièces utiles au débat dès le début de la procédure participative. Ce travail en amont, que l’on n’aura pas besoin de refaire, permettra à l’avocat de réduire le nombre de ses interventions en juridiction à celles qui sont réellement utiles. On oublie de le souligner, alors que cette dimension me paraît très importante.
J’estime donc que cette procédure participative apportera une véritable plus-value par rapport aux autres modes de résolution des conflits.
En outre, je pense que cette procédure représente une occasion formidable pour l’évolution de la profession d’avocat, évolution qui, je crois, était attendue par tout le monde. Désormais, les avocats pourront avoir un rôle d’impulsion dans la recherche d’une solution amiable en vue d’éviter un procès.
Par conséquent, cette nouvelle disposition me semble extrêmement satisfaisante.

Je ne suis pas très favorable au système institué par l’article 31.
Certes, je ne remets pas en cause la forme. Je pense que le processus est assez normal.
En revanche, sur le fond, je n’ai toujours pas bien compris vos explications, monsieur le rapporteur. En commission, vous aviez déclaré que ce dispositif servirait à régler de petits litiges. Or je n’ai pas l’impression que ce soit le cas.
Au demeurant, s’il s’agit de petits litiges, je m’interroge. J’ai vu que l’on pourrait utiliser l’aide juridictionnelle dans la procédure participative. De deux choses l’une : soit l’aide juridictionnelle accordée dans ce cadre sera supérieure à celle qui est allouée dans une procédure judiciaire et le système connaîtra un certain succès, soit elle sera inférieure et le succès ne sera pas au rendez-vous puisqu’il existe une différence considérable entre les petits et moyens barreaux et les grands barreaux.
Je le rappelle, la procédure de transaction existe déjà dans le code civil, avec les articles 2044 et suivants. Les avocats ont depuis toujours, et heureusement, été capables de mener des transactions ou de trouver des solutions amiables, en dehors de ce type de négociations participatives.
S’agissant toujours des petits litiges, ils peuvent être tranchés par la juridiction de proximité qu’est le tribunal d’instance.

Certes, ma chère collègue.
Le juge d’instance est à même, par la procédure de conciliation et sans avocat, de régler des petits litiges.
L’audience de conciliation a malheureusement été dévoyée faute de temps, et de magistrats et greffiers en nombre suffisant. Pourtant, cette procédure était parfaitement adaptée à la résolution sans frais de nombre de petits litiges.
J’entends bien l’argument selon lequel la procédure participative aurait un intérêt pour la profession que j’ai eu souvent l’honneur de représenter. Mais elle aboutirait tout de même à faire passer un certain nombre de dossiers extrêmement importants à l’extérieur des palais de justice et des tribunaux. Je ne crois pas que ce soit une avancée pour notre droit.

Je ne répéterai pas ce qui vient d’être excellemment souligné par notre collègue. Moi aussi, j’ai le souci d’éviter des débats trop longs et ennuyeux au sein de cette enceinte. C’est pourquoi, sans évoquer la forme et la manière dont le nombre de dispositions contenues dans cette proposition de loi a enflé, je centrerai mon propos sur le fond du débat.
Effectivement, les procédures de règlement à l’amiable existent déjà. N’affirmons donc pas que nous créons quelque chose qui serait inexistant dans notre droit.
Cela dit, et nous le voyons bien, la procédure dont nous discutons est inspirée du droit et de la pratique anglo-saxons, notamment américains, dont nous savons qu’ils font essentiellement appel à des modes de résolution privés des conflits. Souvent ce sont des montants financiers importants qui sont en jeu entre des parties égales. Lorsque les parties ne sont pas égales, inutile de le préciser, c’est toujours le faible qui en pâtit.
Que la procédure de négociation assistée par avocat puisse intéresser les cabinets d’avocats pour développer leur clientèle, je n’en doute pas. Mais qu’y a-t-il de commun entre, d’une part, un gros cabinet dont un des avocats prend en main le dossier depuis le départ et le suit tout au long de la procédure, qui peut durer longtemps, et, d’autre part, l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, qui prendra connaissance du dossier juste avant la négociation ? Certes, cela se passe déjà ainsi devant les tribunaux, mais enfin nous pouvons faire confiance au juge.
Par conséquent, je constate que l’on introduit, au détour d’une proposition de loi, un mode de règlement privé des conflits qui risque de nous entraîner très loin dans la voie d’une privatisation de la justice ou, en tout cas, d’un abandon du service public.
Nous sommes donc contre cet article quant au fond.

Tout d’abord, comme notre collègue Jacques Mézard l’a bien montré, compte tenu des taux et des tarifs pratiqués, cette disposition est conçue non pas pour l’aide juridictionnelle, mais pour les personnes qui ont les moyens de faire appel aux services d’un avocat pour régler de gros litiges civils et commerciaux, cher rapporteur !
Ensuite, Mme le garde des sceaux a indiqué, tout à l’heure, qu’elle envisageait une réforme globale de la procédure pénale pour ne pas porter atteinte à cette dernière par petits bouts. C’est magnifique, mais que sommes-nous en train de faire en ce moment ? La procédure civile ne mériterait-elle pas, elle aussi, un débat global ? Il faut savoir ce que l’on veut.
Nos points de vue diffèrent totalement. Vous avez, vous, des conceptions libérales du service public de la justice. Vous voulez le démanteler, de façon à confier au secteur privé un nombre maximum de litiges, qui ne passeront donc plus devant les tribunaux.
Pour notre part, nous résistons à cette tendance que vous voulez nous imposer visant, une fois de plus, la privatisation du service public, …

… dans ce domaine comme ailleurs, notamment dans les universités, l’éducation nationale, ou le secteur hospitalier au travers du projet de loi portant réforme de l’hôpital présenté à l’Assemblée nationale.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 31 est adopté.
Le I de l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de conseil juridique » sont remplacés par les mots : «, de conseil juridique et de conseil en propriété industrielle » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes inscrites sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue à l'article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du ..., sont inscrites, avec effet à la date d'inscription sur cette liste, au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur lieu d'exercice professionnel ou leur siège social, avec la mention de spécialisation prévue en matière de propriété intellectuelle par les dispositions prises pour l'application du 10° de l'article 53. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « et de conseil juridique » sont remplacés par les mots : «, de conseil juridique et de conseil en propriété industrielle, » ;
4° Au quatrième alinéa, après les mots : « fonctions d'avocat », sont insérés les mots : «, du titre de mandataire agréé en brevet européen ou auprès de l'office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ».

Je souhaite intervenir sur les articles 31 et suivants, qui constituent l’ensemble d’un paquet pouvant s’intituler « absorption en rase campagne de la profession de conseil en propriété industrielle par celle d’avocat ».

Nous sommes hostiles, pour le moment, à l’introduction d’un tel cavalier, que dis-je, d’une « armée mexicaine », dans une proposition de loi où elle ne figurait d’ailleurs pas à l’origine.
En premier lieu, s’agissant de la forme, aspect important, rappelons que le débat en cours et, plus généralement, sur la profession d’avocat, est loin d’être parvenu à son terme.
Les avocats, par la voix du Conseil national des barreaux, et le Conseil national des conseils en propriété industrielle se sont prononcés favorablement, dites-vous.
D’abord, nous le savons, « la politique de la France ne se fait pas à la Corbeille ». Ensuite, il faut le souligner, nombre de corps constitués sont hostiles à cette disposition, notamment le MEDEF, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, la CGPME, le Conseil supérieur de la propriété intellectuelle – ce qui n’est pas rien –, mais aussi la commission Darrois, qui doit remettre son rapport et dont vous étiez membre, monsieur le rapporteur, si je ne me trompe.

Il est tout de même curieux que vous preniez position alors que le rapport n’est pas encore sorti ! Ceux qui lisent régulièrement, comme moi, Le Figaro auront pu apprendre que la commission Darrois est hostile à la fusion envisagée et prône l’interprofessionnalité.

Enfin, les conseils de l’Ordre des avocats des barreaux de Paris, de Lyon et de Marseille sont également hostiles à la mesure.

Je ne prolongerai pas la liste, mais vous le voyez bien, c’est un débat qui mérite d’être approfondi.
En second lieu, j’en viens au fond. Je ne m’étendrai d’ailleurs pas, puisque nous demandons que cette mesure puisse faire l’objet d’une proposition de loi ou d’un projet de loi
Avant tout, il convient de se demander si elle favorise la politique de recherche et d’innovation de la France, puisque tel est bien l’enjeu. À cet égard, permettez-moi de soumettre deux arguments à votre réflexion.
D’abord, il faut savoir que le métier d’avocat en propriété industrielle est différent de celui de conseil en brevets – j’exclus ici les conseils en matière de marques ou de droits d’auteurs qui relèvent d’un autre champ.
Le conseil en brevets apporte une aide au chef d’entreprise pour la mise au point de son invention, la définition de ce que l’on appelle les revendications, c’est-à-dire les descriptions, et pour l’intégration de l’invention dans la stratégie de l’entreprise. C’est un ingénieur, un technicien, un praticien de l’entreprise.
En revanche, l’avocat s’occupe de la procédure, des règles, des plaidoiries.
Ces deux professions sont à tel point différentes qu’elles n’ont fusionnées dans aucun autre pays. Même en Allemagne, pays qui a été cité en exemple, les deux métiers coexistent dans les mêmes cabinets dans le cadre de l’interprofessionnalité, mais avec des formations différentes. Dans la pratique d’ailleurs, il n’existe que deux ou trois cabinets de ce type, ce qui tend à démontrer que la formule n’a pas connu un grand succès.
Ensuite, si ce texte est adopté, nous assisterons à la disparition de la profession de conseil en propriété industrielle à la suite de son absorption par celle d’avocat. Or, je le répète, les avocats sont avant tout des juristes et non pas des techniciens, des spécialistes en chimie ou en mécanique ! Nous allons donc appauvrir le nombre et la qualité de ces conseillers, particulièrement importants pour les PME, qui sont dépourvues de services internes de propriété industrielle.
À un moment où chacun s’accorde à dire qu’il importe d’encourager les PME à investir, à exporter, à innover, c’est plutôt un mauvais coup qui leur est porté.
C’est donc un projet mal ficelé et nous demandons la suppression des articles 31 et suivants.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 4 est présenté par M. Sutour et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 31 est présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Simon Sutour, pour présenter l’amendement n° 4.

Les arguments développés par notre collègue Richard Yung, spécialiste de la question, sont très forts.
Il résulte, en effet, du décret du 25 novembre 1991 que la profession d’avocat – 50 000 personnes – est incompatible avec celle de conseil en propriété industrielle – 680 personnes.
Il est reconnu que les services offerts par les conseils en propriété industrielle incluent les consultations juridiques et les rédactions d’actes sous seing privé.
On ne peut exercer que l’une ou l’autre de ces professions et un cabinet ne peut accueillir les deux, alors même qu’elles œuvrent l’une et l’autre dans le même domaine et fournissent, pour partie, les mêmes prestations.
Or le métier de conseil en propriété industrielle est devenu juridique, avec une matière technique et des buts économique, financier, stratégique. Pourtant, il leur est interdit de plaider, la plaidoirie étant le privilège des avocats.
Dans le cadre de ses conclusions sur la proposition de loi qui nous est soumise, la commission des lois propose un dispositif organisant le rapprochement de la profession d’avocats et de conseillers en propriété industrielle.
Comme nous venons de le dire pour l’introduction de la convention participative de négociation assistée par avocat, nous ne sommes pas opposés à cette fusion.
La commission consacre dix-neuf articles à l’élaboration de cette fusion, ce qui représente véritablement un projet de loi ou une proposition de loi à part entière.
Or l’introduction d’un tel dispositif par voie d’amendements nous prive de la possibilité d’entendre les parties et de procéder à une étude approfondie et sereine de cette fusion. Elle nous retire donc la possibilité de procéder à la rédaction correcte d’amendements.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression des articles 32 et suivants, qui visent à mettre en place la fusion des deux professions. Les propos que je viens de tenir valent donc aussi pour les articles suivants, monsieur le président.
J’ajouterai enfin que, ce débat intervenant quelques semaines après la discussion générale, nous avons été assaillis de courriers.

Et, je suis désolé de le dire, monsieur le rapporteur, ces courriers montrent que votre proposition, adoptée par la commission, loin d’être consensuelle suscite un véritable débat.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 31.

Je ne reviendrai pas sur les argumentations de mes collègues, auxquelles je souscris.
Je veux simplement faire part de notre étonnement. En effet, ce texte a été présenté en commission, voilà quelques semaines, comme ne devant pas poser de problème. Même si d’autres dispositions devaient y être ajoutées, tout cela était consensuel et admis par tout le monde…
Ensuite, à écouter les uns et les autres, nous nous sommes aperçus que la commission Darrois n’avait pas encore rendu son rapport et qu’elle n’émettrait pas un avis favorable, semblait-il.
Nous avons également constaté qu’il fallait apporter quelques bémols au consensus de la profession, sachant que certaines associations et même les barreaux de Paris et de Lyon, pourtant très concernés par ces questions, n’étaient pas d’accord avec ces mesures. Au total, le consensus était quelque peu troué.
Je le répète, ce n’est pas une bonne manière de procéder. M. le rapporteur, en sa qualité de membre de la commission Darrois, aurait pu se montrer plus prudent dans ses prises de position et, en tout cas, attendre que le rapport de cette commission soit rendu.
Mon propos n’est pas de dire qu’il faut suivre cette dernière. Ce que je veux souligner, c’est que l’approche de cette disposition n’était pas aussi limpide et consensuelle qu’on a bien voulu nous le dire. Or, en commission, nous nous en remettons bien évidemment au rapporteur et au président quant à notre information sur les conséquences de ce type de loi pour certaines professions. On peut en conclure que, véritablement, quelque chose ne va pas dans les pratiques des commissions.
Monsieur le président, je tiens à vous dire dès à présent que ce développement vaut également pour les articles suivants.

Nous avons failli ne pas en discuter, car les dispositions législatives sont prévues depuis longtemps.

Et le Gouvernement avait envisagé de procéder par ordonnance, après avoir consulté toutes les professions.

Permettez-moi de vous dire que, pour ma part, je préfère que ces dispositions soient examinées en commission, où nous disposons de plusieurs semaines pour y travailler, que le texte soit examiné deux fois devant chaque assemblée, puis, éventuellement, qu’il passe en commission mixte paritaire, plutôt que de nous les voir imposées dans une ordonnance et un éventuel projet de loi de ratification !
Nous examinons aujourd'hui une mesure qui est demandée par les deux professions concernées. Le Conseil national des barreaux s’est prononcé de façon très claire à plusieurs reprises sur cette fusion.

La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle s’est prononcée également sans ambiguïté depuis longtemps.
Tous deux sont favorables à la disposition, non pour le plaisir de modifier le statut des uns et des autres, mais pour régler un réel problème.
Aujourd'hui, il n’existe plus en France que 600 conseils en propriété industrielle. C’est une profession qui disparaît, se meurt, tant son statut n’est plus adapté à ce qui lui est demandé.
Au vu de ce qui se pratique dans les pays voisins, comme l’Allemagne ou le Royaume-Uni, il est évident que de moins en moins de brevets, de marques et autres éléments de la propriété industrielle seront déposés en France. Nous ne pouvons laisser la situation en l’état, et il est urgent d’agir.
C'est la raison pour laquelle les institutions représentatives des deux professions de conseil en propriété industrielle et d’avocat réclament la fusion depuis longtemps.

Certes, deux ou trois cabinets, peut-être un peu plus, qui seront contraints de se réorganiser si cette fusion est décidée, ont multiplié les interventions.
J’ai reçu, comme vous, des courriers très épais de l’Association des avocats de propriété industrielle. Je ne sais d’ailleurs toujours pas qui me les envoie exactement, car les documents ne sont pas signés. Je devine qu’ils émanent de deux ou de trois cabinets parisiens, dont la notoriété et la compétence ne sont pas contestées.
Néanmoins, si ce texte était adopté, nous ne pourrions que les inviter à adapter assez rapidement leurs structures à la nouvelle réglementation !
Croyez bien, chers collègues, que la mesure proposée n’a d’autre objectif que d’accompagner le développement des entreprises, qu’elles soient grandes ou petites.
Si le texte est aussi détaillé et si nous avons voulu que des précisions figurent dans la loi, c’est qu’il n’est pas impossible qu’au cours de la navette parlementaire deux ou trois modifications soient apportées, même si nous travaillons depuis des mois sur le sujet.
Pour répondre à certaines inquiétudes, je souligne que les entreprises pourront continuer à être représentées par leurs propres salariés si elles le souhaitent et qu’il ne leur sera pas fait obligation de passer par un professionnel.
Par ailleurs, les avocats qui interviendront dans ce domaine – dans la quasi-totalité des cas, il s’agira d’anciens conseils en propriété industrielle – auront une mention de spécialisation « conseil en propriété industrielle ». Cette spécialisation sera représentée au sein du Conseil national des barreaux. Sans entrer dans les détails, je puis vous assurer qu’énormément de précautions ont été prises.
Enfin, puisque certains intervenants ont eu la gentillesse de rappeler que je faisais partie de la commission Darrois, je tiens à signaler que je ne suis pas habilité à parler en son nom.
Normalement, cette commission aurait dû rendre ses travaux dernièrement. Cependant, la perspective d’éventuelles modifications concernant la procédure d’instruction annoncées par le Président de la République ne sera pas sans incidence sur le mode de fonctionnement des avocats et surtout de l’aide juridictionnelle.
La commission Darrois a donc demandé un mois supplémentaire avant de remettre son rapport. Le texte est prêt, il est quasiment entièrement rédigé. Concernant les conseils en propriété industrielle et les avocats, il ne fait aucun doute – ce n’est pas un scoop, sinon je ne le divulguerais pas – que la commission sera très favorable à la fusion. En effet, elle est demandée et chacun a compris qu’il s’agissait d’une urgente nécessité.
Je suis donc très étonné par le débat qui s’est instauré. Je pensais que le sujet était un sujet consensuel, même si je ne sous-estime pas l’obligation qui sera faite à quelques cabinets de s’adapter. J’observe néanmoins qu’il s’agit de très gros cabinets et que seuls quelques praticiens, à l’intérieur de ces cabinets, seront concernés. La mesure ne remettra à aucun moment en cause la pérennité des structures. Le bruit qui est fait autour de cette affaire est donc disproportionné et j’aurai préféré que nous trouvions un consensus sur ces dispositions.
Cela dit, vous auriez plutôt été en droit de contester la normalité de la procédure si, il y a quelques mois, vous vous étiez trouvés en face d’une ordonnance instaurant cette fusion.
Pour toutes ces raisons, la commission est défavorable à ces deux amendements de suppression.

On entend cet après-midi des choses singulières dans cet hémicycle.
On nous dit que la proposition de loi, qui comportait initialement 26 articles, en compte maintenant 50, et qu’elle aborde deux sujets très importants, qui auraient nécessité chacun d’eux un texte de loi.
On nous dit également que l’on travaillait sur la fusion de la profession d’avocat et de conseil en propriété industrielle depuis longtemps et que, le Gouvernement étant disposé à agir par voie d’ordonnance, il était préférable d’intervenir par cette proposition de loi. Quel argument singulier ! Pour en arriver à ce résultat, j’aurais envie de vous dire que nous aurions pu gagner du temps et nous épargner l’examen d’un texte !
Par ailleurs, je ne trouve pas M. le rapporteur très à l’aise quand il parle de la façon dont nous travaillons. Il reconnaît que le texte n’est pas parfait, que l’accord n’est pas général, mais, pour lui, ce n’est pas grave : il s’agit de la première lecture et la navette arrangera tout ça !
Monsieur le président, je le répète, nous demandons la suppression des articles 32 et suivants.
Je m’associe aux arguments et aux observations de M. le rapporteur.
Par conséquent, j’émets un avis défavorable sur ces amendements.

Il a beaucoup été dit depuis deux jours que, s’il y avait un lieu pour débattre, c’était bien ici !

Certains auraient voulu un projet de loi. Pourquoi ? Je suis désolé, l’initiative parlementaire existe !

Je rappelle que la mesure avait été présentée une première fois sous forme d’ordonnance. Nous avions estimé, à l’époque, que la concertation entre les professions n’était pas suffisante.

C’était il y a au moins six mois. Nous devions savoir si les professions avaient évolué et où en étaient les réflexions des uns et des autres.
Il est vrai que certaines associations sont hostiles à la fusion. J’ai reçu dans ce sens un certain nombre de coups de téléphone de personnes, que j’apprécie par ailleurs. Mais on ne fait pas la loi pour quelques-uns ; on la fait pour tous !
S’il s’agit uniquement de défendre un ou deux cabinets, je ne suis pas d’accord par principe et je me méfie toujours ! La loi n’est pas faite pour ça : je le dis et je ne cesserai de le redire. En l’occurrence, c’est l’avenir des brevets en France qui est en train de se jouer.

Or s’opposer à la fusion des deux professions est le meilleur moyen d’accélérer la dégradation.

Je ne dois pas rencontrer les mêmes industriels que vous !
Je suis ravi que vous écoutiez le MEDEF et l’Association française des entreprises privée, d’autant que cela ne correspond pas tout à fait à vos options générales !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’esclaffe.

Je défends l’intérêt général, figurez-vous !
En outre, si nous ne défendons pas l’initiative parlementaire, on nous refusera le droit de délibérer de sujets dont nous n’aurons pas été saisis.
M. le rapporteur a reçu le soutien de la majorité de la commission des lois. Je ne vois pas au nom de quel principe nous n’aurions pas le droit de légiférer sur le rapprochement des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle.
Certes, le rapprochement de ces deux professions posera des problèmes à certains cabinets ou à certaines personnes. Mais, mes chers collègues, moi qui suis parlementaire depuis plusieurs années, j’ai assisté à la fusion de la profession de conseil juridique et d’avocat, et je puis vous assurer que la difficulté était tout autre. Le Parlement est pourtant parvenu, en contraignant les uns et les autres, à moderniser ces métiers.
L’intérêt général doit prévaloir. Les professions doivent, quand leurs organes représentatifs sont d’accord entre eux, forcer ceux qui éprouvent des réticences et les inciter à entrer dans un dispositif porteur d’avenir, d’autant que le maintien du statu quo mettrait en péril la propriété industrielle en France.

Je ne suis pas membre de la commission des lois, mais il se trouve que, en tant que sénateur de Paris, j’ai été saisi de cette question par des cabinets d’avocats, et un peu plus de deux ou trois, monsieur le président de la commission des lois.

Dès lors, j’ai été amené à m’interroger sur cette affaire de fusion.
Monsieur Zocchetto, vous évoquez dans votre rapport « un rapprochement nécessaire et souhaité par une très large majorité des membres des deux professions ». Je crois que vous auriez pu nuancer votre propos. Un rapport du Sénat doit être beaucoup plus précis et ne pas contenir de telles assertions sans qu’on y ait regardé de plus près. Pour ma part, c’est ce que je me suis efforcé de faire, sans a priori.
Bien sûr, faisant partie de la majorité, je voterai le texte, mais je tiens tout de même à rappeler que, sur les 48 461 avocats que l’on dénombre en France, Paris en compte 19 763 – ce qui justifie que j’aie mon mot à dire –, pour 67 à Laval, monsieur le rapporteur, ou 118 à Melun, monsieur le président de la commission !

Je ne vous permets pas de faire ce genre de rapprochements ! C’est scandaleux ! Moi, je ne me soucie que de l’intérêt général !

Moi, monsieur le président de la commission, j’ai pris en compte les deux points de vue.

Sur le fond, vous avez tout à fait raison, il est nécessaire d’arriver à une solution.

On n’a jamais dit le contraire !
Simplement, je constate que, sur les 657 conseils en propriété industrielle exerçant en France, 52 % seulement ont approuvé la fusion. Actuellement, il y a 255 avocats spécialisés en propriété intellectuelle ; la plupart d’entre eux exercent à Paris, plus quelques confrères lyonnais et marseillais. Ce sont donc, pour l’essentiel, des cabinets parisiens qui sont touchés par ce problème.
Le 15 janvier, lorsqu’il s’est adressé à la commission des lois, le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, qui représente donc à ce titre près de la moitié des avocats de France, et qui est par ailleurs vice-président du Conseil national des barreaux, vous a certes indiqué que l’instance ordinale des avocats parisiens acceptait le principe de la constitution d’une grande profession juridique, dans laquelle pourrait figurer la profession de conseil en propriété industrielle, mais il n’a jamais dit que cette même instance approuvait la fusion entre la profession d’avocat et celle de conseil en propriété industrielle !
Il me paraît un peu surprenant que tout cela ne soit pas précisé dans le rapport, de manière que l’ensemble du Parlement en soit informé. En tant que membre de la majorité, j’aurais aimé disposer de tous ces éléments ! Or il a fallu que j’aille moi-même les rechercher !

Je sais par ailleurs que le MEDEF et la CGPME sont également très hésitants.
Bien sûr, il est nécessaire que la profession d’avocat s’adapte au monde, …

… mais je rappelle que la commission Darrois a été installée précisément pour examiner cet important sujet. Franchement, si j’étais à la place de M. Darrois, je démissionnerais ! Vous proposez des mesures alors que la commission qu’il préside n’a pas encore rendu ses conclusions. Il y a tout de même de quoi s’interroger !
J’ajoute que, malheureusement, du fait de leur spécialisation, beaucoup d’avocats parisiens subissent la crise de plein fouet, peut-être plus que leurs confrères de province. Il est clair que des cabinets vont se retrouver en faillite, que cela va se traduire par des licenciements en nombre. Et, au même moment, vous leur imposez cette fusion !
À mes yeux, il ne s’agit pas ici d’un clivage entre la majorité et l’opposition. C’est pourquoi je voterai les amendements n° 4 et 31. Comme M. Sutour, je considère qu’il est prématuré de légiférer sur ce point. Attendons au moins les conclusions de la commission Darrois !

Je tiens simplement à apporter une précision : le Conseil national des barreaux s’est prononcé à une majorité de 75 % !

La position du groupe socialiste ne consiste pas à rejeter a priori cette fusion, même si certains de ses membres y sont effectivement hostiles. Ce que nous pensons avant tout, c’est que, en l’occurrence, le Sénat travaille mal.
En effet, aux vingt-six articles que comptait à l’origine la proposition de loi de notre collègue Laurent Béteille, la commission propose d’en ajouter vingt-quatre, qui touchent des questions aussi importantes que la convention de procédure participative ou la fusion de la profession d’avocat et de conseil en propriété industrielle.
On nous explique que la commission travaille sur cette fusion depuis de nombreuses années. Cependant, nous savons qu’il existe par ailleurs une commission Darrois qui travaille sur la réforme de la profession d’avocat, mais qu’elle n’a pas rendu ses conclusions, qu’elle aurait dû les rendre, mais que, le Président de la République ayant formulé certaines propositions sur la modification de la procédure d’instruction, elle n’a pas pu les rendre...
Notre collègue Yves Pozzo di Borgo, qui ne peut pas être suspecté…

… de quoi que ce soit ! Il ne fait que son travail de parlementaire ! Son intervention prouve que cette question n’a pas recueilli un consensus, contrairement à ce qu’a indiqué M. le rapporteur, qui a du reste reconnu que l’on allait un peu vite.
Pour notre part, nous voulons prendre le temps de bien travailler, en procédant à des auditions et en approfondissant certains sujets, afin que nous puissions nous prononcer sur un texte sérieux.
Franchement, je vous enjoins, mes chers collègues, d’accepter notre proposition de supprimer les articles 31 à 50, car nous pourrions ainsi poursuivre notre travail de réflexion en toute sérénité. L’exercice de notre mission d’élaboration de la loi ne pourrait qu’y gagner en sérieux et en efficacité. Ne pensez pas comme M. le rapporteur, ne considérez pas que ce n’est pas grave si ce texte est un peu boiteux, s’il n’est pas très clair puisque la navette parlementaire permettra d’en améliorer la rédaction !

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, qui est en quelque sorte le « père du début », pour explication de vote.
Sourires
Nouveaux sourires.

Effectivement, monsieur le président, il a été répété à plusieurs reprises que l’on était passé de vingt-six articles à cinquante articles. Pour ma part, je m’en réjouis, car je pense que ces nouveaux articles constituent des apports utiles.
Sans doute certains cabinets ou certaines associations peuvent-ils sembler réticents, mais, disons-le clairement, c’est surtout parce qu’ils ont un peu peur du changement. Pour avoir rencontré des représentants des deux professions concernées, moi, je puis vous dire qu’une forte majorité s’est exprimée en faveur de la fusion. C’est le sens de l’histoire, et cette fusion est extrêmement importante si l’on veut défendre la place de notre droit en matière de propriété intellectuelle et industrielle par rapport aux droits étrangers et aux juridictions étrangères.

Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.

Mes chers collègues, les scrutateurs m’informent qu’il y a lieu d’effectuer un pointage ; je vais donc suspendre la séance le temps d’y procéder.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures vingt-cinq, est reprise à dix-sept heures quarante-quatre.

La séance est reprise.
Voici, après pointage, le résultat du dépouillement du scrutin n°114 :
Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 32.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n°115 :
Nombre de votants341Nombre de suffrages exprimés340Majorité absolue des suffrages exprimés171Pour l’adoption199Contre 141Le Sénat a adopté.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce bureau secondaire peut être tenu par un avocat salarié inscrit au barreau où se trouve ce bureau. » –

L'amendement n° 5, présenté par M. Sutour et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Simon Sutour.

Monsieur le président, compte tenu du vote qui vient d’avoir lieu, ayant déjà exposé mes arguments, je ne peux que retirer cet amendement de coordination, de même que tous ceux qui suivent et qui tendaient à la suppression des articles 34 à 50


M. Simon Sutour. Monsieur le président, il s’agit non de complaisance, mais de compréhension !
Sourires
L'article 33 est adopté.
Au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « l'article 11 » sont insérés les mots : « et du dernier alinéa de l'article 13 ». –
Adopté.
L'article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux titulaires du diplôme délivré par le centre d'études internationales de la propriété intellectuelle ayant réussi l'examen européen de qualification organisé par l'Office européen des brevets. » –
Adopté.
L'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un ou plusieurs centres régionaux de formation professionnelle sont habilités par le Conseil national des barreaux à organiser une formation spécifique, dont le contenu est déterminé par décret en Conseil d'État, pour les personnes titulaires du diplôme délivré par le centre d'études internationales de la propriété intellectuelle. » –
Adopté.
Dans le premier alinéa de l'article 42 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « nouvelle profession d'avocat, », sont insérés les mots : « y compris les avocats ayant exercé la profession de conseil en propriété industrielle, mais ». –
Adopté.
L'article 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les obligations de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès, sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de la loi n°... du ... ou ayant exercé avant cette date la profession de conseil en propriété industrielle, soit à titre individuel soit en groupe, ainsi que leurs ayants droit.
« Les obligations de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de l'association générale de retraite des cadres et de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la Caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... ou ayant exercé avant cette date la profession de conseil en propriété industrielle en qualité de salarié d'un autre conseil en propriété industrielle, ainsi que leurs ayants droit. » –
Adopté.
L'article 46 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 46. - Les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants, quel que soit le mode d'exercice de la profession d'avocat.
« La convention collective nationale de l'avocat salarié et ses avenants s'appliquent aux anciens conseils en propriété industrielle devenus avocats salariés.
« Tous les salariés des anciens conseils en propriété industrielle devenus avocats conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis à la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du ... ». –
Adopté.
L'article 46-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :
1° Après les mots : « nouvelle profession d'avocat », sont insérés les mots : «, y compris celui des avocats ayant exercé la profession de conseil en propriété industrielle, » ;
2° Les mots : «, à compter de la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, » sont supprimés. –
Adopté.
Au troisième alinéa de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les références : « 56, 57 et 58 » sont remplacés par les références : « 56, 57, 58 et 62 ». –
Adopté.
Au début de l'article 58 de la loin° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : « Les juristes d'entreprise exerçant » sont remplacés par les mots : « Les juristes d'entreprise et les salariés intervenant dans le domaine de la propriété intellectuelle qui exercent ». –
Adopté.
L'article 62 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 62 - Les mandataires agréés devant les offices européen ou communautaire de propriété industrielle peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé aux seules fins de représentation dans les procédures devant ces offices, et notamment celle prévue à l'article 133 de la convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973. » –
Adopté.
L'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa (5°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Des ressortissants établis dans un État membre de la Communauté européenne ou des ressortissants d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, exerçant une activité en lien avec l'objet social de la société en qualité de professionnels libéraux soumis à un statut législatif ou réglementaire ou en vertu d'une qualification nationale ou internationale reconnue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État selon les nécessités propres de chaque profession. » ;
2° Au huitième alinéa, les références : « au 1° et au 5° » sont remplacées par les références : « au 1°, au 5° et au 6 ». –
Adopté.
Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, les références : « 2°, 3° et 5 » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 5° et 6 ». –
Adopté.
Le titre II du livre IV de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Titre II
« Conseil, assistance et représentation en matière de propriété intellectuelle
« Art. L. 421-1. - Nul ne peut conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété intellectuelle, s'il n'est avocat ou ne satisfait aux conditions posées par le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« Art. L. 421-2 - Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire d'avocats.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet État.
« Art. L.421-3. - Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle publie annuellement la liste des avocats titulaires de la mention de spécialisation prévue en matière de propriété intellectuelle par les dispositions prises pour l'application du 10° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée avec la mention du nom, du lieu d'exercice professionnel et du barreau d'appartenance.
« Cette liste est publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle.
« Art. L. 421-4. - Sera puni des peines prévues à l'article 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée quiconque se sera livré au démarchage en vue de représenter les intéressés, de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière de droit de la propriété intellectuelle.
« Seules peuvent se prévaloir du titre de conseil en propriété industrielle, à la condition de le faire précéder de la mention « ancien », les personnes qui ont été inscrites sur la liste prévue à l'article L. 422-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°... du ...
« Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en brevets ou de conseil en marques ou d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion.
« Toute personne, autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qui aura fait usage de l'une des dénominations visées aux deuxième et troisième alinéas, sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal. » –
Adopté.
L'article 48 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre d'un conseil en propriété industrielle avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° ... du ..., ou postérieurement à cette date en application du présent article. » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pouvoirs disciplinaires de la Chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, supprimée par la loi n° du ..., sont prorogés à l'effet de statuer sur les procédures pendantes devant elles au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Les procédures engagées à compter de cette date sont de la compétence du conseil de discipline prévu à l'article 22 de la présente loi, quelle que soit la date des faits poursuivis. Toutefois, seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits. Les sanctions prononcées par la Chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle dans les instances en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi n °... du ... sont communiquées par son président au bâtonnier de l'ordre dont dépend la personne sanctionnée. » ;
3° Au dernier alinéa, après le mot : « cassation » sont insérés les mots : «, ainsi que les juridictions administratives, ». –
Adopté.
L'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« VII. - Les personnes qui n'exercent pas la profession de conseil en propriété industrielle mais qui sont inscrites au jour de l'entrée en vigueur de la loi n°... du ... sur la liste prévue à l'article L. 422-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, peuvent dans le délai d'un an suivant cette date demander leur inscription au tableau de l'ordre des avocats, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.
« Dans toutes les procédures initiées pendant le même délai, ces personnes peuvent continuer à représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-2 du code de la propriété intellectuelle, dans les cas prévus par cet alinéa.
« VIII. - Les personnes qui n'exercent pas la profession de conseil en propriété industrielle mais qui sont inscrites au jour de l'entrée en vigueur de la loi n°... du ... sur la liste prévue à l'article L. 421-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, peuvent à tout moment demander leur inscription au tableau de l'ordre des avocats, avec la mention de spécialisation prévue en matière de propriété intellectuelle, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État.
« IX. - Les personnes inscrites ou en cours de formation au sein du centre d'études internationales en propriété intellectuelle à la date d'entrée en vigueur de la loi n°... du ... et les titulaires du diplôme délivré par cet établissement en cours de période de pratique professionnelle en vue de leur inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, poursuivent leur formation selon les modalités prévues avant cette entrée en vigueur.
« Elles peuvent, dès lors qu'elles ont accompli avec succès cette formation, demander leur inscription au tableau de l'ordre des avocats, en étant dispensées de la formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. » –
Adopté.
Les sociétés civiles et les sociétés de personnes de conseil en propriété industrielle constituées selon le droit commun et exerçant en conformité avec les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent, dans un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, se mettre en conformité soit avec la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, soit avec la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
Les sociétés de capitaux ayant pour objet social l'exercice de l'ancienne profession de conseil en propriété industrielle en conformité avec les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent, dans un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, se mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
En outre, les dérogations prévues par le e) de l'article L. 423-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et par le décret pris pour son application continuent de s'appliquer pendant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, à l'issue d'un délai de trois années à compter de cette entrée en vigueur, les sociétés concernées devront n'offrir que des prestations compatibles avec l'exercice de la profession d'avocat. –
Adopté.
Les anciens conseils en propriété industrielle devenus avocats en application de l'article 32 de la présente loi peuvent continuer à bénéficier, durant un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, des dispositions prévues aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur. –
Adopté.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Les articles 7, 8 et 9 de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. –
Adopté.
CHAPITRE XI
ENTRÉE EN VIGUEUR
Les articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
L'article 12 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à son application et au plus tard le 1er janvier 2010.
L'article 31 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à son application et au plus tard le 1er janvier 2010.
Les articles 32 à 50 de la présente loi entrent en vigueur le 1er septembre 2010 –
Adopté.

Avant de mettre aux voix les conclusions modifiées de la commission des lois sur la proposition de loi, je donne la parole à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour explication de vote.

La proposition de loi de notre collègue Laurent Béteille, dont nous venons d’achever l’examen, contribue indéniablement à améliorer le fonctionnement du service public de la justice, dans l’intérêt de toutes les parties.
En effet, elle facilite les procédures, améliore l’exécution des décisions de justice et renforce les moyens des juridictions et des auxiliaires de justice.
Sur l’initiative du rapporteur, François Zocchetto, que je tiens à féliciter au nom de l’ensemble de mes collègues du groupe UMP, le Sénat va aujourd’hui adopter deux réformes modernes et ambitieuses qui concernent directement les avocats.
La première consiste à instaurer une procédure participative de négociation assistée par avocat. Il s’agit d’une formidable innovation pour notre système juridique et judiciaire, dans lequel les parties à un différend ne sont pas incitées à négocier et préfèrent souvent, par réflexe, aller en justice.
La seconde vise à organiser la fusion des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle, fusion qui constituera, à notre sens, un instrument essentiel au service du renforcement de la compétitivité des professionnels français face à la concurrence étrangère. Elle contribuera, en effet, à dynamiser la recherche et à créer dans les entreprises une véritable culture de la propriété intellectuelle.
Au total, cette proposition de loi nous permet de franchir une nouvelle étape, pour faire en sorte que notre justice soit plus moderne et plus proche des justiciables. Nous faisons donc aujourd’hui œuvre utile. La commission des lois a démontré, une fois encore, sa volonté constante et sa capacité d’améliorer l’efficacité de notre justice.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe UMP adoptera les conclusions de la commission des lois sur l’excellente proposition de loi de notre collègue Laurent Béteille, dont je salue l’initiative législative.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Au terme de ce long débat, un malaise subsiste.
J’insiste sur le fait que l’« enfant » de M. Béteille, c'est-à-dire sa proposition de loi, qui comportait initialement vingt-six articles, en comprend aujourd’hui cinquante-deux. En vérité, ce sur quoi nous sommes maintenant appelés à nous prononcer aurait dû, de notre point de vue, faire l’objet de deux textes distincts : la convention de procédure participative, d’un côté, la fusion de la profession d’avocat et de celle de conseil en propriété industrielle, de l’autre.
En commission, M. le rapporteur nous avait assuré que les dispositions relatives à cette fusion pouvaient sans difficulté être ajoutées à ce texte dans la mesure où la question était parfaitement « mûre », où elle faisait l’objet d’un consensus, et que cela permettait donc de gagner du temps. On nous avait même fourni comme argument suprême que le Gouvernement voulait procéder par ordonnance et que, finalement, il valait mieux que le Parlement légifère, mais sans modifier une seule virgule ! Pour ma part, j’ai trouvé cet argument un peu curieux.
On nous avait annoncé également que toutes les professions concernées étaient acquises au texte, qu’elles attendaient son adoption et que la commission Darrois était sur le point de proposer de telles évolutions. Finalement, elle ne l’a pas fait, sa réflexion s’inscrivant désormais, depuis le mois de janvier, dans un nouveau contexte.
M. le rapporteur nous avait en outre indiqué que la navette parlementaire permettrait de toute façon d’améliorer un texte quelque peu approximatif.
En fin de compte, dans tout cela, le plus ennuyeux, c’est que, s’agissant d’une initiative parlementaire, nous ne donnons pas l’image d’un travail sérieux, approfondi et abouti. En effet, comme notre collègue Yves Pozzo di Borgo l’a fait remarquer tout à l’heure, les dispositions en question sont loin d’être aussi bien ficelées qu’on l’a prétendu.
Nous considérons par conséquent que, sur le fond, le Sénat n’a pas véritablement tranché. En tout cas, puisque nous n’avons pas obtenu que les articles relatifs à la fusion des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle, qui ont été ajoutés par la commission, soient supprimés, ce qui nous aurait permis d’y réfléchir plus avant, nous voterons, à regret, contre ce texte.

Je l’ai dit dès le départ, je voterai contre ce texte, et pour des raisons de fond – je pense notamment à la convention de procédure participative – et parce que cette proposition de loi « pioche » dans des rapports qui ne sont pas encore achevés.
La façon dont a été « arrachée », à la dernière minute, la fusion des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle me paraît tout de même assez préoccupante, et significative de la manière dont on entend traiter certaines questions.
Le fait que notre assemblée soit partagée sur ces articles témoigne malgré tout d’un certain malaise, dont l’origine tient peut être aussi bien à la forme qu’au fond. Je ne suis pas dans la tête de tous ceux qui ont voté les amendements de suppression de l’article 32… Nos collègues ont-ils souhaité adopter des amendements « « suspensifs », leur permettant d’attendre d’être mieux informés ou d’avoir approfondi la question ? Quoi qu’il en soit, la réponse qui a été apportée ne renvoie pas une bonne image du travail du législateur. Bien sûr, la majorité, c’est la moitié plus un, mais quand le « plus un » est obtenu de cette façon, il est légitime de se poser certaines questions.
Je confirme donc mon vote contre le texte qui nous est soumis, tout en avouant une certaine amertume quant à la manière dont nous avons été, encore une fois, mis devant le fait accompli.

Les arguments des différents orateurs comme les votes ont révélé la complexité de cette affaire de fusion des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle.
Au risque de me répéter, je pense que c’est un mauvais coup porté aux PME, qui ont un besoin essentiel de la profession de conseil en brevets.
Réfléchissez un instant, mes chers collègues, à la formation qui sera exigée de ces professionnels. Après quatre ou cinq ans d’études supérieures d’ingénieur, ils devront suivre pendant deux ans, à Strasbourg, les enseignements du Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle, puis encore se spécialiser en droit pendant trois ou quatre ans : soit une dizaine d’années d’études au total. Mieux vaut devenir chirurgien orthopédique ou radiologue ! La longueur excessive des études risque de décourager les jeunes Français de s’engager dans cette carrière.
La mécanique mise en route va, de fait, aboutir à la disparition de la partie « ingénieur » de cette profession, qui deviendra exclusivement juridique. Je pense qu’une telle évolution sera néfaste pour l’innovation et la recherche françaises, et qu’elle nous fera perdre des positions par rapport aux autres pays européens, à l’heure où la France a tant besoin d’en gagner.

Je tiens d’abord à remercier le rapporteur et le président de la commission des lois d’avoir enrichi ma proposition de loi et d’avoir, pour l’essentiel, validé ma démarche. Je remercie également, bien sûr, le Sénat de les avoir suivis.
Cette proposition de loi porte sur l’exécution des décisions de justice et sur les conditions d’exercice des professions réglementées.
La bonne exécution des jugements fait partie intégrante du droit à un procès équitable tel qu’il est garanti par la Cour européenne des droits de l’homme. En renforçant les procédures d’exécution des jugements rendus, nous améliorons l’exercice de ce droit.
Dans le domaine des conditions d’exercice des professions réglementées, vous avez, mes chers collègues, approuvé l’essentiel de mes propositions. Je regrette néanmoins que l’article 2 ait été supprimé. Je pense qu’il s’agit d’une méprise, car cet article de clarification, dont la rédaction avait été fortement améliorée par la commission, n’avait rien de révolutionnaire et se contentait de préciser que les constats d’huissier font foi jusqu’à preuve du contraire. J’espère donc que nous aurons l’occasion d’y revenir dans la suite du processus parlementaire.
Pour le reste, je pense que nous faisons œuvre utile et je veux, une fois encore, dire ma gratitude à la commission des lois, à son président et à son rapporteur.

Compte tenu de l’évolution qu’a connue ce texte au cours des débats, la majorité du groupe du RDSE ne le votera pas.
S’il présente des aspects positifs, notamment en matière d’organisation des professions, nous considérons qu’il favorise une déjudiciarisation à laquelle nous sommes, par principe, très opposés.
Sur la fusion entre les conseils en propriété industrielle et les avocats, nous n’avons pas, en l’état, de position tranchée, mais, étant donné les problèmes qui restent à élucider, nous aurions préféré que le débat se poursuive.
En ce qui concerne la procédure participative, nous avons émis un certain nombre de réserves et les réponses que nous avons obtenues ne me paraissent pas satisfaisantes, notamment pour les petits litiges.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les conclusions modifiées de la commission des lois sur la proposition de loi n° 31, relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 116 :
Le Sénat a adopté.

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.
La liste des candidats établie par la commission des affaires économiques a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jean-Paul Emorine, Dominique Braye, Philippe Dallier, Mme Brigitte Bout, MM. Daniel Dubois, Daniel Raoul, Thierry Repentin.
Suppléants : MM. Gérard Cornu, Philippe Darniche, François Fortassin, Pierre Hérisson, Jean-Claude Merceron, Jackie Pierre, Mme Odette Terrade.

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à supprimer les conditions de nationalité qui restreignent l’accès des travailleurs étrangers à l’exercice de certaines professions libérales ou privées, présentée par Mme Bariza Khiari et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (nos 176, 197).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme Bariza Khiari, auteur de la proposition de loi.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi que je vous présente aujourd’hui traite d’une problématique souvent méconnue mais qui n’a rien d’anecdotique. Elle s’inscrit dans la droite ligne de la loi du 30 janvier 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la HALDE. À l’époque, cette loi avait bénéficié de l’unanimité dans les rangs sénatoriaux, ce qui prouve l’importance de ces questions et le consensus qu’elles suscitent.
De fait, on a généralement connaissance des restrictions à l’emploi fondées sur des questions de validité du diplôme présenté, mais on ignore fréquemment qu’il en existe d’autres, liées à la seule nationalité de l’intéressé, dans la mesure où il doit être Français pour pouvoir prétendre travailler.
On peut comprendre les premières restrictions : elles visent à protéger les citoyens en ouvrant certaines professions aux seules personnes qui ont suivi une formation conforme à celle que suivent nos propres étudiants se destinant à l’exercice des métiers considérés. La deuxième catégorie de restrictions laisse en revanche plus circonspect, tant leur justification paraît davantage sujette à caution.
Certes, il semble légitime de réserver aux nationaux les emplois touchant à la sécurité du pays ou à l’exercice des prérogatives de la puissance régalienne. Mais, dans la pratique, bien d’autres professions sont concernées par ce principe qui, en l’occurrence, paraît peu compréhensible.
Ce texte vise donc à mettre un terme à une situation ubuesque dans laquelle les conditions de nationalité ne sont pas l’apanage des professions publiques ou en lien avec l’exercice de la puissance publique, mais concernent des secteurs variés qui n’appellent nullement une telle restriction.
Il ne s’agit donc en aucun cas de porter atteinte à la condition de diplôme, mais de limiter celle de nationalité aux cas où elle semble appropriée. En d’autres termes, il s’agit de légiférer dans un souci de meilleure intégration des populations étrangères qualifiées vivant sur notre territoire.
On ne saurait en effet nier le caractère daté de cette législation restrictive, qui rappelle des heures malheureuses de xénophobie et d’intolérance, et à laquelle la République se doit donc de mettre un terme. Les fondements de ces restrictions sont historiquement connotés, économiquement obsolètes et moralement condamnables. La plupart des textes régissant ces limitations furent en effet adoptés dans la période de l’entre-deux guerres, lorsque montaient les tensions entre différents pays. Aujourd’hui, plus rien ne sous-tend désormais ces lois désuètes qui font honte à nos principes républicains.
Plusieurs principes fondent en effet cette proposition de loi. Elle s’inscrit, tout d’abord, dans la continuité de la lutte contre les discriminations et la promotion de la diversité. Elle vise, ensuite, à restaurer la valeur du diplôme, fondement même de notre régime méritocratique. Elle s’attache, enfin, à simplifier le droit en réduisant les procédures administratives, de manière à faciliter les relations entre l’administration et les usagers, objectif à valeur constitutionnelle.
Je reviens sur chacun de ces points.
La République ne récuse pas la différence. Bien au contraire, dès la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, texte sacré s’il en est, est affirmé le droit de chacun de penser comme il l’entend et de sortir du lot. Au fondement de nos institutions se trouve l’idée que, si chacun est différent, nous partageons tous un fond commun qui soutient le vivre-ensemble sur lequel notre régime s’appuie et qu’il tente de préserver chaque jour à travers le pacte républicain. La lutte contre les discriminations se situe dans cette perspective ; elle en constitue même la clé de voûte.
De fait, toute discrimination, parce qu’elle fait primer la différence, mine le vivre-ensemble en renvoyant chacun à sa particularité. Quand on incite à opérer une distinction entre nationaux et étrangers, on renvoie ces derniers à leur condition première, faisant par là même obstacle à leur intégration dans la société. Ils ont ainsi l’impression que la France ne veut pas d’eux, qu’elle cherche à leur fermer de multiples portes et de rendre plus difficile leur existence sur le territoire.
Alors que les étrangers sont, de manière générale, déjà en partie marginalisés du fait de l’absence de connaissances, d’amis, de famille et de réseau sur notre territoire, ils voient leur situation s’aggraver par une relégation supplémentaire du fait de la loi. Nous savons tous que la République vit à l’ombre de ses réseaux. Doit-on pénaliser davantage ceux qui n’en disposent pas ? Quand la société devrait faciliter leur intégration, elle semble au contraire multiplier les freins à cette dernière.
Si la loi invite à opérer une distinction entre discriminations et restrictions du fait de la nationalité, constatons que, dans la réalité, les secondes ne sont pas sans effet sur les premières, qu’elles tendent à les légitimer par effet de système. De fait, les restrictions légales influent sur les discriminations, paraissant les encourager.
Ainsi, les dispositions que nous tenons, par la présente proposition de loi, à abroger ont un double effet négatif : elles minent le lien social qui devrait être créé entre les populations étrangères et la communauté française tout en incitant indirectement à la perpétuation de discriminations illégales.
Par leur suppression, nous rappellerons l’exigence républicaine de lutte contre les discriminations, de promotion de la diversité, qui fait la richesse de notre territoire, de notre culture et de notre société. Il s’agit d’un engagement solennel pour mettre au premier plan les valeurs essentielles qui fondent notre pays.
Le texte que nous vous proposons aujourd’hui tend à défendre aussi la valeur du diplôme.
Notre République s’est bâtie, depuis sa création, sur l’idée de méritocratie. Tout homme doit pouvoir, par son mérite personnel, s’élever au-dessus de la condition de ses parents et atteindre un statut social enviable. S’il apprend, s’il travaille avec ardeur, nos universités lui délivrent un diplôme, synonyme de prestige social, pourvu d’une valeur intrinsèque et respecté en tant que tel. Non seulement les universités, mais aussi les grandes écoles reposent sur cette notion même de méritocratie, de valeur du titre délivré.
Or l’existence de restrictions liées à la nationalité du détenteur du diplôme met gravement à mal la valeur de ce titre, qui semble perdre son caractère absolu et incontestable au profit d’une nature subjective.
Notre système repose sur le fait que le diplôme confère une qualité à celui qui le détient et qu’il suffit en lui-même pour établir l’aptitude de son titulaire à occuper une fonction. Comment justifier, dès lors, qu’un même diplôme n’octroie pas les mêmes droits suivant que l’on est français ou non ? Cela reviendrait à dire que la valeur du diplôme varie avec la qualité juridique de son détenteur. Il s’agit là d’un grave contresens sur nos principes.
Certes, des procédures dérogatoires existent pour permettre aux personnes étrangères titulaires d’un diplôme français d’exercer dans notre pays. Toutefois, il s’agit d’une décision discrétionnaire du ministre concerné. Or, à bien y réfléchir, cette procédure lourde et longue est loin de constituer une solution de repli, tant elle prend un caractère humiliant pour celui qui s’y engage. Alors que le diplôme devrait en lui-même garantir la qualité professionnelle de la personne qui le détient, celle-ci voit la possibilité d’exercer l’emploi auquel elle se prépare soumise à la décision d’une personne tierce n’ayant aucun lien avec le monde universitaire.
Il s’agit là d’une nouvelle entorse au statut du diplôme, qui est d’autant moins acceptable qu’elle contient une part d’arbitraire en raison de son caractère discrétionnaire. J’ajoute que la plupart des décisions ministérielles sont positives ; aussi cette procédure fastidieuse revient-elle de plus en plus fréquemment à perpétuer un droit superfétatoire.
Je vous propose donc de mettre un terme à cette dérogation en replaçant le diplôme au cœur du processus d’exercice d’un emploi, place qu’il n’aurait jamais dû quitter.

Plus encore, la réglementation européenne invite désormais à reconnaître comme ayant une valeur équivalente à celle des diplômes nationaux les diplômes des ressortissants communautaires délivrés par les universités de leur pays d’origine et à leur assurer la liberté d’exercice de la fonction à laquelle leur diplôme ouvre droit.
Le principe de cette directive est louable. Cependant, force est de constater qu’elle accentue encore les désavantages dont souffrent les ressortissants des pays tiers. En effet, avec ce système, il devient plus aisé à un membre d’un État de l’Union européenne titulaire d’un diplôme de son pays d’exercer qu’à un étranger vivant sur notre territoire et titulaire d’un diplôme français. Cela n’est plus acceptable.
Au-delà des deux fondements de notre régime que sont la lutte contre les discriminations et le caractère absolu du diplôme, cette proposition de loi s’appuie sur un troisième élément non moins essentiel : la nécessité de simplifier notre droit et de limiter la pesanteur administrative.
Nombre de rapports ont d’ores et déjà souligné la croissance extravagante du droit dans notre pays, qui tend à perdre de sa nécessité et de sa force à mesure qu’il touche de manière plus fréquente à des sujets variés. Beaucoup fustigent un droit bavard, qui s’immisce là où cela est le moins nécessaire, qui devient instable parce que sans cesse modifié.
La présente proposition de loi tend, à sa modeste échelle, à simplifier le droit en supprimant, autant que faire se peut, la procédure dérogatoire. Elle répond en cela à un objectif à valeur constitutionnelle : celui d’une meilleure lisibilité de la loi pour les citoyens et d’une meilleure relation entre l’administration et les usagers.
Je tiens à remercier Charles Gautier, rapporteur de la commission des lois, de son excellent rapport et des améliorations dont, à la suite des auditions qu’il a conduites, il a enrichi la rédaction initiale de ma proposition de loi.
Je proposerai malgré tout quelques amendements qui, tout en respectant la philosophie du texte adopté en commission, tendent à en simplifier le contenu et à exclure de son champ d’application certaines professions au statut particulier, comme les pharmaciens. En effet, nous avons considéré que les extracommunautaires bénéficiaient déjà de certains droits leur permettant d’exercer cette profession, par ailleurs soumise à un numerus clausus très restrictif s’agissant des ouvertures d’officines.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir adopter cette proposition de loi et les amendements d’amélioration que je vous proposerai. Par un tel vote, le Sénat permettra à notre législation d’accomplir une avancée non seulement symbolique mais encore tout à fait concrète dans la lutte contre les discriminations, en même temps qu’il rétablira le diplôme dans son essence, celle d’un document ouvrant des droits à une personne qu’on a jugée digne, sans considération aucune de son ethnie, de sa religion, de ses convictions politiques, de sa nationalité, d’exercer une fonction donnée.
La République s’honorera ainsi d’avoir, quoique tardivement, retrouvé les valeurs qui étaient les siennes et qui n’auraient jamais dû cesser d’être siennes.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC-SPG, du RDSE et de l’Union centriste.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission des lois a donc été saisie de cette proposition de loi visant à supprimer les conditions de nationalité qui restreignent l’accès des travailleurs étrangers à l’exercice de certaines professions libérales ou privées, présentée par notre collègue Bariza Khiari et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Il existe de nombreuses professions dont l’accès est difficile ou impossible aux étrangers. Citant plusieurs études, l’exposé des motifs de la proposition de loi indique qu’« au total, près de sept millions d’emplois [...] seraient interdits partiellement ou totalement aux étrangers, soit 30 % de l’ensemble des emplois ».
Qu’en est-il de la législation en la matière ?
Deux niveaux de restriction peuvent être distingués : la condition de diplôme et la condition de nationalité.
La condition de nationalité est celle dont l’effet est le plus direct sur l’accès à certaines professions. Le plus souvent, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen n’y sont pas soumis.
La condition de nationalité est également assouplie pour certaines professions par la condition de réciprocité.
S’agissant de la condition de diplôme et de formation, en vertu de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la plupart des diplômes délivrés par les États de l’Union européenne pour l’exercice de professions comparables permettent également de satisfaire à la condition de diplôme en France.
Les emplois fermés aux étrangers se dénombrent avant tout dans le secteur public. Les emplois de titulaires dans les trois fonctions publiques – d’État, hospitalière et territoriale – sont interdits aux étrangers non communautaires et représentent près de 5, 2 millions d’emplois.
Il existe une cinquantaine de professions du secteur privé faisant l’objet de restrictions explicites liées à la nationalité. Or certaines de ces restrictions ont une pertinence réellement discutable.
Comme le disait à l’instant Mme Khiari, l’histoire de l’instauration des conditions de nationalité montre que celles-ci sont apparues pour l’essentiel à partir de la fin du XIXe siècle, et particulièrement au cours de l’entre-deux-guerres, dans un contexte de crise économique et de tensions internationales. Maintenues après la Libération, la plupart de ces conditions de nationalité demeurent très connotées et datées.
Dans les faits, les règles sont souvent contournées. Ainsi, des étrangers non communautaires exercent également au sein des fonctions publiques, par exemple des professeurs ou des médecins. S’agissant des professions libérales, leurs statuts contiennent le plus souvent des procédures permettant, au cas par cas, d’admettre des étrangers non communautaires au sein de l’ordre concerné.
De plus, en vertu d’une obligation communautaire, la libre circulation des travailleurs a conduit la fonction publique française à réduire la portée de la condition de nationalité prévue à l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Ce mouvement d’ouverture aux ressortissants communautaires a également été accompli pour la plupart des professions réglementées. Même certaines professions comportant l’exercice de prérogatives de puissance publique ne sont plus réservées à des ressortissants français. L’influence du droit communautaire s’étend d’ailleurs aux ressortissants extracommunautaires.
Cette proposition de loi répond à deux objectifs : lutter contre les discriminations et aller vers une simplification administrative.
La suppression de la condition de nationalité représenterait une contribution importante à la lutte contre les discriminations. Il est vrai que, si le taux de chômage plus élevé des étrangers est souvent utilisé pour illustrer les faiblesses de l’intégration, la fermeture de millions d’emplois à ces derniers n’est pas de nature à changer la situation. Elle en est même certainement une des causes.
On peut ajouter l’argument de simplification administrative.
Sans prétendre à l’exhaustivité, la présente proposition de loi répond à ces observations en supprimant la condition de nationalité pour l’exercice de certaines professions réglementées.
Après avoir entendu des représentants de l’ensemble des professions concernées par la proposition de loi, je me suis attaché à vérifier, profession par profession, si des motivations légitimes pouvaient justifier le maintien d’une condition de nationalité.
Tout en étant consciente de l’affaiblissement des raisons expliquant l’instauration de conditions de nationalité dans de nombreux métiers au cours du siècle passé, la commission a souhaité examiner isolément la situation de chacune des dix professions visées par la proposition de loi. Des représentants de chaque profession concernée ont été entendus. Seul le conseil national de l’Ordre des pharmaciens n’a pu se rendre à l’invitation de la commission. Néanmoins, celui-ci lui a transmis une contribution écrite.
Sans entrer dans le détail de chaque profession, je dois dire que la commission a estimé de manière générale qu’il convenait d’appliquer le principe selon lequel, à diplôme égal, un étranger non communautaire doit pouvoir exercer lesdites professions dans les mêmes conditions que les ressortissants français ou communautaires.
Parmi les principales réserves, l’absence de condition de réciprocité a été plusieurs fois évoquée. Si cet argument ne peut être négligé, il n’apparaît pas déterminant.
En premier lieu, comme le relève le rapport du groupe d’étude et de lutte contre les discriminations de mars 2000, « l’application du principe de l’égalité de traitement entre les ressortissants de différents pays peut s’exonérer des relations ou des accords d’État à État ». Au demeurant, il est très probable que des professions qui ne sont pas réglementées en France le sont dans certains États tiers. Cela n’implique pas que ces professions soient fermées aux ressortissants de ces pays en France.
En deuxième lieu, il ne semble pas que toutes les professions concernées par la proposition de loi se soient réellement engagées dans une démarche active visant à conclure des accords de réciprocité. L’argument selon lequel la condition de réciprocité est une monnaie d’échange pour contraindre les États tiers à s’ouvrir aux professionnels français ne va d’ailleurs pas de soi. Au contraire, en abandonnant la réciprocité, on prive les États tiers d’un prétexte pour refuser l’ouverture aux professionnels français.
En troisième lieu, la proposition de loi et les modifications adoptées par notre commission ne visent que la condition de nationalité, les conditions de diplôme restant inchangées. Ainsi, il semble difficile de refuser l’égalité de traitement à un étranger titulaire d’un diplôme français pour la seule raison que son État d’origine refuse de reconnaître le diplôme français.
En réalité, la condition de réciprocité ne se justifie que dans le cas de professions soumises à une concurrence internationale intense. C’est la raison pour laquelle la commission des lois a supprimé l’article 3, relatif aux avocats.
Une autre réserve a porté sur les professions soumises à un numerus clausus, professions médicales et vétérinaires en particulier.
Les ressortissants non communautaires titulaires d’un diplôme étranger permettant d’exercer en France n’étant pas soumis aux contraintes du numerus clausus, il pourrait en résulter une forme de discrimination à rebours au préjudice des étudiants français.
Si cette observation n’est pas sans fondement, elle ne doit pas non plus être exagérée et justifier une fermeture de l’accès à ces professions aux ressortissants non communautaires.
Tout d’abord, force est de constater que le numerus clausus est d’ores et déjà largement battu en brèche, d’une part, par des Français qui effectuent leurs études dans d’autres pays de l’Union européenne et, d’autre part, par des ressortissants communautaires qui peuvent s’établir en France librement dès lors qu’ils possèdent un diplôme les autorisant à exercer dans leur pays.
En outre, il faut le rappeler afin de lever toute ambiguïté, l’ouverture de ces professions réglementées aux ressortissants non communautaires ne signifie pas que tout étranger titulaire du diplôme exigé aurait un droit à exercer en France. La législation sur l’entrée, le séjour et le travail des étrangers en France s’applique indépendamment des règles particulières à telle ou telle profession.
En conséquence, sous réserve de plusieurs coordinations, la commission a adopté les articles 1er, 2, 4, 5 et 6 de la proposition de loi, devenus respectivement les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du texte qui est maintenant soumis au Sénat.
Elle a, en revanche, supprimé l’article 3 pour les raisons décrites précédemment, ainsi que l’article 7, relatif aux conférenciers nationaux et guides interprètes, cet article étant privé d’objet.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission vous invite, mes chers collègues, à adopter la proposition de loi dans la rédaction qu’elle a élaborée.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat examine aujourd’hui une proposition de loi visant à supprimer les conditions de nationalité concernant l’accès à l’exercice de certaines professions libérales.
Comme l’indique le rapport de M. Charles Gautier, les auteurs de cette proposition de loi ont le grand mérite de provoquer une réflexion générale sur la pertinence du maintien dans notre droit positif de règles qui imposent d’être ressortissant communautaire pour accéder à certaines professions libérales.
Le débat qu’introduit cette très intéressante proposition de loi est donc légitime.
Comme l’a rappelé M. le rapporteur, pour les professions concernées, le droit actuel repose sur une double condition, de qualification et de nationalité.
Permettez-moi en premier lieu de revenir sur le droit actuellement applicable aux professions libérales concernées par cette proposition de loi.
De manière générale, l’exercice de ces professions libérales est soumis à deux conditions, auxquelles on peut ajouter, s’agissant des professions libérales ordinales, l’inscription à un ordre professionnel. Ces deux conditions concernent la nationalité, d’une part, la qualification, c’est-à-dire les diplômes et la formation, d’autre part.
L’exercice de ces professions est tout d’abord soumis à la détention d’un titre ou diplôme approprié.
À la suite, notamment, de l’adoption de la directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la plupart des diplômes délivrés par les États de l’Union européenne pour l’exercice de professions comparables permettent de satisfaire à la condition de diplôme en France.
À l’extérieur de l’Union européenne, l’exigence d’un diplôme français ou communautaire peut, dans certains cas, être atténuée par des procédures de vérification des connaissances acquises. Le passage devant une commission ad hoc chargée d’examiner chaque demande individuelle est alors la procédure habituelle.
Le critère de nationalité ne s’applique pas aux ressortissants de l’Union européenne, conformément au droit communautaire, et ne contraint donc pas l’accès aux professions concernées.
La présente proposition de loi maintient les conditions d’accès aux professions concernées tenant à la qualification, mais vise à supprimer la condition de nationalité.
Elle concerne huit professions, cinq relevant du secteur médical ou paramédical – médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens et vétérinaires –, les trois autres étant les géomètres-experts, les architectes et les experts-comptables.
De toute évidence, la proposition de loi soulève la question de notre politique d’immigration professionnelle.
Pour être comprise et acceptée par nos concitoyens, et aussi être conforme à l’intérêt général, la politique d’immigration de la nation doit être équilibrée. C’est tout le sens de la notion d’« immigration choisie » que le Gouvernement met en œuvre, sous l’impulsion du Président de la République.
Au regard de la situation de l’emploi, cette politique doit tenir compte de l’intérêt de la France, certes, mais aussi de celui des pays d’origine. Cette politique doit être en rapport étroit avec les besoins et les capacités d’accueil de notre pays. C’est la condition d’une bonne intégration et d’une bonne insertion dans l’emploi.
Ces conditions doivent être respectées, faute de quoi nous serions exposés à différents risques. Nous pourrions par exemple gêner le développement des pays d’origine en favorisant ce que l’on appelle la « fuite des cerveaux » ou déclencher des flux d’immigrants trop importants au regard de nos capacités d’accueil et d’intégration, y compris sur le marché de l’emploi.
Ces conditions étant respectées, il va de soi que le Gouvernement est sensible, comme les auteurs de la proposition de loi, à la nécessité de promouvoir dans toute la mesure du possible l’intégration des immigrés par le travail, lequel constitue, nous le savons, le vecteur le plus puissant d’insertion dans la société.
C’est pour cette raison que nous cherchons à favoriser l’immigration professionnelle et que nous développons l’intégration par l’emploi. Le taux de chômage des étrangers non communautaires est, nous le savons, trois fois supérieur à celui des Français. Il atteignait 24% en moyenne en 2008.
Face à une telle situation, il paraît légitime de s’interroger sur la suppression des conditions de nationalité qui subsistent encore dans certains domaines de notre droit et restreignent l’accès des travailleurs étrangers à l’exercice de certaines professions libérales, en particulier lorsque les travailleurs concernés ont fait leurs études en France, comme Mme Khiari l’a souligné à juste titre.
Toutefois, cette proposition de loi aurait dû s’accompagner d’études d’impact plus détaillées, permettant d’en mieux mesurer la portée. De fait, le Gouvernement comprend et partage l’intention générale des auteurs de cette proposition de loi. Il n’oppose donc pas d’objections de principe, mais il soulève des interrogations pratiques sur les modalités de mise en œuvre de ce texte au regard des conditions nécessaires à la réussite d’une politique d’immigration équilibrée.
Tout d’abord, il serait préférable de procéder à une évaluation prospective préalable de nos besoins dans les différents secteurs d’activité concernés. Le Conseil d’analyse stratégique anime ainsi un groupe, Prospective des métiers et des qualifications à l’horizon 2020, lancé le 16 janvier 2009 sur l’initiative de M. Éric Besson, alors en charge de la prospective, et qui serait sans aucun doute en mesure d’apporter une analyse approfondie sur cette question. Une telle évaluation est bien entendu particulièrement nécessaire pour !es professions soumises à un numerus clausus, les professions médicales et vétérinaires notamment.
J’ai bien conscience, avec un tel discours, de brider l’enthousiasme libéral des auteurs de cette proposition de loi, mais je me dois d’attirer l’attention du Sénat sur le fait qu’en l’absence d’études prospectives, nous pourrions déclencher un appel d’air d’étrangers venant faire des études en France uniquement pour s’y installer. Cela doit être mis en regard de la situation de notre marché de l’emploi et, peut-être plus encore, des besoins des pays d’origine.
Nous devons en effet veiller aussi aux intérêts des pays d’émigration, conformément au principe fondamental de notre politique qui veut que l’immigration professionnelle n’organise pas, comme on le dit parfois, le pillage des élites ou la fuite des cerveaux des pays en développement.
Ainsi que l’a souligné le Président de la République dans la lettre de mission qu’il avait adressée au ministre chargé de l’immigration, M. Brice Hortefeux, le 9 juillet 2007, « la politique d’immigration choisie, c’est une politique qui tient compte des intérêts des pays d’origine autant que des pays d’accueil ».
Nous manquerions à ce principe, madame Khiari, si nous établissions que posséder un diplôme français donne automatiquement le droit de travailler en France.
Comme l’a rappelé M. Charles Gautier, les titulaires de diplômes français doivent, comme les autres ressortissants extracommunautaires, respecter les règles en matière d’entrée et du séjour des étrangers.
En résumé, si nous voulons faciliter l’accès des étrangers non communautaires aux professions libérales réglementées, il nous faut inscrire notre démarche dans une politique d’immigration d’ensemble, fondée sur des évaluations à court, moyen et long termes de nos besoins de main-d’œuvre et de nos capacités d’accueil, en concertation avec les pays d’émigration.
L’accès des professions réglementées a vocation à être également traitée, pour les pays de la zone de solidarité prioritaire, dans des accords de gestion concertée des flux migratoires.
II paraît donc délicat de décider de telles dispositions sans étude d’impact préalable et sans les intégrer dans une gestion concertée des flux migratoires dont le ministre de l’immigration, M. Éric Besson, a la responsabilité.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l’aurez compris, le Gouvernement est très attentif à cette proposition de loi, qui a le mérite de poser la question de l’adaptation de nos règles juridiques. Il en retient et en approuve l’intention générale, mais il estime que sa mise en œuvre suppose des études d’impact qui, pour l’heure, font défaut, et qu’elle devrait s’effectuer dans le cadre plus large de la politique concertée que nous construisons avec les partenaires à part entière de l’immigration choisie que sont les pays en développement.
Le Gouvernement souhaite une concertation plus approfondie avec les organisations professionnelles et ordinales, afin de mieux mesurer l’impact des différentes mesures proposées.
Il constate toutefois que la proposition de loi, et c’est un de ses grands mérites, ne modifie pas les règles applicables aux ressortissants extracommunautaires en matière d’entrée et de séjour sur le territoire. En particulier, elle ne change rien aux conditions de délivrance et de renouvellement des titres de séjour et des autorisations de travail, en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
De plus, la proposition de loi n’affecte pas les règles applicables en matière de qualification professionnelle et de reconnaissance des qualifications professionnelles, qui sont bien entendu essentielles pour maintenir un haut niveau de compétence dans les professions concernées.
Dès lors, ayant rappelé l’opportunité qu’il y aurait à mener une étude d’impact plus approfondie sur ce sujet, le Gouvernement s’en remettra, pour les raisons que j’ai exposées, à la sagesse de la Haute Assemblée sur cette proposition de loi à laquelle il n’est pas hostile.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE et du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, avant d’aborder la proposition de loi de nos collègues du groupe socialiste visant à supprimer les conditions de nationalité qui restreignent l’accès des travailleurs étrangers à l’exercice de certaines professions libérales ou privées, je souhaiterais faire une remarque liminaire, qui n’a pas de rapport avec le texte, ses signataires et son rapporteur, mais qui mérite d’être évoquée à l’heure où le Sénat entame un débat sur l’organisation du travail législatif.
Je constate que, à l’occasion de la journée consacrée à l’initiative parlementaire, lorsqu’un texte est déposé par un membre de la majorité parlementaire, le rapporteur nommé en commission est du même bord politique, lorsque l’auteur est membre du groupe socialiste, le rapporteur nommé est également membre de ce groupe.

Finalement, il n’y a que lorsqu’un membre du groupe CRC-SPG dépose une proposition de loi que le rapporteur nommé est d’une autre sensibilité politique, et de préférence issu de la majorité sénatoriale de droite.
Je pense ici à la proposition de loi déposée par ma collègue Brigitte Gonthier-Maurin et tendant à abroger le service minimum d’accueil dans les écoles maternelles et primaires. Pour ce texte, point de rapporteur CRC-SPG, point d’auditions et, au final, point de discussion des articles.
Il y a vraiment deux poids, deux mesures. Où est donc la prétendue revalorisation du rôle du Parlement et, surtout, où est le renforcement des droits de la minorité parlementaire ?
Pour en revenir au texte relatif aux emplois dits « fermés » qui nous occupe, je rappelle qu’il nous est proposé de supprimer la condition de nationalité pour l’exercice de certaines professions libérales ou privées. Il s’agit en l’occurrence des professions réglementées suivantes : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, vétérinaire, architecte, géomètre expert, expert-comptable ; les avocats et les interprètes ont été retirés du texte pour les raisons explicitées par M. le rapporteur ; en outre, par un amendement, Mme Khiari nous proposera d’en rester au droit en vigueur pour les pharmaciens.
L’objectif ici visé est louable dans la mesure où il s’agit de lutter contre les discriminations à l’embauche que subissent les étrangers non communautaires. À diplôme égal, un étranger non communautaire devrait en effet pouvoir exercer dans les mêmes conditions que les Français ou les ressortissants communautaires qui ont, eux, accès aux professions réglementées et à la fonction publique non régalienne.
On estime que près de 7 millions d’emplois sont interdits aux étrangers extracommunautaires. Au total, 30 % de l’ensemble des emplois sont partiellement ou totalement interdits aux étrangers. Cela concerne, dans le secteur privé, environ cinquante professions qui sont plus ou moins fermées aux étrangers, mais la plupart des emplois fermés – 5, 2 millions – se situent dans la fonction publique non régalienne.
La condition de nationalité pour l’accès au marché du travail n’est pas sans effet sur la dynamique de l’emploi des étrangers et sur leur intégration. Ce sont ces discriminations légales qui, en se propageant dans toute la société, finissent par entraîner des discriminations illégales.
En instituant dans certaines professions des discriminations entre Français et étrangers, entre ressortissants non communautaires et communautaires, voire entre ressortissants communautaires – je pense ici particulièrement aux Bulgares et aux Roumains, qui n’ont pas accès au travail en France –, le droit entretient l’idée selon laquelle il serait normal d’opérer des discriminations envers les étrangers, singulièrement quand ils sont extracommunautaires.
La condition de nationalité explique d’ailleurs la structure de l’emploi des étrangers, lesquels restent cantonnés dans certains emplois alors qu’ils sont totalement absents de certains autres secteurs du marché du travail.
Pour ces raisons, le parti communiste français, dont je suis membre, réclame de longue date l’ouverture des emplois fermés aux étrangers non communautaires dans les secteurs privé et public. Il l’avait d’ailleurs rappelé en 2001 en cosignant avec plusieurs organisations et associations des droits de l’homme, syndicats et partis politiques une lettre ouverte en ce sens adressée au Premier ministre de l’époque.
Il n’est pas inutile de rappeler que la décision d’interdire certaines professions aux étrangers a souvent été prise sous la pression des événements, à des moments troubles de notre passé, lors de guerres, de crises, ou de poussées xénophobes.
Ces interdictions ont également été motivées par la volonté de protéger les nationaux d’une concurrence considérée comme déloyale. Elles n’ont jamais été remises en cause sauf, dans une période récente, pour les ressortissants de l’Union européenne, sous la pression du droit communautaire.
Le présent texte amorce donc ici un processus d’ouverture de certaines professions aux étrangers extracommunautaires munis de diplômes nationaux.
Si l’intention des auteurs de la proposition de loi, à savoir lutter contre les discriminations à l’embauche, est, je le redis, tout à fait louable, il convient en revanche de veiller à ce que de telles mesures n’entraînent pas une fuite des talents de certains pays moins développés, qu’elles ne viennent pas renforcer ou conforter l’« immigration choisie » prônée par le Gouvernement et le Président de la République, choix politique que je combats fermement, enfin, qu’elles ne débouchent pas ultérieurement sur la mise en place de quotas d’étrangers dans chaque profession concernée en fonction des besoins de l’économie française, choix que je récuse tout aussi vigoureusement.
La donne a changé, singulièrement depuis 2003, avec les différentes lois sur l’immigration qui ont été adoptées, mettant en place cette « immigration choisie » chère à M. Sarkozy. À cette vision purement économique de l’étranger, réduit à une main d’œuvre flexible et bon marché, il est temps d’opposer, me semble-t-il, une approche plus respectueuse des droits et de l’égalité de traitement.
Cette proposition de loi ouvre des brèches intéressantes dans la lutte contre les discriminations, même si je m’interroge sur sa portée puisque seules sont visées quelques professions, et uniquement dans le secteur libéral.
Ainsi, la fonction publique non régalienne n’est pas concernée par le présent texte. C’est pourquoi nous présenterons un amendement visant à donner aux étrangers non communautaires la possibilité de concourir– à l’instar des étrangers communautaires depuis la loi de 1991 – pour occuper des emplois de l’une des trois fonctions publiques. J’y reviendrai plus précisément lors de la présentation de cet amendement.
Pour l’heure, j’indique que le groupe CRC-SPG votera cette proposition de loi telle qu’elle nous est présentée. §

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la non-discrimination entre travailleurs en raison de la nationalité, de la race, du sexe, de l’appartenance religieuse ou syndicale est un principe à valeur constitutionnelle.
Le préambule de la Constitution de 1946 l’affirme très clairement : y sont gravés dans le marbre le principe de non-discrimination entre individus ainsi que le droit de chacun à obtenir un emploi.
Par ailleurs, nombre d’engagements internationaux pris par la France imposent aussi un strict respect de ces principes. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté en 1966 sous l’égide de l’ONU et en vigueur en France depuis 1981, obligent notamment les États signataires à reconnaître les droits et libertés qu’ils consacrent à tout individu et ce, sans discrimination entre nationaux et étrangers, européens ou non.
Dès lors, il est bien évidemment légitime de s’interroger sur les fondements des restrictions législatives et réglementaires que l’on constate en France concernant l’accès des étrangers, notamment les non-communautaires, à nombre d’emplois publics ou privés.
En 1999, le rapport intitulé « Les emplois du secteur privé fermés aux étrangers » a recensé l’ensemble des professions dont l’accès est limité pour les étrangers par une condition de nationalité ou une condition de diplôme, ainsi que les motifs de ces restrictions. Ce sont près d’une cinquantaine de professions qui font l’objet de restrictions liées à la nationalité et près d’une trentaine qui requièrent la possession d’un diplôme français comme condition. Au total, plus d’un million d’emplois seraient concernés.
Il est grand temps, dès lors, de prouver l’engagement de l’État dans la lutte contre les discriminations et en faveur de l’ouverture du marché du travail. C’est ce qui nous est fort opportunément proposé à travers le texte qui nous est soumis aujourd’hui et que notre groupe votera majoritairement.
La commission des lois a été plus sensible, dans un premier temps, aux observations des avocats qu’à celles des pharmaciens, pour ne pas « désarmer unilatéralement » notre législation dans un contexte de concurrence internationale exacerbée ; nous ne sommes pas convaincus par cette argumentation, qui pourrait être reprise de la même manière par les architectes et d’autres. Une partie de cette honorable profession fut davantage désarmée par la réforme de la carte judiciaire et le pôle d’instruction.
Cette proposition de loi constitue un progrès incontestable non seulement au regard des grands principes qui viennent d’être rappelés, mais aussi par le fait qu’il est, de manière générale, utile pour les pays d’attirer vers eux des professionnels compétents. L’importation de matière grise ne creuse pas le déficit commercial, bien au contraire !
Nous regrettons à juste titre l’exportation de nombre de nos chercheurs et nous pouvons nous interroger sur les inquiétudes de nombreux pays en voie de développement dont les étudiants émigrent. La question essentielle, c’est la condition de diplôme et de formation, la reconnaissance de véritables qualifications professionnelles sans discrimination entre nationaux et étrangers, y compris extra-européens.
Cette proposition de loi ne remet pas en cause les conditions de diplôme ni les procédures d’autorisation d’exercice. Il convient d’éviter certains écueils : le contournement des dispositions relatives au numerus clausus en est un.
Il n’est pas satisfaisant de constater, comme le fait M. le rapporteur, que le numerus clausus est d’ores et déjà battu en brèche par des Français effectuant leurs études dans d’autres pays de la Communauté européenne et par les ressortissants communautaires pouvant s’installer librement en France avec un diplôme leur permettant d’exercer dans leur pays. La question qui se pose alors est celle de l’adéquation de nos dispositifs de numerus clausus à l’évolution des professions concernées.
S’il est bon de supprimer les conditions de nationalité, il l’est aussi de ne pas placer l’étudiant français en situation plus difficile que son collègue étranger ; même si les voyages forment la jeunesse, tous n’ont pas les mêmes moyens pour aller contourner le numerus clausus à l’étranger !
II faut aussi constater une certaine hypocrisie du système mis en place dans nos hôpitaux pour qualifier l’emploi de plus de 6 000 professionnels qui travaillent avec un diplôme obtenu hors de l’Union européenne en étant placés sous la responsabilité d’un médecin habilité à exercer la médecine en France.
Le besoin a créé la dérogation, et le pragmatisme rime souvent avec la géométrie juridique variable !
Ainsi, aujourd’hui, la grande majorité des emplois interdits pour raison de nationalité sont situés dans le secteur public, alors que ce secteur contourne la règle en recrutant en qualité de contractuels, voire d’auxiliaires, des étrangers non communautaires. Là encore, une évolution est nécessaire.
Quoi qu'il en soit, nous voterons majoritairement cette proposition de loi en espérant qu’elle ne constitue qu’une étape vers des dispositions législatives posant une règle générale et limitant précisément les exceptions à l’exercice d’une profession privée ou publique.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il aura fallu attendre l’année 2009 et l’initiative de notre collègue Bariza Khiari pour mettre enfin un terme à cette injustice, héritée des plus sombres pages de l’histoire de France.
Je ne reviendrai pas sur cette règle inique qui consiste, depuis des décennies, à refuser aux étrangers l’exercice de certaines professions, un des volets de leur citoyenneté. Rien ne justifiait de telles restrictions, et pourtant elles ont été maintenues jusqu’aujourd’hui.
Je salue donc cette initiative et j’espère qu’elle sera un pas supplémentaire vers la suppression totale de toutes les restrictions aux droits des étrangers établis régulièrement en France. Je pense plus précisément à la reconnaissance des droits liés à la résidence, et donc à la reconnaissance de la citoyenneté de résidence, qui a notamment pour corollaire le droit de vote et d’éligibilité aux élections locales ou aux élections professionnelles.
Permettez-moi maintenant de vous faire part de plusieurs préoccupations connexes à l’objet de cette proposition de loi, relatives aux efforts qu’il reste à accomplir afin de garantir les droits que je viens d’évoquer et de permettre un accès effectif des non-nationaux aux professions visées.
Ma première préoccupation, au-delà de l’interdiction légale des discriminations à l’embauche des étrangers, a trait aux discriminations de fait. Mettre, en droit, un terme à une discrimination ne suffit malheureusement pas, car, plus qu’au droit, c’est aux mentalités qu’il faut désormais s’attaquer.
En effet, ce sont les mentalités qui doivent aujourd’hui se plier à l’impératif de justice sociale et d’égalité ! De ce point de vue, je tiens à saluer le travail de la HALDE, non seulement pour l’action qu’elle mène au quotidien auprès des personnes victimes de discriminations à l’embauche ou dans l’exercice de leur profession en raison de leurs origines, mais également pour la visibilité qu’elle a su donner au phénomène des discriminations, aidée en cela par plusieurs associations.
La proposition de loi que nous nous apprêtons à voter n’effacera malheureusement pas les réflexes discriminants, ceux qui, même interdits par la loi, trouveront l’occasion de s’exprimer au détour d’un entretien d’embauche. Les diplômes ou les compétences n’y changeront rien : les « délits de faciès », eux, ont malheureusement la vie longue, et aucune loi ne peut y mettre fin d’un seul coup.
J’espère que la HALDE pourra prolonger l’effet utile de cette loi et contribuera, avec les maigres moyens dont elle dispose, à accompagner un mouvement général d’identification et d’éradication des discriminations vécues par les étrangers dans le monde du travail.
Néanmoins, je déplore aujourd’hui que certaines professions n’aient pu jouer le jeu. Je pense en l’occurrence aux pharmaciens, qui, pas plus que les médecins ou les avocats, ne peuvent revendiquer le droit d’exclure les étrangers de l’exercice de leur profession. Ce qui vaut pour les uns devrait valoir pour les autres !
De ce point de vue, la loi aurait dû refuser d’entrer dans le jeu du corporatisme et témoigner sans demi-mesure de la nécessité, qui est d’ordre général, de supprimer toute barrière à l’accès aux emplois puisque la formation et le diplôme sont les mêmes, la première suivie dans les mêmes écoles, le second délivré par les mêmes instances. Ces barrières ne sont plus justifiées ! D’ailleurs, l’ont-elles été un jour ?
L’autre chantier qui nous attend, et qui ne relève pas directement de la présente proposition de loi, est celui du droit des étrangers.
Les étudiants étrangers seront fatalement confrontés à un problème lorsque, à l’issue de leurs études, ils devront justifier d’un statut de « salarié » au regard du droit d’entrée et de séjour des étrangers. En effet, alors qu’ils ne seront plus « étudiants », ils rencontreront dans leur recherche d’emploi des difficultés renforcées par le fait qu’ils n’auront pas encore ce statut de « salarié », et cette période où ils ne seront pas considérés comme pouvant bénéficier d’un titre de séjour pourra d’autant plus se prolonger que leurs compétences ne seront pas reconnues en tant que telles.
C’est justement sur ce point que la loi doit déployer toute sa force pour garantir à ces personnes l’aboutissement de tant d’années d’études, souvent suivies au prix de sacrifices majeurs ; c’est là que la loi doit prendre le relais pour qu’ils puissent cueillir les fruits de leur labeur.
Malheureusement, en l’état actuel de la législation sur le séjour des étrangers, aucun dispositif n’existe pour assurer l’intérim entre ces deux statuts, pour faciliter un changement du statut « étudiant » vers le statut « salarié ». La conséquence en est simple : faute de trouver immédiatement un emploi conforme à leur formation, et sans cette carte « salarié », ces jeunes ne pourront pas prétendre se maintenir sur le territoire français !
Il s’agit là d’une question extrêmement importante, sur laquelle une réflexion devra d’ailleurs être menée par les services du ministère chargé de l’immigration. Sans cela, le libre accès des étrangers aux professions autrefois réglementées ne sera qu’une chimère, un vœu pieux non suivi d’effets concrets…
La situation de ces étrangers bardés de diplômes devra donc faire l’objet d’une bienveillance particulière de la part des préfectures. Car, sans carte de séjour de dix ans, ces étudiants seront amenés à renoncer à ce à quoi ils ont consacré parfois dix ans d’études !
Je souhaite également lier cette question des emplois réservés à celle de la politique de l’immigration choisie décidée par le Gouvernement.
Les étrangers qui viennent suivre des études en France bénéficient souvent d’une bourse de leur pays d’origine. L’idée même de développement solidaire devrait donc les amener, une fois qu’ils sont diplômés, à y retourner exercer leur art, leur spécialité, et ainsi contribuer au développement de leur pays. Or le pillage de cerveaux, mis en place par M. Brice Hortefeux à l’époque où il était ministre de l’immigration, trouvera naturellement à s’appliquer dans le cas des professions visées par cette loi.
Il faudrait donc assumer une régularisation de ces étrangers sur le territoire français pour qu’ils puissent exercer leur métier en France. N’avons-nous pas besoin de leurs talents et de leurs compétences ?
En contrepartie, il faudrait inventer des mécanismes de compensation visant à solder la dette intellectuelle et humaine que nous contracterons envers leurs pays d’origine. Les coopérations bilatérales en matière scientifique, juridique et culturelle devront s’intensifier afin que les deux pays puissent s’enrichir mutuellement de ces efforts partagés. Peut-être même devrions-nous instaurer des visas « d’aller et retour permanent » afin que ces relations d’échanges intellectuels et techniques ne connaissent aucune entrave.

Mes chers collègues, dans le monde du travail, le plafond de verre sur la tête des étrangers pèse comme un couvercle… Nous nous devons de le percer. Ce n’est qu’à ce prix que la lutte contre les discriminations à l’encontre des étrangers sera véritablement effective. Je compte sur vous pour mener à bien ce combat.
La présente proposition de loi est un premier pas. Elle marque une étape importante, et je remercie encore notre collègue Bariza Khiari de l’avoir déposée. Il faut maintenant soutenir ce progrès, et aller encore plus loin.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) de l’article L. 4111-1 est supprimé ;
2° Au premier alinéa du I bis de l’article L. 4111-2, après les mots : « titulaires d’un titre de formation obtenu dans l’un de ces États » sont insérés les mots : «, autre que ceux définis aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 mais permettant d’y exercer légalement la profession concernée, » ;
3° Au quatrième alinéa (2°) de l’article L. 4131-1, les mots : «, si l’intéressé est ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;
4° Au cinquième alinéa du même article, les mots : « l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 4131-2, les mots : « français ou ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et » sont supprimés ;
6° L’article L. 4131-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-5. – Par dérogation aux dispositions du 1° de l’article L. 4111-1, dans la région de Guyane et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l’État peut autoriser, par arrêté, un médecin titulaire d’un diplôme de médecine, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans la région ou dans la collectivité territoriale. » ;
7° Au quatrième alinéa (3°) de l’article L. 4141-3, les mots : « si l’intéressé est ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;
8° Au cinquième alinéa du même article, les mots : « l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 4141-4, les mots : « français ou ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;
10° Au troisième alinéa (2°) de l’article L. 4151-5, les mots : «, si l’intéressé est ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;
11° Au quatrième alinéa du même article, les mots : « l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
12° Au premier alinéa du I de l’article L. 4151-6, les mots : « français ou ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;
13° Le troisième alinéa (2°) de l’article L. 4221-1 est supprimé ;
14° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4221-10, les mots : « les personnes qui sont titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4221-2 à L. 4221-8, mais qui ne justifient pas de l’une des nationalités mentionnées à l’article L. 4221-1, ainsi que » sont supprimés.

L’amendement n° 2, présenté par Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L’article L. 4111-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins, sages-femmes, et chirurgiens-dentistes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ayant effectué la totalité du cursus en France et obtenu leur diplôme, certificat et titre en France peuvent exercer dans les mêmes conditions, suivant les mêmes règles et dispositions, que les praticiens dont les nationalités relèvent du 2° du présent article. »
La parole est à Mme Bariza Khiari.

Notre pays, nous l’avons vu, connaît pour l’heure une situation préoccupante en matière de santé publique. En période de congés, à la campagne, il ne fait pas bon être malade ! Chacun d’entre nous peut témoigner des problèmes qu’il rencontre dans son département face à ce qui semble être une pénurie de praticiens, et l’on voit de plus en plus de maires se battre en offrant des subventions pour que les jeunes diplômés viennent s’installer chez eux.
Dès lors, permettre à des jeunes formés en France et titulaires d’un diplôme français d’exercer sur notre territoire sans condition de nationalité s’impose non seulement comme une évidence par rapport à nos principes, mais également comme une mesure de bon sens.
Cependant, la rédaction initiale de l’article 1er allait plus loin en proposant d’ouvrir plus largement l’exercice sur notre territoire d’une profession de santé, notamment à destination des extracommunautaires titulaires d’un diplôme communautaire. Tel n’est pas l’objet de la proposition de loi actuelle, et il importe de traiter chaque problème séparément.
J’ai également constaté qu’il existait une procédure allégée permettant à ces praticiens de prétendre exercer en France ; cela constitue un premier point, qui pourra être examiné de façon plus aboutie dans le cadre du projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires ». Rendez-vous est donc pris !
La situation des pharmaciens appelle, elle aussi, un traitement particulier du fait que l’ouverture des officines est soumise à un numerus clausus très strict. Puisque existent déjà des conditions de réciprocité pour l’exercice de cette profession en France, les extracommunautaires peuvent travailler sur notre territoire. Cela n’est pas totalement satisfaisant, mais il y a là un point d’équilibre nécessaire, à l’heure actuelle, en matière de démographie médicale.
L’objet de cet amendement, qui vise à récrire l’article 1er du texte issu des travaux de la commission, est bien de permettre aux ressortissants extracommunautaires ayant effectué leurs études de médecin, sage-femme ou chirurgien-dentiste en France et ayant obtenu les titres sanctionnant ces études d’être traités de la même manière que les Français. Cela reste l’objectif essentiel de la proposition de loi.
Cet amendement tend donc à proposer une solution aussi consensuelle que possible et ne déstabilisant pas les équilibres délicats de la démographie médicale.

Cet amendement vise en effet à récrire l’article 1er tout en sauvegardant la philosophie générale des objectifs donnés, le but étant de proposer une solution aussi consensuelle que possible compte tenu des positions de chacune des professions. Je remercie l’auteur de cet amendement d’avoir accepté de fournir cet effort !
On peut considérer que l’affirmation du principe d’équité sera effectivement un premier pas important, préalable à tous les autres.
Je soulignerai également, car aucun d’entre nous ne l’a suffisamment rappelé, que cela aura aussi des répercussions extrêmement importantes non seulement pour ceux qui exercent déjà, mais aussi pour ceux qui sont en formation. Je pense tout particulièrement aux étudiants en médecine : aujourd’hui, alors qu’ils fréquentent exactement les mêmes cours, suivent le même cursus, la possibilité de travailler à temps partiel à l’hôpital est à un moment offerte à l’étudiant français mais refusée à l’étudiant étranger. Dès cet instant, naît une grande différence entre eux. Il est constamment ressorti des auditions des représentants des organisations de médecins auxquelles nous avons procédé que cet aspect-là apparaissait à ces derniers comme la principale avancée contenue dans la proposition de loi.
La commission a donc émis un avis très favorable sur l’amendement n° 2.
M. Roger Romani remplace M. Roland du Luart au fauteuil de la présidence.
L’amendement vise, pour les professions de médecins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes, à supprimer la condition de nationalité pour les ressortissants extracommunautaires ayant effectué la totalité de leur cursus et obtenu leur diplôme en France. Ces derniers pourront ainsi exercer dans les mêmes conditions que les nationaux ou ressortissants de l’Union européenne.
La situation des pharmaciens, qui sont effectivement soumis à numerus clausus, demeurerait inchangée.
Le Gouvernement est sensible à ce souci de traiter sur un même plan, du point de vue du code de la santé publique, les ressortissants communautaires et extracommunautaires ayant obtenu un diplôme, titre ou certificat de profession médicale française. En conséquence, et eu égard aux éléments que j’ai rappelés dans mon discours liminaire, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée, dont, vous l’aurez compris, il espère une conclusion positive.

Cet amendement vise l’exercice des professions médicales dans notre pays. Ce faisant, il soulève une interrogation sur les modalités de l’exercice libéral.
Le rapporteur a mentionné le problème, évoqué à plusieurs reprises dans cette enceinte, de l’exercice dans les hôpitaux. Mais, dans les hôpitaux, les intéressés ont le statut de salariés : cela n’a rien à voir avec l’exercice libéral de la médecine ! Certes, les contrats de travail conclus avec les directeurs des hôpitaux sont loin d’être satisfaisants et, effectivement, relèvent parfois de l’exploitation pure et simple. Pour autant, je ne pense pas que c’est à travers cette proposition de loi que nous pourrons régler le problème.
Les étudiants en médecine d’origine étrangère accomplissent leur cursus et occupent des postes de faisant fonction d’interne dans des conditions qui sont ce qu’elles sont, mais cela n’a rien à voir avec l’exercice libéral. Exercer en libéral, c’est pouvoir apposer sa plaque et exercer de manière pleine et entière la profession de médecin.
À cet égard, et M. le secrétaire d’État l’a fort bien souligné, deux problèmes se posent.
Le premier, c’est qu’en autorisant l’exercice libéral aux étrangers nous « pomperons » une partie de la matière grise d’un certain nombre de pays, nous fixerons en France ceux de leurs ressortissants qui auront les moyens de venir y suivre leurs études de médecine – cela concerne aussi d’autres disciplines, mais ce sont les études médicales qui sont aujourd’hui au cœur de nos débats – et, finalement, nous empêcherons ces pays de voir leurs étudiants revenir dans de bonnes conditions.
Nous nous heurtons donc à un problème d’équité à l’égard de ces pays tiers, et j’estime que donner à ces étudiants la possibilité de s’installer en France, c’est faire bien peu de cas de cet aspect.
Le deuxième problème est lié à la précision suivant laquelle les étudiants exerceront à un moment donné sous l’autorité d’un médecin titulaire ; je ne sais pas ce qu’est un médecin titulaire ! Qui prendra la responsabilité d’un étudiant dont il ne connaît pas forcément le cursus ? Je suis donc extrêmement réservé sur cette possibilité.
Bien entendu, si l’étranger acquiert la nationalité française – c’est ce qui se passe pour nombre d’entre eux –, cela ne pose aucun problème : il reste définitivement dans notre pays. Pour autant, cela ne résout pas le problème des pays tiers qui manquent de médecins.
Vouloir s’appuyer sur la situation catastrophique et désastreuse des étudiants d’origine étrangère dans les hôpitaux pour régler ce dossier ici n’a aucun sens. C’est pourquoi je m’abstiendrai.

Nous avons malheureusement affaire ici à deux effets contradictoires : l’enfer pavé de bonnes intentions et le diable qui se loge dans le détail.
L’auteur de l’amendement a bien fait de ramener les choses à de plus justes proportions, sans faire de lien avec la démographie médicale, car on a pu constater, à de très nombreuses reprises, que les médecins étrangers ne s’installaient pas en zone rurale. Nous avons eu une très longue discussion à ce sujet l’année dernière lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Je soutiendrai quant à moi avec énergie cet amendement, qui est un amendement de bon sens, même si sa rédaction, en faisant la différence entre les médecins hospitaliers et ceux qui ne le sont pas, n’est peut-être pas parfaite. Ce texte n’est pas déclaré d’urgence, il y aura une navette et il ne faut pas, me semble-t-il, dénaturer l’esprit d’harmonie qu’il tend à faire prévaloir ni entamer l’avancée qu’il représente.

Je partage totalement les arguments de mon collègue Gilbert Barbier, et ce sont les raisons mêmes qu’a avancées ma collègue Nathalie Goulet qui m’amèneront à m’abstenir, comme lui, sur cet amendement.
Premièrement, dans le numerus clausus général des études médicales, il y a un numerus clausus particulier pour les étudiants étrangers. Si ces derniers peuvent ensuite s’installer comme les médecins français, il convient de le supprimer et de l’intégrer dans le numerus clausus global.
Deuxièmement, en ce qui concerne le problème de la démographie médicale, il va y avoir un appel d’air qui aboutira au fait que ces étudiants ayant obtenu leur diplôme de médecin s’installeront en ville. Je serais très étonné qu’ils s’installent dans les zones retirées de Lozère ou dans les zones de montagne des Pyrénées-Orientales. À mon avis, cette disposition aura l’effet inverse !
Troisièmement, enfin, je pense comme Gilbert Barbier que ce problème doit être étudié de façon globale, en prenant en compte le cas des internes étrangers qui exercent dans les hôpitaux. En effet, aujourd’hui, la plupart des hôpitaux français « tournent » avec de jeunes médecins étrangers…

… et, s’ils n’étaient pas là, les hôpitaux rencontreraient bien des problèmes de fonctionnement. Je souhaite donc que cette question soit traitée dans le contexte beaucoup plus global de la démographie médicale.
Je ne peux pas accepter que l’on permette à des étudiants étrangers de s’installer en France tant que l’on n’aura pas réglé le problème de la démographie médicale et que l’on n’aura pas dressé – je le demande depuis plus d’un an – la liste des zones sous-médicalisées. Un certain nombre de mesures ont été prises, y compris dans cette assemblée, pour inciter les médecins à s’y installer, mais encore faut-il les connaître !
Telle est la raison pour laquelle je voterai contre cet amendement et m’abstiendrai sur l’ensemble du texte.
L'amendement est adopté.
Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 241-1, les mots : « de nationalité française ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
2° Dans le cinquième alinéa du même article, les mots : « de nationalité française ou ressortissantes d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 241-2 est ainsi rédigé :
« Les personnes souhaitant exercer en France la profession de vétérinaire doivent être titulaires : ».

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Guené, Bizet et Dulait, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 241-1 est ainsi modifié :
a) au début du cinquième alinéa, les mots : « Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;
b) le dernier alinéa est complété par les mots : « et doivent faire la preuve qu'elles possèdent les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession » ;
2° Après l'article L. 241-2, il est inséré un article L. 241-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241 -2 -1. - I. - Pour l'application des articles L. 241-1 et L. 241-2, est assimilé aux ressortissants des États membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
« - tout ressortissant d'un État ou d'une entité infra-étatique qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France ;
« - toute personne ayant la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« II. - Les vétérinaires titulaires d'un titre de formation non mentionné à l'article L. 241-2 délivré par un État ou une entité mentionné au I et permettant l'exercice dans cet État ou cette entité, peuvent être autorisés à exercer leur profession en France, par le ministre chargé de l'agriculture, sans la vérification de connaissances mentionnée à l'article L. 241-1, si des arrangements de reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires peut conclure de tels arrangements dans le cadre d'une coopération développée avec ses homologues étrangers. »
La parole est à M. Jean Bizet.

Cet amendement, dont notre collègue Charles Guené a pris l’initiative, tout en restant dans l'esprit de la proposition de loi, prévoit, dans un article L. 241-2-1 nouvellement créé, l'accès à l'exercice vétérinaire aux ressortissants non communautaires, sous réserve de réciprocité.
Il s'agit en effet de permettre à ces ressortissants d'exercer en France dans la mesure où leur pays accorde les mêmes droits d'exercice aux ressortissants français.
Ces ressortissants restent soumis aux conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles prévues dans la loi. J’y insiste, l’exercice de la profession vétérinaire en France ne pourra se concrétiser que si la qualification professionnelle des ressortissants concernés est reconnue comparable à celle qui est requise en France et qui devra faire l’objet d’un arrêté du ministre de l’agriculture.
Par ailleurs, le Conseil supérieur de l’ordre devra être partie prenante des arrangements de reconnaissance de qualification professionnelle.
Parallèlement à la transposition de la directive « Services », qui devra être effectuée avant décembre 2009 et qui concerne uniquement les ressortissants intracommunautaires, les articles 22 à 27 et l’article 37 de cette directive visent à encourager la haute qualité des services, qui est elle-même sous-tendue par une haute qualité des diplômes requis.
J’insiste sur ce point, car la France ne doit pas, au travers de cette proposition de loi, abaisser le niveau de qualification des prestations dispensées sur le territoire national.

Avec cet amendement, on est à mi-chemin entre le droit en vigueur et la proposition de loi.
En premier lieu – c’est le point essentiel –, il permet l’ouverture de la profession de vétérinaire aux ressortissants extracommunautaires, mais il pose la condition de la réciprocité.
En deuxième lieu, afin de maintenir l’égalité de traitement entre les ressortissants communautaires et les ressortissants extracommunautaires, il prévoit que les professionnels doivent faire la preuve qu’ils possèdent la connaissance linguistique nécessaire à l’exercice de la profession. Nous ne l’avons pas évoqué pour la profession précédente, mais c’est, bien sûr, évident.
En troisième lieu, il tend à supprimer le quota imposé aujourd’hui pour autoriser l’exercice des ressortissants communautaires titulaires de diplômes extracommunautaires.
Enfin, il ouvre une voie d’accès nouvelle pour les vétérinaires titulaires d’un diplôme extracommunautaire. Ces derniers pourront exercer après autorisation du ministère si un arrangement de reconnaissance des qualifications professionnelles a été préalablement conclu entre l’Ordre de ce pays et le Conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires.
L’amendement est donc globalement en retrait par rapport au texte adopté par la commission, même si, sur certains points, il va au contraire plus loin. En revanche, il représente une avancée par rapport au droit en vigueur et c’est la raison pour laquelle la commission émet un avis favorable.
La profession de vétérinaire concourt de façon directe à la préservation de la santé publique. La modification du droit applicable à cette profession doit donc respecter cet impératif de santé publique, ce qui implique de maintenir un haut niveau de qualification.
La suppression des conditions de nationalité pour l’accès à la profession vétérinaire n’a pas pu faire l’objet d’une étude d’impact détaillée. C’est la raison pour laquelle je suis favorable à ce qu’elle soit assortie, comme le proposent les auteurs de l’amendement, d’une condition de réciprocité.
De plus, il me semble essentiel d’exiger du ressortissant extracommunautaire désirant exercer en France une maîtrise suffisante de la langue française.
Sourires
Plutôt à leurs propriétaires !
Les autres ajouts proposés, relatifs à certaines modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles, me paraissent utiles. Vous supprimez, monsieur Bizet, un quota qui n’était plus nécessaire et vous prévoyez la possibilité de conclure des arrangements de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable.

Il y a moins de deux mois, notre collègue Charles Guené a remis un rapport au Premier ministre sur la profession vétérinaire et son avenir. Ce rapport, très complet, aborde tous les aspects de la profession.
Je suppose que l’objectif de ce texte est de légiférer et de réglementer cette profession de façon plus moderne, ce qui est tout à fait compréhensible.
Dans ces conditions, est-il utile, voire nécessaire de traiter aujourd’hui un seul des aspects d’une question beaucoup plus large, pouvant entraîner des réactions en chaîne qui ne seraient pas maîtrisées ?
On a beaucoup parlé de numerus clausus. En 2006, sur 744 nouveaux vétérinaires installés, 310, soit 41 %, ont obtenu leur diplôme hors de France. Ce sont là des chiffres éloquents !
Comme Paul Blanc pour la médecine, je crois nécessaire de traiter ces sujets de façon plus globale.
Pour ma part, je voterai contre l’amendement et je m’abstiendrai sur l’ensemble du texte, même si j’en comprends les motivations.
L'amendement est adopté.
La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 10, les mots : « de nationalité française ou ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
2° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Un décret précise les conditions dans lesquelles un architecte ressortissant d'un État n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen peut, sans être inscrit à un tableau régional, être autorisé à réaliser en France un projet déterminé. »

L'amendement n° 3, présenté par Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au cinquième alinéa (3°) du même article, les mots : « ne bénéficie pas des diplômes, certificats et autres titres » sont remplacés par les mots : « est titulaire de diplômes, certificats et autres titres délivrés par un État membre de la Communauté européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que ceux » ;
La parole est à Mme Bariza Khiari.

Afin de gagner du temps, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 3 et 4.
Ces deux amendements, tout en restant dans l'esprit de la proposition de loi, visent à remédier à certaines difficultés techniques. Ils ne reviennent pas sur la suppression de la condition de nationalité figurant au 1° de l’article 3. À mêmes conditions de diplôme et de qualification, un ressortissant extracommunautaire serait désormais assimilé à un ressortissant communautaire.
La proposition de rédaction du cinquième alinéa de l'article 10 vise à maintenir une procédure spécifique pour les personnes physiques ayant un diplôme délivré dans l'Union européenne mais ne bénéficiant pas automatiquement de la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que le prévoit la directive de 2005 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Afin de rester conforme à la bonne transposition de cette directive, il faut conserver une procédure distincte pour ces diplômes communautaires susceptibles d'être reconnus.
Cela n'empêche pas – c'est l'objet de l'amendement n° 4 – de prévoir formellement une procédure distincte pour les personnes physiques titulaires d'un diplôme extracommunautaires non reconnu a priori.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur les deux amendements.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 4, présenté par Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Au début du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 11 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Selon une procédure fixée par décret, les personnes physiques ressortissantes des États non membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'Espace économique européen sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional sous les mêmes conditions de diplôme, certificat, titre d'architecture ou de qualification, de jouissance des droits civils et de moralité que les Français, lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions de diplômes, de qualification et d'expérience professionnelles visées à l'article 10.
Cet amendement a déjà été défendu.
La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
L'article 3 est adopté.
La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa (1°) de l’article 3 est supprimé ;
2° Au sixième alinéa (2°) du même article, les mots : « Pour les ressortissants de la Communauté européenne dont l’État membre d’origine ou de provenance n’est pas la France et pour les ressortissants d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « Pour les ressortissants étrangers dont l’État d’origine ou de provenance n’est pas la France » ;
3° Dans la deuxième et la troisième phrases du même alinéa, les mots : « l’État membre » et « les États membres » sont remplacés respectivement par les mots : « l’État » et « les États » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 4, les mots : « aux ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « aux ressortissants étrangers ».

L’amendement n° 5, présenté par Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Remplacer le deuxième alinéa (1°) de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le quatrième alinéa (1°) de l’article 3 est ainsi rédigé :
« 1° Pour les personnes physiques n’étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession en France ; » ;
La parole est à Mme Bariza Khiari.

Il s’agit de préciser que les ressortissants étrangers devront posséder les connaissances linguistiques nécessaires pour pouvoir exercer le métier de géomètre-expert en France.
L’article 1er de l’ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 qui transpose la directive de 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pose la même condition pour les ressortissants communautaires.
Cet amendement maintient l’égalité de traitement entre ressortissants communautaires et extracommunautaires sur ce point.
L’amendement est adopté.
L’article 4 est adopté.
L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa (1°) du II de l’article 3 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article 27, les mots : « soit du diplôme français d’expertise comptable, soit d’un diplôme jugé de même niveau » sont remplacés par les mots : « d’un diplôme jugé de même niveau que le diplôme français d’expertise comptable » ;
3° Au deuxième alinéa du même article, les mots : « après avis du conseil supérieur de l’ordre, par décision du ministre chargé de l’économie en accord avec le ministre des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « par décision du conseil supérieur de l’ordre ».

L’amendement n° 6, présenté par Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le 3° de cet article.
La parole est à Mme Bariza Khiari.

Cet amendement ne remet nullement en cause la suppression de la condition de réciprocité pour les ressortissants non communautaires titulaires du diplôme français d’expertise comptable. Il a simplement pour objet de maintenir la procédure existant actuellement pour accorder l’autorisation d’exercer aux ressortissants extracommunautaires titulaires d’un diplôme non français.
Pour réduire les délais, la proposition de loi accordait au conseil de l’Ordre un pouvoir de décision alors qu’il émettait auparavant un simple avis. Toutefois, cette simplification de la procédure se heurte à quelques obstacles. En effet, en l’état actuel du droit, ce n’est pas le Conseil supérieur de l’ordre qui apprécie la qualité du diplôme et la nécessité, le cas échéant, d’un examen d’aptitude pour les ressortissants communautaires.
Dans les deux cas, les dossiers sont examinés par une commission consultative paritaire, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, composée des représentants de l’ordre et des ministères de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la justice et de l’économie, le ministère de l’enseignement supérieur présidant cette commission.
La proposition de confier la prise de décision au Conseil supérieur de l’ordre se heurte donc à plusieurs obstacles : elle institue une procédure différente pour les ressortissants communautaires et non communautaires, ce qui est contraire à l’objectif de la proposition de loi ; le Conseil supérieur n’a pas de compétence en matière de décisions individuelles puisqu’il est chargé de défendre des intérêts collectifs de la profession.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer le 3° de cet article.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
L’amendement est adopté.
L’article 5 est adopté.

L’amendement n° 7, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France » sont remplacés par les mots : « Les ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la France, les ressortissants des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France, ou les ressortissants des autres États établis régulièrement en France. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.

Loin de remettre en cause le statut de la fonction publique, cet amendement tend à ouvrir les concours de la fonction publique aux personnes régulièrement établies en France, c’est-à-dire qui ont été autorisées à résider sur notre sol et à y travailler.
Cette mesure ne vise que les emplois relevant des missions non régaliennes de l’État, c’est-à-dire qu’elle exclut les emplois qui comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique ainsi que les fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État et des autres collectivités publiques : police, armée, justice, impôts, douanes.
Cette disposition permettrait d’éviter les discriminations qui existent actuellement entre ressortissants européens et non européens dans l’accès aux concours de la fonction publique.
Il faut savoir que, si l’accès au statut de fonctionnaire est refusé aux étrangers, ceux-ci sont bien souvent recrutés pour exercer les mêmes tâches, comme auxiliaires ou contractuels, dans des emplois moins bien payés et plus précaires. Je pense ici aux étrangers recrutés comme maîtres auxiliaires de l’éducation nationale ou aux médecins étrangers qui comblent la pénurie de médecins français dans certains services des hôpitaux.
Ce matin, la discussion en commission a abouti à une demande de retrait de l’amendement n° 7 et de notre amendement suivant, qui est un amendement de conséquence. J’y consens, mais pour une seule raison : un tel sujet mérite, à mon avis, plus qu’une discussion autour d’un amendement.
Nombreux sont celles et ceux d’entre nous qui ont presque la larme à l’œil en évoquant le sort ingrat réservé aux médecins étrangers exerçant dans nos hôpitaux publics. Alors, osons un débat public sur cette grande question ! Osons lancer la discussion dans l’espace public, afin que la question de l’ouverture des concours de la fonction publique aux étrangers en situation régulière – j’insiste sur ce point – soit réellement posée, pour l’extraire de ce qui s’apparente, actuellement, à un débat idéologique !

L’amendement n° 8, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Compléter l’intitulé de la proposition de loi par les mots :
et à la fonction publique
Cet amendement a été précédemment retiré.

Avant de mettre aux voix l’ensemble des conclusions modifiées du rapport de la commission des lois, je donne la parole à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Cette proposition de loi m’inspire un seul regret : celui de ne pas y avoir pensé plus tôt moi-même !
Sourires

Au reste, je ne suis pas surprise que la marraine de l’opération « Talents des cités » dans cet hémicycle ait eu la présence d’esprit de déposer, avec son groupe, cette proposition de loi frappée au coin du bon sens.
Je souhaite simplement formuler une observation relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers sur le territoire français, dans l’esprit de ce qu’a dit Alima Boumediene-Thiery. Nous avons eu un très long débat sur ce sujet lors de la discussion du projet de loi de modernisation de l’économie : nous avons certes réglé un certain nombre de problèmes, mais nous n’avons absolument pas réglé avec M. Hortefeux la question des mesures destinées à faciliter la délivrance des visas.
Si vous voulez que l’accueil des étudiants étrangers en France puisse prospérer, que les mesures tendant à garantir l’égalité de traitement des étudiants extracommunautaires en situation régulière donnent les résultats escomptés, il faudra bien traiter cette question.
Quoi qu’il en soit, l’ensemble du groupe Union centriste votera avec enthousiasme cette proposition de loi, en regrettant que l’urgence n’ait pas été déclarée, car ce texte devrait être appliqué dans les meilleurs délais !
Mme Nicole Bricq applaudit.

On l’oublie trop souvent, mais l’insertion est à double sens. Pour qu’un individu s’intègre facilement, une société doit lui en donner les moyens et non fermer ses portes.
Aujourd’hui, nous tendons une main, du moins je l’espère, à ceux que l’on a souvent rejetés. La République a l’occasion de faire la preuve du courage de ses idéaux, en permettant à ceux qui sont exclus de pouvoir redresser la tête au nom du mérite personnel.
Le vote d’aujourd’hui, s’il était unanime, manifesterait une avancée non pas symbolique mais réelle, vers une meilleure insertion des populations étrangères dans notre pays. Il représente le terme d’une législation faisant honte à nos valeurs, à nos principes, à nos idéaux. Le Sénat se doit de répondre favorablement à la demande de tant d’associations, de tant d’hommes et de femmes victimes d’un système injuste.
En ces temps de crise, nous devons affirmer courageusement la nécessité de conserver les valeurs d’ouverture et de partage. En ces temps où les étrangers sont malmenés dans différents pays européens, où les thèmes de la préférence nationale semblent refaire surface, la France rappelle à la mémoire de tous des textes qui ont constitué les fondements du vivre-ensemble, de cette nation que Renan définissait comme « un plébiscite de tous les jours ».
Nous ne pouvions ignorer plus longtemps les appels à l’égalité de traitement venus de populations vivant sur notre sol, fréquentant nos écoles. Le traitement qui leur était réservé n’était pas digne de notre pays. Pis, il encourageait, par effet de système, les discriminations et marginalisait encore davantage les populations issues de l’immigration. En effet, des jeunes des cités, bien que Français, pensent souvent que les emplois publics leur sont interdits. Leurs représentations mentales sont malmenées par le traitement réservé aux étrangers dont ils se sentent proches. Et les prisons se construisent aussi dans les têtes !
Aujourd’hui, la République a l’occasion de joindre les actes à la parole, en leur envoyant un message clair : elle est prête à les intégrer.
C’est la raison pour laquelle j’attache du prix à l’unanimité des groupes politiques sur cette proposition de loi. Je compte bien évidemment sur le Gouvernement et sur l’action des différents groupes pour que, dans le cadre du partage de l’ordre du jour, cette proposition de loi, qui a recueilli un avis de sagesse positive du Gouvernement, suive son cours.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC-SPG, du RDSE et de l’Union centriste. – Mme Gisèle Gautier applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, cette proposition de loi, présentée par notre collègue Mme Bariza Khiari vise à supprimer les conditions de nationalité qui restreignent l’accès des travailleurs étrangers à l’exercice de certaines professions libérales ou privées.
Comme l’a souligné notre rapporteur, M. Charles Gautier, l’accès à de nombreuses professions est difficile, voire impossible aux étrangers. Ainsi, selon de nombreux rapports, près de sept millions d’emplois seraient interdits partiellement ou totalement aux étrangers, la plupart dans la fonction publique. Concernant le secteur privé, une cinquantaine de professions seraient plus ou moins fermées aux étrangers.
La commission des lois a estimé qu’il convenait d’appliquer, de manière générale, le principe selon lequel, à diplôme égal, un étranger non communautaire doit pouvoir exercer certaines professions libérales ou privées dans les mêmes conditions que les ressortissants français ou communautaires.
Cette proposition de loi ne vise donc qu’à reconnaître à un étranger titulaire d’un diplôme français le droit d’exercer en France, au même titre qu’un Français. Elle ne modifie aucunement les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, ainsi que l’a rappelé M. le secrétaire d’État, et ne modifie pas non plus les conditions de diplôme et de qualification.
En outre, la commission des lois a estimé nécessaire de maintenir une condition de réciprocité pour la profession d’avocat, compte tenu de la forte concurrence internationale dans ce secteur.
Pour l’ensemble de ces raisons et sous le bénéfice de ces observations, la majorité du groupe UMP adoptera les conclusions de la commission des lois sur cette proposition de loi.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifiées, les conclusions du rapport de la commission des lois sur la proposition de loi n° 176, visant à supprimer les conditions de nationalité qui restreignent l’accès des travailleurs étrangers à l’exercice de certaines professions libérales ou privées.
La proposition de loi est adoptée.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, du RDSE et de l’Union centriste.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt-et-une heures cinquante-cinq.