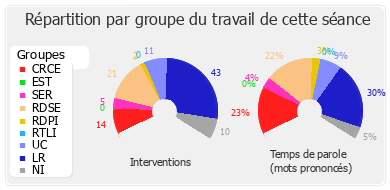Séance en hémicycle du 18 juin 2008 à 15h00
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Création d'une commission spéciale (voir le dossier)
- Candidatures à une commission spéciale
- Modernisation des institutions de la ve république (voir le dossier)
- Souhaits de bienvenue à une délégation du vietnam
- Modernisation des institutions de la vème république (voir le dossier)
- Nomination de membres d'une commission spéciale
- Modernisation des institutions de la ve république
La séance
La séance est ouverte à quinze heures cinq.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

J’ai reçu hier, transmis par M. le Premier ministre, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, …

…de modernisation de l’économie.
Je vous rappelle que nous avons constitué, au mois de février dernier, un groupe de travail intercommissions préfigurant une commission spéciale sur ce projet de loi.
En application de l’article 16, alinéa 2, du règlement, la conférence des présidents m’a donné mandat de proposer au Sénat, le moment venu, la création de cette commission spéciale et nous avons décidé hier de soumettre aujourd’hui cette proposition au Sénat.
Je soumets donc cette proposition au Sénat.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.

Le Sénat venant de créer une commission spéciale pour l’examen du projet de loi de modernisation de l’économie, l’ordre du jour appelle donc la nomination des membres de cette commission.
Il va être procédé à cette nomination conformément à l’article 10 du règlement.
La liste des candidats établie par les présidents de groupe va être affichée.
Cette liste sera ratifiée s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration d’un délai d’une heure.


L'amendement n° 159, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du préambule de la Constitution est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits fondamentaux sont indivisibles et sont des droits opposables. Tout résident sur le territoire français peut demander et obtenir de la puissance publique le respect de ces droits. »
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

L’inscription des droits fondamentaux de la personne, individuels et collectifs – politiques, économiques et sociaux –, dans le préambule de la Constitution en 1946 était une avancée considérable. Elle correspondait à des conquêtes démocratiques, historiques, génératrices de grands services publics.
Ce sont ces conquêtes que le Gouvernement et sa majorité remettent en cause loi après loi, tentant de faire croire qu’il s’agirait d’« avantages », voire de privilèges et, en tout état de cause, d’acquis archaïques. Ces prétendus « privilèges », ce sont notamment l’accès à l’éducation, à la culture, au travail, à la santé, à la retraite, au logement, à la protection sociale.
On le constate pourtant, la reconnaissance de l’égalité des citoyens par l’effectivité de leurs droits fondamentaux est un puissant facteur de luttes et de revendications populaires.
Évidemment, leur satisfaction passe pour beaucoup par le développement de services publics adéquats, accessibles à tous, à l’inverse d’une politique de remise en cause des missions et des emplois publics ; elle passe aussi par une responsabilité sociale des entreprises, et non par une gestion fondée sur la seule rentabilité financière.
Madame le garde des sceaux, lors du débat à l’Assemblée nationale, vous avez insisté sur l’idée que, par définition, les droits fondamentaux sont opposables et qu’il n’y a donc pas lieu d’inscrire leur opposabilité dans la Constitution. L’exemple du droit au logement, dont vous avez concédé l’opposabilité, montre à l’évidence que tel n’est pas le cas. On peut le constater tous les jours !
Je le rappelle, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a ôté toute valeur juridique contraignante aux droits économiques et sociaux proclamés par le préambule de 1946. Ils sont de simples « objectifs à valeur constitutionnelle ». Il est donc important que la Constitution leur reconnaisse cette valeur juridique contraignante qui leur fait défaut. Le droit au logement le montre bien.
Vous avez également souligné qu’un comité présidé par Mme Veil – nous l’avons également lu dans la presse – était chargé d’étudier le contenu des droits fondamentaux et la possibilité d’inscrire de nouveaux principes dans le préambule. Mais les droits fondamentaux sont d’autant moins séparables des pouvoirs institutionnels que la Constitution est le texte fondateur du vivre ensemble. Dès lors, pourquoi y réfléchir de manière parallèle ? D’ailleurs, de notre point de vue, la Constitution devrait même être fondée sur les droits.
De plus, la seule inscription des droits fondamentaux ne garantit pas, on le sait bien, leur effectivité. C’est pourquoi nous souhaitons que cette effectivité soit inscrite dans le corps même de la Constitution.

La Constitution de 1958 et le préambule de la Constitution de 1946, qui renvoie d’ailleurs à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, affirment de nombreux droits. Ceux-ci sont, me semble-t-il, mieux garantis dans notre pays que dans beaucoup d’autres, même si, dans le domaine des droits comme dans celui de la démocratie, il ne faut jamais relâcher ses efforts.

L’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques et qu’elle détermine les principes fondamentaux de l’enseignement, du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Il a semblé à la commission que les modalités d’application de ces droits relèvent de la loi et que l’on ne peut inscrire dans la Constitution un tel principe d’opposabilité des droits. Le préambule de la Constitution de 1946 et la Déclaration de 1789 énoncent d’ailleurs des droits que le Conseil constitutionnel et les juridictions peuvent ainsi faire respecter.
La commission émet donc un avis défavorable.
Par cet amendement, madame Borvo Cohen-Seat, vous souhaitez inscrire dans la Constitution la notion de droits opposables.
Le Gouvernement considère que cette insertion n’est pas utile, puisque les droits fondamentaux sont, par définition, opposables à tous, notamment aux pouvoirs publics. Il n’est donc pas nécessaire de le redire ou de le confirmer.
Comme je l’ai effectivement évoqué à l’Assemblée nationale, le Président de la République a confié à Mme Veil la présidence du comité de réflexion sur le préambule de la Constitution. La lettre de mission précise que ce comité est chargé d’étudier si et dans quelle mesure les droits fondamentaux reconnus par la Constitution doivent être complétés par des principes nouveaux tels que, par exemple, la reconnaissance du principe de dignité de la personne humaine ou le respect de la protection des données personnelles.
D’ici à la fin de l’année, le comité formulera des propositions qui permettront d’identifier les principes dont la réaffirmation peut être nécessaire ou ceux qui ont besoin d’être consacrés.
Dans ces conditions, le Gouvernement vous invite à bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

J’ai entendu votre réponse, madame la ministre. Nous verrons bien ce qui ressortira des travaux du comité Veil.
En attendant, quitte à réviser la Constitution, je pense qu’il aurait mieux valu le faire en une seule fois. Il aurait en effet été préférable que nous examinions une éventuelle modification du préambule en même temps que ce projet de loi.
Par ailleurs, j’ai du mal à comprendre que le Gouvernement ait inscrit dans la loi le droit opposable au logement, puisque, selon vous, les droits fondamentaux sont, par définition, opposables. En fait, je comprends très bien et je ne peux raccorder votre réponse qu’à ce que j’ai dit, à savoir que le Conseil constitutionnel a fait en quelque sorte des droits économiques et sociaux des sous-droits fondamentaux.
On voit donc bien que l’opposabilité des droits économiques et sociaux n’existe pas en réalité. Elle a été inscrite dans une loi sur le logement et on constate aujourd’hui que l’État n’est pas capable de la mettre en œuvre. Cet état de fait légitime donc totalement notre amendement.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 160 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 354 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.
L'amendement n° 419 est présenté par MM. Frimat, Bel, C. Gautier, Gillot, S. Larcher, Lise, Mauroy, Peyronnet, Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Avant l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la deuxième phrase de l'article 1er de la Constitution, les mots : «, de race » sont supprimés.
La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l’amendement n° 160.

Le Sénat serait pionnier en la matière s’il adoptait cet amendement particulièrement important, qui a pour objet de supprimer de notre Constitution le concept de « race », lequel apparaît dès l’article 1er.
Le débat sur cette question n’est pas nouveau, mais il n’a malheureusement encore jamais abouti, ce qui est très regrettable. Les initiatives et les propositions n’ont pourtant pas manqué. Je pense, par exemple, à la proposition de loi de nos collègues députés communistes et républicains déposée sous la précédente législature et qui fut rejetée en séance publique en mars 2003 par le gouvernement de droite et sa majorité parlementaire. Je pense également aux amendements des parlementaires communistes déposés à l’Assemblée nationale comme au Sénat dès qu’un texte le permet. Encore récemment, en avril dernier, lors de l’examen ici même du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, nous avons déposé un amendement visant à supprimer le mot « race ».
Force est donc de constater que ce débat est devenu récurent – sans doute grâce à la pugnacité, entre autres, des élus communistes –, démontrant ainsi la nécessité de faire évoluer nos lois, d’autant que notre proposition de supprimer le mot « race » de notre texte fondateur, mais aussi de l’ensemble de notre législation, fait son chemin et que de plus en plus de parlementaires, y compris de droite, sont sensibles à cette idée.
Je considère que, à l’occasion de la présente révision constitutionnelle, nous devrions procéder à cette modification ; ce serait à l’honneur de notre Haute Assemblée. Si nous ne le faisons pas aujourd’hui, cette réforme constitutionnelle, déjà critiquable à plus d’un titre, sera un rendez-vous manqué.
Peut-être aurait-il fallu, en amont de la présente refonte constitutionnelle, mettre en place un groupe de travail parlementaire chargé de réfléchir à la suppression du mot « race » de l’article 1er de la Constitution, mais aussi de l’ensemble de notre législation, et aux conséquences engendrées par cette suppression.
Nous en sommes bien sûr conscients, notre proposition d’amendement ne va pas, à elle seule, faire disparaître le racisme – qui reste d’une cruelle actualité et donc un combat de tous les jours. Cependant, elle pourrait empêcher les mauvais esprits de continuer à se servir d’un tel vocable pour accréditer les thèses les plus ignobles, sans compter qu’elle contribuerait à changer les mentalités.
Car le mot « race », quand il ne s’applique pas à l’espèce animale, doit disparaître de notre vocabulaire et donc de nos lois, a fortiori de notre loi fondamentale.
Je rappelle que le mot « race » est placé dans l’article 1er de la Constitution après le mot « origine » qui suffit, me semble-t-il, à faire comprendre de quoi nous voulons parler et ce que nous voulons combattre, en l’occurrence le racisme.
Il n’y a pas plusieurs races au sein de l’espèce humaine, mais il existe des origines ou des ethnies différentes. Chacun s’accorde à dire que le mot « race » est un concept scientifiquement faux, politiquement et juridiquement dangereux.
Pour étayer mon argumentaire et tenter de vous convaincre, mes chers collègues, – cela a déjà été évoqué, mais il est utile de le répéter –…

…je voudrais rappeler que le mot « race » est apparu pour la première fois dans la législation française en 1939…

…et que c’est sous la législation antisémite de Vichy que la « race » fut érigée en catégorie juridique explicite. Je vous renvoie ici aux lois du 3 octobre 1940 et du 2 juin 1941.
À partir de 1945, les textes qui ont été élaborés pour proscrire les discriminations fondées sur la « race » l’ont été en réaction contre le nazisme et le régime de Vichy. Ce faisant, le législateur a acté l’existence des « races ».
Je vous prie de m’excuser d’être un peu long, mais ce problème est important. Il faut le souligner, ce concept de « race » a servi – et sert malheureusement encore aujourd’hui – à étayer des thèses vantant la supériorité de certains par rapport à d’autres.
Les opposants à la suppression du mot « race » arguent du fait que c’est un outil nécessaire pour incriminer des infractions racistes et que ce terme figure également dans le préambule de la Constitution de 1946 ainsi que dans de nombreux textes européens et internationaux.
J’entends ces arguments, mais je ne peux les suivre, car j’estime qu’on ne peut pas se retrancher derrière des textes pour refuser la modification que nous proposons ; sinon nous n’avancerons jamais en la matière !
J’ai, par ailleurs, la faiblesse de penser que, même en l’absence du mot « race » dans nos textes, les juges pourront toujours réprimer toutes les formes de racisme fondé sur les ethnies ou les origines. Et les victimes de racisme pourront toujours demander réparation sur ce même fondement.
Laisser ce mot dans nos textes, c’est entériner le fait qu’il pourrait y avoir plusieurs « races », et c’est tout simplement inadmissible.
Pour toutes ces raisons, je vous propose d’adopter cet amendement.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – MM. Jean-Louis Carrère et Jean-Luc Mélenchon applaudissent également.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l’amendement n° 354.

L’esprit de cet amendement est identique à celui de l’amendement précédent.
Le débat suscité par la présence du mot « race » dans notre Constitution est tout à fait légitime. Aujourd’hui, nous savons tous que les races n’existent pas. Nous savons également que la lutte contre le racisme est en réalité une lutte contre toute forme de discrimination liée aux origines.
Le mot « race » n’a donc aucun fondement ni scientifique ni juridique. Il n’a qu’un fondement idéologique. La présence du mot « race » est justement une survivance de cette idéologie dans notre Constitution.
Je comprends les orateurs qui avancent que le mot « race » est le fondement juridique de toute lutte contre le racisme. Mais, je le répète, nous luttons contre les discriminations. Personne aujourd’hui ne peut prétendre que, lors de la création de la Haute autorité de lutte de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la HALDE, nous ayons parlé de race.
Il est vrai que ce terme est présent dans de très nombreuses conventions internationales de protection des droits de l’homme. Permettez-moi de relativiser l’effet que peut avoir cette présence par rapport à la suppression de ce mot de la Constitution.
Le mot « race » est le seul mot que connaît la langue anglaise pour qualifier les différences d’origine. Par commodité linguistique, et pour les besoins d’une définition homogène dans les instruments internationaux, ce terme a été préféré à un autre, parce qu’il est reconnu dans le droit de common law, là où nous disposons, en France, du mot « origine ».
Ainsi, l’existence de ce mot dans les conventions internationales est en réalité un consensus politique, qui nous est défavorable en raison de sa connotation particulière en France.
Ce mot ne veut pas dire la même chose en anglais et en français. En France, il renvoie aux pages les plus sombres de notre histoire, alors que, dans ces conventions, il n’est qu’un simple outil de référence aux origines.
À mon sens, le mot « race » doit être supprimé de la Constitution. Certes, cela ne fera pas disparaître le racisme, mais le symbolisme attaché à ce mot lui donne une connotation qui n’a pas sa place aujourd’hui dans notre Constitution. C’est la raison pour laquelle, par cet amendement, je demande sa suppression.

Avec ce projet de loi constitutionnelle, il nous est proposé de moderniser notre loi fondamentale pour qu’elle soit mieux adaptée à notre époque. Afin que cette modernisation soit réelle, nous devons aussi nous attaquer aux archaïsmes qui subsistent dans le texte.
C’est pourquoi, comme mes collègues l’ont dit, notre assemblée s’honorerait en adoptant cet amendement, qui vise à supprimer le mot « race » de l’article 1er de la Constitution.
Il est utile de rappeler que ce concept de « race » a servi de pierre angulaire à des idéologies qui sont à l’origine des pages les plus sombres de notre histoire. De plus, cela a également été dit, les scientifiques ont démontré l’invalidité totale de cette notion. Les caractères biologiques, le génome sont les mêmes pour tous les humains. Il n’existe pas plusieurs races ; il existe une seule espèce humaine. Notre Constitution ne peut continuer à laisser penser le contraire.
Historiquement, la référence à la race est récente et conjoncturelle dans notre législation. Au sortir du régime de Vichy et de la Seconde Guerre mondiale, en 1946 puis en 1958, le constituant a voulu inscrire dans la loi fondamentale que la République française n’opérerait ou ne reconnaîtrait aucune distinction fondée sur l’appartenance à une race. Cet objectif était louable. Mais il existe un effet pervers de taille : en faisant de la race une catégorie juridique de valeur constitutionnelle, on valide implicitement un concept vide, et ô combien dangereux !
Le texte constitutionnel vise bien sûr à dénier toute portée au terme de « race ». Il n’en demeure pas moins que ce terme y figure dès l’article 1er, ce qui est moralement, politiquement et juridiquement dangereux.
De plus, l’article 1er mentionne la race entre l’origine et la religion. L’appartenance nationale, ethnique ou religieuse peuvent être des catégories objectives. Ce n’est pas le cas du concept de « race » : il n’a aucune portée scientifique ou philosophique.
Cet amalgame entre catégories objectives et subjectives dans notre Constitution peut créer des confusions dangereuses et valider l’idée fausse que les hommes appartiendraient à une race.
C’est pourquoi nous proposons de ne conserver dans l’article que le terme « origine », qui est le support de notre législation contre le racisme et contre les discriminations. En supprimant ce seul mot, nous ne ferons bien évidemment pas disparaître le racisme, mais nous éliminerons toute possibilité de le légitimer en faisant référence à la Constitution.
En outre, le fait de supprimer le terme de « race » n’éteindra pas le support juridique permettant de prononcer des condamnations contre les actes racistes ou les discriminations, puisqu’il figure dans notre bloc de constitutionalité, et notamment dans le préambule de la Constitution de 1946.
Cet amendement est bien sûr hautement symbolique. Mais je ne doute pas qu’il aura aussi une forte valeur pédagogique. En supprimant le mot « race » de notre loi fondamentale, nous affirmerons enfin que notre République n’accorde aucune portée à cette catégorie et qu’elle considère que la race humaine est une.
J’espère vraiment que notre assemblée fera ce pas symbolique, au-delà de tous les clivages, et adoptera cet amendement.

Je vais argumenter mon propos. Je vous ai écoutés avec la plus grande attention et je suis extrêmement sensible à ce qui a été dit par les uns et les autres.
En fait, le mot « race » est présent dans notre Constitution pour retirer tout fondement à une telle notion, contraire au principe d’égalité qui est à la source de notre République. Et, comme l’a dit un membre prestigieux de notre assemblée, la race n’existe pas, mais le racisme existe !
Ainsi, le mot « race » doit figurer dans notre Constitution pour permettre l’incrimination et la condamnation des infractions racistes, qui demeurent malheureusement une réalité. L’article 1er de la Constitution rejette par conséquent toute distinction qui serait fondée sur la prétendue race.
Par ailleurs, je vous rappelle que le terme « race » figure dans de nombreux textes de notre droit. Vous en avez évoqué plusieurs, comme le préambule de la Constitution de 1946. Vous dites qu’il est daté. Je n’en suis pas si sûr, parce que l’on peut toujours voir renaître les choses horribles qui se sont produites à cette époque.
M. Michel Charasse opine.

Ce mot apparaît, à dix-sept reprises, dans notre code pénal, où il constitue un facteur d’aggravation des infractions.
Surtout, il apparaît également dans de nombreuses conventions internationales protégeant les droits fondamentaux : l’article 1er de la Charte des Nations unies ; l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; enfin, depuis 2001, l’article 21 de la Charte européenne des droits fondamentaux.
On pourrait évidemment demander à tous les pays de réviser ces textes en supprimant le terme de « race », même si le sens qui lui est donné n’est pas le même selon qu’il s’agit du droit français ou de la common law, mais tout cela ne serait pas compris.
Je vous le dis franchement, nous avons déjà eu ce débat à de nombreuses reprises, pratiquement à chaque révision de la Constitution. J’y participe pour la seizième fois en tant que parlementaire ; cela ne me rajeunit pas… Monsieur Bel, vous êtes tout jeune, vous !

Je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur ces amendements. Si on ne vise pas ce que l’on veut combattre, le racisme, …

Il faut bien se fonder sur une prétendue notion, autrement personne ne comprendra plus rien !

Ce serait une erreur grave. Je comprends les motivations des uns et des autres. Pour pouvoir combattre les comportements, qui existent, il faut bien poser le terme et ne pas cacher les notions !
De plus, cette suppression ne serait pas conforme aux règles du droit international qui régit notre pays.
Tous ces amendements visent à modifier l’article 1er de la Constitution, qui affirme solennellement l’égalité de tous devant la loi.
Vous souhaitez qu’on retire le terme de race. L’utilisation de ce terme, comme vient de le souligner M. le rapporteur, n’est pas propre à notre Constitution puisque l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme interdisent, eux aussi, toute discrimination fondée sur la race. L’article 3 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés utilise exactement la même expression, tout comme l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée le 7 décembre 2000. À cette époque, personne n’a souhaité retirer ce terme ; personne n’a même soulevé le sujet !
On peut comprendre cette démarche, comme vient de le dire M. le rapporteur. Utiliser l’expression serait laisser entendre que le concept de race existe. Mais le retirer, c’est aussi considérer qu’il existe !
Nous savons aujourd'hui que la notion de race, vous l’avez dit, est dépourvue de tout fondement scientifique, mais le racisme existe. Malheureusement, la négation du mot « race » ne supprimera absolument pas le racisme.
La notion de race est utilisée à dix-sept reprises dans le code pénal. C’est un élément d’aggravation des infractions. Les sanctions sont aggravées quand une qualification est fondée sur la notion de race.
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Il ne faudrait pas laisser croire que le racisme ne serait plus combattu dans notre pays.
Mme Alima Boumediene-Thiery s’exclame.
Dans de nombreux pays, ce serait un recul si la France venait à enlever le mot race, et du code pénal et de tous les textes fondamentaux !
Ce serait interprété comme un affaiblissement de la France en matière de lutte contre les discriminations, mais également contre le racisme.
Par ailleurs, je tiens à rappeler – cela aurait pu être dit plus tôt – que le Gouvernement ne faiblit pas face à la lutte contre les discriminations puisque nous avons créé dans tous les tribunaux de grande instance, depuis un an, un pôle de lutte contre le racisme et les discriminations, avec un délégué du procureur issu du milieu associatif, sensible à ces questions.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
Nous luttons contre les discriminations et toutes les formes de racisme. Enlever le mot « race » de l’article 1er de la Constitution serait interprété comme un affaiblissement, voire comme une volonté de ne plus agir contre le racisme.
M. Bernard Frimat fait un signe de dénégation.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, c’est une question à laquelle aucun d’entre nous ne peut rester évidemment insensible.
Je comprends parfaitement les motivations et l’inspiration de nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen et de ceux de mon groupe qui demandent que disparaisse ainsi de l’article 1er de la Constitution le terme de race.
Je vais être aussi clair que je l’ai été en bien des circonstances, et je remercie M. Hyest d’avoir cité mes propos : les races n’existent pas, mais le racisme existe. Je puis dire que je l’ai rencontré.
Je suis probablement le seul parmi vous qui, étant encore enfant – j’avais douze ans et demi –, est allé, contre l’interdiction de sa mère, à l’exposition du Palais Berlitz sur les Juifs. Visitant cette exposition avec mon frère, à tous les mètres nous avons vu s’étaler les pires ignominies à l’encontre de la race juive dont j’étais, selon les lois de Vichy, l’un des membres.
En 1946, face à l’horreur de ce qu’avait suscité précisément le racisme, les constituants de l’époque ont justement voulu inscrire le principe que, en France, il ne saurait y avoir aucune distinction fondée sur l’origine, la race. On comprend pourquoi. C’était un instrument de lutte contre le racisme, certainement pas une catégorie scientifique !
Nous savions très bien que le racisme existe, mais que le concept scientifique de race, lui, encore une fois, n’existe pas. Ce qui paraissait essentiel, c’était de l’inscrire précisément en termes solennels dans le texte fondamental de nos lois de l’époque.
C’est un moment de l’histoire où, il faut le mesurer, cette volonté s’est exprimée de tous les côtés, pas seulement en France, mais dans tous les pays qui composaient à cette époque les Nations unies parce qu’on émergeait du nazisme.
Partout, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ultérieurement dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la Convention européenne des droits de l’homme, se trouve la référence à la race pour précisément interdire toute distinction qui serait fondée sur la race parce qu’elle est fallacieuse, honteuse et qu’elle engendre les pires conséquences.
S’y est ajoutée, à l’époque, la lutte que ceux qui pensaient juste menaient contre le colonialisme, qui lui aussi utilisait le concept de race.
Tout contribuait donc à ce que l’on proclame solennellement dans les textes du moment que l’on ne pouvait accepter, dans aucun État se réclamant des droits de l’homme, le racisme, et par conséquent à ce que l’on condamne toute discrimination fondée sur la race.
C’est l’origine de ce terme et c’est l’origine de ce qui se trouve reproduit dans la Constitution, à l’article 1er.
On ne peut pas détacher certains textes solennels et riches de portée de leur origine. On ne peut pas, par exemple, débaptiser la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 parce que, compte tenu de l’époque, la femme n’y est pas mentionnée.
Nous avons hérité des textes qui sont ceux de l’après-guerre et on me permettra de dire qu’ils font partie de notre patrimoine juridique républicain.
J’ajoute que si, et encore une fois c’est parfaitement exact, il ne saurait exister de race, il n’en demeure pas moins que juridiquement nous avons un ensemble de textes qui utilisent ce terme pour lutter contre le racisme.
Je rappelle que ces textes ont valeur supérieure à notre droit interne : ce sont des conventions internationales. On va à Strasbourg combattre le racisme au nom du texte qui, lui, interdit les discriminations entre les races. Il est exact que le terme figure également dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000. Je profite de l’occasion pour saluer la mémoire du représentant français à la convention chargée d’élaborer ce texte, Guy Braibant, qui fut un grand juriste et un grand combattant des libertés.
Nous ne pouvons pas retirer le terme de race dans l’article 1er parce que ce terme est ici lié à la lutte contre la discrimination.
Il y a néanmoins une chose que nous pourrions faire, et je tiens à l’indiquer car il nous faudra peut-être y réfléchir dans le cours de nos travaux. Pour lutter contre la discrimination, les constituants de l’époque, reprenant une tradition, ont seulement énuméré un certain nombre de discriminations puisqu’ils ne se réfèrent qu’aux distinctions d’origine, de race ou de religion. C’était au lendemain de la guerre. Depuis lors, la lutte contre les discriminations a revêtu bien d’autres aspects très importants. Le premier est la lutte contre la discrimination sexiste. Cela s’est poursuivi avec d’autres discriminations, dont la dernière en date est la lutte contre la discrimination à l’encontre des orientations sexuelles.
Par conséquent, soit nous complétons la liste – c’est un travail difficile –, soit – j’aurais certainement l’occasion d’y revenir au cours de la navette parlementaire, mais je demande à chacun d’y penser – nous rédigeons simplement ainsi l’article 1er : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens. » Ce serait plus simple au regard des catégories oubliées comme au regard de la sensibilité dont vous témoignez et qui est peut-être liée à la différence de générations. On n’entreprendrait donc pas l’énumération « sans distinction d’origine, de race ou de religion ».
Il y aurait ainsi deux formulations possibles. La première serait d’affirmer simplement l’égalité devant la loi de tous les citoyens. La deuxième consisterait à compléter la liste, parce qu’il n’y a pas de raison d’oublier les autres discriminations et les fléaux qu’elles engendrent.
Quoi qu’il en soit, s’agissant de l’objet de ces amendements, je le dis très clairement, au regard de ce qu’est le droit et en tant qu’instrument juridique international, il serait incompréhensible que, de l’article 1er, nous retirions d’un seul coup ce qui est la condamnation du racisme exprimée, au départ, dans la Constitution.
C'est la raison pour laquelle, vous comprenant parfaitement, mais appartenant peut-être à d’autres temps, je ne peux vous suivre. Je le dis clairement : je ne voterai pas en faveur de ces amendements.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à cet instant, nous mesurons tous l’importance du texte auquel nous touchons.
Par conséquent, il est légitime que nous nous attardions sur les mots et sur leur portée.
Avec cet article 1er, nous sommes dans ce qu’il y a certainement de plus fondamental pour nous, ce qui nous réunit tous, sur toutes les travées de cette assemblée : le parti pris républicain. Car la République n’est pas un régime neutre. Elle repose sur l’idée, qui s’oppose à bien des superstitions et à bien des fanatismes, de l’universalité du genre humain et de l’unité fondamentale de l’espèce humaine, reconnue dans le cadre de la res publica, et sur laquelle celle-ci est fondée.
Cette phrase suscite un malaise que plusieurs de nos collègues, dans les deux assemblées, ont pointé du doigt.
Les discriminations sont évoquées pour être repoussées. On pourrait conclure, comme l’a fait à l’instant Robert Badinter, que le mieux serait qu’elles ne soient pas détaillées. Ainsi, dès lors qu’on aurait postulé l’égalité de tous les citoyens, tout serait dit.
Cependant, la phrase détaillée est là. Plusieurs mots sont utilisés. Leur différence tient à ce que certains sont fondés – les distinctions de sexe, de religion, sont des réalités – alors que la distinction de race ne l’est pas. La race n’a pas de fondement, c’est un concept idéologique, qui a été utilisé dans les circonstances que chacun a présent à l’esprit et qui continue de l’être dans des conditions comparables. Voilà d’où vient notre malaise.
Nous sommes partagés. Nous voudrions être d’accord avec ceux de nos collègues, c’est notamment le cas du groupe socialiste, qui disent qu’il est temps de poser un acte politique dans ce texte déjà si politique et de le faire à cet article 1er, lequel est politique plus que tout autre, au sens le plus noble du terme. Affirmons, nous les Français, dans notre texte, que les races sont une invention, qu’elles n’existent pas et que nous en combattons l’idée ! Je pense que de cœur, d’instinct, toute cette assemblée serait d’accord.
Surgit une difficulté. On nous dit que le fait de supprimer ce mot de race serait totalement contre-performant, car voulant combattre le racisme, au contraire, on se priverait de l’outil juridique qui permet de le combattre.
Je ne suis pas certain de cette conclusion. Je demande que l’on s’assure de sa véracité, ne serait-ce que parce que la France est signataire de traités internationaux, qui, eux, posent ce terme de « race ».
Par conséquent, comme ces documents sont de portée supérieure à celle de nos propres délibérations, en toute hypothèse, personne ne pourrait arguer du retrait du mot de « race » du texte de la Constitution pour en conclure aussitôt que le racisme et ses débordements ne seraient plus condamnables dans notre pays !
Aussi, nous pouvons penser que ce risque n’existe pas. C’est une première considération.
Par ailleurs, peut-être pourrions-nous réfléchir, sur une base politique, à une autre proposition, afin de mettre d’accord tout le monde. En effet, personne ici - si j’en crois en tout cas tous ceux qui se sont exprimés - ne soutiendrait que l’un quelconque d’entre nous croit à l’existence des races ou a la moindre faiblesse à l’égard du racisme. Nous cherchons à aboutir et à le faire dans la tradition, qui est celle du Sénat, de sagesse raisonnée.
Pourquoi, madame la ministre, ou monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, n’introduiriez-vous pas à cet instant le mot « prétendue », auquel vous avez vous-mêmes fait référence ? Ainsi, dans la deuxième phrase de l’article 1er de la Constitution, il serait inscrit « sans distinction d’origine, de prétendue race ou de religion ».
Dès lors, nous aurions à la fois la référence à la race au sens que lui donnent les racistes et la référence à l’objection politique que nous soulevons tous, qui est que nous ne voulons pas que la race soit reconnue dans nos textes fondamentaux.
Si vous nous faites cette proposition, je suis sûr que nous aurons tous à cœur d’y souscrire. Ce faisant, nous aurons, premièrement, assuré la sécurité juridique et, deuxièmement, réaffirmé, de manière solennelle et fondamentale, l’universalité du genre humain, à laquelle nous sommes tous ici attachés.
Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste. – M. Robert Bret applaudit également.

Permettez-moi de me réjouir que le premier débat sur ce texte au sein de notre assemblée se déroule dans la sérénité. C’est un débat de qualité qui, d’une certaine façon, est curieux puisqu’il a lieu entre des personnes qui sont d’accord sur le fond. Comme l’ont souligné Jean-Luc Mélenchon, Robert Badinter et les auteurs de ces trois amendements, aucun d’entre nous, ici, n’a de position fondamentalement différente.
Nous réagissons, néanmoins, de façon opposée. Ainsi, M. Hyest, après nous avoir dit qu’il comprenait la démarche des auteurs de ces amendements, a conclu son intervention en exprimant un avis défavorable.
À l'Assemblée nationale, un député de la majorité a dit que puisque le mot « race » apparaît dix-sept fois dans le code pénal il faut lui substituer dix-sept fois l’expression « prétendue race », qui va nier ce concept détestable et faux.
Robert Badinter a retracé la genèse du texte, en 1946. À l’époque et compte tenu du contexte, personne ne mettait en cause le fait que le texte constitutionnel ait été rédigé de cette façon.
À ce propos, permettez-moi de vous renvoyer aux manuels de géographie qui étaient distribués dans les écoles primaires au cours des années cinquante, et que l’on trouve encore facilement chez les bouquinistes. Vous y verrez une merveilleuse page intitulée « Les races », sur laquelle sont présentées quatre figures : une figure blanche, une figure jaune, la plupart du temps affublée d’un chapeau, une figure noire, représentée, dans l’iconographie de l’époque, le plus souvent avec un pagne, et un chef sioux.

Les petits Français obtenaient de leur instituteur, fondamentalement antiraciste, la note de dix sur dix quand ils pouvaient répéter qu’il existait quatre races : la blanche, la noire, la jaune et la rouge. Le métissage n’était d'ailleurs pas évoqué dans ces cours de géographie.

Voilà un exemple de ce que pouvait être l’enseignement à l’époque où la Constitution a été rédigée. Et combien sont ceux qui, durant cette même période, ont appris à l’école que leurs ancêtres étaient les Gaulois, quand bien même ce n’était pas le cas ?
Nous demandons donc simplement, en entendant bien les références aux traités internationaux, que l’on cesse d’affirmer dans notre loi fondamentale quelque chose qui n’existe pas, qui n’est pas recevable scientifiquement, qui est dénué de sens, ou, quand on lui en donne, a un sens abject.
C'est la raison pour laquelle un certain nombre d’entre nous vous proposent de supprimer toute référence à la race. Nous pouvons en parler de la manière la plus sereine qui soit, puisque nous n’avons pas de divergence sur le fond.
Nous maintenons donc ces amendements. Nous nous séparerons au niveau du vote, en ayant au moins la satisfaction - ce ne sera peut-être pas vrai sur tous les autres votes – que, si nous votons différemment, au fond, nous pensons la même chose !
Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste. – M. Ivan Renar applaudit également.

Monsieur Frimat, je rappelle que l’expression sur laquelle nous discutons actuellement figurait déjà dans le préambule de la Constitution de 1946.

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, l’intervention de Robert Badinter me permettra d’être bref.
Je suis, bien entendu, très sensible à la haute élévation de pensée de celles et de ceux qui proposent qu’on s’interroge sur la mention du mot « race » dans le texte le plus sacré de la République. Mais je suis en même temps, moi aussi, très gêné par cette proposition, même si je comprends, je le répète, la démarche de ses auteurs.
Mes chers collègues, ceux qui ont introduit cette mention en 1946, dans le préambule notamment, ainsi que M. le président vient de le rappeler, avaient assez souffert pour savoir de quoi ils parlaient ! Cette mention, qui est plus qu’une précision, même si on peut la considérer aujourd’hui comme inadaptée, correspond à une réalité et à un état d’esprit nés dans les combats, dans le sang, dans la souffrance et dans la victoire.
Cette mention, comme l’a dit Robert Badinter, fait partie du patrimoine de la République, c’est-à-dire des combats pour la créer, la défendre et la rétablir, c’est-à-dire des souffrances de tant et tant de nos compatriotes.
Mes chers collègues, ce serait renier l’héritage de la Résistance que de revenir sur cette mention, qui fait partie d’un ensemble qui constituait le cri du cœur de ceux qui sortaient des maquis, et qui visait à dire clairement - peut-être est-ce mal écrit, mal exprimé… - que le racisme était incompatible avec l’humanité et les fondements de la République.
Donc, cette mention ne reconnaît pas les races. Elle veut dire, au contraire, que la République et la société française ne les reconnaissent pas ! C’est de là que part toute la législation, y compris internationale, qui permet de combattre le racisme.

Je ne serais pas opposé – même si rayer d’un trait ce qui a été écrit en 1946 me peine beaucoup – à la formulation que propose Robert Badinter. Après tout, c’est au législateur constituant de voir ce qu’il veut faire.
Effectivement, comme l’a dit notre collègue, la mention, aujourd’hui, compte tenu de l’évolution des choses, est sans doute devenue insuffisante. Elle était suffisante en 1946. Mais, croyez-moi, affirmer quand même d’une manière ou d’une autre que la République combat le racisme et l’interdit, c’est bien mieux que beaucoup d’autres mentions inutiles, superflues, redondantes ou vaseuses, dont, à l’article 1er, nous aurons tout à l’heure un exemple patent.
MM. .Robert Badinter et Roger Romani applaudissent.

Le problème, quand j’écoute les arguments des uns et des autres, c’est que je suis d’accord avec les uns comme avec les autres.

Il semble que nous soyons nombreux dans cet hémicycle à être dans cette situation.
Un groupe de travail, présidé par Mme Simone Veil, est en train de réfléchir à une réécriture de ces dispositions. Mais on m’a rappelé, ce matin, en commission des lois, que le Parlement étant constituant, donc souverain, nous pouvions modifier ces dispositions avant même de connaître les conclusions du groupe de travail auquel je faisais allusion.

Donc, nous sommes constituants. Très bien !
Le problème concernant l’article dont nous parlons, c’est qu’il est, bien sûr, historiquement daté. J’entends bien les arguments de ceux qui disent que l’on ne peut pas toucher à un dispositif qui fait allusion à ce qui s’est passé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais, que je sache, il ne vient à l’esprit de personne de réécrire la Déclaration de 1789 ou le préambule de 1946 !
Aujourd'hui, si nous touchons à ces articles, nous devons le faire en utilisant le vocabulaire, y compris juridique, de ceux qui vivent en 2008, et non pas de ceux qui vivaient en 1946, que je respecte, ou en 1958, que je respecte tout autant.
À mon humble avis, la solution la plus simple serait de supprimer purement et simplement, comme le propose Robert Badinter, la deuxième partie de la phrase. D'ailleurs, entre parenthèses, je souligne que la première partie, aujourd’hui, pose problème, car affirmer que la République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens », c’est méconnaître qu’elle assure aussi l’égalité devant la loi de ceux qui vivent sur le territoire français sans être citoyens. (
Je propose donc d’écrire simplement : « Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens », en supprimant « sans distinction d’origine, de race ou de religion », mais en ajoutant « et combat toutes les formes de discrimination ». Cela permettrait de régler le problème de savoir si sont en cause l’origine, la race – qui est effectivement un terme ambigu, aujourd’hui, en 2008 –, la religion ou d’autres formes de discrimination que nous connaissons aujourd’hui.
Il vaut mieux adopter, si l’on veut aujourd’hui faire un travail de constituant, un vocabulaire qui est celui de 2008, et ne pas essayer de rafistoler celui qui correspond aux références de 1946 ou de 1958.
Applaudissements sur quelques travées de l ’ UMP.

Ce n’est pas la première fois que nous présentons cet amendement, et nous le présenterons de nouveau s’il le faut, parce que, même si nous partageons tous la même vision des choses, il faut être conséquent.
Je suis pour ma part très attachée au préambule, et je proposerai que l’on n’y touche pas, mais je crains beaucoup que le comité actuel ne soit tenté de le faire. Moi, je refuserai absolument d’y toucher ! Les textes de 1789 et 1946 sont datés. C’est justement pour cette raison qu’il ne doit pas y avoir de modification des textes que nous avons annexés comme préambule.

Ici, il est proposé de modifier l’article 1er de la Constitution. Or, bien évidemment, qui oserait prétendre que le racisme n’existe pas ? Hélas, trois fois hélas ! il existe fortement dans notre beau pays, où vous le combattez, paraît-il.

Effectivement.
J’ajoute que la question des races - même s’il est reconnu scientifiquement qu’il n’y a pas de races humaines - n’est malheureusement pas réglée. Des gens s’entretuent en fonction de l’appréciation qu’ils ont de l’existence de prétendues races. Aux États-Unis, il est fait mention sur les papiers officiels de la couleur de la peau.
Par conséquent, si nous sommes effectivement convaincus que les races humaines n’existent pas, il ne faut pas maintenir dans notre texte les mots : « sans distinction d’origine, de race ou de religion ». En effet, cela implique, même si l’on combat le racisme, que les races existent !
Il serait sage que nous soyons pionniers en la matière. Certes, le mot « race » est utilisé à plusieurs reprises. Eh bien, nous le changerons à plusieurs reprises, et nous ferons valoir l’acte par lequel nous décidons que le mot « race » - les races n’existant pas concernant les humains - ne figure plus dans nos textes ! Je suis éventuellement d’accord avec l’expression « prétendue race », mais cette modification ne s’impose pas.

Nous sommes tous réunis ici pour lutter contre le racisme et nous mesurons tous combien ce fléau a blessé notre histoire et blesse encore aujourd’hui notre société. Je trouve donc ce débat riche et noble.
Cependant, comme le disait tout à l’heure M. Badinter, n’oublions pas le cœur de ceux qui ont inscrit ces mots dans la Constitution et respectons la gravité de ce texte car, c’est pour moi une conviction de fond, il fait honneur à la République.
De plus, je crois que nous avons besoin de la négation de la race pour lutter contre le racisme. Or, ce texte emploie la forme négative : si nous venions à supprimer ce mot, nous appauvririons la Constitution.
Courtoisement et amicalement, je dis à Jean-Luc Mélenchon que l’épithète « prétendue » ouvre le débat sur la race. Or, avec la préposition « sans », nous restons dans la négation de la race. C’est pourquoi je pense qu’il ne faut rien toucher à ce texte, car nous avons besoin de cette négation de la race pour lutter contre le racisme !
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – Mme Muguette Dini applaudit également.

Ceux qui ont écrit ce texte sont encore en vie !
La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.

Mon intervention sera extrêmement brève pour apporter une précision sémantique.
En premier lieu, et ce n’est pas moi qui le dis, la République est fondée sur un certain nombre de blocs de granit et il est des termes qui font référence à ces blocs : le mot « race » en est un.
Je voudrais aller plus loin : si on ne mentionne pas le mot « race », on supprime toute allusion au racisme ; or, dans cette enceinte, personne ne le souhaite !
Je serais donc tout à fait d’accord avec les précisions apportées par M. Robert Badinter pour dire, d’une part, qu’il ne faut pas affaiblir ce qui constitue un des fondements de notre République et, d’autre part, que l’on ne doit surtout pas considérer que le mot « racisme » ne devrait pas figurer dans la Constitution. Nous voulons combattre le racisme et, pour ce faire, le mieux est de l’énoncer très clairement !

Je suis de ceux qui pensent qu’on ne peut pas modifier dans l’improvisation un texte aussi fondamental sans prendre les plus grands risques.
Je suis de ceux qui, du fait de leur âge, ont vu de près ce que le racisme a eu de spécialement terrible dans notre histoire, dans les années 1940-1944. Je sais donc précisément de quoi je parle : raison de plus pour s’en tenir à la rédaction adoptée au lendemain de ces événements.
La critique de l’actuelle rédaction de l’article 1er, fondée sur l’analyse scientifique, tend, en réalité, à introduire dans une démarche juridique et culturelle, qui est la démarche générale de la Constitution, des difficultés d’un autre ordre, qui ont leur importance, mais qui restent étrangères à cette démarche.
Tout notre système juridique est fondé sur la signification générale des mots dans la langue française. Je suis sorti de l’hémicycle un instant pour consulter le Dictionnaire culturel en langue française en quatre volumes : il consacre aux mots « race » et « racisme » deux pages qui expliquent le problème.
Notre langue est ainsi faite : le mot « race » a un sens juridique, répété dans de nombreux textes, il a également un sens culturel évident et un sens historique très lourd. Tous ces sens comptent !
Je comprends bien la démarche de M. Mélenchon, consistant à ajouter l’épithète « prétendue ». Mais, comme cela vient d’être dit, on introduirait ainsi un élément de discussion, d’incertitude, suscitant des interrogations diverses sur les intentions du constituant.
Il ne faut donc pas se risquer à toucher à ce texte dans l’improvisation. Tel quel, le mot « race » est compris de tous les citoyens ; il est dans la langue populaire, s’il n’est pas dans la langue scientifique : c’est l’essentiel dans une démarche constitutionnelle ! N’y touchons pas !
Applaudissements sur plusieurs travées de l ’ UMP.

L’article 1er me semble appeler deux réflexions.
En premier lieu, il place le terme « race » entre deux autres, « origine » et « religion », et exige de ne fonder aucune distinction sur ces trois notions. Or, si l’on refuse de fonder des distinctions sur les origines, c’est parce que celles-ci existent, sur les races, c’est parce qu’elles n’existent pas, et sur les religions, c’est parce qu’elles existent. Vous comprenez la curiosité de cette juxtaposition qui pourrait donc conférer à cette notion de race, placée entre deux affirmations, une forme de crédibilité.
En second lieu, considérant que la discrimination ne souffre pas d’exceptions, il me semble que la proposition de M. Badinter est très intéressante. Même si elle ne doit pas être adoptée aujourd’hui, il faut y réfléchir, car je suis persuadé, avec d’autres certainement, qu’on ne confère jamais autant de force à un texte qu’en lui donnant une forme ramassée.
Ne commettons pas d’oubli, supprimons ces quelques précisions très utiles qu’il ne faut pas rejeter dans l’oubli de l’histoire. En les supprimant plus tard, après une réflexion plus générale, nous conférerons une force bien plus grande à notre Constitution.

Je souhaite simplement réagir aux propos de M. Raffarin. Il nous dit que le texte comporte une négation. J’ai donc repris ma Constitution où je lis : « Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. » Je ne vois pas où se trouve la négation !

« Sans distinction » n’est pas une négation. Au contraire, c’est plutôt une reconnaissance des origines, des races et de la religion.
Par ailleurs, la présence du mot « race » est une survivance dans notre Constitution de l’idéologie que j’évoquais, c’est la raison pour laquelle je continue à penser qu’il faut le supprimer !
Les amendements ne sont pas adoptés.

Après ce débat d’une grande hauteur qui honore notre assemblée, il est prouvé qu’on ne peut pas improviser en séance publique. Nous avons bien vu à quelles propositions diverses et variées de telles questions donnent matière. Il n’y aurait donc rien de pire qu’une improvisation sur un sujet aussi délicat.
Nous en sommes aujourd’hui à la vingt-quatrième – peut-être ! – révision de la Constitution ; le comité présidé par Simone Veil a engagé ses travaux, je pense qu’il devrait se saisir de ce sujet ; le doyen Gélard siège d’ailleurs dans ce comité.

Me référant à ce qu’on dit Robert Badinter et Pierre Fauchon, notamment, je pense au livre de Jean Cassou La mémoire courte. N’ayons jamais la mémoire courte et ne voyons pas les choses de manière trop terre à terre !
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen comporte aussi des mots qu’on n’emploierait plus aujourd’hui ! Mais cela fait partie de notre histoire…

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. …et on comprend mieux les choses si on se réfère à l’histoire. Ne bouleversons pas trop ces notions car nous pourrions commettre beaucoup d’erreurs !
M. Michel Charasse opine.

Je n’ai qu’un mot à dire : un grand merci à toutes et à tous pour la qualité de ce débat qui honore le Sénat.

Mes chers collègues, j’ai le très grand plaisir, au nom du Sénat tout entier, de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d’une délégation de l’Assemblée nationale du Vietnam, conduite par M. Luong Phan Cou, président de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale du Vietnam.
Nous sommes particulièrement sensibles à l’intérêt et à la sympathie qu’ils portent à notre institution.
Au nom du Sénat de la République, je leur souhaite la plus cordiale bienvenue et je forme des vœux pour que leur séjour en France contribue à renforcer les liens d’amitié entre nos deux pays.
Mme le garde des sceaux, M. le secrétaire d'État, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.

Nous reprenons la discussion du projet de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale, de modernisation des institutions de la Ve République.
L'article 1er de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les langues régionales appartiennent à son patrimoine. »

Je suis saisi de onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les six premiers sont identiques.
L'amendement n° 3 rectifié est présenté par M. Charasse, Mme N. Goulet et M. Fortassin.
L'amendement n° 77 est présenté par MM. Gélard, Portelli et Lecerf.
L'amendement n° 145 est présenté par M. Mélenchon.
L'amendement n° 157 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 250 rectifié ter est présenté par M. Gouteyron, Mme B. Dupont, MM. Gournac et Retailleau et Mme Papon.
L'amendement n° 260 rectifié est présenté par MM. Détraigne, Deneux et Merceron, Mme Morin-Desailly et MM. Biwer, Fauchon, J.L. Dupont, C. Gaudin, Zocchetto et Pozzo di Borgo.
Ces amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Charasse, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié.

Lorsque l’on parle de réviser la Constitution, les propositions les plus inattendues sont souvent formulées. Je ne suis pas le seul dans cette assemblée à avoir été surpris par l’apparition dans ce projet de révision constitutionnelle, à l’issue des débats de l’Assemblée nationale, d’une mention visant à classer les langues régionales dans le patrimoine de la France.
Car, après tout, on pourrait profiter de la révision de la Constitution pour classer dans le patrimoine national tout ce qui est considéré comme monument historique depuis la loi de 1913, y compris la gastronomie dont la France demande officiellement à l’UNESCO de la reconnaître comme patrimoine de l’humanité ! Si la gastronomie entre dans le patrimoine de l’humanité, elle entre nécessairement dans le patrimoine de la France puisque la France fait partie de l’humanité. Enfin, la potée auvergnate classée monument historique !

M. Michel Charasse. C’est une chose que je n’aurais pas cru voir avant ma mort !
Sourires.

En tout cas, nous voyons bien que cette mention des langues régionales n’a rien à faire dans la Constitution.
Applaudissements sur plusieurs travées de l ’ UMP.

Que la Constitution dise que le français est la langue de la République – grâce au roi François Ier –, cela va de soi, c’est la base et c’est ce qui définit le mode des échanges, notamment juridiques et officiels. Mais qu’on aille au-delà en ajoutant cette précision concernant les langues régionales, c’est véritablement inouï !
Et si, en plus, cette mention se limite à préciser que les langues régionales font partie du patrimoine, de deux choses l’une : soit il ne sert à rien de l’inscrire dans la Constitution puisque l’on peut parvenir au même résultat par d’autres voies législatives, soit quelque chose d’inavouable se cache derrière.
Certes, notre collègue rapporteur, M. Gélard, nous dit…

Notre collègue rapporteur, M. Hyest – je rends à César ce qui est à César –, nous dit que cette mention n’a pas de portée normative et c’est ce que je crois personnellement.
Mais je suis persuadé que ceux qui l’ont introduite sous cette forme ne sont pas assez naïfs pour introduire dans la Constitution des dispositions non normatives et qu’ils nous cachent quelque chose.
En fait, ils cachent leur intention de contourner la décision du Conseil constitutionnel…

…concernant la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires dont nous savons tous que, compte tenu de ses règles actuelles, la République ne peut pas la ratifier, en raison de certaines de ses dispositions en tout cas, dont le Conseil constitutionnel a dit qu’elles portaient atteinte à l’unicité du peuple français, à l’indivisibilité de la République et au principe d’égalité des citoyens devant la loi, trois fondements essentiels de la République.
Ou cette mention ne veut rien dire et il faut la supprimer, ou elle signifie que l’on pourrait demain considérer, par exemple, que cet élément du patrimoine nécessitant une protection particulière et renforcée, celle-ci passe nécessairement par la ratification de la Charte. Dans le premier cas, c’est inutile, dans le deuxième cas, c’est dangereux, c’est pourquoi je propose la suppression de cet article qui n’a pas sa place dans la Constitution !
Applaudissements sur plusieurs travées de l ’ UMP.

Je suis en parfait accord avec les propos de notre collègue Michel Charasse. J’ajouterai simplement ceci : je ne sais pas très bien ce qu’est le patrimoine national et je crains que, si nous insérons ce type de disposition dans la Constitution, nous n’y retrouvions aussi demain la franc-maçonnerie, le christianisme, les cathédrales, toutes choses qui font aussi partie de notre patrimoine !

C'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 1er A.

La parole est à M. Jean-Luc Mélenchon, pour présenter l'amendement n° 145.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, notre assemblée connaît déjà ma position à propos des langues régionales. En effet, j’ai eu le privilège d’intervenir sur cette question lors du débat consécutif à la question orale – fort opportune – posée par notre collègue Nicolas Alfonsi.
Récemment, j’ai pris la liberté d’adresser à chacun d’entre vous une présentation argumentée de mes idées. Comme j’ai pu l’observer, nos travaux sont suivis avec beaucoup d’attention par les partisans, qui ne sont pas toujours très raisonnables, de la pratique des langues régionales : ils ont bruyamment fait connaître leur opinion, le plus souvent de manière injurieuse à mon égard et quelquefois de façon plus respectueuse du point de vue que j’exprime ici.
Je ne peux donc faire moins à cet instant que de rappeler qu’il n’est pas question dans mon esprit, ni sans doute dans celui de beaucoup d’entre vous, d’opposer la langue française aux langues régionales ou de nier leur existence, leur intérêt et leur contribution à la constitution même de l’identité des Français.
À la bataille de Valmy, nos ancêtres ne parlaient pas tous la même langue, n’adoraient pas les mêmes dieux, ne pesaient pas dans les mêmes unités de mesure. Pourtant, ils ont contribué tous ensemble à faire l’histoire de la France, et singulièrement la grande rupture républicaine, qui fonde son identité contemporaine.
Nous ne raisonnons pas ici en termes d’opposition entre langue nationale et langue régionale. À l’origine de ce débat, il y a une décision prise dans le cadre du Conseil de l’Europe dont l’objectif était de protéger les minorités nationales dans les pays où celles-ci subissaient des discriminations et des répressions. Notre pays n’est pas concerné car nul en France n’a jamais été poursuivi ou inquiété du fait de son parler maternel, ni interdit d’accès à quelque fonction que ce soit.
Certes, il y a eu autrefois des pratiques « pédagogiques » fort rudes dont on nous rebat les oreilles. Mais il est temps de rappeler que, à l’époque, la pédagogie était dure quelle que soit la matière enseignée. Je ne crois pas qu’il faille sans cesse nous opposer ces exemples pour prouver que notre pays aurait jeté un opprobre particulier sur ceux qui ne parlaient pas la langue française dès leur plus jeune âge. Laissons maintenant cela de côté !
En tant que socialiste – je demande un instant de bienveillance à mes collègues qui ne partagent pas mes convictions –, il serait absurde que je me soustraie à cette communauté intellectuelle qui associe les hommes de gauche à la promotion des langues régionales, dans la droite ligne de Jean Jaurès – prenant la défense de l’occitan – et du communiste Marcel Cachin – faisant de la propagande en breton. Je le rappelle, la première loi qui a reconnu ces langues en France et qui a instauré l’obligation de leur pratique est l’œuvre du député socialiste Maurice Deixonne. La loi Toubon a, certes, permis par la suite que soit élargi le champ des dispositions de la loi Deixonne, mais c’est Lionel Jospin qui, le premier, a permis l’enseignement du corse à tous les niveaux et créé une option langues régionales au baccalauréat ouverte à tous les élèves.

Par conséquent, il n’y a pas d’ambigüité sur la volonté qui, me semble-t-il, est unanimement partagée de protéger et développer les langues régionales en France. La République française n’opprime personne ; tout au contraire, elle donne les moyens de développer les langues régionales.

La seule question qui vaille est de se demander si le cadre légal existant permet ou non la pratique et le développement de ces langues. Et c’est bien le cas avec l’ensemble de lois que je viens de rappeler. Cet argument ne peut donc pas nous être opposé.
Certains ont rappelé, avec humour, que bien des particularités appartiennent au patrimoine. Quelles sont donc les intentions de ceux qui veulent introduire les langues régionales dans la Constitution ? Ils estiment certainement que la langue régionale, parce qu’elle est la langue maternelle ou supposée telle, est constitutive de l’identité particulière des personnes. À cette argumentation, nous devons répondre de manière très précautionneuse car il faut respecter ce sentiment si humain, si spontané, si noble. Mais nous devons aussi préciser que bien d’autres particularités sont considérées par nos concitoyens comme définissant leur identité la plus profonde. C’est le cas par exemple de la foi : elle peut être considérée comme étant « reçue » dans des conditions qui s’apparentent à celles de la transmission de la langue.
La République française respecte et garantit la liberté de conscience ; il n’est donc pas besoin d’introduire cette particularité dans la Constitution.
Alors, je le répète, pourquoi nous le demande-t-on ? Je crains que la bonne volonté de ceux qui s’enthousiasment à juste titre pour le développement des langues régionales n’ait été surprise. Il existe un parti « ethniciste » qui veut faire introduire dans la Constitution une référence à ces langues. Aujourd'hui, cette inscription à l’article 1er peut paraître inoffensive mais, il faut le rappeler, c’est le Gouvernement qui a fait retirer les premiers amendements déposés sur ce sujet à l'Assemblée nationale visant explicitement à permettre l’application possible de la Charte des langues régionales. La rédaction proposée pour l’article 1er est une version rendue « inoffensive » de ces amendements.

Il n’empêche : il est temps d’affirmer avec fierté que la patrie républicaine ne réprime pas les langues et que nous n’avons donc pas besoin d’introduire une telle disposition dans la Constitution. Ce seul fait ferait porter un soupçon sur l’équanimité de cette République. Par voie de conséquence et en toute logique, cette mention pourrait, à terme, être intégrée à l’article 2, et la charte des langues régionales être inscrite dans la Constitution.
La France appliquait l’essentiel des dispositions de la Charte avant même qu’elle soit promulguée.

Celles qu’elle n’applique pas sont celles qui ont été déclarées anticonstitutionnelles au motif qu’elles créaient une différence de droits fondée sur la locution.
Nous n’admettons pas que des différences de droits soient créées à raison de particularités. La laïcité de la République, son unité, son indivisibilité l’exigent autant que le simple bon sens et la raison.
M. Robert Bret applaudit.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous, sénateurs communistes, souhaitons tout d’abord réaffirmer que nous avons toujours été de fervents militants du plurilinguisme et de la diversité culturelle. À cet égard, les langues régionales font indiscutablement partie de cette riche et indispensable diversité qu’il convient de préserver. C’est pourquoi nous avons toujours soutenu leur pratique et leur enseignement. Pour autant, nous ne sommes pas favorables à leur inscription dans l’article 1er de la Constitution : cela ne contribuerait pas pour autant à les rendre plus vivantes, mais conduirait avec certitude à écorner les grands principes de notre République.
Le premier article de la Constitution définit la République comme l’œuvre de tous et appartenant à tous, quelles que soient les particularités de chacun. Ainsi, la République consacre ce qui rapproche les citoyens contre ce qui les divise. La meilleure façon de protéger les particularismes est bien de garantir leur libre expression privée en les protégeant de toute ingérence publique.
Pourquoi alors introduire ce particularisme et pas un autre ? Et demain, est-ce que ce sera le tour de la religion ? Cela risque d’apparaître discriminatoire et d’ouvrir la voie à une division entre citoyens contraire à l’esprit de notre République.
Ne serait-ce qu’en matière linguistique, les personnes pratiquant des langues dites des migrants, d’ailleurs plus nombreuses que celles qui pratiquent une langue régionale, ne pourraient-elles pas légitimement par exemple se sentir victimes de discriminations ?
Le français est une langue mouvante qui ne cesse d’évoluer et, aujourd’hui comme hier, c’est le parler populaire qui lui apporte ses nouvelles lettres de noblesse. Les nouveaux mots courants apparus ces dernières années doivent beaucoup aux parlers, aux métissages des cultures et à la culture des quartiers populaires. Les langues importées par l’immigration ont en effet introduit une syntaxe, une prononciation et un lexique nouveaux qui ont une incidence certaine sur notre langue.
Pourquoi la Constitution évoquerait les langues régionales, qui plus est avant le français qui n’est mentionné qu’à l’article 2 ? Et ce, alors même que notre langue nationale est de plus en plus menacée, y compris dans les instances internationales ou européennes où elle est pourtant l’une des langues officielles. Dans le contexte de mondialisation actuelle où de nombreuses langues nationales sont de plus en plus mises en danger par l’usage de l’anglais qui devient hégémonique, la priorité reste de consolider la place du français, y compris sur l’échiquier international. « Union européenne : alerte sur les langues » titrait Le Monde en date du 10 juin : l’article soulignait que le français et l’allemand, deux des trois langues de travail de l’Union européenne qui compte vingt-trois idiomes officiels, continuent de perdre du terrain à Bruxelles au profit de l’anglais.
En mars 2006 à Bruxelles, Jacques Chirac, alors Président de la République, avait quitté la salle du Conseil, refusant d’entendre le français Ernest-Antoine Seillière, président du patronat français, s’exprimer en anglais, qui est devenu la langue de l’économie dominante. Le président Chirac avait bien raison, car, comme le disait Stendhal, « le premier instrument du génie d’un peuple, c’est sa langue ».
Comment ne pas relayer l’inquiétude de l’Académie française quant à la reconnaissance des langues régionales dans la Constitution ? C’est une démarche extrêmement rare de la part de cette vénérable institution.
L’Académie « qui a reçu le mandat de veiller à la langue française dans son usage et son rayonnement » demande « le retrait de ce texte dont les excellentes intentions peuvent et doivent s’exprimer ailleurs, mais qui n’a pas sa place dans la Constitution ». Les académiciens contestent en particulier la primauté donnée aux langues régionales, désormais inscrites dans l’article 1er de la Constitution alors que la langue française reste mentionnée dans l’article 2. « Depuis plus de cinq siècles, la langue française a forgé la France. Par un juste retour, notre Constitution a, dans son article 2, reconnu cette évidence : “ La langue de la République est le français”. »
Même si elle ne l’a pas ratifiée, la France applique de nombreux articles de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. La législation française prend déjà en compte le fait linguistique régional, même si cette législation doit être encore améliorée car unité du pays ne signifie pas pour autant uniformisation. Les langues régionales font bien sûr partie du patrimoine de la France ! C’est tellement évident ! Mais pourquoi l’inscrire dans la Constitution ?
Le français est avant tout une langue fédératrice, qui permet de donner corps aux principes de liberté, d’égalité et de fraternité de notre République. Tous différents, nous sommes tous égaux en droits. Ainsi, l’ordonnance de Villers-Cotterêts qui a institué sous François Ier le français comme langue du royaume permet à chacun de se faire comprendre et de comprendre les autres, de se défendre, de témoigner, d’ester en justice. Remettre en question cette ordonnance, ainsi que le prévoit pourtant la Charte européenne, constituerait un net recul, comme l’a d’ailleurs confirmé le Conseil constitutionnel en 1999. L’usage du français pour les actes législatifs et les autres documents est une nécessité politique démocratique.

Si, depuis la révision constitutionnelle de 1992, l’article 2 du texte fondamental précise que « la langue de la République est le français », c’est pour lutter non pas contre les langues régionales, mais contre l’envahissement de l’anglais.
Mme Christine Albanel a annoncé le dépôt d’un projet de loi destiné à « normaliser et organiser l’apprentissage et l’emploi des langues régionales ».

Alors que l’État ne cesse de se désengager et que de nombreux enseignements sont aujourd’hui en souffrance, on peut craindre qu’une telle loi ne voie ses effets limités si elle n’est pas accompagnée des moyens nécessaires de l’État qui font déjà cruellement défaut. Alors qu’il n’y aurait aucun intérêt à faire lire La Princesse de Clèves à l’école, comment croire alors que les poètes Frédéric Mistral et Jules Mousseron trouveraient soudain une place de choix dans les programmes ?

M. Ivan Renar. La promotion des langues et des cultures régionales est un élément de culture important. Je dis souvent que l’universel, c’est le local sans les murs. En revanche, cela ne doit pas s’apparenter à un enfermement régionaliste ou communautariste, bien au contraire ! Posséder des racines ne doit pas empêcher d’avoir des ailes. On ne rappellera jamais assez que nous appartenons à une communauté qui s’appelle l’humanité. Pour cette raison, nous devons tous voter les amendements qui visent à supprimer la phrase proposée à l’article 1er A pour compléter l’article 1er de la Constitution.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC. – MM. Jean-Luc Mélenchon et Michel Charasse applaudissent également.

La parole est à M. Adrien Gouteyron, pour présenter l'amendement n° 250 rectifié ter.

Tout d’abord, je me réjouis que plusieurs amendements de suppression de l’article 1er A du projet de loi constitutionnelle émanent des différentes travées de la Haute Assemblée. C’est déjà un signe.
Tout à l’heure, plusieurs orateurs ont fait référence à « ce qui nous rassemble ». À mon sens, l’article 1er de la Constitution est fait pour rappeler ce qui nous rassemble, et non ce qui nous distingue.
Mes chers collègues, prenons le texte. Actuellement, l’article 1er dispose : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. » L’article 1er A du projet de loi vise à ajouter les mots : « Les langues régionales appartiennent à son patrimoine. »
Sentez-vous, comme moi, le décalage et la chute ?
M. Michel Charasse acquiesce.

L’organisation « décentralisée » de la République n’en est pas à la hauteur non plus !

C'est la première raison pour laquelle j’ai déposé cet amendement de suppression.
Pour ma part, je suis également attaché aux langues régionales. D’ailleurs, je fais partie de membres de cette assemblée qui en parlent une correctement, et qui la comprennent parfaitement.
Simplement, je songe en ce moment à ceux qui, chez moi, m’ont enseigné le français. Même s’ils parlaient une langue régionale, ils considéraient que la langue de notre pays, c’est le français.
Mes chers collègues, je crois sincèrement que le sujet dont nous débattons actuellement n’est ni mineur ni anecdotique. Il est essentiel.
À l’article 1er de la Constitution, nous devons, me semble-t-il, affirmer ce qui nous rassemble, et non ce qui nous distingue. Or, avec le dispositif que le présent article 1er A vise à instituer, nous sommes, je le crois, dans ce qui nous distingue.
S'agissant de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, je rejoins totalement la position qui a été défendue par plusieurs de nos collèges. En réalité, même s’il n’est pas avoué, le véritable motif de l’insertion d’une telle disposition à l’article 1er de la Constitution est bien de conduire la France là où elle ne veut pas aller.
Si nous nous engagions dans une telle voie, ce n’est pas un quelconque document interprétatif – je rappelle que Jacques Chirac et Lionel Jospin, qui étaient alors respectivement Président de la République et Premier ministre, avaient déjà signé une déclaration interprétative en 1999 – qui nous empêcherait d’être soumis aux obligations de la Charte, car il n’aurait pas une valeur juridique suffisante.
Par conséquent, mes chers collègues, ne nous laissons pas aller et supprimons la référence aux langues régionales qui nous est ici proposée. §

La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l'amendement n° 260 rectifié.

Moi aussi, je me réjouis de constater que des amendements identiques ont été déposés par des collègues venant de tous les groupes politiques représentés dans notre Haute Assemblée. En effet, il s’agit d’un sujet important.
Naturellement, je partage ce qui a été souligné par la plupart de nos collègues.
Certes, et je ne le conteste pas, les langues régionales appartiennent à notre histoire. À ce titre, elles sont l’un des éléments constitutifs de notre patrimoine.
Pour autant, je ne vois pas – ou, plutôt, je ne le vois que trop bien – pourquoi certains voudraient leur attribuer une existence constitutionnelle. Comme cela a été rappelé à plusieurs reprises, la Constitution est la loi fondamentale. Nous ne pouvons pas en faire un texte déclaratif qui contiendrait un certain nombre de dispositions uniquement destinées à faire plaisir aux uns ou aux autres.
La Constitution est la loi qui régit le fonctionnement de nos institutions. Or je ne vois pas en quoi la pratique des langues régionales relève du fonctionnement de nos institutions. Plus précisément, je redoute que l’on ne prenne ensuite prétexte d’une telle disposition pour rendre obligatoire l’apprentissage des langues régionales ou pour imposer la communication des documents publics dans deux langues, le français et la langue régionale locale. Nous mettrions ainsi le doigt dans un engrenage qui conduirait à une remise en cause de notre unité nationale.
En outre, et cela a été soulevé par plusieurs orateurs, si nous devions reconnaitre l’appartenance des langues régionales à notre patrimoine, pourquoi nous limiterions-nous à celles-ci ? Pourquoi ne pas également mentionner nos paysages ou notre patrimoine bâti ?

En tant que Marnais, je pourrais par exemple exiger la reconnaissance constitutionnelle de la cathédrale de Reims, qui a accueilli le baptême de Clovis par Saint Remi. C’est évidemment également un élément constitutif de notre patrimoine.

M. Yves Détraigne. En effet, pourquoi ne pas évoquer aussi dans la Constitution le château de Versailles ? Nous pourrions même y faire figurer nos spécialités culinaires. Le cassoulet, c’est important ; cela participe à notre réputation !
Rires.
Mêmes mouvements.

Effectivement, mon cher collègue.
Quoi qu’il en soit, préservons notre loi fondamentale. N’entrons pas dans ce jeu qui consisterait à y faire figurer de simples déclarations – ce n’est pas l’objet d’une Constitution – pour faire plaisir aux uns ou aux autres.
Applaudissements sur plusieurs travées de l ’ UC-UDF et de l ’ UMP.

Je rappelle qu’il a été procédé à l’affichage de la liste des candidats aux fonctions de membre de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie.
Le délai fixé par le règlement est expiré.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée, et je proclame membres de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de modernisation de l’économie : Mme Marie-France Beaufils, MM. Laurent Béteille et Claude Biwer, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cambon, Jean-Claude Carle, Gérard Cornu et Serge Dassault, Mmes Isabelle Debré et Christiane Demontès, MM. Éric Doligé, Philippe Dominati, Jean-Paul Émin, François Fortassin, Alain Fouché, Jacques Gautier, Jean-Pierre Godefroy, Alain Gournac et Jean-Jacques Jégou, Mme Bariza Khiari, MM. Pierre Laffitte et Serge Lagauche, Mme Élisabeth Lamure, MM. Gérard Larcher, Gérard Longuet, Philippe Marini, Marc Massion et Jean-Marc Pastor, Mmes Anne-Marie Payet et Catherine Procaccia, MM. Daniel Raoul, Thierry Repentin, Bruno Retailleau, Henri de Richemont et Jean-Pierre Sueur, Mme Odette Terrade et M. Richard Yung.

Nous reprenons la discussion du projet de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale, de modernisation des institutions de la Ve République.
Nous poursuivons l’examen de l’article 1er A.

Six des onze amendements faisant l’objet d’une discussion commune ont déjà été présentés.
L'amendement n° 95, présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. L'article 1er de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les langues régionales appartiennent à son patrimoine. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. »
III. En conséquence, le dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution est supprimé.
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement a deux objets. C’est en cela que la situation est un peu plus compliquée.
D’ailleurs, si les amendements identiques tendant à supprimer l’article 1er A étaient adoptés, nous serions amenés à scinder cet amendement en deux, pour n’en conserver que la seconde partie.
La commission des lois du Sénat a décidé de maintenir l’article 1er A dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, où les débats ont été extrêmement longs et parfois vifs. En effet, les commissaires ont estimé que la reconnaissance constitutionnelle de l’appartenance des langues régionales à notre patrimoine n’aurait pas pour effet d’obliger la France à ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. De ce point de vue, j’ai suivi les débats sur le sujet à l’Assemblée nationale.
La commission a jugé qu’il n’était pas nécessaire de supprimer la disposition adoptée par nos collègues députés.
Un autre point a été très débattu. Faut-il mentionner les langues régionales dès l’article 1er de la Constitution, alors que la disposition selon laquelle la langue de la République est le français ne figure qu’à l’article 2 ? C’est effectivement une question importante.
Certes, la solution retenue par nos collègues députés me laisse un peu sceptique. Mais il est vrai que l’article 2 de la Constitution fait partie des dispositions relatives à la « souveraineté ». Or, si la langue française relève bien de la souveraineté, ce n’est certainement pas le cas des langues régionales. Vous le voyez, nous sommes dans une situation difficile.
Ce qu’il nous faudrait, ce serait, en quelque sorte, un « article-balai » qui contiendrait des dispositions à caractère déclaratif, mais sans grande portée juridique. Malheureusement, un tel article n’existe pas dans la Constitution…
Sourires.

Telle est la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. J’ai écouté les différents arguments qui ont été échangés. D’ailleurs, des problèmes similaires risquent d’apparaître dans quelques instants, lorsque nous examinerons les propositions ayant trait à la francophonie, sujet sur lequel notre collègue Legendre a émis des suggestions extrêmement intéressantes.
En revanche, la seconde partie de l’amendement vise à insérer les dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales, à l’article 1er de la Constitution.
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi constitutionnelle tend à faire figurer « l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales » à l’article 34. Pour ma part, je pense qu’une telle disposition a tout à fait sa place à l’article 1er.
Monsieur le président, si vous le permettez, je propose de vous donner tout de suite l’avis de la commission sur les amendements tendant à supprimer l’article 1er A.
Comme vous l’avez compris, la commission souhaite le maintien de la mention des langues régionales dans la Constitution.
Murmures ironiques.

Dès lors, je suis tenu d’émettre un avis défavorable sur les amendements de suppression.
Toutefois, comme d’éminents membres de la commission qui avaient voté le maintien de l’article 1er A en demandent à présent la suppression, je suis extrêmement embarrassé sur le sujet. §

L’amendement n° 95 est assorti de huit sous-amendements.
Le sous-amendement n° 304 rectifié, présenté par MM. Béteille et de Richemont, est ainsi libellé :
Supprimer le I de l'amendement n° 95.
La parole est à M. Laurent Béteille.

J’aurais pu reprendre la plupart des arguments qui ont été évoqués par les différents orateurs ayant défendu des amendements de suppression de l’article 1er A.
Cela dit, j’ai préféré déposer un sous-amendement à l’amendement de la commission. J’en profite pour signaler à M. le président de la commission que je regrette de n’avoir pas pu assister à la réunion au cours de laquelle cet amendement a été approuvé.
L’amendement n° 95 a deux objets. Il vise, d’une part, à reprendre le texte relatif aux langues régionales adopté par l’Assemblée nationale et, d’autre part, à insérer des dispositions relatives à l’égalité professionnelle et sociale des femmes et des hommes.
Pour ma part, je ne souhaite pas la suppression de la seconde partie de cet amendement. En effet, dès lors que l’article 1er de la Constitution vise à proscrire toute discrimination, on peut y faire figurer une disposition destinée à lutter contre les discriminations entre les hommes et les femmes.
Certes, le texte qui nous est proposé manque un peu de concision. Personnellement, j’aurais volontiers suivi les explications que M. Robert Badinter nous a apportées tout à l’heure. Nous aurions ainsi pu insérer les mots « de sexe » après les mots « d’origine, de race ou de religion » à l’article 1er de la Constitution.
Ce sous-amendement vise à supprimer la référence totalement incongrue et baroque aux langues régionales. Je ne reprendrai pas les arguments qui ont été énoncés de manière tout à fait convaincante par les différents intervenants. Mais je pense qu’une telle phrase n’a sûrement pas sa place dans notre Constitution.
Mme Janine Rozier et M. Jackie Pierre applaudissent.

Le sous-amendement n° 38 rectifié bis, présenté par M. Cointat et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du I de l'amendement n° 95 par le mot :
culturel
La parole est à M. Christian Cointat.

J’aurais été tenté de soutenir les amendements tendant à supprimer la référence aux langues régionales dans la Constitution.
Mais, nous devons en être bien conscients, l’histoire des peuples et celle de leur langue sont intimement liées. Nos concitoyens qui vivent dans des régions sont très attachés à cet héritage du passé que représentent les langues régionales.
Certes, le patrimoine de la République française est très vaste. Mais les langues doivent faire l’objet d’un traitement séparé, car elles font partie des racines de certains de nos concitoyens.
Un poète breton a prononcé cette phrase très belle : « La Bretagne est une province de l’âme avant d’être une terre que l’on habite. » Cela vaut également pour toutes les autres régions. L’histoire de la langue fait également partie intégrante de l’individu.
Dans ces conditions, faut-il supprimer l’article 1er A du projet de loi constitutionnelle ? Peut-être.
Mais n’y a-t-il pas une autre manière de contourner l’obstacle ? Si nous devons faire en sorte que les langues régionales ne deviennent pas un outil de communication, car cela créerait des frontières linguistiques portant atteinte à l’unité de la République, elles constituent également une richesse culturelle.
C’est pourquoi ce sous-amendement a pour objet d’ajouter l’adjectif « culturel » après les mots « Les langues régionales appartiennent à son patrimoine » Ce n’est pas anodin. Une telle précision a pour vocation de démontrer que les langues régionales sont un élément de richesse culturelle, et en aucun un vecteur de communication.
La langue française fait également partie du patrimoine. Mais, en plus d’un élément culturel, c’est un outil de communication. Les langues régionales, quant à elles, doivent seulement faire partie de la richesse culturelle.

Le sous-amendement n° 4 rectifié bis, présenté par M. Charasse, Mme N. Goulet et M. Fortassin, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du I de l'amendement n° 95 par une phrase ainsi rédigée :
Leur usage et leur pratique ne peuvent remettre en cause les principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du Peuple français.
La parole est à M. Michel Charasse.

Monsieur le président, lorsque vous consulterez le Sénat tout à l’heure, nous aurons finalement deux solutions.
La première, c’est la suppression de l’article introduit par l’Assemblée nationale. Là, ce sera clair et net. Et nous venons de voir l’ensemble des amendements de suppression, auxquels je rajouterai celui qui a été défendu voilà quelques instants par M. Béteille, qui est un sous-amendement, mais qui revient au même, pour la première partie de l’amendement de la commission.
Ou bien, seconde solution, adopter l’amendement de M. Hyest. Le sous-amendement que je vous propose est la transformation d’un amendement qui figure un peu plus loin dans le dérouleur distribué.
Dans l’hypothèse où l’amendement de la commission serait adopté, je vous proposerais d’en préciser le paragraphe I en ajoutant la phrase suivante : « Leur usage et leur pratique ne peuvent remettre en cause les principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du Peuple français. »
Il s’agit exactement des mentions utilisées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 juin 1999, décision qui nous met à l’abri de toute tentative de transposition « à la hussarde » des dispositions de la Charte européenne des langues régionales qui ont été jugées incompatibles avec les grands principes de la République française.

Le sous-amendement n° 276 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mmes Férat et Dini et MM. Arthuis, Biwer, Deneux, Merceron, Nogrix, J.L. Dupont, Dubois et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Supprimer les II et III de l'amendement n° 95.
La parole est à Mme Muguette Dini.

Ce sous-amendement porte sur la seconde partie de l’amendement de M. Hyest.
Par ce sous-amendement, nous demandons la suppression de l’alinéa qui dispose : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. »
Cet alinéa a pour objet de permettre une politique dite de « discrimination positive ». Nous nous situons bien loin du principe d’égalité, devise de la République, bien en deçà du principe d’égalité entre les hommes et les femmes, affirmé et réaffirmé en droit.
L’article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 stipule que « Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »
Comment ne pas rappeler le Préambule de la Constitution du 17 octobre 1946, dans son article 3, qui dispose que « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. »
On retrouve cette affirmation de l’égalité entre hommes et femmes au niveau des textes européens. C’est le cas de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe ». Il en est de même de l’article 2 du traité de Rome, aux termes duquel la Communauté européenne a notamment pour mission de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. C’est sur la base de ce dernier que plusieurs directives communautaires ont été élaborées.
En droit interne, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est posée au travers notamment de la loi du 13 juillet 1983, qui a opéré la transposition de la directive du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, et surtout de la loi du 23 mars 2006 qui a trait à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Ces lois ont pour objectif une véritable mixité dans tous les secteurs et à toutes les étapes de la vie professionnelle. Parallèlement, il existe un arsenal juridique, en constante adaptation, permettant d’éliminer à tous les stades de l’activité professionnelle toute forme de discrimination.
Le dispositif juridique existe donc. Faut-il en rajouter, notamment dans le corps de la Constitution ? Faut-il, comme le propose la commission des lois, compléter le cinquième alinéa de l’article 3 de la Constitution ? Je ne le crois pas.
Introduire, comme le fit la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999, l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives répondait à la nécessité de la juste représentation de notre humanité sexuée, composée à égalité d’hommes et de femmes, dans les lieux où se décide notre vie quotidienne, c’est-à-dire dans les instances élues.
Cette disposition trouvait naturellement sa place dans la Constitution, du fait que celle-ci fixe l’organisation des pouvoirs publics. Cela dit, à plusieurs reprises, j’ai eu à regretter, dans cet hémicycle, que ce dispositif de parité n’ait que très peu fait évoluer le nombre des femmes élues au sein du Parlement.
La Constitution doit-elle aller jusqu’à poser le principe de parité dans les sphères professionnelles et sociales ? Je le répète, je ne le crois pas. Ce principe d’égalité existe. Les femmes, individuellement, doivent s’en emparer. Comme le dit fort justement Guy Carcassonne, « seuls les individus sont titulaires de droits égaux, la République ignore les groupes qui, par leur nature, introduiraient des discriminations ».
Les femmes disposent de droits égaux à ceux des hommes. Le vrai challenge est non pas d’établir des quotas par sexe, mais de permettre à chaque français, homme ou femme, de faire sien ce principe d’égalité, de poursuivre l’évolution de notre société en ce sens et de garantir, notamment dans le monde du travail, en plus de l’égal accès, l’égalité de traitement.
Cela dit, Mme le garde des sceaux a rappelé que le comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution, dont Mme Simone Veil assure la présidence, a été chargé d’examiner cette question. Doit-on permettre au législateur de mieux garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités, en dehors même de la sphère politique ? Attendons les conclusions dudit comité. Je fais toute confiance à Mme Veil pour réaffirmer que l’égalité entre les hommes, c’est aussi l’égalité entre les hommes et les femmes.
Je tiens à rappeler que l’article 1er de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 stipule : « Tous les êtres humains – donc les hommes et les femmes – naissent libres et égaux en dignité et en droits. » Ne galvaudons pas ce principe en le glissant au détour d’un article, en le découpant en petits morceaux et en lui enlevant ainsi toute sa valeur et son importance.
Notre sous-amendement, en supprimant cet alinéa, vise donc à redonner toute sa dignité au principe d’égalité entre les hommes et les femmes.
Applaudissements sur les travées de l ’ UC-UDF.

Monsieur le président, il me paraît difficile de continuer à avoir un débat de qualité en mêlant la question des langues régionales et celle de l’égal accès des hommes et des femmes aux responsabilités professionnelles et sociales.
Ayant le privilège de ne pas présider, monsieur le président, je me permets de vous demander s’il ne serait pas possible de disjoindre ces deux questions et d’organiser nos débats de telle sorte que nous finissions d’abord de traiter du problème des langues régionales. En effet, nous sommes en train de rendre confus un débat qui me semblait relativement clair, sans préjuger des positions de chacun.

M. le président. Monsieur Frimat, il aurait fallu prévoir cette distinction dès le départ. Maintenant, le débat est engagé.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Rien n’interdit de faire voter d’abord sur les amendements de suppression !

L’amendement de M. Hyest est assorti de huit sous-amendements que je suis obligé de faire présenter dans la foulée. Ensuite, nous en viendrons de nouveau à des amendements concernant les langues régionales. C’est le débat !

Les deux premiers de ces huit sous-amendements sont identiques.
Le sous-amendement n° 156 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Le sous-amendement n° 349 est déposé par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet, MM. Desessard et Muller.
Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :
Dans l'avant-dernier alinéa de l'amendement n° 95, remplacer le mot :
favorise
par le mot :
assure
La parole est à Mme Annie David, pour présenter le sous-amendement n° 156.

Monsieur le président, il est vrai que, pour la clarté des débats, il aurait sans doute été préférable de clore la question des langues régionales.
Quoi qu’il en soit, pour défendre ce sous-amendement, je reprendrai une partie des arguments de ma collègue Muguette Dini, même si je n’en tire pas les mêmes conclusions - je suis d’ailleurs assez surprise que Mme Dini termine ses propos de la sorte.

Dans l’article 3 du Préambule de la Constitution du 17 octobre 1946, il est effectivement écrit que « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ». Jusque-là, madame Dini, je vous suis.
Depuis cette date, vous le savez, comme dans beaucoup d’autres domaines, l’égalité telle qu’elle est énoncée dans la devise de la République française est un combat de chaque jour, et l’égalité homme-femme ne déroge pas à cette règle. J’ai eu l’occasion de le rappeler encore récemment, lors de la transposition de directives concernant les discriminations, au sujet d’un amendement proposé par le Gouvernement qui remettait en cause la mixité dans les écoles.
Certes, notre société a évolué, les mentalités aussi, mais nous sommes encore loin du compte. Le simple exemple des écarts de salaire, à qualification égale, entre hommes et femmes nous prouve que ce combat n’est pas terminé.
L’égalité entre hommes et femmes, c’est aussi l’égalité d’accès aux responsabilités, comme élu, comme représentant dans une institution publique ou dans un conseil d’administration d’une grande entreprise. Partout où les décisions sont prises, il faut que les femmes puissent être représentées au même titre que les hommes. C’est seulement lorsque nous donnerons aux femmes le pouvoir d’être représentées à égalité avec les hommes que nous pourrons parler de parité.
Or le terme « favorise », qui figure dans l’amendement de M. Hyest, ne nous semble pas à la hauteur de cette ambition. C’est pourquoi nous proposons de lui substituer le mot « assure ».
Voilà quelques instants, nous évoquions justement, au sein de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, le rapport concernant l’accès des femmes aux études et aux hautes responsabilités qui doit être rendu cette année. Il est prouvé que les jeunes filles et les femmes réussissent très bien à l’école, mais qu’elles n’accèdent malheureusement que très rarement aux hautes responsabilités dans notre société.

Il faut donc continuer à défendre la parité en tous lieux ; tel est le sens de notre sous-amendement.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter le sous-amendement n° 349.

Le fait que nous traitions en même temps de la question de l’égalité homme-femme et des langues régionales complique quelque peu nos débats. Ceux-ci mériteraient une meilleure organisation sur ces questions.
Pour en venir à notre proposition, il s’agit d’un sous-amendement de repli, qui vise à remplacer le mot « favorise » par le mot « assure ». Je doute en effet de la cohérence rédactionnelle de l’article. Nous proposons d’instaurer une obligation positive d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes. En fait, dans ce domaine, il s’agit non pas d’une obligation de moyens, mais d’une obligation de résultat.
Or favoriser, c’est donner un plus ; assurer, c’est garantir. Nous devons considérer que la parité nous incombe comme une règle, pas comme un objectif. C’est pourquoi le mot « assure » me paraît préférable.

Le sous-amendement n° 399 rectifié, présenté par M. About, Mme Payet et M. Merceron, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du II de l'amendement n° 95 par les mots :
, et l'accès à l'emploi des personnes handicapées en mesure de travailler
La parole est à M. Nicolas About.

M. Nicolas About. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, curieusement, je suis le premier surpris d’avoir déposé ce sous-amendement ainsi que le suivant
Sourires

Si la loi doit défendre les plus faibles, la loi fondamentale – la Constitution – doit défendre les plus faibles parmi les faibles. Aussi, les sous-amendements n° 399 rectifié et 400 rectifié ont pour objet de rappeler l’obligation de favoriser l’égal accès à l’emploi des personnes handicapées et le maintien en activité des personnes les plus âgées.
J’espère cependant que toutes ces mentions vont disparaître pour sauvegarder la qualité de notre Constitution !

Le sous-amendement n° 400 rectifié, présenté par M. About, Mme Payet et M. Merceron, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa du II de l'amendement n° 95 par les mots :
, ainsi que le maintien en activité des personnes âgées de plus de cinquante ans
La parole est à M. Nicolas About.

L'amendement n° 315, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article 1er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage. Les langues régionales appartiennent à son patrimoine ».
La parole est à M. Jean-René Lecerf.

Monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 315 et l'amendement n° 57 rectifié.
Tout le monde l’a constaté : la référence aux langues régionales pose problème et place bon nombre d’entre nous dans l’embarras.
Sur l'article 1er Adu projet de loi constitutionnelle, je suis à la fois l’auteur de l'amendement n° 315 et un des cosignataires des amendements n° 77 et 57 rectifié.
Si, je l’avoue, c’est à l'amendement de suppression n° 77 présenté par Patrice Gélard que va ma préférence, je reste conscient non seulement de l’attachement de notre population aux langues régionales – je pourrais poursuivre cette intervention dans la langue du Nord chère à Jules Mousseron qu’évoquait tout à l’heure notre collègue Ivan Renar, mais je m’en abstiendrai, rassurez-vous !
Sourires

Tout à fait, mon cher collègue !
L'amendement n° 315 vise à concilier la référence à la francophonie avec la reconnaissance des langues régionales. Il me paraît très bien rédigé et si je me permets de le dire, c’est parce que j’ai emprunté sa rédaction à celle qu’avait proposée mon collègue Jacques Legendre pour l’un de ses amendements initiaux.
En signalant dans l'article 1er que « la République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage », avant même qu’il soit fait référence aux langues régionales, la primauté est redonnée au français sur les langues régionales. À mon sens, cela annule tout risque de ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, à laquelle je ne suis personnellement pas du tout favorable.
Il faut considérer l'amendement n° 57 rectifié comme une autre tentative de conciliation. Il vise à maintenir la référence aux langues régionales, tout en la déplaçant à l'article 2 de la Constitution, soit après la mention du français comme langue de la République. Toutefois, je suis bien conscient de l’inconvénient que cela comporte et qui a été signalé par M. le rapporteur : cette reconnaissance serait alors incluse dans le titre Ier intitulé « De la souveraineté », où elle n’a pas grand-chose à faire.
Monsieur le président, je tiens à insister sur ce point. Pour moi-même, comme pour un certain nombre de collègues, il est absolument indispensable de savoir si la référence à la francophonie sera placée avant la reconnaissance des langues régionales. Si tel n’était pas le cas et si elle devait intervenir après l'article 31, cela résoudrait la question de la francophonie...

...– Jacques Legendre nous le confirmera –, mais pas celle des langues régionales, ce qui me conduirait à voter en faveur des amendements identiques de suppression.

Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 57 est présenté par MM. Virapoullé et Lecerf.
L'amendement n° 356 est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller,
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Au début du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
L'article 1er
par les mots :
Le premier alinéa de l'article 2
L’amendement n° 57 rectifié a déjà été défendu.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 356.

Là encore, la situation est un peu compliquée.
La révision de l’article 1er de la Constitution est une opération extrêmement grave et il n’est pas question de transformer cet article en un article fourre-tout. Aussi, monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 356 et l'amendement n° 368, pour essayer d’expliquer les raisons qui, à mes yeux, justifient le déplacement de dispositions d’un article à un autre.
En effet, je regrette le maintien à l’article 1er de la référence aux langues régionales, où je considère qu’elle n’a pas sa place. Selon moi, il conviendrait, et c’est l’objet de l'amendement n° 356, de déplacer cette référence de l'article 1er à l'article 2, bien sûr après qu’il est précisé que « la langue de la République est le français ».
S’agissant du principe selon lequel la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, le fait de le faire remonter de l'article 3 à l'article 1er me semble important. En effet, cela permet de montrer que l’égalité entre les hommes et les femmes et la parité doivent exister dans le domaine professionnel et social comme dans le domaine électoral et politique.
S’il est essentiel que ces principes soient inscrits dans la Constitution, ils n’ont pas leur place dans l'article 1er. La parité doit figurer à l'article 3, et la référence aux langues régionales dans l'article 2.
Il paraît aujourd'hui impossible de lutter contre les discriminations sans mentionner celles qui sont fondées sur le sexe et qui se manifestent dans différents domaines, qu’ils soient social, professionnel ou politique, et contre lesquelles la réponse est la parité.

L'amendement n° 376 rectifié, présenté par MM. Legendre, Gouteyron, Marini, Romani, Bourdin, Duvernois, Fournier, Gaillard et Cointat, est ainsi libellé :
Compléter le second alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Elle participe à un espace francophone de solidarité.
La parole est à M. Jacques Legendre.

Curieusement, la Constitution ne mentionne pas la participation de la France à la création d’un ensemble solidaire de pays ayant le français en partage.
À plusieurs reprises, des tentatives ont été engagées pour inscrire la francophonie comme un élément de l’action de notre République. Cette disposition a été évoquée en 1995 – si elle avait alors été adoptée par le Sénat, elle n’avait pas été retenue par l'Assemblée nationale –, puis en 1996 et en 1998. Je souhaite rappeler ici la mémoire de Maurice Schumann, avocat déterminé et talentueux à l’origine de cette initiative.

Mais, si cette dernière révision ne permettait pas l’inscription de la francophonie dans la Constitution, aujourd'hui, incontestablement, c’est possible.
Dans quel article de la Constitution faut-il faire référence à la francophonie, c'est-à-dire à la solidarité qui nous lie aux pays ayant le français en partage et que nous devons à notre histoire, comme la géographie nous place, elle, en Europe ? Or nous inscrivons bien dans la loi fondamentale l’Europe comme un élément essentiel de notre espace de vie et d’action.
J’ai déposé cet amendement visant à inscrire la francophonie à l'article 1er, pour des raisons un peu circonstancielles.
Nous venons d’avoir un débat de qualité sur les langues régionales, qui témoigne de notre respect et de notre attachement à toutes les langues. N’opposons pas l’attachement aux langues régionales de certains de nos compatriotes à la langue française, qui est la seule langue de la République, celle qui traduit notre façon de vivre ensemble et inscrit la volonté politique dans la loi.
Toutefois, il me semble impensable de mentionner l’existence des langues régionales avant même d’avoir indiqué dans la Constitution que le français est la langue de la République. Or cette précision n’apparaît qu’à l'article 2.
Si le Sénat devait maintenir la reconnaissance des langues régionales, il serait indispensable d’évoquer antérieurement la francophonie, c'est-à-dire dès l'article 1er. En revanche, si la référence aux langues régionales n’était pas votée, l’inscription de la présence de la France dans la construction de la francophonie pourrait figurer dans un autre article de la Constitution, par exemple au titre XIV, dans un article 87.
Je souhaite que le Gouvernement nous précise sa position sur ce point, afin de savoir s’il accepte que la francophonie soit mentionnée à l'article 1er – une fois clos le débat sur la référence aux langues régionales – ou dans le titre XIV de la Constitution.

Je rappelle que la disposition votée par l'Assemblée nationale ne porte en rien atteinte aux principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français.
Il s’agissait, pour les députés, d’indiquer dans notre Constitution la valeur et la place des langues régionales dans notre patrimoine.
Ce patrimoine linguistique est le plus riche d’Europe, avec soixante-dix-neuf langues identifiées, notamment celles qui existent dans les collectivités d’outre-mer et dont certaines sont d’ailleurs en voie de disparition.

Je pense ainsi au marquisien, mais il en est beaucoup d’autres, que certains de nos collègues élus de l’outre-mer parlent quasiment sans difficulté.
Les questions liées aux langues sont délicates et complexes, car la langue est un élément important de notre identité nationale et un instrument de communication.
Je rappelle la décision du Conseil constitutionnel en date du 15 juin 1999, que certains ont évoquée et qui affirme l’obligation d’utiliser le français, langue de la République, dans la sphère publique. Elle autorise par ailleurs les enseignements en langue régionale, sous réserve qu’ils ne soient pas obligatoires et ne portent pas préjudice aux exigences du service public de l’enseignement.
La disposition adoptée par l'Assemblée nationale ne diminue aucunement la place du français dans notre sphère publique, place qui est affirmée depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, laquelle en a imposé l’usage aux parlements et aux tribunaux.
La commission des lois a donc considéré qu’il ne fallait pas exagérer la portée de la reconnaissance qui serait ainsi accordée aux langues régionales. Même si le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale n’a certes pas été des plus limpides sur ce sujet, la disposition introduite ne permettrait nullement de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
Tel est le point de vue de la commission des lois. C’est d’ailleurs pour cette raison que l'amendement n° 95 reprend cette disposition, sans la modifier.
À ce titre, et sans vouloir rouvrir un débat qui a été extrêmement complexe à l'Assemblée nationale, la commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques de suppression.
Si ceux-ci étaient adoptés, l’amendement de la commission ainsi que les sous-amendements afférents deviendraient sans objet. Dans ce cas, afin d’inscrire dans l'article 1er la référence à l’égalité professionnelle et sociale entre les femmes et les hommes, je déposerais au nom de la commission des lois un nouvel amendement tendant à insérer un article additionnel, qui ne comprendrait que la seconde partie de l'amendement n° 95.
J’en viens aux sous-amendements à l'amendement n° 95.
Sur le sous-amendement n° 304 rectifié, la commission émet un avis défavorable.
En revanche, la précision que tend à apporter le sous-amendement n° 38 rectifié bis me semble pertinente. La commission y est donc favorable
Pour ce qui concerne le sous-amendement n° 4 rectifié bis, la commission n’a pu l’examiner.
M. Michel Charasse s’exclame.

Le sous-amendement n° 276 rectifié, quant à lui, a pour objet de supprimer l’introduction à l’article 1er de la Constitution du principe selon lequel la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que l’Assemblée nationale avait introduit cette disposition à l’article 34 de la Constitution. Or, ce n’est pas sa place puisque l’article précité fixe les règles dans un certain nombre de domaines.
De surcroît, nous avons déjà adopté, voilà quelques années, une disposition relative à l’égalité en politique. Par la suite, une décision du Conseil constitutionnel a empêché que soit également favorisée l’égalité dans le domaine économique et social.
En déposant l’amendement n° 95, la commission a simplement voulu déplacer la disposition tendant à favoriser l’égal accès aux responsabilités professionnelles et sociales. Elle n’a pas du tout repris le texte de l’Assemblée nationale.
Une question se pose, mes chers collègues : êtes-vous contre ce principe ou contre son introduction à l’article 1er de la Constitution ? Je crois avoir compris que vous y êtes opposés. La commission émet donc un avis défavorable sur le sous-amendement n° 276 rectifié.
J’en viens aux sous-amendements identiques n° 156 et 349. Le choix entre « favorise » et « assure » peut donner lieu à un débat. Mais l’emploi du verbe « favorise » constitue d’ores et déjà un progrès. À chaque jour suffit sa peine !

Dans certains cas, assurer l’égal accès des femmes et des hommes pourrait se révéler compliqué, notamment dans l’enseignement ou dans la magistrature. La commission émet donc un avis défavorable.
Concernant le sous-amendement n° 399 rectifié, rappeler la place des handicapés dans notre société est important. Mais on ne peut pas dresser une liste indéfinie des personnes qui doivent être favorisées.
Monsieur About, je vous remercie d’avoir signalé que la Constitution ne doit pas énumérer une liste trop importante de catégories, sinon ce sera incompréhensible et de grands principes ne pourront plus être dégagés. Il est toujours très dangereux de procéder à une énumération. La commission est donc défavorable à ce sous-amendement.
La commission émet le même avis sur le sous-amendement n° 400 rectifié.
L’amendement n° 315 tend à apporter une précision bienvenue, qui contrebalancerait utilement la reconnaissance de la valeur patrimoniale des langues régionales. Toutefois, la commission préfère de loin l’amendement n° 377 rectifié de M. Legendre, qui tend à insérer un article additionnel après l’article 31 et que nous examinerons, par conséquent, ultérieurement. Je vous demande donc, monsieur Lecerf, de bien vouloir retirer l’amendement n° 315 au profit de l’amendement n° 377 rectifié.

Bien que ces deux amendements soient très proches, l’amendement n° 377 rectifié me paraît plus complet. De plus, il prévoit d’insérer cette disposition dans le titre XIV de la Constitution, ce qui me semble préférable. La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 315.
Je veux faire remarquer en cet instant que depuis ce matin, nous traitons de sujets qui ne constituent pas le cœur de la révision constitutionnelle et qui ne figuraient pas dans le projet de loi initial.
Pour ce qui concerne les amendements identiques n° 57 rectifié et 356, certains veulent faire figurer à l’article 2 de la Constitution les langues régionales, après la référence au français – spontanément, j’aurais agi de même–, mais l’article 2 de la Constitution traite de la souveraineté.

Y mentionner les langues régionales poserait un problème. L’article 1er énonce des principes. La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Quant à l’amendement n° 376 rectifié, comme précédemment, la commission préfère l’amendement n° 377 rectifié, qui est plus complet. Elle émet donc un avis défavorable.
Si vous me le permettez, monsieur le président, je traiterai d’abord les amendements relatifs aux langues régionales, puis les autres.
Les langues régionales sont abordées dans les amendements n° 3 rectifié, 77, 145, 157, 250 rectifié ter, 260 rectifié, les sous-amendements n° 304 rectifié, 4 rectifié bis et 38 rectifié bis ainsi que les amendements n° 57 rectifié et 356.
L’article 1erA relatif aux langues régionales résulte d’un amendement introduit par les députés. Il dispose que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Je constate, en cet instant, l’existence d’un profond désaccord entre le Sénat et l’Assemblée nationale sur cette question.
Je tiens à préciser que, initialement, cet article ne faisait pas partie du projet de loi constitutionnelle. Nous avons trouvé un compromis relatif à l’inscription des langues régionales dans la Constitution.
Sourires.
Plusieurs amendements, qui vont d’ailleurs bien au-delà de la position de la commission des lois, tendent à la suppression de cette mesure.
Pour plusieurs d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, une telle disposition n’est pas normative et n’a donc pas sa place dans la Constitution. Selon vous, monsieur Gouteyron, elle remet même en cause les principes d’égalité des citoyens, d’indivisibilité et d’unicité de la République.
Comme vous le savez, de nombreux députés ont manifesté leur grand attachement à la reconnaissance des langues régionales – ils voulaient même que l’on aille bien au-delà – et ils ont souhaité que celui-ci se traduise par une inscription dans la Constitution. Ils ont estimé que le projet de loi annoncé par le Gouvernement tendant à faire mieux vivre les langues régionales dans notre pays était positif, mais qu’une reconnaissance plus solennelle était nécessaire.
Cet amendement répond également aux souhaits émis par nombre d’entre vous lors du débat sur les langues régionales qui a eu lieu ici même le 13 mai dernier.
Il ne s’agit absolument pas de remettre en cause l’article 2 de la Constitution qui dispose que « La langue de la République est le Français ». C'est pourquoi le Gouvernement n’a pas souhaité que les langues régionales soient visées à cet article. Ce point a également fait l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale.
Il ne s’agit pas non plus de créer le droit pour les particuliers d’exiger des administrations l’usage d’une autre langue que le français ou des droits spécifiques pour des groupes.
Il s’agit de reconnaître que les langues régionales sont une richesse de notre patrimoine. Elles font partie de notre identité.
Il convient donc de les préserver.
Monsieur Charasse, vous dites que l’usage et la pratique des langues régionales ne doivent pas remettre en cause les principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français. Je suis entièrement d’accord avec vous. C'est pourquoi il est proposé de faire figurer ces langues à l’article 1er de la Constitution.
Les principes constitutionnels que vous avez rappelés doivent demeurer, et l’amendement adopté par l’Assemblée nationale ne les remet absolument pas en cause, puisqu’il s’agit, je le rappelle, d’un compromis entre le Gouvernement et les députés. Il ne reconnaît en aucune manière des droits particuliers à des groupes de locuteurs. L’indivisibilité du territoire, l’unicité du peuple français, l’égalité devant la loi ne sont donc pas écornées.
Pour toutes ces raisons, j’estime que les amendements de suppression ou de précision qui ont été présentés sont inutiles.
Monsieur Cointat, vous proposez d’ajouter l’adjectif « culturel » après le mot « patrimoine ». Je ne crois pas que cet ajout soit nécessaire. Le terme « patrimoine » est suffisamment clair et global.
M. Christian Cointat fait un signe de dénégation.
Certains d’entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, font valoir qu’une telle disposition aurait mieux sa place à l’article 2 de la Constitution. Tel fut le débat à l’Assemblée nationale. Nombre de députés ont d’ailleurs hésité. J’estime que le choix effectué, à savoir le maintien de cette disposition à l’article 1er, fut le bon.
En effet, l’article 2 de la Constitution concerne la République et s’inscrit dans le titre Ier, consacré à la souveraineté. Le français est la langue de la République française, comme il est la langue de la France, ainsi que vous l’avez rappelé tout à l’heure, monsieur Renar, depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539.
L’article 1er est relatif à la France, dans toute sa diversité, acceptée et assumée, au nom du principe d’égalité devant la loi et du respect des différences. Cette diversité est prise en compte sur le plan administratif, notamment par l’organisation décentralisée. C'est pourquoi le Gouvernement a estimé que les langues régionales avaient leur place dans cet article, qui mentionne l’organisation décentralisée de la République.
Dans cette reconnaissance de notre diversité, les langues régionales ont toute leur place. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements et sous-amendements que j’ai cités au début de mon intervention.
J’en viens aux amendements et sous-amendements qui ne concernent pas les langues régionales. Le Gouvernement est uniquement favorable à l’amendement n° 95, présenté par la commission. Il est, par conséquent, défavorable au sous-amendement n° 276 rectifié, aux sous-amendements identiques n° 156 et 349, aux sous-amendements n° 399 rectifié et 400 rectifié, ainsi qu’aux amendements n° 315 et 376 rectifié.
L’objectif de parité en matière politique a été reconnu à l’article 3 de la Constitution par la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté le principe de la parité dans le domaine des responsabilités professionnelles et sociales. Elle a donc introduit de nouvelles dispositions à l’article 34 de la Constitution relatif au domaine de la loi.
Monsieur le rapporteur, vous proposez de regrouper ces dispositions à l’article 1er de la Constitution, qui a trait à la diversité de notre nation et réaffirme les principes d’égalité et de respect mutuel. Cette proposition est tout à fait judicieuse. La Constitution y gagnera en clarté et, surtout, en cohérence. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 95.
Monsieur Détraigne, vous critiquez l’introduction dans la Constitution de la disposition tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales. La question a été soumise au comité de réflexion sur le préambule de la Constitution, dont la lettre de mission comporte l’interrogation suivante : « Doit-on permettre au législateur de mieux garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités, en dehors même de la sphère politique ? » C’est pour cette raison que le Gouvernement s’était déclaré défavorable à l’amendement initial qui avait été déposé au Palais-Bourbon. Toutefois, l’Assemblée nationale a considéré qu’elle était suffisamment éclairée pour trancher la question et a souhaité faire figurer ladite disposition dans la Constitution, et non dans le préambule.
Vous avez également indiqué que la disposition du préambule de 1946 en vertu de laquelle « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme » serait plus favorable. Je rappelle que, au contraire, la jurisprudence du Conseil constitutionnel montre les limites de l’application stricte du principe d’égalité.
Ainsi, il n’est pas possible, sans modifier la Constitution, de prévoir une proportion minimale de femmes au sein des conseils d’administration, des conseils de surveillance, des comités d’entreprise, sur les listes des candidats aux conseils de prud’hommes ou autres organismes paritaires de la fonction publique. Telle est la décision prise au mois de mars 2006 par le Conseil constitutionnel. J’en déduis, par conséquent, que l’amendement adopté a toute sa pertinence. De ce fait, le Gouvernement émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 276 rectifié.
Mesdames, messieurs les sénateurs, plusieurs d’entre vous souhaitent que le principe de parité soit renforcé dans la Constitution et qu’il soit imposé au législateur d’assurer, et non de favoriser, l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités. Le choix du verbe « favorise » a été longuement débattu lors de la discussion de la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Le texte adopté à l’époque était déjà le fruit d’un compromis. Il permet au législateur de disposer de la liberté d’appréciation nécessaire pour adopter soit des mesures contraignantes, soit des mesures incitatives. Le comité présidé par Mme Veil examine cette question. C’est pourquoi le Gouvernement avait initialement émis un avis défavorable à l’Assemblée nationale.
Dans l’attente du rapport qui sera remis par le comité d’ici à la fin de l’année, il paraît préférable de maintenir l’équilibre issu de la loi du 8 juillet 1999 et donc de maintenir les mêmes termes. Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir rejeter les sous-amendements déposés à l’amendement n° 95.
Monsieur About, vous souhaitez inscrire à l’article 1er de la Constitution que la loi favorise l’accès à l’emploi des personnes handicapées en mesure de travailler.
Le Président de la République a promis d’engager la France dans une démarche de long terme pour améliorer l’intégration des personnes handicapées au travers non seulement de l’accès à l’emploi, mais également de l’éducation. Des mesures seront prochainement proposées en ce sens par Valérie Létard. Votre préoccupation est donc pleinement prise en considération par le Gouvernement.
Je rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’insérer cette proposition dans la Constitution, dans la mesure où plusieurs textes – les lois du 10 juillet 1987, du 12 juillet 1990 et du 11 février 2005 – prennent d’ores et déjà en compte cette préoccupation.

Si les handicapés sont mieux défendus que les femmes, je vais retirer mon amendement !
Compte tenu de la différence de situation que connaissent les personnes handicapées, le Conseil constitutionnel admet que le législateur puisse prendre des mesures spécifiques en leur faveur. Il n’y a donc aucun verrou constitutionnel à lever.
Vous souhaitez aussi inscrire dans la Constitution que la loi favorise le maintien en activité des personnes âgées de plus de cinquante ans.
Là encore, le Gouvernement partage pleinement votre préoccupation et des propositions vous seront présentées très prochainement en ce sens. Il n’apparaît donc pas davantage nécessaire d’insérer ces dispositions dans la Constitution.
Je demande par conséquent au Sénat de rejeter les sous-amendements n° 399 rectifié et 400 rectifié, sauf si M. About accepte de les retirer.
Messieurs Lecerf et Legendre, vous souhaitez consacrer dans notre Constitution le principe de la participation de la France au développement de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.
La France est particulièrement attachée au développement de la francophonie, qui constitue un espace de plus de 180 millions de personnes. Elle agit avec ferveur en faveur de son rayonnement et cette action s’exprime au travers du réseau des Alliances françaises, des lycées français et des autres centres culturels. Elle s’appuie d’ailleurs sur l’Organisation internationale de la francophonie et sur l’organisation de sommets des chefs d’État.
Le comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution, présidé par Simone Veil, examine actuellement si cette question nécessite un ancrage constitutionnel. Nous vous demandons donc de bien vouloir retirer vos amendements, en attendant que ce comité rende ses conclusions. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Nous allons passer aux explications de vote sur les amendements.
La parole est à M. le rapporteur.

De quels amendements s’agit-il, monsieur le président ? Nous avons abordé deux sujets au cours de ce débat. Les explications de vote porteront donc sur les deux sujets. Chacun s’est d’ailleurs largement exprimé, sauf ceux, naturellement, qui n’ont pas souhaité prendre la parole.

Nous allons tout d’abord procéder au vote sur les six amendements identiques de suppression de l’article 1er A, qui concerne les langues régionales, et les explications de vote porteront sur ces amendements.

J’ai l’impression, monsieur le président, que certaines explications de vote concerneront l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, dispositions qui font l’objet de la deuxième partie de l’amendement n° 95 de la commission. Ceux qui souhaitent s’exprimer sur ce sujet devront donc le faire dans un second temps.

Tout à fait !
La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote sur les amendements identiques de suppression.

En premier lieu, je serai beaucoup plus mesuré que ceux des orateurs précédents qui ont comparé, de façon quelque peu abusive, les langues régionales avec la gastronomie, les cathédrales ou le champagne. Le sujet dont nous discutons me paraît suffisamment sérieux pour que nous évitions ce genre de comparaisons.
Il me semble, en second lieu, que si nous devons parvenir à un accord sur un point, c’est bien celui de l’inscription de ces mesures à l’article 1er de la Constitution ; nous partageons en effet tous le même sentiment à cet égard. Seul persiste le problème de l’opportunité de cette inscription.
Il faut remettre les choses en perspective et simplifier le débat qui nous occupe.
Au fond, ces deux heures de discussion symbolisent la politique de « l’entrisme », si j’ose dire, permanent menée par ceux qui souhaitent inscrire les langues régionales dans la Constitution.
J’ai noté, sur ce point, une évolution très sensible de la position du Gouvernement. En effet, à l’occasion d’une question orale avec débat que j’avais posée le 13 mai dernier, j’avais cru comprendre que le Gouvernement, qui avait anticipé ce débat en faisant une déclaration sur les langues régionales le 7 mai, souhaitait, par cette initiative, déminer le débat pour ne plus avoir à en parler à l’occasion de la révision constitutionnelle.
Or l’Assemblée nationale a saisi l’opportunité de cette réforme pour insérer dans la Constitution ces mesures relatives aux langues régionales. S’agit-il, de la part du Gouvernement, d’une faiblesse ou d’une décision de circonstance consistant à s’en remettre à la sagesse des parlementaires, compte tenu des difficultés qu’il rencontre par ailleurs ? Je n’en sais rien ! Toujours est-il que le Gouvernement est revenu sur sa position : alors qu’il refusait le débat voilà un mois, il a subitement changé d’avis et décidé d’inscrire ces dispositions à l’article 1er A du projet de loi constitutionnelle.
Notre collègue Adrien Gouteyron a parlé d’un sentiment de chute. J’ajouterai que le mot « culturel » accentue la chute. Nous avons l’impression d’un effilochage du texte constitutionnel, notamment s’agissant de l’article 1er de la Constitution.
Quel est le vrai débat qui nous occupe aujourd’hui ?
Compte tenu de la politique de l’entrisme – par précaution, je ne parle pas de lobbying car, à titre personnel, je voterai l’article 1er A – et de bouclage permanent menée par ceux qui souhaitent l’inscription des langues régionales dans la Constitution, le seul problème qui se pose concerne la position qu’adoptera, à l’avenir, le Conseil constitutionnel.
Notre ami Michel Charasse a rappelé quels étaient les principes essentiels du Conseil constitutionnel, dans le cadre de l’indivisibilité de la République. Si la phrase concernant les langues régionales avait été inscrite à l’article 2 de la Constitution, peut-être aurait-on pu en conclure qu’une évolution sensible s’était produite. On voit bien quelle précaution le Gouvernement a voulu prendre en l’inscrivant à l’article 1er : il a souhaité manifester sa volonté de dire au Conseil constitutionnel : ne touchons à rien et ne ratifions surtout pas la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires !
Le débat est engagé ! Je n’ai pas de réponse à la question, mais je sais que je voterai contre ces amendements de suppression.

En ce qui me concerne, je suis partisan de la suppression pure et simple de la mention des langues régionales dans la Constitution.
J’attire en effet votre attention, mes chers collègues, sur le fait que, si nous acceptons cette rédaction, nous risquons de favoriser l’apparition de très nombreux contentieux, émanant de personnes qui pratiquent quelquefois la démagogie et qui, au prétexte de défendre l’identité du territoire, l’appartenance à un comté - et je sais de quoi je parle ! – ou à une province, exigeront que les arrêtés municipaux, voire préfectoraux, soient rédigés dans la langue régionale ou locale.

Ils pourront également exiger que la langue locale soit utilisée pendant les débats municipaux et, si les autorités le leur refusent, lancer d’interminables contentieux, largement médiatisés.

Je souhaite tout d’abord expliquer pourquoi j’ai cosigné les amendements déposés par Michel Charasse.
Pratiquant une langue régionale, en l’occurrence le gascon, langue que j’ai même enseignée dans une vie antérieure, et en tant que militant de la défense des langues régionales, je comprends parfaitement ceux qui ont souhaité le renforcement de la reconnaissance de ces langues, dont l’usage s’étiole dangereusement.
Je suis malgré tout favorable à ces amendements de suppression, car le danger existe de voir apparaître de nombreuses dérives. Pour ma part, je défends tout ce qui peut renforcer l’unicité de la République et le principe de laïcité.
On peut être pour les langues régionales sans, pour autant, graver leur appartenance au patrimoine dans le marbre de la Constitution.
Pour conclure sur un mode plaisant, je dirai qu’au fond, si nous ne nous exprimons pas aujourd’hui en gascon dans cette assemblée, comme je pourrais le faire, c’est tout simplement parce que cette langue merveilleuse, qui était celle de la cour de Nérac, a été abandonnée en raison du trop grand succès d’Henri IV.
Rires et applaudissements sur des travées du RDSE, de l’UC-UDF et de l ’ UMP.

Le président Jean-Jacques Hyest nous a dit tout à l’heure que beaucoup de choses avaient été dites et redites sur ce sujet. Pour notre part, nous sommes peu intervenus dans le débat, car l’amendement voté par l’Assemblée nationale a été repris par la commission des lois du Sénat. À partir du moment où nous étions favorables à l’inscription de ce dispositif dans la Constitution, nous nous sommes sentis confortés par la position adoptée par la commission des lois.
Existe-t-il néanmoins, dans notre pays, un problème majeur et récurrent concernant les langues régionales ? La réponse est oui, tout le monde en convient.
Le débat qui s’est instauré au cours des dernières semaines sur ce sujet est-il, comme le disait François Fillon, le 9 juillet 1999, dans un article intitulé Ne perdons pas notre temps, « un débat entre ceux qui regardent l’avenir avec ses priorités et ceux qui pensent que la France a du temps à perdre pour vagabonder dans le passé » ? Je crains que cette présentation des choses ne soit totalement contraire à la réalité. Je pense, pour ma part, que cette question doit être considérée avec beaucoup plus de sérieux que ne le fait M. Fillon.
Ce sujet ne me paraît ni dérisoire ni anodin. Nous sommes tous des citoyens du monde et il nous importe à tous de connaître le regard que porte le monde sur la situation de notre pays. Je me suis penché, à cet égard, sur la dernière réunion du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, qui s’est réuni il y a quelques jours. Que dit ce comité concernant la France d’aujourd’hui ?
« Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie – la France – n’a pas fait d’efforts suffisants dans le domaine de la préservation et de la promotion des langues et du patrimoine culturel régionaux et minoritaires. »

« Le Comité constate aussi que l’absence de reconnaissance officielle des langues régionales et minoritaires a contribué au déclin constant du nombre des locuteurs de ces langues. […]
Et le comité conclut : « Le Comité réitère les recommandations formulées dans ses observations finales précédentes […] que l’État partie accroisse ses efforts pour préserver et promouvoir les langues et le patrimoine culturel régionaux ou minoritaires, entre autres en assurant que des financements et des ressources humaines suffisants soient alloués dans l’enseignement public et à la télévision et à la radio dans ces langues. Le Comité recommande aussi que l’État partie envisage de réviser sa position concernant l’absence de reconnaissance officielle des langues régionales ou minoritaires dans la Constitution de l’État partie. »
Telle est la position des Nations unies !

Cela met en exergue deux points essentiels, me semble-t-il.
Tout d’abord, 50 % des langues régionales sont menacées de disparition d’ici à cinquante ans selon les prévisions officielles. Le risque est réel !
Ensuite, pour inverser cette tendance, une reconnaissance officielle des langues régionales est nécessaire.
C’est dans cet esprit que, depuis des années, plusieurs de mes collègues et moi-même réclamons, ici même, une reconnaissance constitutionnelle de ces langues.
Le Gouvernement a annoncé, voilà quelques jours – mon collègue Nicolas Alfonsi y a fait allusion – un projet de loi visant à la mise en valeur des langues minoritaires. Une avancée remarquable a été obtenue à l’Assemblée nationale, à la quasi-unanimité des députés ; il s’agit d’un compromis.
Cette inscription dans la Constitution nous paraît essentielle.
J’estime, quant à moi, que si le Sénat, aujourd’hui, prenait la décision de supprimer une avancée qui a été particulièrement appréciée dans de nombreuses régions de France, cela aurait certainement des conséquences très graves pour les habitants de nombreuses régions françaises.
C’est la raison pour laquelle je suis tout à fait opposé à ces amendements de suppression.

J’exprimerai une forte conviction et je procéderai à un rappel historique.
La France s’est faite aussi – certains disent beaucoup – autour de la langue française. Cela n’a pas été facile. C’est une très longue histoire, un très long combat, et qui a mobilisé de nombreux républicains.
Dans le grand texte du rapport à la Convention sur l’éducation nationale, les premiers mots de Condorcet étaient, si j’ai bonne mémoire, ceux-ci : « La France compte vingt-six millions de Français, six seulement savent lire et écrire dans notre langue. »

Toute l’histoire de la République, particulièrement de la IIIe République, est marquée par la lutte pour que la France se soude autour de la langue française. Telle est la tradition républicaine !
Je suis, pour ma part – je le dis franchement – pénétré par la langue française : mon père et ma mère étaient des immigrés ; mon père, républicain farouche et patriote ardent, interdisait que l’on parle une autre langue que le français chez lui.
Pourquoi ce rappel ? Certainement pas pour dénier la très grande richesse des langues régionales : chacun connaît les grands chefs-d’œuvre que nous leur devons ; c’est un hommage que je leur rends volontiers. Et il est bon que ces langues soient enseignées, qu’elles fassent l’objet de thèses, de travaux, notamment dans nos meilleures universités, particulièrement régionales.
Toutefois, cela implique-t-il que ces langues doivent trouver leur place dans la Constitution ?
Je rappelle qu’une constitution est un instrument qui sert à gouverner un pays, en définissant les pouvoirs, leurs rapports, et, dans son préambule, figurent les valeurs fondamentales sur lesquelles repose cet équilibre constitutionnel.
Il ne s’agit donc pas d’un catalogue des richesses culturelles nationales ou des différents aspects de la communauté nationale. Tout ce qui est inscrit dans une constitution entraîne ensuite, s’il s’agit de principes généraux, des conséquences.
S’agissant des langues régionales, qui nous occupent aujourd’hui, nous constatons qu’elles trouvent parfaitement leur place dans les universités, dans l’enseignement – je ne vais pas reprendre le détail des propos qui ont déjà été tenus –, et que, dans le domaine des associations, à plus forte raison dans le domaine privé, elles ont plein et entier exercice.
Alors, quelle serait la raison d’être de cette constitutionnalisation ? Je le dis franchement, je n’en vois qu’une, sur laquelle je m’attarderai.
Vous savez tous – cela remonte à 1999 – que, lorsque le gouvernement Jospin a signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires – elle porte toujours ce nom –, la question s’est posée de la conformité à la Constitution de son éventuelle ratification, et c’est d’ailleurs le Président de la République qui a saisi le Conseil constitutionnel. Ce dernier a rendu une décision dont je me dois de rappeler les termes, tant ils sont importants.
« Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en ce qu’elle confère des droits spécifiques à des groupes de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l’intérieur de territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées, porte atteinte aux principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français. […] » J’ai rarement trouvé, dans les décisions du Conseil constitutionnel, des mots d’une telle force !
« Considérant que ces dispositions sont également contraires au premier alinéa de l’article 2 de la Constitution en ce qu’elles tendent à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le français non seulement dans la vie privée mais également dans la vie publique, à laquelle la Charte rattache la justice et les autorités administratives et services publics. […] » On ne peut pas être plus explicite : cela veut dire, très précisément, que la charte est incompatible avec la Constitution française.
Je tiens à rappeler un principe, et à éclairer très précisément tous mes collègues. Le Conseil constitutionnel statue à Constitution constante. Dès l’instant où l’on modifie la Constitution, le Conseil constitutionnel n’est plus tenu par l’interprétation qu’il a donnée antérieurement.
Disons-le clairement : si le constituant a voulu reprendre, ici, la question des langues régionales, c’est qu’il était animé d’une certaine volonté, et l’on s’interroge sur cette volonté.
Si, d’aventure, la question était à nouveau posée, le Conseil constitutionnel l’examinerait essentiellement au regard de l’adjonction effectuée. Je ne sais pas ce qu’il déciderait, mais je m’inscris en faux contre l’affirmation de certains d’entre vous selon laquelle il ne faut avoir aucune crainte, la jurisprudence du Conseil étant fixée. Ce n’est pas vrai ! Elle est fixée dans l’état actuel de la Constitution ; elle ne peut être fixée au regard d’une modification de la Constitution.
Je conclurai en interrogeant Mme la garde des sceaux. Le Conseil constitutionnel étudiera les travaux préparatoires, si nous adoptons ce texte, pour essayer de dégager la pensée du constituant ; c’est son devoir. Mme la garde des sceaux peut-elle, d’une façon très précise, nous dire que le Gouvernement, en se ralliant à ce qui est à l’origine un amendement parlementaire, considère que l’on ne peut, en aucune manière, ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires ?
Il faut, à cet égard, une réponse très claire du Gouvernement, car, en apportant cette précision, celui-ci s’interdit de le faire – mais il éclairerait le Conseil constitutionnel –, et, selon moi, il l’interdit également à ses successeurs.
Applaudissements sur certaines travées de l ’ UC-UDF, de l ’ UMP et du RDSE.

Notre groupe, à l’unanimité, a déposé un amendement de suppression de la mention des langues régionales à l’article 1er de la Constitution, donc avant celle de la langue française.
Néanmoins, une majorité d’entre nous souhaitaient faire preuve d’une certaine ouverture, s’agissant de l’identité de notre pays, et proposaient de citer les langues régionales comme l’une des richesses de notre patrimoine dans un autre article, éventuellement à l’article 2.
J’entends bien les réserves qui s’expriment, encore que je ne sois pas vraiment convaincue.
J’ai déposé un sous-amendement à l’article 2, qui n’a pas été retenu – je n’ai pas très bien compris pourquoi, mais peu importe – visant à inscrire dans la Constitution que les cultures et langues régionales font partie du patrimoine de la République, même si la langue fait partie de la culture.

Fidèle défenseur de la langue française en tant que langue nationale, et par là même en tant qu’entité de l’histoire de notre pays, je ne suis pas favorable à ce que des groupes de locuteurs aient des droits inscrits dans la Constitution, et ce par principe républicain.
La France, riche de sa diversité culturelle, grâce, notamment, à ses langues régionales, doit rester, comme le définit la Constitution, « une et indivisible », car entre la loi et la personne il n’y a pas d’intermédiaire.
Or quiconque intercale une communauté crée alors des droits particuliers pour ses membres et rompt avec l’unité et l’indivisibilité constitutionnelles de la République.
De ce droit particulier, plusieurs, dont je fais partie, ne veulent pas.
« Le français est la langue de la République », comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1999, sachant que ce même Conseil constitutionnel, en la matière, ne peut être un recours, puisqu’il ne peut se prononcer sur la révision de la Constitution. Nous avons donc à prendre nos responsabilités en tant que parlementaires.
Enfin, des dispositions favorisant la découverte et l’apprentissage des langues régionales existent et sont mises en œuvre ; je pense, notamment, au fait que l’État républicain finance des postes pour l’enseignement de ces langues dans les régions où elles se pratiquent.
On peut toujours considérer que ce n’est pas suffisant et, éventuellement, se demander s’il ne serait pas judicieux et nécessaire de développer ces actions. Pour autant, comme législateurs, nous n’avons pas à répondre aux spécificités de chacun, puisque le propre de la loi est justement d’organiser la vie en société pour assurer collectivement la liberté et les droits de chacun.
Pour toutes ces raisons, je suis favorable à la suppression de l’article 1er A, adopté à l’Assemblée nationale, tendant à inscrire la reconnaissance des langues régionales dans la Constitution. Je ne souhaite cette inscription ni dans l’article 1er, qui définir la République, ni dans l’article 2, qui concerne la souveraineté de notre pays.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC – M. Jean-Luc Mélenchon applaudit également.

Je n’ai pas l’habitude de ne pas suivre la commission ou de voter contre ce qu’a décidé le Gouvernement. Toutefois, je considère qu’intégrer les langues régionales dans la Constitution serait une erreur. Un certain nombre d’orateurs de grand talent, notamment MM. Gouteyron, Balarello et Badinter, ont parfaitement cerné le sujet. Depuis que j’ai été élu sénateur en 1977, j’ai participé à de nombreuses révisions constitutionnelles et j’ai appris deux choses.
Premièrement, il est très difficile de toucher à l’article 1er de notre Constitution.

C’est un article essentiel, que beaucoup de gens connaissent, à défaut, souvent, de connaître la suite. On ne peut donc pas le modifier sous un quelconque prétexte et y insérer la référence aux langues régionales, surtout après avoir consacré dans la Constitution, voilà quelques années, sur l’initiative de M. Raffarin, l’organisation décentralisée de la République.
Deuxièmement, il y a trois degrés de législation : la loi, la loi organique et la Constitution. À mon sens, la protection et le développement de l’enseignement des langues régionales relèvent de la loi, et non de la loi organique ou de la Constitution.

Je suis tout à fait prêt à voter une loi, comme l’a annoncé le Gouvernement, pour améliorer l’enseignement des langues régionales.
Au demeurant, ce débat sur les langues régionales me paraît un tout petit peu dépassé, à l’heure où nos enfants et nos petits-enfants parlent plus volontiers le texto que le français.
Sourires

Si nous voulons améliorer l’indivisibilité de la République et la cohésion sociale, mieux vaut renforcer l’enseignement du français et lutter contre toutes les déformations constatées à l’heure actuelle.

M. Jean-Pierre Fourcade. Ce n’est pas en mentionnant les langues régionales dans la Constitution que nous améliorerons la place du français !
Bravo ! et applaudissements sur les travées de l’UMP, ainsi que sur certaines travées de l’UC-UDF et du RDSE.

Je souhaiterais attirer l’attention sur l’utilisation qui est faite dans ce texte des termes « langues régionales ». Ces termes ne rendent pas compte, me semble-t-il, de la diversité des parlers qui peuvent exister dans une même région. Je dirais même que l’emploi de tels termes tend, paradoxalement, à contribuer à l’appauvrissement de la richesse de notre patrimoine linguistique.
En ma qualité d’élu d’un département dont l’identité bretonne fait l’objet d’un débat passionné qui n’est toujours pas tranché, je prendrai l’exemple des différents parlers pratiqués en Bretagne. Il apparaît en effet qu’il y existe non pas une langue régionale unique, mais un nombre important de parlers, lesquels se rattachent à cinq grands types de dialectes.
Dans la région rennaise, on pratique le gallo, qui est un dialecte de langue d’oïl parlé en Bretagne orientale. Dans le reste de la Bretagne, que l’on nomme la Bretagne bretonnante, on dénombre quatre grands dialectes, qui, eux, sont celtiques : le trégorois, le vannetais, le léonard et le cornouaillais.
Il faut le savoir, chaque dialecte se décompose en sous-familles. Leurs différences sont telles que les linguistes ont pris l’habitude de se référer aux parlers qui composent ces sous-familles. Ainsi, pour prendre l’exemple du cornouaillais, il faut y distinguer les parlers du pays Bigouden, du Poher, du Cap Sizun, ou encore du pays de l’Aven.
Les choses se compliquent encore plus si l’on considère qu’à l’intérieur même de ces zones il existe des sous-dialectes spécifiques. Ainsi, le sous-dialecte du pays Bigouden diffère entre les locuteurs issus du pays Glazik, c’est-à-dire de Quimper et de ses alentours, et ceux de la région de Douarnenez, autrement dit, du pays Penn Sardin.
Aussi, en organisant la promotion des langues régionales en Bretagne par le biais des écoles bilingues, qui enseignent une forme d’espéranto composé des différents parlers bretons et qui présente le paradoxe d’être incompréhensible par ceux qui ont l’un d’entre eux pour langue maternelle, on contribue à la liquidation d’un patrimoine linguistique bien plus riche, bien plus divers encore dans la réalité que dans la description sommaire que je viens de réaliser. Par parenthèse, je vous rappelle que cet espéranto breton a été constitué en 1941 par un admirateur du régime nazi.
Pour toutes ces raisons, je considère que les langues régionales ne doivent pas figurer dans la Constitution. C’est la raison pour laquelle je voterai ces amendements de suppression.
Sourires

Les débats sur le mot « race », d’abord, et sur les langues régionales, ensuite, étaient d’une telle qualité que j’ai déserté une réunion de la commission des affaires culturelles, regrettant, au passage, la simultanéité de nos travaux.
J’ai bien entendu tous les arguments de ceux qui plaident en faveur de la suppression de l’article 1er A. Plusieurs auteurs des amendements ont d’ailleurs pris la peine de préciser qu’ils n’avaient aucun compte à régler avec ces langues de pays.
Je constate néanmoins qu’à partir d’une unanimité sur ces travées contre le concept de « race » le Sénat a choisi de le maintenir dans la Constitution. Pour de bonnes raisons, certes ! Et maintenant, à partir d’une relative bienveillance pour les langues régionales, le Sénat s’apprête à exclure celles-ci de la loi fondamentale.
Je souhaite donc soutenir la rédaction initiale du texte qui nous est parvenue, quitte à ce qu’elle soit améliorée et cadrée par un certain nombre de sous-amendements. Une fois n’est pas coutume, j’apprécie la proposition annexe de M. Charasse.
Ah ! sur certaines travées de l’UMP.

En revanche, il n’y a pas lieu, me semble-t-il, de faire référence à la notion de « racines ». Nous parlons non pas de racines – le terme était d’ailleurs cher à Barrès –, mais de mémoire collective, ce patrimoine d’histoires et de vies croisées qui fait notre identité française, cette diversité qui fait richesse.
Le pédiatre Aldo Naouri, proche de la majorité, connu pour son attachement à la rigueur éducative et son aversion pour les choix « post-soixante-huitards » trop permissifs, décrit très bien, dans son dernier ouvrage – tous les linguistes le savent –, comment le très jeune enfant acquiert sa ou ses langues maternelles par l’abandon de plusieurs dizaines de phonèmes, qui auraient permis, à lui comme aux Auvergnats, de maîtriser très tôt le « th » anglais ou la jota espagnole ou arabe.
En France, en 2008, l’existence durable des parlers locaux n’est pas une atteinte au français. C’est une initiation aux autres phonèmes, utiles pour l’acquisition des futures langues étrangères, c’est une fenêtre ouverte sur la diversité. Nous sommes ici au niveau de la comptine, et non au niveau de l’ébranlement de l’école de la République ou du conseil municipal en catalan.
La sauvegarde des langues régionales n’est pas une quête d’ancrage, c’est le soin donné à un patrimoine fragile, humain, culturel, terrain d’ouvertures, de curiosités, de voyages intellectuels, poétiques.
Le succès inédit d’un film populaire, presque populiste, caricatural, mais chaleureux, Bienvenue chez les Ch’tis, …

…a révélé chez nous l’évidence de résonances humaines intimes pour des accents ou des parlers privés qui font lien, et même sens. Ce film, qu’un journaliste du Monde diplomatique a qualifié de premier film populaire depuis La bête humaine, a fait du bien, sans faire de mal.
Inscrire les langues régionales dans la Constitution fait sens et constitue un message symbolique, sans engendrer de fragilisation.
C’est pourquoi les Verts voteront contre la suppression.
Applaudissements sur certaines travées du groupe socialiste.

Ce débat est très riche, mais j’ai tout de même le sentiment, au travers des différentes interventions, que les uns et les autres combattent plus souvent des démons que des réalités.
Chacun ici, me semble-t-il, – à l’exception peut-être de quelques-uns, mais ils ne se sont pas exprimés – est très attaché aux principes fondamentaux, aux éléments constitutifs de la République que sont la laïcité et la langue française.
À mon sens, c’est un combat inachevé. Je peux donc comprendre que nombre d’orateurs expriment leurs convictions et cherchent à dénicher, dans cette affaire des langues régionales, le moindre petit indice révélateur de la volonté de fragiliser ce qui n’est jamais acquis. En même temps, lorsqu’autant de doutes ou d’alertes se font jour, c’est que l’on sent monter dans la société un courant de pensée qui pourrait fragiliser l’unicité de la République, la laïcité ou la langue française.
Cela étant, je reste perplexe. L’exacerbation des nationalismes constatée dans un certain nombre de pays, notamment en Europe et tout particulièrement dans les Balkans, constitue un réel danger de destruction de nations telles qu’elles se sont constituées au xxe siècle. Mais quand j’analyse les raisons d’une telle montée en puissance, j’en arrive à chaque fois à la même conclusion : il s’agit d’États autoritaires qui ont imposé, d’une manière totalement hermétique et antidémocratique, l’écrasement de minorités, y compris au travers des langues. Avec une telle façon de faire, toutes ces langues, bien loin de s’éteindre, ont « explosé à la figure » des dirigeants à la fin du xxe siècle, dans tout un tas d’endroits où l’on pensait que la question était réglée.
La France a agi autrement. Il n’y a pas, aujourd’hui, de baïonnettes aux portes de la langue française pour imposer un séparatisme avec des langues régionales. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi on serait sur la défensive.
En revanche, et cela a été évoqué tout à l’heure, je constate que la langue française est actuellement fragilisée, y compris de plus en plus dans des actes courants de la vie publique. Mais cette fragilisation est plutôt le fait de la langue anglaise.

Loin de moi l’idée de la critiquer, car elle aussi a ses charmes. Malgré tout, elle fait peser une menace, et ce dans de multiples domaines. Il n’est qu’à voir le grand nombre d’offres d’emplois pour des postes où il faut écrire la moitié du temps en anglais. Il n’est qu’à voir le grand nombre d’anglicismes introduits en français. C’est cela, et non les langues régionales, qui fragilise notre langue.
Moderniser la Constitution, c’est veiller à défendre les socles fondamentaux, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte, cinquante ans après, un certain nombre d’évidences.
Je n’étais pas présent lors du débat sur le mot « race ». Lorsque j’étais professeur d’histoire-géographie et d’éducation civique, j’avais énormément de mal à aborder la question du racisme, car comment expliquer que les races n’existent pas, comme tout le monde le sait, mais que leur mention figure dans la Constitution ?

On me rétorque, avec de grands discours, que l’article 1er de la Constitution est intangible. Pour ma part, je préférerais que l’on fasse œuvre de pédagogie pour lutter contre le racisme.

Je le sais bien, monsieur le rapporteur, mais je fais le lien entre ces deux thèmes !
Certains nous mettent en garde : si l’on touche aux socles tels qu’ils ont été définis à l’origine, on fragilise l’édifice. C’est une façon défensive d’aborder le problème. À mon avis, personne, dans cet hémicycle, ne veut fragiliser la langue française.
L’argumentation selon laquelle il est fâcheux de mentionner dans la Constitution les langues régionales avant la langue française est, certes, recevable. Mais si celles-ci avaient été placées au même niveau, on aurait alors entendu cette autre argumentation, tout aussi recevable : le français et les langues régionales ont la même valeur, et l’on sème la confusion sur la façon dont doit être appréhendée la question de la langue dans la Constitution.
(Marques d’exaspération sur plusieurs travées de l’UMP.) Nous abondons tous dans le même sens : il faut veiller à ne pas fragiliser aujourd’hui la République et la laïcité. Mais, en France, comme ailleurs dans le monde, le vrai danger, ce sont les intégrismes religieux, et pas les langues minoritaires régionales !
M. François Marc applaudit.

Au final, je suis très embarrassé par ce débat, car j’ai l’impression que l’on se bat aujourd’hui non pas contre ce qui menace la langue, la République et son unicité, mais contre des épouvantails. §

Je serai bref, car je me suis déjà beaucoup exprimé. Je tiens surtout à remercier le président et ceux de mes collègues qui ont bien voulu répondre aux arguments que j’ai fait valoir au cours du débat sur la place des langues régionales.
Je salue l’engagement de mon camarade et collègue François Marc. Il aura finalement convaincu la majorité du groupe socialiste, faute de me convaincre, comme vous avez pu le constater.
Je déplore, cependant, le recours à la citation d’un comité de l’ONU, qui ne me semble pas fondé à donner des appréciations sur la nature de la Constitution de la République française dans la mesure où lui-même méconnaît l’importance de la laïcité.
De plus, l’ordre du monde et son état justifient que nous soyons extrêmement précautionneux sur les conditions qui rendent possible l’unité et l’indivisibilité de la République française.
L’unité linguistique de la France est un bien précieux. Elle ne signifie pas l’uniformité, ni la répression des différences ; elle signifie l’unité, avec tout le sens inhérent à ce mot, donc la possibilité d’un espace public commun, que l’on nomme la République.
Pour avoir entendu largement s’exprimer la sensibilité de tous ceux qui voient dans cette culture régionale une partie constitutive de leur identité, je voudrais faire entendre à mon tour qu’il s’agit de 7 % de la population. Le reste, la nouvelle France, issue, comme moi, de l’immigration, parle avec passion le français, la langue, pour elle, de l’égalité, celle qui l’a libérée individuellement, comme elle a libéré collectivement chacun des Français.
Je tenais à ce que cela soit dit aussi ! Entendez à leur tour ceux qui sont blessés de voir sans cesse mettre en cause la France, qui ne le mérite pas : elle a fait son devoir à l’égard du développement de la diversité linguistique, mais elle a surtout fait son devoir à l’égard de tous les enfants qu’elle accueillait et qu’elle intégrait comme moi-même, qui vous parle à cet instant.

Dans la mesure où la référence à la francophonie a été rejetée au mieux par la commission dans l’espace, après l’article 31, au pire par le Gouvernement dans le temps, après le comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution, présidé par Mme Veil, il va de soi que nous n’avons plus la possibilité de faire remonter la référence au français avant la mention des langues régionales.
Dans ces conditions, je n’ai pas d’autre solution, en ce qui me concerne, que de voter les amendements de suppression de cette référence.

M. Philippe Dallier. En entendant notre collègue François Marc faire état de l’avis d’un comité Théodule du grand machin new-yorkais qui devait probablement s’exprimer dans quelque volapük intégré
Rires sur les travées de l ’ UMP.

Pour en revenir à des choses plus concrètes, je me dois de rappeler que, pendant la dernière campagne des municipales, certains candidats ont cru bon de rédiger leur propagande électorale dans des langues étrangères. Ce genre de pratique devrait nous interpeller, les uns et les autres, et nous convaincre de la nécessité qu’il y a de renforcer toujours et partout l’usage du français.
Représentant d’un département où nous avons beaucoup de difficultés à intégrer un certain nombre de jeunes, de toutes origines d’ailleurs, venus du monde entier, et que la langue française peut rassembler, je sais le mal que nous avons à faire en sorte que la langue française soit correctement utilisée. Il me semble que la référence aux langues régionales dans la Constitution ne pourrait que compromettre nos efforts.
Bravo ! et applaudissements sur de nombreuses travées de l ’ UMP.

Je voudrais dire pourquoi je voterai les amendements de suppression de la mention des langues régionales à l’article 1er de notre Constitution. Il s’agit non pas de se prononcer pour ou contre ces idiomes régionaux, mais de savoir si cette mention a bien sa place dans notre loi fondamentale. Je ne pense pas que tel soit le cas, etce pour deux raisons.
Premièrement, je suis convaincu que le premier souci dans notre pays est aujourd’hui l’apprentissage et la maîtrise de la langue française. Et je suis également persuadé que nous, Français, avons une responsabilité au regard de la francophonie. En octobre prochain, se tiendra à Québec le sommet de la francophonie. Dans cette perspective, M. Yvon Bourges a fait seize propositions intelligentes pour passer d’une position défensive à une position offensive.
Au moment où il faut défendre la langue française, ce serait un très mauvais signe que de laisser, à l’article 1er, la référence aux langues régionales. Elle précéderait ainsi celle à la langue française, bien commun de tous les Français depuis l’édit de Villers-Cotterêts. Ce serait un mauvais service à rendre à notre pays, à la langue française et à la francophonie.
Applaudissements sur plusieurs travées de l ’ UMP.

En écoutant avec une extrême attention les échanges qui ont été les nôtres cet après-midi, mes chers collègues, j’ai constaté qu’il y a eu, formulé ou informulé, un double débat. L’un, conduit avec le talent qui est le sien par notre collègue Robert Badinter, a posé la question de la pertinence de l’inscription de cette préoccupation dans la Constitution. L’autre, contenu dans une multitude d’interventions, nous interrogeait sur le bien-fondé de cette demande, qui paraissait attentatoire à l’unicité et à la laïcité de la République, en un mot comme en cent, à la République elle-même.
En ce jour du 18 juin, on a même invoqué les mânes du général de Gaulle, un homme qui a terminé le discours de Quimper en breton, un homme dont je puis attester qu’il portait une grande considération aux langues régionales.
Marques d’approbation sur diverses travées.

Ce n’est pas ce qui m’a choqué le plus !
Profitant de l’une de mes rares interventions dans cet hémicycle, je voudrais vous dire que j’appartiens à une région qui a son histoire, sa particularité, son identité. Ce qui fonde cette histoire, cette particularité, cette identité, c’est en grande partie sa langue : c’est l’un de ses socles ; c’est l’une de ses valeurs.
Enfant de cette région, ayant appris les deux langues, j’ai le profond sentiment d’avoir été porté par tous ceux qui parlaient cette langue, par tous ceux, hussards noirs de la République qui nous l’ont apprise, par ceux qui ne la parlaient pas et qui le regrettaient, par les pères de ceux-là. J’ai le sentiment d’avoir été conduit par tous, par ceux que j’ai connus, mais aussi par ceux qui ont précédé ceux que j’ai connus, vers un pays auquel nous étions profondément attachés, dont nous voulions qu’il fût républicain, unique et laïc.
Le souhait, que vous pouvez ou non partager, de faire inscrire cela dans notre patrimoine, c’est-à-dire dans ce que nous avons reçu de nos pères, quelle que fût la langue qu’ils aient parlée – et je reconnais aux autres le droit de demander la même chose pour leurs pères – ce souhait, dis-je, ne croyez pas qu’il puisse être porteur de risques là où nous nous trouvons. Ne croyez pas qu’il puisse être attentatoire à une quelconque unicité de la République et ne nous ramenez surtout pas aux années quarante !
Les régions à forte identité – il n’y a pas que la Bretagne ; je pense également à l’Alsace, à la Lorraine, à la Corse, à la Catalogne, aux régions ultramarines – sont des régions profondément républicaines, profondément laïques. Si vous en doutez, comptez les morts et regardez ce que les enfants de ces régions ont donné à la France !
Bravo ! et applaudissements sur diverses travées.

Troisième Breton à m’exprimer dans cet hémicycle, je voudrais dire combien je partage le propos de mon collègue et ami Joseph Kerguéris sur le fait que la langue bretonne a été le ciment de notre identité.
Puisqu’on a fait allusion au 18 juin, je voudrais dire aussi que les premiers à rejoindre le Général de Gaulle étaient des pêcheurs de l’île de Sein. Ces hommes-là ne parlaient pas tous le français, mais avaient le cœur français.
Applaudissements sur diverses travées.

Et je ne voudrais pas que l’on vienne ici, dans cet hémicycle, dire à ceux qui s’opposent à l’article que nous allons voter tout à l’heure et qui inscrit les langues régionales dans la Constitution qu’ils sont des ennemis des langues régionales.
J’appartiens à la partie francophone de la Bretagne. En ma qualité d’ancien président du conseil régional de Bretagne, je puis indiquer que nous avons consacré beaucoup de crédits à l’enseignement du breton. Nous avons créé un office de la langue bretonne. Nous avons financé des émissions audiovisuelles en breton, même si certaines chaînes de télévision croient intelligent de doubler en breton Columbo ou des dessins animés japonais
Rires

Le problème évoqué tout à l’heure, c’est que la loi que nous allons, je l’espère, voter donnera les moyens de conforter l’enseignement du breton, de diffuser la culture bretonne pour les locuteurs qui veulent le faire. Mais c’est dans la loi que se trouve la solution. Les langues régionales n’ont pas leur place dans la Constitution !
Bravo ! et applaudissements sur diverses travées.

Je dirai simplement quelques mots pour expliquer mon vote en faveur des amendements de suppression, car je ne voudrais pas que l’on se trompe sur l’interprétation à lui donner.
J’estime que la Constitution doit définir des procédures, des règles, des normes pour permettre l’organisation des pouvoirs publics et le fonctionnement de l’État. Elle n’a pas à qualifier et à commenter notre patrimoine !

Peut-être est-ce le rôle du préambule de la Constitution, mais il s’agit d’un autre débat, qui n’est pas ouvert aujourd’hui.

M. Philippe Marini. C’est simplement en fonction de cette vision concrète et utile de la Constitution que je vote contre l’article ajouté à l’Assemblée nationale, sans doute avec d’excellentes intentions, mais qui risque de poser une infinité de problèmes, comme on l’a vu au cours de notre excellent débat.
Applaudissements sur de nombreuses travées de l ’ UMP et de l’UC-UDF.

Monsieur le président, je demande une suspension de séance pour réunir mon groupe.

Le Sénat va, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le président.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures trente, est reprise à dix-huit heures cinquante.
Je souhaite répondre à la question posée tout à l'heure par M. Badinter et M. Alfonsi, afin de les rassurer : le Gouvernement n’a absolument pas l’intention de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
Je vous renvoie d'ailleurs à la décision de 1999 du Conseil constitutionnel, qui avait considéré que cette Charte était contraire aux « principes d’égalité, d’unicité et d’indivisibilité de la République ».

Monsieur le président, je souhaite expliquer en quelques mots la position du groupe UMP du Sénat.
Comme sans doute la plupart – sinon la totalité – de nos collègues, j’ai énormément appris au cours de cet après-midi, et je pense que nos échanges ont été extrêmement instructifs.
Il est clair que nous avons des préoccupations communes : loin d’être partisanes, celles-ci sont d'abord et avant tout nationales. Nous nous demandons tous comment servir notre pays tout en laissant les libertés locales s’exprimer sous les formes les plus diverses et en respectant les territoires.
Toute la question est donc de savoir jusqu’où nous pouvons aller s’agissant de la traduction de ce souci dans l’organisation de nos institutions. Pour notre part, nous considérons, eu égard à ce qui a déjà été fait ou voté et aux perspectives que vient de tracer Mme le garde des sceaux, qu’en cet instant nos convictions – même si, je le répète, nous ne critiquons pas ceux qui pensent autrement que nous – nous conduisent à nous prononcer en faveur des amendements identiques de suppression de l’article 1er A.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 3 rectifié, 77, 145, 157, 250 rectifié ter et 260 rectifié.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 98 :
Nombre de votants324Nombre de suffrages exprimés319Majorité absolue des suffrages exprimés160Pour l’adoption216Contre 103Le Sénat a adopté.
Applaudissements sur les travées de l’UMP, sur plusieurs travées de l’UC-UDF, du groupe CRC et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

En conséquence, l'article 1er A est supprimé et les amendements n° 95, 315, 57 rectifié et 356, 376 rectifié, ainsi que les sous-amendements n° 304 rectifié, 38 rectifié bis, 276 rectifié, 156, 349, 399 rectifié, 400 rectifié et 4 rectifié bis n'ont plus d'objet.
La parole est à M. le rapporteur.

Monsieur le président, l’adoption des amendements de suppression de l’article 1er A rendent sans objet l’amendement n° 95 de la commission, ainsi que les sous-amendements qui y étaient rattachés. Afin de préserver les dispositions de l’amendement n° 95 qui étaient relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes, la commission des lois dépose un nouvel amendement tendant à créer un article additionnel avant l’article 1er.
À cet amendement pourraient s’appliquer les sous-amendements qui visaient la même question de l’égalité entre les hommes et les femmes, à savoir les sous-amendements n° 156, 349, 399 rectifié et 400 rectifié. Si les auteurs de ces sous-amendements décident de les maintenir, je vous propose de poursuivre la discussion

Je retire les sous-amendements n° 399 rectifié et 400 rectifié, monsieur le président.

Je suis saisi d’un amendement n° 509, présenté par la commission des lois, et ainsi libellé :
Avant l’article 1er de la Constitution, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article 1er de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. »
II. En conséquence, le dernier alinéa de l’article 3 de la Constitution est supprimé.
Madame Nicole Borvo Cohen-Seat, le sous-amendement n° 156 est-il maintenu ?

Madame Alima Boumediene-Thiery, le sous-amendement n° 349 est-il maintenu ?

Je suis donc saisi de deux sous-amendements identiques.
Le sous-amendement n° 510 est présenté par Mme Borvo Cohen-Seat.
Le sous-amendement n° 511, est présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller.
Tous deux sont ainsi libellés :
Dans l'avant-dernier alinéa de l'amendement n° 509, remplacer le mot :
« favorise »
par le mot :
« assure »
L’amendement n° 509 ainsi que les sous-amendements n° 510 et 511 ont déjà été défendus.
La commission et le Gouvernement se sont exprimés.
La parole est à M. Yves Détraigne.

Il me semble que le sous-amendement n° 276 rectifié est toujours d’actualité.

Ce sous-amendement visant à supprimer la totalité de mon amendement, il n’est pas recevable.

J’interviens ici non pas au nom de la commission, mais à titre personnel.
Si l’amendement de la commission est adopté, certains amendements déposés sur ce sujet à l’article 11 deviendront sans objet, en particulier celui que j’ai présenté et qui tend à la suppression de cette disposition dans l’article 34 de la Constitution.
Pour ma part, je ne prendrai pas part au vote sur l’amendement n° 509, ni sur les sous-amendements n° 510 et 511, et ce pour une raison très simple : je suis membre du comité de réflexion sur le Préambule de la Constitution, présidé par Mme Veil. Or ce comité doit respecter une lettre de mission du Président de la République, qui le charge précisément de traiter ce problème.

Tout d’abord, je voudrais revenir sur les propos tenus tout à l’heure par notre collègue Mme Dini. Il me semble qu’elle n’a plus en mémoire ce qui a été dit lors de la discussion du texte sur les inégalités salariales. À l’époque, nous avions déposé un amendement, qui avait été adopté, dont l’objet était de faire en sorte qu’il y ait égalité entre les hommes et les femmes concernant les pratiques professionnelles.
Malheureusement, on le sait, cet amendement a été, comme on dit dans notre jargon, « retoqué » par le Conseil constitutionnel et, en dépit des différentes mesures qui sont prises ici ou là, qu’elles soient incitatives ou dissuasives, je m’aperçois que nous n’avançons guère.
Dès lors, les dispositions qui nous sont proposées aujourd'hui concernant l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de responsabilités professionnelles et sociales doivent être inscrites dans le marbre de la Constitution.
C'est la raison pour laquelle j’apporte mon total soutien à l’amendement n° 509 de la commission.

Mon intervention a pour objet de rappeler que le sous-amendement n° 511 vise à remplacer le mot « favorise » par le mot « assure ». En effet, ce dernier terme, contrairement au premier, apporte une garantie en matière de parité, ce qui me paraît très important.
Par ailleurs, il m’a semblé souhaitable de réunir l’égalité professionnelle et sociale et la parité dans les mandats électoraux. En revanche, il convient d’inscrire ces dispositions non pas dans l’article 1er, mais dans l’article 3 de la Constitution.

L’article 1er de la Constitution définit la nature même de la République, à savoir : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. » ; il affirme donc les principes fondamentaux.
Or parler de l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ne me paraît pas relever de la définition de la nature de la République. Pourquoi cette disposition ne figurerait-elle pas dans l’article 34 ? Il a la même valeur constitutionnelle !
Déjà, avec les termes « Son organisation est décentralisée. », qui figurent à l’article 1er de la Constitution, nous étions descendus d’un cran s’agissant de la valeur de cet article.

J’ai bien entendu la réponse de M. le rapporteur, qui m’a dit que c’était une avancée ; c’est déjà mieux que rien !
Toutefois, dans le même temps, s’agissant de l’inscription d’un principe dans la Constitution, je rejoins notre collègue Robert Badinter quant à la place de ces mesures introduites par l’Assemblée nationale. Quoi qu’il en soit, vous avez décidé, monsieur le rapporteur, de les faire figurer à l’article 1er de la Constitution, et c'est la raison pour laquelle nous défendons ce sous-amendement n° 510.
Plusieurs textes ont déjà été votés concernant l’égalité, notamment professionnelle, des femmes et des hommes. Malheureusement, on ne progresse pas ! La mention de la parité dans la Constitution tendait donc à donner plus de poids à nos législations pour véritablement atteindre cette parité.
Je regrette que vous ne nous ayez pas suivis et que vous n’ayez pas choisi de remplacer le mot « favorise » par le mot « assure ».

Chacun, sur ces travées, sait que je ne suis ni un juriste ni un constitutionnaliste éminent ; j’écoute donc avec une très grande attention ceux de nos collègues qui le sont.
Naturellement, personne, à l’heure actuelle – et même si quelqu’un l’était, il n’oserait l’avouer –, ne peut être contre l’égal accès des hommes et des femmes à toutes les responsabilités.
J’ai bien entendu ce que nous a dit Robert Badinter et ce qu’a rappelé à mots plus couverts notre ami Patrice Gélard, à savoir que cette disposition n’avait rien à faire à l’article 1er. En revanche, je suis étonné de la proposition du président de la commission des lois, éminent juriste, qui a souvent déclaré que la loi ne devait pas être redondante.
Certes, je sais bien que l’exercice auquel nous nous livrons en ce moment consiste à faire plaisir au plus grand nombre pour essayer d’atteindre – c’est quasiment impossible ! – l’objectif qui nous a été fixé. Mais, personnellement, je ne participerai pas à cette dénaturation du texte de notre loi fondamentale…

M. Dominique Braye. … et je me verrai donc dans l’obligation, monsieur Hyest, avec un immense regret, de voter contre l’amendement n° 509, considérant que je rends ainsi service au texte fondamental de notre République.
Applaudissements sur certaines travées de l ’ UMP.

Je souhaite que les interventions se situent dans la lignée du rapport de la commission. En effet, s’il y a des choses que je veux bien admettre, je rappellerai toutefois que l’article 34 définit, notamment, les règles fixées par la loi et les principes fondamentaux déterminés par la loi.
On ne peut pas donc intégrer des principes généraux dans l’article 34 ! C'est d’ailleurs la raison pour laquelle, à l’unanimité, les membres de la commission des lois, bien meilleurs juristes que moi, …

…ont profité de cette occasion pour préciser que cette mesure n’avait rien à voir avec l’article 34.
Bien sûr, il y a le comité de réflexion présidé par Mme Veil, mais je rappelle tout de même que, voulant favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, nous avions rédigé un texte particulier, que nous avions intégré à l’article 3 de la Constitution. Mais cet article concerne la souveraineté nationale.
Puis, l’Assemblée nationale, à la suite de jurisprudences du Conseil constitutionnel interdisant de favoriser l’égal accès aux responsabilités professionnelles et sociales, a considéré qu’il fallait inscrire ces dispositions dans la Constitution, de manière que le Conseil constitutionnel ne puisse dire : vous n’avez pas le droit de le faire !
À partir de ce moment-là – je note d’ailleurs que l’article 1er se complète au fur et à mesure, même s’il intervient avant la définition de la souveraineté –, nous avons pensé qu’il valait mieux, dans un souci de simplification, regrouper les mesures relatives aux responsabilités professionnelles et sociales avec les dispositions qui existaient déjà dans la Constitution, à savoir : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. » Et il nous a semblé préférable de ne faire qu’une seule phrase.
Bien sûr, certains peuvent ne pas partager cet avis et ne pas voter ce dispositif, mais s’agit-il de raisons de forme ou de raisons de fond ? Ce n’est pas la même chose !
Les sous-amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi constitutionnelle, avant l'article 1er.
L'amendement n° 368, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la deuxième phrase de l'article premier de la Constitution, après le mot : « d'origine, » sont insérés les mots : « de sexe, d'orientation sexuelle, »
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Même si l’article 1er ne peut pas être un article fourre-tout, il doit tout de même évoluer.
L’égalité des sexes et l’orientation sexuelle n’étaient certainement pas des préoccupations majeures du constituant de 1958. C’est désormais le cas ! En effet, l’égalité des femmes et des hommes est au cœur de l’action publique et constitue l’un des principes qui fondent notre République. Nous devons non seulement l’inscrire de manière explicite dans l’article 1er de la Constitution, mais également lutter contre les discriminations.
Nous le savons, la modernisation de notre Constitution passe par son adaptation aux réalités. C’est la raison pour laquelle nous proposons d’ajouter les termes « de sexe, d’orientation sexuelle ». Cette inscription à l’article 1er aurait une valeur hautement symbolique et elle refléterait la liberté d’orientation sexuelle qui existe aujourd’hui.

Nous avons longuement discuté de ce point, ainsi que d’autres sujets, cet après-midi.
En énumérant à l’article 1er de la Constitution l’ensemble des critères de discrimination qui peuvent exister – certains voudraient simplifier, d’autres non –, on risquerait d’en oublier. Le principe d’égalité rend déjà toutes ces discriminations condamnables et notre corpus juridique est très complet à cet égard.
L’énumération de nouveaux critères de distinction à l’article 1er de la Constitution me paraît donc comporter plus d’inconvénients que d’avantages. Ce qui importe surtout en matière de discrimination, ce sont l’éducation et l’efficacité du traitement judiciaire.
Je comprends les raisons qui ont motivé cet amendement, mais la commission a émis un avis défavorable.
Madame la sénatrice, vous souhaitez compléter l’article 1er de la Constitution pour y affirmer que l’égalité devant la loi est assurée sans distinction d’origine, de sexe, d’orientation sexuelle, de race ou de religion.
Le principe d’égalité devant la loi est garanti par notre Constitution à l’article 1er. En outre, l’article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que la loi doit être la même pour tous. Cet article affirme également que tous les citoyens sont égaux aux yeux de la loi, sans autre distinction.

L’origine, la race ou la religion sont citées à l’article 1er de la Constitution !
Oui, mais le mieux peut être l’ennemi du bien ! À force de vouloir établir des listes, on risque d’oublier des critères. Il vaut donc mieux en rester à l’expression « sans distinction d’origine, de race ou de religion ».
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Lorsque nous avons débattu de la question de la race tout à l’heure, j’ai évoqué la situation dans laquelle nous nous trouvons. Pour des raisons historiques et ô combien ! éminentes, nous savons pourquoi le constituant de 1958 a choisi ces trois termes.
Depuis lors, d’autres formes de combat contre des discriminations insupportables sont apparues, au premier rang desquelles celui concernant les femmes, le sexe et l’orientation sexuelle.
Au cours de la navette, il faudra faire un choix. Je crois en effet que le mieux est de conserver l’expression « sans distinction d’origine, de race ou de religion » ; je pense notamment aux propos tenus par notre collègue M. Portelli.
Mais les choses étant ce qu’elles sont, je tiens à dire que les discriminations que nous évoquons en cet instant sont également odieuses. C’est la raison pour laquelle nous voterons cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 158, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase de l'article premier de la Constitution sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« La démocratie participative est garantie par la loi. L'État et les collectivités territoriales sont chargés de l'organiser. »
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Nous proposons de faire du développement de la participation des citoyens à tous les niveaux des décisions publiques un principe fondamental inscrit dans la Constitution.
La reconnaissance de la souveraineté du peuple est très récente dans l’histoire et la souveraineté du peuple réel, c’est-à-dire des hommes et des femmes, l’est encore plus. Malheureusement, bien que souverain, le peuple exerce sa souveraineté de façon épisodique en élisant ses représentants tous les cinq à sept ans. En outre, nous savons bien que les modes de scrutin corsettent quelque peu cette souveraineté.
Or, aujourd’hui, la représentation politique est en crise. Comment ne pas voir le lien étroit existant entre cette crise et le mépris ou, en tout cas, le corsetage de la souveraineté du peuple ? Je pense ainsi à l’éloignement des décisions, au sentiment d’être mal représentés, au constat que les choix ne sont pas respectés, et j’ai déjà parlé du référendum de 2005.
En s’abstenant à nouveau massivement aux dernières élections municipales et cantonales, les citoyens ont confirmé la distance qui s’est instaurée entre eux et les institutions. Après s’être mobilisés pour l’élection présidentielle, ils ont très rapidement constaté que ce n’était pas vraiment ce qu’ils attendaient.
Le rejet de la politique et de ses acteurs dominants, auxquels sont de plus en plus associés, hélas ! l’ensemble des politiques, traduit avant tout le refus d’un système qui ignore la revendication profonde d’une participation des citoyens aux décisions ; je dis bien : aux décisions !
C’est donc bien la question du pouvoir qui est au cœur de cette crise de la représentation politique que nous constatons depuis plus d’un quart de siècle non seulement en France, mais également dans la plupart des démocraties développées.
Aucune loi, pas plus celle sur la démocratie de proximité que celle sur la décentralisation, n’a pris le problème à bras-le-corps.
Quant à ce projet de loi, il n’y répond absolument pas : il tourne le dos aux exigences démocratiques en ignorant des évolutions déjà en œuvre dans des collectivités territoriales, mais aujourd’hui laissées à leur bon vouloir.
Ce dont nous débattons avec ce texte, c’est d’une nouvelle répartition des pouvoirs entre ceux qui les ont déjà. Or si la souveraineté procède du peuple, c’est à lui d’assumer, à travers l’initiative et l’action de chaque citoyen, les responsabilités essentielles. C’est pourquoi nous voulons rendre obligatoire l’élargissement de l’initiative citoyenne, sous toutes ses formes et dans tous les territoires de la République.
Les élus locaux, les parlementaires que nous sommes doivent exercer leur activité en étant tenus d’associer les citoyens à l’élaboration des décisions et, pour ce qui nous concerne, à l’élaboration des lois. L’essentiel est de créer, à tous les niveaux, les conditions d’une collaboration entre élus et citoyens, dans le respect mutuel.

A l’évidence, il est difficile de concevoir la démocratie sans participation des citoyens. Je dirais même que l’expression « démocratie participative » ressemble fort à un pléonasme.

L’article VI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. »

Je viens de dire qu’il s’agissait d’un pléonasme !
L’article 2 de la Constitution dispose également que le principe de notre République est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Je ne vais pas entrer dans le détail des dispositions constitutionnelles et législatives garantissant la participation des citoyens à la démocratie, mais il y a le référendum national, le référendum local, les nouvelles procédures de référendum d’initiative parlementaire soutenu par les électeurs et la procédure de saisine du Conseil économique et social par voie de pétition.
L’affirmation de la démocratie participative dans notre Constitution me paraît totalement inutile, d’autant qu’il s’agit, c’est le moins que l’on puisse dire, d’une notion floue.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Notre Constitution est suffisamment claire. Ainsi, son article 3 dispose : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants….
… et par la voie du référendum. »
L’introduction de la notion de démocratie participative n’apporterait pas d’avancée réelle. Elle risquerait au contraire de brouiller les choses, puisque notre démocratie est d’abord représentative.
Le Gouvernement préfère proposer des avancées concrètes pour les droits des citoyens en créant, par exemple, le droit de pétition devant le Conseil économique et social, qui relaiera les initiatives dignes d’intérêt auprès du Parlement et du Gouvernement.
Avec l’accord du Gouvernement, l’Assemblée nationale a introduit dans le texte qui vous est soumis le référendum d’initiative populaire. Au niveau des collectivités territoriales, la Constitution permet déjà la soumission d’un projet à un référendum local. En outre, l’article 72-1 de la Constitution reconnaît l’exercice du droit de pétition.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Personnellement, je comprends très bien les motivations des auteurs de l’amendement. Je voudrais simplement rappeler que, au cours de l’histoire, la démocratie participative a existé : c’était au temps de l’Antiquité grecque.
La démocratie grecque apparaît comme exemplaire à bien des égards. Si elle n’a pas été reprise par les États modernes, c’est tout simplement parce qu’elle ne peut fonctionner qu’avec un petit nombre de citoyens.
Aujourd’hui, comme certains le font, on peut pratiquer la démocratie participative à l’échelle de communes de petite taille ou de taille moyenne. Au-delà, c’est un leurre, car on fait participer quelques citoyens et les autres sont exclus.
Si l’on veut aller au bout de la démarche de la démocratie participative, il faut supprimer la démocratie représentative.
Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l ’ UC-UDF et de l ’ UMP.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 161, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase de l'article premier de la Constitution est supprimée.
La parole est à M. Robert Bret.

Lors de l’examen de la réforme constitutionnelle en 2002, nous nous étions opposés à l’insertion dans l’article 1er de la Constitution de la phrase prévoyant l’organisation décentralisée de la République.
Nous avions rappelé qu’il n’était pas acceptable de donner la même force à un principe d’organisation administrative qu’aux principes fondamentaux de la République contenus dans cet article 1er, principes qui établissent le contrat politique et social entre les citoyens, autrement dit le projet commun.
La presse s’était fait l’écho de l’opposition du Conseil d’État à cette disposition. Cette dernière avait un temps été supprimée par la commission des lois elle-même, avant que celle-ci opère un de ces revirements dont elle a le secret.
Nous avions souligné que l’insistance à placer cette disposition dans l’article 1er n’était pas anodine, car elle marquait une volonté politique déterminée à mettre en cause l’unité nationale et ses fondements : la solidarité, l’égalité des personnes et des territoires ; elle marquait une volonté de fragmenter, de diviser.
On voit ce qu’il en est aujourd’hui. Hélas ! la mise en œuvre de la décentralisation telle qu’elle avait été alors décidée sur le principe, puis telle qu’elle a été déclinée dans les lois de décentralisation ultérieures, nous a donné raison.
De la décentralisation, nous n’avons vu ni démocratisation ni réponse équilibrée aux besoins des habitants. Les collectivités locales se sont vu transférer non seulement les compétences, mais aussi les charges afférentes, sans juste compensation, même si c’est inscrit dans la Constitution, rencontrant de plus en plus de difficultés financières. Nous sommes tous bien placés pour le savoir !
De la décentralisation, nous voyons la fermeture de services publics et la diminution des emplois publics. La révision générale des politiques publiques, la RGPP, qui fait actuellement l’actualité, aggravera encore la situation.
Nous voyons les privatisations, la mise en compétition entre les territoires et l’abandon d’un aménagement équilibré de ces mêmes territoires.
Le Président de la République vient d’indiquer, par exemple, à propos du Livre blanc sur la défense, que les armées n’avaient pas pour vocation d’aménager le territoire : c’est évident !
Cependant, l’aménagement du territoire, c’est aussi la répartition équilibrée des services et des équipements qui dépendent de l’État, de telle sorte que chaque partie de notre territoire bénéficie d’activités qui concourent à son développement. On voit bien, dans les départements concernés par le Livre blanc et la restructuration des armées, les problèmes que cela posera.
C’est pourquoi, une nouvelle fois, nous vous appelons à revenir sur une disposition qui n’a pas sa place dans la Constitution.

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer une disposition importante qui a été adoptée le 28 mars 2003 par le Congrès.

Nous avons donné une assise constitutionnelle à la décentralisation. Elle a apporté plus de substance au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Depuis, l’autonomie locale est mieux assurée et une nouvelle architecture des pouvoirs locaux s’est mise en place.

Cette réforme, qui a rompu avec une tentation séculaire de centralisation dans notre pays – c’est peut-être la raison pour laquelle cela ne vous plaît pas ! –, constitue une avancée.

Certes, mais ce n’est pas la peine de supprimer la disposition maintenant, car cela pourrait être interprété différemment !
La question de la maîtrise des dépenses publiques est d’une autre nature. Elle affecte l’ensemble des finances publiques et ne saurait conduire à remettre en cause les acquis de la décentralisation.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
Vous souhaitez la suppression de dispositions adoptées récemment, puisqu’elles datent du 28 mars 2003.
Le principe d’indivisibilité de la République est énoncé à l’article 1er de la Constitution. Les collectivités territoriales font partie intégrante de la République. La décentralisation s’inscrit dans ce cadre.
C'est pourquoi l’article 72 de la Constitution prévoit que le représentant de l’État a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois dans les collectivités territoriales.
L’article 72-2 oblige le législateur à prévoir des dispositifs de péréquation pour favoriser l’égalité entre collectivités.
Vous dites que vous êtes partisans de l’approfondissement d’une décentralisation démocratique, sociale et égalitaire, mais vous proposez de supprimer une disposition précisant cette organisation. Il y a là une petite incohérence !
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Nous avons eu ce débat lors de la révision constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République, laquelle a eu lieu lorsque Jean-Pierre Raffarin était Premier ministre. Le groupe socialiste avait alors considéré que la formulation de l’article 1er n’était pas heureuse et que nous pouvions nous en dispenser.
Aujourd’hui, la discussion nous semble dépassée, même si les arguments qui avaient été présentés à l’époque restent valables. Le mal est accompli et je ne vois pas ce que changerait la suppression dans la Constitution des mots : « Son organisation est décentralisée. »

Comme mon collègue et toujours ami Bernard Frimat vient de le rappeler, le groupe socialiste avait effectivement voté contre cette disposition au moment de la révision de 2003. Je faisais partie, à l’époque, avec plusieurs amis de ce groupe, de ceux qui ont le plus vigoureusement combattu ce dispositif.
J’aurais donc été plutôt enclin à voter en faveur de l’amendement n° 161 de nos collègues communistes. Seulement, il y a un problème : l’exposé des motifs ne me convient absolument pas.

En fait, le problème posé par l’exposé des motifs est inexact, car il s’agissait de porter atteinte à l’unité de la République par une organisation girondine de la République, au sens des années 1789-1792 !
Lier cela au démembrement des services publics, qui n’est que la conséquence directe du traité de Maastricht, approuvé par la majorité du peuple français, me paraît vraiment abusif.
Quant à la décentralisation démocratique, sociale – ce ne sont que des mots -, mais surtout égalitaire, ce qui est différent, elle ne peut se faire que par la péréquation. Or tout le monde est pour la péréquation, mais quand il faut la voter, personne n’en veut, …

… pour la simple et bonne raison que les partisans de la péréquation disent : ce qui est à moi est à moi ; ce que tu me donnes en plus, je veux bien le partager ! Mais comme il n’y a plus un centime dans la caisse, nous ne sommes pas près de l’avoir !
Pour toutes ces raisons, je ne voterai pas en faveur de cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 381 rectifié, présenté par MM. Baylet, A. Boyer, Collin, Delfau, Fortassin et Vendasi, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article premier de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle permet l'application du principe fondamental de laïcité reconnu par les lois de la République. »
La parole est à M. Gérard Delfau.

Aux termes de l’article 1er de la Constitution, « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. » Après cette affirmation, est déclinée l’application de ces principes : « Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »
Nous proposons, à la suite de cette dernière phrase, d’ajouter les mots : « Elle permet l’application du principe fondamental – je pourrais faire l’économie de ce dernier terme – de laïcité reconnu par les lois de la République. »
Pourquoi faisons-nous cette proposition d’enrichissement du texte ?

Il nous semble qu’il y a urgence à rappeler ce principe républicain, alors qu’un certain nombre de déclarations, de manifestations ou de projets inquiètent des républicains, qu’ils soient de droite ou de gauche, quant à l’effectivité de la séparation des églises et de l’État, fondement du principe de laïcité depuis 1905.
J’ai ici une liste très longue, mais je me limiterai à l’essentiel, monsieur le président. Certaines déclarations, intéressantes, d’ailleurs, par leur cheminement, du Président de la République à Ryad, à Rome, à Paris, en fin et en début d’année, nous ont alertés : y aurait-il, ici ou là, la tentation de revenir sur la loi de 1905 ?

La commission Machelon a été chargée par le ministre de l’intérieur en 2005, année du centenaire de la loi de 1905, de réfléchir à une éventuelle révision de la loi de 1905. Ses conclusions sont toujours dans les cartons et peuvent resurgir à tout moment.
Vous me direz sans doute que ces problèmes ne doivent pas être évoqués lors d’une révision de la Constitution et vous me renverrez à la loi organique. Mais, justement, c’est pour prévenir tout risque en la matière ! Un certain nombre de déclarations nous font craindre que des représentants des cultes puissent, à l’occasion d’une modification du Conseil économique et social, entrer dans cette institution républicaine. Il y aurait alors rupture avec le principe de séparation des églises et de l’État !
Voilà pourquoi, madame la ministre, ayant lu la réponse que vous avez faite à l’Assemblée nationale à mes collègues radicaux de gauche, je ne puis me contenter de ce que vous leur avez dit.
La première phrase de l’article 1er affirme le caractère laïc de la République. Je souhaite soit que nous complétions cet article, soit, à tout le moins, que vous preniez devant la Haute Assemblée un certain nombre d’engagements, notamment sur la question très précise de l’entrée de représentants des cultes au Conseil économique et social.

Je note, tout d’abord, que notre collègue parle de laïcité positive et négative.

Ils figurent dans l’objet de votre amendement ! Je ne connais que la laïcité, qui est reconnue par les lois de la République.
Vous avez des questions à poser au garde des sceaux et il ne m’appartient pas d’y répondre.
M. Gérard Delfau. s’exclame.

La laïcité est déjà affirmée dans la première et dans l’avant-dernière phrase de l’article 1er ; la répétition est inutile.
Par ailleurs, je vous rappelle qu’il n’est pas souhaitable de constitutionnaliser certaines lois, les champs constitutionnel et législatif devant rester distincts. Cela risquerait d’introduire une totale confusion dans la Constitution.
Je comprends parfaitement que vous ayez saisi cette occasion pour poser un certain nombre de questions ou évoquer diverses déclarations. Mais, en ce qui nous concerne, il est parfaitement clair, et depuis longtemps, au moins depuis 1958, et l’on pourrait remonter jusqu’à la loi de 1905, qu’il n’y a rien à changer à tout cela. Pourquoi préciser les choses à partir du moment où elles sont parfaitement claires ?
Je vous rappelle aussi que le respect de ces principes fait l’objet d’un contrôle : le rôle du Conseil constitutionnel est de veiller à la conformité des lois à ces principes, et l’application de celles-ci est sous le contrôle des tribunaux, auxquels, me semble-t-il, on peut faire confiance.

Si vous ne faites pas confiance à l’autorité judiciaire, c’est un autre problème ! On en reparlera plus tard, sans doute en fin de semaine !
Monsieur Delfau, comme vous le savez, la laïcité a fait son entrée dans notre droit positif avec la Constitution de la IVe République. C’est la disposition selon laquelle la France est une République indivisible, laïque et sociale.
La Constitution de 1958 reprend cette formule. Elle la met particulièrement en valeur, puisqu’elle lui réserve le premier alinéa de son article 1er. Faut-il aller plus loin et ajouter, comme vous le suggérez, une phrase indiquant qu’« elle permet l’application du principe fondamental de laïcité reconnu par les lois de la République » ?
Soyez assuré que le Gouvernement partage totalement votre volonté d’assurer un ancrage constitutionnel particulièrement fort au principe de laïcité. Il s’agit de l’un des piliers de notre République, et vous avez eu raison, d’ailleurs, de rappeler les discours du Président de la République, qui, ainsi qu’il le répète souvent, est très attaché à la laïcité.
La laïcité, c’est le respect de l’exercice des cultes, ce n’est pas l’interdiction des cultes.
La référence que vous proposez et qui vise à donner un socle constitutionnel à la loi du 9 décembre 2005 n’est pas nécessaire. Comme vient de le dire M. le rapporteur, le champ constitutionnel et celui de la loi doivent être distincts.
L’amendement communiste introduisant la notion de laïcité dans notre texte constitutionnel a été voté à l’unanimité en 1946.
Or ses auteurs ont été parfaitement limpides sur leurs intentions, puisqu’à leurs yeux, et je vous cite les propos qui ont été tenus à l’époque, « Il était nécessaire que la laïcité de l’État, qui se traduit par la séparation des églises et de l’État et le principe que l’État ne reconnaît et ne protège aucun culte ni aucune religion, soit inscrite dans la Constitution. Le silence sur ce point ne pourrait être compris que comme un abandon d’une des conquêtes les plus importantes des Républicains. »
Voilà ce qui a motivé l’adoption à l’unanimité de cet amendement.
Il paraît difficile d’être plus clair sur les liens intimes qui existent entre notre principe républicain de laïcité et la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’État. Je crains même que la précision que vous proposez ne contribue à alimenter l’idée que ce lien entre le principe de laïcité et la loi de 1905 n’irait pas nécessairement de soi.
Retenir votre amendement, ce serait, d’une certaine façon, se sentir obligé d’inscrire dans la Constitution un principe fondamental reconnu pratiquement par toutes les lois de la République. Or le Conseil constitutionnel n’évoque, en principe, cette notion qu’en cas de silence d’un texte constitutionnel. Je crois que tel n’est pas l’objectif que vous visez, compte tenu de la manière dont vous avez exposé votre amendement.
J’ajoute que la jurisprudence du Conseil constitutionnel n’est pas en retrait, puisque, dans sa décision du 19 novembre 2004, le Conseil constitutionnel n’a pas hésité à conférer une portée particulièrement forte aux dispositions de l’article 1er de notre Constitution.
De même, à l’article 3 sur l’égalité des citoyens devant la loi, il a insisté sur le fait que la laïcité interdisait le communautarisme, défini comme la reconnaissance de droits collectifs à des groupes religieux.
Au-delà de ces considérations juridiques, je voudrais également répondre à une préoccupation que traduit l’objet de votre amendement : vous évoquez la nécessité de donner une définition précise et intangible de la notion de laïcité, qui ne doit pas être à géométrie variable.
Je partage avec vous l’idée que la laïcité ne doit pas être instrumentalisée de façon partisane. Elle fait partie de notre héritage républicain commun. Nous serons donc attentifs à sa défense, dans toutes ses dimensions.
Afin de dissiper toute ambigüité et être parfaitement claire sur le sujet, je tiens à redire solennellement dans cet hémicycle l’attachement du Gouvernement aux principes qui fondent la loi de 1905. Le Président de la République a réaffirmé qu’ils conservaient toute leur actualité.
Sous le bénéfice de ces considérations, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
S’agissant de la représentation des courants spirituels au sein du Conseil économique et social, il est indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi : « Ces mesures préfigurent une vaste réforme de la composition du Conseil – nous en reparlerons quand viendra le débat sur la composition du CES – qui devra faire davantage de place - ainsi que le président de la République l’a dit lui-même – aux organisations non gouvernementales, aux jeunes, notamment aux étudiants, et le cas échéant aux grands courants spirituels. »
Je vous renvoie donc à la réponse contenue dans l’exposé des motifs du projet de loi, et aux déclarations constantes du Président de la République pour qui le Conseil économique et social représente les forces vives de la nation, dont font partie les courants spirituels.

On peut évidemment discuter indéfiniment sur la question de savoir s’il faut compléter ou non l’article 1er de la Constitution. C’est la question que soulève l’amendement n° 381 rectifié, qui vient d’être présenté par M. Delfau.
Je voudrais simplement dire, madame le garde des sceaux, que répéter sans cesse la même chose n’est pas inutile tant les menaces les plus sournoises pèsent constamment sur la laïcité, et tant les pouvoirs publics ont quelquefois tendance à « mollir », alors qu’il faudrait être ferme, pour des raisons diverses et variées, manifestations de banlieues, manifestations ici ou là, pressions diverses, etc.
Je ne parle pas simplement des incertitudes qui entourent les problèmes de construction sur fonds publics de lieux de culte, où, là, les textes sont plus ou moins soumis à des appréciations variables, ou des subventions à certains cultes, qui ne vont pas toutes devant le tribunal administratif.
J’ajouterai que, par rapport à la loi de 1905, le problème posé aujourd’hui n’est pas seulement celui du culte catholique ; je dirai même que ce n’est plus vraiment celui du culte catholique, car il s’agit en fait d’autres cultes.
Madame le garde des sceaux, dans votre réponse, et je vous en remercie et vous en félicite, vous avez, à deux reprises, donné le titre exact de la loi de 1905 : « Séparation des églises et de l’État ».
Il serait utile que le Premier ministre adresse une circulaire à l’ensemble des services publics et des fonctionnaires placés sous son autorité ainsi qu’aux membres du Gouvernement, afin que soit reprise l’habitude de parler de la séparation « des églises et de l’État ». Il importe de ne pas donner le sentiment à nos interlocuteurs, à de nombreuses reprises, qu’un seul culte est visé, le culte catholique. En effet, la loi de 1905 ne visait pas que le culte catholique, elle visait aussi l’ensemble des cultes, puisqu’elle prenait la suite, pour l’abroger, du concordat de Napoléon Ier, mais c’est une autre histoire !
Donc, outre que j’ai été heureux de relever cette précision dans vos propos, je souhaite que l’expression se généralise beaucoup plus. Je suis toujours choqué quand j’entends un ministre, un préfet, une autorité de la République, évoquer la séparation de l’église et de l’État, quand il s’agit des églises, et celle à laquelle on pense quand on parle de la séparation de l’église et de l’État n’est pas celle qui, aujourd’hui, même si elle n’a renoncé à rien, menace le plus la République dans certaines circonstances.

Cet amendement, il y a un an, n’aurait pas attiré spécialement mon attention. Mais, depuis une année, nous avons relevé un faisceau d’indices, tels que le discours de Riyad ou les propos tenus lors du discours de Latran quant à la supériorité du curé sur l’instituteur pour la transmission des valeurs, qui sont préoccupants pour la laïcité
Le toilettage envisagé de la loi de séparation des églises et de l’État nous préoccupe et nous amène à penser qu’il y aurait un projet de civilisation en marge de notre projet républicain.
C’est la raison pour laquelle je voterai l’amendement n° 381 rectifié.

J’aurais pu, madame le garde des sceaux, retirer cet amendement, qui serait ainsi devenu un amendement d’appel, mais je ne le ferai pas pour deux raisons.
D’abord, M. le président-rapporteur de la commission des lois, ayant sans doute écouté un peu distraitement mes propos, …

… m’a prêté une conception de la laïcité qui est rigoureusement celle que je récuse, puisque je ne parle, à ma modeste place, contrairement au Président de la République, que de « principe de laïcité », et surtout pas de « laïcité positive » !
Par ailleurs, vous venez de confirmer, madame le garde des sceaux, qu’au sommet de l’État, aujourd’hui, est prônée l’idée, combattue par nombre de républicains, dont M. Dechartre, d’ouvrir le Conseil économique et social aux forces représentant les cultes et les églises ès qualités. Si tel était le cas, la réaction serait vive et large dans l’opinion publique, car cela signifierait que l’on a commencé à revenir sur la loi de 1905 !
M. Guy Fischer applaudit.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 162, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mode de scrutin proportionnel assure une juste représentation du peuple. »
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Nous proposons, par cet amendement, d’inscrire dans la Constitution le principe même du mode de scrutin proportionnel pour la mise en œuvre du suffrage universel. Nous suggérons d’indiquer que c’est ce mode de scrutin qui permet une juste représentation du peuple.
Bien entendu, la disposition présentée ne préjuge pas des modalités d’application aux différentes élections se déroulant dans notre pays.
Chacun connaît ici les atouts de la proportionnelle en matière démocratique, même s’il ne veut pas les entendre : la proportionnelle, c’est la garantie du pluralisme, c’est la garantie de la parité entre les femmes et les hommes, c’est la garantie du renouvellement des générations et d’un recul de la notabilisation et du clientélisme, c’est, enfin, la garantie d’une juste photographie de l’état politique du pays, d’une collectivité territoriale à un moment donné de son histoire.
Cette question de l’instauration de la proportionnelle est donc centrale.
Comment envisager de moderniser les institutions - c’est l’objectif affiché de ce projet de loi - sans chercher à améliorer la représentativité des assemblées - je pense en particulier au Parlement -, alors que tous les observateurs notent le décalage entre leur composition et la réalité politique et sociologique du pays ?
Cette évidence de la proportionnelle n’a échappé à personne, puisque le Président de la République lui-même avait avancé l’idée d’une mise en œuvre de celle-ci, certes très minimaliste.
À plusieurs reprises, lors de la campagne de l’élection présidentielle, au lendemain de celle-ci, à l’occasion de son discours d’Épinal, ou encore dans les différentes lettres de mission adressées à MM. Balladur et Fillon pour l’élaboration de la présente révision, le candidat Nicolas Sarkozy d’abord, puis le Président de la République, a demandé l’instauration d’une dose de proportionnelle.
Dans sa lettre du 12 novembre au Premier ministre, il lui demandait de réfléchir à l’application de la proportionnelle soit au Sénat, soit à l’Assemblée nationale. D’ailleurs, des voix se sont élevées au sein de l’UMP, par exemple celle de M. Devedjian, pour préconiser la modification des modes de scrutin en ce sens.
Améliorer la représentativité du Parlement relève vraiment de l’urgence. Le débat auquel a donné lieu l’examen de la proposition de loi du groupe socialiste relative aux conditions de l’élection des sénateurs, les discussions au sein de la commission des lois et celles que nous avons en permanence dans cet hémicycle, démontrent tous les jours la nécessité de revoir nos modes de scrutin : dire que la proportionnelle est le meilleur moyen de représenter le peuple est une bonne façon de le faire !
M. Jean Desessard applaudit.

On a indiqué à plusieurs reprises, ces dernières semaines, que les modes de scrutin ne relevaient pas de la Constitution. Je vous le confirme.
Par conséquent, j’émets un avis défavorable.
Les modes de scrutin ne relèvent pas de la Constitution ; nous en avons longuement débattu à l’Assemblée nationale et lors de mon audition par la commission des lois du Sénat. La Constitution fixe les grands principes : elle prévoit, notamment, que le suffrage est toujours universel, égal et secret, le reste relevant de la loi organique et des lois électorales.
Au-delà, il n’y a aucune raison de considérer que le scrutin proportionnel doit être la règle. Le scrutin uninominal a aussi ses avantages : il permet de voter pour une personne et non pour une étiquette politique, il assure une proximité plus grande entre l’élu et ses électeurs, ainsi qu’une meilleure représentation des territoires.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. Jean Desessard. Les Verts vont voter l’amendement présenté par le groupe CRC, car ils estiment que la représentation proportionnelle permet de représenter la diversité des opinions.
Exclamations sur les travées de l ’ UMP.

Mes chers collègues, les écologistes sont obligés d’engager des négociations à n’en plus finir avec les grands partis pour être représentés ! C’est parfois très difficile, en particulier pour les prochaines élections !
Sourires

Aujourd’hui, nous ne sommes plus dans un contexte de bipolarisation ! La pluralité d’opinions et d’analyses dans notre société est une réalité, et la sensibilité écologiste qui émerge doit être représentée aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.
Par ailleurs, on nous dit qu’une assemblée élue à la proportionnelle n’est pas gérable. Enfin, soyons sérieux ! En Allemagne, les députés sont élus à la proportionnelle, et je ne vois pas en quoi le système allemand serait plus critiquable que le système français.

La moitié des députés sont élus sur des listes, mais le résultat final respecte la représentation proportionnelle intégrale.

M. Jean Desessard. En France, les instances régionales et municipales sont élues en partie à la proportionnelle : je n’ai jamais entendu de critiques sur le fonctionnement de ces assemblées ! On peut dire que tel président ne fait pas grand-chose
Exclamations sur les travées de l ’ UMP.

M. Jean Desessard. … ou encore que tel groupe politique n’est pas assez actif, certes !
Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.

Enfin, je suis tout à fait d’accord avec l’explication donnée par le groupe CRC, selon laquelle la représentation proportionnelle permet la représentation de la diversité de la société.
Je vous citerai un exemple ! J’ai étudié la représentation des femmes dans notre assemblée : celle-ci compte 17, 6 % de femmes ; mais lorsque les départements votent à la proportionnelle, les femmes représentent 24 % des élus ; et lorsque le mode de scrutin est uninominal, la proportion de femmes élues est seulement de 3 % !
La proportionnelle permet la représentation des femmes, elle permet la représentation des minorités, …

…ce qui n’est pas le cas du mode de scrutin uninominal, système standard qui favorise l’homme blanc de 55 ans appartenant aux classes moyennes.
La représentation générale de la société est donc assurée par la représentation proportionnelle !

Nos collègues communistes sont constants dans leur position, car ils ont toujours défendu la représentation proportionnelle lorsqu’ils étaient dans l’opposition.
Je tiens cependant à rappeler que, dans tous les pays où ils sont parvenus au pouvoir, l’une des premières mesures qu’ils ont prises a été de supprimer immédiatement la proportionnelle !
Rires et applaudissements sur les travées de l ’ UMP. –Protestations sur les travées du groupe CRC.

M. Dominique Braye. Ils ne sont pas près de prendre le pouvoir chez nous, avec 1, 9 % des voix !
Nouvelles protestations sur les travées du groupe CRC.

Je ne suis pas sûre d’avoir saisi la remarque de M. Portelli, mais si j’ai bien compris son allusion, je doute qu’il apprécierait que je lui demande ce que font ses amis dans tel ou tel pays !
L'amendement n'est pas adopté.

Dans la passion qui était la nôtre au moment de voter sur la question des langues régionales et compte tenu de la complexité de la situation – sachant qu’en votant pour les amendements de suppression, on était contre l’introduction des langues régionales dans la Constitution, et inversement –, une erreur matérielle s’est produite.
Je souhaite donc apporter une rectification : M. Nogrix souhaitait voter contre les amendements de suppression de l’article 1er A et Mme Morin-Desailly voulait voter pour.

Acte vous est donné de cette mise au point, monsieur Mercier.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Philippe Richert.