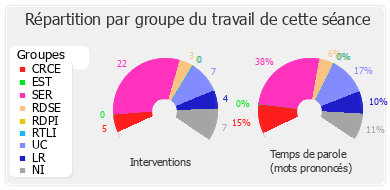Séance en hémicycle du 30 mars 2015 à 16h00
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à seize heures.

Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 25 mars a été publié sur le site internet du Sénat.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre l’avenant n° 1 à la convention du 28 septembre 2010 entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d’investissements d’avenir, action « Ville de demain ».
Acte est donné du dépôt de ce document.
Il a été transmis à la commission des finances et à la commission des affaires économiques.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, d’une part, le rapport sur les droits familiaux de retraite et, d’autre part, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d’un Conseil d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
Acte est donné du dépôt de ces rapports.
Ils ont été respectivement transmis à la commission des affaires sociales et à la commission des lois, ainsi qu’à la commission des affaires économiques.

Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 26 mars 2015, deux décisions du Conseil relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :
- le droit de présentation des greffiers des tribunaux de commerce (n° 2015-459 QPC) ;
- l’affiliation des résidents français travaillant en Suisse au régime général d'assurance maladie (n° 2015-460 QPC).
Acte est donné de ces communications.

M. le président du Sénat a reçu de M. le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie les avis formulés par le congrès de la Nouvelle-Calédonie au cours de sa séance publique du mardi 24 mars 2015 sur :
- le projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer ;
- et le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande concernant le statut des forces en visite et la coopération en matière de défense.
Ces documents ont été transmis respectivement à la commission des lois et à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, renforçant la lutte contre le système prostitutionnel (proposition n° 207 [2013-2014], texte de la commission n° 698 [2013-2014], rapport n° 697, tomes I et II [2013-2014], rapport d’information n° 590 [2013-2014]).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d'État.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je prends la parole aujourd’hui devant vous consciente de l’importance du débat qui nous réunit. Il s’agit en effet d’avoir des échanges sur un sujet souvent tabou, rarement évoqué par notre société : la prostitution. Plus précisément, il s'agit d’aborder non pas la seule prostitution, mais le système prostitutionnel qui unit les trois acteurs que sont le proxénète, la prostituée et le client.
Je veux d’abord rappeler l’engagement international de la France qui fait d’elle un pays abolitionniste depuis 1960.
À cette date, elle a ratifié la convention de l’Organisation des Nations unies du 2 décembre 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui. Déjà, cette convention établit un lien direct entre prostitution et traite des êtres humains. Son préambule affirme que « la prostitution et […] la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine ».
Se sont ensuite succédé, en 1979, la convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2000, le protocole de Palerme contre la traite des femmes et, en 2005, la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.
La directive européenne de 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil demande de faire en sorte que « les autorités nationales compétentes aient le pouvoir de ne pas poursuivre les victimes de la traite ».
Tous ces textes internationaux sont rappelés dans la résolution de l’Assemblée nationale du 6 décembre 2011 réaffirmant la position abolitionniste de la France en matière de prostitution.
Enfin, le 26 février 2014, le Parlement européen a adopté une résolution affirmant que « la prostitution [est] contraire aux principes de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment l’objectif et le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes ».
Aujourd’hui, en mars 2015, il s’agit de savoir ce que dit la France. Sachez que nous sommes regardés partout dans le monde ! Je reviens de l’ONU, de New York, et je peux en témoigner : nombreux sont ceux qui attendent et espèrent un geste fort de notre pays.
Le débat de ce jour est un débat de société. La sémantique a son importance. Qu’est-ce que l’abolitionnisme ? C’est un système qui vise à abolir toute forme de réglementation de la prostitution, afin de ne pas encourager celle-ci. Il s’agit de décourager les réseaux de prostitution en instaurant un contexte défavorable à leurs activités. Cette posture de l’État a des résultats, comme la police suédoise peut le constater lors d’écoutes téléphoniques : les réseaux de proxénètes qualifient désormais la Suède de « dead market », c'est-à-dire une zone non accueillante pour leur trafic.
Bien sûr, il ne s’agit pas de se satisfaire que les réseaux migrent et se déplacent chez nos voisins ; il faut que, à terme, toute l’Europe soit considérée comme un continent où les réseaux de traite ne peuvent agir librement et où les prostituées sont des victimes à protéger et non des objets de consommation sur le marché de la sexualité.
Abolir la prostitution en France, c’est poser un interdit, c’est envoyer un signe. À ceux qui pensent encore que le réglementarisme est une solution, il faut rappeler qu’il a été appliqué dans notre pays de 1830 à 1946, avec fichage des prostituées, maisons closes ayant pignon sur rue et contrôle sanitaire obligatoire. Mais ce système n’a pas été convaincant et a laissé se développer un trafic d’êtres humains destiné à alimenter ces maisons dites « de tolérance ».
Après-guerre, la France a donc choisi de fermer ces maisons, qui, loin de la vision romantique que d’aucuns se plaisent parfois à véhiculer, mettaient les femmes en situation de se soumettre à soixante-dix passes par jour. Que l’on ne s’y trompe pas, telle est encore aujourd’hui la situation en Allemagne ou en Suisse dans ces immenses Eros centers qui fleurissent à l’entrée des villes ! Ces pays réglementaristes sont en plein débat sur leurs choix, qui sont contestés par une partie de la population.
En France, il n’y a pas de supermarchés du sexe, mais on assiste à une transformation profonde de la prostitution. Selon l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains, l’OCRTEH, actuellement, 97 % des filles proviennent directement de la traite des êtres humains. Roumaines, Ukrainiennes, Nigérianes ou Chinoises, elles ont été arrachées à leur famille ou achetées. Elles ont payé leur passeur pour le rêve d’une vie en Europe et vivent sous la menace du remboursement de la dette contractée. Elles sont parquées dans des dortoirs et mises sur le trottoir le soir. Elles sont tatouées, scarifiées, droguées, violentées, assassinées. La prostitution est une violence. Comme vous, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis allée voir au plus près la réalité de la vie de ces prostituées, et personne ne peut prétendre qu’elles sont libres de leur activité. Il est faux de le dire, et pire de le croire.
Le corps des femmes est donc l’objet d’un marché lucratif. Selon le Bureau international du travail, les profits tirés de l’exploitation des êtres humains s’élèvent à 150 milliards de dollars par an. Eu égard à cette estimation, la traite, notamment sexuelle, est la deuxième forme de criminalité la plus lucrative derrière le trafic de drogue. Et les réseaux ne s’y trompent pas, car ils investissent massivement dans cette activité et s’organisent, telles des multinationales. C’est ce que nous explique l’OCRTEH, qui, en 2014, a démantelé cinquante réseaux pour un total de 590 proxénètes.
Par ailleurs, des associations – il convient de leur rendre hommage pour leur remarquable travail de terrain – suivent les prostituées et alertent sur la situation dramatique de celles-ci en termes de santé. Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, ou IGAS, intitulé Prostitutions : les enjeux sanitaires, du mois de décembre 2012, confirme la fragilité des prostituées, qui sont confrontées au sida et aux maladies sexuellement transmissibles, bien sûr, mais aussi au risque de tuberculose, aux dermatoses, aux pathologies hépatiques, aux troubles digestifs liés au stress, aux troubles musculo-squelettiques, à des déséquilibres alimentaires et à des problèmes dentaires.
Une tribune d’un collectif de médecins – dont Axel Kahn, Xavier Emmanuelli et Israël Nisand – rappelle que les personnes prostituées sont victimes de violences graves, qui portent atteinte à leur intégrité physique et psychique : leur taux de mortalité est six fois plus élevé que celui du reste de la population.
Selon une étude de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies publiée en 2004, l’usage de l’alcool et de produits stupéfiants est fréquent dans ce milieu. Il peut apparaître comme l’unique moyen de tenir dans un univers anxiogène et violent.
Aux termes d’une étude de l’Institut de veille sanitaire conduite en 2010 et 2011, 29 % des personnes prostituées déclaraient avoir eu des pensées suicidaires, contre 3 % à 4 % de la population générale.
Il faut donc porter une attention sanitaire particulière aux prostituées.
Cela étant, la prostitution n’est pas une activité comme une autre. Elle n’est pour personne un projet de vie. Les survivantes de la prostitution parlent d’actes sexuels répétés, consentis, mais non désirés. Elles disent à quel point l’estime de soi est rapidement mise à mal, expliquent que seule une dissociation de personnalité permet de tenir. La prostitution est une violence qui a de lourdes conséquences physiques et psychiques.
Par ailleurs, si la présente proposition de loi devait comporter le délit de racolage sans aucune responsabilisation du client, nous aboutirions à un statu quo et vous conforteriez, mesdames, messieurs les sénateurs, les réseaux de traite des prostituées et leur financement par l’achat d’actes sexuels.
La responsabilisation du client permet au troisième acteur du système prostitutionnel de ne pas rester invisible. C’est le client qui crée la demande.
Permettez-moi d’abord de rappeler que, en France, depuis 2002, l’achat d’acte sexuel est déjà sanctionné lorsque la personne prostituée est mineure ou particulièrement vulnérable. Il s’agit donc non pas de créer une nouvelle infraction, mais d’étendre celle qui existe à tous les achats d’acte sexuel, quelles que soient les caractéristiques de la personne prostituée. Il a été choisi de faire de ces actes non pas un délit, mais une contravention de cinquième classe.
Toutefois, l’enjeu du présent texte va au-delà du droit. C’est aussi un message clair qui est envoyé : par le biais de la proposition de loi, il est dit, d’une part, au client qu’acheter un corps est punissable, que ses actes le font participer au financement du système prostitutionnel et, d’autre part, aux réseaux qu’ils ne sont pas les bienvenus en France.
Pour assurer la cohérence du texte, il faut protéger les prostituées. La suppression du délit de racolage au profit de l’instauration d’un parcours de sortie de la prostitution renverse totalement l’approche. D’une délinquante, le texte fait de la prostituée une victime, ce qui est juste.
Il faudra que l’État assume son rôle en augmentant le fonds, prévu à la mesure 21 du plan d’action national contre la traite des êtres humains, qui vise à financer les parcours de retour à une vie normale.
Pour clore mon propos, je tiens à dire que ce choix de lutte contre le système prostitutionnel s’inscrit aussi dans une visée plus large : l’égalité entre les femmes et les hommes. Celle-ci ne sera pas possible tant que le corps des femmes restera un objet que l’on peut s’acheter.
Victor Hugo écrivait : « On dit que l’esclavage a disparu de la civilisation européenne. C’est une erreur. Il existe toujours. Mais il ne pèse plus que sur la femme, et il s’appelle prostitution ». Alors, soyons à la hauteur de nos engagements !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste et de l'UDI-UC.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, cela fait désormais un peu plus d’un an que la commission spéciale chargée d’examiner la présente proposition de loi a entamé ses travaux. Nous avons mené de nombreuses auditions qui nous ont permis d’entendre les points de vue des uns et des autres : institutions, associations, médecins et, évidemment, personnes prostituées, à l’exception, toutefois, des clients !
Au cours de ce processus qui a conduit la commission spéciale à élaborer un texte le 8 juillet dernier, j’ai travaillé étroitement avec le président de celle-ci, qui était alors Jean-Pierre Godefroy ; je le remercie de nos relations constructives et cordiales. Je salue également M. Vial, qui assure actuellement la présidence de la commission spéciale. Je remercie enfin Mme Gonthier-Maurin de son rapport intitulé Prostitution : la plus vieille violence du monde faite aux femmes, travail aujourd’hui soutenu par Mme Jouanno, au titre de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Aborder un sujet aussi passionnel et complexe que celui de la prostitution n’est pas chose aisée. Nombre des questions soulevées par la proposition de loi transcendent les clivages partisans habituels. Ce texte s’inscrit dans la droite ligne de la proposition de résolution adoptée par l’Assemblée nationale au mois de décembre 2011, qui réaffirmait « la position abolitionniste de la France, dont l’objectif est, à terme, une société sans prostitution ». Ce texte est également cohérent avec l’article 1er de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. C’est aussi à un changement de regard sur cette violence faite aux femmes que nous invite la présente proposition de loi.
Les réalités de la prostitution ont évolué. De la prostitution de rue à l’exploitation organisée dans le cadre des réseaux, en passant par l’escorting pratiqué via internet, la prostitution est multiforme. Mais, quelle que soit la forme de la prostitution, que celle-ci soit régulière ou occasionnelle, le système prostitutionnel reste très majoritairement masculin. En effet, 85 % des 20 000 à 40 000 personnes prostituées en France sont des femmes et 99 % des clients sont des hommes. L’association Agir contre la prostitution des enfants estime, quant à elle, que 5 000 à 8 000 mineurs sont prostitués en France. L’âge moyen d’entrée dans la prostitution se situerait autour de treize à quatorze ans.
Un constat s’impose : le poids des réseaux de proxénétisme et de traite à des fins d’exploitation sexuelle n’a cessé de grandir au cours des dernières décennies. Si depuis toujours les personnes prostituées appartiennent aux classes sociales les plus défavorisées, depuis les années 2000, elles sont, selon l’OCRTEH, à 97 %, de nationalité étrangère. Leur vulnérabilité et leur invisibilité sont extrêmes. Ces personnes sont sans droits, ne parlent pas notre langue et sont maintenues sous la coupe de réseaux organisés et violents qui les déplacent au gré du « marché ».
La lutte contre ces réseaux continue d’être notre premier objectif. La France est très active en ce domaine, mais doit encore aller plus loin en renforçant les moyens humains et financiers de la police et de la justice. Le Gouvernement a engagé ce chantier en créant la MIPROF, la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, et en lançant le premier plan national de lutte contre la traite des êtres humains au mois de mai dernier. En outre, toutes les mesures visant à intervenir sur l’offre et la demande concourent à cette lutte contre la traite humaine.
Mes chers collègues, la présente proposition de loi nous permet aussi d’aller plus loin, notamment en ce qui concerne la lutte contre les réseaux sur internet. Le texte adopté par l’Assemblée nationale inscrit déjà le proxénétisme et la traite parmi les délits graves qui doivent susciter une réaction rapide des hébergeurs et des fournisseurs d’accès lorsque des sites manifestement liés à de tels agissements leur sont signalés par les internautes. En revanche, lorsque la commission spéciale a établi son texte au mois de juillet dernier, la réflexion n’était pas suffisamment mûre pour adopter un dispositif plus contraignant de blocage des sites à la demande de l’administration. Depuis, la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a permis la mise en place d’un tel système pour les sites faisant l’apologie du terrorisme. Ce mécanisme fonctionne depuis quelques semaines. C’est la raison pour laquelle j’ai proposé à la commission spéciale, rejointe sur ce point par Chantal Jouanno, d’adopter un amendement visant à bloquer les sites internet utilisés par les réseaux de traite et de proxénétisme.
En matière de lutte contre les réseaux, la proposition de loi prévoit, par ailleurs, des mesures de protection des personnes prostituées qui s’inspirent du dispositif créé pour les repentis, ce qui constitue une avancée notable. Enfin, je rappelle que la commission a adopté, sur mon initiative et sur celle de Jean-Pierre Godefroy, un amendement qui vise à conférer aux inspecteurs du travail le pouvoir de constater les infractions de traite des êtres humains, ce qui concourt directement à l’objectif visé par le texte, dans la mesure où 79 % des victimes de la traite sont victimes d’exploitation sexuelle.
Notre deuxième objectif concerne la prise en charge et l’accompagnement sanitaire et social des personnes prostituées.
Quelles qu’en soient les modalités d’exercice, la prostitution réduit la personne prostituée à l’état d’objet, de marchandise devant répondre à toutes les exigences sexuelles de celui qui achète. C’est une donne universelle : la « pute », même « de luxe », même indépendante, même mineure, doit subir ces insultes, ces humiliations et ces violences, de par sa posture sociale. La prostitution, quel que soit le milieu social du client et quel que soit son mode d’exercice, est assimilable à un viol tarifé. Les personnes en situation de prostitution connaissent, je le rappelle, un taux de mortalité six fois plus élevé que celui du reste de la population. Elles ont soixante à cent vingt fois plus de risques de mourir de mort violente. Inutile de développer davantage les conséquences évidentes de la prostitution du point de vue physique, psychique et social !
Pour toutes ces raisons, les pouvoirs publics doivent soutenir l’action associative. La présente proposition de loi renforce donc les actions en matière de réduction des risques pour les personnes prostituées. Elle élargit la formation des travailleurs sociaux et crée un parcours de sortie de la prostitution. La commission spéciale a clarifié les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi de ce parcours, qu’elle a choisi d’intituler « projet d’insertion sociale et professionnelle » et qu’elle a ouvert à l’ensemble des personnes victimes de la prostitution.
Organisé sous la responsabilité du préfet, le projet sera défini en accord avec la personne accompagnée, en fonction de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Il lui permettra d’accéder à des solutions autres que la prostitution. Toute association ayant pour objet l’aide et l’accompagnement des personnes en difficulté pourra y participer, sous réserve de remplir des conditions d’agrément fixées par voie réglementaire. Je souhaite remercier en cet instant les associations qui s’engagent aux côtés des personnes prostituées et qui attendent avec impatience l’issue des travaux parlementaires.
L’entrée dans le projet permettra aux personnes étrangères de prétendre au bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour dont la commission spéciale a fixé la durée, contre mon avis, à un an renouvelé automatiquement. Des amendements tendant à ramener cette durée à six mois renouvelables – cela correspond aux conditions prévues par l’Assemblée nationale – ont été présentés. La commission spéciale a longuement débattu de ce point la semaine dernière. Par cohérence, je pense qu’il serait logique d’aligner la durée du projet d’insertion sociale et professionnelle sur celle de l’autorisation provisoire de séjour. Dès lors, en prévoyant une période de six mois, nous aurions la garantie d’un réexamen régulier de la situation des personnes accompagnées, des difficultés qu’elles rencontrent et des moyens mis en œuvre pour assurer leur sécurité et les aider. Des délais de renouvellement trop espacés risquent non seulement de nuire à la qualité de l’accompagnement, mais également d’entraîner une instrumentalisation par les réseaux.
Je rappelle à cet égard que, en supprimant la condition de sortie de la prostitution pour bénéficier de l’autorisation provisoire de séjour, la commission spéciale a fixé une obligation de moyens, et non de résultat, aux personnes qui entreront dans le projet d’insertion sociale et professionnelle. Il s’agit là d’une position réaliste qui permet de tenir compte des difficultés qui entourent la sortie de la prostitution.
Par ailleurs, les mesures d’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées doivent être financées par un fonds dédié. La commission spéciale a renforcé ces financements en prévoyant d’allouer au fonds l’ensemble des recettes prélevées sur les gains des proxénètes ainsi que les biens et produits dont sont redevables les personnes reconnues coupables de l’infraction de traite des êtres humains. L’enjeu financier est essentiel pour que les mesures d’accompagnement soient effectivement mises en œuvre. Je suis heureuse, madame la secrétaire d’État, que vous ayez confirmé l’objectif de consacrer jusqu’à 20 millions d’euros à la protection et à la réinsertion des victimes de la traite des êtres humains lors de votre audition la semaine dernière.
S’agissant de l’aspect pénal de la proposition de loi, l’article 16 prévoyait l’incrimination du client avec la création d’une contravention de cinquième classe ; par voie de conséquence, l’article 17 créait une peine complémentaire de stage de sensibilisation. J’emploie l’imparfait, car ce sont les seules dispositions qui ont été refusées par la commission spéciale. À titre personnel, je le regrette.
Il s’agissait pourtant d’un dispositif novateur, s’appuyant sur des expériences conduites par des pays voisins. Celles-ci sont tout à fait probantes du point de vue tant de leur incidence sur la demande et sur l’offre de prostitution que de la prise de conscience du client et de la société tout entière à l’égard de ce qui représente, avant tout, une violence à l’égard des femmes.
Ce volet était essentiel à l’équilibre général de la proposition de loi et marquait concrètement et symboliquement la responsabilisation du client en tant qu’acheteur, acteur du système prostitutionnel. Poser clairement l’interdiction d’acheter un acte sexuel revient à dire qu’une relation sexuelle doit se négocier librement entre deux personnes véritablement consentantes. Nous renforcions ainsi l’interdit du viol, de l’inceste, du tourisme sexuel et de toute agression sexuelle.
La majorité des membres de la commission spéciale a considéré qu’une telle mesure pourrait placer les personnes prostituées en situation de risques accrus du fait d’une plus grande clandestinité. Pourtant, aujourd’hui, la principale cause de clandestinité de la prostitution réside dans le délit de racolage, instauré en 2003, qui place les personnes prostituées en situation de délinquantes. Il y aurait donc, selon moi, une contradiction évidente à refuser la pénalisation des clients tout en maintenant le délit de racolage public. Nous aurons l’occasion d’évoquer cet aspect lors de l’examen d’un amendement visant à rétablir ce délit dans le présent texte.
Mes chers collègues, le dernier pilier de cette proposition de loi concerne l’éducation à la sexualité et la prévention du recours à la prostitution auprès des jeunes. La commission spéciale l’a conforté, en créant notamment un nouvel article au sein du code de l’éducation prévoyant qu’une information sur les réalités de la prostitution sera dispensée dans les collèges et lycées par groupes d’âge homogène. Nous avons précisé que cette information devra également porter sur les enjeux liés aux représentations sociales du corps humain, avec « une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes » et contribuer ainsi « à l’apprentissage du respect dû au corps humain. »
Victor Hugo, sénateur illustre qui a siégé dans cet hémicycle même, voyait dans la prostitution la dernière forme d’un esclavage que pensait avoir aboli la civilisation européenne. Nous avons donc aujourd’hui une responsabilité historique. Je ne peux pas douter que la Haute Assemblée mettra un point d’honneur à décider l’abolition de la prostitution en tant que privilège de genre et de classe et d’entrave majeure à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Pour ma part, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je suis fière de contribuer aujourd’hui, par mon vote, à faire de notre société une référence internationale en matière de droits humains, en particulier de droits des femmes.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe écologiste et de l’UDI-UC.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, il n’était pas prévu, voilà quelques semaines, que je m’exprime en tant que président de la commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel. Je souhaite donc saluer en préambule la manière dont Jean-Pierre Godefroy a conduit les travaux de cette commission et la qualité des débats qui s’y sont déroulés.
J’adresse également mes remerciements à Mme la rapporteur, Michelle Meunier, dont l’investissement et les convictions sont toujours aussi forts. La commission spéciale a rencontré, durant cinq mois, près de quatre-vingts personnes, représentants du monde associatif, des milieux judiciaire et policier, personnes prostituées, chercheurs et personnalités qualifiées. J’ai été frappé, à cet égard, d’entendre un certain nombre de personnes nous dire qu’elles étaient invitées pour la première fois à s’exprimer sur cette proposition de loi, qui avait pourtant déjà fait l’objet d’un examen par l’Assemblée nationale. Ainsi, sur ce texte comme sur d’autres, le Sénat aura travaillé de manière approfondie, en faisant preuve d’écoute et de pragmatisme, alors même que le sujet suscite de nombreuses réactions passionnelles et souvent contradictoires.
En effet, depuis le début de son processus législatif, entamé à l’automne 2013, ce texte, et plus précisément sa mesure la plus médiatique, qui prévoit la pénalisation des clients de prostituées, divise profondément. Il divise, comme on le verra dans un instant, non seulement les groupes politiques, mais aussi les associations féministes, les acteurs de terrain qui aident les personnes prostituées, les chercheurs, les milieux judiciaires, médicaux, voire, madame la secrétaire d’État, les membres du Gouvernement : certains d’entre eux, dans le cadre de leur audition par la commission spéciale, ne nous ont pas semblé particulièrement enthousiasmés par cette mesure.
Membre de la commission spéciale depuis sa création, j’ai observé que certains collègues, en écoutant les personnes concernées et les associations œuvrant au plus près du terrain, ont changé d’avis – c’est assez rare pour être souligné –, prenant notamment conscience des effets négatifs que pourrait avoir cette disposition du texte. La présidente de la Commission nationale consultative des droits de l’homme elle-même nous a indiqué qu’elle avait été initialement favorable à la pénalisation des clients de prostituées, mais que sa position s’était inversée durant les travaux qu’elle avait menés.
On le constate, la question est donc loin d’être simple. La pénalisation soulève en effet deux interrogations de nature bien différente.
La première est d’ordre conceptuel, philosophique, voire moral, et concerne les fondements mêmes du phénomène : peut-on admettre qu’existe une prostitution librement choisie, comme le revendiquent un certain nombre de personnes prostituées et d’associations ? Ou bien la prostitution est-elle par définition une activité ne pouvant s’exercer que sous la contrainte, sans parler d’autres considérations ?
La seconde question obéit à une logique plus pragmatique, ou plus réaliste. Dans la mesure où le texte ne s’inscrit pas dans le cadre de la prohibition et s’intéresse aux effets concrets d’une telle mesure, comment lutter au mieux contre la traite des êtres humains à des fins sexuelles, véritable fléau progressant en Europe, et mieux protéger celles qui en sont victimes ? Sur ce point, madame la secrétaire d’État, nous sommes tous d’accord. Les chiffres sont d’ailleurs suffisamment accablants pour y prêter l’attention nécessaire.
S’agissant de la première question, nous ne pouvons ignorer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle, dans un arrêt datant de 2007, considère que « la prostitution [est] incompatible avec la dignité de la personne humaine dès lors qu’elle est contrainte ». Cet aspect juridique est bien souvent écarté des débats, je me permettrai d’y revenir.
Dès lors, peut-on présumer et décréter que la prostitution est toujours contrainte, en dépit des nombreuses déclarations de celles qui affirment exercer librement leur activité ? Au-delà de ces témoignages, l’Inspection générale des affaires sociales elle-même, au terme d’une enquête menée en 2012 sur les enjeux sanitaires de la prostitution, a constaté que « l’examen de la diversité des situations de prostitution fait apparaître des degrés très variables dans la contrainte ou au contraire dans la liberté. » De même, dans l’avis qu’elle a rendu au mois de juin 2014 sur ce texte, la Commission nationale consultative des droits de l’homme indique : « le phénomène prostitutionnel est hétérogène et […] particulièrement difficile à appréhender. Il couvre un ensemble large de pratiques sociales, dont on ne connaît ni l’étendue, ni les limites exactes, ni la diversité. La prostitution peut être “traditionnelle”, de rue ou indoor, féminine, masculine ou transgenre – on considère aujourd'hui que la prostitution masculine est de l’ordre de 20 % –, régulière ou occasionnelle, etc. Cette hétérogénéité témoigne du fait qu’il n’y a pas “d’état de prostitution”, mais des “situations de prostitution”. »
Si l’on accepte de prendre en compte cette diversité, il devient difficile de considérer que la prostitution s’exerce toujours, par définition, sous la contrainte. Dès lors, on peut douter de la compatibilité de la mesure proposée avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
S’agissant de la seconde interrogation, qui concerne les effets concrets d’une telle disposition, la commission spéciale a cherché à obtenir une évaluation des effets de la législation suédoise, qui est souvent citée. Dans ce pays, l’achat d’un acte sexuel est interdit. Or le bilan en l’espèce est loin d’être probant. Il est très difficile d’obtenir des chiffres précis, mais plusieurs rapports indiquent que, loin de tarir la demande, la pénalisation des clients l’a plutôt déplacée et dissimulée.
À cet égard, je prendrai comme exemple le Danemark, lequel, par culture et système, est considéré comme relativement proche de la Suède et de la Norvège. Or ce pays a justement décidé, je le souligne, de s’éloigner des dispositifs mis en place chez ses voisins.
Pour les policiers et les magistrats, la pénalisation des clients ne constituera pas un instrument très utile dans la lutte contre les réseaux, puisque les clients n’ont, par nature, aucun lien avec ceux-ci. C’est là un aspect sur lequel je reviendrai : il n’est pas insignifiant dans le choix que nous pouvons faire.
En revanche, la commission spéciale a été alertée à de nombreuses reprises par la quasi-totalité des associations œuvrant pour l’accès aux droits et aux soins des personnes prostituées sur les risques sociaux et sanitaires de cette mesure. Ces associations nous ont dit que les personnes prostituées seraient davantage précarisées et fragilisées, alors même que c’est l’objectif inverse qui est recherché.
Pour toutes ces raisons, à la fois juridiques et pragmatiques, la majorité des membres de la commission spéciale a jugé, en harmonie avec de nombreuses associations, que la mesure proposée était plus porteuse de risques que de bénéfices. Cette dernière a donc été supprimée du texte adopté par la commission.
Cette suppression conduisait logiquement au rétablissement du délit de racolage, que les magistrats et policiers auditionnés nous avaient très largement demandé de ne pas abroger. En effet, selon eux, l’unique moyen d’accéder aux personnes prostituées est de les isoler des réseaux qui les exploitent.
Je le rappelle, en 2012, l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains a démantelé 52 réseaux de prostitution et 751 victimes de la traite ont été identifiées dans le cadre de procédures judiciaires. Selon les responsables de la brigade de répression du proxénétisme, un quart à un tiers des 50 à 65 procédures closes chaque année avec succès à Paris en matière de proxénétisme a pour point de départ des informations recueillies lors d’une garde à vue pour racolage.

Ces mêmes policiers et magistrats nous ont précisé que les personnes interpellées dans ce cadre ne faisaient pas l’objet de poursuites, mais étaient présentées à des associations, souvent pour la première fois.
La commission spéciale a ainsi émis un avis favorable sur le rétablissement du délit de racolage.
Reste bien évidemment le volet plus consensuel, à savoir le volet social de cette proposition de loi que la commission spéciale a consolidé.
Au travers du projet d’insertion sociale et professionnelle qui pourra être proposé aux personnes prostituées, l’ensemble des acteurs concernés à l’échelon local devront coordonner leurs actions sous l’égide du préfet, afin d’aider celles qui le souhaitent à sortir de la prostitution. Il s’agit là d’une bonne mesure, à condition, bien entendu, que les moyens financiers soient à la hauteur des espoirs qui auront été suscités. Je ne cacherai pas, madame la secrétaire d’État, que nous nous engageons dans une voie novatrice. Il faudra donc, sans doute dans deux ou trois ans, évaluer la mise en œuvre d’un tel dispositif pour l’apprécier et, éventuellement, le renforcer.
De même, la commission spéciale a consolidé le volet du texte consacré à la lutte contre la traite des êtres humains, véritable fléau contre lequel tous les efforts doivent être mobilisés. À cet égard, notre attention a été attirée sur la nécessité d’une coopération plus étroite entre les pays européens, notamment afin de mettre en place un parquet européen permettant de centraliser les poursuites.
Madame la secrétaire d’État, comme vous pouvez le constater, le consensus est très large s’agissant du volet social. Bien évidemment, c’est à la mesure phare de ce texte que nous nous opposons.
Vous l’avez rappelé, 80 % des prostituées sont étrangères.

Dont acte ! Nous connaissons les réseaux : le réseau africain, celui de l’Europe centrale, sans compter ceux qui relèvent de trafics mafieux. Ces derniers ne concernent pas tous les départements, et les préfets tremblent quand ils les voient apparaître dans un département voisin.
L’objet de ce texte, à défaut d’éradiquer les réseaux, est de les fragiliser. C’est la raison pour laquelle nous avons privilégié, dans un souci d’efficacité, le dispositif du délit de racolage. À cet égard, je ne reviendrai pas sur les mesures adoptées par la Suède et la Norvège, qui n’ont pas montré leur pertinence.
Par ailleurs, comment pouvez-vous imaginer, madame la secrétaire d’État, qu’une contravention de cinquième classe puisse avoir un effet déstabilisateur sur un système prostitutionnel ?
Permettez-moi de revenir sur l’aspect légal de la question. Robert Badinter l’a longuement évoqué au cours de son audition, en rappelant que la Cour européenne des droits de l’homme avait précisé très clairement dans un arrêt que « le droit d’entretenir des relations sexuelles découle du droit fondamental de disposer de son corps. » Il a ajouté : « chacun est maître de disposer de son corps, pourvu qu’il soit adulte, dans le respect de l’intimité de la vie privée, et à condition qu’il n’y soit pas contraint. »
Par conséquent, le dispositif proposé, à savoir la pénalisation du client, est tout à fait contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Ainsi Robert Badinter s’est-il interrogé sur la constitutionnalité d’une telle mesure au regard du droit interne. Cette réflexion, qui émane d’un ancien président du Conseil constitutionnel, ne peut être sans fondement !
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission spéciale a proposé le rétablissement du délit de racolage, dans un souci d’efficacité qui fait écho à la philosophie de la proposition de loi. J’espère que le Sénat apportera son soutien à un combat efficace contre le proxénétisme.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

La parole est à Mme la présidente de la délégation aux droits des femmes.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, en cette période très politique, il est pertinent d’avoir un débat fondamentalement politique. La prostitution, les orateurs précédents l’ont rappelé, pose la question de nos valeurs, de l’humanité que nous accordons aux membres les plus infimes de notre société.
C’est un débat délicat. Je m’engage à y participer avec un esprit ouvert, dans le respect des positions exprimées par les uns et les autres. J’espère, mes chers collègues, que vous aurez à cœur de prendre le même engagement.
Au préalable, je souhaite vous restituer les faits tels que je les connais. Mon information est bien évidemment limitée par la faiblesse criante des études sur le sujet, notamment pour ce qui concerne la prostitution étudiante ou sur internet.
Je m’appuierai donc uniquement sur les rapports officiels et les travaux que j’ai menés avec Jean-Pierre Godefroy sur la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées. Ce travail et les excellents rapports de Guy Geoffroy, Danielle Bousquet, Maud Olivier, Brigitte Gonthier-Maurin et Michelle Meunier nous donnent une base sérieuse pour débattre aujourd'hui.
Tous ces travaux convergent vers une idée partagée : il convient d’inverser le regard sur la prostitution, d’inverser la charge de la preuve, en considérant les personnes prostituées comme des victimes. D’ailleurs, toutes les dispositions d’accompagnement social prévues par le texte ont été majoritairement approuvées par la commission spéciale.
Car les faits sont clairs, et accablants pour la France et l’Europe.
Premier fait que je tiens à relever au nom de la délégation aux droits des femmes : la prostitution reste fondamentalement un domaine dans lequel sévit l’inégalité entre les hommes et les femmes. Les hommes représentent entre 10 % à 20 % des personnes prostituées et quasiment 100 % des clients.
Deuxième fait, la prostitution est un monde de violences inouïes, Michelle Meunier l’a rappelé. Les études conduites, notamment chez nos voisins allemands, estiment que 63 % des personnes prostituées sont victimes de viols. Elles ont soixante à cent fois plus de risques que les autres femmes d’être battues ou assassinées. Il faut le souligner, 90 % de ces violences sont le fait des clients.
Troisième fait, crucial, la prostitution a radicalement changé de visage. Il s’agissait, dans les années quatre-vingt-dix, d’une prostitution dite « traditionnelle », exercée par des femmes françaises en situation légale. Elle est aujourd’hui exercée à 90 % par des femmes étrangères ou d’origine étrangère en situation irrégulière et sous l’emprise de réseaux.
La prostitution « traditionnelle », celle qui s’exprime, est aujourd’hui minoritaire. Les femmes exploitées dans le cadre de réseaux ne viendront jamais ni manifester ni prendre la parole dans nos réunions.
C’est cette réalité qu’il nous faut reconnaître et combattre aujourd’hui : une prostitution qui majoritairement exploite des femmes, dans un monde de violence inouïe, sous l’emprise de réseaux extrêmement lucratifs ; une prostitution qui est une forme d’esclavagisme moderne, très fructueux, cela a été rappelé. Toute tolérance face au système prostitutionnel, tout discours ouvert sert de fait les intérêts des réseaux, tel Boko Haram, dont les victimes se retrouvent aujourd’hui dans nos bois.
La prostitution a donc radicalement changé de visage, alors que notre législation n’a pas évolué. Cette dernière, au nom de la liberté de choix, n’est pas interventionniste : le législateur s’y refuse et, dans le même temps, se refuse à légaliser la pratique. Notre législation est dite « abolitionniste » et était sans doute très adaptée jusque dans les années quatre-vingt-dix ; en 2015, en revanche, elle est clairement inefficace.
Que faire ? Nous critiquons beaucoup le modèle suédois, mais il nous faut savoir quelles solutions s’offrent à nous.
Faut-il conserver le système existant, qui fait peser la présomption de culpabilité par le délit de racolage sur la personne prostituée ? C’est ce système qui oblige cette dernière à se cacher alors qu’elle est victime. On peut continuer à le cautionner, il n’en reste pas moins que c’est une injustice. C’est la raison pour laquelle je suis opposée au texte issu des travaux de la commission spéciale. Le système existant a fait la preuve de son inefficacité. C’est l’annonce d’un échec assuré.
Il ne suffira pas d’augmenter les moyens des services de lutte contre la traite. Certes ceux-ci accomplissent un travail formidable, mais cela représente malheureusement une goutte d’eau face à un phénomène mondial. Nous devons envoyer un message clair aux réseaux en France et en Europe.
Je serai également opposée à toute suppression du délit de racolage sans pénalisation du client. En effet, ce serait ouvrir la voie à un système prostitutionnel de masse.
Certains souhaiteraient aller plus loin et tendre vers le réglementarisme en autorisant le commerce encadré de la prostitution. Madame la secrétaire d’État, vous l’avez rappelé, les exemples allemands, néerlandais ou belges font froid dans le dos. En Allemagne, on estime que le trafic de la traite a été multiplié par soixante-dix depuis l’entrée en vigueur d’une telle législation. Les autorités d’Amsterdam témoignent de leur incapacité à contrôler le développement des réseaux dans les structures dédiées. La raison est simple : ces pays ont levé l’interdit symbolique de la prostitution.
La troisième voie, celle dite « néo-abolitionniste », consiste à reconnaître la responsabilité du client complice de ce système de violence. C’est le modèle de la Suède, de la Norvège et en partie du monde anglo-saxon, dont on sait de manière objective qu’il a fait reculer la prostitution de rue. C’est une réalité attestée par les chiffres officiels.
Certains affirment que, en parallèle, la prostitution s’est développée au large des côtes, et des études dites « indépendantes » montrent que la prostitution sur internet a continué à croître. C’est possible. Personne, ni vous ni moi, ne peut ni le nier ni le confirmer ; les études sur le sujet ne sont pas suffisamment sérieuses. C’est bien ce qui se passe en France ! La prostitution se développe sur internet, alors même que notre législation est plus tolérante.

Il est quelque peu cocasse de se prévaloir d’études réalisées dans des pays lointains, alors même que nous sommes incapables de savoir ce qui se passe en France.
Je suis favorable à la responsabilisation du client. Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, vous le savez, ce n’est pas nouveau. C’est une question de principe et d’honnêteté intellectuelle. Un client qui va payer une jeune femme qui ne parle pas français, une femme nue au fond d’un bois, peut-il très objectivement soutenir qu’il n’est pas au courant ?
Mme Maryvonne Blondin acquiesce.

La limite du modèle suédois est ailleurs. Ce système pénalise le client purement et simplement. Par conséquent, il interdit l’achat et, de fait, il interdit la vente. Il est donc à la limite du prohibitionnisme.
Je serais personnellement favorable à la prohibition, mais les textes légaux nous l’interdisent. Aussi, dans le respect d’une position « néo-abolitionniste », une position adaptée, il nous faut pénaliser les clients qui ont recours à des personnes prostituées sous contrainte, en présumant cette contrainte. La réalité de la prostitution est que la contrainte apparaît dans 90 % des cas. Cette disposition combinée aux dispositifs de fuite et d’accompagnement social permet d’inverser la charge : le droit est du côté des victimes. Ce sera non plus aux personnes prostituées, mais aux clients de se cacher.
L’argument principal contre cette nouvelle voie n’est pas la fatalité de la prostitution. L’histoire, l’antériorité pas plus que l’utilité sociale de la prostitution, rien ne justifie celle-ci. Considérer les personnes prostituées comme les défouloirs des pulsions de la société ne nous grandirait pas.
L’argument principal est celui de la liberté.
Je pourrais m’engager sur d’autres débats, mais je préfère m’attarder sur celui-là et me concentrer avec pragmatisme sur les faits : 10 % des personnes prostituées auraient librement choisi cette voie. Combien pourtant l’ont choisie par précarité financière ou par vulnérabilité face à un amant un peu trop intéressé ? Combien se trouvent coincées dans l’engrenage de la prostitution après y être entrées ? Après cinq ou dix ans de prostitution, même de luxe, que met-on sur son CV ? Le dit-on à ses amis ou à ses enfants ? J’ai souvenir d’une rencontre très touchante avec une prostituée dite « traditionnelle » âgée de soixante-cinq ans qui n’a jamais avoué son activité à ses enfants. Voilà la réalité de la prostitution !
Le législateur doit-il préserver la liberté de 10 % des prostituées ou protéger 90 % des personnes victimes de la prostitution ?
En toute humanité, au terme des différents travaux que nous avons pu réaliser et du rapport que nous avons produit, nous sommes parvenus à la conclusion qu’il n’y avait pas d’égalité dans la prostitution. Celle-ci demeure fondamentalement l’expression de l’exploitation des femmes. Il n’y a pas de fraternité dans un pays qui ferme les yeux sur les violences qui se cachent au fond des bois. En toute sincérité, je ne vois pas non plus de liberté dans le système prostitutionnel.
Telles sont les raisons pour lesquelles je soutiens l’esprit originel de la proposition de loi. Je voterai par conséquent contre tout texte qui serait perçu comme un message de tolérance ou de résignation. Quand une partie, même infime, de l’humanité est victime de notre indifférence, c’est toute notre société qui est affaiblie.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi qu’au banc des commissions. – Mme Christiane Kammermann applaudit également.

Monsieur le président, des amendements ont été déposés à l’article 4 afin d’affecter au fonds pour la prévention de la prostitution et l’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées le produit des amendes perçues auprès des clients de personnes prostituées.
Par cohérence, la commission spéciale demande que l’examen de cet article soit réservé après celui des articles 16 et 17 relatifs à la pénalisation des clients. C’est en effet une conséquence.
Par ailleurs, la commission spéciale demande la réserve de l’examen de l’amendement n° 19 rectifié bis portant sur l’intitulé du chapitre II jusqu’à la fin de ce même chapitre, dans un même souci de logique.

Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la réserve est de droit, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Esther Benbassa.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission spéciale, madame la rapporteur, mes chers collègues, nous débattons aujourd’hui du texte abolitionniste voté par l’Assemblée nationale. La commission spéciale de la Haute Assemblée en a fait un texte prohibitionniste, avec le rétablissement du délit de racolage, que le Sénat avait pourtant abrogé en 2013 en adoptant à l’unanimité une proposition de loi que j’avais déposée au nom du groupe écologiste.
Le titre même de la présente proposition de loi gomme la diversité de la réalité de la prostitution. De quel « système » parlons-nous ? Ce concept, créé de toutes pièces, réduit le phénomène de la prostitution aux réseaux de proxénétisme et donne à la puissance publique un seul but : arracher des griffes de leurs proxénètes de « pauvres femmes étrangères ».
En Europe, la traite dont nous parlons rapporterait environ 3 milliards de dollars par an. Cela représente un marché criminel colossal. Reste que, selon l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime et l’Organisation internationale du travail, sur un million de personnes prostituées en Europe, de 140 000 à 270 000, soit entre 14 % et 27 %, seraient effectivement soumises à la traite pour exploitation sexuelle.
Les personnes prostituées étrangères – femmes, hommes et « trans » – ne relèvent pas toutes de ce « système ». Certes, parties de divers continents, nombre d’entre elles ont eu recours à des réseaux pour atteindre l’Europe dans l’espoir d’améliorer leur condition économique. Cependant, elles abandonnent ces réseaux par la suite, une fois leur dette payée. Nous sommes, en tout cas, loin du chiffre, asséné dans le rapport de l’Assemblée nationale, de 90 % de personnes prostituées dépendant d’un réseau de proxénétisme.
Le premier objectif d’une loi sur la prostitution devrait être de soustraire les personnes victimes de proxénètes à la contrainte et à la violence qui transforment leur vie en enfer. Robert Badinter l’a de nouveau souligné : l’urgence est de s’attaquer au « mal organisé », c'est-à-dire aux réseaux mafieux, et de s’en donner les moyens.
Or où en sommes-nous sur ce point ? Pas assez d’argent n’est dégagé pour augmenter le nombre de policiers chargés de la chasse aux proxénètes. Pour l’accompagnement des étrangères souhaitant échapper à ces réseaux, que prévoit-on ? Des miettes, à savoir l’attribution d’un titre de séjour de six mois renouvelable, si le parcours d’insertion est positif. Comment ces femmes pourraient-elles, en six mois, se reconstruire, trouver un logement, un travail ? Après avoir dénoncé leurs réseaux, seront-elles donc renvoyées chez elles pour risquer le pire ?
Et que fait-on des autres prostitués ? Des hommes ? Des étudiants et étudiantes qui se prostituent ponctuellement parce que leurs parents, appauvris par la crise, ne peuvent subvenir à leurs besoins ? Des Françaises sans ressources, sans qualification, sans capital familial, qui parent ainsi aux effets d’une précarité insupportable ?
Celles qui continuent à se prostituer seraient toutes des femmes violentées, agressées sexuellement dans leur enfance, victimes d’inceste. Aux yeux des abolitionnistes, une femme « normale » ne pourrait librement consentir une relation sexuelle contre rémunération.
Virginie Despentes, dans son essai King Kong Théorie publié en 2006, affirme : « La sexualité masculine en elle-même ne constitue pas une violence sur les femmes, si elles sont consentantes et bien rémunérées. C’est le contrôle exercé sur nous qui est violent, cette faculté de décider à notre place ce qui est digne et ce qui ne l’est pas. »

Quant au psychanalyste Pierre-Henri Castel, il précise : « au nom de la sauvegarde de leur dignité, on va priver d’un coup beaucoup de gens de la liberté d’arbitrer entre divers maux dans une situation d’inégalités sociales subies de facto. [...] On peut préférer se prostituer pour abriter son enfant du besoin. [...] Mépriser les gens qui font des choix si graves ne convaincrait d’ailleurs vraiment que si, au lieu de dénoncer la prostitution seule, on dénonçait les inégalités en bloc. »
Ne transformons pas le code pénal à la seule fin d’un affichage idéologique. Sachons écouter les premières intéressées ; ne les traitons pas en mineures privées de parole. Ayons d’autres soucis que celui, fort politicien, des « bonnes mœurs ». Chacun peut-il, oui ou non, librement disposer de son corps ?
Les féministes avaient fait de cette exigence leur devise pour la légalisation de la contraception et de l’IVG. On ne pourrait donc pas l’invoquer pour l’acte prostitutionnel ? Oui, il y a des prostitués par choix. Dans leur pétition du 23 août 2012, de nombreux intellectuels – hommes et femmes –, dont je partage la position, déclaraient : « Décréter illégal ce qu’on trouve immoral n’est pas un grand pas vers le Bien, c’est une dérive despotique. Le pouvoir politique n’a pas à intervenir dans les pratiques sexuelles des adultes consentants. »
En conclusion, le vote du groupe écologiste dépendra, mes chers collègues, de nos débats. Sa grille d’analyse sera simple : protéger, oui, stigmatiser et précariser davantage, non.
M. Simon Sutour applaudit.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la Haute Assemblée peut enfin examiner la présente proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale au mois de décembre 2013. Les membres de mon groupe et moi-même faisons partie de celles et de ceux qui ont à plusieurs reprises interpellé les présidents successifs du Sénat et le ministre chargé des relations avec le Parlement pour que ce texte soit mis à l’ordre du jour. Je me réjouis donc qu’il en soit ainsi aujourd’hui.
Je souhaite que nos débats en séance plénière permettent de ne pas suivre le vote majoritaire de la commission spéciale renouvelée qui vide totalement la proposition de loi de son sens en réintroduisant le délit de racolage et en rejetant la pénalisation de l’acte sexuel tarifé.
Il y avait urgence à débattre de cette proposition de loi, et surtout urgence à se donner les moyens de lutter efficacement contre le système prostitutionnel. La France, pays abolitionniste, se doit d’avoir une politique cohérente avec cette position.
Pour les abolitionnistes, la prostitution est une forme d’exploitation et une atteinte à la dignité humaine qui doit être abolie. Les prostituées sont des victimes non punissables, les proxénètes des criminels, et les clients peuvent être sanctionnés comme acteurs du système.
Comment prétendre instaurer une société de pleine égalité entre les femmes et les hommes quand on accepte que des hommes achètent le corps des femmes ? Où est le choix de ces dernières ?
Même si je considère que le débat premier ne se limite pas à une question de chiffres, il me semble à mon tour nécessaire d’illustrer la réalité de la prostitution par quelques données statistiques.
En France, les personnes prostituées seraient au nombre de 30 000, et 85 % sont des femmes. À l’inverse, 99 % des clients sont des hommes. La prostitution est donc bien un phénomène sexué.
De surcroît, comme vous l’avez dit, madame la secrétaire d’État, plus de 90 % des personnes prostituées exerçant sur le territoire français sont de nationalité étrangère. Les pays d’origine sont bien connus : il s’agit principalement de la Roumanie, du Nigeria et de la Chine. Alors que 80 % des personnes prostituées étaient françaises au début des années quatre-vingt-dix, cette proportion s’est aujourd’hui très largement inversée. Cela ne peut que nous conduire à nous interroger et à admettre que cette tendance n’est pas sans lien avec les réseaux de proxénétisme, de traite d’êtres humains.
Quant aux hommes qui ont recours à des prostituées, ils ne sont pas particulièrement confrontés à la misère affective et sexuelle : plus des deux tiers d’entre eux vivent ou ont vécu en couple et plus de 50 % sont pères de famille. Je dirai qu’il s’agit de M. Tout-le-Monde.

Nous savons pertinemment que la prostitution est un phénomène lié à une vulnérabilité sociale et économique.
Nous connaissons toutes et tous les raisons qui peuvent pousser telle ou telle personne à quitter son pays d’origine et surtout les difficultés qu’elle rencontre et les menaces auxquelles elle est exposée en arrivant dans un nouveau pays : elle constitue une proie idéale. Nous savons les chantages qui sont exercés sur elle lorsqu’elle veut obtenir ou récupérer ses papiers, son passeport, etc.
À cette précarité, à cette subordination économique, s’ajoutent les risques sanitaires qu’encourent les personnes prostituées. C’est une catégorie majoritairement bien plus exposée que le reste de la population aux maladies sexuellement transmissibles ou aux infections sexuellement transmissibles, sans parler des maladies chroniques et autres problèmes de santé souvent liés à des conditions de vie dégradées et à la perte de l’estime de soi. Or on ne le sait que trop bien, le cumul des difficultés est un obstacle à l’accès aux soins. Je vous renvoie, mes chers collègues, au rapport de Michelle Meunier ou au rapport d’information de Chantal Jouanno et Jean-Pierre Godefroy qui sont extrêmement éloquents et préoccupants à cet égard.
Au-delà de ces chiffres qu’il convenait de rappeler, la prostitution est une violence extrême, inhérente au système prostitutionnel, infligée tout aussi bien par les clients que par les proxénètes : violences sous toutes formes, chantages, humiliations, insultes, coups, viols répétés… Les témoignages de personnes prostituées ou qui sont sorties de la prostitution – je pense notamment à Rosen Hicher– sont tout simplement insoutenables.
Comment, à partir de là, continuer à banaliser la prostitution en la considérant comme étant le plus vieux métier du monde ? Je rappellerai l’expression de Brigitte Gonthier-Maurin qui, elle, parlait de « plus vieille violence du monde infligée aux femmes ». Comment accepter cette violence masculine s’exerçant sur des personnes plus vulnérables, au nom d’un rapport sexuel prétendument consenti car tarifé ?
On le voit à travers ces constats, les défis à relever sont importants et la présente proposition de loi vise à s’y attaquer par la mise en place d’une politique fondée sur quatre piliers, qui sont fondamentaux dans la mesure où ils prennent en compte le système prostitutionnel dans son ensemble, dans sa globalité, en intégrant tous les acteurs concernés, personnes prostituées, proxénètes et clients.
Nous le savons tous dans cette enceinte, le débat va tourner essentiellement autour des articles 13, 16 et 17 de la proposition de loi et les dispositions adoptées alors détermineront le vote final de chacun.
À l’instar de la majorité de mes collègues du groupe CRC, j’estime que nous devons réintroduire dans ce texte les articles 16 et 17 ayant pour objet la responsabilisation du client, au risque, sinon, de le vider de sa substance. De même, l’article 13 abrogeant le délit de racolage doit être maintenu en l’état.
Bien évidemment, il est important d’insister sur les moyens qui doivent être accordés pour que cette proposition de loi puisse être suivie d’effets et pour que l’on parvienne à lutter efficacement contre le système prostitutionnel.
Je conclurai mon propos en disant que la prostitution est une défaite non seulement pour les femmes, mais également pour les hommes et le vivre ensemble. Lutter pour son abolition est une question éminemment politique. C’est un combat mixte en faveur du respect et de l’universalité des droits humains qui rassemble de nombreux progressistes et la majorité des associations féministes, notamment celles qui composent le collectif Abolition 2012.
Notre responsabilité de parlementaire est de légiférer en ce sens, pour la majorité des prostituées qui sont contraintes d’exercer cette activité. Mes chers collègues, je vous remercie d’être attentifs à cet aspect de la question au cours de notre débat et de redonner à cette proposition de loi toute la portée qu’elle avait à l’issue des travaux de l’Assemblée nationale.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste. – Mme Chantal Jouanno applaudit également.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, au timbre de ma voix, vous comprendrez aisément que le sujet de la prostitution, ô combien passionné, est difficile à aborder.
Par cette intervention, je me fais l’écho du groupe du RDSE et, à titre liminaire, je veux saluer le travail effectué par la commission spéciale qui a permis de dégager une solution raisonnable et surtout réaliste, sans dogmatisme, sur une question véritablement sensible, alors que, en l’espèce, aucune solution n’est parfaite.
En 2012, lors de la discussion d’une proposition de loi, le groupe du RDSE s’était déjà prononcé en faveur de l’abolition du délit de racolage passif – un non-sens –, qui repousse la prostitution aux marges de la ville, dans des espaces retranchés, coupés, isolés, livrant ainsi les prostitués à la clandestinité et à tous les dangers.
Outre l’inanité de ce délit, le nombre de personnes mises en cause pour racolage par la police nationale n’a cessé de baisser depuis 2003 – preuve s’il en fallait que la solution juridique n’était pas la bonne – et, dans le même temps, la prostitution n’a ni disparu ni diminué.
En qualifiant la prostituée de délinquante, le délit de racolage passif a eu des effets pervers particulièrement dommageables, se traduisant par l’aggravation de la précarité des personnes prostituées et le renforcement des réseaux mafieux. Douze années après son instauration, son bilan est peu flatteur, à rebours des objectifs initiaux de répression et d’annihilation de la prostitution.
Les personnes prostituées ont quitté les centres-villes pour les zones périurbaines. De ce fait, les risques d’agression ont augmenté, sans baisse corrélée des activités. L’incrimination du racolage passif a placé ces personnes dans une position précaire face aux clients et aux logeurs qui ont pu tirer profit de leur situation. La fragilisation des personnes prostituées a même pu les amener à se placer sous la dépendance de proxénètes pour assurer leur protection.
Se sont ensuivies une dégradation des relations avec les forces de l’ordre ainsi que des difficultés d’accès aux soins, complexifiant la prise en charge sanitaire et la diffusion de messages de prévention.
Parallèlement à ce bilan mitigé, il paraît nécessaire de s’interroger sur les raisons qui poussent certains à défendre la pénalisation des clients. Cette mesure, qui poursuit la même logique inhérente au délit de racolage passif, ne pourra que renforcer encore l’isolement et la vulnérabilité des femmes qui sont victimes de la prostitution. De fait, il s’agit de bien comprendre que l’emploi de dispositions juridiques à caractère répressif – le racolage passif et la pénalisation des clients – ne constitue pas une solution viable aux problèmes que pose la prostitution.
Pour autant, nous ne nions pas la situation désastreuse, à la fois psychologique, sanitaire et sociale, dans laquelle se trouvent ces personnes.
La prostitution est un phénomène complexe et multiforme qui a évolué ces dernières années sous l’influence de la mondialisation, de l’ouverture des frontières et de la dématérialisation des moyens de la prostitution. Ces derniers favorisent, du fait de contingences économiques et sociales défavorables, le développement de réseaux mafieux, dont les gains ont été évalués à plus de 3 milliards d’euros par an.
Cependant, comme l’a souligné la féministe Élisabeth Badinter, interdire par voie législative la prostitution serait « revenir sur un acquis du féminisme qui est la lutte pour la libre disposition de son corps. » En effet, les pouvoirs publics n’ont pas à légiférer sur l’activité sexuelle des citoyens et sur l’aspect moral lié à la commercialisation de ces relations. Ainsi, nous choisissons de ne pas considérer le prostitué ou la prostituée comme une personne irresponsable, au sens juridique du terme.
La pénalisation des clients est une mesure simpliste, et il nous semble que la réflexion devrait davantage porter sur le caractère transnational de la prostitution et les enjeux liés aux inégalités de développement.
La commission spéciale a défendu la bonne position sur le sujet, parvenant ainsi à un texte d’équilibre. Les membres du RDSE s’opposeront donc aux amendements qui visent à rétablir soit la pénalisation du client, soit le délit de racolage passif.
Quant à l’accompagnement sanitaire et social des personnes prostituées, la proposition de loi présente le mérite de poser des questions centrales.
Nous saluons le renforcement des droits de ces personnes par la mise en place d’un parcours de sortie de la prostitution, ainsi que la création d’un fonds dédié. Néanmoins, encore une fois, il faudra veiller à ce que le consentement du prostitué ou de la prostituée, en tant que personne majeure et responsable, soit bien recueilli pour toutes les mesures le concernant.
Nous proposons également, au travers d’un amendement, d’intégrer dans l’instance départementale les professionnels de santé. Ces derniers, experts, représenteraient une plus-value pour tout ce qui concerne le sujet préoccupant de la santé des personnes prostituées.
L’abolition de la prostitution, si elle doit avoir lieu, ne passera que par la prévention des comportements en cause. L’éducation et la sensibilisation, notamment auprès du jeune public, peuvent permettre la prévention de telles pratiques.
Familièrement qualifiée de « plus vieux métier du monde », la prostitution est aussi, nous en sommes conscients, la plus vieille violence du monde, comme le notent dans leur rapport mes collègues, pour celles et ceux qui y sont contraints par des contingences sociales, économiques ou psychologiques.
Pour toutes ces raisons, la majorité des membres du groupe du RDSE défendra et approuvera le texte issu des travaux de la commission spéciale du Sénat.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’objet principal de la présente proposition de loi est, selon ses auteurs, de « faire prendre conscience que la prostitution est […] une violence à l’égard de personnes démunies et une exploitation des plus faibles par des proxénètes, qu’ils agissent de manière individuelle ou dans des réseaux réalisant des profits très élevés, la traite se cumulant souvent avec d’autres trafics. »
Ce texte apporte un certain nombre d’avancées sensibles en améliorant la situation des personnes prostituées et en sensibilisant le public aux réalités de la prostitution. Il comporte des dispositions protectrices à l’égard des « victimes » de la prostitution. Nous nous félicitons à cet égard de l’introduction d’un parcours de sortie de la prostitution.
Ces « victimes », ainsi qualifiées par le texte, sont en effet avant tout victimes du chômage et de la misère sociale en France ou ailleurs. Sortir de la prostitution nécessite de véritables perspectives d’avenir. Aider ces hommes et ces femmes à construire un projet d’insertion sociale et professionnelle, les accompagner dans leur parcours : là me semble la seule solution réaliste et efficace.
Le soutien à ce public très fragilisé se traduira notamment par l’institution, dans chaque département, d’une instance spécifique nouvellement créée pour coordonner et organiser l’action en faveur des victimes.
D’autres mesures sont à l’étude, comme le bénéfice possible d’autorisations provisoires de séjour ou la mise en place d’un fonds particulier à destination de la prévention de la prostitution et de l’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées.
La sensibilisation des plus jeunes aux réalités de la prostitution est également un enjeu sociétal.
Au-delà des batailles de chiffres que ses proportions suscitent, force est de reconnaître que la prostitution estudiantine est en constante évolution. Le développement croissant des sites spécialisés témoigne de la réalité de cette nouvelle prostitution, qu’elle soit occasionnelle ou régulière.
Renseigner, informer nos jeunes sur tous les sujets et problématiques qu’impliquent les pratiques prostitutionnelles – je songe aux violences sexuelles, aux viols, au rapport au corps et à ses représentations, aux relations entre hommes et femmes – et les prévenir sont autant d’enjeux pour leur construction et leur éducation.
En outre, deux dispositions du présent texte ont cristallisé un certain nombre de tensions. Je reviens maintenant sur l’une et l’autre.
Premièrement, l’article 13 de cette proposition de loi, inchangé par la commission spéciale, abroge l’article 225-10-1 du code pénal. Introduite dans notre législation en 2003, cette disposition institue un délit de racolage passif.
Sur quels motifs se fonderait une telle suppression ?
Selon ses partisans, ce délit équivaudrait à une double peine. Dirigé à l’encontre des personnes prostituées, il pénaliserait des individus déjà très fragilisés, eux-mêmes victimes de la prostitution. Cette affirmation n’est pas totalement fausse.
Toutefois, abroger cette disposition, c’est oublier qu’elle est l’une des rares armes dont disposent les élus sur leur territoire. En effet, elle permet de justifier l’arrêt de toute sollicitation ou incitation à des relations sexuelles sur la voie publique qui – vous l’admettrez, je l’espère, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues – peuvent rapidement constituer un trouble à l’ordre public.

Ainsi, l’amendement déposé par M. le président de la commission spéciale tendant à supprimer l’article 13 emporte notre adhésion. Quoique conscients des imperfections de ce système, nous souhaitons, en la matière, le maintien du droit actuellement en vigueur.
Deuxièmement, l’article 16 du présent texte, adopté par l’Assemblée nationale puis supprimé par la commission spéciale du Sénat, a fait couler beaucoup d’encre. Quel était son contenu ?
Cet article modifiait l’actuel article 225-12-1 du code pénal qui pénalise les clients de pratiques prostitutionnelles avec des mineurs, par son premier alinéa, ou avec des personnes présentant une particulière vulnérabilité telle qu’une infirmité ou une déficience psychique, par son second alinéa. Il étendait la pénalisation des clients aux pratiques prostitutionnelles avec toute prostituée, l’extension du champ ainsi voulue permettant d’« assécher » l’offre. Craignant, au-delà de la contravention instituée, l’opprobre populaire, les clients cesseraient de se livrer à cette pratique et le monde s’en porterait beaucoup mieux.
Mes chers collègues, vous l’aurez compris, cette démarche m’inspire un certain nombre de réserves.
Certes, la rédaction retenue peut permettre d’appliquer le dispositif en question à des infractions commises sur internet. Mais il faut bien admettre que ces dispositions ont été conçues plus spécifiquement en vue d’une répression physique. Aussi, elles me semblent assez anachroniques : désormais, la grande majorité des « contrats de prostitution » sont conclus en ligne, via des sites spécialisés.
En outre, ce texte serait difficilement applicable sans une augmentation substantielle des effectifs chargés de la poursuite de ces infractions. Je doute que de tels moyens puissent être déployés pour une simple contravention. Dès lors, pour quelques clients sanctionnés, combien compterait-on d’impunis ? Je n’en dirai pas autant des réseaux mafieux qui sévissent sur notre territoire et qu’il faut combattre sans merci.
Cette proposition de loi assure des avancées notables en matière de lutte contre le système prostitutionnel, notamment en créant un parcours de sortie de la prostitution ou en instituant des mesures protectrices à l’égard de ces victimes et des dispositifs tendant à sensibiliser le jeune public aux réalités de la prostitution.
Toute initiative visant à améliorer la situation des personnes prostituées et la lutte contre le système prostitutionnel doit être soutenue.
La mesure que je viens d’évoquer se veut avant tout symbolique et dissuasive, je le comprends, mais je crains qu’elle ne soit inefficace. En conséquence, j’ai tendance à soutenir la suppression de l’article 16 et de son pendant, l’article 17, par la commission spéciale.
Cela étant, je le rappelle, je suis viscéralement hostile à la prostitution sous toutes ses formes. Je souhaite voir intensifier la lutte contre les réseaux de prostitution, les réseaux mafieux. Je souhaite également que les sanctions les plus sévères soient prises à l’encontre de ces groupes qui foulent au pied la dignité d’êtres humains qu’ils rabaissent au rang de marchandises.
Vous le savez, face à des sujets sociétaux comme celui-ci, même chez les centristes, l’unanimité est rarement atteinte, chacun votant selon ses convictions personnelles, lesquelles sont inflexibles à toute contradiction. La majorité du groupe UDI-UC votera cependant pour les progrès traduits par ce texte.
M. le président de la commission spéciale et Mme Joëlle Garriaud-Maylam applaudissent.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la force de la présente proposition de loi réside dans sa cohérence globale, qui inclut les réseaux de proxénètes, les personnes prostituées et les clients. En effet, priver le système d’un de ces acteurs, c’est le faire s’effondrer dans son ensemble. On ne peut prétendre lutter efficacement contre la traite des êtres humains sans mettre en œuvre des mesures visant à décourager la demande d’achats sexuels.
Comment feindre plus longtemps d’ignorer que c’est l’argent des clients qui alimente les réseaux criminels, que ces derniers se livrent à l’exploitation sexuelle ou au terrorisme ? Le constat est clair, et Mme la secrétaire d’État l’a rappelé : avec 97 % de prostituées d’origine étrangère, le mythe de la prostitution d’antan, fantasmée, a assez duré.
Mme la rapporteur acquiesce.

Face à cette situation dramatique, les pays réglementaristes ont longtemps prétendu que la réglementation était le moyen le plus efficace de lutter contre la traite et les réseaux criminels. Or c’est précisément le contraire qui a lieu : ces pays deviennent les destinations privilégiées des réseaux mafieux. En bonne logique commerciale, les trafiquants conduisent leurs victimes là où la demande est forte et surtout légale !
Selon la police néerlandaise, entre 50 % et 90 % des personnes prostituées agissent sous la contrainte d’un réseau de proxénétisme. Par ailleurs, nous nous en souvenons tous, lors de la Coupe du monde de football de 2006, les femmes originaires des pays de l’Est arrivaient en Allemagne par bus entiers !
Mme Marie-Pierre Monier opine.

Aujourd’hui, ces mêmes pays réglementaristes s’interrogent et envisagent de faire machine arrière. À l’inverse, d’autres États ont décidé de sanctionner l’achat d’actes sexuels. Je songe à l’exemple tout récent du Canada.
Les écoutes téléphoniques auxquelles la police suédoise a procédé à l’égard des réseaux internationaux le prouvent sans ambiguïté : ces réseaux se détournent de la Suède car l’investissement y est moins rentable que dans d’autres pays et ils n’ont pas la possibilité de s’organiser librement.
Le Conseil de l’Europe, dont je suis membre, a adopté, au mois d’avril 2014, une résolution appelant les États à « envisager la criminalisation de l’achat de services sexuels, fondée sur le modèle suédois, en tant qu’outil le plus efficace pour prévenir et lutter contre la traite des êtres humains ». Il est donc temps que notre pays prenne ses responsabilités et adresse aux réseaux un message de fermeté : non, la France n’est pas un pays d’accueil pour la traite des êtres humains !

À cet égard, il est impératif de rétablir les articles 16 et 17 de cette proposition de loi. Non seulement ces derniers sont un outil indispensable dans la lutte contre la traite, mais ils ont une portée symbolique et pédagogique pour les jeunes en ce qu’ils fixent clairement l’interdit dans la loi.
Mes chers collègues, il est temps de changer, dans les faits, notre regard, et de responsabiliser la société tout entière à la réalité du système prostitutionnel.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, cinq minutes pour résumer deux ans et demi de travail, c’est très court !
Longtemps, appliqué au problème de la prostitution, le terme « abolitionnisme » a visé la suppression de toute forme de réglementation. Je songe notamment au combat mené en Angleterre par Josephine Butler dans les années 1870. Je pense bien entendu à la loi de 1946, qui a érigé le racolage en délit lors de la fermeture des maisons closes.
Par extension, ce que l’on appelle « abolitionnisme » est devenu le combat contre la prostitution, pour la disparition de celle-ci.
Je suis convaincu que la prostitution contrainte est une barbarie, un esclavagisme. En ce sens, oui, je suis abolitionniste.
Toutefois, par ce que je considère comme une confusion, la pensée abolitionniste est, désormais, souvent associée à la défense d’une politique pénale qui sanctionne le client. Or je ne crois pas que la pénalisation de ce dernier soit un choix pertinent, suffisant et efficace.
Nos débats vont se concentrer sur la pénalisation du client, car cette mesure cristallise certains désaccords.
Je le dis et je le répète : si je m’oppose à la pénalisation des clients des personnes prostituées, c’est pour ces dernières et pour elles seules. C’est parce que, au terme de deux ans et demi de travaux consacrés à ce sujet, je suis convaincu qu’en pénalisant les clients l’on pénaliserait avant tout les personnes prostituées, que celles-ci seraient les premières à subir directement les conséquences d’une telle mesure. Je suis persuadé qu’une telle disposition serait subie aussi et avant tout par elles, que l’on cherche précisément à protéger à travers cette proposition de loi.
Ma conviction est intacte et, avec détermination, je persiste à m’opposer à cette mesure.
Je crains que la pénalisation des clients n’ait pour effet de dégrader la situation sanitaire et sociale déjà préoccupante des personnes prostituées, obligées de se retrancher dans des lieux isolés, étant ainsi moins accessibles aux représentants des associations de prévention et d’accompagnement qui viennent à leur rencontre. À mon sens, cette mesure aurait les mêmes conséquences que la disposition relative au racolage passif.
Au demeurant, la pénalisation du client n’aurait éventuellement d’effet que sur ce qui se voit, c’est-à-dire, notamment, sur la prostitution de rue. A contrario, elle serait inopérante pour la prostitution sur internet, qui se révèle aujourd’hui en plein essor. Elle ne permettrait pas de lutter contre les réseaux. Elle n’aiderait pas à remonter les filières.
L’article 16 de la proposition de loi initiale, que certains amendements tendent à rétablir, me fait l’effet d’une position de principe dont la seule vocation serait de transcrire une éthique, une morale. Pourquoi pas ? Je pourrais suivre ce raisonnement si je n’étais pas convaincu que son application mettrait les personnes prostituées en danger, qu’elle aurait l’effet inverse de celui que nous visons et qu’elle n’inverserait le mécanisme de la culpabilité que dans la lettre du droit.
Oui, je reste circonspect face au volet pénal du présent texte. Les auteurs de ce dernier ont voulu prendre exemple sur le modèle suédois, qui – nous y reviendrons sans doute lors de l’examen des articles – n’est pourtant pas si exemplaire qu’on le prétend parfois. Ce système est loin de faire l’unanimité !
En dépit d’une promesse de campagne, le Danemark a finalement renoncé à introduire dans sa législation une disposition similaire, en raison des conséquences qui auraient pu en résulter pour les personnes prostituées et du fait du degré d’incertitude particulièrement élevé que présenterait une telle mesure en matière de lutte contre les réseaux.
En 2012, le Parlement écossais a également rejeté un texte de loi interdisant tout achat de prestation sexuelle.
Par ailleurs, l’applicabilité d’une telle mesure pose problème : comment la relation sexuelle tarifée serait-elle matériellement caractérisée, sachant que ni le client ni la personne prostituée n’auront intérêt à reconnaître que celle-ci a eu lieu ?

Les moyens humains et financiers qui seraient nécessaires pour l’application de cette nouvelle contravention ne pourraient-ils pas être plus utilement employés, au service de la lutte contre le proxénétisme et les réseaux internationaux ?
À cela s’ajoute un problème de cohérence. Les auteurs du présent texte ont voulu renverser le mécanisme actuel en supprimant toute pénalisation du racolage et en sanctionnant le client. Mais comment pourrait-on concilier juridiquement le fait que la prostitution soit autorisée en France, puisqu’elle n’est pas interdite, la suppression du délit de racolage et la pénalisation du client ?
Nous aboutirions à cette situation : la prostitution serait autorisée ; sa promotion serait permise par le texte que nous voterions ; en revanche, il serait interdit aux clients de se livrer à de telles relations tarifées… Il me semble que, en agissant ainsi, nous irions au-devant de graves difficultés. En outre, le manque de clarté, de lisibilité et d’intelligibilité de la loi qui en découlerait conduirait à s’interroger sur sa constitutionnalité.
De telles dispositions pourraient également être contradictoires à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, reconnaissant le droit de disposer de son corps, juge que les relations sexuelles entre adultes sont libres et échappent à l’ingérence des pouvoirs publics, dès lors qu’aucune contrainte n’est exercée.
Souhaitons-nous réellement prendre ces risques vis-à-vis de la Constitution comme du droit européen ? Voter une loi d’affichage, inapplicable, juridiquement fragile, inopérante au regard des objectifs assignés apparaîtrait comme la pire des solutions. Un sujet aussi grave que celui-ci, dont dépendent la vie et la santé des personnes en cause, exige de notre part réalisme et pragmatisme
C’est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable au rétablissement de l’article 16, même si, vous l’aurez compris, je suis tout à fait en accord avec tout ce qui touche au volet social.
J’aurais souhaité, comme Chantal Jouanno l’a indiqué tout à l'heure, que nous réfléchissions plus en profondeur. Au lieu de supprimer l’article 251-10-1 du code pénal, il aurait été préférable de le réécrire. Si le client doit être pénalisé, il faut prévoir une condition de contrainte. Nous pourrions ainsi nous assurer de la conformité du texte avec le droit européen et nous donner les moyens de lutter contre les réseaux tout en permettant aux personnes qui le souhaitent d’exercer librement cette activité.
Nous écrivons la loi certes pour la majorité, mais il est de notre devoir de préserver dans le même temps les droits des minorités !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sommes appelés à débattre d’un texte important, visant à lutter contre le système prostitutionnel en France.
Je suis heureux de constater qu’un large consensus se dégage autour d’une action contre la prostitution qui soit efficace et qui permette de lutter contre les réseaux mafieux et les violences que subissent les personnes prostituées. Ce consensus concerne notamment le volet social du présent texte comme l’interdiction de l’utilisation d’internet.
À ce stade de la réflexion, le débat se focalise encore sur deux points : la question de la pénalisation du client et celle du délit de racolage, qui a resurgi à l’occasion d’une récente réunion de la commission spéciale.
Pour ma part, je suis complètement abolitionniste. Je ne crois pas à la fable de la prostitution libre et consentie. Songez que, de l’adhésion franche jusqu’à la résignation, le spectre du consentement est très large. À cet égard, 90 % des prostituées sont d’origine étrangère et sont liées à des réseaux de traite des êtres humains. Même si, parmi les 10 % restant, quelques personnes déclarent être libres et consentantes, nous constatons bien que ce consentement recouvre des situations très différentes.
Je ne crois pas non plus à la possibilité d’une prostitution sans risques. Les pays réglementaristes qui imaginent une prostitution contrôlée vont d’échec en échec. L’Allemagne en offre un exemple : les prostituées y sont dix fois plus nombreuses qu’en France, et les maladies, les violences, les difficultés y sont tout aussi présentes.
Enfin, je ne crois pas que la prostitution soit un métier comme un autre.
Sur ces points-là, nous devons renforcer clairement la tradition abolitionniste de la France. Je ne souhaite pas que mon enfant se prostitue ni qu’il aille voir une prostituée.
Cela étant, je remercie le Gouvernement d’avoir pris conscience de l’enjeu que représente aujourd’hui cette question en France. Il fallait agir. Nous constations, en effet, que les dispositifs législatifs, comme les systèmes visant à aider et à accompagner les prostituées, étaient complètement insuffisants et laissaient de côté trop de personnes démunies et en difficulté.
Certains députés ont pris l’initiative de cette proposition de loi, qui est en discussion maintenant depuis longtemps. Le débat a été large, à la fois au Parlement et dans la société. Aujourd’hui, la solution proposée, qui consiste à faire entrer le client dans le jeu, si je puis dire, et à le considérer comme un acteur susceptible d’être sanctionné s’il achète un acte sexuel, doit être regardée comme efficace. Elle l’est parce qu’elle envoie un message clair. Il faut être cohérent : on ne peut pas affirmer que la prostitution est la source de tous les maux, sans ajouter qu’il est illégal d’acheter un acte sexuel. Cela constitue en outre un outil efficace pour lutter contre les réseaux en tarissant leurs recettes financières, qui s’élèvent à 3 milliards d’euros chaque année. C’est en faisant en sorte qu’il y ait moins de clients, et donc en attaquant de front les réseaux, que l’on favorisera la diminution de la prostitution.

Monsieur Vial, Nicolas Sarkozy avait introduit le délit de racolage en 2003 en le présentant comme la solution pour lutter contre la prostitution. Dix ans plus tard, nous avons constaté l’échec complet de cette mesure. Il n’est pas sérieux de proposer aujourd’hui de mener la lutte contre la prostitution avec une recette qui a déjà démontré son inefficacité absolue.
Choisissons l’efficacité : sanctionnons le client plutôt que de revenir à une idée qui a déjà montré ses limites.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, disposant de peu de temps et les orateurs précédents ayant déjà exposé de nombreux points, j’irai à l’essentiel.
Le sujet complexe que nous abordons aujourd’hui suscite bien des passions. Et pourtant, nous avons tous dans cet hémicycle la volonté d’œuvrer pour mettre fin au fléau de l’exploitation de femmes et d’hommes à des fins sexuelles. C’est bien l’un des objets de cette proposition de loi. La question est de déterminer les moyens les plus efficaces.
Tel qu’adopté par les députés, dans un large consensus transpartisan, le texte comporte une vraie cohérence, manifestée par quatre piliers : renforcement de la lutte contre le proxénétisme, création d’un parcours de sortie de la prostitution, prévention et éducation, responsabilisation du client. Il s’agit donc bien d’agir auprès des trois acteurs : les réseaux, les prostituées et les clients.
Cessons l’hypocrisie : le client est le premier rouage du système prostitutionnel ; c’est bien son argent qui enrichit les réseaux, lesquels, pour satisfaire sa demande, mettent sur le trottoir toujours plus de prostituées. Tout est dit, suis-je tentée d’indiquer ! Il est illusoire de vouloir mettre fin à ce marché sans ouvrir les yeux de celui qui en est à l’origine : le consommateur.
Le législateur s’est saisi de ce sujet depuis de nombreuses années. Arrêtons de prétendre, comme je l’ai une nouvelle fois entendu récemment, qu’il faudrait encore du temps !
Le statu quo serait le pire des choix et constituerait un aveu d’incapacité dont nous n’avons vraiment pas besoin. La société a évolué. Un récent procès a révélé qu’il n’y avait pas deux prostitutions, comme on avait voulu nous le faire croire, l’une liée à la traite, esclavagiste et violente, et une autre, rebaptisée « travail du sexe » pour aseptiser la réalité de la marchandisation des corps. Quoi qu’il en soit, les prostituées sont tout autant humiliées, maltraitées, dominées. Dans toute relation marchande, le client est roi !
Oui, la prostitution est toujours une violence physique et psychologique. Dans plusieurs tribunes, dont l’une signée hier encore par le fondateur du SAMU social et de Médecins sans frontières, Xavier Emmanuelli, le généticien Axel Kahn, le psychiatre Christophe André, le gynécologue Israël Nisand, des médecins ont dû rappeler que la prostitution représentait bien un nombre incalculable et quotidien de pénétrations vaginales, anales et buccales non désirées.
Oui, la prostitution est une exploitation des inégalités sociales et économiques – plus de 90 % des prostituées sont d’origine étrangère – et de genre – 10 % des personnes prostituées sont des hommes, mais ceux-ci représentent 99% des clients.
Oui, la prostitution est une atteinte à la dignité humaine que le consentement de quelques-uns ne saurait suffire à justifier.
J’évoquerai plus tard plus précisément la nécessité de renverser la responsabilité entre la prostituée et le client. Je puis toutefois affirmer dès maintenant qu’une grande partie du groupe socialiste est derrière moi pour rétablir le texte, avec ses quatre piliers.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

La discussion générale est close.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures quarante, est reprise à dix-sept heures cinquante.

La séance est reprise.
Nous passons à la discussion du texte de la commission spéciale.
Chapitre Ier
Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle
(Non modifié)
L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Le 7 du I est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 225-4-1, 225-5, 225-6, » ;
b à d)
Supprimés
2°
Supprimé

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 33 rectifié bis est présenté par Mmes Jouanno, Morin-Desailly et Létard, MM. Zocchetto, Détraigne, Roche, Kern, Canevet, Bonnecarrère et Guerriau et Mmes Deromedi et Kammermann.
L'amendement n° 37 est présenté par Mme Meunier, au nom de la commission spéciale.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle relevant des articles 225-4-1, 225-5 et 225-6 du même code ».
La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 33 rectifié bis.

Cet amendement vise à restaurer le texte dans sa version initiale, à savoir autoriser l’autorité administrative à notifier aux fournisseurs d’accès à internet les adresses électroniques des sites internet favorisant le proxénétisme et la traite des êtres humains, afin de permettre leur blocage immédiat.
À l’époque, votre prédécesseur, madame la secrétaire d’État, avait demandé la suppression de cette mesure au motif qu’une réflexion sur la faisabilité et l’efficacité d’un tel dispositif était en cours. Depuis lors, un tel mécanisme a été adopté dans le cadre de la loi pour la confiance dans l’économie numérique concernant spécifiquement la lutte contre le terrorisme et la pédopornographie.
De fait, ni la contrainte technique ni l’argument procédural ne peuvent donc être opposés à la réintégration de cette disposition dans le présent texte.
Cette mesure est d’autant plus importante qu’il y aurait, selon le sociologue Laurent Mélito, environ 10 000 annonces distinctes sur internet sur cinq à six sites dédiés. L’ampleur du phénomène est réelle, ainsi que plusieurs d’entre vous, mes chers collègues, l’ont relevé. Si les autorités publiques, notamment policières, ne peuvent pas agir rapidement pour bloquer les sites en cause, nous laissons la voie ouverte – nous connaissons le temps que prennent les procédures juridiques – au développement de ces réseaux.
Tel est l’objet de cet amendement.

Cet amendement a pour objet de rétablir la possibilité de bloquer les sites internet utilisés par les réseaux de traite et de proxénétisme.
Je ne développerai pas les arguments présentés par Mme Jouanno. Avec la loi du 13 novembre 2014, le contexte a évolué. Aussi est-il possible de réinstaurer la faculté de bloquer les sites à caractère prostitutionnel.
Mesdames les sénatrices, je vous demande de bien vouloir retirer vos amendements respectifs.
Le Gouvernement a la préoccupation de travailler à l’élaboration d’outils efficaces. Selon nous, le blocage des sites internet n’est pas le seul moyen efficace pour lutter contre la prostitution. Nous souhaitons faire évoluer les capacités à remonter les filières de proxénétisme. D’ailleurs, des textes présenteront une approche globale du numérique sur l’ensemble des sujets.

Madame la secrétaire d'État, j’ai un peu de mal à comprendre : pourquoi ce qui était possible dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique, qui traite du numérique, à savoir le blocage des sites – cela semble a priori efficace – ne le serait-il pas pour la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains ?
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Les amendements sont adoptés.
L'article 1 er est adopté.
Le premier alinéa de l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces formations comportent un volet relatif à la prévention de la prostitution ainsi qu’à l’identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains. » –
Adopté.
(Supprimé)

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 21 est présenté par Mme Benbassa.
L'amendement n° 25 rectifié est présenté par MM. Yung, Leconte et Madec, Mmes Bataille et Khiari, M. Chiron, Mme Claireaux, MM. Courteau et Sutour et Mmes Conway-Mouret et Campion.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les personnes qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se voient délivrer une attestation d’élection de domicile. »
La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 21.

Aux termes de l’article 1er ter A, « pour leurs démarches administratives, les personnes prostituées peuvent déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées. » Toutefois, considérant que cet article n’avait pas lieu d’être eu égard au fait que le droit commun s’applique déjà à ces personnes, la commission spéciale l’a supprimé.
Si les citoyens non européens en situation administrative régulière bénéficient sans restriction du dispositif de domiciliation de droit commun, ce n’est pas le cas des personnes en situation irrégulière. Or nombreuses sont les personnes victimes de traite et de proxénétisme en situation irrégulière qui sont aujourd’hui largement entravées dans l’exercice de leurs droits, notamment pour ce qui concerne leurs démarches au titre de l’admission au séjour.
Cet amendement tend à ce que ces personnes aient la possibilité d’avoir une domiciliation afin de pouvoir engager des démarches administratives, tel le dépôt d’une demande de titre de séjour auprès de la préfecture.

La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret, pour présenter l'amendement n° 25 rectifié.

Cet amendement vise à faciliter l’obtention d’une domiciliation par les personnes étrangères victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme.
La domiciliation ou élection de domicile permet aux personnes sans domicile stable ou fixe – c’est le cas de très nombreuses prostituées, notamment étrangères – de disposer d’une adresse postale administrative grâce à laquelle elles peuvent non seulement recevoir du courrier mais, surtout engager des procédures administratives, telles que la demande d’un titre de séjour, pour laquelle un justificatif de domicile est systématiquement requis.
C’est pour faciliter ces démarches que la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale prévoyait, dans son article 1er ter A, que « pour leurs démarches administratives, les personnes prostituées peuvent déclarer comme domicile l’adresse de leur avocat ou d’une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées. »
Comme l’a indiqué Mme Benbassa, cet article a été supprimé par la commission spéciale.
L’article 1er ter de la proposition de loi dispose : « Lorsqu’il est fait application à ces personnes des dispositions de l’article 706-57 relatives à la déclaration d’adresse, celles-ci peuvent également déclarer comme domicile l’adresse de leur avocat ou d’une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées. »
Par ailleurs, le dispositif de domiciliation de droit commun prévu à l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique qu’aux citoyens européens et aux personnes en situation administrative régulière. Or denombreuses personnes prostituées victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme sont en situation irrégulière. À cet égard, je rappelle que 97 % des prostituées sont d’origine étrangère. Pour certaines d’entre elles, ce sont même les proxénètes qui détiennent leurs papiers d’identité.

Ces deux amendements identiques conduisent à traiter de façon différente les personnes en situation irrégulière selon la nature du titre de séjour qu’elles sollicitent.
En effet, les titres de séjour autres que la carte de séjour « vie privée et familiale » et l’autorisation provisoire de séjour, créée à l’article 6 de la proposition de loi, sont exclus du dispositif prévu par ces amendements.
En outre, la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », a assoupli et clarifié les règles applicables à la domiciliation des personnes en situation irrégulière. Ces dernières peuvent désormais se faire domicilier dans les conditions de droit commun lorsqu’elles demandent à bénéficier de l’aide médicale d’État, de l’aide juridictionnelle ou à exercer les droits civils qui leur sont reconnus par la loi.
En pratique, cela signifie que le droit à domiciliation est déjà largement ouvert aux personnes en situation irrégulière, contrairement à ce que vous dites, mes chères collègues. Il n’y a donc pas lieu de créer un régime dérogatoire pour les personnes prostituées qui sollicitent la carte « vie privée et familiale » ou l’autorisation provisoire de séjour.
Pour ces raisons, la commission spéciale a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Avis défavorable, pour les mêmes raisons.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas les amendements.
Après l’article 706-34 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-34-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-34-1. – Les dispositions de l’article 706-63-1 permettant la mise en œuvre de mesures de protection et de réinsertion ainsi que l’usage d’une identité d’emprunt sont applicables aux personnes victimes de l’une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs proches.
« Lorsqu’il est fait application à ces personnes des dispositions de l’article 706-57 relatives à la déclaration d’adresse, celles-ci peuvent également déclarer comme domicile l’adresse de leur avocat ou d’une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées. » –
Adopté.
(Supprimé)
Au 1° de l’article L. 8112-2 du code du travail, après les mots : « par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code », sont insérés les mots : «, l’infraction de traite des êtres humains prévue à l’article 225-4-1 du même code ». –
Adopté.
Chapitre II
Protection des victimes de la prostitution et création d’un projet d’insertion sociale et professionnelle

Je rappelle que l’amendement n° 19 rectifié bis, portant sur l’intitulé du chapitre II, est réservé jusqu’à la fin de l’examen de ce chapitre.
Section 1
Dispositions relatives à l’accompagnement des victimes de la prostitution
(Suppression maintenue)
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-9. – I. – Dans chaque département, l’État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1.
« Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle assure la mise en œuvre du présent article. Elle est présidée par le représentant de l’État dans le département. Elle comporte en outre un nombre égal de magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département, de représentants de l’État, de représentants des collectivités territoriales et de représentants d’associations.
« II. – Un projet d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est proposé et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association répondant aux critères définis au sixième alinéa du présent II.
« L’entrée dans le projet d’insertion sociale et professionnelle est autorisée par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au deuxième alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II.
« La personne engagée dans le projet d’insertion sociale et professionnelle peut prétendre au bénéfice de l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d’indigence prévues au 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu’elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues aux articles L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et L. 5423-8 du code du travail, une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle lui est versée.
« L’instance mentionnée au deuxième alinéa du I assure le suivi du projet d’insertion sociale et professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et l’accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient garantis. Elle s’assure du respect de ses engagements par la personne accompagnée.
« Le renouvellement du projet d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au deuxième alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée ainsi que des difficultés rencontrées.
« Toute association qui a pour objet l’aide et l’accompagnement des personnes en difficulté peut participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’insertion sociale et professionnelle, dès lors qu’elle remplit les conditions d’agrément fixées par décret en Conseil d’État.
« La durée du projet d’insertion sociale et professionnelle, ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le projet et les modalités de suivi de ces actions sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 121-10 est abrogé.
II. –
Non modifié
1° L’article 42 est abrogé ;
2° À la première phrase de l’article 121, la référence : « 42 » est remplacée par la référence : « 41 ».

L’article 3 de cette proposition de loi crée un parcours de sortie de la prostitution pour les victimes de cette prostitution. Il consacre la création d’une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains.
Si je tiens à intervenir à propos de cet article 3, c’est qu’il me paraît fondamental. Il constitue en effet l’un des piliers les plus importants de ce texte. L’essentiel, c’est bien la protection et la sécurisation des victimes de la prostitution. Voilà ce que propose cet article 3, qui met en place un véritable système de protection et d’accompagnement.
L’enjeu majeur de ce texte, je le répète, c’est l’humain, et plus précisément l’avenir de ces personnes. La question simple qu’elles se posent est la suivante : que vont-elles devenir ?
La loi leur dit qu’elles ne sont pas seules, que la République les protège. L’article 3 met en place un véritable parcours de sortie de la prostitution. Il entend apporter une réponse durable, concrète, crédible, en termes de soins, de revenus, de sécurité, de logement, de formation et d’accompagnement vers l’emploi. Ce parcours de sortie ouvrira des droits nouveaux à ces personnes que la République a l’impérieux devoir de protéger, car cette République – ne l’oublions jamais – est le pays des droits de l’homme.
Souvent, ces jeunes femmes ne parlent pas nos langues. Comment feront-elles si nous ne les aidons pas, au début, dans un parcours de réinsertion sociale ? Aujourd’hui, des femmes souffrent ; la priorité est de les aider à s’en sortir.
C’est au nom de la lutte contre la prostitution que le parcours de sortie de l’enfer se justifie. Il s’agit ici d’ouvrir des alternatives : cet article 3 le permet, grâce à l’accompagnement des victimes de la prostitution, de la traite des êtres humains et du proxénétisme vers une réinsertion sociale et professionnelle.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 22 est présenté par Mme Benbassa.
L'amendement n° 26 rectifié est présenté par MM. Yung, Leconte et Madec, Mmes Bataille et Khiari, M. Chiron, Mme Claireaux, MM. Courteau et Sutour et Mmes Conway-Mouret et Campion.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux personnes qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 22.

Les personnes étrangères rencontrent de nombreux obstacles dans l’accès à l’hébergement et au logement, discrimination notamment liée à leur origine et à leur situation juridique et administrative précaire, ce alors même qu’elles ont un besoin impérieux de protection et de mise à l’abri.
Ces importantes difficultés pour accéder à un hébergement ont des conséquences parfois dramatiques sur ces personnes en situation de vulnérabilité : impossibilité de bénéficier d’un accompagnement social, mise en danger, femmes à la rue, risque de retour vers la source des violences, impossibilité d’extraction du réseau.
Nous considérons qu’il est indispensable de prévoir un accompagnement social effectif et proposons donc de donner un véritable accès au logement aux personnes victimes de traite et de proxénétisme.

La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret, pour présenter l'amendement n° 26 rectifié.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, cet amendement vise à préciser que la protection et l’assistance, notamment en matière d’accès au logement, prévues pour les victimes par l’article 3 de la proposition de loi sont accordées aux personnes étrangères victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme.
L’article 3 de la proposition de loi modifie l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, lequel disposera que : « Dans chaque département, l’État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1. »
Cet article ne précise donc pas si les dispositions prévues sont applicables aux personnes étrangères.
Or ces personnes rencontrent de nombreux obstacles dans l’accès à l’hébergement et au logement. Les personnes prostituées étrangères subissent tout d’abord des discriminations du fait de leur activité, de leurs origines et de leur situation administrative précaire, que ce soit dans l’accès au logement dans le parc privé ou dans l’accès aux dispositifs de droit commun d’aide au logement ou de mise à l’abri, comme ceux qui sont prévus dans le cadre du quatrième plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes.
Il faut ensuite souligner que la réduction des budgets dédiés à l’hébergement, et notamment aux structures spécialisées, affecte tout particulièrement les personnes étrangères.
Enfin, les rares places qui sont obtenues se révèlent souvent inadaptées, à cause de la courte durée de leur mise à disposition ou de la difficile cohabitation avec les personnes rencontrées dans ces structures, ce qui rend impossible un accompagnement social et juridique.
Il est d’autant plus essentiel de lever ces obstacles que l’accès à un hébergement est le préalable indispensable à la mise en œuvre d’un projet d’insertion sociale et professionnelle. En effet, l’absence de logement accroît la précarité administrative, économique et sociale de la personne prostituée et accroît parallèlement le risque pour elle de retomber dans la prostitution.

La commission comprend parfaitement la volonté de ne pas exclure les personnes prostituées en situation irrégulière des dispositifs d’hébergement.
La commission a cependant estimé que ces deux amendements identiques étaient satisfaits. En effet, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 3, l’État « assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin. », et ce notamment en leur fournissant une place d’hébergement.
Sont donc, par définition, concernées les personnes qui sont susceptibles de faire une demande de carte « vie privée et familiale » ou d’une autorisation provisoire de séjour.
En outre, la rédaction des deux amendements identiques laisse entendre que le dispositif de protection, d’assistance et de mise à l’abri assuré par l’État serait ouvert aux seules personnes qui demandent la carte « vie privée et familiale » ou l’autorisation provisoire de séjour, ce qui ne correspond certainement pas à l’objectif.
La commission demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut elle émettra un avis défavorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 9 rectifié bis, présenté par M. Requier et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :
Alinéa 4, dernière phrase
Après les mots :
collectivités territoriales
insérer les mots :
, de professionnels de santé
La parole est à M. Guillaume Arnell.

Cet amendement a pour objet de préciser la composition de l’instance qui sera chargée de proposer et de mettre en œuvre le parcours d’insertion professionnelle et sociale de la personne prostituée.
Il tend à intégrer à cette instance des professionnels de santé, compte tenu de l’importance de la problématique sanitaire et sociale pour ces personnes. La qualification de « professionnel de la santé » autorisera notamment infirmiers ou psychologues nommés par le préfet à participer à l’élaboration du projet d’insertion professionnelle et sociale.
Il s’agit-là d’une vraie plus-value pour les personnes victimes de la prostitution.

L’instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite sera composée d’un nombre égal de magistrats, de représentants de l’État, de représentants des collectivités territoriales et de représentants d’associations.
L’amendement tend à y ajouter des « professionnels de santé ». Cette notion permet de couvrir un ensemble de professions allant des médecins aux infirmières, en passant, par exemple, par les psychothérapeutes.
Nous avons eu un débat en commission spéciale sur les termes qui seraient les plus appropriés, et ceux de « professionnels de santé », couramment utilisés dans le code de la santé publique, nous ont paru les plus adaptés à ce stade de la loi.
Ils laissent suffisamment de marge de manœuvre aux préfets pour organiser ensuite les instances dans chaque département, en faisant appel aux professionnels les plus compétents pour accompagner les victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite.
L’avis de la commission est donc favorable.
L'amendement est adopté.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 7 rectifié est présenté par M. Requier et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
L'amendement n° 11 est présenté par Mmes Gonthier-Maurin et Cohen.
L'amendement n° 23 est présenté par Mme Benbassa.
L'amendement n° 27 rectifié est présenté par MM. Yung, Leconte et Madec, Mmes Bataille et Khiari, M. Chiron, Mme Claireaux, MM. Raoul et Sutour et Mme Campion.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
peut prétendre au bénéfice
par le mot :
bénéficie
La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié.

Il s'agit de lever une ambiguïté rédactionnelle s'agissant des droits des victimes du système prostitutionnel à bénéficier de l'autorisation provisoire de séjour.
Cette précision rédactionnelle permettra de sécuriser l’accès des personnes prostituées au bénéfice de l’autorisation provisoire de séjour.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l'amendement n° 11.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, cet amendement vise à mettre en cohérence les articles 3 et 6 de cette proposition de loi, après l’adoption, en juillet dernier, par la commission spéciale de la rédaction de ce nouvel article L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA.
En effet, la commission spéciale avait introduit l’automaticité de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour les étrangers victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme, et porté la durée de cette autorisation de séjour à un an, contre six mois, modifications que notre groupe avait soutenues.
En cohérence, nous proposons que cette automaticité soit introduite à l’alinéa 7 de l’article 3.
Il serait en effet tout à fait incompréhensible que subsistent dans la proposition de loi deux rédactions différentes, et donc deux interprétations différentes, pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour aux personnes étrangères victimes de traite ou de proxénétisme.
Ce point est tout à fait primordial, car nous connaissons très bien les difficultés extrêmes, pour ne pas dire plus, que rencontrent déjà ces victimes pour faire valoir leurs droits à bénéficier des dispositions prévues à l’article L. 361-1 du CESEDA.
Ces dispositions sont très strictement encadrées. Les titres ne sont en effet que très rarement délivrés par les préfectures aux victimes de la traite ou du proxénétisme qui portent plainte et dénoncent les auteurs de ces infractions.
Selon les chiffres du ministère de l’intérieur, pointés par la CIMADE, trente-huit titres de séjour temporaire « vie privée et familiale » ont été délivrés à des victimes de la traite en 2013. Ce chiffre passe à cinquante-cinq pour l’année dernière. Quant à la délivrance d’une carte de résident, seule une victime de la traite en 2011 et quatre en 2012 ont pu en bénéficier, selon les chiffres présentés lors du Comité interministériel de contrôle de l’immigration, en 2012.
Cette délivrance au compte-gouttes traduit la méfiance, pour ne pas dire la suspicion des autorités administratives vis-à-vis des personnes qui déposent une demande de carte de séjour parce qu’elles ont été victimes de traite.
Cette réalité administrative est pourtant en contradiction flagrante avec les engagements déclinés dans le quatrième plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, présenté par le Gouvernement pour la période 2014-2016, dont l’une des trois grandes priorités consiste à « organiser l’action publique autour d’un principe d’action simple : aucune violence déclarée ne doit rester sans réponse. »
Elle est en contradiction aussi avec les engagements internationaux pris par la France, qui a ratifié la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.
De la parole aux actes, le chemin est souvent long ; c’est pourquoi je vous propose d’adopter cet amendement.

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l'amendement n° 23.

La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour présenter l'amendement n° 27 rectifié.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, cet amendement tend à mettre en cohérence l’article 3, alinéa 7, avec l’article 6, alinéa 7, de la proposition de loi, afin de renforcer l’automaticité de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour aux personnes étrangères victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme qui se sont engagées dans un projet d’insertion sociale et professionnelle.
La commission spéciale avait voulu rendre cette délivrance automatique. L’objectif était d’accorder de plein droit le bénéfice de l’autorisation de séjour aux personnes qui se sont engagées dans ce projet d’insertion sociale et professionnelle.
En effet, les personnes prostituées étrangères ne s’engageront dans un tel projet qu’à la condition d’être certaines d’être aidées et de voir leur situation administrative régularisée pendant la durée du projet.
Par ailleurs, la proposition de loi accorde déjà au préfet la possibilité de s’opposer, au nom de l’impératif d’ordre public, à la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour.
C’est donc à raison que la commission spéciale a modifié l’article 6 de la proposition de loi pour rendre automatique la délivrance de cette autorisation.
Seulement, elle n’a pas modifié l’alinéa 7 de l’article 3, qui va à l’encontre du principe d’automaticité en disposant que la personne engagée dans un projet d’insertion sociale et professionnelle « peut prétendre au bénéfice » de l’autorisation provisoire de séjour.
Prévoir que cette personne « en bénéficie » permettrait de lever toute ambiguïté et serait parfaitement en accord avec les objectifs de la commission spéciale comme des auteurs de la proposition de loi.

Ces amendements visent à préciser qu’une autorisation provisoire de séjour doit être délivrée à toute personne engagée dans un projet d’insertion sociale et professionnelle qui en fait la demande, sans que le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation en la matière.
Ce principe serait cohérent avec l’article 6 dans la rédaction adoptée par la commission spéciale, en vertu duquel le préfet aura compétence liée pour délivrer une autorisation provisoire de séjour aux personnes engagées dans un projet d’insertion sociale et professionnelle.
Toutefois, cette compétence liée entraîne un risque d’instrumentalisation par les réseaux des dispositifs d’accompagnement proposés aux personnes prostituées ; je parlerai même d’un risque d’appel d’air.
Dans ces conditions, la commission spéciale sera favorable aux amendements à l’article 6 visant à rétablir le pouvoir d’appréciation du préfet. Elle est donc défavorable à ces quatre amendements identiques.
Pour les mêmes raisons que Mme la rapporteur !

Je mets aux voix les amendements identiques n° 7 rectifié, 11, 23 et 27 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Yung, Leconte et Madec, Mmes Bataille et Khiari, M. Chiron, Mme Claireaux, MM. Courteau, Raoul et Sutour et Mmes Conway-Mouret et Campion, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Après le mot :
association
insérer les mots :
choisie par la personne concernée
La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.

Les auteurs de cet amendement entendent s’assurer que l’association agréée qui participera à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’insertion sociale et professionnelle sera choisie par la personne victime de la traite des êtres humains ou du proxénétisme qui en bénéficiera.
L’article 3 de la proposition de loi prévoit que « toute association qui a pour objet l'aide et l'accompagnement des personnes en difficulté peut participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'insertion sociale et professionnelle, dès lors qu'elle remplit les conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'État ». Cette disposition permet à des associations d’accompagner la personne prostituée dans la définition et la réalisation de son projet d’insertion sociale et professionnelle.
Il peut être justifié de réserver cet accompagnement aux seules associations agréées par l’État, afin de s’assurer que le projet s’inscrira dans un cadre précis et que les associations qui le prendront en charge respecteront les exigences fixées par l’État.
En revanche, la personne prostituée devrait pouvoir choisir librement, parmi les associations agréées par l’État, celle qui l’accompagnera dans son projet. En effet, de nombreuses personnes prostituées sont déjà suivies par des associations, avec lesquelles elles ont construit une relation de confiance ; il semble inopportun de briser ce lien en imposant à la personne prostituée d’être accompagnée par une autre association, dès lors que celle par laquelle elle est suivie est agréée.
Quant aux personnes prostituées qui ne sont pas déjà suivies par une association ou qui le sont par une association non agréée, il semble tout aussi essentiel qu’elles puissent choisir l’association agréée avec laquelle elles veulent coopérer. En effet, les relations personnelles et le lien de confiance entre la personne prostituée et les membres de l’association jouent un rôle déterminant dans la réussite du projet d’insertion sociale et professionnelle.
C’est ce libre choix que les auteurs du présent amendement vous proposent de garantir.

L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Requier et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Après les mots :
dès lors
insérer les mots :
qu'elle a été choisie par la personne concernée et
La parole est à M. Guillaume Arnell.

La commission souscrit pleinement à l’intention des auteurs de ces deux amendements : s’assurer qu’un lien de confiance puisse s’établir entre la personne engagée dans un projet d’insertion sociale et professionnelle et l’association qui l’accompagnera. C’est si vrai que l’alinéa 5 de l’article 3 du texte de la commission prévoit explicitement que le projet devra être proposé et mis en œuvre « en accord avec la personne accompagnée ».
En outre, l’agrément prévu par la proposition de loi sera ouvert à toutes les associations œuvrant pour l’accompagnement des personnes en difficulté. Les personnes qui s’engagent dans un projet d’insertion sociale et professionnelle seront donc orientées vers les associations reconnues pour leur action dans ce domaine.
Ces deux précautions me semblent suffisantes.
Par ailleurs, prévoir un choix revient à supposer que les personnes destinées à être accompagnées disposeront d’une information complète sur l’offre associative existant là où elles se trouvent. Or nous savons bien que tel n’est pas le cas, les personnes prostituées étant souvent très éloignées des associations susceptibles de les aider.
Dans la mesure où ces deux amendements risquent de rester des vœux pieux, la commission sollicite leur retrait ; s’ils sont maintenus, elle y sera défavorable.
L'amendement est adopté.
L'article 3 est adopté.
Après le huitième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« f) De personnes engagées dans le projet d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ;
« g) De personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal. » –
Adopté.

Je vous rappelle que l’article 4 a été réservé jusqu’après l’article 17.
(Suppression maintenue)
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 316-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;
2° Après l’article L. 316-1, il est inséré un article L. 316-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 316 -1 -1. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’un an est délivrée à l’étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui est engagé dans le projet d’insertion sociale et professionnelle mentionné à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du projet d’insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;
3° L’article L. 316-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, la référence : « de l’article L. 316-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 » ;
b) Après la référence : « L. 316-1 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et de l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 316-1-1 et les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de l’étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée. »

L’article 6 de la proposition de loi introduit des modifications significatives en matière de droit au séjour des personnes étrangères victimes de la traite ou de la prostitution ayant déposé plainte contre les auteurs de ces infractions.
Les modifications entérinées par la commission spéciale en juillet dernier sont très importantes, tant il est vrai que, sur le terrain, l’accès effectif à ce droit est particulièrement compliqué et contraint pour les victimes.
Pour vous faire mesurer ces difficultés, mes chers collègues, je vous exposerai un cas très concret et, malheureusement, toujours d’actualité : celui de quatorze femmes et hommes victimes de traite dans un salon de coiffure du 57, boulevard de Strasbourg, dans le Xe arrondissement de Paris. Mes collègues Laurence Cohen et Pierre Laurent et moi-même vous avons déjà saisie de leur situation, madame la secrétaire d’État, après en avoir avisé le Premier ministre, le ministre de l’intérieur, la garde des sceaux et le ministre du travail.
Ces personnes, majoritairement des femmes sans papiers, mènent depuis le mois de juin dernier une lutte exemplaire et difficile contre un système mafieux d’exploitation. Recrutées dans la rue par ceux qui les ont exploitées, soumises à des conditions de travail contraires à la dignité humaine, exposées à des produits cancérigènes et en situation de vulnérabilité, car démunies de titre de séjour, ces quatorze personnes ont eu, malgré tout, le courage de dire « stop ! ».
Elles ont commencé par se mettre en grève pendant quinze jours, occupant leur salon, et ce malgré les intimidations verbales et physiques, sans parler des menaces d’être « mises sur le trottoir » ; elles ont ainsi obtenu des contrats de travail, ainsi que le paiement de leurs salaires.
Elles ont ensuite eu le courage de déposer plainte auprès du procureur de la République de Paris pour des faits de traite d’êtres humains. Au terme de contrôles dont les conclusions ont été transmises au parquet de Paris, l’inspection du travail a estimé que « les éléments de constats relevés dans le procès-verbal pourraient permettre de caractériser le délit de traite des êtres humains ».
Or la préfecture de police de Paris a, pour toute réponse, envisagé un examen au cas par cas des demandes de régularisation, au regard de la seule circulaire du 28 novembre 2012, et non pas de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle subordonne l’application à l’engagement de poursuites sur ce fondement par le procureur de la République. Or l’article lui-même ne prévoit pas cette condition et mentionne seulement le dépôt de plainte ; deux arrêts, rendus respectivement par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 22 mars 2011 et par la cour administrative d’appel de Paris le 11 octobre de la même année, ont confirmé que l’engagement de poursuites n’était pas nécessaire.
Actuellement, seules cinq personnes sur les quatorze dont je parle ont pu bénéficier d’un titre de séjour ; encore est-ce seulement à raison de leur temps de présence en France, et non parce qu’elles ont déposé plainte pour traite d’êtres humains.
Toutes doivent désormais bénéficier de la protection déjà prévue dans la loi et renforcée par le présent article. Si cette protection ne leur bénéficiait pas, mes chers collègues, songez au signal envoyé aux victimes et aux réseaux de traite !

L'amendement n° 38, présenté par Mme Meunier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la rapporteur.

Les alinéas 4 et 5 de l’article 6 sont inutiles, l’article 48 de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ayant déjà apporté les compléments nécessaires au premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est pourquoi la commission spéciale vous propose de supprimer ces deux alinéas.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 16 rectifié bis, présenté par Mmes Lepage et Blondin, M. Courteau, Mmes E. Giraud, Monier, Tocqueville, Jourda et Guillemot, MM. Kaltenbach, Carvounas, Berson, Tourenne, Desplan et Roger, Mme D. Michel, MM. Filleul, Madrelle et Lalande, Mme Ghali, MM. Manable et Miquel, Mmes Cartron, Génisson, Conway-Mouret et Bataille et M. Durain, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
d’un an est délivrée
par les mots :
de six mois peut être délivrée
La parole est à Mme Claudine Lepage.

L’article 6 de la proposition de loi modifie le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux fins de faciliter l’obtention d’un titre de séjour par les victimes de la traite et du proxénétisme.
Notre commission spéciale a adopté un amendement visant à inscrire à l’article L. 316-1 de ce code que le préfet aura compétence liée pour la délivrance de titres de séjour aux victimes de la traite ou du proxénétisme qui dénoncent les auteurs de ces infractions, dès lors que les conditions fixées par la loi seront remplies. Elle a également modifié le nouvel article L. 316-1-1 inséré dans le même code pour prévoir la compétence liée du préfet pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour aux victimes de la traite ou du proxénétisme engagées dans un projet d’insertion sociale et professionnelle.
Privé de compétence discrétionnaire, le préfet sera donc tenu, dans ce cas-là aussi, de délivrer l’autorisation de séjour, même si la personne prostituée n’a pas porté plainte contre le réseau de traite et est encore sous le joug de son proxénète.
On voit bien le risque de manipulation qui en résulte : les réseaux auront tôt fait de détourner la loi à leur bénéfice, en faisant en sorte qu’un plus grand nombre de prostituées puissent séjourner légalement en France.
Il me semble que nous n’avons pas intérêt à présenter la France comme un pays d’accueil de la prostitution ! Il importe donc de ne pas dessaisir le préfet de son pouvoir d’appréciation et de lui laisser la possibilité de vérifier, avant de délivrer un permis de séjour, que la personne prostituée n’est pas contrainte par un proxénète qui la manipule.
La réduction de la durée de ce permis de un an à six mois répond à la même logique.
Bien entendu, il doit en être autrement si la personne prostituée dépose plainte, puisque, dans ce cas, sa liberté d’action ne fait aucun doute ; cette personne doit impérativement être protégée du proxénète qu’elle a dénoncé durant toute la durée de la procédure judiciaire.

Cet amendement tend à revenir au texte initial de l’Assemblée nationale et correspond à la position que j’avais défendue en juillet dernier devant la commission spéciale.
Je souligne, d'ailleurs, que, au cours des auditions complémentaires que nous avons organisées ces dernières semaines, nous avons été alertés sur le risque de détournement par les réseaux de traite d’un titre de séjour qui serait octroyé automatiquement.
Par conséquent, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

On se souvient que la commission spéciale du Sénat, en juillet dernier, à la suite d’un amendement déposé par Jean-Pierre Godefroy, avait décidé d’allonger la durée de l’autorisation à un an et en avait décidé l’automaticité.
Le présent amendement tend à revenir sur cette automaticité et à réduire la durée de l’autorisation à six mois, ce que je déplore.
Au reste, je dois dire que je ne comprends pas l’argument de l’appel d’air pour les réseaux mafieux et de proxénètes : qu’est-ce qui peut mieux contrarier un proxénète ou un réseau que la possibilité, pour une femme contrainte à la prostitution, d’engager une démarche pour obtenir des papiers ? Bien au contraire, cette possibilité est l’une des conditions de son émancipation !
Je ne voterai donc pas cet amendement.

Je ne voterai pas non plus cet amendement.
Je veux bien entendre que l’on supprime la compétence liée. À la limite, sa suppression ne me dérange pas trop, parce que je vois bien les difficultés qu’elle peut soulever.
Cela dit, je souhaite aborder deux points.
Premièrement, j’ai cru comprendre que l’on voulait revenir à la condition du dépôt de plainte. C’est pourtant le meilleur moyen pour que personne ne s’engage dans un parcours d’insertion !

En effet, on sait parfaitement qu’aujourd'hui les personnes ne déposent pas plainte parce que les risques de représailles, sur elles-mêmes ou sur leur famille, sont trop grands.

D'ailleurs, et nous l’avions signalé, dans notre pays, la personne ayant déposé plainte n’est pas protégée, si ce n’est à la fin de la procédure judiciaire, quand il y aura eu, le cas échéant, condamnation des proxénètes, ce qui est problématique, et même complètement stupide !
Deuxièmement, la durée est essentielle ! Comment voulez-vous qu’une personne qui se décide à arrêter son activité de prostituée et porte plainte ait, en six mois, le temps de se remettre, de trouver le courage d’engager des procédures, d’essayer de s’insérer, de chercher un travail, une activité… ? Elle doit aussi, bien souvent, être protégée.
Nos amis italiens nous avaient expliqué, à Chantal Jouanno et à moi-même, que, dans leur pays, ces personnes sont protégées tout au long de cette période et ne sont alors pas accessibles.
Je pense donc véritablement que, si l’on veut engager les personnes dans un parcours de réinsertion, il faut absolument maintenir les deux mesures prévues à l’article 6. Sinon, ce texte n’aura aucune efficacité !

Je serai brève, parce que je souscris totalement aux interventions de mes deux collègues.
Nous devons faire attention au message que nous allons délivrer en votant cet amendement.
Comme nous l’avons tous dit dans nos interventions liminaires, avec nos sensibilités différentes, il est compliqué et long, pour une ancienne prostituée, de se reconstruire : cela nécessite tout un processus psychologique, pendant lequel cette personne a besoin d’être accompagnée.
Or, tout à coup, on a l’impression que la défiance revient dans ce débat, et, à nouveau, à l’égard des prostituées.
Les auteurs de l’amendement se justifient en disant que le texte créera un appel d’air pour les réseaux. Je crois qu’il faut cesser de raisonner de cette manière ! De toute façon, les criminels ont toujours beaucoup d’imagination pour détourner les lois… L’enjeu n’est pas là : il faut raisonner par rapport aux prostituées, qui sont engagées dans un parcours extrêmement difficile et qui ont besoin de temps.
Par conséquent, réduire l’autorisation provisoire de séjour à six mois les contraint à nouveau de manière très dure : elles ne sont pas forcément en capacité de faire des choix dans un délai aussi court.
Je crois donc qu’il faut au contraire laisser du temps au temps et en rester à l’autorisation de séjour d’un an qui est prévue dans le texte.
Je vais apporter quelques précisions, parce que je ne voudrais pas que nous nous trompions de débat.
Il est maintenant prévu que la personne qui porte plainte ou décide de témoigner se voie automatiquement délivrer une carte de séjour temporaire. Pourquoi revenons-nous à une durée de six mois ? Parce que nous avons besoin de vérifier l’absence de manipulation éventuelle des réseaux. Et je peux vous dire que le risque existe !
Au reste, nous renforçons et la protection de la personne prostituée et l’automaticité de la carte de séjour temporaire, qui est renouvelable, d’autant plus pendant le temps de la procédure, jusqu’à la condamnation et le démantèlement du réseau.
Le texte ne marque donc absolument pas un recul ! Nous préférons simplement procéder en deux fois, et retenir, dans un premier temps, une autorisation de séjour de six mois renouvelable, même si la personne prostituée est couverte par une protection et par l’octroi d’une carte de séjour pendant toute la durée de la procédure.
Je le répète, nous avons besoin de vérifier que l’octroi des cartes de séjour ne fait pas l’objet de manipulation de la part des réseaux.

Mme la secrétaire d'État a été claire.
Je veux juste préciser que nous allons débattre plus loin d’un amendement qui prévoit que le renouvellement de l’autorisation de séjour est possible, justifiant que l’on s’en tienne à une durée de six mois.
Exclamations sur les travées du groupe CRC.

Pour des personnes démunies, restreintes dans leur liberté, ce n’est pas la même chose !

Il faut aussi trouver un équilibre entre, bien sûr, la volonté de faciliter l’insertion des prostituées, mais aussi la nécessité de prendre toutes les garanties. À cet égard, une autorisation de séjour de six mois renouvelable me semble une proposition équilibrée.
Se demander si l’autorisation doit être de six mois renouvelable ou d’un an, c’est, me semble-t-il, couper les cheveux en quatre.
Exclamations sur les travées du groupe CRC.

Une durée de six mois renouvelable permet de faire des vérifications et, ainsi, de mieux protéger tout le monde : et la prostituée, et ceux qui travaillent pour la réinsertion.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 17 rectifié bis, présenté par Mmes Blondin et Lepage, M. Courteau, Mmes E. Giraud, Monier, Tocqueville, Jourda et Guillemot, MM. Kaltenbach, Carvounas, Berson, Tourenne, Desplan et Roger, Mme D. Michel, MM. Filleul, Madrelle et Lalande, Mme Ghali, MM. Manable et Miquel, Mmes Cartron, Génisson, Conway-Mouret et Bataille et M. Durain, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
projet d’insertion sociale et professionnelle
par les mots :
parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle
La parole est à Mme Maryvonne Blondin.

L’article 6 reconnaît un droit de séjour pour les personnes prostituées victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme.
On l’a vu, il s’agit là d’un élément essentiel afin d’assurer l’efficacité des mesures que nous souhaitons mettre en place : c’est faire primer le droit des victimes, qu’elles aient porté plainte ou non contre leurs proxénètes.
Sur ce sujet, il apparaît toutefois nécessaire de sécuriser la situation des femmes étrangères victimes de la traite.
Tel est l’objet du présent amendement, qui vise à subordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à l’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution.
En effet, ce parcours est le corollaire de tout projet d’insertion sociale et professionnelle pérenne. Il entend apporter une réponse durable et concrète en termes de soins, de sécurité, de logement, de revenus, de formation et d’accompagnement vers l’emploi.
Reconnaître un droit au séjour aux personnes prostituées qui s’engagent dans un parcours de sortie de la prostitution constitue, ainsi, une disposition essentielle à leur protection et à leur avenir.

Cet amendement vise à remplacer l’expression « projet d’insertion sociale et professionnelle » par celle de « parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle » s’agissant des conditions de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour aux personnes victimes de la prostitution.
Il revient ainsi sur la position de la commission spéciale, qui avait suivi la demande formulée par un grand nombre des organismes et des associations entendus. Il s’agissait de ne pas imposer un parcours prédéfini à ces personnes, mais de construire, avec elles, un parcours personnalisé pour une insertion sociale et professionnelle durable.
Toutefois, il est vrai que la notion de « parcours de sortie de la prostitution » indique clairement une intention de cessation de la prostitution et permet peut-être ainsi d’éviter un risque d’instrumentalisation par les réseaux de proxénétisme, qui pourraient essayer d’obtenir des papiers pour des personnes prostituées sans que celles-ci cessent leur activité.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis de sagesse.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Je dois dire que cet amendement me chiffonne.
En effet, nombreuses sont les personnalités auditionnées par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes qui nous ont dit qu’il ne fallait pas s’attendre à un parcours facile. Au contraire, celui-ci sera probablement semé d’embûches, avec de possibles échecs, des interruptions momentanées, sans remettre en cause, sur le fond, l’intention de la personne prostituée de sortir de la prostitution.
Dans ces conditions, une formalisation aussi stricte m’inquiète beaucoup.
J’avoue donc que je ne suis pas très favorable à cet amendement.

Je veux juste dire que je suis complètement d’accord avec ma collègue Brigitte Gonthier-Maurin.
Elle reflète, du reste, la position de la commission spéciale que nous avions adoptée le 8 juillet dernier.

On sait très bien que le parcours de sortie peut être interrompu, raison pour laquelle nous avons retenu l’expression « parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle », lequel peut durer plus longtemps.
En tout état de cause, nous avons préféré à la notion de « projet d’insertion sociale et professionnelle » celle de « parcours de sortie », qui prend en compte les préoccupations que vous venez de formuler.

Je suis d’accord avec mes collègues Brigitte Gonthier-Maurin et Jean-Pierre Godefroy : l’expression « parcours de sortie » est très limitée. En tout cas, elle est plus limitative que le terme de « projet », qui suppose une avancée, un futur et qui est beaucoup plus ouvert !
Il faut donner cette chance aux personnes qui veulent s’insérer socialement et professionnellement.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

L'amendement n° 18 rectifié bis, présenté par Mmes Lepage et Blondin, M. Courteau, Mmes E. Giraud, Monier, Tocqueville, Jourda et Guillemot, MM. Kaltenbach, Carvounas, Berson, Tourenne, Desplan et Roger, Mme D. Michel, MM. Filleul, Madrelle et Lalande, Mme Ghali, MM. Manable et Miquel, Mmes Cartron, Génisson, Conway-Mouret et Bataille et M. Durain, est ainsi libellé :
Alinéa 7, dernière phrase
Remplacer le mot :
renouvelée
par le mot :
renouvelable
La parole est à Mme Claudine Lepage.

Cet amendement relevant de la même philosophie que l’amendement n° 16 rectifié bis, qui a été rejeté, je le retire, monsieur le président.
L'article 6 est adopté.
(Suppression maintenue)
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « défavorisées », sont insérés les mots : «, les associations agréées en application de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ». –
Adopté.
(Non modifié)
Au dernier alinéa de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « humains », sont insérés les mots : «, du proxénétisme et de la prostitution ».

L'amendement n° 39, présenté par Mme Meunier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le début de cet article :
À l'avant-dernier alinéa de ...
La parole est à Mme la rapporteur.

Il s'agit d’un amendement de coordination avec la création d'un nouvel alinéa à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles par la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
L'amendement est adopté.
L'article 9 est adopté.
(Supprimé)
(Non modifié)
Au dernier alinéa du 2° de l’article 706-3 du code de procédure pénale, après la référence : « 225-4-5 », sont insérées les références : «, 225-5 à 225-10 ». –
Adopté.
I. – L’article 2-22 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 2 -22. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la lutte contre l’esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou l’action sociale en faveur des personnes prostituées, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimées par les articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12-2, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l’accord doit être donné par son représentant légal. »
II. –
Non modifié

L'amendement n° 40, présenté par Mme Meunier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2, dernière phrase
Remplacer les mots :
doit être
par le mot :
est
La parole est à Mme la rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 11 est adopté.
(Non modifié)
Au troisième alinéa de l’article 306 du code de procédure pénale, après le mot : « sexuelles, », sont insérés les mots : « de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, réprimé par les articles 225-7 à 225-9 du code pénal, ». –
Adopté.
Section 2
Dispositions portant transposition de l’article 8 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil

L'amendement n° 24, présenté par Mme Benbassa, est ainsi libellé :
Avant l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La fonction de rapporteur national sur l’évaluation de la politique publique de lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains est assurée par la Commission nationale consultative des droits de l’homme.
La parole est à Mme Esther Benbassa.

La directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil prévoit que les États membres mettent en place des rapporteurs nationaux indépendants chargés d’évaluer la politique publique mise en œuvre en matière de lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains.
Le plan d’action national contre la traite des êtres humains pour la période 2014-2016, adopté par le conseil des ministres le 14 mai 2014, confie dans son point 23 à la Commission nationale consultative des droits de l’homme, CNCDH, autorité administrative indépendante, la fonction de rapporteur national.
L’objet du présent amendement est d’inscrire dans la loi cette fonction de rapporteur national attribuée à la CNCDH par le plan d’action national adopté en conseil des ministres, et ce afin qu’elle puisse exercer de manière pérenne son rôle d’évaluation des résultats des actions engagées par les pouvoirs publics et la société civile dans la lutte pour prévenir et réprimer la traite ainsi que l’exploitation des êtres humains et protéger les victimes.
Il existe en France, comme vous le savez, une mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains, ou MIPROF, créée par le décret n°2013-7 du 3 janvier 2013 et constituée de deux personnes. Cette mission interministérielle a mis en place un plan national de lutte, qui ne peut qu’être évalué par une institution indépendante de celle-ci.
Depuis son institution en 1947, la CNCDH a fourni de nombreux travaux et a répondu à de nombreuses auditions au Sénat et à l’Assemblée nationale à propos de la traite et de l’exploitation des êtres humains - douloureux sujet au cœur de ses missions.
Parallèlement à la MIPROF, il existe aussi en France une délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, ou DILCRA, le rapporteur national sur la lutte contre le racisme et l’antisémitisme et la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, qui, au titre de l’article 2 de la loi 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, remet chaque année au Premier ministre depuis plus de vingt ans son rapport annuel sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Le rapport 2014 sera remis au Premier ministre le 8 avril 2015.
Je n’ai pas compris pourquoi la commission spéciale a rejeté cet amendement. La traite des êtres humains et la prostitution sont-elles un domaine à ce point spécifique qu’elles ne sauraient relever que d’une structure interministérielle ? Il n’est pas possible d’être à la fois juge et témoin. Nous devons peut-être réfléchir sur ces questions, j’attire votre attention sur ce point.

La commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
La fonction de rapporteur national, que vous décrivez, est déjà prévue par la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, et le plan d’action national contre la traite la confie déjà à la CNCDH.
L’inscrire dans la loi aurait pour effet de figer une situation qui peut évoluer. D’autres instances peuvent aussi assurer ce rôle à l’avenir.
En outre, pour le moment, la CNCDH n’a pas de domaine de compétence spécifique confiée par la loi qui obligerait à la saisir de tout projet de texte dans ce domaine. Il n’est pas forcément souhaitable de créer un précédent spécifique pour la traite et l’exploitation des êtres humains.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
L’article 225-10-1 du code pénal est abrogé.

Cette intervention sur l’article 13 ne préjuge en rien du vote que j’émettrai sur cet article. Je souhaite simplement formuler quelques interrogations à l’orée de cette discussion.
À mon sens, l’article 13 et l’article 16 auraient pu faire l’objet d’un article unique concernant la pénalisation, dans la mesure où ils sont indissociables l’un de l’autre. Ils sont même tellement indissociables que le vote préalable de l’un peut fausser le vote sur l’autre. À défaut de pouvoir les réunir dans un article unique, j’aurais souhaité que l’on puisse les examiner en même temps.
Je voudrais aussi rappeler à mes collègues que la procédure accélérée n’a pas été engagée. Autrement dit, le texte que nous examinons aujourd’hui, en navette, sera renvoyé à l’Assemblée nationale avant de revenir au Sénat ; peut-être fera-t-il même l’objet d’une commission mixte paritaire. Par conséquent, nous avons encore le temps de la réflexion. Même si parfois nous souhaitons avancer rapidement, il me semble nécessaire, sur des sujets aussi importants, de prendre le temps de la réflexion et, le cas échéant, de dialoguer avec le Gouvernement et les députés.
J’avais émis beaucoup de réserves sur l’article 13 lorsque Mme Benbassa avait déposé sa proposition de loi. À cette époque, la ministre au banc m’avait affirmé que ce sujet serait traité à nouveau dans un texte sur la prostitution. Seulement, force est de constater que nous retrouvons sur ce sujet le texte que nous avons voté ici même dans son intégralité, ce qui me chagrine un peu.
En effet, le délit de racolage tel qu’il est conçu aujourd’hui ne me paraît pas adapté. Comme cela a souvent été souligné, la mise en œuvre de ce délit de racolage a eu bien des inconvénients, et majeurs, au niveau sanitaire et social, mais aussi en ce qu’il a éloigné les prostituées notamment des associations qui sont à même de prendre contact avec elles.
Dans le texte de 2003, l’article 225-10-1 prévoit l’interdiction du racolage « par tous moyens », et c’est là que se situe le nœud du problème, puisque même une « attitude passive » serait passible de sanction.
En 2003, l’objectif était surtout d’obtenir des résultats chiffrés et de faire en sorte que les prostituées ne soient plus visibles dans un certain nombre de lieux, notamment à Paris ou dans d’autres grandes villes, ce qui a eu d’importantes conséquences sanitaires.
Aujourd’hui, l’article 13 prévoit d’abroger l’article 225-10-1 du code pénal, ce qui entraîne par là même la suppression de toute législation sur le racolage. Mais n’est-il pas nécessaire que le code pénal statue sur le racolage ? Je m’interroge à haute voix, mes chers collègues, car la question se pose.
D’autant plus que, dans toutes les auditions que nous avons menées depuis maintenant deux ans, les représentants de la Brigade de répression du proxénétisme, la BRP, et ceux de l’Office central pour la répression de la traite des êtres humains, l’OCRET, ainsi qu’un certain nombre de magistrats, ont insisté systématiquement sur le fait que le délit de racolage est un moyen pour eux de lutter contre les réseaux et d’obtenir des informations pour pouvoir remonter ensuite un certain nombre de filières. Par conséquent, il semble nécessaire de le maintenir.
On nous a dit aussi que le délit de racolage permet parfois d’avoir un contact avec des personnes prostituées qui viennent de pays étrangers, notamment du Nigeria, même si le contexte de la garde à vue n’est malheureusement pas très agréable. Les personnes prostituées ont souvent tellement peur de l’uniforme, de tout ce qui représente l’ordre en général, parce qu’elles ont subi tellement de violence au cours de leur trajet pour venir en France de ces mêmes représentants de l’ordre, qu’elles ne prendront jamais directement contact avec les institutions. Voilà pourquoi une suppression totale du délit de racolage m’interpelle.
Je pense donc qu’une réflexion plus profonde est nécessaire sur ce point, voire une réécriture de l’article. De la même manière, je vous proposerai plus loin une rédaction différente de l’article 16 qui pourrait satisfaire un certain nombre de nos collègues.
Je suis donc tenté de m’abstenir sur ce texte, pour la raison que je viens de vous donner, et parce que je ne peux pas m’engager sur l’article 13 tant que je ne connais pas le vote du Sénat sur l’article 16.

Contrairement à mon collègue, je pense qu’il est extrêmement important de faire en sorte qu’il n’y ait plus de délit de racolage et donc de sanction à ce titre.
Je suis inquiète quant au sort réservé à cet article, dans la mesure où la commission spéciale a émis un avis favorable sur l’amendement de M. Jean-Pierre Vial.
La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, plus connue sous le nom de « loi Sarkozy », a renforcé la répression de la prostitution. La création du délit de racolage passif avait pour objectif, il faut le redire, de maintenir la tranquillité publique en limitant la visibilité des activités de prostitution.
Douze ans après, nous devons examiner les éléments qui nous permettent de faire le bilan de cette loi.
L’objectif était double : limiter la prostitution « de rue » et atteindre les proxénètes à travers les quelque 80 000 prostituées vivant en France, ces dernières, comme vient de la rappeler notre collègue, étant susceptibles de livrer des renseignements lors de leur interpellation.
Or, si des informations peuvent être effectivement obtenues lors des gardes à vue, la corrélation entre la création du délit de racolage et une plus forte répression du proxénétisme semble inexistante. Le Casier judiciaire national constate ainsi une évolution plutôt stable du nombre de condamnations des proxénètes au cours des dix dernières années, entre 600 et 800 par an, alors qu’il enregistre des fluctuations beaucoup plus importantes en ce qui concerne les gardes à vues pour racolage.
Même au plus haut du nombre de gardes à vue pour racolage passif – 4 712 en 2004 – les gardes à vue pour proxénétisme plafonnent à moins de 1 000. L’objectif principal de la création de ce délit semble donc caduc : l’incrimination du racolage ne permet pas de démanteler un réseau.
De plus, cela a contribué à déplacer la prostitution et à fragiliser encore davantage les prostituées, qui plus est en les criminalisant. Sans parler bien évidemment du caractère discutable et flou de la définition même du racolage.
Le bilan est donc plus que mitigé. Nous avons eu l’occasion de le constater encore avec le rapport de notre collègue Virginie Klès, lors de l’examen de la proposition de loi d’Esther Benbassa.
La suppression du délit de racolage est attendue par l’immense majorité des associations. Elle a aussi fait l’objet d’une recommandation de la CNCDH, selon laquelle « la convention de 2005 comme le droit pénal français prévoient que les victimes de traite ou d’exploitation doivent être exonérées de responsabilité pénale dès lors qu’elles ont adopté un comportement illicite sous la contrainte ». La CNCDH rappelle avec raison que « les victimes de traite ou d’exploitation contraintes à commettre des crimes ou des délits doivent être considérées avant tout comme des victimes de délinquance forcée et doivent être exonérées de responsabilité pénale pour avoir commis de tels faits. »
Mes chers collègues, il est très important de prendre cela en compte et, si nous rétablissions le délit de racolage, ce serait un très mauvais signal, totalement contraire à la proposition de loi, qui vise notamment à accompagner les prostituées pour les aider à sortir de ce système prostitutionnel.
Je ne comprends pas bien pourquoi l’article 13 et l’article 16 sont mis en corrélation. Je pense qu’il nous faut poser le problème du système prostitutionnel dans sa globalité et, exerçant notre libre choix, décider que les prostituées ne sont pas des criminels, qu’elles ne sont pas à pénaliser et qu’il faut au contraire poursuivre les réseaux et responsabiliser les clients.
Ce débat abolition/prohibition est malvenu dans le contexte de cette proposition de loi, j’en profite pour le dire.
Pour conclure, je reprendrai ici les propos de Grégoire Théry, secrétaire général du Mouvement du nid, association bien connue qui accompagne les personnes prostituées dans leurs démarches : « Si le Sénat prend la décision de mesures de répression contre les prostituées et parallèlement d’impunité pour les auteurs d’achats d’actes sexuels, il aura travaillé seize mois pour revenir dix ans en arrière ! »
J’en appelle donc à votre réflexion, mes chers collègues.

À la suite de mes collègues, je veux rappeler que, il y a deux ans presque jour pour jour, notre Haute Assemblée adoptait, à l’unanimité, la proposition de loi visant à l’abrogation du délit de racolage public que je défendais au nom du groupe écologiste.
Il ne s’agissait pas d’une proposition de gauchiste écervelée, mais bien d’une mesure à la fois humaniste et pragmatique.
Supprimer le délit de racolage ne fait pas courir le risque d’une perte notable d’informations sur les réseaux. Nous avions déjà débattu de cette question en 2013, mais il ne semble pas inutile de rappeler certains chiffres.
Les infractions de proxénétisme non aggravé font l’objet d’un nombre de condamnations stable depuis 1995, soit autour de 400 condamnations par an. Depuis 2003, entre 600 et 800 infractions de proxénétisme aggravé sont enregistrées chaque année au Casier judiciaire national.
Or ce chiffre n’a pas été affecté par la baisse du nombre de faits passibles de poursuites pour racolage, qui a chuté de 1 030 en 2003 à 815 en 2011. L’instauration du délit de racolage n’a donc pas rendu la traque des proxénètes plus efficace.
En revanche, et ce point fait consensus, les conséquences de la loi de 2003 ont été terribles pour les personnes prostituées : dégradation de leur état de santé et des conditions de pratique de la prostitution, augmentation de l’isolement et de la clandestinité, elle-même propice à la multiplication des violences.
De surcroît, on a assisté à un développement de la prostitution « indoor » – en appartement, dans les hôtels, bars, salons de massage, sur internet –, facteur d’isolement et de vulnérabilité supplémentaires, et qui coupe les personnes prostituées des associations de prévention et d’aide.
Il est tout bonnement impensable, mes chers collègues, de rétablir le délit de racolage public qui aura, en douze ans d’existence, fait toute la preuve de son inutilité en matière de lutte contre les réseaux et de sa dangerosité pour les personnes prostituées.

L’amendement de suppression de l’article 13 répond à une logique de sanction des victimes, qui se voient ainsi infliger une double peine.
Le délit de racolage passif, en vigueur depuis plus de douze ans maintenant, n’a cessé de montrer ses limites et son caractère paradoxal.
Il a été créé dans le but, à l’époque, de lutter contre la visibilité de la prostitution de rue – cela ne faisait pas bien ! – et relevait d’une logique sécuritaire et du souci de la tranquillité publique.
Les pratiques décrites par les policiers et les magistrats entendus lors des auditions ne sont pas homogènes sur l’ensemble du territoire national, de sorte que les victimes de ce délit de racolage peuvent être jugées et même condamnées. Elles sont donc considérées comme coupables et menacées de poursuites.
Je rappelle que ce retour au délit de racolage est contraire à la CEDAW, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi qu’à la Convention de Varsovie relative à la lutte contre la traite des êtres humains, conventions que la France a signées et qui posent comme exigence que les personnes prostituées ne soient pas doublement victimes, et de la situation que leur imposent les trafiquants, et de la pénalisation de leur activité.
Je suis donc d’accord avec les précédents intervenants et, en conséquence, je ne voterai pas cet amendement.

Je commencerai par un bref rappel historique.
En 1946, la loi Marthe Richard a imposé la fermeture des maisons closes et a également fait du racolage un délit passible de peines correctionnelles.
En 1958, ces peines correctionnelles ont été supprimées au profit de simples contraventions. Ainsi, pendant des décennies, le racolage en France était passible d’une contravention.
Puis, en 2003, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’intérieur, dans le but de rendre la prostitution moins visible, mais aussi de lutter contre les réseaux de prostitution, a poussé à l’instauration du délit de racolage passif.
Cette décision de 2003 revêt donc deux aspects : non seulement on crée un délit passible d’une peine de prison de deux mois maximum – il n’est plus question de simples contraventions –, mais en plus on introduit cette notion de « racolage passif », qui tient quand même beaucoup de l’oxymore - d’ailleurs, la Cour de cassation a bien du mal à interpréter le sens de cette expression.
C’est pourquoi, à mon sens, il ne faut en aucun cas revenir au dispositif de 2003, à la fois parce qu’on crée un délit passible d’une peine de prison, sanction bien trop lourde, et parce que cette idée de « racolage passif » ne veut rien dire.
Qui plus est, en douze ans, on a bien vu que cette mesure était complètement inefficace : elle n’a absolument pas permis de lutter contre la prostitution ni contre les réseaux. Peut-être a-t-elle rendu, dans quelques agglomérations, la prostitution moins visible en centre-ville, mais, dans ces cas-là, elle n’a fait que la déplacer vers la périphérie.

Le bilan de ce qui était présenté en 2003 comme la solution miracle est donc extrêmement léger.
C’est pourquoi, comme les précédents orateurs, je crois qu’il ne faut surtout pas revenir au système mis en place par Nicolas Sarkozy.
Cela étant, comme l’a proposé notre collègue Jean-Pierre Godefroy, ne pourrait-on pas envisager un retour à la situation d’avant 2003, afin de parvenir à un équilibre entre le client, d’une part, qui peut déjà écoper d’une amende, et la prostituée se livrant à un racolage agressif, d’autre part, qui, à ce titre, pourrait également être punie d’une amende ? C’est un débat qui pourra avoir lieu dans la suite de la navette.
Quoi qu’il en soit, rétablir le délit instauré en 2003, dont tous les professionnels s’accordent à dire qu’il n’a pas été efficace, est inacceptable et serait contre-productif. Comme l’a souligné notre collègue Laurence Cohen, le Mouvement du nid a bien expliqué la situation : si le Sénat devait maintenir ce délit de racolage passif et, en plus, renoncer à pénaliser le client, il n’aurait rien changé, il aurait maintenu le statu quo sans ajouter la moindre efficacité à la lutte contre le système prostitutionnel.

Je veux simplement indiquer que deux rapports, publiés respectivement par l’Inspection générale des affaires sociales, en 2012, et par le Conseil national du sida et des hépatites virales en 2010, pointent de graves difficultés d’accès aux soins pour les personnes prostituées du fait de leur méfiance envers les administrations et de leur crainte d’être jugées en raison de leur activité professionnelle.
C’est un autre argument en faveur de l’abrogation du délit de racolage : elle faciliterait l’accès aux soins des personnes prostituées.

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Vial et Pillet, Mme Deroche, MM. Grosdidier, Courtois et Gournac, Mmes Kammermann et Troendlé et MM. Buffet et B. Fournier, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Christiane Kammermann.

L'auteur de cet amendement est opposé à la suppression du délit de racolage institué dans la loi pour la sécurité intérieure de 2003, suppression qui fait courir le risque d'une perte notable d'informations sur les réseaux.

La commission spéciale a beaucoup débattu de cet amendement.
À titre personnel, j’estime que, dix ans après l’entrée en vigueur de la loi pour la sécurité intérieure, le délit de racolage a aggravé la situation des personnes prostituées, tandis que les objectifs du législateur de 2003 n’ont été que très partiellement atteints, et je partage sur ces deux points les arguments développés par mes collègues.
Par ailleurs, du seul point de vue du droit, l’utilisation actuelle du délit de racolage n’est pas satisfaisante et constitue un détournement des règles de la garde à vue. Les personnes prostituées, quand il s’agit de lutter contre le proxénétisme, ne devraient être entendues que sous le statut de témoin.
En outre, je rappelle que l’abrogation du délit de racolage ne laisse pas les pouvoirs publics démunis face aux troubles à l’ordre public parfois suscités par la prostitution : les maires peuvent notamment, au titre de leurs pouvoirs de police générale, prendre des arrêtés municipaux interdisant ou restreignant la présence de personnes prostituées sur la voie publique, là où cette présence est susceptible de créer des troubles.
Toutefois, la majorité de la commission spéciale a estimé qu’il était préférable de maintenir ce délit de racolage afin de laisser à la police un outil qu’elle juge nécessaire.
L’avis de la commission spéciale est donc favorable.
Je souhaiterais répondre à quelques interrogations qui se sont exprimées depuis le début de la discussion de cet article.
D’abord, oui, il est difficile, lorsque l’on est considérée comme une délinquante, d’aller vers celles et ceux qui peuvent vous apporter de l’aide. Mais c’est encore plus difficile, lorsqu’on est à la fois en situation de grave danger et aussi, statutairement, une délinquante, de franchir la porte d’un commissariat.
Mmes Maryvonne Blondin, Claudine Lepage et Marie-Pierre Monier acquiescent.
Donc, oui, c’est extrêmement difficile, et ce statut ne permet nullement d’assurer la protection des personnes prostituées. C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Ce n’est toutefois pas la seule raison.
Je peux comprendre l’inquiétude qui s’est exprimée dans la discussion générale concernant les troubles à l’ordre public, mais des textes permettent déjà aux maires d’agir.
L’article 222-32 du code pénal punit « l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public » ; l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales permet à la police municipale de réprimer les atteintes à la tranquillité publique et les pouvoirs de police générale du maire lui permettent de prendre des arrêtés municipaux afin d’interdire ou de restreindre la prostitution sur la voie publique.
Il existe donc déjà des outils. En revanche, supprimer le délit de racolage permettrait aux personnes prostituées, de délinquantes, de devenir des victimes, …
… ce qui permettrait aux associations d’accompagner ces personnes dans de meilleures conditions et de les aider à sortir de la prostitution.
Je rejoins d’ailleurs les propos de Mme Benbassa : les propositions qu’elle a défendues en 2013 et qui ont été adoptées par le Sénat permettront à la fois de protéger les personnes prostituées, de les accompagner, mais aussi de donner des moyens supplémentaires à la police pour démanteler les réseaux.
Il existe en effet une corrélation entre ces deux objectifs : être efficace dans la lutte contre les réseaux et, en même temps, favoriser l’accompagnement sanitaire et social des personnes prostituées, ce qui est votre souhait à tous.
Je vous invite donc, mesdames, messieurs les sénateurs, à voter contre cet amendement si vous voulez que nous disposions réellement des outils pour lutter contre ces réseaux et aussi permettre à ces personnes de choisir une autre vie au lieu de subir le quasi-esclavage dans lequel on les maintient.

Cet amendement vise à supprimer l’article 13 et donc à réintroduire la pénalisation des prostituées.
Tout ça pour ça ? C’est la première phrase qui me vient à l’esprit !
Pourtant, je pense avant tout au devoir de responsabilité des législateurs : en décembre 2011, l’Assemblée nationale adoptait à l’unanimité la proposition de résolution réaffirmant la position abolitionniste de la France.
Le 28 mars 2013, c’était au tour de la proposition de loi de Mme Benbassa d’être adoptée par le Sénat. Ce texte d’abrogation du délit de racolage se fondait sur le double constat de l’absence de contribution significative de ce délit à la lutte contre les réseaux de proxénétisme et de la stigmatisation et de la précarisation des personnes prostituées que sa création avait entraînées.
En décembre 2013, l’Assemblée nationale, en adoptant le texte que nous examinons aujourd’hui, renouvelait cette position abolitionniste.
Cet amendement représente donc un coup d’arrêt à la possible amélioration des conditions de vie des personnes qui se prostituent. C’est bien cette mesure qui les met en danger, les condamnant à la clandestinité et à l’isolement, en les éloignant, cela a été dit, des structures de prévention et de soins.
Comment à la fois reconnaître que la prostitution est une violence et traiter les personnes prostituées comme des délinquantes, et non comme des victimes que la société doit protéger et accompagner, ce qui permettrait d’instaurer un lien de confiance avec elles ?
Comment laisser perdurer cette mesure inique en dépit de la quasi-unanimité recueillie par l’annonce de la suppression du délit de racolage passif ? Je pense, par exemple, aux personnes qui se prostituent, aux associations qui travaillent à leur côté, aux élus et à nombre d’institutions sociales et sanitaires, mais aussi aux rapports de l’Inspection générale des affaires sociales, de 2011, du Conseil national du sida, et de la Commission nationale consultative des droits de l’homme.
Comment poursuivre dans cette voie, alors que cette disposition a démontré son inefficacité en un peu plus de dix années d’application ? La proportion de prostituées étrangères a explosé, les réseaux sont donc de plus en plus puissants et nombreux. Christiane Taubira l’a encore souligné lors de son audition par la commission spéciale, la pertinence du délit de racolage comme outil de détection et de remontée des réseaux n’est pas avérée.
De surcroît, vous l’avez dit, madame la secrétaire d’État, deux moyens non spécifiques à la prostitution sont utilisés depuis longtemps pour limiter les troubles à l’ordre public et garantir la sécurité publique : la sanction de l’exhibition sexuelle et la possibilité pour les maires, au titre de leur pouvoir de police générale, de prendre des arrêtés municipaux interdisant ou restreignant la présence, la circulation, le stationnement de personnes prostituées sur la voie publique, là où cette présence est susceptible de créer des troubles à l’ordre public.
Au regard de tous ces éléments, le groupe socialiste votera contre le présent amendement. Je vous invite d’ailleurs, mes chers collègues, à faire de même.

Le débat que nous avons sur l’article 13, mes chers collègues, relève par moments d’une démarche schizophrène.
Madame Benbassa, vous qui évoquez la position « unanime » qu’aurait eue le Sénat sur ce sujet en 2013, je vous invite à faire preuve de plus de prudence : je vous rappelle en effet le faible nombre de sénateurs présents dans l’hémicycle le jour du vote dont vous faites mention, ainsi que les réserves qui avaient alors été exprimées. Il suffit de se rapporter au compte rendu intégral pour disposer d’éléments extrêmement précis à ce sujet.
Par ailleurs, je rejoins Jean-Pierre Godefroy quand il se demande s’il n’aurait pas été opportun de se prononcer sur les articles 13 et 16 de manière globale. La procédure est ce qu’elle est, mon cher collègue ! Cela dit, je crois que vous en conviendrez, notre débat porte bien sur les deux articles. Défendre tout à la fois l’abrogation du délit de racolage passif de l’article 13 et maintenir la suppression de l’article 16, cela reviendrait à adopter une position abolitionniste, position que je n’ai entendu personne défendre dans cet hémicycle. Nous en sommes bien conscients, mes chers collègues : c’est l’un ou l’autre.
Néanmoins, je suis assez étonné de constater qu’à la détermination manifestée pour l’abrogation du délit de racolage public répond la légèreté avec laquelle est abordée la question de la pénalisation du client.
Protestations sur les travées du groupe CRC.

Je vous suggère, mes chers collègues, de vous rapporter aux propos tenus sur ce sujet par une personne qui devrait faire consensus dans cet hémicycle : Robert Badinter.

Je n’ai pas dit que ses propos devaient faire l’unanimité, chère collègue. Il s’agit seulement d’un avis éclairé, tenu par un ancien membre éminent de cette chambre.

Je respecte d’ailleurs le vôtre, ma chère collègue, mais permettez que d’autres en aient aussi ! Celui dont je parle n’est d’ailleurs pas seulement éclairé, il est motivé.

Pour ce qui est de l’efficacité, Robert Badinter a montré la fragilité d’un tel dispositif. Du point de vue de la légalité, dont je ne pense pas qu’une assemblée comme la nôtre puisse faire fi, Robert Badinter évoque la position de la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH, pour démontrer, là encore, sa fragilité. On peut considérer que les questions posées par un ancien président du Conseil constitutionnel ont du sens, et s’interroger, avec lui, sur la constitutionnalité du dispositif.
La pénalisation du client pose donc un vrai problème. Tout le monde – en tout cas, les professionnels – en convient, l’infraction introduite par l’article 16 serait, vous l’avez plusieurs fois souligné, madame la secrétaire d’État, une contravention de cinquième classe. Peut-on sérieusement prétendre que les réseaux, les organisations mafieuses, les personnes rompues aux arsenaux juridiques, judiciaires et policiers seront le moins du monde émus par la création d’une telle contravention ?
Nous devons être la risée de ces personnes que nous prétendons ainsi bousculer, si elles nous regardent !
Vous l’avez souligné, madame la secrétaire d’État, 97 % des prostituées sont étrangères, ce qui témoigne de la puissance des réseaux, dont certains sont même mafieux. Il est donc nécessaire de s’armer contre ce fléau.
J’en viens au délit de racolage, dont je suis le premier à considérer qu’il n’est pas parfait en soi. Jean-Pierre Godefroy l’a dit, n’étant pas examiné en procédure accélérée, le présent texte fera l’objet d’une navette. À voir la précipitation avec laquelle l’Assemblée nationale s’est prononcée pour l’abrogation de ce délit, je me demande si le rétablir ne constituerait pas une interpellation forte, obligeant à se poser les vraies questions, si l’on veut effectivement perturber les réseaux et remonter les filières.
Or une question fait l’unanimité : il s’agit non pas tant de savoir s’il faut pénaliser ou non les prostituées – cela n’est, je crois, la volonté de personne –, mais bien de pouvoir remonter les réseaux.
Mais cela supposerait une réelle volonté politique, afin que les forces de l’ordre puissent entrer en voie d’action et les magistrats en voie de sanction. Combien de fois, quand on les interroge, les policiers et les gendarmes nous confient devoir mobiliser leurs forces pour constituer des dossiers qui, pourtant, n’aboutissent que très rarement ! Par « dossier », j’entends la contravention de cinquième classe pour la pénalisation du client ou le délit de racolage.
L’état actuel du droit contraint donc les forces de l’ordre à établir des filatures qui peuvent les mener à l’exhibitionnisme. Pour que le dossier puisse aboutir, elles sont donc obligées de tordre le droit !
Allons encore plus loin, mes chers collègues. Les forces de l’ordre nous expliquent que, pour remonter une filière de prostitution, il faudrait pouvoir remonter tout le réseau. Or cette chaîne compte des maillons qui, en réalité, sont des fusibles ! Une personne mettant à disposition un véhicule ou des moyens de liaison, par exemple, n’est pas poursuivie.
Je rejoins donc Jean-Pierre Godefroy sur ce point, ce texte profitera – espérons-le – de la navette parlementaire pour être enrichi. Même la question du délit de racolage peut être approfondie, complétée.
Si le groupe UMP dépose cet amendement tendant à rétablir le délit de racolage, c’est que, sans lui, je vous le dis très sincèrement, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous adopterions un texte en état d’apesanteur.
Applaudissements sur certaines travées de l'UMP.

Tout le monde, je crois, partage l’objectif d’un texte efficace. Il me semble, monsieur le président de la commission spéciale, qu’il n’y a aucune « légèreté » dans nos débats, ni sur le délit de racolage ni sur la pénalisation des clients. M. Badinter s’est peut-être exprimé sur le sujet, mais bien d’autres personnes tout aussi sérieuses – des médecins par exemple, qui, comme M. Emmanuelli, sont sur le terrain – l’ont fait en faveur de la pénalisation.
Manifestement, les réseaux ne sont pas non plus très émus par le délit de racolage. Si la pénalisation devait être finalement votée, c’est pour « émouvoir » non pas tant les réseaux que les clients, monsieur le président de la commission spéciale. Tarir la demande, en effet, c’est lutter contre les réseaux.
Je voudrais revenir sur les dispositions de la loi de 2003 pour la sécurité intérieure ; j’ai en effet eu la chance, à l’époque, d’être la plume des discours de son promoteur. Honnêtement, chacun prête aujourd’hui à cette loi des intentions qu’elle n’avait pas alors. La loi de 2003 avait pour objet de supprimer la distinction entre le délit de racolage passif et le délit de racolage actif, distinction qui, sur le terrain, n’avait pas beaucoup d’efficacité.
Cette loi était adaptée à la réalité de la prostitution d’alors, qui était majoritairement le fait de femmes françaises, dont la plupart n’étaient pas nécessairement sous l’emprise de réseaux.
La situation a radicalement changé. La loi a donc, aujourd’hui, des effets pervers.
Elle oblige d’abord les personnes prostituées à se cacher ; elles se trouvent donc plus aisément sous l’emprise des réseaux, ce qui rend la tâche des différentes associations du secteur plus délicate.
J’indique, ensuite, qu’il faut du temps pour avoir confiance dans les institutions. Un dispositif qui autorise la personne à s’évader de ces réseaux et à entrer dans un parcours d’insertion crée un tel lien de confiance ; ce lien permettra sans doute de faire parler les personnes prostituées, de les amener à témoigner contre leur proxénète. Ce n’est pas dans le délai très contraint d’une garde à vue que nous gagnerons la confiance de ces personnes, et que nous aurons leur témoignage.
Nous sommes donc confrontés à un problème. Ne nous voilons pas la face, mes chers collègues, nous nous orientons vers le maintien de la suppression de la pénalisation du client. Si, dans le même temps, le présent texte ne contient plus aucune disposition sur le racolage, on ouvre beaucoup de portes.

Étant personnellement favorable à la pénalisation du client, ainsi qu’à l’inversion de la charge de la preuve, je ne peux pas voter pour le rétablissement du délit de racolage. Le rapport que j’ai rédigé, le discours que je viens de tenir, montrent que je ne peux m’inscrire dans cette logique.
Il est néanmoins évident qu’adopter un texte qui ne rétablisse ni le délit de racolage ni la pénalisation du client reviendrait à faire un très beau cadeau aux réseaux.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

À ce moment de l’examen du texte, nos débats portent sur la question du racolage passif, mais ils commencent aussi, c’est bien naturel, à faire le lien avec celle, que nous savons complexe, de la pénalisation des clients.
Nous voulions que cette proposition de loi revête une dimension éducative très forte, et ce afin de travailler à une prise de conscience dans la société. Il s’agissait de faire reconnaître que la prostitution est une violence qui s’inscrit dans un continuum beaucoup plus large de violences faites aux femmes. En cela, cette question a bien à voir avec l’égalité entre les hommes et les femmes.
L’une des grandes forces du texte issu des travaux de l’Assemblée nationale était de faire reposer cette prise de conscience dans la société sur quatre piliers fondamentaux. La disparition d’un seul de ces piliers remettrait en cause tout l’exercice pédagogique que nous voulons conduire.
Le premier pilier, c’est la suppression du délit de racolage passif. Nous voulons faire reconnaître que ces femmes qui exercent la prostitution sont d’abord des victimes. Ce statut doit leur être reconnu, si l’on veut lutter contre leur fragilisation.
Le deuxième pilier est révolutionnaire : il s’agit, pour la première fois, de poser le principe d’un parcours de sortie de la prostitution, axé naturellement sur la formation, qui sera absolument nécessaire, sur la professionnalisation et l’accès à l’emploi, mais, plus largement, aussi sur un parcours de santé, afin que ces femmes puissent retrouver l’équilibre dont elles sont aujourd’hui privées.
Combien de femmes prostituées, y compris parmi celles qui affirment le faire « par choix », nous ont avoué qu’elles avaient perdu l’estime d’elles-mêmes ?
Troisième pilier, le parcours de sortie, dont nous savons qu’il s’agira nécessairement d’un processus long, aura besoin de financements.
Quatrième pilier, sans lequel l’ensemble n’aurait aucun sens, il faut pénaliser l’achat de services ou d’actes sexuels ! Il serait absurde de rétablir le racolage passif, ce qui revient à considérer la prostituée comme une délinquante, sans reconnaître que, s’il y a prostitution, c’est bien qu’il y a des acheteurs !
C’est sur ces quatre volets qu’il faut agir. À défaut, nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs : faire reconnaître que la prostitution est une violence aussi vieille que le monde !
Très bien ! sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
Je souhaite rappeler quelques éléments à M. le président de la commission spéciale, qui a invoqué l’argument de la « constitutionnalité ».
D’une part, le Parlement européen a adopté une résolution soulignant que les personnes prostituées ne devaient pas « être considérées comme des criminelles » et appelant tous les États membres à « abroger la législation répressive contre les personnes prostituées ».
D’autre part, le Conseil de l’Europe a également exhorté les États membres et observateurs à « envisager la criminalisation de l’achat de services sexuels, fondée sur le modèle suédois, en tant qu’outil le plus efficace pour prévenir et lutter contre la traite des êtres humains ».
Certes, il y a un débat sur le fond. Mais, monsieur le président de la commission spéciale, vous ne pouvez pas affirmer, en vous fondant sur une déclaration qui n’était d’ailleurs pas liée à ce débat, que les deux dispositions en question seraient inconstitutionnelles !
En l’occurrence, la discussion ne porte sur la liberté de disposer de son corps, qui est au demeurant limitée : on ne peut pas vendre ses organes !
En effet, madame la sénatrice.
Je pourrais également faire référence à la procréation. Aujourd’hui, dans notre pays, on ne peut pas avoir recours à certaines pratiques, même de manière provisoire et encadrée !
Monsieur le président de la commission spéciale, vous avez le droit de ne pas être d’accord, vous pouvez vous opposer aux mesures que nous prônons, mais vous ne pouvez pas prétendre qu’elles seraient inconstitutionnelles.

Je ne fais pas partie de la commission spéciale, mais il s’agit évidemment d’un sujet qui m’interpelle.
Que voulons-nous, mes chers collègues ? Nous opposons en permanence la pénalisation des utilisateurs à celle des prostituées. Ne pourrions-nous pas aller un peu plus loin ? Nous sommes des parlementaires ! Nous la voulons, cette abolition ! La prostitution, c’est l’esclavage, la violence la plus inhumaine qui soit !
Comment faire ? Abolir le délit de racolage, ce serait effectivement retirer aux forces de police la possibilité d’identifier les prostituées et, peut-être, de les aider à sortir de cet engrenage infernal.
Exclamations sur quelques travées du groupe socialiste.

Bien entendu, il faut un parcours de sortie ; Mme la secrétaire d’État y a fait référence. Mais, pour aider ces femmes, il faut d’abord les identifier !
Aussi, je suis désolée, mais je ne suis pas pour la suppression du délit de racolage. Je pense que ce dispositif est un outil, certes insuffisant, peut-être mal adapté, mais nécessaire pour identifier ces femmes, qui sont effectivement des victimes. D’ailleurs, il n’y a pas de contradiction ; ce n’est pas parce qu’une femme sera conduite au poste de police pour racolage qu’elle ne sera pas une victime ! Les deux éléments peuvent être indépendants.
Au demeurant, selon une étude réalisée en 2014 par des universitaires britanniques – il ne me semble pas qu’elle ait été mentionnée dans cet hémicycle –, 98 % des prostituées sont hostiles à la pénalisation des clients, qui, selon elles, leur causerait une perte de revenus et les rendrait encore plus vulnérables.
S’il fallait choisir entre les deux mesures, j’opterais pour la pénalisation du client. Mais, en conscience, je préférerais voter à la fois contre la suppression du délit de racolage et pour la pénalisation des clients.
Je crois qu’il faut vraiment sortir de la situation actuelle. J’ai l’impression que nous tournons en rond depuis des années. Tout se passe comme si c’était un crime d’envisager que la prostitution puisse un jour devenir illégale et que nous puissions un jour enfin sauver les victimes – car ce sont bien des victimes ! – de la prostitution.
Et pardon si je ne suis pas consensuelle !

Je rappelle que, intervenant sur l’article, je me suis prononcé pour une modification de l’article 225-10-1 du code pénal.
Je suis tout à fait favorable à la suppression du délit de racolage passif. Simplement, l’article 13 ne supprime pas seulement le délit de racolage passif ; il supprime le délit de racolage tout court !
Aujourd'hui, il y a le racolage qui se voit, par exemple dans la rue, mais, si on supprime totalement le délit de racolage, tous les moyens seront bons : internet, petites annonces, distributions de tracts, appels téléphoniques…
À mon sens, pour éviter que les personnes prostituées, c'est-à-dire les victimes, ne soient sanctionnées alors qu’elles ne le méritent pas – c’est bien notre objectif –, il suffit de modifier la rédaction de l’article 225-10-1 du code pénal, en retirant les mots : « y compris par une attitude même passive, ». Car c’est bien là qu’est le nœud du problème.
Si l’article 225-10-1 est supprimé, il n’y aura plus aucune disposition sur le racolage actif dans le code pénal.
Mais si ! J’ai répondu sur ce point !

J’ai bien entendu vos propos, madame la secrétaire d’État. Mais je souhaite bien du plaisir aux personnes qui seront chargées de vérifier ce qui relève de « l’exhibitionnisme » ou de « l’atteinte aux bonnes mœurs » : cela ne va pas forcément de soi !
Quant aux arrêtés des maires, ils concerneront essentiellement le stationnement ou l’interdiction sur certains lieux précis. Les maires ne pourront pas prononcer d’interdiction générale sur tout un territoire ; ce serait presque du réglementarisme.
Dans le même temps, le racolage sera complètement libre !
C'est le sens de mon interpellation. Ma conviction profonde, c’est qu’il ne faut surtout pas pénaliser les personnes prostituées. Certes, dans les faits, la distinction n’est pas toujours aussi nette. Il y a une hiérarchie parmi les personnes qui se prostituent ; certaines sont victimes, quand d’autres sont à la fois victimes et exploiteuses. Tout n’est pas tout blanc !
Je ne voterai pas le rétablissement de l’article 225-10-1 dans sa rédaction actuelle, mais je pense que ce serait une erreur de supprimer toute référence au racolage dans le code pénal. À mon avis, nous devrions profiter de la navette pour réécrire le dispositif.
À cet égard, si nous optons pour un vote conforme sur les articles 13 et 16 de la proposition de loi, ils ne reviendront plus en discussion ; c’est le principe de l’entonnoir. Or la question du racolage mérite plus ample réflexion. Il y a sans doute besoin d’une rédaction plus cohérente. Il ne faut évidemment pas pénaliser les prostituées, qui sont des victimes. En revanche, il faut garder dans notre arsenal pénal des instruments de lutte contre le racolage, qui peut être actif, sous toutes ses formes.
Aujourd'hui, il est déjà très difficile, même avec les dispositions en vigueur, de faire condamner les personnes qui lancent certains types de messages sur internet. Avec la suppression du délit de racolage, cela deviendrait tout bonnement impossible !
Entendons-nous bien : mon propos n’est pas de casser la logique de la présente proposition de loi. Mais, encore une fois, je pense que c’est une faute de retirer toute référence au racolage dans le code pénal.

Outre la difficulté que j’ai évoquée précédemment, je suis troublée de constater combien la Haute Assemblée insiste sur tous les aspects positifs qu’il y aurait à maintenir le délit de racolage. En revanche, quand il s’agit de la pénalisation des clients, le président de la commission, notamment, parle de « légèreté » et notre assemblée ne creuse pas la question plus avant. Il y a donc deux poids, deux mesures !
Le Sénat s’accroche à une disposition qui n’a pas prouvé son efficacité – je l’ai dit dans mon propos liminaire, comme plusieurs de mes collègues – sans davantage réfléchir à la manière de faire reculer la prostitution, et donc de l’abolir.
Comme l’a souligné très justement Brigitte Gonthier-Maurin, ce texte repose sur quatre piliers. Pourtant, dès que l’on cherche à explorer des pistes importantes, les réactions sont tout à fait disproportionnées. On évoque tels et tels obstacles, qui semblent majeurs. Par exemple, il ne peut être question de s’attaquer au client. Pourquoi ? Mystère… Ce serait peut-être un crime de lèse-majesté ? Mais si les uns et les autres évoquent des motifs divers, on voit que se reforme une coalition pour que l’on ne touche pas au client. Est-ce à dire que le client est totalement irresponsable et hors du système prostitutionnel ? Tout tend pourtant à prouver le contraire !
Certains disent vouloir s’attaquer aux réseaux de proxénétisme, mais tout cela n’est qu’incantatoire. La proposition de loi ouvre un chemin, et un chemin important. Mais si vous vous accordez à reconnaître ici, la main sur le cœur, l’air extrêmement touché, que les prostituées sont des victimes, chers collègues, vous n’hésitez pas à emprunter le chemin traditionnel de la criminalisation et à pénaliser ces « pauvres femmes », comme vous dites non sans une certaine suffisance !
Au bout du compte, ce texte aura des répercussions extrêmement graves, car il va à l’encontre du projet gouvernemental et constituera pour le coup un appel d’air pour les clients comme pour les réseaux de proxénétisme, lesquels pourront continuer leur trafic allègrement.
Contrairement à ce que vous affirmez, quand vous défendez au Sénat le rétablissement du délit de racolage, vous déniez aux prostituées leur qualité de victimes. Tout le travail de réinsertion s’en trouve laminé. Or les spécialistes – non pas Robert Badinter, mais des psychologues et des psychanalystes – s’accordent à dire que, pour qu’une victime se reconstruise, il faut qu’elle soit reconnue comme telle et donc que l’on sorte du déni.
Aujourd'hui, le Sénat piétine des principes essentiels, au nom de je ne sais quelle certitude fondée sur des images préconçues, pour mieux éviter de considérer la prostitution pour ce qu’elle est, c’est-à-dire une violence !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Je serai brève, car Laurence Cohen vient de résumer ma pensée.
Nous nous sommes beaucoup focalisés ces derniers mois sur les articles 16 et 17. J’en veux pour preuve le fait que la commission spéciale n’est pas revenue, au mois de juillet dernier, sur l’abrogation prévue à l’article 13. Or il est brutalement proposé ici de supprimer cet article. C’est une erreur, qui vide la proposition de loi de toute sa philosophie.
Il s’agissait d’élaborer un texte équilibré, ne faisant pas reposer l’entière responsabilité de la prostitution sur les seules prostituées, mais mettant en cause également les clients.
À titre personnel, je ne voterai pas cet amendement, qui vise à rétablir le délit de racolage.

Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié, tendant à supprimer l’article 13.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, Mmes et MM. les secrétaires m’informent qu’il y a lieu de procéder au pointage des votes. Cette opération prenant un certain temps, nous allons interrompre maintenant nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de M. Thierry Foucaud.