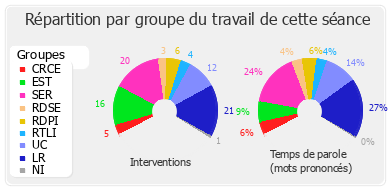Séance en hémicycle du 10 décembre 2020 à 14h30
Sommaire
- Protection patrimoniale et promotion des langues régionales
- Communication relative à deux commissions mixtes paritaires
- Préservation des biens communs pour la construction du monde d'après (voir le dossier)
- Contribution exceptionnelle sur les assurances (voir le dossier)
- Délais d'organisation des élections législatives sénatoriales et municipales partielles ainsi que des élections des membres des commissions syndicales (voir le dossier)
- Adoption des conclusions de commissions mixtes paritaires sur un projet de loi organique et un projet de loi (voir le dossier)
- Ordre du jour (voir le dossier)
La séance
La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.

La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion, à la demande du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Claude Kern.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il n’y a rien de plus politique que les batailles linguistiques, parce que la langue est le principal marqueur identitaire. Sans langue commune, point d’appartenance collective. Dans le fond, c’est peut-être pour cela que l’Europe peine à s’intégrer davantage : elle est orpheline d’une langue commune. En miroir, imposer sa langue, c’est imposer sa culture, sa vision du monde, son identité.
Telle fut la logique de la construction nationale française : pour soumettre les particularismes locaux, il fallait imposer la langue du roi. C’est tout le sens de l’ordonnance de Villers-Cotterêts par laquelle François Ier imposa le français comme seule et unique langue administrative du pays, au XVIe siècle.
Cette guerre linguistique s’est poursuivie jusqu’au XXe siècle, jusqu’aux générations dont j’ai fait partie, à qui l’on interdisait de parler leur idiome régional à l’école, et ce jusque dans la cour.
Mais, aujourd’hui, la bataille linguistique de la construction nationale est gagnée. Tellement bien gagnée, d’ailleurs, que, comme cela a été rappelé, la quasi-totalité des soixante-quinze langues régionales françaises sont en voie d’extinction.
Cela a ouvert une nouvelle bataille linguistique : celle de leur sauvetage. Maintenant, l’enjeu est patrimonial, linguistique, culturel. Les jeunes en quête d’identité sont en demande ; les anciens, dont certains parlent encore leur idiome, surtout en zone rurale, sont aussi coupés de leurs racines par ce dépérissement.
La Palice, lui-même maréchal de François Ier, le dirait « en bon françois » : les langues régionales se meurent de ne plus être parlées.
Elles ne sont plus parlées parce qu’elles ne sont plus enseignées : l’école est le nerf de la guerre linguistique de sauvegarde patrimoniale.
Rien d’étonnant à ce que toutes les lois récentes visant à protéger les langues régionales soient intervenues sur le terrain de l’éducation : la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République a posé le principe que les familles doivent être informées de l’offre d’enseignement. Elle a aussi encouragé l’accès aux enseignements de langue régionale, soit sous la forme d’un enseignement de langue et de culture régionales, soit sous celle d’un enseignement bilingue.
La loi NOTRe du 7 août 2015 a concrétisé la faculté de choix laissé aux familles, en prévoyant un système de compensation entre communes : celles qui proposent cet enseignement se voient compenser la prise en charge des enfants venant des communes qui ne l’offrent pas. La loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a élargi cette possibilité aux écoles sous contrat.
Aussi louables que soient ces initiatives, elles sont encore insuffisantes. Pour ne prendre que l’exemple de l’Alsace, celui que je connais naturellement le mieux, pour la maternelle et le primaire, seules les écoles associatives ABCM, c’est-à-dire des écoles privées, proposent un véritable enseignement en alsacien.
Même dans le supérieur, la situation n’est pas plus brillante, puisque, sur l’ensemble du cycle à l’université de Strasbourg, seuls trente étudiants sont inscrits en langue allemande, langue très proche de l’alsacien, une partie d’entre eux se destinant normalement à devenir de futurs enseignants. Or la majorité d’entre eux partent, à la fin de leur cycle, en l’Allemagne, où les salaires sont bien meilleurs.
Seul l’office pour la langue et les cultures d’Alsace et de Moselle, soutenu par le département et la région, relayés par l’intercommunalité et la commune, remédie à l’absence de pratique scolaire de l’alsacien en dispensant des cours en périscolaire ou des cours du soir pour les adultes. Mais ces efforts ne peuvent être que limités, parce que l’on ne trouve même plus d’enseignant, pour une raison que j’ai déjà évoquée.
On le voit bien, il faut aller plus loin en matière d’enseignement des langues régionales. Or l’Assemblée nationale a supprimé tout le volet éducatif de la présente proposition de loi, ce que nous regrettons. Nous soutiendrons donc les amendements tendant à rétablir l’article 3, qui pose le principe de la reconnaissance de l’enseignement des langues régionales comme matière facultative dans le cadre de l’horaire normal d’enseignement. Cet article ne fait qu’étendre à toutes les langues régionales l’article L. 312-11-1 du code de l’éducation, qui prévoit déjà que la langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse.
Mais, pour maintenir le particularisme corse, l’enseignement des autres langues régionales ne pourrait être dispensé qu’après la signature de conventions entre l’État et les régions et pourrait ne s’appliquer qu’à certains territoires ciblés.
Dans ce cadre contractuel, la langue régionale devrait être obligatoirement proposée aux élèves sans, bien sûr, être obligatoire.
De plus, un tel enseignement ne saurait se substituer aux autres ; il s’y surajouterait.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, la promotion des langues régionales est une compétence partagée des collectivités territoriales. Ces dernières ont besoin d’un cadre juridique renforcé pour mettre en œuvre cette compétence, ce que leur offrirait l’article 3.
En revanche, les autres articles du dispositif supprimé à l’Assemblée nationale iraient trop loin et pourraient ouvrir une brèche dans laquelle tous les communautarismes pourraient s’engouffrer. Nous ne soutiendrons donc pas leur rétablissement.
Hors champ éducatif, le reste du texte va dans le bon sens. L’incorporation des langues régionales dans le patrimoine immatériel va de soi, ainsi que l’inclusion parmi les trésors nationaux des biens présentant un intérêt majeur pour la connaissance des idiomes.
Enfin, loin d’être folklorique, la possibilité pour les régions de promouvoir les langues locales dans l’espace public est également un axe de mise en valeur patrimoniale non négligeable.
Vous l’aurez compris, le groupe Union Centriste votera ce texte.
Veelen dank fers züherre, un a scheener nochmedaa ! Merci beaucoup pour votre attention et bon après-midi !
Applaudissements sur les travées des groupes UC, GEST et SER, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, chère Monique, que je salue pour ce travail réalisé en un temps restreint, mes chers collègues, memestra, ar brezhoneg zo eur yezh flour : cette phrase m’accompagne depuis des années. C’était l’exclamation de l’agricultrice finistérienne chez qui j’ai effectué un stage étudiant voilà quelques décennies.
Cette phrase parle simplement de la beauté d’une langue, du lien étroit qui lie pour la vie le locuteur à sa langue maternelle. Eur yezh flour, une belle langue, même si la traduction française est un peu réductrice, flour disant aussi la douceur de la langue.
Eur yezh flour : j’ai déjà utilisé cette citation ici même voilà quelques années, mais elle est probablement plus adaptée aujourd’hui, car nous parlons bien de notre responsabilité commune pour la préservation de ce grand patrimoine qui marque nos imaginaires et nos territoires des différentes langues de France.
Après bien des combats, la révision constitutionnelle de 2008 a inscrit les langues régionales au patrimoine de la France, mais l’article 75-1 de la Constitution nécessite encore quelques précisions, de même que les langues de nos territoires doivent être inscrites dans le code du patrimoine.
C’est ce à quoi répond le texte notre collègue député Paul Molac, que je salue, adopté par l’Assemblée nationale, et que le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires est très heureux de reprendre dans le cadre de sa première niche parlementaire.
Mais, vous le savez bien, monsieur le ministre, l’avenir d’une langue passe toujours par l’école. Certes, nous n’en sommes plus à cette époque terrible où celui qui était surpris à parler breton ou occitan, surpris à parler sa langue maternelle, se retrouvait puni, chargé de corvée, jusqu’à ce qu’un autre camarade ne soit surpris à la parler.
Les témoins de ce temps deviennent moins nombreux chez nous, mais celles et ceux qui ont connu – parfois un peu plus tard – ce système en parlent toujours avec beaucoup d’émotion et bien des colères. Ils sont souvent africains, car nous avons malheureusement exporté ce système – dit en Bretagne du « symbole » – contre le wolof ou le fon dans bien des pays du continent, et il a perduré bien après les indépendances.

Mais il peut y avoir des procédés plus insidieux pour réduire le nombre d’élèves suivant un enseignement devenu souvent facultatif. Il peut, par exemple, se tapir dans la réforme du baccalauréat, qui, dans l’académie de Toulouse, s’est traduite par une baisse de 50 % des effectifs de lycéens de terminale recevant un enseignement en occitan, en seulement un an. Ce chiffre est désastreux et nécessite, monsieur le ministre, non pas de grandes déclarations la main sur le cœur sur l’importance des langues régionales, mais bien des décisions concrètes pour redonner son attractivité initiale à cet enseignement.
Monsieur le ministre, il ne devrait pas y avoir de difficulté à reconnaître une erreur d’appréciation. La licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) ne correspond pas aux besoins, elle est bien trop peu proposée ; tandis que le système langue vivante B et langue vivante C a désorienté les élèves. Il faut de toute urgence tout remettre à plat.

Nous attendons toujours votre réponse et celle du Président de la République au courrier que Paul Molac, François Alfonsi et moi-même lui avons adressé en juin dernier, au nom du collectif Pour que vivent nos langues.
Aussi, il était impossible de ne pas revenir dans cette proposition de loi sur les enjeux d’enseignement écartés du texte lors de la discussion à l’Assemblée nationale. Deux amendements répondent à ces enjeux majeurs de contractualisation avec les régions et de versement du forfait scolaire. Sur ce point, l’engagement pris par le Premier ministre Édouard Philippe lors d’un déplacement en Bretagne s’était traduit par l’adoption d’un amendement de notre ancienne collègue Maryvonne Blondin à la loi pour une école de la confiance, amendement qui semblait, à l’époque, faire consensus.
Mais la modification de sa rédaction par la commission mixte paritaire en a profondément changé la compréhension, ce qui entraîne, rien que pour la Bretagne, entre 140 et 160 contentieux entre communes, nécessitant l’intervention du préfet. Ce n’est pas raisonnable et, sauf à vouloir encombrer inutilement les services de l’État, nous espérons que vous donnerez, monsieur le ministre, un avis favorable à cet amendement dont l’adoption simplifierait bien des situations.
J’avoue aussi, monsieur le ministre – et c’est la deuxième fois que nous échangeons sur ce point dans cet hémicycle – que je reste parfois abasourdi par votre réticence – pour ne pas utiliser un mot plus fort – à l’égard de l’enseignement immersif, et ce à partir d’un argument absurde et éculé, de surcroît démenti par toutes les enquêtes pédagogiques, celui d’un risque pour l’enseignement du français.
Cet enseignement immersif n’a jamais eu d’impact sur l’enseignement du français, nous le savons, mais offre pourtant l’un des principaux espoirs de maintenir toutes ces langues de France comme langues vivantes de notre République. Bloquer son développement par la multiplication des retards de contractualisation, par exemple à Saint-Herblain, ou d’autres tracasseries administratives est, de fait, contraire à notre Constitution. Je m’inquiète encore de vos propos.
Monsieur le ministre, nous avons aujourd’hui l’occasion de faire passer un message fort de soutien à tous ceux qui se mobilisent pour ce patrimoine précieux, ce patrimoine commun. J’espère donc votre soutien aux avancées que le Sénat – en tout cas, nous le souhaitons – s’apprête à adopter collectivement.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST et sur des travées du groupe SER.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans sa décision du 15 juin 1999, le Conseil constitutionnel estimait que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires comportait plusieurs dispositions contraires à la Constitution, en particulier au regard de son article 2, qui dispose que « la langue de la République est le français ».
À la suite de la révision constitutionnelle de 2008, les langues régionales ont, enfin, obtenu une reconnaissance justifiée au sommet de notre hiérarchie des normes, étant définies par l’article 75-1 de notre Constitution comme « appartenant au patrimoine de la France ».
Pour autant, cette évolution, qui était attendue de longue date, n’a pas entraîné la ratification de la Charte européenne par la France – je le regrette –, témoignant des réticences, plus ou moins discrètes, et de la nécessité, toujours patente, de consolider et d’affermir les langues régionales dans notre droit positif.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi, qui vise à les protéger et à les promouvoir.
Alors, il y a eu des tentatives : je pense à la proposition de loi des députés socialistes adoptée en janvier 2017, dont la rapporteure était Annie Le Houerou, ici présente ; je pense aussi à la proposition de loi de Roland Courteau, qui, en 2017, avait fait adopter des mesures relatives à l’installation des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération en langue régionale.
Je suis donc d’autant plus satisfaite que l’on examine ce texte, et je remercie notre collègue Monique de Marco d’avoir repris la proposition de loi de Paul Molac, notre collègue député breton que je salue.
Cette proposition de loi a vocation à lever les freins qui empêchent de respecter et d’appliquer pleinement la lettre de notre Constitution.
C’est singulièrement le cas en matière d’enseignement, dans la mesure où l’article 34 de la loi pour une école de la confiance, qui avait suscité d’intenses débats – souvenez-vous-en ! – dans notre assemblée – je pense en particulier à Maryvonne Blondin, qui avait défendu un amendement dont la rédaction a malheureusement été modifiée par la suite –, a suscité de nombreux imbroglios administratifs.
À titre d’illustration, en région Bretagne, plus de cent cinquante demandes de médiation ont été transmises aux services de l’État, soulignant les ambiguïtés et difficultés d’application de la loi.
Quand la loi est mal comprise, c’est qu’elle est mal rédigée. Il nous revient donc de lever les incertitudes et de revenir sur les dispositions de l’article 34 : tel est le sens des amendements que nous défendrons collectivement dans cette assemblée.
En outre, la préservation et le développement des langues régionales dans notre société passent par la sécurisation juridique des usages et des pratiques qui leur sont liés. Je pense particulièrement au titre III de la proposition de loi, singulièrement à ses articles 8 et 9.
Ce dernier me tient particulièrement à cœur en tant que Bretonne, puisqu’il conforte l’utilisation de signes diacritiques dans les actes d’état civil, dont le tilde, permettant ainsi de clore un feuilleton jurisprudentiel qui pouvait « insécuriser » et limiter le recours à ces signes.
Alors, je ne dirai jamais assez que la diversité linguistique et culturelle est une richesse inestimable. Concilier aspirations universalistes et singularités humaines, c’est à cette introspection dévoilée par notre emploi des langues régionales que nous invite Mona Ozouf, que j’ai envie de citer devant vous, cet après-midi : « En chacun de nous, en effet, existe un être convaincu de la beauté et de la noblesse des valeurs universelles, séduit par l’intention d’égalité qui les anime et l’espérance d’un monde commun, mais aussi un être lié par son histoire, sa mémoire et sa tradition particulières. Il nous faut vivre tant bien que mal entre cette universalité idéale et ces particularités réelles. »
En somme, mes chers collègues, il nous faut composer et recomposer avec nos langues comme avec nos identités, certes ancrées, mais constamment en devenir. C’est à ces conditions que nous pourrons enfin résoudre ces tensions si personnelles et, pourtant, si collectives.
Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST, ainsi que sur des travées du groupe UC.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, une langue ne saurait vivre et survivre sans un statut officiel et juridique qui lui assure une existence pleine et entière. C’est essentiel.
Il existe quelque 6 500 langues utilisées à travers le monde. Celles qui disparaissent sont celles qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance officielle, légale, nationale ou régionale.
En France, les langues régionales appartiennent à notre patrimoine depuis leur inscription dans la Constitution, en 2008. Ce patrimoine est une richesse pour notre pays et pour nos territoires, mais si nous voulons le conserver, ces langues doivent être enseignées, acquises et transmises.
Loin des clichés folkloriques, les langues régionales et le multilinguisme constituent un atout, notamment pour les régions frontalières. Mon expérience d’élue de la région rhénane m’a montré que le bilinguisme est aussi un outil de coopération économique, qui offre des possibilités d’emploi pour de nombreux habitants. En effet, on compte quelque 50 000 travailleurs frontaliers du nord au sud de l’Alsace, sur les frontières allemande et suisse.
En Alsace, le nombre d’élèves, du primaire au lycée, qui fréquentent ces classes a été multiplié par deux depuis dix ans. Permettre un multilinguisme dès le plus jeune âge offre aux élèves la possibilité d’acquérir plus facilement d’autres compétences.
L’éducation nationale, d’une part, et les collectivités locales, d’autre part, sont les maillons indispensables de cette transmission linguistique et culturelle. En théorie, le dispositif d’apprentissage existe, de la maternelle à la terminale, pour les élèves qui le souhaitent. En pratique, cet enseignement se heurte à des obstacles parfois administratifs, mais le plus souvent idéologiques.
La proposition de loi de Paul Molac, que nous examinons aujourd’hui, est un bon exemple de tous ces obstacles. Les articles 3 à 7, relatifs à l’enseignement des langues régionales dans ses différentes formes, ont été supprimés à l’Assemblée nationale, vidant le texte de sa substance.
Or nous savons tous, dans cet hémicycle, que seul l’enseignement permet aux langues régionales de rester vivantes. Les restreindre à un affichage sur les noms de rue et les documents d’état civil en ferait à coup sûr des langues mortes.
Notre ambition est donc d’abord de réaffirmer le rôle du forfait scolaire comme contribution à cet enseignement. En effet, la participation financière des communes pour les établissements associatifs ou privés qui enseignent une langue régionale est nécessaire. Plusieurs amendements ont été déposés en ce sens.
Ensuite, une gestion efficace des ressources humaines, monsieur le ministre, est vraiment nécessaire. Aujourd’hui, en Alsace, nous constatons que des candidats allemands et autrichiens doivent, malgré leurs compétences reconnues, s’engager dans des démarches trop longues pour obtenir une équivalence.
En réalité, le manque d’enseignants est un faux problème. C’est la raison pour laquelle la Collectivité européenne d’Alsace se propose légitimement d’organiser la formation et le recrutement des enseignants au plus près de nos besoins en frontière.
Concernant l’enseignement immersif, il existe aussi des malentendus et des incompréhensions qu’il faut éclaircir. Ce sera l’objet de mon amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 2 bis.
Sans le volontarisme de certains élus et la détermination des réseaux d’écoles associatives, l’enseignement des programmes en breton, en basque, en occitan, en catalan ou en alsacien aurait disparu, alors qu’il attire chaque année de plus en plus d’élèves.
Au Sénat, plusieurs groupes politiques partagent la même ambition et les mêmes objectifs au-delà des alliances partisanes. Je m’en félicite.
Cette proposition de loi nous donne aujourd’hui l’occasion et la responsabilité de promouvoir la modernité, l’envergure et l’intérêt de ces langues qui nous unissent. Elles portent en elles une mentalité, une racine, une culture et une sensibilité qui nous emmènent tous vers l’avenir.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, GEST, SER et CRCE.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, si, aujourd’hui, la langue française est omniprésente jusque dans les villages les plus reculés, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le paysage linguistique de notre pays était bien différent : outre le français, presque tous ses habitants parlaient ce que l’on appelle communément un dialecte, fruit de particularismes ancestraux qui ont survécu à l’épreuve du temps.
Alors que, à ce titre, ces langues sont un vrai trésor, les paradoxes historiques et idéologiques ont voulu qu’elles soient longtemps reniées, négligées, dépréciées et méprisées, avec l’obligation qui a été faite à beaucoup d’entre nous de ne parler que le français.
Le résultat s’en ressent aujourd’hui lourdement.
L’usage du dialecte par les enfants permet certes de maintenir des liens intergénérationnels, mais s’il était davantage pratiqué, il permettrait également à ces adultes en devenir de s’approprier leur histoire, de les rendre plus forts en ancrant leurs racines dans une terre dont la langue s’est enrichie au fil du temps, au fil de ce que fut la vie de ceux qui l’ont habitée.
C’est la raison pour laquelle il faut préserver et valoriser cette richesse ; les langues régionales témoignent, si tant est qu’on veuille les entendre, de ce que nous sommes et de ce que nous avons été, de nos modes de vie présents et passés, des liens qui nous unissent.
En Alsace, et chez moi dans le Sundgau, un territoire où trois frontières se rejoignent, les vicissitudes historiques ont imposé tantôt le français, tantôt l’allemand comme langue officielle.
Mon arrière-grand-père, né en 1865, a, durant sa vie, changé quatre fois de langue officielle. Pendant ce temps, parfois clandestinement, l’alsacien, l’alémanique, plutôt, qui en est la racine, est resté la langue du quotidien. Alors que je n’en aurais pas fondamentalement besoin, je m’astreins à parler cette langue qui remonte au Ve siècle.
L’alémanique, tel qu’il est pratiqué chez nous, est parlé par six millions et demi de personnes et témoigne d’une histoire que nous avons en commun avec le Bade-Wurtemberg et la Bavière en Allemagne, avec le nord de la Suisse, l’ouest de l’Autriche, le Liechtenstein et le nord de l’Italie.
En Alsace, la question de l’emploi est une raison supplémentaire de pratiquer la langue régionale, car l’alémanique, depuis les années 1950, est aussi synonyme d’opportunités économiques et d’emploi. Dans le Sundgau, il permet à de très nombreux habitants de travailler en Suisse et de bénéficier de revenus confortables, même pour des emplois parfois peu qualifiés.
Depuis quelques années, pourtant, la très grande majorité des jeunes ne parlent plus l’alsacien et n’accèdent plus, de ce fait, aux emplois transfrontaliers : ils viennent gonfler les rangs des demandeurs d’emploi d’un territoire jusque-là préservé, et qui a perdu ses propres outils de production.
Pour que nous soyons à la hauteur de l’enjeu, la tâche qui nous incombe aujourd’hui consiste à souffler sur les braises des langues régionales en soutenant la mise en œuvre de leur enseignement et en valorisant leur pratique.
À ce titre, il faut d’abord les protéger ; c’est le rôle de l’État d’en être le gardien. Il faut aussi les promouvoir, c’est à l’éducation nationale de le faire, à travers une politique publique éducative qui s’adapte aux langues et aux identités régionales dans leur diversité.
La question de la place faite par l’école républicaine à l’enseignement des langues régionales est centrale, car celui-ci ne doit pas être l’apanage des seules écoles privées et des associations.
Monsieur le ministre, faites confiance aux territoires qui ont besoin que vous soyez à leurs côtés ; nous comptons sur vous et espérons que vous soutiendrez les amendements qui vous seront présentés.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et GEST. – M. Claude Kern applaudit également.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
TITRE Ier
PROTECTION PATRIMONIALE DES LANGUES RÉGIONALES
(Non modifié)
Le second alinéa de l’article L. 1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « et du patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’État et les collectivités territoriales concourent à l’enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues. »
L ’ article 1 er est adopté.

L’amendement n° 5 rectifié bis, présenté par Mmes Berthet et Noël, MM. Calvet et E. Blanc, Mme Gruny, MM. Gremillet et Charon, Mmes Deromedi et Belrhiti, M. Savary, Mme Drexler, MM. H. Leroy et Klinger et Mmes M. Mercier et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-10 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces enseignements s’appliquent au basque, au breton, au catalan, au corse, au créole, au gallo, à l’occitan-langue d’oc, au francoprovençal, aux langues régionales d’Alsace, aux langues régionales des pays mosellans, au tahitien, aux langues mélanésiennes (drehu, nengone, païci, aïje) ainsi qu’au wallisien et au futunien. »
La parole est à Mme Marie Mercier.

Cet amendement de correction vise à ajouter le francoprovençal à la liste des langues régionales reconnues par l’éducation nationale.
Les élèves qui veulent présenter cette langue au baccalauréat doivent aujourd’hui passer une épreuve de langue occitane avec des examinateurs qui ne connaissent pas toujours le francoprovençal, ce qui est bien gênant.
Cette langue s’est mise en place sur une partie des Alpes du Nord au cours du premier millénaire et perdure depuis plus de soixante générations dans des départements tels que la Savoie, la Haute-Savoie, l’Isère, l’Ain, le Rhône et la Loire. Elle a des origines essentiellement latines, avec quelques traces de celte.
Des groupes de locuteurs travaillent à la sauvegarde de ce patrimoine vivant en faisant intervenir des enseignants et des bénévoles, ainsi qu’en organisant des groupes de théâtre et de chant en francoprovençal dans les écoles des départements concernés.

La liste des langues régionales bénéficiant d’un enseignement est actuellement définie par circulaire. L’inscription dans la loi d’une telle liste aurait un effet contre-productif, car elle exclurait, de fait, les langues non mentionnées. Ainsi, la liste proposée par notre collègue ne comprend pas le flamand occidental.
L’avis de la commission est défavorable.
L’argument que vient de présenter Mme la rapporteure est très important, il relève le défaut principal de cet amendement, qui n’est toutefois pas le seul : son adoption contribuerait à rigidifier cette liste.
Cela nous renvoie à une considération plus générale. Nous devons faire attention à ne pas tout centraliser, ce qui constituerait en outre un sacré paradoxe dans le débat qui nous occupe. Comme vient de le dire Mme la rapporteure, cet amendement nous conduirait à devoir changer la loi chaque fois que nous voudrions ajouter une langue. Cela serait tout de même un problème.
Cette remarque vaut d’ailleurs pour d’autres débats. Tout ne passe pas toujours par l’éducation nationale ; la vitalité des langues s’exerce aussi au travers, par exemple, des activités périscolaires, ou du numérique, comme je l’ai indiqué, autant d’éléments qui ne relèvent heureusement pas de la loi.
Cette proposition d’amendement me semble donc un peu paradoxale – même si j’en comprends et j’en partage l’esprit, qui est de promouvoir cette belle langue –, car elle part d’une critique du jacobinisme et utilise pourtant ses outils pour promouvoir des langues régionales.
Puisque nous sommes tous adeptes de la pluralité et de la tonicité des langues régionales, faisons-les vivre, comme il nous a été dit qu’on le faisait en Alsace, par exemple, où la collectivité régionale prend des initiatives, plutôt que de toujours modifier le code de l’éducation et de demander que la rue de Grenelle décide de chaque détail de ce qui se passe pour chaque langue régionale.
Je voulais souligner ce paradoxe en introduction, parce que la vitalité ne passe pas forcément par des décisions centralisées, beaucoup d’autres choses sont possibles.
S’agissant du sujet en discussion, nous pouvons, bien sûr, répondre à l’esprit de votre amendement en étant actifs sur le francoprovençal. En examinant la question, on constate toutefois que nous manquons de professeurs pour l’enseigner, comme de tout ce qui permettrait de préparer une éventuelle nouvelle dynamique autour de cette langue.
Nous devons être pragmatiques. On peut faire avancer cette question dans le cadre du rectorat concerné, sans pour autant être contraint à officialiser par la loi ce mouvement, au risque, comme Mme la rapporteure l’a indiqué, d’emporter des effets contre-productifs.
L’avis est donc défavorable.

C’était pour moi l’occasion d’évoquer le francoprovençal et les difficultés des élèves se trouvant face à des examinateurs qui ne sont pas formés à cette langue.
Toutefois, j’ai bien entendu les arguments avancés, c’est tout le paradoxe des listes : quand on n’en fait pas partie, on n’est pas ciblé.
Je retire cet amendement, monsieur le président.
(Non modifié)
Après le mot : « art », la fin du 5° de l’article L. 111-1 du code du patrimoine est ainsi rédigée : «, de l’archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article 21 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est ainsi rédigé :
« Art. 21. – Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur. » –
Adopté.

L’amendement n° 16 rectifié, présenté par Mmes Muller-Bronn et Belrhiti, MM. Calvet et Charon, Mmes Dumont, Drexler, Deromedi et Imbert, M. Klinger, Mme Gruny et MM. Reichardt et Regnard, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est supprimé ;
2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un enseignement immersif en langue régionale sans préjudice de l’objectif d’une bonne connaissance de la langue française. »
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.

Je tenais à introduire dans cette discussion le sujet de l’immersion. J’ai toutefois bien conscience qu’il s’agit d’un amendement un peu frondeur et qui suscite des réticences.
Malgré son intérêt et ses résultats, nous constatons que l’apprentissage des langues en immersion n’est pas reconnu dans l’enseignement national. Officiellement, cette démarche est acceptée à titre d’expérimentation, alors qu’elle est pratiquée dans les écoles immersives depuis des dizaines d’années.
Ce statut expérimental est inadapté et porte préjudice à cet enseignement, considéré comme une activité accessoire. L’expérience a montré, au contraire, non seulement que ce procédé était efficace, mais qu’il était le seul capable de former de véritables élèves bilingues.
Cet amendement m’offre aussi l’occasion de revenir sur le reproche d’inconstitutionnalité que l’on oppose régulièrement à cette pratique. Le Conseil d’État lui-même, lorsqu’il rend des décisions défavorables à l’enseignement immersif, ne se fonde ni sur cet argument ni sur l’article 2 de la Constitution relatif à la langue officielle de la République.
Si l’immersion était inconstitutionnelle, elle ne pourrait d’ailleurs pas faire l’objet d’expérimentations, de même que l’enseignement bilingue ne pourrait pas faire l’objet de conventions entre les régions, les départements et l’État.
En réalité, les difficultés de l’apprentissage des langues régionales ne résultent ni du cadre législatif ni d’obstacles constitutionnels, mais plutôt de notre culture et de notre histoire nationale. Laissons ce choix politique, dont le Parlement doit débattre, aux collectivités qui peuvent en organiser l’application.

La création d’un enseignement immersif pose un problème de constitutionnalité. En effet, le Conseil constitutionnel a déduit à plusieurs reprises de l’article 2 de la Constitution disposant que « le français est la langue de la République », que l’usage d’une langue autre que le français ne pouvait être imposé aux élèves d’un établissement de l’enseignement public ni dans la vie de l’établissement ni dans l’enseignement de disciplines autres que la langue considérée. Ainsi, l’enseignement dit « immersif » ne serait pas possible.
La pratique de la langue régionale peut aller jusqu’à la parité horaire hebdomadaire dans l’usage de la langue régionale et du français en classe, sans qu’aucun domaine disciplinaire autre que la langue régionale soit exclusivement enseigné dans cette dernière langue.
La commission a émis un avis défavorable.
Je reprends de nouveau à mon compte les arguments très justes de la commission.
Plusieurs décisions de justice, y compris une décision du Conseil constitutionnel, font très clairement référence à l’article 2 et à son caractère contradictoire avec l’enseignement immersif.
J’observe que certaines écoles privées réputées, bilingues français-anglais, ne font pas de l’immersif, mais, au contraire, du français et de l’anglais.
Je n’entrerai toutefois pas dans le débat pédagogique, car chat échaudé… fait attention ! Durant nos derniers échanges à ce sujet, j’avais indiqué à quel point cette question me semblait mériter de la subtilité, mais les débats médiatiques qui avaient suivi en ont été tout à fait dépourvus. Je vais donc peser chacun de mes mots et les rendre insécables, de manière que ma pensée ne soit pas travestie.
Ces éléments sont importants. Il existe donc un cadre juridique, mais également une grande ouverture, à travers les expérimentations menées.
Pour toutes les raisons que Mme la rapporteure a rappelées, nous ne pouvons pas être favorables à cet amendement.

Oui, monsieur le président. J’ai déjà répondu à l’argument de l’inconstitutionnalité.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2 bis.

L’amendement n° 13 rectifié bis, présenté par MM. Hassani, Mohamed Soilihi et Dennemont, Mmes Duranton, Evrard et Havet et MM. Iacovelli, Rohfritsch, Théophile et Patient, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 372-1 du code de l’éducation est abrogé.
La parole est à M. Abdallah Hassani.

L’article L. 312-10 du code de l’éducation reconnaît les langues régionales comme appartenant au patrimoine de la France et prévoit leur enseignement. Or l’article L. 372-1 du même code dispose que cet article n’est pas applicable à Mayotte.
Nous demandons que l’on nous sorte de ce carcan qui nous empêche d’être comme les autres en abrogeant cet article L. 372-1.

L’ancien article L.O. 6161-26 du code général des collectivités territoriales prévoyait des dispositions spécifiques concernant l’enseignement de la langue mahoraise, ce qui justifiait la non-application à Mayotte de l’article L. 312-10 du code de l’éducation.
Or, dans le cadre de la départementalisation, l’article du code général des collectivités territoriales a été abrogé, mais la correction correspondante n’a pas été opérée dans le code de l’éducation.
L’enseignement des langues et des cultures régionales doit être possible à Mayotte, c’est pourquoi la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Le shimaoré et le kibushi sont des langues très importantes à Mayotte, nous devons y être attentifs, comme dans d’autres territoires d’outre-mer. Même si cet amendement n’était pas adopté, il nous faut toujours tenir compte de ce qui se passe en pratique s’agissant des langues régionales.
J’ai entendu les arguments de Mme la rapporteure : je m’en remets à la sagesse du Sénat.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2 bis.
Je suis saisi de sept amendements identiques.
L’amendement n° 1 rectifié bis est présenté par M. Brisson, Mme Drexler, M. Reichardt, Mme Muller-Bronn, M. Panunzi, Mme Micouleau, MM. Cadec et Klinger, Mme Dumas, MM. Savin et Sautarel, Mme Deromedi, MM. Savary, D. Laurent et Cardoux, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Gremillet et Belin et Mmes Berthet et Canayer.
L’amendement n° 2 rectifié bis est présenté par MM. Calvet, Sol, A. Marc, Grand, E. Blanc, Chatillon, Rapin et Longeot.
L’amendement n° 3 est présenté par MM. Dantec et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dossus, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge, MM. Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian.
L’amendement n° 6 rectifié est présenté par Mme S. Robert, M. Stanzione, Mme Espagnac, M. Kanner, Mme Le Houerou, MM. Fichet, Assouline et Bouad, Mmes G. Jourda et Lepage, MM. Lurel et Magner, Mmes Préville, Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 15 rectifié bis est présenté par MM. Decool, Wattebled, Médevielle et Chasseing, Mme Mélot, M. Lagourgue et Mme Paoli-Gagin.
L’amendement n° 17 rectifié quater est présenté par MM. Delcros, J.M. Arnaud, Laugier, Détraigne, Le Nay, Moga et Canevet, Mmes Billon, Saint-Pé et Perrot, MM. Cigolotti, Vanlerenberghe et P. Martin et Mme Vermeillet.
L’amendement n° 18 rectifié est présenté par Mme Havet, M. Rohfritsch, Mme Phinera-Horth, M. Haye, Mme Duranton et M. Buis.
Ces sept amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312-10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. »
La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié bis.

Cet amendement vise à préciser les dispositions du code de l’éducation, lequel énonce que la participation financière à la scolarisation des enfants dans un établissement du premier degré qui dispense un enseignement de langue régionale doit faire l’objet d’un accord entre la commune de résidence de l’élève, à la condition que cette dernière ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale, et l’établissement d’accueil situé sur le territoire d’une autre commune.
Il est proposé, par cet amendement, de préciser que cette participation financière est due lorsque la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale afin de permettre une meilleure application de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
Il s’agit ainsi d’atteindre l’objectif que celle-ci assigne en apportant une modification rédactionnelle à l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation afin de rendre opérationnelle l’intention de l’État et de permettre le versement du forfait scolaire à l’établissement d’enseignement bilingue.
À la suite de la déclaration du Premier ministre Édouard Philippe au président de la région Bretagne en février 2019, matérialisée dans le contrat pour l’action publique en Bretagne, sur la possibilité de faire bénéficier les écoles bilingues en français et en langue régionale du forfait scolaire communal et du vote favorable de la conférence territoriale de l’action publique (CTAP) en avril 2019, le ministre de l’éducation nationale s’est engagé, devant l’Assemblée nationale, à honorer les annonces du Premier ministre lorsque le texte serait en discussion au Sénat.
Dans ce cadre, le Sénat a voté un amendement, présenté par la sénatrice Maryvonne Blondin, qui réglait le problème. Cependant, en commission mixte paritaire, la rapporteure du texte à l’Assemblée nationale a proposé une réécriture qui a été adoptée. Or cette rédaction ne fonctionne pas de manière satisfaisante sur le terrain, les écoles concernées n’obtenant pas, dans de nombreux cas, la participation financière des communes.
Aujourd’hui, en Bretagne seulement, 56 demandes d’arbitrage sont à la charge des préfets. Les relations entre élus communaux, en premier lieu les maires, d’une part, et les parents et les structures des écoles, d’autre part, se tendent.
Une rédaction claire et sans ambiguïté sera en mesure de pacifier ce conflit. Cet amendement, qui tend à préciser que seuls les établissements dispensant un enseignement de langue régionale seront concernés, est de nature à limiter les contentieux.

L’amendement n° 2 rectifié bis n’est pas défendu.
La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 3.

En dehors d’un désaccord quant au nombre de contentieux, il a été très bien défendu.

La parole est à Mme Sylvie Robert, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié.

Il est défendu. Je rappelle au ministre que cet amendement, qui reste dans l’esprit de ce texte, reprend un engagement du Gouvernement et avait été adopté après accord de la CTAP.

La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour présenter l’amendement n° 15 rectifié bis.

La parole est à M. Michel Laugier, pour présenter l’amendement n° 17 rectifié quater.

La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié.

Ces amendements concernent le forfait scolaire ; le Sénat avait déjà débattu de ce sujet lors de l’examen de la loi pour une école de la confiance. Or la rédaction issue de la commission mixte paritaire, notamment la notion de contribution volontaire, est source de tensions sur le terrain.
Ces amendements visent à clarifier la situation, l’avis de la commission est favorable.
Il est toujours un peu étonnant de devoir revenir sur quelque chose qui a été décidé en commission mixte paritaire il y a très peu de temps.
La loi pour l’école de la confiance constitue une avancée concernant les langues régionales et je renvoie, à ce sujet, à la notion d’équilibre que j’évoquais dans mon discours initial et qui doit nous guider sur ces sujets. Nous devons en effet considérer l’ensemble des acteurs, en particulier les communes, lesquelles, si cet amendement était adopté, se trouveraient dans une situation d’obligation.
Ensuite, nous créerions un précédent. Je rappelle que, lorsqu’un en enfant est scolarisé dans une autre commune, cette obligation existe aujourd’hui pour trois types de motifs seulement, qui s’imposent chacun à l’enfant et à sa famille, comme le motif de santé. Si une commune doit verser cette contribution à une autre quand un enfant va s’y scolariser, c’est donc parce que celui-ci y est obligé par des raisons objectives.
Avec cet amendement, nous créerions le précédent, aussi légitime soit-il, d’une obligation liée à une « envie » de quelque chose. Je ne conteste pas la légitimité de ce sentiment, mais d’autres pourraient surgir dans le futur et demander à bénéficier de la même approche.
Ce serait donc créer un précédent, alors même que nous prenons un engagement qui est, selon moi, de nature à créer du liant et du consensus, puisqu’il suppose que l’on s’entende. Dans une région, tout le monde souhaite normalement l’enseignement d’une langue régionale, mais il peut y avoir des cas particuliers. J’ai entendu précédemment un sénateur s’inquiéter de ce que cela impliquait en matière d’équilibre entre le secteur public et le secteur privé, par exemple.
Je n’ai pas changé quant à l’esprit avec lequel j’aborde ces questions : oui à la promotion des langues régionales, à la possibilité pour une commune d’aider une autre commune lorsqu’un enfant de la première va dans la seconde pour recevoir l’enseignement de cette langue régionale, mais créer une obligation satisferait les uns en mécontentant les autres. Il me semble qu’un système de dialogue allié à un maillage, auquel l’éducation nationale est associée, me paraît plus opportun.
Encore une fois, il ne s’agit pas d’aller contre l’esprit de cette proposition de loi, mais d’être, dans la lettre, attentif à ne pas franchir un pas que nous pourrions être conduits à regretter. On peut constater des insatisfactions sur le terrain, gardons-nous d’en créer de plus grandes encore.
L’avis est défavorable.

L’amendement qui nous est soumis porte extension de la loi du 28 octobre 2009, dite loi « Carle », du nom de notre regretté collègue sénateur.
Vous l’avez dit très justement, monsieur le ministre, il s’agit d’ajouter une quatrième condition à un texte contre lequel nous avions voté, avec nos collègues socialistes. Nous étions alors ensemble pour refuser ce texte, nous restons, quant à nous, sur cette position.
Vous l’avez dit clairement, monsieur le ministre, et j’ai plaisir à constater que nous nous rejoignons dans l’hémicycle : cette quatrième condition nous semble dénaturer totalement l’équilibre de la loi Carle, à laquelle nous étions déjà opposés.
Nous ne pouvons pas voter cet amendement, je le dis avec une grande tristesse, mes chers collègues, parce que, à mon sens, il aurait été intéressant de construire un consensus global et de voter conforme le texte qui nous est arrivé de l’Assemblée nationale. Vous savez comme moi ce qu’il adviendra des dispositions que nous votons dans la suite du parcours législatif.
Nous aurions pu, symboliquement, travailler ensemble pour pousser le consensus jusqu’au bout, voter conforme ce texte et, ainsi, marquer un changement politique majeur de la façon dont la représentation nationale aborde le sujet complexe des langues régionales.
Je regrette de devoir vous l’indiquer après mon collègue Jérémy Bacchi : si cet amendement était adopté, nous ne pourrions pas voter ce texte.

J’entends que, finalement, la loi pour une école de la confiance est gravée dans le marbre quasiment définitivement – pourtant, les lois changent ! – et que les paroles d’un Premier ministre qui s’engage solennellement à Rennes peuvent être remises en cause.
C’est l’engagement du Premier ministre que vous êtes en train de remettre en cause par vos propos, cet après-midi, monsieur le ministre ! Certes, depuis que celui-ci l’a pris, nous avons changé de Premier ministre, mais il me semblait que vous nous décriviez une continuité de la parole de l’État, alors que, de surcroît, la majorité, elle, n’a pas changé.
Lisez bien le dispositif de cet amendement. Il y est écrit : « fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune ». L’idée d’un dialogue y est toujours présente.
La rédaction issue de la commission mixte paritaire indique simplement que ce processus est facultatif, sans obligation, alors qu’un accord est tout de même nécessaire, ce qui entraîne des contentieux. Cela ne fonctionne pas et nous vous proposons justement de recréer le dialogue entre les uns et les autres.
Votre position remet en cause ce qu’a dit Édouard Philippe à Rennes.

Je partage ce que vient de dire Ronan Dantec. Monsieur le ministre, vous êtes cohérent avec vous-même, permettez au Sénat de l’être tout autant. Nous avions voté ainsi ce texte en première lecture de la loi pour une école de la confiance.

En effet, nous avions voté ce texte comme l’a indiqué M. Brisson, dans la rédaction proposée dans cet amendement.
Il est nécessaire de faire preuve de pragmatisme : nous constatons tous les problèmes qui surgissent dans les régions et nous essayons de leur apporter une solution. Bien entendu, celle-ci se trouve dans la discussion avec les élus, mais il ne s’agit pas d’ouvrir des précédents. Monsieur le ministre, vous mettez en garde, à juste titre, contre la tentation d’opposer les différents modes d’enseignement. Restons dans le cadre de l’école publique et consolidons-y l’enseignement et la place des langues régionales.
Nous sommes tous ouverts, vous-même avez apporté votre soutien aux langues régionales et je vous en remercie. Or il ne saurait être question aujourd’hui de restrictions ; nous sommes là pour faire en sorte que tout se passe bien.
Je tiens d’ailleurs à rendre hommage à Paul Molac, avec qui j’avais travaillé au sein de la commission Filippetti ainsi que sur la charte des langues régionales.
Cette mesure est de bon sens, c’est pourquoi, comme beaucoup de nos collègues, nous vous demandons de faire preuve de bienveillance.

Monsieur le ministre, nous ne modifions pas l’esprit de la loi par cet amendement. Nous l’avions voté ici et, comme le rappelait M. Dantec, cette rédaction a fait l’objet d’un engagement de votre gouvernement.
En Bretagne, nous avons respecté la validation par la CTAP de cet engagement et de cet amendement, comme notre collègue Maryvonne Blondin nous l’avait bien expliqué.
Nous modifions simplement la rédaction pour que la loi soit bien appliquée et bien comprise. C’est une question de cohérence pour le Sénat et je forme le vœu qu’il en aille de même pour votre gouvernement.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et Les Républicains.

Cet amendement important est un des points principaux du débat qui nous occupe cet après-midi.
J’ai bien entendu les arguments des uns et des autres et je comprends que ceux de nos collègues pour qui la langue régionale correspond à quelque chose de très profond entendent défendre ce dispositif.
Néanmoins, ce qui prime, ce n’est pas l’expression d’une somme de sénateurs impliqués, du fait de leur histoire personnelle, dans la défense des langues régionales, mais la position du Sénat, qui va s’exprimer. Nous allons envoyer un message, notamment à l’Assemblée nationale.
Je ne vais pas reprendre mot pour mot les arguments du ministre et de Pierre Ouzoulias, mais je les partage entièrement.
À travers cet amendement, nous sommes tout de même en train de créer une dépense obligatoire pour nos communes ! Il n’est pas anodin que le Sénat, dans le contexte actuel, connaissant les difficultés financières auxquels nos villes et nos villages sont confrontés, alors que la priorité, pour un certain nombre d’entre eux, est le financement des écoles publiques, crée une telle dépense, aussi méritoire et légitime que soit sa cause.
En outre, effectivement, le cadre général du financement des écoles privées ou associatives est construit ainsi : quand celles-ci sont situées sur le territoire de la commune, la commune a l’obligation de les financer, quand elles sont situées sur le territoire d’une autre commune, cela devient une possibilité et non plus une obligation.
Nous sommes donc en train de sortir de ce cadre général, qui intégrait déjà quelques exceptions très précises. Or la question du financement des écoles privées et associatives repose sur un équilibre qui s’est construit au fil du temps et qui, s’il donne assez largement satisfaction et fait l’objet d’un consensus, est néanmoins précaire.
Encore une fois, je comprends parfaitement vos motivations, mais je voterai contre cet amendement, malgré toute la bienveillance que je nourris envers ce texte et je vous alerte sur ses conséquences.
Je veux tout d’abord saluer l’éloquence du président Lafon. En quelques mots, il a parfaitement résumé la question de principe à laquelle nous sommes confrontés, car – il est très important de le souligner – c’est bien d’une question de principe qu’il s’agit, derrière ce débat.
Je souhaite en profiter pour aborder une seconde question de principe.
Je suis échaudé, je le répète, par les débats que nous avons déjà eus sur cette question ; ce thème se prête souvent à des échanges, dans lesquels chaque parlementaire veut se montrer plus généreux que le ministre. Ce n’est pas forcément le problème, me direz-vous, mais nous devons, en tout cas, tâcher de préserver un certain équilibre.
La notion d’équilibre a été abordée au travers de la question du privé et du public. C’est, à mes yeux, un point majeur et il est dans l’intérêt de tout le pays, de tous les acteurs, que nous sachions conserver cet équilibre.
Il faut également maintenir un équilibre dans notre manière de concevoir le sujet qui nous occupe aujourd’hui. Or ce qu’il y avait de désagréable dans la précédente discussion – j’y ai déjà fait allusion, mais je souhaite y revenir –, c’est que, alors que la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a incontestablement représenté un progrès pour les langues régionales et tandis que notre discussion d’aujourd’hui pourrait encore aboutir à de nouvelles avancées pour ces langues – bref, quels que soient les progrès accomplis –, les commentaires qui sont faits ensuite sont toujours des commentaires d’insatisfaction et de stigmatisation du jacobinisme prétendu du ministre.
En vous écoutant, celui qui vous parle s’est rendu compte qu’il a des ascendances – Dieu sait que je n’aime pas faire référence à cela ni, d’ailleurs, utiliser cette expression – catalanes, alsaciennes ou encore bretonnes. Un de mes arrière-grands-pères a été obligé de changer plusieurs fois de langue, comme le vôtre, madame Drexler ; il a même été contraint de quitter l’Alsace pour continuer de parler le français. Quant à moi, je me suis inscrit à l’épreuve de breton lorsque j’ai passé le baccalauréat et le catalan m’est une langue extrêmement sympathique.
Il est donc pénible d’être sans cesse obligé d’occuper la position du jacobin rétif, sur la défensive, alors même que nous avons une politique de promotion des langues régionales. Simplement, à certains moments – par exemple avec la rupture de l’équilibre entre enseignement public et enseignement privé ou avec la création d’une obligation supplémentaire pour les communes –, les propositions vont trop loin et cela conduit à me placer, face aux générosités diverses, dans la position désagréable du gardien des principes ou dans celle du gardien de l’intérêt général. En effet, derrière ces débats se pose la question de l’intérêt général et de la postérité de la loi Carle, car vous risquez de créer un déséquilibre alors que cette loi représentait un point d’équilibre.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 1 rectifié bis, 3, 6 rectifié, 15 rectifié bis, 17 rectifié quater et 18 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 47 :
Nombre de votants343Nombre de suffrages exprimés312Pour l’adoption253Contre 59Le Sénat a adopté.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi que sur des travées des groupes SER et Les Républicains.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2 bis.
L’amendement n° 10 rectifié, présenté par M. Reichardt, Mmes Muller-Bronn, Berthet et Deromedi, M. Grand, Mme Dumont, MM. Daubresse, H. Leroy, Savary, Moga, Charon et Klinger, Mmes Lassarade et Gruny, M. Calvet, Mmes Drexler et Belrhiti, MM. Gremillet, P. Martin et Longeot et Mme Chain-Larché, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ces domaines, l’action de ces collectivités territoriales peut notamment prendre la forme de soutiens financiers attribués à l’investissement ou au fonctionnement d’institutions publiques ou privées agissant pour la promotion des langues régionales, notamment dans les domaines éducatif ou scolaire. »
La parole est à M. André Reichardt.

Cet amendement tend simplement à reconnaître la faculté, pour les collectivités territoriales, auxquelles la mission de promotion des langues régionales est déjà formellement attribuée, de contribuer au financement d’institutions publiques ou privées agissant en faveur des langues régionales, notamment dans le domaine de l’éducation.

Tel qu’il est rédigé, cet amendement va au-delà du domaine scolaire. Or les collectivités territoriales ont déjà la possibilité d’apporter un soutien financier à des institutions agissant pour la promotion des langues régionales.
En outre, cette disposition créerait une inégalité dans les possibilités de soutien financier pour des dépenses d’investissement entre les établissements privés sous contrat dispensant un enseignement en langue régionale et ceux qui n’en dispensent pas.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
D’une certaine façon, cet amendement tend à pousser les choses d’encore un cran, sur les dépenses d’investissement. Il s’agit d’autoriser les collectivités locales à attribuer un soutien financier pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement des institutions qui agissent pour la promotion des langues régionales, notamment des établissements privés, sous contrat ou hors contrat, du premier et du second degrés, qui dispensent un enseignement en langue régionale.
Si l’on recherche les dispositions en vigueur dans ce domaine, on trouve, d’une part, la loi du 30 octobre 1886 portant sur l’organisation de l’enseignement primaire, la « loi Goblet », qui instaure le principe d’interdiction de toute aide publique aux dépenses d’investissement des écoles privées du premier degré – c’est l’article L. 151-3 du code de l’éducation –, et, d’autre part la loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement, la « loi Falloux », reprise à l’article L. 151-4 du même code, en vertu de laquelle les établissements d’enseignement privés du second degré général ne peuvent se voir attribuer de financement public pour leurs dépenses d’investissement qu’à hauteur de 10 % de leurs dépenses annuelles.
Ces principes n’ont pas été modifiés par la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’État et les établissements d’enseignement privés, la « loi Debré », et ils sont rappelés constamment par les juridictions administratives.
Il existe quelques dérogations à ces principes d’interdiction ou de limitation du financement public des investissements des établissements d’enseignement privé, mais pour des objets bien déterminés et relatifs à des éléments obligatoires et incontournables de la formation, dans le respect des exigences rappelées par le Conseil constitutionnel.
Les auteurs de la présente proposition de loi et du présent amendement entendent reprendre, dans la loi, les éléments de la décision du Conseil du 13 janvier 1994 relative à l’aide aux investissements des écoles privées par les collectivités territoriales. Or ces dérogations visent des situations bien précises et objectives : il s’agit, d’une part, du financement d’équipements pour les enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle des élèves de collège ou pour la préparation à des diplômes et, d’autre part, du financement de certains équipements informatiques – c’est l’article L. 442-16 du code précité.
Par conséquent, la condition que le présent amendement tend à instaurer pour autoriser le financement, par les collectivités locales, des dépenses d’investissement ou de fonctionnement des établissements privés ne répond pas à ces exigences du Conseil constitutionnel. En particulier, l’offre d’un enseignement en langue régionale ne constitue pas un critère objectif de financement des établissements privés, dans la mesure où cela exclurait, par exemple, le financement des écoles privées sous contrat avec l’État qui ne dispenseraient pas un tel enseignement. L’un des risques encourus avec certaines des dispositions proposées serait donc de créer une forme d’inégalité, selon qu’un établissement propose ou non une langue régionale.
Si l’article 75-1 de la Constitution dispose que les « langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision du 20 mai 2011, que « cet article n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ». Le Conseil constitutionnel a donc estimé qu’il ne s’agissait pas d’un droit opposable.
Cette disposition ne répondant pas aux exigences rappelées par le Conseil constitutionnel et pouvant même entrer en contradiction avec le régime législatif actuel, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
(Suppression maintenue)

Je suis saisi de six amendements identiques.
L’amendement n° 7 rectifié bis est présenté par MM. Parigi, Dantec et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Gontard, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco, Poncet Monge et Taillé-Polian et M. Salmon.
L’amendement n° 8 rectifié quater est présenté par M. Brisson, Mmes Drexler et Schalck, M. Reichardt, Mme Muller-Bronn, MM. Panunzi et Cadec, Mme Gruny, MM. Cardoux, Pemezec, Savary et D. Laurent, Mme Dumas, M. Charon, Mme Borchio Fontimp, M. Longuet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Gremillet et Belin et Mmes Chain-Larché, Canayer, Berthet et M. Mercier.
L’amendement n° 9 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Canevet et Détraigne, Mme Billon, MM. Le Nay, Folliot et Moga, Mme Saint-Pé et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° 12 rectifié bis est présenté par Mme S. Robert, M. Stanzione, Mme Espagnac, M. Kanner, Mme Le Houerou, MM. Fichet, Assouline et Bouad, Mmes G. Jourda et Lepage, MM. Lurel, Magner et Montaugé, Mmes Préville, Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 14 rectifié est présenté par MM. Decool, Wattebled, Médevielle, A. Marc et Chasseing, Mme Mélot, M. Lagourgue et Mme Paoli-Gagin.
L’amendement n° 19 rectifié bis est présenté par Mme Havet, M. Rohfritsch, Mme Phinera-Horth, MM. Buis et Haye et Mme Duranton.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11- … . - Sans préjudice des dispositions de l’article L. 312-11-1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d’Alsace ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »
La parole est à M. Paul Toussaint Parigi, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié bis.

Cet amendement vise à étendre, au sein du code de l’éducation, les dispositions existant aujourd’hui pour la seule langue corse et pour les seules écoles maternelles et élémentaires, à l’ensemble des langues régionales et dans les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et les lycées des territoires concernés.
Il tend également à préciser que l’enseignement des langues régionales, dans le cadre de l’horaire normal de ces établissements, devrait donner lieu à des conventions entre l’État et les régions ou, le cas échant, la collectivité de Corse ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, soit les départements et régions d’outre-mer. L’obligation prévue ne s’appliquerait que si une telle convention a été conclue et dans les territoires pour lesquelles elle l’a été. Une telle convention pourrait également prévoir la mise en place progressive de cette mesure, afin notamment de former les enseignants, en particulier dans le cadre de la formation initiale.
Cet amendement s’inscrit dans un cadre général et pour toutes les langues régionales ; sa rédaction ne restreint pas à un certain type d’enseignement ni ne présage de la forme de celui-ci.

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié quater.

La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié bis.

La parole est à M. Lucien Stanzione, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié bis.

La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour présenter l’amendement n° 14 rectifié.

La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié bis.

La convention entre la collectivité territoriale de Corse et l’État a montré son efficacité en matière d’enseignement d’une langue régionale ; plus de 90 % des élèves étudient le corse à l’école primaire. Un tel dispositif respecte la Constitution tant que l’enseignement en langue régionale n’est obligatoire ni pour l’élève ni pour l’enseignant.
Il n’y a pas de raison que de telles conventions ne puissent pas être signées entre l’État et les régions ou la collectivité européenne d’Alsace, qui exerce des compétences spécifiques en matière d’enseignement des langues régionales.
La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
À titre préliminaire, je veux indiquer que, au-delà de ce qui est discuté dans le cadre de l’examen de cette proposition de loi, il existe toute une série de facteurs de dynamisme pour les langues régionales, qui se déploieront dans des temps futurs. Je veux notamment rappeler ce que je disais précédemment à propos du CNED et de ses possibilités d’extension quantitative extrêmement importantes, au travers de l’enseignement à distance ou des mécanismes périscolaires.
En effet, maintenant que nous avons un ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, nous avons la possibilité, avec, par exemple, le plan Mercredi, de favoriser l’enseignement des langues régionales en dehors du temps scolaire ; c’est une opportunité majeure. Certes, cela est de niveau infralégislatif, mais, d’un point de vue pratique, cela peut conduire à des choses très importantes.
La disposition contenue dans ces amendements est redondante avec les dispositions de l’article L. 312-10 du code de l’éducation, qui prévoit déjà qu’un enseignement de langue et de culture régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité, selon des modalités définies par voie de conventions entre l’État et les collectivités territoriales. Nous avons de multiples conventions de ce type ; je citais, précédemment, celle qui a été conclue avec l’Alsace.
En outre, telle qu’elle est rédigée, cette mesure est de nature à intégrer l’enseignement de la langue régionale parmi les enseignements obligatoires et, si elle était ainsi interprétée, à imposer cet enseignement aux élèves, ce qui serait contraire au principe de libre choix des familles face à l’offre linguistique proposée dans les écoles et les établissements publics locaux d’enseignement fréquentés par les enfants. En effet, le caractère non obligatoire de cette disposition n’est pas précisé dans l’amendement, la langue régionale n’étant pas mentionnée comme matière facultative ou optionnelle, dans le cadre de l’horaire normal d’enseignement. Ce caractère obligatoire pourrait tout à fait être induit par le contenu des conventions signées en amont.
La circulaire n° 2017-72 du 12 avril 2017 indique déjà qu’une langue régionale peut être enseignée à l’école élémentaire sur l’horaire dévolu aux langues vivantes, étrangères ou régionales. L’enseignement de la langue régionale peut éventuellement être renforcé, selon le projet d’école, par la conduite d’activités en langue régionale dans différents domaines d’apprentissage. Cet apprentissage peut en outre être précédé par des actions de sensibilisation et d’initiation à l’école maternelle, sous la conduite d’un professeur ou d’un intervenant extérieur. Il n’y a donc pas de caractère obligatoire pour l’enseignant et l’on compte beaucoup de projets extrêmement dynamiques sur le terrain, dans ce domaine.
Par ses décisions du 17 janvier 2002 et du 12 février 2004, le Conseil constitutionnel indique que « si l’enseignement de la langue [régionale] est prévu “dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires”, il ne saurait revêtir pour autant un caractère obligatoire ni pour les élèves, ni pour les enseignants ; […] il ne saurait non plus avoir pour effet de soustraire les élèves aux droits et obligations applicables à l’ensemble des usagers des établissements qui assurent le service public de l’enseignement ou sont associés à celui-ci ». Or les limites fixées par le Conseil constitutionnel ne sont pas prises en compte dans le présent amendement.
En effet, tel que celui-ci est rédigé, l’enseignement de la langue régionale devra être obligatoirement proposé aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, dès lors qu’il existerait une convention ou une demande exprimée sur le territoire. Cette disposition serait susceptible d’alourdir considérablement le poids des dépenses publiques.
Enfin l’amendement tend à attribuer un caractère obligatoire aux conventions passées avec l’État et, tel qu’il est formulé, il vise également à exclure de son champ les langues n’étant soumises à aucune convention, ce qui créerait une situation d’inégalité entre les langues régionales actuellement enseignées.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 7 rectifié bis, 8 rectifié quater, 9 rectifié bis, 12 rectifié bis, 14 rectifié et 19 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
(Suppressions maintenues)
TITRE III
SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D’ÉTAT CIVIL
(Non modifié)
Les services publics peuvent assurer sur tout ou partie de leur territoire l’affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l’occasion de leur installation ou de leur renouvellement. –
Adopté.
(Non modifié)
L’article 34 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les signes diacritiques des langues régionales sont autorisés dans les actes d’état civil. »

L’amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
Le Gouvernement s’est engagé à ce que les prénoms et noms de famille puissent comporter des signes diacritiques régionaux lorsqu’ils sont mentionnés dans les actes de l’état civil.
Toutefois, l’intégration de tels signes régionaux relève du domaine non de la loi, mais du règlement ; c’est donc simplement une question de droit. Ainsi, un décret en conseil d’État précisera, avant la fin du mois de janvier 2021, la liste des signes diacritiques régionaux recensés par le ministère de la culture qui pourront être utilisés dans les actes de l’état civil.
C’est pourquoi le Gouvernement propose, par cet amendement, la suppression de l’article 9 de la présente proposition de loi, dont le contenu trouvera néanmoins sa traduction, à sa place dans la hiérarchie des normes.

La position du Gouvernement a évolué sur ce sujet depuis janvier 2020. En effet, un amendement similaire avait été adopté par le Sénat à l’occasion de l’examen de la proposition de loi relative à la déclaration de naissance auprès de l’officier d’état civil du lieu de résidence des parents, sans que cela suscite de remarque particulière de la part du Gouvernement.
Vous évoquez, monsieur le ministre, un décret à venir. Pour l’instant, il n’est pas publié. Nous aurions aimé en avoir le texte.
En outre, selon les explications du ministre, ce décret devrait mentionner la liste des signes régionaux recensés par le ministère de la culture. Or l’existence d’une liste nous expose au risque de l’exclusion de signes diacritiques qui n’y figureraient pas. Lors de nos échanges avec la ministre de la culture, une telle liste m’a été transmise, mais elle portait la mention « non exhaustive ». Le ministère de la culture dispose-t-il seulement d’une liste exhaustive ?
La commission, qui s’est réunie pendant la suspension du déjeuner – cet amendement nous a été transmis très tardivement –, a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 9 est adopté.
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif à l’accueil, dans les académies concernées, des enfants dont les familles ont fait la demande d’un accueil au plus près possible de leur domicile dans les écoles maternelles ou classes enfantines en langue régionale. –
Adopté.
(Non modifié)
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur les conventions spécifiques conclues entre l’État, des collectivités territoriales et des associations de promotion des langues régionales relatives aux établissements d’enseignement de ces langues créés selon un statut de droit public ou de droit privé et sur l’opportunité de bénéficier pour les établissements scolaires associatifs développant une pédagogie fondée sur l’usage immersif de la langue régionale de contrats simples ou d’association avec l’État. –
Adopté.

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Paul Toussaint Parigi, pour explication de vote.

En préambule, je tiens à remercier, au nom du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, les sénateurs ici présents. Dans un esprit transpartisan, vous avez contribué, mes chers collègues, à redonner du sens et de la teneur à ce texte ambitieux pour nos langues, légitime pour notre histoire, fidèle à notre culture, à nos racines. Vous avez même redonné de l’âme, dirais-je, à cette proposition de loi vidée de sa substance par la majorité des députés, confortée par un gouvernement encore hanté par le fantôme de l’idéologie monolinguiste, par un État qui ânonne l’importance de soutenir les langues régionales tout en réduisant les moyens qui leur sont consacrés.
Au pays du centralisme jacobin, hostile à toute la diversité linguistique, alors que la Constitution édicte que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, on laisse ces langues mourir en silence, empêchant toute déclinaison législative de ce principe constitutionnel et – pis ! – en sapant les timides avancées proposées, comme vous l’avez fait, monsieur le ministre, dans le cadre de la réforme du baccalauréat.
Vous ne duperez personne, monsieur le ministre ; les déclarations et les vœux pieux ne feront pas revivre nos langues, reconnues si tardivement par la République française. L’urgence à agir pour assurer l’enseignement de ces langues et leur promotion est à la mesure des talents que l’on a développés, en France, pour les éradiquer.
En donnant d’un côté et en reprenant de l’autre, vous démontrez votre volonté délibérée de rompre le progrès fragile qui prévalait depuis cinquante ans, foulant aux pieds l’histoire linguistique et le multilinguisme de la France et créant un ennemi virtuel de la République en brandissant le spectre du séparatisme. Mais, monsieur le ministre, c’est la folle volonté de l’État qui nous y accule ! Si nos langues doivent être sauvées, c’est au nom de la richesse culturelle, qui charrie d’autres rêves que ceux de la globalisation et de l’implacable conformisme auquel on plie nos destins tout entiers, c’est au nom de l’avenir de nos enfants, à qui l’on doit enseigner le plurilinguisme, et au nom de l’exercice des libertés de tous.
Sur les travées de la Haute Assemblée, c’est notre patrimoine vivant qui s’est exprimé aujourd’hui, le passé et l’avenir de nos langues que nous ne laisserons pas mourir sous la férule jacobine. Vi ringraziu ! Trugarez ! Milesker ! Velmol merci ! Je vous remercie !
Applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER.

Je l’indiquais dans mon propos liminaire, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste voyait dans cette proposition de loi un acte législatif largement symbolique, mais important pour les langues régionales. En effet, une partie importante des dispositions contenues dans le texte existent déjà dans la loi.
Je mettais toutefois notre vote en balance. En effet, certains amendements déposés en amont du débat déséquilibraient le texte, en franchissant certaines lignes rouges et en dénaturant le dispositif proposé.
Oui, nous aurions pu aller plus loin en matière de promotion des langues régionales, c’est vrai, mais il ne faut pas que ces dernières deviennent un prétexte pour, une nouvelle fois, affaiblir le service public de l’éducation nationale en favorisant encore le secteur privé. Il me paraît d’ailleurs assez incohérent de vouloir démocratiser l’enseignement des langues régionales en privilégiant les établissements privés ; on aurait pu – cela aurait été plus efficace pour atteindre l’objectif annoncé – aller plus loin, en favorisant l’émergence de cursus de langues régionales au sein des établissements publics. C’est notamment par cette voie que le législateur a réussi à démocratiser l’offre de formation concernant certaines langues étrangères et mortes.
Par ailleurs, en faisant une nouvelle fois porter le poids de l’enseignement aux familles et aux collectivités, on crée un cadre parfait pour renforcer les inégalités territoriales et sociales au sein d’une même aire linguistique.
Ces amendements ayant été adoptés, c’est à regret que nous nous voyons dans l’impossibilité de voter pour ce texte. Toutefois, nous nous abstiendrons, étant entendu que la proposition de loi ne se résume pas à ces seules dispositions.

Je n’approuve pas tout ce qu’a pu dire notre collègue Parigi, mais nous sommes d’accord sur deux points : d’une part, notre débat a effectivement été transpartisan – dans nos territoires, la défense de nos langues dépasse les clivages politiques – et, d’autre part, il y a urgence à agir. Voilà les deux points sur lesquels je serai d’accord avec notre collègue.
Je veux dire au président de la commission, M. Laurent Lafon, que nos langues sont le trésor de tout le pays, et non seulement celui des élus des départements où elles sont parlées. Qu’il se rassure, l’amendement que nous avons adopté aura peu de conséquences dans le Val-de-Marne ; en revanche, il pourrait avoir des conséquences bénéfiques pour les écoles de nos territoires qui ont des besoins de financement. Or, dans ces territoires, les maires sont déjà convaincus.
Monsieur le ministre, vous avez parlé d’intérêt général. Je pense que la Haute Assemblée est aussi porteuse de l’intérêt général et que, en l’occurrence, l’intérêt général consiste à se préoccuper des générations futures. Sans cela, nous serons la génération qui aura sacrifié et fait disparaître ces langues. Cette responsabilité, nous ne pouvons pas l’assumer devant les générations futures.
Applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.

Je n’avais pas prévu d’intervenir, mais les propos de monsieur Parigi me poussent à dire quelques mots.
Les élus du groupe Union Centriste ne partagent pas le point de vue qu’il a exprimé. Il y a une réelle volonté, je crois, y compris du côté du ministère de l’éducation nationale – en tout cas, pour ma part, je le ressens en Bretagne –, de faire avancer la cause des langues régionales ; je sais que des moyens importants y sont consacrés.
Je ne pense donc pas qu’il faille fustiger un pouvoir qui serait jacobin et qui s’opposerait aux girondins. Non, les uns et les autres veulent faire avancer la cause des langues régionales, parce que ces langues font partie de notre patrimoine, et nous devons essayer, ensemble, de construire quelque chose qui permette d’avancer pour la préservation de ce patrimoine. En aucun cas, nous ne pouvons nous retrouver dans la mise en cause du Gouvernement sur ce sujet, compte tenu de ce qu’il a déjà fait.
Le groupe Union Centriste votera ce texte.
Mme Françoise Gatel applaudit.

Je ne souhaitais pas reprendre la parole, mais je veux simplement me faire l’écho de ce que certains de mes collègues ont dit.
D’aucuns ont indiqué que le meilleur moyen d’aider les langues régionales consistait à développer l’enseignement au sein de l’école publique, de ne pas favoriser les écoles catholiques sous contrat ou autres. C’est tout l’enjeu ! L’école de la République et l’enseignement des langues régionales sont des enjeux majeurs pour le Sénat.
Les uns et les autres, nous nous sommes battus pour essayer de développer cet enseignement et, cher collègue Jérémy Bacchi, nous avons tous la volonté de développer les langues régionales dans l’école publique. Ce n’est pas ce qui se passe aujourd’hui. Il ne s’agit pas de monter les uns contre les autres – bien au contraire, monsieur le ministre, nous avons été à vos côtés pour chercher des solutions –, mais, je l’affirme, au Pays basque, c’est l’inverse que nous vivons.
Max Brisson et moi-même, nous nous battons donc pour faire progresser l’enseignement des langues régionales au sein de l’école publique, afin de ne pas instaurer de compétition ni de désordre entre les différents types d’enseignement.
Eu égard à ce que M. le ministre a affirmé, je veux croire que nous y parviendrons. Dans plusieurs de nos offices – offices publics de langue basque ou de langue bretonne –, il y a un partenariat majeur avec l’État ; il est aussi placé sous l’égide du ministère de l’intérieur et du ministère de la culture. On sait à quel point tout cela est important.
Nous devons trouver une solution et, si cela passe par la contractualisation avec l’État, je veux croire que celui-ci aura une autre attitude. Il ne s’agit pas, monsieur Blanquer, de vous pointer du doigt ; bien au contraire, je connais votre volonté en la matière – vous l’avez rappelée à la tribune et je vous en remercie –, mais j’espère que nous trouverons une issue positive pour l’école publique.
Je ne rejouerai pas M. Smith au Sénat – ce serait faisable, puisqu’il reste cinq minutes avant la fin du temps consacré à l’examen de ce texte –, mais je veux très rapidement vous dire ma façon de voir à l’issue de ces débats.
Je veux remercier le sénateur Canevet de ses propos, qui résument bien mon état d’esprit.
Toutefois, je ne trouve pas convenable que ce type de débat se termine par une fausse opposition entre les sénateurs, qui seraient tous pour les langues régionales, et le Gouvernement, qui serait contre. Ce n’est pas vrai, c’est masquer la réalité que de décrire les choses ainsi. Certains d’entre vous ont bien voulu le reconnaître, il existe, à l’échelon local, un dynamisme conduisant l’État, c’est-à-dire l’éducation nationale, à faire progresser les langues régionales aux côtés des collectivités locales.
Tout cela repose sur de multiples instruments, qui ne sont pas tous de niveau législatif. Cela passe aussi par la prise en considération de la demande – cela a été souligné, y compris par le sénateur Brisson –, ce qui témoigne d’une inversion de la situation par rapport aux époques précédentes. En effet, très souvent, on ne parle pas la langue en famille et c’est l’école qui l’encourage ; auparavant, c’était l’inverse. Faire semblant de croire le contraire alimente des débats, qui créent du conflit de manière totalement inutile, puisque, oui, nous allons encourager les langues régionales. Ensuite, nous pouvons avoir des conceptions différentes des chemins à prendre, sans pour autant être dans la critique manichéenne.
Par ailleurs, au travers de ce débat, on touche à d’autres sujets que les langues régionales, mais qui ne sont pas moins importants. L’équilibre public-privé en est un, de même que la question du taux d’encadrement. En effet, cette politique suppose des moyens publics et, aujourd’hui, les structures qui enseignent les langues régionales ont un taux d’encadrement beaucoup plus favorable que dans le reste du système. Il y a donc aussi un risque dans ce domaine, celui de créer des inégalités en faveur de classes sociales qui, en général, ne sont pas parmi les plus défavorisés. Il faut avoir l’honnêteté et la lucidité de traiter cette question, sans quoi on crée une République de la consommation culturelle. Ce n’est pas ce que nous voulons, nous voulons la vitalité des langues régionales, ce qui n’est pas la même chose.
Évidemment, cette position n’est pas facile à tenir, parce qu’elle est ensuite facilement caricaturée ; j’observerai d’ailleurs attentivement les commentaires médiatiques qui suivront, puisque, je le répète, les restitutions du précédent débat n’étaient pas spécialement objectives. Néanmoins, je tiendrai cette position, celle du dynamisme des langues régionales dans le cadre de l’équité, de l’équilibre, mais aussi d’un dynamisme « sérieux », c’est-à-dire permettant d’agir sur les causes profondes pour développer les langues régionales.
Oui, ce gouvernement agit en faveur des langues régionales ; oui, il y aura de nouveaux progrès. Cela passera peut-être par cette proposition de loi, si elle est adoptée définitivement, mais également par l’action de terrain. Cela suppose que l’on soit non dans le conflit, mais dans la construction collective ; si l’on se réfère aux principes que nous avons tous énoncés, normalement, nous sommes à peu près tous d’accord…
Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Bernard Buis applaudit également.

Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures cinq.

J’informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles et sur le projet de loi relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales sont parvenues à l’adoption de textes communs.

L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, la discussion de la proposition de loi constitutionnelle visant, face à la crise actuelle, à construire le monde d’après fondé sur la préservation des biens communs, présentée par Mme Nicole Bonnefoy et plusieurs de ses collègues (proposition n° 419 rectifié [2019-2020], résultat des travaux de la commission n° 169, rapport n° 168).
Dans la discussion générale, la parole est à Nicole Bonnefoy, auteure de la proposition de loi constitutionnelle.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis que je siège au Sénat, je me suis tout particulièrement consacrée à des travaux liés aux questions de santé environnementale, ainsi qu’aux risques climatiques et industriels.
Tous ces risques ont pour origine nos sociétés dites modernes et leur modèle de développement fondé sur le productivisme et le consumérisme à outrance, ainsi que la primauté de la loi du marché. Nous mesurons chaque jour les conséquences désastreuses de cette dernière sur le plan humain, social et environnemental.
Quelles réponses avons-nous vraiment apportées à ces risques qui ne sont pas nouveaux ? Sommes-nous, d’ailleurs, toujours capables d’apporter des réponses efficaces ? Celles que nous avons pu apporter sont-elles suffisantes ? Il semble que non.
Au contraire, nous constatons chaque jour, d’un côté, l’impuissance de l’État face à la toute-puissance des firmes globalisées qui cherchent à imposer leurs normes et, de l’autre, le recul de l’État face au rouleau compresseur du libéralisme économique.
La pandémie de covid-19 a déjà tué 1, 5 million de personnes à travers le monde et conduit, en quelques semaines, à une quasi-paralysie de pans entiers de l’activité économique. Par ses conséquences socioéconomiques d’une extrême gravité, le coût de cette pandémie est immense pour la société.
Son irruption en Chine ne doit rien au hasard : la puissance de ce pays est reconnue, voire enviée, notamment pour son insolente croissance économique. Pour autant, la Chine est-elle vraiment un modèle ?
Comme l’écrit l’économiste Éloi Laurent : « La Chine n’est pas “un modèle de croissance” : c’est le contre-modèle en crise d’une stratégie économique qui a trop longtemps donné la priorité à la croissance, et a de ce fait détruit et la santé, et l’environnement […]. Ce système, permis, guidé et alimenté par la croissance, est insoutenable : […] il travaille à sa propre perte au lieu d’œuvrer à sa perpétuation. »
Néanmoins, la Chine est-elle la seule coupable ? Inventée il y a un siècle environ en Occident, cette croissance constitua, certes, la réponse à la grande dépression des années 1930, mais ses excès provoquent, aujourd’hui, une crise écologique et sociale profonde qui met en danger nos institutions mêmes et notre propre civilisation.
Ce mode de production de masse, y compris notre mode de production agricole productiviste, a recouru activement aux pesticides et développé des élevages industriels intensifs hors-sol ; il a, vraisemblablement, atteint ses limites.
Avons-nous oublié la crise de la vache folle ? Nous pouvons lui ajouter les crises sanitaires zoonotiques récurrentes, comme la fièvre aphteuse, les grippes aviaire et porcine, etc. En recrachant dans l’atmosphère des tonnes de CO2 et en déversant autant de déchets, notre mode de production et de consommation de masse contamine l’air, pollue les sols, asphyxie les mers et les océans et provoque des crises climatiques dont les conséquences économiques et sociales ne sont pas moins violentes que celle des crises sanitaires. J’en veux pour preuve l’augmentation de la pauvreté, les famines dans certaines régions du monde, l’accessibilité plus difficile à la ressource en eau, les déplacements contraints des populations et l’augmentation des réfugiés climatiques.
Toutes ces crises soulignent les impasses d’un modèle de croissance à bout de souffle.
Comme le dit encore Éloi Laurent : « Nous nous pensions riches de notre destruction de la biosphère et de notre domination des espèces qui la peuplent et dont nous sommes en fait les partenaires, nous voici en quelques jours, par centaines de millions, isolés, immobilisés et bâillonnés, en un mot dominés par notre domination. » L’avenir de l’humanité ne survivra pas si nous continuons à détruire le monde vivant comme nous le faisons.
Cette crise sanitaire mondiale plaide donc, en premier lieu, pour une gouvernance mondiale rénovée, fondée sur la reconnaissance de notre appartenance à une communauté de destin. C’est l’objectif premier de ma proposition de loi, qui vise à inscrire la préservation des « biens communs mondiaux » dans notre Constitution.
Comme le souligne Mireille Delmas-Marty, professeure honoraire au Collège de France : « Il est urgent que d’autres pays, ou unions comme l’Europe s’intéressent aussi à ce destin commun de l’humanité afin d’éviter l’émergence ou la résurgence d’un Empire monde, d’où qu’il vienne. Il est grand temps que l’Europe se lève et se relève de toutes ses tentations souverainistes pour prendre en charge une partie du destin commun de l’humanité. »
Comment mieux protéger notre environnement ? Comment préserver la diversité de nos écosystèmes, de nos espèces et du monde vivant ? Comment prendre soin de la forêt amazonienne qui constitue un maillon essentiel dans la lutte contre le changement climatique, sans, pour autant, priver les populations autochtones de la jouissance de ce type de bien ?
La solution est, sans doute, de considérer que la forêt amazonienne fait partie des « biens communs mondiaux » en ce qu’elle constitue un bien non appropriable, contribuant au bien-être de tous et préservant la biodiversité qu’elle inclut.
Comme le souligne Mireille Delmas-Marty : « La qualification de “bien commun mondial” semble préférable à la reconnaissance de droits de la nature. […] Mieux vaut répondre par des catégories juridiques nouvelles à ces nouvelles questions que les catégories juridiques traditionnelles ne permettent pas de résoudre. »
C’est, précisément, l’objet premier de ma proposition de loi constitutionnelle : préserver le climat, la biodiversité, l’air ou encore la santé en promouvant un autre modèle de gouvernance mondiale fondée sur la reconnaissance de biens communs mondiaux et leur préservation.
Autrement dit, le futur vaccin de la covid-19 ne doit-il pas être considéré comme un bien commun accessible à tous, sans discrimination de quelque nature que ce soit, notamment de prix ?
Le deuxième objectif de ma proposition de loi est de promouvoir un régime juridique permettant d’encadrer l’exercice du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre, afin de préserver les biens communs.
Face à une artificialisation de plus en plus poussée des sols et à l’utilisation intensive des pesticides qui les appauvrissent ainsi qu’au risque d’une intensification des spéculations foncières qui pourraient remettre en cause notre sécurité et notre autonomie alimentaires, l’article 2 tend à inscrire dans le droit un nouvel équilibre permettant de réconcilier la liberté d’entreprendre avec la protection du sol, le partage du foncier agricole et la sécurité alimentaire.
En effet, ne devons-nous pas protéger nos terres d’un accaparement, par des firmes globalisées, des fonds de pension ou des fonds d’investissement étrangers dont la vocation est loin d’être agricole et qui, néanmoins, provoquent une forte spéculation foncière contraire à l’intérêt général et à la préservation de l’usage et de l’exploitation des terres agricoles ? À cet égard, les exemples, en France et en Europe, ne manquent pas : l’accaparement des terres viticoles en illustre la réalité.
Enfin, l’article 3 propose un nouvel équilibre entre la liberté d’entreprendre et le nécessaire respect des biens communs sans, bien évidemment, nuire à l’entreprise. Tel n’est, en effet, absolument pas l’objectif de cette proposition de loi : nous cherchons, au contraire, à concilier – ou plutôt à réconcilier – le respect des biens communs avec le droit de propriété et la liberté d’entreprendre.
Nous préférons considérer, comme nous le prouve la crise sanitaire et économique que nous traversons que, sans préservation du monde vivant, il n’y a pas d’économie possible.
Mes chers collègues, nous vivons un moment décisif pour l’humanité. Il est de notre devoir à tous de le mesurer et d’agir pour changer de paradigmes. La notion de « bien commun » permet précisément d’opérer ce changement, à la fois sur le plan international par l’inscription, dans notre Constitution, de la nécessité de préserver les biens communs mondiaux, que nationalement, cette notion ayant des déclinaisons très concrètes dans les territoires.
Ceux qui en douteraient devraient lire la série des six articles intitulée « Le retour des communs » publiée dans le journal Le Monde dont le premier s’ouvrait par l’interview de la juriste Judith Rochfeld avec le titre : « Les citoyens obligent leur gouvernement à réintégrer les communs en politique ».
Dans son discours aux Français du 13 mars dernier, le Président de la République ne disait pas autre chose : « Ce que révèle cette pandémie, c’est qu’il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie au fond à d’autres est une folie ».
Ces biens et services dont il est question sont, précisément, des « biens communs ». Ils peuvent être définis, comme l’a fait le juriste italien Stefano Rodotà, comme des choses matérielles ou immatérielles qui contribuent aux droits fondamentaux et au libre développement de la personne, autrement dit qui sont nécessaires au plein exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis.
Aussi, cette proposition de loi composée des trois articles que je défends devant vous, a pour objet d’apporter une réponse en renversant la hiérarchie des valeurs et en responsabilisant les acteurs, pour faire en sorte que les droits fondamentaux soient considérés comme les biens communs de l’humanité.
Ces biens communs ne peuvent être la propriété de personne, dès lors que nous en avons tous besoin pour vivre. Nous devons, à ce titre, les protéger et favoriser leur accès pour tous.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, cette proposition de loi constitutionnelle, au travers de la notion de « biens communs » et de « communs », vise le « réencastrement » de l’économie dans la société, pour nous permettre de repenser nos modes de production, de consommation et d’organisation, pour réinventer un modèle de vivre ensemble écologiquement soutenable, socialement inclusif et démocratiquement participatif.
Ces biens communs peuvent également s’imposer comme une réponse à la crise démocratique, en ce qu’ils permettent de concevoir de nouvelles formes d’organisation sociale plus solidaires, avec de nouveaux modes de gestion, d’appropriation et de partage. Les citoyens eux-mêmes nous le montrent déjà ; il convient que nous encouragions ce processus.
Puissions-nous voir la crise actuelle comme une opportunité qui nous aide à changer notre regard sur le monde, pour ne pas repartir comme si de rien n’était, mais, plutôt, pour nous attaquer aux causes profondes. L’homme n’est plus au centre du monde, mais fait partie de la nature dont il est une composante. Ne l’oublions pas.
Tel est l’objet de cette proposition de loi constitutionnelle que je vous appelle à voter, ce qui honorerait le Sénat.
Je regrette que la commission des lois, après avoir examiné ce texte, l’ait rejeté. Je salue, néanmoins, le travail sérieux du rapporteur qui, malgré tout, a bien compris les enjeux.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, effectivement, la commission des lois invite le Sénat à ne pas reprendre à son compte le texte en l’état de sa rédaction et du fait de ses effets juridiques trop incertains.
Néanmoins, cette proposition de loi constitutionnelle ouvre un débat très riche – ce n’est pas seulement une formule – en n’hésitant pas à ébranler certains piliers de notre ordre juridique interne et international. Ce débat doit se poursuivre, afin que nous puissions nous entendre sur un diagnostic, sur des objectifs à déterminer et sur les moyens les plus appropriés pour les atteindre. Le législateur est, sans conteste, le plus légitime pour cela.
Les questions abordées me semblent fondamentales pour l’avenir de notre société, comme le travail prospectif sur les évolutions souhaitables de notre droit.
Pour toutes ces raisons, je souhaite remercier chaleureusement Nicole Bonnefoy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain pour leur initiative et leur travail ainsi que le président de la commission des lois pour sa confiance.
Nicole Bonnefoy constate – elle vient de le faire de nouveau avec fougue, passion et ténacité – les impasses de notre modèle de développement, révélées par les crises écologique et sanitaire, par la progression des inégalités sociales et un niveau de chômage élevé depuis quarante ans.
Elle constate également l’affaiblissement de la coopération internationale, au moment même où sont plus évidentes l’interdépendance des nations et la nécessité d’une réponse globale à des problèmes mondiaux.
Pour répondre à ces différents constats, Nicole Bonnefoy nous propose plusieurs modifications de la Constitution française, questionnant, d’une part, le droit de propriété et la liberté d’entreprendre à des fins d’intérêt général et, d’autre part, la notion de souveraineté étatique.
L’un des moyens envisagés consisterait à inscrire dans notre loi fondamentale la notion de « biens communs » dont la « préservation » ou le « respect » seraient ainsi constitutionnellement garantis.
Seraient consacrés, par ailleurs, de nouveaux objectifs de valeur constitutionnelle tenant à la protection du sol, à la sécurité et à l’autonomie alimentaires, ainsi qu’un principe de conciliation entre le « respect des biens communs », d’une part, le droit de propriété et la liberté d’entreprendre, d’autre part.
J’ai rappelé, dans mon rapport, la notion de « bien commun » dans la théorie économique classique – ces ressources à la fois « non exclusives » et « rivales », accessibles à tous, mais insuffisantes pour tous –, la référence aux anciens commons, les anciens « communaux », comme la thèse de la « tragédie des communs ».
Cette dernière thèse a été battue en brèche, à partir des années 1980, par les travaux de l’Américaine Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie en 2008. Elle a montré comment des communautés de taille limitée parviennent à organiser la gestion de ressources communes, de manière à ce que tous les membres de la communauté y accèdent sans que la ressource s’épuise pour autant. Cette gestion repose sur la mise en place, par les utilisateurs eux-mêmes, d’un système de règles socialement sanctionnées.
Notons que la réflexion théorique sur les « communs de la connaissance », engagée dans les années 1990 a débouché sur des mouvements économiques et sociaux, tels que ceux des « logiciels libres » ou des « semences libres ». Plus largement, la notion de « biens communs » a été fortement mobilisée, depuis une vingtaine d’années, par ceux qui combattent les effets de politiques d’inspiration libérale, ou présentées comme telles.
La question est de savoir quelle traduction juridique donner à ces aspirations. La notion de « bien commun » n’existe pas en droit français. Celui-ci connaît, en revanche, toutes sortes d’institutions permettant d’organiser l’appropriation ou l’usage collectif de certaines ressources ou leur protection sur la longue durée.
Je pense, par exemple, à la propriété des personnes publiques, à l’usage de prérogatives de puissance publique pour limiter l’exercice de la propriété, aux différentes formes de propriété privée collective – l’indivision, la copropriété, la communauté de biens des époux, la propriété des personnes morales – ou encore à de nouvelles formes contractuelles permettant de conférer, à toutes les personnes qui le souhaitent, sous certaines conditions, des droits d’usage ou de jouissance sur certaines choses.
Consacrer, dans notre droit constitutionnel, la notion de « bien commun » supposerait, évidemment, de la définir préalablement et de préciser son articulation avec les catégories juridiques existantes. La tâche n’est pas impossible. Nous pourrions nous inspirer, à cette fin, des travaux menés en Italie par la commission Rodotà qui avait proposé d’inscrire dans le code civil italien la notion de beni comuni.
Par ailleurs, il nous faudrait avoir les idées très claires sur les effets juridiques que l’on voudrait produire en inscrivant dans la Constitution le principe de préservation des « biens communs ». Pour les auteurs de la proposition de loi constitutionnelle, il s’agirait d’abord de contrebalancer le poids excessif accordé, aujourd’hui, aux droits et libertés économiques dans nos textes et dans la jurisprudence constitutionnelle. Je ne suis pas sûr de les suivre sur ce point.
Le droit de propriété, la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle, protégés par la Constitution, ne jouissent d’aucune prépondérance par rapport aux autres principes et objectifs constitutionnels.
Le législateur conserve un large pouvoir d’appréciation pour décider si des atteintes aux droits et libertés économiques se justifient, au regard d’autres exigences de valeur constitutionnelle – comme le droit à l’emploi, le droit à un logement décent, la lutte contre la fraude fiscale –, ou même par de simples objectifs d’intérêt général.
Un examen attentif de quelques décisions du Conseil constitutionnel, souvent critiquées – à mon avis, à tort –, confirme ce constat. Ces décisions portent respectivement sur la contribution carbone, le reporting fiscal, pays par pays, des grandes entreprises, le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) et le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre.
Les auteurs du texte considèrent, en particulier, que le droit de propriété et la liberté d’entreprendre doivent pouvoir céder aux exigences liées à la protection de l’environnement. Or de fortes garanties sont offertes, à cet égard, par le bloc de constitutionnalité, surtout depuis l’entrée en vigueur de la Charte de l’environnement de 2004, qui consacre aussi bien des principes substantiels que des droits procéduraux.
En revanche, quelques points restent effectivement en suspens depuis l’entrée en vigueur de la Charte, qu’il s’agisse de la portée du principe de précaution ou encore de l’existence d’un principe de non-régression en matière de protection de l’environnement. En la matière, le présent texte aurait une portée symbolique non négligeable, puisqu’il permettrait d’inscrire le principe de préservation de l’environnement dans le corps même de la Constitution et de mentionner expressément l’exigence de protection du climat.
Outre l’objectif consistant à rééquilibrer la jurisprudence constitutionnelle relative aux droits et libertés économiques, nos collègues souhaitent, grâce à la consécration constitutionnelle de la notion de « biens communs mondiaux », contribuer à l’édification d’un nouveau modèle de gouvernance mondiale fondé sur la « souveraineté solidaire », voire sur « un État de droit opposable aux États ». Cet objectif est louable et, sans doute, largement partagé. Toutefois, le moyen employé est-il pertinent ?
À l’évidence, le renforcement de la coopération internationale, l’accroissement des obligations des États, la consolidation de leur responsabilité juridique internationale, voire la mise en place de nouveaux mécanismes de décision au niveau mondial n’impliquant pas l’unanimité des États, reposent, avant tout, sur la négociation et la conclusion de nouvelles conventions internationales, et non pas sur une modification de nos textes de droit interne.
Néanmoins, une révision de la Constitution française ne serait pas dénuée de tout effet juridique à cet égard. De nouvelles exigences de fond relatives à l’action de la France dans le monde pourraient servir de base au contrôle de constitutionnalité de nos engagements internationaux. Elles pourraient, également, être opposables aux actes de droit interne, dans la mesure où ceux-ci ont des conséquences globales dans la lignée de la décision du Conseil constitutionnel du 31 janvier 2020, qui a validé l’interdiction d’exportation, hors de l’Union européenne, de produits phytosanitaires qui n’y sont pas autorisés, au nom de la protection de l’environnement en tant que « patrimoine commun des êtres humains ».
Toutefois, pour produire de tels effets juridiques, les nouvelles dispositions constitutionnelles devraient avoir un contenu suffisamment clair et précis.
Sur mon rapport, la commission a estimé que, en l’espèce, tel n’est pas le cas. Néanmoins, et bien au contraire, elle ne s’oppose pas à une réflexion appelée par les enjeux contemporains, l’opinion publique et le mouvement du Conseil constitutionnel.
Permettez-moi d’esquisser trois interrogations pour la réflexion à venir.
Premièrement, le législateur souhaite-t-il en affirmant, par exemple dans le préambule de la Constitution, que « le Peuple français reconnaît qu’il partage une communauté de destin avec les autres peuples, qu’il contribue à la protection des biens communs mondiaux et favorise l’accès de tous à ces mêmes biens », fixer une ligne de conduite régissant l’action internationale de la France ? Il empêcherait la ratification ou l’approbation de conventions internationales contraires à ces principes sans, pour autant, soumettre la conduite des relations internationales de la France à un contrôle juridictionnel.
Le législateur souhaite-t-il s’autoriser à prendre en compte plus largement les effets des règles de droit interne sur la protection et l’accessibilité des « biens communs mondiaux » ?
Deuxièmement, le législateur souhaite-t-il affirmer lui-même l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, déjà consacré par la Charte de l’environnement, ajouter explicitement le climat parmi les composantes de l’environnement, consacrer le principe de non-régression en matière environnementale, non encore dégagé par la jurisprudence constitutionnelle ?
Troisièmement, le législateur souhaite-t-il définir lui-même les biens communs et leur régime juridique en s’inspirant, éventuellement, de la commission Rodotà et en s’intéressant, tout particulièrement, au domaine législatif et à l’article 34 de la Constitution ?
Voilà quelques esquisses de pistes pouvant prolonger l’initiative de nos collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et INDEP.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, madame la sénatrice Bonnefoy, mesdames, messieurs les sénateurs, des feux géants en Amazonie et en Australie, des océans ensevelis sous le plastique, des espèces qui disparaissent à un rythme sans précédent depuis des millénaires, notre planète qui se réchauffe : voilà la tragédie des biens communs !
Plus de cinquante ans après le cri d’alarme lancé par Garrett Hardin, ce n’est plus une théorie dans les manuels d’économie ou de sciences politiques ; il s’agit bien de notre monde et de notre réalité.
Le visage même de notre pays et de nos territoires change : les hêtres ne survivront pas dans la moitié sud du pays et, d’ici la fin du siècle, les glaciers des Alpes auront disparu.
Non, mesdames, messieurs les sénateurs, notre génération ne peut plus prétendre ignorer les conséquences de ses actes.
Nous ne pourrons pas dire à nos enfants que nous construisions leur avenir en saccageant les biens communs.
L’eau, sous toutes ses formes, l’air, la terre, la biodiversité sont les piliers qui soutiennent toute existence humaine et toute société. Notre devoir, notre responsabilité est de les protéger, de les transmettre, aussi intacts que possible, et de ne pas laisser le poids des lâchetés et des renoncements imprimer une marque indélébile sur notre planète.
Nous-mêmes, en tant qu’humains, subissons déjà le prix de cette tragédie. Je pense aux migrants climatiques. Je pense aux femmes et aux hommes qui voient leur Terre changer et s’appauvrir. Je pense à toutes celles et à tous ceux qui sont déjà en première ligne du changement climatique et de ses effets.
Pour eux, pour nous, nous devons inventer, reconstruire un autre avenir.
Il est encore temps d’agir.
Comme vous, madame la sénatrice Bonnefoy, dont je connais l’engagement de longue date sur le sujet, comme vous, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs qui présentez cette proposition de loi constitutionnelle, et, je le sais, comme toutes et tous les membres de cette chambre, je crois que nous ne reconstruirons la possibilité d’un futur qu’en préservant les biens communs.
Chaque génération a ses combats à mener. Le nôtre, le mien, c’est l’écologie. Et, pour livrer ses batailles, chaque époque se dote de ses règles, de ses normes morales, institutionnelles, techniques.
Mais, si nous partageons l’ambition farouche et la volonté tenace de protéger les biens communs, je crains que votre proposition de loi constitutionnelle ne permette pas de faire avancer ce noble combat.
En effet, je veux souligner que notre Charte de l’environnement englobe déjà, en substance, les modifications que vous proposez d’apporter par les articles 1er et 2 du texte. Je pense notamment à l’article 6 de la Charte, qui dispose que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. » Cette charte a une valeur constitutionnelle. Les biens communs sont donc au niveau de protection que vous demandez, le plus haut niveau possible dans notre pays.
Protestations sur les travées du groupe SER.
Par ailleurs, la notion de « communs », qui m’est chère, est insuffisamment définie dans votre proposition – je pense, par exemple, aux « communs informationnels » – pour que nous puissions placer cette notion au sommet de la pyramide des normes.
Enfin, la Convention citoyenne pour le climat avait proposé en substance d’encadrer le droit de propriété et la liberté d’entreprendre pour garantir le respect des biens communs, comme vous le prévoyez à l’article 3. (Exclamations sur les travées du groupe SER.) Et, vous le savez, le Président de la République avait alors mis en garde sur le risque de « placer la protection de l’environnement au-dessus des libertés publiques ». Je n’y suis donc pas favorable.
Si la révision de la Constitution est un outil dont on peut toujours continuer à débattre, je crois que notre époque, nos concitoyens, notre planète nous demandent surtout d’agir : agir maintenant, agir résolument et rapidement, agir pour produire des résultats concrets, agir pour changer la vie des Françaises et des Français et pour construire l’avenir des territoires de notre pays. Je suis d’accord avec vous pour dire qu’il y a urgence. Faisons-le maintenant !
C’est ce que nous faisons, en faisant le choix de l’écologie au cœur de la relance.
Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, jamais un Gouvernement n’avait consacré 30 % d’un plan de relance ni 30 milliards d’euros à la transition écologique. Ces moyens sont historiques. Nous en avons besoin pour transformer durablement notre pays, pour changer son ADN, en décarbonant l’économie, en construisant des filières d’avenir et en accompagnant chacune et chacun dans ce changement.
Oui, nous avançons, avec France Relance et l’ensemble de nos politiques publiques.
D’ailleurs, alors que nous allons célébrer le cinquième anniversaire de l’accord de Paris, nous pouvons déjà constater que le monde dans lequel nous vivons maintenant n’est plus le même que celui d’il y a cinq ans.
Depuis la signature de cet accord, six fois plus de voitures électriques se vendent en France.
Il y a cinq ans, il était impensable de déployer 1 000 kilomètres de pistes cyclables en quelques semaines, de réparer un million de vélos en quelques mois à peine, de remettre des millions de nos concitoyens en selle. Pourtant, nous l’avons fait.
En 2015, il n’y avait ni cap ni clarté sur l’avenir des chaudières au fioul, qui émettent chacune autant de CO2 que trois voitures. Nous avons fait en sorte que l’installation de nouvelles chaudières au fioul soit interdite dès 2022, les ménages pouvant compter sur l’État pour les aider à changer leur système de chauffage.
Bientôt, nous atteindrons l’objectif, fixé par le Président de la République, de protéger 30 % des espaces naturels sur terre et en mer. Deux parcs naturels ont été créés lors du conseil de défense écologique de juillet dernier, au mont Ventoux et dans la baie de Somme, en Picardie. Ce sont autant de coffres-forts de la biodiversité qui vont protéger la nature et l’incroyable richesse qu’abritent nos territoires, en métropole comme en outre-mer.
Isolément, ces exemples peuvent paraître bien modestes. Mais l’écologie, c’est aussi cela ! L’écologie n’est pas toujours spectaculaire. L’écologie, c’est tout ce travail de fourmi qui, à la fin, produit un résultat titanesque.
Cependant, je le sais aussi d’expérience, les solutions techniques, les budgets, les dispositifs ne font pas tout.
En réalité, c’est un changement profond qui est en train de s’opérer : une révolution dans nos idées, dans nos valeurs, dans la conception de notre manière de vivre, entre nous et au monde.
Dès lors, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je suis fière d’être une ministre de l’écologie qui peut dire que, enfin, nous changeons de modèle.
Oui, enfin, notre pays mène les grands chantiers de front, pour construire la France de demain, une France neutre en carbone, une France respectueuse des biens communs, résiliente et armée pour les immenses défis de ce siècle qui débute à peine. Notre pays y est prêt. Nous verrons si tout le monde l’est…
Nos concitoyens nous attendent. Les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat l’ont écrit.
Marques d ’ ironie sur les mêmes travées.
Aujourd’hui, un plan de relance, aussi ambitieux soit-il, ne serait évidemment pas suffisant. Nous allons au-delà.
Aujourd’hui, dans notre pays, avec la mise en œuvre des mesures de la Convention citoyenne, nous mettons l’écologie en haut de l’agenda, pour mettre un terme à l’étalement urbain, à cette « artificialisation » dont Nicole Bonnefoy a parlé, et sortir d’un modèle issu du siècle dernier, qui avale la nature. Nous la mettons en haut de l’agenda pour réguler la publicité, pour généraliser l’éducation à l’environnement tout au long de la vie, pour favoriser le train et réduire les vols domestiques.
Imaginait-on, voilà cinq ans, que les vols domestiques seraient interdits quand une alternative en train existe ?

M. Jean-Pierre Sueur. Il y a cinq ans, nous étions dans les ténèbres… C’était la nuit !
Sourires sur les travées du groupe SER.
Aucun autre pays ne l’a fait !
Nous avons créé un délit d’écocide et écrit dans notre droit que nous ne tolérerons plus ces agissements.
Et même si nous devons poursuivre les efforts pour atteindre les objectifs climatiques que nous nous sommes fixés, jamais aucun pays n’a mené un exercice aussi ambitieux en si peu de temps. Jamais aucun gouvernement n’a répondu si rapidement à l’appel des citoyennes et des citoyens !
J’entends bien qu’il faut toujours faire plus, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Vous me trouverez toujours à vos côtés pour pousser, pour faire plus.
Monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, au-delà d’une modification constitutionnelle, qui prendra du temps, je crois que construire un autre monde, protéger les biens communs, sans lesquels nous n’avons pas d’avenir, transcende nos appartenances politiques. Cela dépasse nos divergences. Je dirai même que cela dépasse chacune de nos existences.
Nous avons la même ambition et la même passion. C’est ensemble que nous y arriverons, si nous réussissons à nous entendre sur les moyens d’y arriver.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souscris totalement au constat formulé dans l’exposé des motifs de cette proposition de loi constitutionnelle.

Selon celui-ci, la crise sanitaire a révélé, « d’un côté, les dégâts du libéralisme économique et d’une mondialisation non régulée et, de l’autre, l’état de décohésion de notre société et la mise en danger de nos écosystèmes ».
Face à la crise de la mondialisation que nous connaissons aujourd’hui et qui a créé, comme vous le dites très bien, chers collègues, une société ultra-individualiste et marchande, vous proposez une approche en termes de « biens communs ».
J’aimerais faire preuve de bienveillance à votre égard, mais qu’est-ce que le bien commun ? Voilà toute la question.
Le bien de chacun et le bien de la communauté au plan matériel et social consistent à rechercher ensemble les conditions sociales qui permettent le développement et le bien de l’humanité. Il y a un objectif social dans la recherche du bien commun. Celui-ci a trait à l’eau, à l’alimentation, au logement, au travail, à l’éducation, à l’environnement, à la biodiversité, aux transports, aux soins, à la culture, à la religion.
Le bien commun, c’est ce qui doit guider notre action de législateurs, car la première justification de la politique, de mon engagement comme du vôtre, chers collègues, est d’œuvrer pour le bien commun.
Le problème est que la notion de « bien commun » demeure très largement un objet juridique mal identifié, qui n’a guère reçu de consécration en droit français. Le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 31 janvier 2020, consacré l’objectif de valeur constitutionnelle de « protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains », tiré du préambule de la Charte de l’environnement.
L’absence de définition solide de cette notion, dans son texte lui-même comme dans le reste de l’ordre juridique, est la faiblesse de cette proposition de loi, relevée d’ailleurs par M. le rapporteur et par un certain nombre de sénateurs en commission. Cette absence est de nature à la fois à fragiliser son application et à laisser de facto au seul juge constitutionnel la responsabilité de fixer, par son interprétation, les contours du concept. Il convient de ne pas laisser la porte ouverte à l’interprétation, donc au relativisme.
La proposition de loi procède, en substance, à des modifications de nature à inscrire directement et à de multiples endroits dans le corps du texte constitutionnel des principes de protection de l’environnement et à introduire un certain nombre de notions nouvelles en droit, en lien avec les « biens communs ». Ces modifications comprendraient en particulier des dispositions garantissant constitutionnellement la possibilité pour le législateur de limiter les droits de propriété et la liberté d’entreprise lorsqu’il s’agit de protéger ces « biens communs ».
Une autre question soulevée est celle de l’opérativité du concept de « biens communs mondiaux » dans la perspective de sa présence au sein du seul droit constitutionnel français. Les auteurs de la proposition de loi constitutionnelle affirment vouloir créer une forme d’« État de droit opposable aux États ». Toutefois, si la Constitution oriente nécessairement l’action internationale de la République française, elle n’est pas de nature à amener à elle seule la « souveraineté solidaire » des États, autre notion assez vague invoquée par les auteurs du texte. Il s’agirait in fine d’inscrire dans la Constitution une pétition de principe susceptible d’interférer avec les relations qu’entretient la France avec les autres pays du monde.
La recherche du bien commun traduit une espérance profonde de l’humanité dans son existence politique, économique et sociale. Dans un monde marqué par l’individualisme et le communautarisme, comment répondre aux urgences et aux défis de cette espérance ?
Je pense, à titre personnel, que la première réponse est de retrouver notre souveraineté et notre liberté.
Cette mondialisation déréglée constitue une attaque directe contre l’environnement, nos emplois et notre modèle, lequel doit contrer une logique commerciale qui est maîtresse de tous les échanges aujourd’hui, avec les limites que cela comporte.
Nos institutions, nationales comme européennes, sont aujourd’hui affaiblies à cause d’une administration surpuissante et des excès de normes parfois incompréhensibles. Elles ne nous protègent plus.
Nous payons le court-termisme des politiques publiques. La réindustrialisation et la valorisation des filières stratégiques, que ce soit l’agriculture, la santé ou la défense, sont indispensables. Notre autonomie et notre souveraineté alimentaires sont vitales pour notre sécurité sanitaire et environnementale.
Il nous faut réapprendre à produire ce que nous consommons. Dans un marché de 500 millions d’habitants comme celui de l’Union européenne, nous devons pouvoir trouver un point d’équilibre et de l’éthique.
Nous devons réaffirmer que nous croyons aux échanges, à la force de nos entreprises, à la compétence de nos entrepreneurs et de nos agriculteurs et à l’excellence de nos savoir-faire. Mais pour que cette liberté d’échanger ait un sens, il faut que les règles soient les mêmes pour tous ! C’est une réciprocité qu’il faut rechercher dans nos échanges.
Une seconde réponse, après la souveraineté, consiste à s’appuyer sur les corps intermédiaires pour défendre notre bien commun.
Je crois que les Français doivent retrouver confiance en eux et en leur pays. Les corps intermédiaires, que sont les familles, les entreprises, les territoires, nos communes à taille humaine, espaces de vie sociale et d’apprentissage de l’engagement, nos associations, avec l’engagement bénévole associatif, garantissent une préservation du bien commun. Ils aident aussi à une responsabilité collective et sont un frein aux risques d’abus du pouvoir d’en haut.
J’insiste sur la famille, corps intermédiaire qui fait aussi partie du bien commun et qui assume un rôle social indispensable.
La protection des biens communs peut être assurée par ces corps intermédiaires plus que par le droit constitutionnel.
Il faut, pour cela, engager des réformes en profondeur dans notre pays, en particulier de l’administration, qui a un poids trop important – 35 % en France, contre 24 % en Allemagne.
Il y a trop de technocratie, et celle-ci est parfois guidée par l’application excessive d’un principe de précaution qui étouffe la liberté entrepreneuriale et l’innovation dans les territoires. Il n’y a pas d’avancées humaines sans prise de risque ni liberté. Donnons davantage de liberté !
Faisons confiance à l’intelligence collective pour développer un esprit d’entreprise. Nos territoires regorgent d’atouts dans ce domaine. Je le mesure chaque jour dans mon département, où fleurissent des initiatives très positives pour défendre le bien commun et agir en sa faveur.
Il me semble que, pour protéger les biens communs, nous devons retrouver notre souveraineté et notre liberté. Le texte que nous examinons aujourd’hui ouvre un débat intéressant, mais je pense qu’il faut aller au-delà.
Le groupe Les Républicains votera contre cette proposition de loi constitutionnelle.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. le rapporteur applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi constitutionnelle que nous examinons cet après-midi vise à inscrire dans la Constitution l’engagement de l’État à protéger les « biens communs mondiaux ».
Seraient par ailleurs consacrés de nouveaux objectifs de valeur constitutionnelle tenant à la protection du sol et à la sécurité et à l’autonomie alimentaires, ainsi qu’un principe de conciliation entre, d’une part, le « respect des biens communs » et, d’autre part, le droit de propriété et la liberté d’entreprendre.
Historiquement, la notion de « biens communs » est avant tout de nature économique.
Lorsque, en 1968, paraît l’article de l’écologue américain Garrett Hardin, « La tragédie des communs », à part les historiens et les lecteurs de Karl Marx ou de Karl Polanyi, tous les économistes semblaient avoir oublié la notion de « biens communs ». Dans cet article, l’auteur estime que chacun est guidé par son avidité et va essayer de bénéficier au mieux des biens communs, sans prendre en charge leur renouvellement. Il en conclut que la gestion optimale des biens communs passe soit par la privatisation du bien considéré, soit par la nationalisation, et qu’il vaut mieux créer des inégalités que conduire à la ruine de tous.
Cet article va rester une référence longtemps, jusqu’à ce que, en 1990, Elinor Ostrom conteste cette théorie, en faisant le récit de nombreux cas où des groupes réussissent à échapper à la tragédie des communs décrite par Garrett Hardin. Plutôt que des pièges qui se referment systématiquement sur les individus, elle décrit des formes d’ingéniosité collective, qui permettent de gérer de manière pérenne des ressources communes. Elinor Ostrom sera la première femme à obtenir, en 2009, le prix Nobel d’économie, pour ses développements sur la théorie des communs.
En droit français, la notion de « biens communs » est inconnue. En revanche, notre droit connaît les « choses communes », qui ne sont pas susceptibles d’appropriation, comme l’air ou l’atmosphère, ou bien les choses « hors commerce », placées par la loi en dehors de la sphère des échanges civils et commerciaux, tels que les éléments du corps humain ou les droits extrapatrimoniaux.
Il existe également diverses institutions juridiques organisant la propriété, l’usage ou la jouissance collectifs de certains biens, notamment le domaine public, les « licences libres » ou encore des modes collectifs de propriété privée, tels que la communauté de biens des époux, l’indivision, la copropriété ou la propriété des personnes morales.
En outre, notre droit reconnaît à la puissance publique diverses prérogatives pour porter atteinte à la propriété privée à des fins d’intérêt général. Je veux parler du droit d’expropriation, du droit de préemption ou encore du droit d’imposer des servitudes d’utilité publique.
Selon les auteurs de la proposition de loi constitutionnelle, la protection effective des « biens communs » impliquerait de contrebalancer le poids excessif accordé aujourd’hui aux droits et libertés économiques dans la jurisprudence constitutionnelle. Or le droit de propriété, la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle, qui sont certes protégés par la Constitution, ne jouissent d’aucune prépondérance par rapport aux autres principes et objectifs constitutionnels.
Madame la ministre, mes chers collègues, un grand nombre de catégories et d’institutions juridiques peuvent être utilisées pour construire des régimes visant à protéger certaines ressources ou à en garantir l’usage partagé.
La notion de « biens communs » n’apparaît pas suffisamment définie et sa consécration dans la Constitution ne semble pas utile pour atteindre les objectifs visés.
Pour ces raisons, le groupe Les Indépendants s’abstiendra sur ce texte.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les actions du Gouvernement ne vont pas à la vitesse des urgences climatiques et écologiques. Vous le savez, madame la ministre, car je connais vos convictions ainsi que leur sincérité.
Je remercie Mme Bonnefoy et ses collègues de proposer à notre réflexion et à notre étude la place que peuvent occuper les biens communs.
Ces derniers peuvent être définis de différentes façons. Ils procèdent d’une nouvelle classification des biens dans la sphère économique. Il s’agit de biens rivaux, dont la consommation par une personne va diminuer la capacité de consommation par une autre personne, et de biens non exclusifs, dont l’accès ne peut être restreint.
Les biens communs étant souvent des biens ressources, ils sont aujourd’hui de plus en plus nombreux, du fait de la diminution des ressources naturelles. C’est vrai pour les biens communs en France comme pour les biens communs de l’humanité, à l’instar de l’eau.
Je comprends très bien qu’il puisse être compliqué de légiférer à ce sujet, monsieur le rapporteur. Vous avez raison.
Cela dit, devons-nous ne rien faire ?
En bon méridional que je suis, je veux vous citer l’exemple des prud’homies de pêche de Marseille au travers des siècles. Ces dernières existent depuis le Moyen Âge. L’équilibre qui a été trouvé par les pêcheries locales, dans les restrictions acceptées par tous pour les zones et les jours de pêche, dans la résolution des conflits, dans la répartition des ressources et dans l’attention portée au renouvellement de la ressource en poissons pour éviter tout épuisement irréparable a été exemplaire, mais cette gestion du bien commun a été mise à mal par deux éléments qui permettent de comprendre l’intérêt réel de cette proposition de loi constitutionnelle pour la protection des biens communs : l’arrivée de nouvelles technologies de pêche, qui a perturbé l’équilibre du processus de renouvellement de la ressource, le « progrès » n’étant pas toujours source de bien-être, et l’arrivée de pêcheurs venus de l’extérieur, qui a fait basculer l’équilibre compétitif, puisqu’il s’agissait d’un intérêt commercial, et marqué la fin de l’acceptation de ces règles d’exploitation durable.
Il me semble important de tirer les enseignements de cette expérience. Au vu du contexte actuel, cet avertissement devrait nous amener à avoir pour ambition une gouvernance à long terme, acceptée par tous, garantissant une répartition équitable des biens communs et assurant la préservation de l’environnement, de la biodiversité, de l’eau et de l’air – de la vie, en quelque sorte.
Les auteurs du texte qui est soumis à notre examen nous interpellent sur la nécessité de penser ces biens communs comme des biens réellement à part, mais leur qualification ainsi que la portée et la valeur juridique de leur inscription dans la Constitution laissent encore des questions en suspens.
Comment inscrire la protection effective de ces biens communs en tenant compte du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre ? On l’a fait à moult reprises quand on a dû exproprier pour construire des lignes de TGV – pas toujours très bien d’ailleurs. On l’a également fait dans le cadre de la santé, via la production et la distribution de médicaments sous le régime de licences d’office. Nous acceptons donc d’ores et déjà, dans certains cas, que l’intérêt général prime sur des intérêts privés et sur ces autres droits.
La préservation de la biodiversité ne devrait-elle pas accéder à ce statut d’intérêt général ? Alors que les règles de la mondialisation ne prennent pas en compte l’aspect durable de l’exploitation des ressources naturelles, comme le montrent les choix faits par l’Europe, dictés par des normes comptables, il est temps, me semble-t-il, de commencer à prendre des mesures juridiques pour préserver nos biens communs.
L’introduction de la notion de protection des biens communs mondiaux au niveau constitutionnel, le renvoi au pouvoir législatif de la protection des sols et de l’autonomie alimentaire, mais aussi des mesures garantissant le respect des biens communs par l’encadrement du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre, tels sont les objectifs du texte qui nous est proposé.
Notre groupe adhère à ces objectifs, approuve la démarche et défend cette inscription au cœur de la Constitution. Il votera donc cette proposition de loi.
La pétition « Notre affaire à tous », qui a recueilli plus de 2 millions de signataires, s’est transformée en une action en justice, qui a déjà obtenu gain de cause une fois et va se perpétuer, montre bien que la voie juridique doit également être utilisée.
Les auteurs de la proposition de loi constitutionnelle ont raison de montrer que le niveau supranational est le niveau de réflexion nécessaire de protection pour la préservation de nos biens communs. Nombreux y verront un optimisme infondé, mais, dans notre démarche, qui va du local au global, c’est notre pays, le local, qui doit prendre l’initiative. Nous invitons le Gouvernement à tout mettre en œuvre et à agir d’une manière rapide et concrète dès maintenant pour une protection globale des biens communs, que ce soit au niveau français, européen ou mondial.
Applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le monde d’après, c’est le monde que nous laissons à nos petits-enfants. Certains d’entre eux ne sont même pas encore nés. Certains essaient déjà aujourd’hui, au quotidien, d’imaginer des solutions pour rendre ce monde viable.
Pour leur faciliter la tâche, nous devons relever plusieurs grands défis qui se dressent face à nous : le défi social, le défi climatique, le défi sécuritaire. Sans aucun doute, ces défis se rejoignent en plusieurs points. Ils convergent autour des notions de « souveraineté », d’« écologie » et de « biens communs ».
Cette proposition de loi constitutionnelle, déposée par le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain en mai 2020, vise à modifier l’article 1er et l’article 34 de la Constitution afin d’y conforter l’objectif de préservation de l’environnement et d’y introduire la notion de « biens communs ».
Examinée en commission des lois le mercredi 2 décembre dernier, elle a été rejetée. En effet, sa rédaction est apparue trop imprécise au rapporteur Arnaud de Belenet, s’agissant notamment de la notion de « biens communs », qui n’est pas définie en droit français.
Toute révision constitutionnelle appelle un regard acéré, en ce qu’elle implique une procédure extrêmement lourde et complexe. Ce n’est pas par amour de la technocratie, mais parce qu’il s’agit du texte suprême de notre ordre juridique. Y opérer des modifications au gré des évolutions de l’opinion publique serait dégrader sa valeur et sa portée.
Bien sûr, le pouvoir constituant est souverain pour modifier ce qu’il entend au sein la Constitution, hormis la forme républicaine du Gouvernement, protégée par l’article 89, alinéa 5. Bien sûr, nous avons la capacité de nous ériger en ce pouvoir constituant, le Conseil constitutionnel refusant de contrôler les lois de révision.
Pour autant, le véhicule proposé est-il le plus adapté ? L’exposé des motifs de cette proposition de loi est très peu précis s’agissant de ses objets : « Transformer la souveraineté solitaire des États en souveraineté solidaire et leurs irresponsabilités illimitées en responsabilités communes mais différenciées. » L’idée est, plus généralement, d’autoriser le législateur à porter plus largement atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre à des fins d’intérêt général.
Bien évidemment, nous partageons l’objectif que soient prises en compte ces exigences par la jurisprudence constitutionnelle. Cependant, le Sénat est la chambre de la prudence, du recul et de la puissance qui s’inscrit dans le temps. Il ne pouvait se borner à s’incliner devant l’objet d’un texte sans en examiner attentivement le contenu.
À ce titre, il paraissait nécessaire de s’interroger sur ce que permet de faire le cadre constitutionnel en vigueur.
Comme cela a déjà été dit, la Charte de l’environnement a été intégrée au bloc de constitutionnalité en 2005. Le Conseil constitutionnel a notamment tiré de son préambule, en 2020, un nouvel objectif de valeur constitutionnelle de « protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains ». Il a également retenu, sur ce fondement, que le législateur pouvait tenir compte des effets des activités exercées en France sur l’environnement à l’étranger. Il doit, enfin, se prononcer prochainement sur le principe de non-régression. Le cadre constitutionnel actuel porte ainsi haut les objectifs des auteurs de ce texte.
Il existe un chemin pour mettre en œuvre ces objectifs sans contrevenir à la Constitution. La Convention citoyenne pour le climat avait d’ailleurs fait des propositions en ce sens.
Le projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique, présenté par le Gouvernement le 29 août 2019, prévoyait déjà l’ajout d’une phrase selon laquelle la France « favorise la préservation de l’environnement, la diversité biologique et l’action contre les changements climatiques ».
Aujourd’hui, deux points nous interrogent dans la rédaction de la présente proposition de loi : d’une part, certains termes nous apparaissent trop imprécis et trop incertains dans leurs effets. C’est le cas de la notion de « biens communs », notion de théorie économique fondée sur les critères de non-exclusivité et de rivalité, mais qui n’est pas définie en droit. Cette notion pourrait donc recevoir un contenu extensif selon l’application qu’en feront les législateurs futurs.
De même, la notion d’« autonomie alimentaire » pourrait, à l’avenir, contrevenir aux principes du droit européen tels que la libre circulation et la non-discrimination, ou encore venir se heurter au marché agricole commun.
D’autre part, l’article 3 nous pose quelques questions en ce qu’il semble introduire une hiérarchie générale au détriment du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre. Cette hiérarchie pourrait fonder des mesures économiques et fiscales très défavorables aux TPE et PME.
Plus généralement, le législateur doit travailler en tenant compte de la jurisprudence constitutionnelle lorsqu’il élabore la loi ordinaire. Nous aurons d’ailleurs l’occasion de le faire lors de l’examen du projet de loi annoncé par le Gouvernement, dans la continuité de la Convention citoyenne pour le climat, qui devrait notamment renforcer la lutte contre le banditisme environnemental.

Je pense à l’infraction générale de pollution de l’eau, du sol, de l’air, au délit d’écocide ou encore à l’augmentation des sanctions applicables aux personnes morales.
Mes chers collègues, comme les révisions antérieures nous l’ont montré, l’introduction dans la Constitution d’un objectif peut être préférée à une notion clivante et indéfinie. La loi constitutionnelle du 8 juillet 1999, qui préférait l’introduction d’un simple objectif d’« égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives » en offre un bon exemple. Aujourd’hui, soyons la chambre de l’action et de la mesure, pas celle des mots et des effets d’annonce.
Pour toutes les raisons évoquées, le groupe RDPI votera contre cette proposition de loi constitutionnelle.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, voilà une trentaine d’années, le professeur Maurice Bourjol, historien du droit local, publiait un ouvrage intitulé Les biens communaux, voyage au centre de la propriété collective, dans lequel il se consacrait avec érudition à l’histoire et à la théorie des biens communaux à travers le souvenir des communautés d’habitants de l’Ancien Régime.
Il introduisait son propos par ces quelques mots : « “Biens communaux” et “commune” apparaissent comme les deux éléments indissociables d’un “corps moral” immortel formé par les générations passées, présentes et à venir. À cet ordre éternel des choses, l’État superpose ses normes et sa culture. »
Certes, depuis la parution de ces lignes, en 1989, le discours s’est transformé : il n’est plus seulement question de « biens communaux », mais plus vastement de « biens communs », de sorte que leur dimension n’est plus seulement locale et communale, mais aussi mondiale, voire universelle. On ne parle plus de « patrimoine commun des communautés d’habitants », mais, comme le propose la Charte de l’environnement, de « patrimoine commun des êtres humains ».
Nous sommes ainsi passés des pâturages ruraux et villageois à la forêt amazonienne ou encore à des choses immatérielles telles que les encyclopédies numériques libres.
Pour autant, bien que vertigineux, le glissement entre notre discours et celui de l’historien met en évidence deux éléments qui demeurent invariables.
Il s’agit d’abord de la transmission de ces biens, de génération en génération. Cette problématique est largement mise en lumière par les préoccupations écologiques et de préservation de l’environnement.
Il s’agit ensuite du rôle de l’État, législateur ou constituant, auquel il revient de fixer un régime juridique pour ces biens. Que nous les qualifiions de mondiaux ou de communaux, c’est d’abord à l’État qu’il incombe de fixer les règles quant à l’administration et à la protection de ces biens. Autrement dit, si le cadre national n’est pas suffisant pour protéger ces biens communs mondiaux, nous ne pouvons pour autant nous dérober face aux enjeux qu’ils soulèvent dans nos sociétés actuelles.
Ainsi, il y a lieu de se réjouir que soit engagée, dans cet hémicycle, une réflexion sur le traitement réservé aux biens communs. Nos échanges contribueront à ce qu’ils puissent être mieux appréhendés, mieux pensés et mieux encadrés afin notamment de concilier leur usage avec la liberté d’entreprendre.
Cela étant, alors même qu’il pourrait sembler nécessaire de penser le régime de ces biens, il faut également constater qu’ils mettent à l’épreuve nos définitions et nos qualifications juridiques traditionnelles.
Comment les définir ? Ni biens privés ni biens publics, mais plutôt biens collectifs, dont l’usage est partagé par tous. C’est dans cet entre-deux que naît la tension, et donc le débat légitime qui entoure leur régime juridique.
Ces quelques éléments, bien que succincts, suffisent à révéler que la notion n’est pas née avec le « monde d’après », pour reprendre la formule mise en avant par les auteurs de cette proposition de loi. Et pour preuve, notre droit s’y intéresse déjà.
Je ne referai pas la liste des textes et jurisprudences traitant de la question des biens communs. Toutefois, je me permettrai de revenir sur la récente décision du Conseil constitutionnel du 31 janvier 2020 : à travers son interprétation de la Charte sur l’environnement, le Conseil a dégagé, en des termes inédits, un objectif de valeur constitutionnelle de « protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains ». Le texte dont nous discutons aujourd’hui s’inscrit naturellement dans cette actualité. Il n’est donc pas question de minimiser les enjeux qui y sont liés.
Toutefois, cette décision remonte à moins d’un an. De même, nous croyons que certaines potentialités normatives de la Charte de l’environnement – adossée à la Constitution en 2005 – restent encore à découvrir, notamment dans son préambule qui dispose, au nom du peuple français, que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains. Laissons-nous le temps de poursuivre notre réflexion et d’affiner nos idées, surtout sur un sujet aussi fondamental. Laissons aussi le temps aux dispositifs juridiques existants de produire pleinement leurs effets pour être mieux à même de les réaménager et de les renforcer le jour venu.
Aussi, vous l’aurez compris, au regard de ces éléments, le groupe RDSE ne votera pas en faveur du texte.
Mme Nicole Duranton applaudit.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi trouve ses racines dans des débats très anciens. Ainsi, Aristote déplorait que : « Ce qui est commun à tous fait l’objet de moins de soins, car les hommes s’intéressent davantage à ce qui est à eux qu’à ce qu’ils possèdent en commun avec leurs semblables. »
Les auteurs de cette proposition de loi s’appuient donc sur un concept ancien, mais qui trouve un certain écho chez les économistes et philosophes contemporains. Au travers de l’exposé des motifs, ils contestent le carcan de la loi du marché et dénoncent son incapacité à préserver ces communs, au premier chef les ressources naturelles.
Une telle reconnaissance de « biens communs », même si les contours de cette notion restent très flous et juridiquement mal définis, permet un changement de l’échelle des valeurs en reléguant les notions de profit et de rentabilité derrière les besoins premiers des hommes.
Nous apprécions le fait que cette proposition de loi désigne très directement et très clairement le libéralisme comme la source des dérèglements mondiaux, qu’ils soient climatiques, migratoires ou financiers.
Pour notre part, mes chers collègues, nous ne le découvrons pas. Nous portons ces convictions depuis toujours. Le marché est incompatible avec la protection des biens communs et, plus largement, avec la défense de l’intérêt général.
En entrelaçant les enjeux mondiaux et nationaux, cette proposition de loi témoigne également d’une approche intéressante, fondée sur les interactions de souverainetés nationales qui pourraient trouver des débouchés collectifs – une vision intéressante de ce que pourrait être un ordre mondial progressiste.
Cette évolution, que l’on retrouve dans plusieurs mouvements au niveau mondial, témoigne d’une volonté de changer de paradigme, notamment au sein de la jeunesse. C’est un espoir immense.
Derrière cette remise en cause globale, permettant l’affirmation d’une souveraineté réinventée autour d’un humanisme nouveau, il y a, chez les auteurs de cette proposition de loi, une volonté plus pragmatique : s’opposer à une censure du Conseil constitutionnel sur des lois votées par le Parlement et utiles à nos sociétés. L’opérationnalité de cette proposition de loi se résume à cela : encadrer les décisions du Conseil constitutionnel.
Nous y sommes favorables, tout en y trouvant des limites. Les objectifs définis par la réécriture de la Constitution resteront en balance avec d’autres objectifs et principes constitutionnels. Le libre arbitre du Conseil constitutionnel pour concilier différents principes de même valeur restera ainsi plein et entier, ce qui pose, au fond, la question de la légitimité de cette instance. Mais il s’agit d’un autre débat…
Par ailleurs, la reconnaissance de « biens communs », si essentielle soit-elle, par la définition d’une nouvelle catégorie juridique, ne suffira malheureusement pas à les protéger.
La Constitution énonce beaucoup de droits – au travail, à la santé, au logement digne… –, sans qu’ils soient pour autant réellement garantis. Ils demeurent des droits incomplètement satisfaits du fait des politiques menées et des choix budgétaires qui en résultent. Il y a les concepts, les mots, et il y a le droit.
Derrière les biens communs, il y a donc des droits humains, notamment celui de vivre dignement dans un environnement sain. Pour garantir ces droits humains, il existe des outils, traduits dans des lois et dans la Constitution. Je pense aux services publics, mais aussi, plus largement, aux politiques publiques.
Alors que l’exposé des motifs rappelle l’intérêt des services publics en tant qu’amortisseurs de crise, nous regrettons que les fermetures de lits et la privatisation rampante de l’hôpital public aient débuté bien avant la présidence actuelle.
Pour notre sensibilité politique, dont l’objectif de défense des « communs » reste une constante, l’hôpital, et donc aussi la santé, relève d’un bien commun. L’affirmation de ce droit implique alors des engagements politiques tels que le retour d’une souveraineté industrielle. C’est ce que nous vous avons proposé hier, au travers de notre proposition de loi portant création d’un pôle public du médicament, sans succès. Les concepts ont donc besoin de s’ancrer dans des politiques.
Pour nous, la protection des biens communs va au-delà des principes de cette proposition de loi. Il s’agit tout simplement de la protection de l’intérêt général, dont font partie non seulement les ressources naturelles, mais également les services publics et les biens publics – l’énergie, l’eau, les transports, l’hôpital… Il s’agit d’autant d’outils de garantie des droits de nos concitoyens : se loger, se soigner, s’éduquer…
La protection des biens communs, telle que la proposent les auteurs de ce texte – sur lequel nous émettrons un vote positif –, nous semble nécessaire, mais insuffisante. En conclusion, nous aimerions allier la reconnaissance des biens communs à celle de droits garantis par la Constitution et à des outils opérationnels sous le contrôle démocratique de nos concitoyens. Voilà la direction et les valeurs que nous défendons.
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et SER. – M. Daniel Salmon applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier le rapporteur pour son travail, dans lequel il a mis beaucoup de cœur, d’énergie et de réflexion. Nos échanges avec lui ont été très constructifs.
Évidemment, nous restons au milieu du gué, puisque M. de Belenet a demandé à la commission de rejeter ce texte, ce dont nous ne pouvons nous satisfaire. Cependant, inciter la commission à se pencher sur la notion de « biens communs » constitue pour nous une première victoire.
L’ambition du texte de Mme Bonnefoy peut effrayer. Rappelons que mon estimée collègue est extrêmement opiniâtre, sérieuse, et qu’elle travaille dans le concret. D’ailleurs, un certain nombre de ses propositions de loi ont été adoptées, alors que le résultat n’était pas garanti, souvent avec le soutien de l’ensemble du Sénat, parce qu’elles sont ancrées dans la réalité.
C’est le cas de la thématique des biens communs, laquelle est tout à fait documentée, comme le souligne le rapport. Les auditions que nous avons menées attestent qu’il s’agit d’une thématique émergente. C’est d’ailleurs l’honneur du Sénat d’avoir été, ces dernières années, à la pointe des conquêtes juridiques les plus importantes. À titre d’exemple, je mentionnerai le travail de notre collègue Retailleau sur le préjudice écologique, celui de notre collègue Nicole Bonnefoy sur l’indemnisation des victimes de produits phytosanitaires ou encore le texte relatif à l’écocide, même s’il a été rejeté. Mme la ministre, qui appartient à un gouvernement qui tente de s’emparer de la notion d’écocide, même s’il en minimise, selon moi, la portée, ne me contredira certainement pas sur ce rôle d’aiguillon, ce rôle prospectif du Sénat.
Je rappelle également la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Notre collègue Christophe-André Frassa, alors rapporteur, avait désossé ce texte avec toute la rondeur que nous lui connaissons, ses trois articles ayant été supprimés. Mais à l’autre bout de la planète, au Bangladesh, où je suis allé visiter une usine textile, j’ai pu constater que le petit bout de droit que nous avions modifié produisait des effets au quotidien. Nous ne sommes donc pas dans un débat philosophique, nous agissons concrètement sur la vie des personnes. S’agissant de la notion de « biens communs », c’est bien cet objectif qui est visé.
Nous ne devons toucher à la Constitution qu’avec une main tremblante, mais l’implication de Nicole Bonnefoy est justifiée par l’expérience. Nous constatons qu’ont été censurées, ces dernières années, au nom de la liberté d’entreprendre, des dispositions importantes relatives au reporting fiscal ou encore à la protection et au partage du sol face à la spéculation foncière. Aucun d’entre nous ne conteste la liberté d’entreprendre, mais elle peut et doit s’articuler avec d’autres principes. La notion de « biens communs » nous permettrait, sans doute, de contourner ce type d’écueil.
J’ai bien noté les arguments développés dans le rapport, mais ils ne me convainquent guère – sauf un, peut-être. Ainsi, le rapport cite l’article 1er du projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique, présenté par le Gouvernement le 29 août 2019, qui prévoyait d’ajouter à l’article 1er de la Constitution une phrase selon laquelle la France « favorise la préservation de l’environnement, la diversité biologique et l’action contre les changements climatiques ». Cela devrait pousser Mme la ministre à soutenir ce texte.
Je rappelle d’ailleurs ce que l’on pouvait lire sur le site de l’ancienne députée Pompili : « Les initiatives locales pour produire et consommer autrement notre alimentation, notre énergie, nos déplacements… la préservation de biens communs que sont l’eau, l’air, la nature, … l’ouverture à l’autre au travers de l’école, ou de l’intégration du handicap… la conscience planétaire au travers de l’enjeu climatique… nécessitent plus que jamais un relais politique fort et organisé.
« Cette citoyenneté et cette aspiration au changement, révolutionnaires au quotidien, ne peuvent se faire qu’en dépassant des blocages, de vieilles habitudes, et dans un dialogue large avec la société, en construisant progressivement des majorités d’idées et des majorités politiques. »
Madame la ministre, je ne vous demande pas de défendre cet extrait du site de l’ancienne députée Pompili, j’aimerais seulement comprendre où veut en venir le Gouvernement sur ces sujets.
La ministre Pompili nous exhortait voilà quelques instants à inventer – ce que nous faisons avec cette proposition de loi constitutionnelle –, avant de nous dire qu’il fallait avant tout agir, comme si la nécessaire évolution du droit s’opposait à l’action immédiate. Mais il faut les deux !
Quand nous parlons « biens communs », vous nous renvoyez au bilan environnemental du Gouvernement et aux 30 milliards d’euros du plan de relance. Nous vous proposons l’inversion des valeurs, vous nous renvoyez, d’une certaine manière, à la réintroduction des néonicotinoïdes, au maintien de l’usage du glyphosate ou à la demande que le Conseil d’État a adressée au Gouvernement de respecter ses engagements climatiques.
Il faut des majorités d’idées, des majorités politiques, et peut-être, si j’ose dire, des majorités de pays. Il ne s’agit pas d’une réflexion seulement franco-française : en Italie, la commission Rodotà, chargée d’introduire dans le code civil italien la notion de « biens communs », a permis d’engager un débat juridique. Après les travaux pionniers de Stefano Rodotà, une définition des « biens communs », qui seraient ceux qui contribuent aux droits fondamentaux et au libre développement de la personne, qui doivent être soustraits à la logique destructive du court terme, y compris au bénéfice des générations futures, n’est pas quelque chose de fantasque. Ce débat ne concerne pas qu’un pays ni qu’un parti.
J’ajouterai qu’il ne concerne pas que les juristes – quitte à être provocateur. Le rapport souligne à plusieurs reprises qu’il s’agit aussi d’un concept très économique, et c’est heureux ! Méfions-nous des visions purement juridiques qui peuvent parfois oublier la portée politique de nos actes législatifs.
Ainsi, j’ai tiqué en entendant les critiques sur la portée juridique de la Charte de l’environnement. Je crains qu’à être trop conservateurs sur le plan du droit, nous ne soyons pas du tout au rendez-vous sur le plan de l’environnement. Les raisonnements en chambre ont leurs limites. Le rejet de la recherche de l’autosuffisance alimentaire à l’échelle nationale, en cette année de réapparition concrète des frontières, m’a semblé très contestable.
Ce texte, mes chers collègues, obéit à une évolution juridique inéluctable, à un mouvement inexorable des idées. Par le passé, certains ont pu rejeter le devoir de vigilance ; c’est aujourd’hui un concept inscrit dans notre droit qui prospère aussi à l’étranger. Certains ont fait la sourde oreille à l’écocide ; ils finiront par accepter l’entrée de ce concept dans notre droit.
J’espère que nous gagnerons du temps aujourd’hui et que beaucoup parmi vous ne refuseront pas l’inéluctable. Pour ma part, et avec tous les membres de notre groupe, si nombreux en séance aujourd’hui, je soutiens pleinement cette initiative bienvenue de Nicole Bonnefoy.
Applaudissements sur les travées des groupes SER, GEST et CRCE.
M. Hervé Marseille applaudit.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je voulais remercier Nicole Bonnefoy de cette proposition de loi constitutionnelle qui nous oblige tout à la fois à prendre de la hauteur par rapport à notre droit et à nous interroger sur une humanité universelle et solidaire et sur son avenir.
Les références à ce qu’il convient d’appeler dans notre débat « les communs », voire, en cette période de crise sanitaire, « les très essentiels », permettent de découvrir l’œuvre d’Elinor Ostrom, qui a pu retenir l’attention du rapporteur. Prix Nobel d’économie en 2009, elle s’est essayée, dans son ouvrage de 1990 qui a fait date, à repenser la gestion collective des ressources.
Les « communs », dans votre conception, renvoient à des biens qui ne sont ni publics ni privés, relevant d’une exploitation et d’un usage collectifs. C’est un sujet qui suscite l’intérêt des économistes depuis des années et, petit à petit, celui des juristes, qui tentent d’évaluer ses limites et ses définitions dans notre droit, comme l’a fait notre rapporteur sur ce texte, et trouver ainsi une voie vers une acceptation juste et consensuelle. Cependant, dans cette effervescence de la nouveauté, il règne, comme souvent, une certaine confusion.
En effet, notre droit administratif se structure autour de notions qui construisent ce débat des « choses communes » : l’intérêt général, les services collectifs publics ou encore le domaine public. Et c’est alors que l’on prend conscience de la révolution juridique que cette notion pourrait provoquer. C’est à la lumière de cette importance pour notre droit qu’il faut qualifier, avec prudence, ces « choses communes ».
Cette proposition de loi constitutionnelle se heurte, me semble-t-il, à différents obstacles. Le premier est relatif à la nécessaire définition des « choses communes » au regard du droit existant et au-delà de son périmètre. C’est la volonté de l’article 1er.
Cependant, il existe de nombreuses catégories juridiques qui pourraient être mobilisées pour encadrer ce régime d’un partage de certaines ressources, ou du moins le partage de leur usage. Notre droit constitutionnel est d’ailleurs particulièrement bien doté depuis la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, qui a adossé ladite Charte à la Constitution.
Elle énumère un certain nombre de droits et de devoirs en matière de préservation de l’environnement qui permettent notamment au Conseil constitutionnel d’apprivoiser cette notion récente de biens communs. Celui-ci a avant tout reconnu une pleine valeur constitutionnelle à « l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement ».
Cette première étape a permis, par une décision de janvier 2020, de reconnaître la valeur constitutionnelle de l’objectif de protection de l’environnement en tant que « patrimoine commun des êtres humains ». La question se pose alors d’un début d’acceptation des « choses communes » par nos sages du Palais-Royal. À ce stade, notre loi fondamentale n’est-elle pas déjà assez bien faite ?
Un autre obstacle apparaît ensuite, celui de déterminer quelles conséquences emporterait la création de cette nouvelle catégorie au sein de notre droit. Notre rapporteur, Arnaud de Belenet, dont je tiens à saluer le travail extrêmement rigoureux et attentif, l’a très bien décrit : une telle inscription n’est pas sans conséquence pour les droits non seulement économiques, mais aussi immatériels, dont ceux de la propriété intellectuelle – il me semble d’ailleurs que l’étude de son impact n’est pas suffisante sur ces questions…
En outre, l’action internationale de la France se trouverait elle-même restreinte et compromise dans ses engagements internationaux au regard de cette nouvelle norme. D’où l’importance d’une définition travaillée et consensuelle, sans laquelle nous ne pouvons établir le périmètre des conséquences de cette caractérisation.
C’est ce qu’a tenté de faire Elinor Ostrom en utilisant différents critères, dont celui d’une reconnaissance minimale des droits d’organisation, qui m’a particulièrement frappée.
Dans cette conception des biens communs, les droits des « appropriateurs » – mot horrible s’il en est – d’élaborer leurs propres institutions ne sont alors pas remis en cause par des autorités gouvernementales externes. Ce point révèle la contradiction dans votre démarche, dans l’attente d’une acceptation plus globale de cette notion, notamment à l’échelle européenne, comme l’a très bien souligné notre rapporteur en ce qui concerne la politique agricole commune.
Avec la rédaction que vous proposez, nous nous retrouvons face à un dilemme : ne débattons-nous pas d’un thème qui devrait être porté, pour plus de pertinence et d’efficience, a minima au niveau européen, voire au niveau mondial, comme ont pu en témoigner les intergroupes de préparation de la conférence de Paris sur le climat, l’un d’entre eux s’étant fait l’écho de la notion de biens communs ?
L’expérience des municipalités transalpines ne peut que nous pousser à observer et à coordonner nos actions doctrinales sur cette notion dans le temps. Notre droit n’est pas figé dans son interprétation, il évolue. C’est une matière vivante, comme un arbre, disent nos amis canadiens.
Nos travaux d’aujourd’hui permettront de nourrir notre réflexion et pourront servir la doctrine. Nous devons nous en réjouir, et je remercie encore une fois l’auteure de cette proposition de loi.
Toutefois, vous l’aurez compris, la rédaction de ce texte nous paraît encore trop incertaine, trop fragile et ses conséquences encore trop peu évaluées pour que le groupe centriste le soutienne.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Loïc Hervé applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord de remercier le groupe socialiste, et singulièrement Nicole Bonnefoy, d’avoir inscrit ce texte à l’ordre du jour de notre assemblée.
« Le jour d’après ne sera pas un retour au jour d’avant. » Ces mots, prononcés par le Président de la République en mars dernier, à l’annonce du confinement, sont forts. Ils doivent maintenant se concrétiser au sein de l’ensemble de nos politiques publiques, bien au-delà d’un plan de relance de 100 milliards d’euros.
Cette crise sanitaire nous oblige. Elle nous oblige à repenser totalement nos sociétés. Notre mode de vie, nos modes de production et de consommation doivent être réfléchis à l’aune des grands défis du siècle et des défis écologiques.
Le monde d’après doit plus que jamais prendre en compte l’environnement et la finitude de certaines ressources naturelles. Cette prise de conscience est urgente. Elle doit être française, mais elle doit être aussi mondiale. C’est ce qu’ambitionne le texte dont nous discutons aujourd’hui et dont nous partageons l’objectif.
Les biens communs sont une notion économique popularisée par le prix Nobel Elinor Ostrom. Elle vise à inventer une nouvelle gouvernance pour des ressources qui peuvent se dégrader du fait de leur consommation. C’est le cas des données ouvertes, mais aussi, et surtout de l’environnement, de l’air, de la biodiversité, de l’alimentation ou des sols.
Ces sujets sont d’une grande envergure. L’ensemble de ces thématiques doit être traité. Les nombreux rapports du Sénat et les propositions de loi sont des preuves de cette nécessité d’agir.
Cependant, cette proposition de loi appelle des remarques de fond et de forme.
En ce qui concerne la forme, le vecteur de la révision constitutionnelle semble inadapté au regard des objectifs fixés. Notre droit constitutionnel est déjà pleinement armé pour la préservation de l’environnement et des ressources naturelles, notamment grâce à l’intégration de la Charte de l’environnement à notre bloc de constitutionnalité depuis la révision constitutionnelle opérée sous Jacques Chirac, en 2005.
C’est un texte essentiel, mais aussi précurseur, car peu d’États à l’époque avaient saisi ce sujet avec autant de force. Cette charte est aujourd’hui pleinement opérationnelle, puisque le Conseil constitutionnel l’invoque à de nombreuses reprises pour bâtir une véritable jurisprudence constitutionnelle sur les questions écologiques.
Trois grands principes sont entrés dans notre bloc de constitutionnalité : le principe de prévention, le principe de précaution et le principe pollueur-payeur. L’environnement et les ressources naturelles se retrouvent ainsi grandement protégés dans notre loi fondamentale.
Verdir la Constitution, alors que la protection de l’environnement y est déjà inscrite, est inefficace. Ce désir de modifier sans cesse notre texte fondamental doit nous interroger sur la valeur que nous lui donnons. La Constitution ne peut être l’objet d’effets d’affichage sans que rien de concret soit entrepris.
Mais c’est surtout sur le fond que cette proposition de loi interroge.
En effet, les biens communs ont le défaut de ne pouvoir être définis juridiquement de manière précise.
Vous procédez à une énumération, avant d’évoquer les « autres biens communs », ce qui n’est pas sans poser des questions relatives à la clarté de la loi et peut faire peser des risques juridiques sur de nombreuses activités économiques et sociales.
La notion de « biens communs » est aujourd’hui un objet juridique et constitutionnel non identifié. Son aspect évasif donnerait une grande latitude d’interprétation, dont il est difficile d’imaginer les limites et les conséquences.
C’est une donnée que doit prendre en compte le Sénat, en tant que pouvoir constituant.
Il faut également souligner que les différentes gestions communes décrites par Elinor Ostrom se font à l’échelle de communautés de taille limitée, entre 50 et 15 000 personnes, et non pas à l’échelle d’un pays, comme vous le proposez aujourd’hui. D’ailleurs, elle étudie des cas où cette entreprise de gestion commune réussit et des cas où elle échoue. Comment pourrait-on inscrire dans notre texte fondamental une gestion des ressources susceptible d’échouer ?
Il ne s’agit pas ici de remettre en cause le fait que ces ressources ne sont pas infinies. L’air, l’eau, les sols : chacun est conscient de la finitude de ces ressources et de la nécessité de les protéger, fort heureusement. Il conviendra sûrement de légiférer sur ces sujets dans les années à venir.
Aussi, il ne s’agit pas de contester les biens communs en tant que théorie économique, mais de souligner que la traduction juridique que vous en proposez n’est pas satisfaisante.
Par ailleurs, vous le savez, nous disposons déjà d’outils juridiques pour protéger certains des biens communs que vous mentionnez. L’air et l’atmosphère sont ainsi considérés comme des choses communes, protégées dans le code civil comme des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. La puissance publique elle-même dispose d’outils qui favorisent la gestion commune des ressources, à des fins d’intérêt général : on peut mentionner à cet égard le droit d’expropriation ou le droit de préemption. Nous ne partons donc pas de nulle part en la matière.
Surtout, cette proposition de loi, dans son article 3, vise à encadrer le droit de propriété et la liberté d’entreprendre.
Quand on aborde le sujet des droits fondamentaux, il convient de légiférer d’une main tremblante, pour paraphraser Montesquieu.
C’est particulièrement vrai quand une proposition de loi vise à encadrer des libertés. Limiter aujourd’hui des droits et libertés dans la Constitution peut avoir des conséquences considérables.
Si la propriété et la liberté d’entreprendre sont constitutionnellement protégées, la liberté individuelle n’empêche pas d’agir collectivement pour faire face aux plus grandes menaces qui pèsent sur notre pays. Elle protège tous les citoyens, notamment les plus faibles.
Aussi, la prise de conscience écologique ne peut se faire au détriment du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre.
La liberté d’entreprendre n’est pas un frein à la transition écologique. Le Conseil constitutionnel a lui-même reconnu en début d’année que la protection de l’environnement peut justifier des atteintes à la liberté d’entreprendre. Cette décision donne une véritable valeur constitutionnelle à la protection de l’environnement, « patrimoine commun des êtres humains », comme le titre le préambule de la Charte.
Cette dernière jouant pleinement son rôle, il semble donc inopportun d’alourdir notre texte constitutionnel.
Au contraire, on peut même attendre de notre liberté d’entreprendre des innovations qui marqueront notre réussite écologique. En effet, que serait la transition écologique sans les innovations dans le secteur nucléaire, qui permettront le développement de réacteurs recyclant une partie des déchets radioactifs ?
Que serait la transition écologique sans les nouveaux outils technologiques et numériques permettant un tri optimal des déchets ?
Que serait la transition écologique sans entreprises innovantes développant des enzymes permettant la biodégradation ou le recyclage à l’infini des plastiques ?
La liberté d’entreprendre n’est pas un problème pour la transition écologique ; c’est au contraire une partie de la solution.
L’équilibre entre écologie et économie est certes complexe, mais il ne passe pas par une modification constitutionnelle.
Il passe par des lois, des réglementations, des initiatives, des actions rapides et efficaces pour la préservation de l’environnement.
Nous constatons déjà les premiers effets de la finitude de ressources naturelles. D’autres devraient être perceptibles dans les années à venir.
Il convient donc d’agir de manière concrète, dans le cadre de l’ensemble de nos politiques, pour faire progresser encore et toujours la transition écologique.

Modifier la Constitution pour la verdir, tout en encadrant des libertés fondamentales, n’est pas notre méthode.
Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains ne pourra pas soutenir cette proposition de loi constitutionnelle.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. - Mme Françoise Gatel applaudit également.

La discussion générale est close.
La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi constitutionnelle initiale.
Le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle garantit la préservation de l’environnement, de la biodiversité, du climat, de l’eau, de la santé, des communs informationnels et de la connaissance et des autres biens communs mondiaux. »

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi sur laquelle nous devons nous prononcer nous invite à nous questionner sur le type de société que nous souhaitons créer à l’aube de ce nouveau millénaire. Elle interroge, car elle appelle à la connaissance de notre passé économique et industriel, à la compréhension des grands principes qui l’ont accompagné, au premier rang desquels le droit de propriété privée.
Surtout, elle suscite une réflexion sur notre avenir commun, avec la conscience des nouveaux enjeux sociaux et environnementaux auxquels nous devons nécessairement faire face.
De l’émancipation des serfs à l’abolition des tenures, le droit à la propriété privée est un acquis indéniablement cher aux Français, inscrit dans notre bloc de constitutionnalité à l’article XVII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
À cette époque préindustrielle, l’économie et les modes de production et de propriété étaient principalement agraires et ne heurtaient ni la terre ni la planète. Si l’ère industrielle a ouvert la voie à plusieurs siècles de prospérité économique et de droits sociaux, elle a également, hélas, eu un impact considérable sur notre environnement, allant de la détérioration de nos sols et de la qualité de l’air à une pollution de masse engendrée par un productivisme à outrance.
Selon l’ONG WWF, nous aurons consommé l’équivalent des ressources de deux planètes Terre d’ici à 2030. Il faut cesser cette spirale infernale et mettre un terme à ce système de production stakhanoviste qui détruit notre écosystème.
Nous entrons dans une ère postindustrielle. Il est grand temps que nous adaptions notre rapport à la propriété et à la production à ces réalités, pour la préservation de nos biens communs.
Tel est le sens de cette proposition de loi, dont nous soutenons les objectifs.
Applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j’ai bien compris, au détour des différentes interventions, la difficulté de certains orateurs à appréhender la notion de « biens communs », thématique émergente pour le moins polymorphe et d’une plasticité qui fait la valeur de nos grands principes constitutionnels.
Pourriez-vous me définir précisément, mes chers collègues, ce que recouvre l’horizon de principes comme la liberté d’entreprendre ou la fraternité ? « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », selon l’article 1er de la Charte de l’environnement. Mais qu’entend-on précisément par ces termes ? C’est là que le bien commun, entendu comme ressource commune culturelle ou naturelle, prend tout son sens et apporte sa pierre à l’édifice constitutionnel.
Vous dites, monsieur le rapporteur, que la rédaction proposée ne renforce en rien les exigences constitutionnelles en matière de protection de l’environnement et de la santé.
Je crois au contraire, mes chers collègues, que nous avons ici l’embryon juridique d’une révolution très explicite, d’une exigence qui s’affirme, et, en creux, d’une réappropriation collective de notre contrat social au service de l’environnement et de l’humain. Il s’agit d’affirmer le primat de l’humain, du vivant et de la biodiversité sur la puissance privée.
À l’heure où la crise climatique est une réalité concrète que plus personne ne peut nier, où des plateformes numériques sont capables de déstabiliser nos modèles sociaux, où notre environnement se dépeuple de sa faune, où des entreprises privatisent et dérégulent jusqu’au ciel, il s’agit de donner des outils démocratiques de réappropriation de ces communs et de poser avec sagesse des limites à la captation des ressources.
En votant pour cette proposition de loi, le Sénat s’honorerait à poser un jalon essentiel pour la préservation de notre environnement et le bien-être des générations futures. En tant que législateurs, nous avons un rôle historique à jouer pour ouvrir la voie de la réinvention des communs.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il est temps que nous inscrivions en priorité dans notre Constitution, à l’article 1er, la préservation de l’environnement et de la biodiversité. Je pense notamment à l’eau. Il est temps de concrétiser nos engagements, car le drame absolu que représente la baisse drastique de la biodiversité nous oblige. Nous n’avons pas encore commencé à endiguer cette catastrophe irrémédiable. Nous nous devons de maîtriser notre puissance. L’eau et l’air sont nos biens communs, ceux de tout le vivant sur Terre, nous devons les préserver pour notre survie. Sans eau, pas de vie !
Parce qu’elle est inédite, la menace appelle des mesures inédites, et donc radicales. Nous en sommes là ! Les petites mesures sont improductives, c’est un constat. La Charte de l’environnement n’a rien empêché. Tout ne va pas bien, mes chers collègues !
Bien sûr, l’inscription de la préservation de l’environnement et de la biodiversité à l’article 1er de notre Constitution aura des conséquences, puisque c’est son but ! Mais ne rien faire, où cela nous mène-t-il ? Le monde est durablement abîmé. Il est temps de le réparer, en inscrivant sa préservation en priorité dans notre Constitution.
Le drame serait de s’habituer à cette dérive, comme si nous étions frappés par une cécité progressive, délétère et inquiétante, signe, peut-être, du vieillissement inexorable de notre civilisation.
Nous avons pourtant des outils. Je pense en particulier aux dix-sept objectifs de développement durable élaborés par la communauté internationale, auxquels nous avons souscrit voilà déjà plusieurs années. Mais jamais je ne vois nos lois être passées au scan de ces objectifs de développement durable. Jamais un article de loi n’est présenté comme répondant à tel ou tel objectif de développement durable.
Nous pourrions pourtant le faire ! Pour avoir participé à divers ateliers lors de différentes COP, je sais que d’autres pays font ce travail. Une telle évolution constituerait une marge de progression particulièrement intéressante pour l’examen des lois.
Cette proposition de loi est une bouteille à la mer dont je vous demande, mes chers collègues, de mesurer la portée symbolique.

L’une des questions posées concerne la place de cette évolution du droit interne dans l’ordre juridique international.
Permettez-moi de rebondir sur les débats que nous avons eus concernant le devoir de vigilance des sociétés mères et l’écocide. On nous a dit alors que la France n’avait pas à être le gendarme du monde, que son droit national était bien aimable, mais que sa prétention à vouloir changer l’ordre mondial était exagérée.
Je citais l’exemple du Bangladesh et de ses usines textiles, qui, sous le poids des injonctions venues de l’extérieur et des législations adoptées, notamment ce texte relatif au devoir de vigilance des sociétés mères, ont commencé à faire des progrès et à s’adapter aux normes sociales et environnementales qui sont les nôtres.
Quelles sont les conséquences extraterritoriales de l’action interne des pouvoirs publics ? Le rapport d’Arnaud de Belenet s’efforce de répondre à cette question, en faisant référence à la décision du 31 janvier 2020 du Conseil constitutionnel, selon laquelle le législateur peut faire obstacle à l’exportation de produits jugés dangereux pour l’environnement, quand bien même les mesures prises dans l’ordre interne ne suffiraient pas à empêcher la commercialisation de ces produits à l’étranger.
Nous n’acceptons pas, en tant que membres d’une communauté humaine planétaire, de laisser se dérouler sous nos yeux la dégradation des biens communs informationnels, naturels, écologiques, de santé ou de biodiversité.
La question de l’opposabilité à d’autres pays ou continents de ce que nous souhaitons se posera très vite. Voir la forêt amazonienne brûler, comme le disait Mme la ministre, doit nous interroger sur notre capacité à ériger en biens communs un certain nombre d’espaces de droit. Nous ne le faisons pas seulement pour nos concitoyens ; nous le faisons pour tous les habitants de cette planète et pour les générations futures.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Tout à l’heure, en conclusion de mon intervention, j’évoquais des interrogations.
À titre personnel, je considère qu’il s’agit plus de pistes de travail et de reformulations permettant, me semble-t-il, de régler un certain nombre de problématiques juridiques réelles évoquées dans ce débat.
Nous pouvons avoir une ambition plus grande que celle d’inscrire la notion de « biens communs » dans l’article 1er de la Constitution. Selon moi – c’est un avis personnel –, elle mérite, si le législateur décide de la retenir, de figurer dans le Préambule de la Constitution.
Il appartient au seul législateur de déclarer quels sont les biens communs, après les avoir définis. Ces dispositions méritent donc de figurer à l’article 34 de la Constitution. Je vous le rappelle, en Italie, la commission Rodotà, qui a d’ailleurs fait « pschitt », puisque rien ne s’est passé ensuite, a esquissé un certain nombre d’éléments dont nous pouvons nous inspirer.
On l’a bien vu lors des travaux de commission, derrière une écriture plus ou moins adroite, chacun met ce qu’il veut sous le vocable de « biens communs ». Il nous faudra être précis le jour, que j’espère prochain, où nous réécrirons un certain nombre d’éléments pour répondre à l’intention de cette proposition de loi.
Dans le texte qui nous est présenté, le droit à la santé fait partie des biens communs. Or ce droit est déjà constitutionnellement garanti.
D’autres ont proposé que la relation à la mort ou la préservation de notre civilisation figurent parmi les biens communs.
Nous sommes responsables de l’État de droit et de sa préservation au travers de l’écriture de la Constitution. Nous devons anticiper ce que d’autres, moins soucieux des libertés publiques, pourraient faire d’une notion constitutionnelle non explicitée.
Je répète ce que j’ai dit au cours de la discussion générale, le législateur est tout à fait habilité, comme le Conseil constitutionnel l’y invite, à s’approprier les conséquences internationales des règles posées en interne. Il n’existe donc aucune incompatibilité entre nos travaux et la prétention, non pas à établir l’ordre mondial, mais à contribuer à son amélioration.
L ’ article 1 er est adopté.
Le quinzième alinéa de l’article 34 de la Constitution est complété par les mots : «, de la protection du sol et de la garantie de la sécurité et de l’autonomie alimentaires ».

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 2 a pour objet d’inscrire dans la Constitution la protection du sol, ainsi que la garantie de la sécurité et de l’autonomie alimentaires parmi les grands domaines dont la loi détermine les principes fondamentaux.
Ces dernières années, la jurisprudence tend certes à évoluer vers un rééquilibrage entre la liberté d’entreprendre et la protection de l’environnement. Toutefois, avec cette proposition de loi, nous ne souhaitons pas simplement donner un coup d’accélérateur, bien nécessaire à cette évolution ; nous proposons un réel changement de paradigme.
Voilà quelques mois, dans cet hémicycle, à la sortie du premier confinement, nous évoquions tous la nécessité de préparer le monde d’après. Nous étions sonnés par cette crise inédite et par ce qu’elle avait révélé de l’état de dépendance de notre pays dans toute une série de productions, non seulement stratégiques, mais aussi vitales, dont, bien évidemment, l’agriculture.
En juin, le débat sur le rapport d’information Vers une alimentation durable : un enjeu sanitaire, social, territorial et environnemental majeur pour la France ? avait notamment fait ressortir l’urgence pour notre pays d’être plus résilient sur le plan alimentaire, afin de ne pas être aussi démuni face aux prochaines catastrophes. Mais les réponses concrètes qui ont émergé depuis sont loin d’être à la hauteur de cette exigence essentielle.
Aujourd’hui, nous ne pouvons plus être dans une posture défensive et nous contenter de corriger, rustine après rustine, les conséquences les plus visibles des excès ou des dérives de l’économie de marché. C’est pourquoi, avec ce texte, nous ne voulons pas simplement autoriser le législateur à porter plus largement atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. Nous proposons de définir positivement ce qui doit exister en dehors du marché, ce qui doit être régi par des principes fondamentaux propres.
Ainsi que le disait déjà en 1944 Charles de Gaulle, « les grandes sources de la richesse commune doivent être dirigées et exploitées non point pour le profit de quelques-uns, mais pour l’avantage de tous ». S’il n’a pas inscrit ces mots dans la Constitution de 1958, rien ne nous empêche aujourd’hui de donner corps à cette idée au travers de la notion de « biens communs ».
Les biens communs se définissent comme une approche alternative de la gestion de biens et de services qui bouscule le modèle économique dominant basé sur la propriété, mais aussi comme un imaginaire politique renouvelé. Les inscrire dans la Constitution permettra d’ouvrir la porte de cet imaginaire, pour que le législateur puisse penser des solutions qui permettront non seulement de préserver l’existant, mais aussi de bâtir véritablement ce monde d’après dont nous avons tant besoin.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
L ’ article 2 est adopté.
Après le dix-septième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La loi détermine les mesures garantissant le respect des biens communs par l’encadrement du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre. » –
Adopté.

Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi constitutionnelle.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 48 :
Le Sénat n’a pas adopté.

L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, la discussion de la proposition de loi visant à instaurer une contribution exceptionnelle sur les assurances pour concourir à la solidarité nationale face aux conséquences économiques et sociales d’une crise sanitaire majeure, présentée par MM. Olivier Jacquin, Claude Raynal, Mme Sophie Taillé-Polian, MM. Thierry Carcenac et Rémi Féraud (proposition n° 477, 2019-2020, résultat des travaux de la commission n° 167, rapport n° 166).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Olivier Jacquin, auteur de la proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, cette proposition de loi vise à instaurer une contribution exceptionnelle sur les assurances en cas de crise sanitaire majeure. C’est un dispositif juste et proportionné, à l’inverse d’une taxe aveugle.
« Nous sommes en guerre. » Vous vous souvenez certainement de ces paroles prononcées par le président Macron en mars. L’État revient au cœur des politiques de solidarité. Tous, cette année, nous appelons à plus d’État, à tel point que le Fonds de solidarité pour les entreprises se monte déjà à plus de 20 milliards d’euros.
Parallèlement, on nous a répété, tout au long de l’année, qu’il n’y aurait pas d’« argent magique ». Effectivement, l’argent, c’est des maths. Mais aider les entreprises qui souffrent et risquent de mourir, c’est une nécessité. Je ne vous parlerai pas de l’hôtellerie, de la restauration, de nos fameux « petits commerces » ou des secteurs de l’aérien et du tourisme. Vous connaissez leurs difficultés, mes chers collègues.
Comme dans une économie de guerre, certains secteurs profitent de la situation. Dans les guerres, ce sont les marchands d’armes qui prospèrent. Dans la guerre contre le covid, nous pouvons citer les GAFA, les supermarchés, les plateformes numériques et certains secteurs de la santé. Dans toutes les crises majeures, des mesures d’exception sont prises, puisque les règles habituelles, notamment en matière budgétaire, ne tiennent plus. Ainsi avons-nous voté plusieurs projets de loi de finances rectificative (PLFR).
Début avril, un débat public naissait sur l’impact du confinement, cette interdiction incroyable de circuler, cette assignation à résidence qui laissait nos automobiles immobiles. Et chacun de s’inquiéter des sur-profits à venir des assureurs, la baisse de sinistralité dans ce secteur étant évidente. Le chiffre de 1, 4 milliard d’euros fut évoqué, alors que les primes étaient payées.
Taxer ou ne pas taxer ? That is the question. Permettez-moi d’expliquer très simplement le mécanisme que je propose pour les assurances non-vie. Mes propos seront simples, car j’ai entendu dire : « C’est lui, le socialiste, qui veut taxer les assurances à 80 % ! » Non ! La taxe que nous proposons n’est pas aveugle, mais particulièrement nuancée, puisqu’elle s’applique non pas sur le chiffre d’affaires, mais sur le résultat d’exploitation. Nous savons faire la différence entre les deux : il s’agit bien de cibler l’économie exceptionnelle réalisée.
Ce prélèvement exceptionnel de 80 % porte sur la seule augmentation, en 2020, du résultat d’exploitation, comparée à sa moyenne des trois dernières années. Prenons un exemple simple, celui d’une entreprise d’assurances réalisant un résultat d’exploitation de 1 milliard d’euros en moyenne sur trois ans. Si, en 2020, son résultat d’exploitation est de 1, 2 milliard d’euros, le prélèvement s’appliquera à ces 200 millions d’euros supplémentaires et s’élèvera donc à 160 millions d’euros. En aucun cas il ne s’agit d’appliquer le taux de 80 % aux 1, 2 milliard d’euros.
Vous l’avez compris, si cette entreprise réalise un résultat d’exploitation moindre que les trois années précédentes, elle ne paiera rien. Ce n’est pas, monsieur le rapporteur, un dispositif aveugle.
Ce n’est pas non plus une usine à gaz. En effet, il suffit de considérer la déclaration d’impôt sur les sociétés d’avril 2021 pour l’appliquer, sans même avoir à remplir une croix sur un formulaire administratif.
Ce prélèvement est juste et proportionné, à l’inverse de la taxe Husson, que vous avez votée dans le cadre du PLF et qui s’applique aveuglément sur le chiffre d’affaires de toutes les sociétés, qu’elles aient profité de la crise ou en aient été pénalisées. Nous sommes pour la justice.
Seconde particularité de ce mécanisme : il n’est pas systématique ; il ne se déclenche qu’en cas d’état d’urgence sanitaire. Il n’est donc pas récurrent, mais exceptionnel, comme ce séisme covid – de mémoire d’ancien, nous n’avions rien vu d’équivalent depuis la guerre ; rien à voir avec les crises cycliques de l’économie, lesquelles, précisément, ne déclencheront pas ce dispositif.
Quelques observations sur votre rapport, monsieur Nougein : premièrement, vous critiquez le fait que le dispositif proposé se déclenche systématiquement en cas d’état d’urgence sanitaire et ne prévoie aucun critère ni de durée ni d’ampleur géographique de la crise. Par exemple, dites-vous, si une ville ou un département seulement sont concernés, le mécanisme s’appliquera sur toute la France.
Mais cela ne pose aucun problème, puisque le dispositif que nous proposons a pour objet de capter les sur-profits ! Si la crise ne touchait qu’une ville, les sur-profits seraient nuls au niveau national ; il n’y aurait donc pas de déclaration particulière à faire. Et nous espérons tous que l’état d’urgence sanitaire restera une rareté, même si les biologistes nous annoncent davantage de pandémies à l’avenir.
Deuxième point : dans l’état des lieux de votre rapport, vous affirmez, en bon connaisseur, que cette PPL serait fondée sur le postulat socialiste et dogmatique de la profitabilité systématique des compagnies d’assurances. Mais pas du tout !

Si ! Vous l’avez écrit et affirmé en commission des finances.
Nous avons au moins appris que le chiffre allégué d’environ 2 milliards d’euros de sur-profits était proche de la réalité, avec toutefois une grande variété de situations. Ainsi, dans le domaine des catastrophes naturelles, en mars et avril derniers, les sinistres ont augmenté – vous citez ce chiffre – de 43 %. Dans le domaine des assurances professionnelles, on constate également une augmentation des sinistres. Sur les sinistres de la branche automobile, en revanche, les économies ont été importantes. Quant au domaine de la protection santé, les sinistres y seraient, à ce jour, en légère hausse.
Mais l’inquiétude des assureurs est énorme pour 2021, puisque les contrats collectifs prévoyance et santé s’appliquent même après le dépôt de bilan d’une entreprise, pendant douze mois ; le cas échéant, il n’y aurait pas de cotisations en 2021, mais bien des droits à payer.
La variété est donc immense. Je voudrais vous parler, de ce point de vue, d’une grosse mutuelle spécialisée dans le domaine du spectacle – elle n’a pas souhaité être citée. Elle perd près de 100 millions d’euros de cotisations professionnelles à cause de l’arrêt des activités. Son activité d’assurance annulation d’événements culturels essuie d’énormes pertes cette année. Notre dispositif permettrait d’aller dans la nuance et de ne pas taxer cette société d’assurances, qui est victime de la crise. En revanche, une autre société d’assurances disposant d’un portefeuille spécialisé dans l’automobile serait, elle, contributrice.
Troisième point : vous évoquiez la participation généreuse des assureurs – souvenez-vous : ils avaient mis 200 millions d’euros dans le panier du Fonds de solidarité ; moins d’une semaine plus tard, devant le tollé provoqué par le ridicule de cette somme, ils annonçaient 400 millions d’euros ! Aujourd’hui, on entend des déclarations de générosité incroyables : ils donneraient près de 4 milliards d’euros ! Les chiffres sont très variables ; comme pour le Téléthon, comme pour l’incendie de Notre-Dame de Paris, il faudra, le moment venu, les comparer à la réalité.
Quatrième point : comme il est signalé dans les rapports de l’ACPR, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et de la direction générale du Trésor, ce n’est qu’en avril 2021 que nous connaîtrons effectivement l’impact réel pour les assurances non-vie. D’où l’intérêt de ce dispositif ! Il ne sera pas aveugle et ira taxer à l’endroit précis où des sur-profits sont réalisés.
Un mot sur un point qui vous inquiète, monsieur le rapporteur, et qui inquiète la partie droite de l’hémicycle : vous évoquez une « nouvelle doctrine fiscale » et les risques attachés à sa pérennisation, qui reviendrait à taxer opportunément ou conjoncturellement tel ou tel secteur quand ça va bien pour lui : les marchands de glace pendant une canicule, les marchands de parapluies en cas de mauvais temps. C’est ce que feraient les socialistes, selon vous.
Vous avez raison, le risque économique, pour une entreprise donnée, ne s’appréhende pas à l’année, mais sur un cycle plus long. L’agriculteur que je suis sait très bien que les bonnes récoltes viennent effacer les mauvaises, et que l’on compte en permanence sur les premières.
Notre dispositif est exceptionnel et fondé sur l’état d’urgence sanitaire. Mais son caractère pérenne vous gêne et vous inquiète. Nous avons bien vu comment vous réagissiez à nos demandes d’un taux majoré exceptionnel d’impôt sur les sociétés cette année. Une telle majoration exceptionnelle aurait pourtant été vraiment juste, et préférable à ce dispositif, que je ne présente que par défaut !
Mais vous n’en avez pas voulu : vous votez en applaudissant la baisse de l’IS et des impôts de production pour 10 milliards d’euros. Ça, c’est dogmatique et aveugle !
Quant à vous, madame la secrétaire d’État, votre gouvernement augmente discrètement la taxe de solidarité additionnelle (TSA) de 1, 5 milliard d’euros – les assurés ne verront pas directement que c’est vous qui en avez décidé ainsi par décret…
Le groupe Les Républicains du Sénat, lui, a voté la taxe Husson sur les primes d’assurance, taxe aveugle et injuste, au taux de 2 %.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, comme vous le savez, cette proposition de loi s’inscrit dans la continuité des réflexions engagées depuis le début de la crise sanitaire, qui visent à faire participer les assureurs à l’effort national de soutien de notre tissu économique.
Lors de l’examen des projets de loi de finances rectificative pour 2020 et du projet de loi de finances pour 2021, le Sénat a déjà eu l’occasion, à plusieurs reprises, de débattre de ce sujet, et de définir sa position.
Le dispositif de la présente proposition de loi ne nous est d’ailleurs pas inconnu, puisqu’il a été présenté, dans une rédaction différente, lors de l’examen du deuxième projet de loi de finances rectificative, puis, dans la rédaction dont nous discutons aujourd’hui, lors de l’examen des troisième et quatrième projets de loi de finances rectificative pour 2020.
Comparé aux autres dispositifs fiscaux visant à taxer le secteur assurantiel que nous avons examinés au cours des derniers mois, celui-ci présente certes une certaine originalité – je le reconnais –, en ce qu’il établit un lien causal entre l’application de l’état d’urgence sanitaire et la taxation du résultat d’exploitation des assureurs.
En effet, l’article unique de cette proposition de loi prévoit que les assurances non-vie opérant en France soient assujetties à une contribution exceptionnelle au titre de tout exercice au cours duquel l’état d’urgence sanitaire est appliqué sur tout ou partie du territoire. Cette contribution est assise sur la hausse du résultat d’exploitation constaté au cours de l’exercice par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos.
L’objectif est clair : il s’agit de taxer les sur-bénéfices réalisés au cours de l’état d’urgence sanitaire. Le taux de cette contribution s’élève à 80 %.
Ainsi ce dispositif est-il établi sur deux présupposés : d’une part, l’idée d’un lien « automatique » entre l’application de l’état d’urgence sanitaire et une variation du résultat d’exploitation des assurances non-vie ; d’autre part, celle d’une évidente profitabilité de la crise sanitaire pour ces compagnies. Or les auditions que j’ai menées ont conforté l’idée d’une très grande fragilité de ces deux postulats – vous me direz qu’un postulat ne se démontre pas ; nous en avons ici une nouvelle preuve… Cela m’a conduit à conclure que le dispositif proposé est peu opérant.
Premièrement, l’idée d’un lien direct entre l’état d’urgence sanitaire et le résultat d’exploitation des assurances non-vie n’apparaît pas fondée.
Certes, en choisissant d’assujettir les assurances à cette taxe en raison de l’application de l’état d’urgence sanitaire, les auteurs de la proposition de loi ont évidemment souhaité instaurer une taxe qui ne serait appliquée qu’en cas de crise sanitaire grave – je l’avais bien compris.
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que l’état d’urgence sanitaire peut entraîner des conséquences économiques et sociales variables selon l’ampleur et la durée des mesures administratives prises. En effet, l’état d’urgence sanitaire est une « boîte à outils » de nature à permettre au pouvoir exécutif de prendre des mesures face à une catastrophe sanitaire.
Ce constat est renforcé par le fait que le dispositif proposé ne prévoit aucune durée ni ampleur géographique minimales d’application de l’état d’urgence sanitaire – c’est surprenant. Ainsi, un état d’urgence circonscrit localement et pour une durée brève, à l’échelle d’un département et pour deux semaines par exemple, en cas d’accident industriel, entraînerait d’office un assujettissement de l’ensemble des assurances non-vie à cette contribution, alors même que le sur-profit constaté n’aurait rien à voir avec ce phénomène local.
De la même façon, le résultat des assurances non-vie peut se dégrader au cours de l’application de l’état d’urgence sanitaire, sans aucun lien avec celui-ci. Ainsi, en mai et avril derniers, les sinistres payés au titre des catastrophes naturelles ont augmenté de 43 % par rapport à la même période en 2019.
Compte tenu de ces éléments, je ne partage pas l’idée selon laquelle les premières expériences liées à l’application de l’état d’urgence sanitaire puissent fonder une nouvelle « doctrine » fiscale. Je suis très réservé sur le principe d’instaurer une disposition fiscale pérenne, alors que chaque état d’urgence sanitaire a ses propres caractéristiques.
Le dispositif proposé repose sur un second postulat, à savoir l’idée d’une profitabilité de la crise sanitaire pour les assureurs non-vie. La question d’un possible « effet d’aubaine » de cette crise a jalonné nos débats depuis le début de l’épidémie, en raison de la baisse de la sinistralité. Ce contexte a d’ailleurs justifié que le Parlement demande un rapport au Gouvernement, dans le cadre de la deuxième loi de finances rectificative, sur l’évolution de la sinistralité par rapport à 2019.
Ce rapport, qui a été remis en juillet dernier, se fonde sur une enquête statistique partielle pilotée par la direction générale du Trésor. Le constat qui ressort de cette première enquête est très clair : en avril et mai 2020, on observe une baisse de 25 % des sinistres payés, toutes catégories d’assurances non-vie confondues, ce qui correspond à une réduction de 1, 9 milliard d’euros du montant des prestations payées – c’est factuel.
Néanmoins, les auditions que j’ai menées m’ont encouragé à la plus grande prudence dans l’interprétation de ces premières données, obtenues sur deux mois.
En effet, lors de son audition, la direction générale du Trésor a souligné que l’appréciation de l’évolution de la sinistralité pour 2020 ne pourra être menée qu’ex post, lorsque les données définitives pour l’ensemble des assurances non-vie seront connues, soit en avril 2021 seulement.
De son côté, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, entité de supervision du secteur assurantiel, a indiqué que, à la fin du troisième trimestre de cette année, il n’était pas observé de décrue substantielle de la charge des sinistres en assurance non-vie, à l’exception de l’assurance santé – cette dernière fait évidemment figure d’exception en raison de l’important report de soins observé ces derniers mois.
Ce constat s’explique notamment par des disparités entre les branches assurantielles. Par exemple, l’ACPR a fait état d’une hausse significative des sinistres couverts par les contrats d’assurance de « pertes pécuniaires diverses », qui enregistrent les sinistres payés en matière d’annulation d’événements.
La Fédération française de l’assurance, quant à elle, évalue la hausse du montant des sinistres payés en 2020 à près de 2 milliards d’euros, nette des économies réalisées sur les sinistres de la branche automobile. Cette estimation doit toutefois être reçue avec prudence, étant donné qu’il s’agit d’une prévision sur l’ensemble de l’année 2020.
Au-delà de la sinistralité au cours de l’année 2020, l’ACPR a souligné que les sinistres en matière d’assurance non-vie pourraient également être en hausse l’année prochaine, en raison d’une augmentation du taux de défaillance des entreprises. En effet, selon le principe dit de « portabilité », les contrats d’assurance santé collectifs font obligation aux assureurs de continuer à honorer la couverture des sinistres durant les douze mois suivant la fin du contrat de travail, alors même qu’ils ne reçoivent plus de cotisations. Cet exemple montre bien la difficulté du dispositif proposé : les conséquences économiques de la crise sanitaire ont un effet bien plus direct sur le résultat des assurances que l’application de l’état d’urgence sanitaire en elle-même.
Aussi suis-je opposé au principe d’une taxation systématique d’un soi-disant effet d’aubaine qui pourrait donner lieu, chaque année, à des revendications sectorielles éparses, au détriment d’une politique fiscale cohérente. On peut varier les plaisirs : allons-nous proposer de taxer les fabricants de crème solaire lorsqu’une année est marquée par un record d’ensoleillement ? Vous pourriez creuser cette idée…
Au-delà de la question du caractère opportun du dispositif proposé, il me semble indispensable d’apprécier toute proposition de contribution au regard des engagements déjà pris par le secteur des assurances.
Par ailleurs, les auditions ont été particulièrement éclairantes quant aux perspectives du secteur assurantiel. En effet, l’année 2020 a été marquée par une dégradation de la solvabilité des assureurs – c’est important ! –, même si celle-ci reste nettement au-dessus des ratios prudentiels exigés, je vous l’accorde.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission des finances n’a pas adopté le texte proposé.
Pour l’avenir, il est évident que nous devons tirer les leçons de la crise sanitaire en organisant de façon pragmatique et pérenne la participation des assureurs au soutien de l’économie. Ma conviction est la suivante : cette participation doit reposer sur le cœur de métier des assureurs, à savoir l’indemnisation d’un risque prévue contractuellement.
Dans cette perspective, la proposition de loi adoptée le 2 juin dernier et introduite par le Sénat dans le projet de loi de finances pour 2021 constitue une première réponse adéquate et pertinente.
À court terme, et dans l’attente de l’instauration d’un tel dispositif, il est certain que la question de la participation financière des assureurs n’est pas complètement épuisée, notamment en raison de la seconde vague que nous connaissons et de la prorogation du Fonds de solidarité.
Sur ce point, le Sénat a clairement exprimé sa position lors de l’examen de la première partie du PLF pour 2021, en adoptant une taxe ponctuelle de 2 %, au titre des seules primes perçues au cours de l’année 2020.
Mes chers collègues, au terme de mes travaux en tant que rapporteur, je vous remercie de suivre l’avis de la commission et de ne pas adopter le texte de la présente proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur Claude Nougein, mesdames, messieurs les sénateurs, la crise sanitaire et sa deuxième vague ont, comme vous l’avez rappelé, des impacts sur l’ensemble de notre tissu économique.
L’État a pris ses responsabilités pour soutenir l’activité économique et l’emploi dans notre pays, quoi qu’il en coûte. Dès le mois de mars, nous avons mis en place le Fonds de solidarité, l’activité partielle, le prêt garanti par l’État ou encore le report de charges. Ce soutien inédit s’est poursuivi et intensifié durant la seconde vague, qui a entraîné la fermeture de 200 000 commerces et de près de 160 000 restaurants. Si les commerces ont pu rouvrir, je pense chaque jour aux secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés, de l’événementiel et de la culture, piliers de notre vie sociale, contraints de demeurer fermés face à un virus qui se répand précisément par le contact, l’interaction, bref la vie en société.
Je veux vous dire, je veux leur dire que nous ne les lâcherons pas. L’État a été là ; l’État est là ; l’État sera là jusqu’au bout.
Je mesure leur détresse. Ce n’est pas seulement la secrétaire d’État qui vous le dit ; c’est aussi l’ancienne entrepreneure que je suis qui vous le confirme : quand un travail pour lequel on donne tout se retrouve soumis à des restrictions sanitaires contre lesquelles on ne peut rien, alors on cherche des responsables. Personne ici ne niera que l’État a, en la matière, pris ses responsabilités. Néanmoins, cette crise appelle tous les corps du pays à faire preuve de solidarité.
Les assureurs n’y font évidemment pas exception – nous le disons depuis le début. Certains ont d’ailleurs fait preuve d’un bel esprit civique qu’il faut aussi savoir saluer. J’ai, comme vous, entendu les histoires d’entrepreneurs qui, s’étant naturellement tournés vers leur compagnie d’assurance, n’ont pas obtenu les réponses qu’ils étaient en droit d’attendre.
Je mesure, là encore, l’incompréhension et la colère de ces entreprises. Je rappellerai seulement que le Gouvernement ne s’est pas, à ce propos, contenté d’un constat, et qu’il a cherché à faire bouger les lignes. Bruno Le Maire a pris l’initiative, dès le printemps dernier, de convoquer à plusieurs reprises les assureurs pour composer avec eux une réponse immédiate et opérante aux problématiques auxquelles sont exposés les secteurs les plus sinistrés.
Les assureurs ont pris des engagements financiers : leur effort est au total d’un peu plus de 3, 2 milliards d’euros, dont 400 millions d’euros de participation directe au Fonds de solidarité, premier acte de solidarité significatif et bienvenu.
Pour autant – votre proposition de loi en témoigne –, la deuxième vague a rendu nécessaire une nouvelle participation des assureurs pour répondre aux besoins des entreprises les plus touchées. Cette demande a été entendue. Nous avons travaillé, sous l’impulsion de Bruno Le Maire, mais aussi de nombreux parlementaires, à un nouvel accord. Je veux profiter de cette tribune pour remercier la Fédération française de l’assurance pour son implication ; son esprit de solidarité nous a permis, ce lundi – vous le savez –, de conclure ce nouvel accord que je souhaiterais détailler.
Quatre mesures de soutien d’urgence ont été prises. Premièrement, un gel des primes pour l’année 2021 a été décidé à destination de secteurs identifiés et profondément sinistrés par les restrictions économiques. Cette mesure vise les TPE et PME des secteurs de l’hôtellerie, des cafés, de la restauration, du tourisme, de la culture, du sport et de l’événementiel. L’impact de cette mesure destinée aux professionnels est réel sur leur trésorerie, l’objectif étant de soutenir la relance de leur activité.
Deuxièmement, une couverture d’assistance gratuite a été mise en place pour les chefs d’entreprise et salariés hospitalisés à cause de la covid-19 ; cette couverture santé proposera des indemnités de convalescence de 3 000 euros et d’autres indemnisations annexes couvrant notamment la garde d’enfants ou la livraison de repas à domicile.
Troisièmement, les contrats seront conservés en garantie jusqu’à la fin du premier trimestre 2021 pour les entreprises qui connaîtraient des retards de paiement des cotisations.
Quatrièmement, la médiation de l’assurance sera ouverte aux professionnels, qui pourront saisir le médiateur pour tout litige sur leur contrat d’assurance professionnelle. Avec son concours, un accord à l’amiable pourra être proposé pour des litiges portant par exemple sur l’évolution des garanties contractuelles, un refus de renouvellement des couvertures ou la résiliation d’un contrat.
Cette mesure répond directement aux difficultés rencontrées par les entreprises en matière d’indemnisation des pertes d’exploitation liées notamment à la crise sanitaire.
Le Gouvernement croit à la logique du dialogue, qui doit l’emporter sur la logique du conflit, qui plus est en temps de crise. Les assurés et les assureurs ont besoin d’un tel espace de communication pour trouver ensemble des solutions individualisées et pertinentes.
De cette crise, nous avons appris que l’anticipation du risque pandémique devait intégrer notre politique assurantielle. Plusieurs voix se sont élevées pour demander la création d’une assurance pandémique obligatoire. Il ressort aujourd’hui des travaux et des longues concertations organisées depuis le printemps dernier que les entreprises ne sont pas encore prêtes à suivre cette voie, qui impliquerait forcément – vous le savez – de nouvelles cotisations obligatoires.
En revanche, nous continuons de travailler à la mise en œuvre de solutions individuelles et facultatives de gestion du risque, permettant de renforcer la résilience des entreprises, mais aussi leur capacité à affronter des crises de grande ampleur, sans rigidifier leurs charges.
Concrètement, nous donnerons la faculté aux entrepreneurs de se constituer des provisions dans des conditions fiscales avantageuses qui permettront de mettre de l’argent de côté si jamais une nouvelle pandémie devait survenir.
En attendant, je juge plus utile que nous nous en tenions à l’accord obtenu : il s’agit de mesures concrètes, effectives, coconstruites et plutôt constructives, aux effets directs sur le quotidien des entreprises. C’est par l’apaisement que nous trouverons des solutions, là où la confrontation n’a plutôt tendance qu’à créer des problèmes.
Un examen du fond de la présente proposition de loi conforte la position du Gouvernement.
Malgré un niveau de taxation du sur-profit très élevé, il y a en effet de fortes chances que le rendement final de la taxe soit faible, voire nul. Même en retenant les hypothèses les plus optimistes, nous estimons que le rendement de la mesure proposée ne dépasserait pas les 400 millions d’euros ; en outre, plusieurs techniques assurantielles de mise en provision pourraient trop facilement annuler les sur-profits éventuels, et donc anéantir une bonne partie de l’assiette de la taxe. Bref, ce dispositif serait assez facilement contournable ; il ne saurait donc être un bon substitut à des engagements fermes et d’ores et déjà négociés.
C’est pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement n’est pas favorable à ce texte. Nous croyons en l’esprit de solidarité existant dans notre pays. L’accord que nous avons trouvé avec les assureurs en témoigne, de même que les efforts redoublés du Gouvernement et des parlementaires pour adapter en permanence nos dispositifs de soutien aux nouvelles situations créées par les pandémies.
Nous sortirons de cette crise ! Mais nous en sortirons en aidant nos victimes, et pas forcément en cherchant des coupables !

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, on reconnaît une bonne idée à ce qu’elle se fraie un chemin dans l’opinion publique ; on reconnaît une bonne mesure à ce qu’elle arrive au bon moment dans le débat public.
L’idée de faire contribuer les assureurs à la solidarité nationale peut ainsi être considérée comme une bonne idée.
Alors que nous traversons une crise économique sans précédent, et que nos finances publiques ont été lourdement dégradées par la pandémie, les assurances, elles, dégagent des profits faramineux. Et pour cause : la sinistralité n’a jamais été aussi basse qu’en 2020, du fait des restrictions sanitaires.
La mécanique qui s’en est ensuivie est désormais bien connue : la diminution des sinistres a entraîné une forte diminution des indemnisations, c’est-à-dire une forte baisse des coûts pour les entreprises, sans révision correspondante des polices d’assurance, générant ainsi une profitabilité exceptionnelle en ces temps difficiles.
Car les temps sont difficiles, madame la secrétaire d’État ; nous le savons tous ici, nous qui entretenons des liens forts avec les élus de terrain. Les Français ne comprennent pas que des entreprises tirent profit de cette situation catastrophique. Ils demandent de l’équité.
C’est à cette logique qu’ont répondu les différentes propositions formulées depuis le début de la crise sanitaire. Et je crois utile de préciser qu’elles n’ont pas été l’apanage d’un seul camp, qui détiendrait le monopole du cœur.
Dès le début du confinement, des sénateurs de tous bords ont relayé la sidération des entrepreneurs qui découvraient que leur contrat d’assurance ne couvrait pas le risque pandémique. La prise de conscience fut alors collective : la situation à laquelle nous faisons face n’entre dans aucune case.
Après le temps des questions au Gouvernement est venu celui des initiatives du Parlement. Le Sénat a produit plusieurs propositions de loi, dont celle de mon collègue Jean-Pierre Decool, dont je tiens à saluer le travail, qui visait à créer un mécanisme d’assurance des pertes d’exploitation liées à des menaces ou crises sanitaires graves.
Le Sénat a finalement adopté la proposition du rapporteur général de la commission des finances, Jean-François Husson, qui redéfinit et coordonne le rôle des assureurs dans la solidarité nationale.
Nous avons eu par ailleurs, lors de l’examen de la première partie du budget pour 2021, de longs débats sur l’opportunité d’une contribution exceptionnelle sur les assurances, dont le produit viendrait gonfler les efforts déjà consentis volontairement.
Je veux redire le soutien du groupe Les Indépendants à la proposition de la commission votée par le Sénat. Notre groupe a même soutenu le doublement du taux de cette contribution proposé par Vincent Delahaye.
Je remarque d’ailleurs que le Gouvernement, qui n’avait pas émis d’avis favorable sur la proposition du rapporteur général, a pu utiliser cette contribution dans sa négociation pour obtenir un engagement de la part des assureurs sur le gel des tarifs l’année prochaine. Cette garantie est la bienvenue pour la cohésion du pays, et le crédit en revient en partie au travail du Sénat.
En résumé, mes chers collègues, le Sénat est une force de propositions depuis le début de la crise sanitaire. Nous avons suggéré de réformer le cadre assurantiel afin de l’adapter, de façon stable et pérenne, à l’état d’urgence sanitaire. Nous avons aussi voté une contribution exceptionnelle, bornée dans le temps et calibrée sur la période du premier confinement.
Je crains donc, mes chers collègues, que la proposition du groupe socialiste, qui institue un dispositif pérenne de contribution exceptionnelle – oxymore magnifique
Mme la secrétaire d ’ État approuve.

J’ignore si les auteurs de ce texte espèrent vraiment qu’il puisse être adopté d’ici la fin de l’année. Je crains surtout qu’il ne soit pas opportun de doter notre arsenal fiscal d’une nouvelle arme dans cette négociation.
Le groupe Les Indépendants votera donc contre cette proposition de loi.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, avant toute chose, permettez-moi de remercier mes trois collègues Sophie Taillé-Polian, Teva Rohfritsch et Stéphane Artano d’avoir accepté d’intervertir l’ordre de passage des orateurs.
N’y voyez pas d’acharnement de notre part, madame la secrétaire d’État, mais le ministre Bruno Le Maire n’a décidément que peu d’égards pour le Sénat.
Après avoir ignoré nos travaux, voilà qu’il les brandit fort opportunément pour essayer de se faire entendre – enfin ! – des assureurs. Il leur demande à présent de trouver un arrangement sur le gel des primes contrats pour les commerces les plus touchés. « Et si vous ne le faites pas, leur dit-il, il se trouve que le projet de loi de finances revient en deuxième lecture à l’Assemblée nationale et que le Sénat a voté un prélèvement obligatoire de 1, 2 milliard d’euros sur les assureurs… » Et d’ajouter : « Je considère que c’est vraiment traiter les problèmes à la hache et que ce n’est jamais la bonne solution, mais si les assureurs ne trouvent pas eux-mêmes la porte de sortie, nous n’aurons pas d’autre choix que de maintenir ce prélèvement obligatoire sur les assureurs. La balle est dans leur camp et je parie, comme toujours, sur le sens des responsabilités de chacun. »
Je cite volontairement in extenso les propos du ministre. Le Sénat, qui a voté une contribution exceptionnelle des assureurs à l’effort de crise, sert d’instrument de chantage auprès des professionnels du secteur. Nous sommes accusés de traiter les problèmes « à la hache » ; la commission des finances appréciera…
Ce plaisir sera probablement partagé par nos collègues députés, qui n’ont pas droit à plus d’égards, car c’est bien seul que le ministre de l’économie décidera de retenir ou pas cet article voté par le Sénat.
Pourtant, je le dis d’emblée, toutes les mesures votées par notre assemblée s’avèrent complémentaires, justes et proportionnées : le dispositif proposé dans le cadre de ce texte parachèverait la constitution d’un arsenal pour contraindre les entreprises à participer à l’effort de solidarité nationale.
Les assureurs ont trop longtemps rechigné à faire cet effort essentiel : les 400 millions d’euros versés au Fonds de solidarité constituaient un bon début, mais ce n’est pas suffisant, loin de là. J’ai entendu qu’il était question d’ajouter 1, 5 milliard d’euros issus d’un programme d’investissement global, majoritairement en fonds propres, en faveur des ETI et des PME du secteur de la santé. Mais l’on parle ici d’investissements ; il n’y a pas de dons, d’efforts ou quoi que ce soit qui relèverait de la générosité : un investissement a vocation à être rentable.
Nous avions déjà salué les différentes mesures adoptées par le Sénat, à commencer par la taxe de 1 %, habilement sous-amendée par nos collègues centristes pour être portée à 2 %, sur les primes versées au titre de l’année 2020.
Dans un deuxième temps, le rapporteur général a continué le « combat » en instaurant une cotisation obligatoire des assurés permettant aux entreprises ayant perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires de bénéficier d’une couverture à hauteur des charges d’exploitation lors de la mise en place d’un état d’urgence sanitaire.
Juste avant l’adoption de ce dispositif, M. Bruno Le Maire annonçait un gel des cotisations des contrats multirisques professionnels pour l’année 2021. C’est la moindre des choses !
Un petit rappel des événements s’impose : les assureurs ont envoyé une lettre aux restaurateurs pour les prévenir que leurs contrats pourraient être interrompus et que leurs pertes d’exploitation ne seraient pas couvertes. Un chantage de ce type est-il digne ? D’aucuns affirment qu’il s’agit d’une maladresse. Nous disons, nous, que c’est une offense caractérisée. Le gel était indispensable, mais il n’est pas une condition suffisante pour revenir sur les dispositifs de solidarité adoptés par le Sénat.
Il nous faut donc voter cette proposition de loi sur la taxation des activités non-vie, car la baisse de sinistralité est manifeste. Prenons la branche corporelle de l’assurance automobile : la sinistralité – et c’est heureux – est en chute libre. La comparaison entre les deux mois de mars 2019 et 2020 atteste de cette différence, avec une diminution de 45 % des blessés sur la route.
Toutefois, si nous reconnaissons l’ambition de ce texte, celle-ci est mesurée au regard de la prise en compte des trois derniers exercices clos, qui diminuera mécaniquement l’assiette. Par ailleurs, la notion de compte d’exploitation ne focalise pas cette contribution sur le patrimoine ou le capital des assureurs, qui ne cesse de croître. Enfin, la notion floue des « entreprises de l’assurance non-vie » exclut nombre d’acteurs du secteur de l’assurance.
Cette contribution sur les activités non-vie sera très certainement maigre, mais elle n’en sera pas moins utile. L’idée est bonne, en dépit du faible profit.
Les placements des assureurs représentaient 91 % de leurs bilans agrégés et atteignaient 2 813 milliards d’euros, soit 200 milliards d’euros de plus que l’année précédente.
C’est pourquoi nous souhaitions une taxe sur les réserves de capitalisation. Nous vous l’avons proposée, mais vous l’avez refusée, mes chers collègues, alors qu’il s’agissait également de mettre à contribution ceux qui ont bénéficié de la crise. De la même manière, les établissements bancaires et de crédits sont les grands absents de l’effort de solidarité nationale que nous appelons de nos vœux. Le secteur bancaire tire profit des 120 milliards d’euros de prêts garantis tout en laissant l’État supporter le risque et le coût du dispositif.
Vous l’aurez compris, nous voterons sans réserve cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, un bon accord vaut mieux qu’une loi hâtive !
Le ministre Bruno Le Maire nous l’a encore démontré lundi, au travers d’une négociation rondement menée. Le Sénat y a certes un peu contribué, puisque l’amendement, qualifié de « brutal », mais bel et bien voté par notre chambre sur l’initiative du rapporteur général de la commission des finances, fut un argument de poids brandi par le ministre et relayé par les médias. Le Sénat a donc, bon gré, mal gré, participé à la réussite de l’accord obtenu par le ministre. Dont acte !
Ainsi, à sa demande, les assureurs ont consenti un gel des primes de l’assurance multirisque professionnelle non seulement pour les cafés, les hôtels et les restaurants, mais également pour les secteurs de l’événementiel, du tourisme, du sport et de la culture.
Nous en conviendrons tous, cet accord est plus approprié, au final, qu’une taxe brouillonne et tardive. Brouillonne, car elle frapperait indifféremment tous les secteurs de l’assurance – hors assurance vie – de manière récurrente et récursive. Tardive, car la navette législative pourrait encore mettre des mois avant d’aboutir.
L’accord obtenu par le ministre permettra concrètement de venir en aide immédiatement aux secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et par les mesures de fermeture administrative. C’est au final l’objectif principal recherché et partagé, j’en suis certain, au-delà de nos clivages, par les auteurs du texte soumis à notre approbation.
L’accord trouvé avec les assureurs va encore plus loin pour soutenir les entreprises en difficulté. Ces derniers se sont engagés à maintenir les garanties pour les assurés en cas de retard de paiement au premier trimestre 2021, mais également à offrir gratuitement une couverture supplémentaire d’assistance pour les chefs d’entreprise et leurs salariés touchés par la covid.
Rappelons que les assureurs se sont engagés en mars dernier, à la demande du Gouvernement, à verser 400 millions d’euros au Fonds de solidarité et à faire un geste commercial de 1, 35 milliard d’euros pour leurs assurés les plus touchés par la crise, dont 450 millions d’euros pour les petites entreprises et les indépendants, 550 millions d’euros pour les personnes les plus exposées au covid-19, 150 millions d’euros pour le personnel soignant et 200 millions d’euros pour l’ensemble des ménages. Bien sûr, nous ferons ensemble le bilan de toutes ces mesures.
Nous pouvons certes toujours discuter et débattre de la juste contribution du secteur des assurances en ces temps de crise, une interrogation qui vaut d’ailleurs pour d’autres secteurs, eu égard aux effets de la crise sanitaire sur nos modes de consommation. Bref, il s’agit d’un vaste débat.
Mais où placer le curseur ? Et avec quel recul devons-nous agir ? Dans la gestion de l’urgence, il ne s’agirait pas de céder à la tentation de la facilité punitive et englobante, ni à celle de l’approximation contre-productive ! Un bon accord nous semble donc encore une fois constituer la voie à suivre. C’est la méthode la plus efficace pour apporter une réponse rapide et adaptée à l’urgence du moment.
Revenons à la proposition de loi qui nous est soumise cet après-midi et qui a été rejetée la semaine dernière par la commission des finances. Ce texte vise à taxer la hausse du résultat d’exploitation de toutes les entreprises d’assurance, hors assurance vie. La taxation devrait s’appliquer chaque fois que l’état d’urgence sanitaire serait établi, quelles que soient sa durée et l’étendue des mesures décidées. Ce dispositif nous paraît trop vague et trop large pour être pertinent et applicable, comme cela a été rappelé lors de nos débats en commission.
Certes, nous avons pu constater pour les mois d’avril et de mai 2020 une diminution des sinistres payés de 25 %, avec une baisse de 1, 9 milliard des prestations sur la période, comme l’a souligné en commission notre rapporteur. Mais ce constat est bien plus nuancé sur l’ensemble de l’année.
Les responsables de la Fédération française de l’assurance, la FFA, ont reconnu lors de leur audition une baisse de la sinistralité de 1, 4 milliard d’euros sur l’année pour l’assurance dommages, mais, pour le reste des secteurs, la tendance s’est inversée. Cette baisse est largement compensée par la hausse de 2, 6 milliards d’euros des sinistres de la branche « professionnels » et de 820 millions d’euros pour les autres branches. Je note même, à la lecture du rapport de notre collègue Claude Nougein, qu’en avril et mai 2020 les sinistres payés en raison des catastrophes naturelles auraient augmenté de 43 % si on les compare à 2019.
Chers collègues, la taxe qui nous est proposée dans ce texte ne fait pas de détail. Tous les assureurs y sont soumis, pour toute l’année, quels que soient l’état du marché et les sinistres déclarés.

Qui plus est, telle qu’elle est conçue, elle serait réactivée année après année, à chaque nouvelle utilisation de l’état d’urgence sanitaire, même si cet état d’urgence n’est déclaré que localement ou pour une durée très réduite. Ce n’est pas acceptable, quelles que soient les intentions qui ont motivé les auteurs de ce texte.
Je soulignerai enfin un dernier problème. Certains de nos collègues ont cité la MAIF lors de nos discussions en commission. Cette dernière a effectivement reversé 100 millions d’euros à ses adhérents, mais elle n’a pas été suivie par ses concurrents. Certains voulaient y voir la démonstration de l’utilité de cette proposition de loi. Je crois au contraire que cet épisode nous prouve que l’accord signé par le Gouvernement lui est préférable. Avec une telle taxe, nous pénaliserions les assureurs qui se sont bien comportés, au sens moral du terme – chacun appréciera à l’aune de ses convictions –, et qui subiraient alors une double peine par rapport à leurs concurrents. Là encore, ce n’est pas une solution acceptable.
Cela étant, il nous faudra répondre au problème de fond et à l’appel – car il s’agit bien d’un appel – lancé par les auteurs de cette proposition de loi.
Cette pandémie que nous traversons nous a tous pris de court, elle a bouleversé tout ce que nous croyions immuable et a remis en question tout ce qui nous semblait certain. Le métier même des assureurs est de nous protéger d’événements incertains, mais pouvant être prévisibles à grande échelle. La pandémie a remis en question ce modèle.
Profitons de ce débat pour rappeler que l’État doit permettre aux acteurs économiques d’anticiper les crises et de provisionner les risques à venir dans les périodes de reprise et de croissance. Son rôle n’est pas et ne doit pas être d’ajouter une charge nouvelle et d’alourdir le choc des cycles économiques au plus fort de la crise. Il ne doit pas non plus créer de l’instabilité fiscale. Autrement, comment pourrions-nous attendre de ces mêmes acteurs économiques qu’ils prennent leurs responsabilités et puissent faire face aux risques ?
Ajouter de l’aléa aux aléas, ce n’est pas la priorité à nos yeux. Notre prochain défi collectif est bien d’intégrer l’aléa d’une pandémie mondiale et systémique. Gérer l’urgence, c’est trouver des réponses rapides et efficaces face à la crise.
Mes chers collègues, nous ne pourrons pas voter cette proposition de loi. L’appel a été lancé. Il a été entendu. Fermons le ban. Le Sénat aura répondu présent !

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la crise du covid-19 a révélé les carences de la couverture assurantielle des entreprises pour les pertes d’exploitation ne résultant pas d’un dommage strictement matériel.
La controverse n’a cessé de monter depuis plusieurs mois pour déterminer si ce risque était couvert ou non par les contrats d’assurance multirisque professionnelle souscrits par les entreprises, ce qui a conduit à de nombreuses procédures contentieuses. Plus largement se pose la question de savoir si les pertes économiques pour raison sanitaire majeure étaient assurées ou même assurables.
Dans le contexte exceptionnel que nous connaissons depuis le premier confinement, un appel à la solidarité du secteur assurantiel par rapport aux entreprises les plus touchées par la crise a été lancé : à défaut d’indemniser directement les assurés, les assureurs ont, par exemple, contribué au Fonds de solidarité pour les TPE et les indépendants à hauteur de 400 millions d’euros.
Cette contribution avait été décidée pour des raisons morales, mais aussi eu égard à la baisse de la sinistralité au moment du confinement, qui a entraîné des économies imprévues pour les compagnies d’assurance. Je pense, en particulier, à la baisse des accidents de la circulation.
Toutefois, cette contribution, à laquelle il faut ajouter des aides dites « extracontractuelles » des assureurs – couverture de certaines pertes d’exploitation, investissement en quasi-fonds propres, report d’échéances et autres remises –, dont le montant demande encore à être précisément établi, n’a pas éteint les critiques adressées au secteur, car les pertes des entreprises sont bien supérieures aux aides consenties et se chiffrent à plusieurs dizaines de milliards d’euros.
Pour leur défense, lors de leur audition le 28 avril dernier devant la commission des finances, les représentants de la Fédération française de l’assurance ont rappelé que certains sinistres courants n’avaient pas diminué avec le confinement, notamment les sinistres domestiques. Ils ont également fait valoir que la sinistralité routière repartirait à la hausse après le déconfinement. Il serait intéressant de savoir ce qu’il en est aujourd’hui de ce dernier point, notamment au regard des effets du second confinement.
Les pertes du secteur assurantiel lui-même, du fait de la crise économique, seraient également importantes. Rappelons qu’il s’agit d’un secteur diversifié, comprenant aussi des structures mutualistes.
Le 2 juin dernier, le Sénat a adopté une proposition de loi présentée par le rapporteur général de la commission des finances, Jean-François Husson, et largement cosignée, tendant à définir et à coordonner les rôles respectifs des assurances et de la solidarité nationale dans le soutien des entreprises victimes d’une menace ou d’une crise sanitaire majeure.
Elle vise à créer, d’une part, une garantie obligatoire contre les pertes d’exploitation consécutives à une menace ou à crise sanitaire grave et, d’autre part, un fonds d’aide à l’indemnisation de 500 millions d’euros par an, géré par la puissance publique. Le groupe RDSE avait soutenu cette initiative.
La présente proposition de loi de notre collègue Olivier Jacquin instaurerait, elle, une contribution exceptionnelle et « spontanée » sur les assurances pour financer la solidarité nationale face aux conséquences économiques et sociales en cas d’état d’urgence sanitaire. Cette contribution serait due sur la hausse du résultat d’exploitation constatée par les compagnies d’assurances par rapport à la moyenne des trois derniers exercices. Le non-paiement de la contribution entraînerait comme sanction la suspension pour au moins un an de leur agrément administratif par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Il faut lire cette proposition de loi à l’aune de l’accord conclu ce lundi entre le ministre de l’économie et les représentants du secteur de l’assurance, mais aussi de l’exclusion annoncée du risque pandémique des polices d’assurance à partir de 2021.
Si le secteur assurantiel n’est peut-être pas en mesure de couvrir l’essentiel des pertes subies par les secteurs directement touchés par les mesures administratives comme l’hôtellerie-restauration, le tourisme, la culture et l’événementiel, nous nous devons aussi d’apporter des solutions à ces derniers.
C’est le sens des amendements adoptés par le Sénat dernièrement, en loi de finances rectificative et dans le projet de loi de finances pour 2021, au sein duquel a d’ores et déjà été instaurée une contribution exceptionnelle de solidarité sur les primes versées au titre de l’assurance dommages.
Le message exprimé par les représentants de la restauration, de l’hôtellerie et des bars lors de leur audition hier par la commission des affaires économiques a été clair. Les différends avec les assureurs peuvent aussi porter sur des risques assurantiels considérés comme normaux…
Dans ce contexte, et à court terme, la présente proposition de loi n’apparaît pas déraisonnable. Elle aurait mérité sans doute davantage de précisions quant à la durée et à l’étendue géographique des restrictions donnant lieu à contribution. Les membres du groupe RDSE détermineront leur vote à l’issue des débats.
Applaudissements sur des travées du groupe SER.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je remercie Olivier Jacquin de cette proposition de loi visant à instaurer une contribution exceptionnelle sur les assurances pour concourir à la solidarité nationale face aux conséquences économiques et sociales d’une crise sanitaire majeure.
Concourir à la solidarité nationale, telle est la question qui se pose actuellement à nous. Elle se posera peut-être aussi dans le futur, car en l’état nul ne peut prédire s’il s’agit d’une crise exceptionnelle ou si nous serons amenés à en connaître d’autres.
La réponse à la crise sanitaire actuelle a exigé une mobilisation sans précédent de la part des pouvoirs publics afin de parer au plus pressé : chômage partiel, prêts garantis, etc. Toutes choses que nous avons ici saluées et auxquelles nous avons apporté notre soutien. Se pose ensuite la question du financement de l’ensemble de ces mesures.
La solidarité nationale doit être à présent au rendez-vous. Mais quid des financements ? Disant cela, je me tourne vers certains ménages, notamment ceux dont les revenus figurent parmi les deux déciles les plus élevés, et qui ont constitué une épargne spécifique grâce à cette crise. On peut aussi se poser la question de savoir comment faire contribuer les secteurs qui tirent particulièrement leur épingle du jeu. Cette semaine, Amazon s’est félicité d’avoir enregistré une hausse de 60 % de son chiffre d’affaires depuis le début de la crise.
Dans cette situation, force est de constater que les assurances, en raison d’une baisse inévitable de la sinistralité dont nous nous réjouissons tous, ont réalisé un sur-profit. Nous ne disposons pas encore de chiffres très précis, mais cela ne saurait tarder.
D’aucuns ont affirmé que cette proposition de loi était brouillonne. Mais c’est un peu notre réponse collective à la situation – et c’est normal, car il s’agit d’une crise sans précédent – qui a été brouillonne !
On a dit d’abord : ce serait bien si les assurances aidaient. Certaines ont aidé, d’autres non. Mme la secrétaire d’État chargée de l’économie sociale, solidaire et responsable le sait, les mutuelles se sont montrées solidaires, mais nous n’avons pas pu compter de la même manière sur l’ensemble du secteur assurantiel, plus guidé – c’est sa nature – par la recherche du profit que par le désir d’exprimer sa solidarité, contrairement au monde mutualiste.
Nos réponses ont été brouillonnes : appel à la morale, don forcé des assurances, taxe votée au Sénat, etc. La proposition d’Olivier Jacquin tend à nous sortir de cette situation : en cas de nouvelle crise sanitaire, nous n’aurons plus à improviser des réponses au fur et à mesure que nous nous rendons compte qu’elles sont insuffisantes !
Il s’agit d’un texte assez judicieux, qui se fonde non sur d’éventuels sur-profits imaginaires, mais sur un calcul a posteriori de la sinistralité et des économies réalisées. Son adoption nous permettrait à l’avenir de ne plus avoir à gérer une crise d’une telle ampleur de façon aussi confuse et en ayant toujours un temps de retard.
On ne gère pas une crise aussi forte en faisant appel à la morale. Le rôle de l’État est d’anticiper et d’organiser la solidarité, ainsi que le permettra ce texte.
Certaines compagnies d’assurances disposent de moyens suffisants pour engager des dépenses exceptionnelles. J’ai noté qu’Axa avait dépensé 587 869 dollars pour participer à la campagne des élections présidentielles américaines, preuve que cet assureur ne manque pas d’argent ! Il pourrait peut-être plus utilement faire preuve de solidarité afin que les coûts de cette crise sanitaire soient mieux partagés !
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
M. Philippe Folliot applaudit.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, cette proposition de loi n’est pas brouillonne, elle est dogmatique !
En effet, elle vise, comme souvent d’ailleurs les propositions émanant d’un certain côté de l’hémicycle, à institutionnaliser une situation événementielle, ce qui est particulièrement regrettable. Comment, d’une situation tout à fait extraordinaire, tirer des règles générales en matière de prélèvement de ressources ?
Le deuxième travers de ce texte nous ramène à 2012, lorsqu’un candidat à l’élection présidentielle proposait d’instaurer des taux extraordinaires d’imposition. Il en est revenu !Avec cette proposition de loi, on repart dans le même sens : une taxation à 80 %, chers collègues, c’est extraordinaire, c’est énorme !

Nous ne pouvons pas partager cette logique. Très clairement, cette proposition est dogmatique. En revanche, le raisonnement du groupe Union Centriste a été parfaitement clair et ordonné durant cette période de crise.
Lors du PLFR 2, en avril dernier, Françoise Férat et les membres du groupe UC ont présenté un amendement visant à taxer à 10 % les provisions des compagnies d’assurances afin de tenir compte des économies réalisées durant la période de crise sanitaire. Cette proposition a été retenue par le Sénat, contre l’avis du rapporteur général, mais elle a été supprimée pendant la navette.

Lors du PLFR 3, nous avons de nouveau présenté cette proposition, mais elle n’a pas été retenue.
Sourires.

Puis, lors du PLFR 4, il y a peu, Vincent Delahaye a défendu un amendement tendant à établir une taxe sur le chiffre d’affaires des compagnies d’assurances pour les risques dommages sur le montant des primes. Cette proposition n’a pas été retenue, mais nous sommes convenus d’en rediscuter dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021. C’est ce que le rapporteur général Jean-François Husson a fait.
Fort opportunément, Vincent Delahaye, au nom du groupe Union Centriste, a proposé de doubler cette taxe. Sa proposition a recueilli l’assentiment d’une majorité de notre assemblée. Ainsi, comme les orateurs précédents l’ont souligné, le Gouvernement a pu disposer d’un outil et d’un moyen de pression sur les compagnies d’assurances afin de les inciter à la modération en 2021 !
C’est dire que le cheminement suivi par le groupe UC est un raisonnement fort à propos, qui tient compte de la réalité des situations et ne cherche pas à établir des règles avant de savoir comment la crise évoluera et quelles seront ses conséquences sur l’un ou l’autre des opérateurs.
Aujourd’hui, les compagnies d’assurances sont les bénéficiaires de la situation, mais elles ne le seront peut-être plus demain si elles doivent prendre en charge les risques liés à la perte d’exploitation. Pourquoi leur infliger une peine supplémentaire alors même qu’elles pourraient remplir leur mission et formuler des propositions de prise en charge ?
C’est dire combien, en situation de crise, il importe de rester modeste et de chercher systématiquement les solutions les plus appropriées. C’est ce qu’ont fait Vincent Delahaye et le groupe Union Centriste en présentant un amendement ayant permis, à notre grande satisfaction, de faire avancer les choses.
Il faut, lorsque c’est nécessaire, mettre à contribution certains opérateurs – ce fut le cas pour les compagnies d’assurances –, mais il faut aussi songer à travailler ensemble à l’élaboration d’une couverture la plus large possible des risques susceptibles d’affecter l’activité économique. Nous avons du pain sur la planche. Mieux vaudrait, à notre sens, porter tous nos efforts sur ce type de travaux plutôt que de proposer des solutions dogmatiques, qui ne trouveront aucune application pratique à la prochaine situation événementielle !
Le bon sens doit prévaloir. De ce fait, comme l’a proposé Claude Nougein, que je salue, le bon sens conduit à ne pas approuver cette proposition de loi. Vous pouvez compter sur les membres du groupe UC pour ne pas voter un texte ne présentant aucun intérêt. Bien au contraire, il nuirait même à nos bonnes relations avec l’ensemble des opérateurs.
Mme la secrétaire d’État l’a évoqué, les hypothèses de rendement financier de cette contribution restent relativement modestes au regard des coûts identifiés. Cette proposition n’est donc absolument pas à la hauteur des enjeux. En revanche, la proposition de Vincent Delahaye était claire puisqu’elle portait sur 1, 2 milliard d’euros.

Là, c’est du concret !
J’espère que cette proposition de loi n’ira pas plus loin que ce premier examen au Sénat !
Applaudissements sur des travées des groupes UC et Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le bonheur des uns fait le malheur des autres : en période de crise sanitaire, l’adage populaire semble dramatiquement s’appliquer dans les relations problématiques des assurés avec leur assureur…
Contrairement à ce que j’ai entendu en commission des finances, le mécanisme que vient de présenter mon collègue Jacquin n’est pas confiscatoire. Il vise à taxer les sur-profits réalisés durant une période de crise. Plus précisément, la présente proposition de loi instaure une contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des entreprises d’assurance non-vie, dès lors que l’état d’urgence sanitaire s’est appliqué au cours d’un exercice comptable.
Nous ne nions pas que ce dispositif viendrait en complément d’autres dispositifs, qu’ils soient d’initiative sénatoriale – la taxe à 2 % dite Husson, du nom de notre rapporteur général – ou gouvernementale – l’augmentation de la TSA couplée au récent accord avec les assureurs. Reste que, au regard des lacunes que comportent tous ces dispositifs, le mécanisme proposé par les auteurs du texte paraît plus opportun.
Je ne reviendrai pas en détail sur la technique du dispositif ; Olivier Jacquin l’a fort bien présentée. En revanche, mes chers collègues, j’insiste, car il n’y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre : la proposition de loi a trait à la taxation des sur-profits des assureurs, non de leurs profits !
Cette distinction posée, parlons-en, de ces sur-profits… Durant le premier confinement, ils se sont montés à plus de 2 milliards d’euros selon le Gouvernement – estimation confirmée par l’UFC-Que Choisir. Cette proposition de loi présente donc un intérêt tout particulier, loin d’être superflue ou obsolète.
D’abord, elle n’est pas un outil législatif superfétatoire, car les pertes indemnisables que créent les pandémies ne sauraient être laissées à la simple appréciation des assureurs. L’interminable bras de fer – du moins celui qui semble être mis en scène – entre le Gouvernement et les assureurs est symptomatique de la discorde qui nous traverse sur ce sujet.
De ce point de vue, nous ne sommes pas dupes de l’accord récemment obtenu par le ministre de l’économie et des finances avec les assureurs : un simple gel des tarifs d’assurance en 2021 dans le secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration et les mondes de la culture, de l’événementiel et du sport ne nous paraît pas satisfaisant au regard des intérêts en présence.
Avec cet accord, je suis rassuré de voir que la majorité sénatoriale et le Gouvernement s’entendent sur un point : il faut faire participer les assurances, mais pas trop quand même, au risque de brusquer la « poule aux œufs d’or », pour reprendre l’expression employée par le rapporteur devant la commission des finances… D’autres n’ont pas ces pudeurs de gazelle : qui mieux qu’un ancien assureur, président de la région des Hauts-de-France, pour nous rappeler qu’il est urgent d’agir en matière de taxation des assureurs en temps de crise ?
Comment pourrions-nous nous en remettre à la seule confiance et au bon vouloir des assureurs, quand on sait que, avant le début de la crise sanitaire, seuls 7 % des contrats de restaurateur prévoyaient, plus ou moins explicitement, l’indemnisation du risque pandémique ?
Malgré ces stipulations, les assureurs ont refusé de couvrir les pertes liées à la pandémie, arguant de circonstances particulières : la fermeture ayant touché plusieurs établissements, il s’agit d’un risque de grande ampleur, non assurable, qui ne peut être porté par une compagnie privée ; c’est donc à l’État de gérer le sinistre. Alors que certains contrats comportaient le terme « pandémie », ce postulat, calqué sur le régime des catastrophes naturelles, revient à nier l’essence même de leur engagement !
Des actions en justice voient le jour par centaines, mais il n’appartient pas au juge de régler cette problématique a posteriori : c’est au législateur de s’en saisir a priori.
Certains assureurs ont tenu à informer leurs assurés que, à compter de l’année prochaine, ils ne seraient plus couverts pour les risques pandémiques. De fait, s’ils ne le sont plus, c’est qu’ils l’étaient… Pourquoi alors ne pas payer ? Au regard de l’imbroglio juridique que font naître ces conflits, un mécanisme aussi clair et précis que celui défendu par mon collègue Jacquin s’impose.
Malheur à celui qui voudrait faire respecter les termes du contrat, à l’image du grand chef gastronomique qui en a fait l’amère expérience : après avoir refusé de l’indemniser, son assureur a prétendu lui faire signer un avenant diminuant ses garanties ; quand le chef a refusé, il s’est vu signifier la résiliation de son contrat…
Non superfétatoire, le mécanisme proposé n’est pas non plus obsolète, car, malheureusement la pandémie de la covid-19 risque fort de n’être que la première d’une longue série. En ce sens, un rapport du groupe d’experts de l’ONU sur la biodiversité, publié en octobre dernier, nous met en garde : « Les pandémies futures seront plus fréquentes, se propageront plus vite, feront plus de mal à l’économie et tueront plus de personnes, si l’on ne fait rien. » On est bien loin du caractère exceptionnel des circonstances invoqué il y a quelques instants par Michel Canevet…
Ce groupe d’experts a chargé vingt-deux scientifiques d’éplucher des centaines d’études sur les liens entre les humains et la nature pour mieux comprendre le risque sanitaire posé par l’empiètement croissant de l’activité humaine sur l’habitat animal. Leurs conclusions sont sans appel : la coexistence de plus en plus étroite entre êtres humains et animaux sauvages revient à ouvrir une boîte de Pandore sanitaire ; jusqu’à 850 000 virus présents chez les animaux seraient capables d’infecter les humains.
Face à ces chiffres, comment pouvez-vous raisonnablement taxer cette proposition de loi d’obsolète ?
« Gouverner, c’est prévoir ; et ne rien prévoir, c’est courir à sa perte », disait Émile de Girardin. En ne prévoyant aucun mécanisme concret et actionnable en temps de crise sanitaire, vous faites courir à leur perte des millions d’assurés !
Les pertes économiques, pourtant bien réelles, sont considérées par le rapporteur comme « très variables selon l’ampleur et la durée des mesures administratives prises ». Il y a pourtant une variable qui ne varie pas : c’est l’engrangement de profits colossaux par les assureurs lorsque la sinistralité baisse de façon colossale.
« Je crains le pire, qui est probable, mais j’espère en l’improbable » : ce trait d’esprit d’Edgar Morin traduit plutôt bien le sentiment du groupe SER sur cette proposition de loi. Nous espérons qu’elle n’aura jamais à servir, mais, si la situation l’impose, nous pensons qu’il est vital que son mécanisme puisse être actionné. C’est pourquoi il est urgent de l’adopter !
Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les entreprises françaises, nous le savons tous, sont très durement touchées par la crise économique consécutive à l’épidémie de la covid-19. Nombre d’entre elles ont été confrontées à une absence de couverture de leurs pertes d’exploitation par leurs assurances, qui couvrent très rarement les pandémies.
Dans ce contexte, il semblerait que, en raison des fermetures administratives dues aux confinements successifs, qui ont entraîné une baisse des incidents habituellement couverts par les assurances, on constate une hausse des résultats d’exploitation des compagnies d’assurance.
Je comprends donc tout à fait l’intention louable des auteurs de cette proposition de loi. Je suis bien conscient qu’ils souhaitent seulement venir en aide à l’économie et opérer une redistribution de cette hausse des résultats d’exploitation vers les acteurs économiques les plus touchés par les terribles conséquences de la pandémie.
Toutefois, pour plusieurs raisons que je vais développer, je suis opposé à la méthode qu’ils proposent pour établir une contribution des assurances à l’effort de crise.
D’abord, ils suggèrent que les assurances soient assujetties à une contribution exceptionnelle chaque fois qu’un état d’urgence sanitaire sera déclaré sur tout ou partie du territoire, dès lors que leurs résultats d’exploitation augmentent. Lier tout état d’urgence sanitaire à une hausse des résultats des compagnies d’assurances est un raccourci ; la réalité est loin d’être aussi simple.
En effet, une corrélation entre ces deux phénomènes ne peut être formellement établie. L’état d’urgence sanitaire n’est pas statique : il peut s’accompagner de nombreuses mesures, susceptibles de changer au cours d’une même période d’urgence ou entre deux états d’urgence successifs, en fonction de la nature et de l’étendue de la menace sanitaire pesant sur le pays. Ainsi, le second confinement a été différent du premier, et des mesures intermédiaires ont été mises en place entre les deux.
Selon la nature des mesures prises, il n’est donc absolument pas certain qu’une hausse des résultats d’exploitation soit constatée lors de chaque état d’urgence sanitaire. En créant une disposition fiscale pérenne établissant un lien automatique entre état d’urgence sanitaire et hausse des résultats d’exploitation des compagnies, nous ouvririons la porte à des réclamations systématiques lorsque des bénéfices sont produits durant des périodes où l’économie est mise à mal. Nous risquerions également de mettre en place un système trop rigide, qui ne permettrait pas de s’adapter à la réalité de la situation, les manifestations d’une crise pouvant être extrêmement diverses.
Il me paraît bien plus opportun de prendre des mesures temporaires, applicables sur une courte période – généralement, un an –, et d’en reprendre de nouvelles en cas de nécessité. Dans cette perspective, le dispositif proposé par notre collègue Jean-François Husson lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2021 me semble bien plus adapté à la situation que cette proposition de loi.
En outre, la proposition de loi adoptée cet été par notre assemblée sur l’initiative du même Jean-François Husson vise, en substance, le même objectif que le texte soumis à notre examen cet après-midi – soutenir les entreprises françaises en difficulté en raison de la crise sanitaire par le biais des assurances –, mais serait bien plus efficace et moins pesante pour les compagnies d’assurance, qui seraient en partie soutenues par un fonds de l’État.
Par ailleurs, un accord a été trouvé entre le ministère de l’économie et les compagnies d’assurance. Comme le ministre Bruno Le Maire l’a récemment annoncé, les cotisations pour 2021 des contrats multirisques professionnels des entreprises de moins de 250 salariés du secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration, mais aussi de l’événementiel, du tourisme, du sport et la culture, seront gelées.

J’espère toutefois que le ministre reviendra sur sa déclaration s’opposant à l’instauration d’une assurance pandémie obligatoire, à laquelle il préfère la mise en place d’une faculté pour les entreprises de constituer des provisions à des conditions fiscales avantageuses. En effet, il me semble quelque peu naïf de penser que les petites entreprises seront en mesure de mettre volontairement de l’argent de côté à l’issue de la crise actuelle.
Si je comprends la volonté du ministre de ne pas imposer de nouvelles charges aux entreprises, déjà fortement mises à mal, je ne pense pas, à titre personnel, que la solution soit uniquement de leur donner la possibilité d’épargner. Si les entreprises venaient à ne pas recourir à cette faculté, l’État serait de nouveau forcé, en cas de nouvelle crise sanitaire, d’intervenir massivement pour les soutenir, à l’instar de ce qui a été fait durant l’actuelle pandémie. Cela induirait de nouveau une dette colossale pour la France, difficilement supportable compte tenu de celle que nous avons contractée ces derniers mois.
Nous devons soutenir les entreprises, mais cela ne devrait pas être du simple ressort de l’État : les assurances peuvent et doivent les aider par solidarité. Seulement, pour qu’une telle contribution ne soit pas contre-productive, sa mise en œuvre doit être réfléchie et mesurée. Malheureusement, je ne trouve pas que cela soit le cas avec cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la crise sanitaire a frappé notre économie de plein fouet. Malgré les mesures de soutien massives de l’État, nombre de nos concitoyens sont aujourd’hui en réelle difficulté et nombre d’entreprises jouent, ou joueront dans les mois à venir, leur survie.
Dès le début de la crise, la question de la participation des assureurs au soutien de l’économie s’est posée dans le débat public. Ce débat est légitime. De fait, il est normal qu’on attende de ce secteur qu’il prenne sa part de l’effort national et se mobilise en cas de survenance d’une telle crise sanitaire.
Tel est l’objectif affiché par les auteurs de cette proposition de loi, qui vise à créer une contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des entreprises d’assurance non-vie, dès lors que l’état d’urgence sanitaire a été appliqué au cours d’un exercice comptable. Concrètement, il s’agit de cibler les sur-bénéfices engrangés par les compagnies d’assurances du fait de la crise sanitaire, qui a entraîné une baisse significative de l’accidentologie et de la sinistralité.
Si cet objectif est louable, la réponse proposée par nos collègues risque de se heurter à de nombreux écueils.
D’abord, en visant une disposition fiscale liée à l’état d’urgence sanitaire, les auteurs de la proposition de loi supposent que ce régime entraîne automatiquement une hausse du résultat d’exploitation, ce qui est loin d’être évident pour le secteur des assurances non-vie. Cela constitue aussi une immixtion excessive dans la gestion de l’entreprise.
Ensuite, la proposition de loi crée une disposition fiscale pérenne, risquant ainsi de faire naître des réclamations sectorielles chaque fois qu’un secteur produira des bénéfices lors d’une période économique dégradée.
Plutôt qu’un système de taxation pérenne, il conviendrait d’envisager un dispositif fiscal ponctuel, à l’image de ceux adoptés par notre assemblée lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et du projet de loi de finances pour 2021. Ces dispositifs fiscaux exceptionnels n’ont vocation à s’appliquer qu’au cours d’un ou de deux exercices budgétaires.
En outre, toute initiative doit tenir compte des perspectives mitigées de rentabilité du secteur à moyen et long termes.
Le secteur assurantiel français compte plusieurs leaders mondiaux et fait face aujourd’hui à une concurrence européenne et mondiale. Il ne faudrait pas que des décisions trop brutales fragilisent nos compagnies à moyen terme. Or le dispositif de la proposition de loi est trop large et le taux de contribution proposé, prohibitif – 80 %.
Il faut ajouter que les acteurs de l’assurance n’ont pas tous été touchés de la même manière par la crise : en fonction du domaine d’activité, celle-ci a eu des conséquences plus ou moins graves.
N’oublions pas non plus que, à la suite des demandes répétées du Sénat, de l’Assemblée nationale et du Gouvernement, le secteur assurantiel a déjà contribué au soutien du tissu économique en réponse à la crise sanitaire. Pour les seuls adhérents à la Fédération française de l’assurance, les gestes commerciaux consentis se seraient élevés à 2, 6 milliards d’euros, auxquels il faut ajouter un abondement du Fonds de solidarité à hauteur de 400 millions d’euros.
Si la mobilisation des assureurs en réponse à une crise sanitaire est tout à fait justifiée, elle doit reposer sur le cœur de métiers des assureurs : l’indemnisation d’un risque prévu contractuellement, via l’instauration d’une couverture assurantielle applicable au risque sanitaire pour les entreprises.
Telle est l’orientation pragmatique choisie par le Sénat à travers plusieurs initiatives récentes, dont celle de notre collègue Jean-François Husson. Sa proposition de loi, adoptée en juin dernier par le Sénat, constitue une première réponse adéquate, en prévoyant l’instauration d’une garantie obligatoire pour indemniser les entreprises en cas de crise sanitaire.
Lors de l’examen du deuxième projet de loi de finances rectificative, le Sénat avait également adopté deux dispositifs fiscaux motivés par le souci d’instaurer une contribution exceptionnelle du secteur assurantiel en réponse aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Ils n’ont toutefois pas été retenus lors de la commission mixte paritaire.
Je déplore les lenteurs du Gouvernement pour trancher la question de la participation des assurances à l’effort national : il ne s’est pas saisi de la proposition de loi Husson, a mis en place un groupe de travail dont le devenir des propositions est inconnu et n’a pas repris non plus les propositions de nouveau mécanisme avancées par la Fédération française de l’assurance.
Mes chers collègues, la covid-19 nous a fait prendre conscience qu’il n’était plus possible de s’exonérer du risque sanitaire. Mais parce que cette proposition de loi ne prévoit pas le dispositif le plus adapté pour anticiper ce nouveau risque, ni même pour faire participer les assurances à la solidarité nationale, nous ne pouvons pas la voter.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons cet après-midi instaure une contribution exceptionnelle pour les entreprises d’assurances – hors assurance vie – due au titre de tout exercice au cours duquel un état d’urgence sanitaire a été déclaré en France et si le résultat d’exploitation a augmenté par rapport à la moyenne des trois précédents exercices. Le taux de cette contribution serait de 80 % du montant de cette augmentation.
Si tous les secteurs doivent être mis à contribution, il ne faudrait pas tomber dans l’excès envers un secteur en particulier, avec un taux de contribution tout à fait prohibitif, comme celui proposé par nos collègues.
D’autant que le Sénat, comme il a été rappelé, a déjà adopté plusieurs dispositifs tout à fait adaptés, en particulier la proposition de loi de Jean-François Husson en juin dernier, et, cet automne, l’amendement à la première partie du projet de loi de finances pour 2021 que notre collègue a présenté en sa qualité de rapporteur général, visant à instaurer une contribution exceptionnelle pour la seule année 2020, assise sur les primes versées au titre des contrats d’assurance dommages, avec un taux de 2 %.
« La crise sanitaire n’a pas de coupable, mais l’assurance fait un bon bouc émissaire », titrait dans sa chronique la journaliste en charge de l’actualité des entreprises, Bertille Bayart, dans Le Figaro du 1er décembre dernier. En effet, dans chaque crise que nous traversons, personnelle ou collective, il nous faut un coupable que nous pouvons blâmer de tous les maux : l’assurance jouera donc ce rôle cette fois, comme d’autres institutions précédemment, dans d’autres crises…
Pourtant, il nous faut analyser la situation non pas dans la précipitation, à chaud de l’événement encore en cours, mais avec pragmatisme et justesse.
Ainsi, comme l’expliquait le 28 mai dernier Bernard Delas, vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, « des améliorations en assurance automobile et une dégradation plus ou moins forte en prévoyance, assurance annulation d’événements, chômage, assurance crédit, pertes d’exploitation ou responsabilité civile sont prévisibles ». Et de conclure : « Au total, les résultats du secteur de l’assurance seront cette année fortement affectés, mais il est difficile d’apprécier aujourd’hui dans quelles proportions, sachant que tous les effets de cette crise sur la sinistralité comme sur l’activité n’apparaîtront que progressivement au cours des prochains mois. »
Dans ce contexte, mes chers collègues, il serait précipité d’adopter ce type de mesures avant même de connaître les effets réels et chiffrés de la crise sur ce secteur en particulier.
Au reste, ce secteur est le seul à avoir contribué au Fonds de solidarité, à hauteur de 400 millions d’euros, au côté de l’État et à s’être engagé à investir 1, 5 milliard d’euros dans les fonds propres des entreprises – sans même parler du 1, 6 milliard d’euros de mesures individuelles prévues par les assureurs en faveur des entreprises, des particuliers et d’initiatives citoyennes.
De plus, lundi dernier, les assureurs ont pris, sous la pression de Bercy, l’engagement de geler en 2021 les cotisations d’assurance multirisque professionnelle pour toutes les TPE et PME employant jusqu’à 250 salariés dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration, de l’événementiel, du tourisme, du sport et de la culture.
Il faut prendre en compte dans notre raisonnement ces différentes démarches, alors qu’aucun autre secteur n’a envisagé de faire de même.
Comme parlementaires, nous nous devons de prendre de la hauteur et ne pas céder aux pressions médiatiques et populistes, dont cette proposition de loi est clairement l’émanation. Comme le dit un proverbe chinois, « élever la voix ne donne pas raison »…
Souvenons-nous, mes chers collègues, qu’il y aura un jour d’après : il ne faudrait pas que, par nos actes d’aujourd’hui, nous mettions en péril notre modèle de société, auquel l’assurance concourt quotidiennement.
Pour toutes ces raisons, je ne voterai pas la proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

La discussion générale est close.
La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion de l’article unique de la proposition de loi initiale.
Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution exceptionnelle du secteur des assurances en cas d’état d’urgence sanitaire
« Art. 224. – I. – Les entreprises d’assurance non-vie opérant en France sont assujetties à une contribution exceptionnelle au titre de tout exercice au cours duquel un état d’urgence sanitaire a reçu application sur tout ou partie du territoire de la République lorsque, sur cet exercice, leur résultat d’exploitation a augmenté par rapport à la moyenne des trois derniers exercices clos. Le taux de cette contribution est fixé à 80 % du montant de cette augmentation.
« II. – La contribution est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« L’entreprise adresse à l’administration fiscale une déclaration, accompagnée des pièces justificatives, sur le calcul du montant de la contribution dont elle est redevable. Cette contribution est payée spontanément au comptable public compétent.
« III. – Le cas échéant, l’entreprise d’assurance qui ne procède pas au paiement de la contribution dans le délai prévu au II du présent article encourt la suspension pour une durée d’un an au plus de l’agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 du code des assurances. »

La présente proposition de loi vise à instituer une juste contribution exceptionnelle sur les assurances, afin qu’elles concourent à la solidarité nationale dans la réponse globale à la pandémie.
La diminution importante des accidents et des sinistres justifie de demander un effort important aux assureurs. Comme l’ont souligné mes collègues, les compagnies d’assurances avaient déjà économisé 1, 5 milliard d’euros sur la seule assurance automobile à la fin du mois d’avril…
Naturellement, il est essentiel qu’une telle contribution soit adoptée à périmètre constant des recettes des assurances, afin d’éviter que celles-ci ne la répercutent sur l’ensemble de leurs assurés par une augmentation des tarifs et des primes.
Le conseil municipal de Saint-Étienne, à l’unanimité, a demandé au Gouvernement de reprendre à son compte cette proposition de loi visant à instaurer une contribution exceptionnelle sur les assurances. Proposé par le groupe municipal de gauche « Saint-Étienne demain », ce vœu a obtenu le soutien de la majorité de droite ; il a été voté, en particulier, par le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, vice-président des Républicains.
Vous voyez, chers collègues centristes, des Républicains, madame la secrétaire d’État, que certaines propositions peuvent faire l’unanimité !
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

M. Olivier Jacquin. Ne vous inquiétez pas, j’en ai juste pour deux minutes trente – je n’irai pas jusqu’au couvre-feu…
Sourires.

Je ne répondrai pas à ceux de nos collègues qui, visiblement, n’ont même pas lu la proposition de loi, tant leur propos est resté général.
Plusieurs ont soutenu que ce texte interviendrait trop tard – cet argument est avancé aussi par Mme la secrétaire d’État. Pas du tout ! L’idée a été proposée dès le mois d’avril, sous la forme d’un amendement qu’on m’a invité à retravailler. Dans un projet de loi de finances rectificative suivant, on m’a dit : il faut un rapport de l’État… Je vous épargne toutes les étapes.
Au demeurant, le dispositif est prévu pour être récurrent. Comme l’a souligné ma collègue Sophie Taillé-Polian, au milieu de la réaction brouillonne de cette année, on mettrait dans la boîte à outils associée à l’état d’urgence sanitaire un instrument de plus pour anticiper.
Certes, madame la secrétaire d’État, le rendement de cette contribution serait faible, mais l’objectif n’est pas de s’acharner pour chercher de l’argent : il est de prélever un sur-profit – une notion qui se définit économiquement d’une manière très simple. Si vous voulez des idées de taxe à rendement fort, venez lors de l’examen de la partie recettes des PLF ; nous en défendons régulièrement un certain nombre…
Faible, le rendement le serait d’autant plus que certains assureurs ont fait des « gestes », comme ils disent, notamment de nombreuses mutuelles. Mais, comme l’a souligné l’UFC-Que Choisir, parmi les douze majors du secteur de l’assurance automobile, sept n’ont fait aucun geste commercial : ces entreprises seraient prélevées beaucoup plus que les autres.
A contrario, l’établissement du Grand Est d’une grande mutuelle d’origine agricole, dont j’ai appelé l’administrateur départemental, un établissement qui réalise en moyenne 600 millions d’euros de chiffre d’affaires, a consenti 18 millions d’euros de « gestes », preuves en main, ce qui correspond à son résultat d’exploitation moyen. Si vous lui appliquez la taxe aveugle de 2 % du chiffre d’affaires, tant vantée par nos collègues, il sera perdant par rapport au dispositif que nous proposons !

Cette proposition de loi vise à instaurer un prélèvement exceptionnel sur les assurances qui ont réalisé des sur-profits, pour qu’elles contribuent à la hauteur exigée par la situation. Je m’étonne que certains orateurs hostiles à ce texte aient opposé l’idée de générosité, de participation – pourquoi pas de don ? Dans quel pays, dans quelle philosophie politique négocie-t-on son imposition, sa contribution, surtout lorsque la situation est aussi grave qu’aujourd’hui et que les besoins de solidarité et de financements publics sont aussi importants ?
En démocratie, en république, les contributions sont fixées par la loi, suivant des critères assurant une juste participation, tenant compte des capacités contributives de chacun. Tel est l’esprit de cette proposition de loi de notre excellent collègue Olivier Jacquin, que je voterai résolument !
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Michel Canevet a excellemment présenté la position du groupe Union Centriste sur cette proposition de loi. Si l’idée est louable, force est de constater que sa mise en pratique ne serait assurément pas efficace.
En tout état de cause, ce dispositif ne correspond pas à un certain nombre de réalités, à commencer par celles du marché. Qu’on le veuille ou non, le système assurantiel dans notre pays est aujourd’hui ouvert à la concurrence, avec des sociétés de structures différentes – compagnies privées et mutuelles. Dans ce cadre, en cas de sur-profits, comme disent nos collègues, ou de profits exceptionnels, l’assureur pourra toujours in fine ajuster, en fonction de ses résultats et par rapport aux risques encourus, le niveau des cotisations demandées aux assurés, lesquels ont la liberté de changer d’assureur, dans des conditions facilitées par plusieurs dispositions législatives votées ces dernières années.
La surtaxation proposée condamnerait à certains égards les sociétés d’assurances françaises dans un marché ouvert à l’échelle européenne et mondiale, avec un certain nombre de conséquences macroéconomiques difficilement supportables pour ce secteur.
Dès lors, même si nous comprenons l’intention qui sous-tend la proposition de loi, nous ne pensons pas que la mesure proposée répondrait efficacement à l’objectif fixé. Je confirme donc que le groupe Union Centriste votera contre ce texte.

Je ferai trois observations.
La première est qu’un consensus s’est formé au Sénat pour taxer les compagnies d’assurances et les encourager à participer à la solidarité nationale. La taxe votée par le Sénat ne leur tord certes pas les bras comme celle qui est proposée dans ce texte, mais elle existe. Il n’y a donc pas de débat à ce sujet.
Ma deuxième observation est que cette proposition de loi a un gros défaut : il s’agit du déclenchement du dispositif. Je doute que les compagnies d’assurances réalisent des sur-profits en 2020 et 2021. En effet, comme le rappelait Mme la secrétaire d’État, elles devront constituer des provisions – les commissaires aux comptes s’en assureront – pour traduire dans leur bilan les dépréciations très importantes et bien réelles qui affectent leurs actifs.
Ces dépréciations concernent notamment l’immobilier commercial – les compagnies d’assurances sont propriétaires de nombreux centres commerciaux qui connaissent une baisse de valeur –, ou des actifs tels que les obligations d’État, dont la baisse des taux de rendement entraînera la dépréciation. Je doute donc que ces compagnies dégagent des sur-profits dans les deux ou trois années à venir.
Enfin, ma troisième observation a trait au caractère pérenne du dispositif proposé. Imaginons que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré localement du fait de la pollution causée par un accident survenu dans une usine. Une telle crise sanitaire, même locale et de courte durée, déclencherait l’application des mesures prévues dans la présente proposition de loi, alors même que les éventuels sur-profits enregistrés par les compagnies d’assurances ne seraient pas liés à cette crise. C’est un autre gros défaut de ce texte.
En conclusion, je rappellerai ce que l’on sait depuis la nuit des temps, à savoir qu’un bon impôt a une assiette large et un taux réduit ; à l’évidence, c’est tout le contraire qui nous est proposé.

Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi.
Je vous rappelle que le vote sur l’article unique vaudra vote sur l’ensemble de la proposition de loi.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 49 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Délais d'organisation des élections législatives sénatoriales et municipales partielles ainsi que des élections des membres des commissions syndicales
Délais d'organisation des élections législatives sénatoriales et municipales partielles ainsi que des élections des membres des commissions syndicales

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions des commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer des textes sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles et du projet de loi relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales (textes de la commission n° 221 et 222, rapport n° 220).
Dans la discussion générale commune, la parole est à Mme le rapporteur.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes en phase ultime d’examen de deux textes prévoyant le report d’élections partielles en raison de la crise sanitaire.
Alors que ces deux textes ont été déposés le 18 novembre dernier, nous arrivons déjà, moins d’un mois plus tard, au bout du processus parlementaire. Si cela démontre une nouvelle fois que le Parlement sait travailler efficacement, cela illustre aussi un certain manque d’anticipation du Gouvernement, qui s’est traduit par le report puis l’annulation de l’élection législative partielle dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais.
Je tiens tout d’abord à remercier la rapporteure de l’Assemblée nationale, Catherine Kamowski, pour son ouverture d’esprit et son écoute. Nous avons longuement échangé hier pour préparer les commissions mixtes paritaires et faire converger nos points de vue. Chacune a pu exprimer sa position en toute franchise et dans le respect du bicamérisme.
Je crois que nous partageons tous le même constat : la dégradation de la situation sanitaire nous contraint à reporter les élections partielles. Le danger ne porte pas sur les bureaux de vote, qui sont soumis à un protocole sanitaire très strict, mais sur la campagne qui précède les scrutins.
Ces textes s’inscrivent ainsi dans la continuité du report du second tour des élections municipales de 2020 et de la proposition du Gouvernement de reporter les élections régionales et départementales de 2021.
Nous partageons également le même objectif : ces élections partielles doivent être organisées dès que la situation sanitaire le permettra, et au tard le 13 juin 2021. L’intention du législateur doit être très claire à ce sujet : il s’agit bien d’une date butoir, les scrutins pouvant être organisés beaucoup plus tôt dans l’année, notamment dans les départements les moins touchés par le virus.
L’enjeu est important pour l’Assemblée nationale, où deux sièges sont aujourd’hui vacants, mais également à l’échelle municipale. Dans nos communes, le nombre d’élections partielles augmente au fil des semaines en raison des démissions, mais également du calendrier des annulations contentieuses : 161 élections partielles sont aujourd’hui pendantes, soit 100 de plus que la liste annexée à l’étude d’impact.
Dans 101 communes de moins de 1 000 habitants, des élections complémentaires sont nécessaires pour compléter le conseil municipal. Ces cas sont les moins problématiques, car le conseil municipal continue de fonctionner et dispose de l’ensemble de ses compétences. Dans 60 communes, une délégation spéciale a été mise en place, ce qui crée un véritable vide dans l’administration municipale. Comme l’a indiqué le Conseil d’État, ces communes doivent faire l’objet d’une vigilance particulière au regard du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Seul un motif sanitaire impérieux peut justifier le report du scrutin : je tiens vraiment à insister sur ce point afin de confirmer l’intention du législateur.
Au cours de ses travaux, le Sénat a prévu trois garde-fous pour s’assurer que les élections partielles seront bien organisées dès que la situation sanitaire le permettra. Telle est en effet la conséquence du principe constitutionnel de périodicité raisonnable du droit de suffrage que Philippe Bas a rappelé à juste titre au cours de nos débats.
Nous avons échangé de manière très constructive avec Mme la rapporteure de l’Assemblée nationale sur chacun de ces garde-fous, ce qui nous a permis de proposer une position équilibrée en commission mixte paritaire cet après-midi.
Premièrement, le Sénat a souhaité territorialiser l’information sanitaire pour que les élections partielles soient organisées dans les meilleures conditions possible en fonction des circonstances locales. Les recommandations générales du conseil scientifique ne sont pas suffisamment opérationnelles, notamment pour des communes qui ne comptent que quelques habitants.
Le Sénat a donc privilégié une information par les agences régionales de santé (ARS), qui sera rendue publique tous les quinze jours jusqu’à la tenue du scrutin. Après échange avec la rapporteure de l’Assemblée nationale, une nouvelle rédaction du texte précise bien qu’il s’agit de données épidémiologiques chiffrées permettant d’objectiver la décision de convocation des élections partielles. Loin de nous l’idée de lier cette décision à l’avis de l’ARS ni de permettre à cette dernière d’émettre un avis « de fond » sur le modèle des avis du conseil scientifique.
Deuxièmement, le Sénat a proposé de revenir plus rapidement au droit commun en prévoyant que ces textes s’appliquent pour les vacances survenues, non pas avant le 13 mars, mais avant le 16 février 2021. Cette date est en effet cohérente avec la sortie de l’état d’urgence sanitaire. La rapporteure de l’Assemblée nationale a toutefois souligné les risques d’effets de seuil que pouvait entraîner cette mesure, en particulier pour les élections législatives.
Nous avons donc accepté en CMP de nous rallier au calendrier de l’Assemblée nationale : les vacances constatées avant le 13 mars seront couvertes par le dispositif dérogatoire, les élections partielles devant être organisées avant le 13 juin 2021. Le ministre de l’intérieur a toutefois confirmé qu’il n’était pas possible d’organiser trois scrutins – une élection partielle ainsi que les élections régionales et départementales – dans la même journée. Le calendrier électoral devra être adapté en conséquence.
Lors de nos échanges avec la rapporteure de l’Assemblée nationale, nous avons envisagé des calendriers alternatifs, mais nous avons buté sur la difficulté d’organiser des élections partielles en mai, ce mois de l’année comptant quatre jours fériés.
En contrepartie de cette concession sur le calendrier, la CMP a décidé de maintenir le troisième garde-fou prévu par le Sénat, à savoir la création d’une voie de recours permettant à tout électeur de demander au sous-préfet d’organiser l’élection partielle lorsque la situation sanitaire le permet. Le sous-préfet devra alors répondre dans un délai de quinze jours, son silence valant rejet. Le cas échéant, l’électeur pourra ensuite déposer un référé-liberté, sur lequel le juge administratif statuera en quarante-huit heures. C’est donc un contrôle juridictionnel et citoyen qui est institué.
Enfin, la CMP a retenu le dispositif de double procuration prévu par l’Assemblée nationale et la facilitation des procurations à domicile prévue par le Sénat.
Il est également précisé dans le texte final que l’État doit fournir des équipements de protection aux communes, comme lors du second tour des élections municipales.
Toutes les conditions ont donc été réunies pour aboutir à un épilogue heureux, afin d’assurer de la meilleure façon possible la continuité de la vie démocratique. C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à voter les deux textes issus de ces CMP conclusives, fruits des échanges constructifs que nous avons eus avec Mme la rapporteure de l’Assemblée nationale, que je remercie encore.
Mme Jacky Deromedi et M. Thani Mohamed Soilihi applaudissent.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, les débats tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale ont permis d’enrichir utilement les deux textes proposés par le Gouvernement que je vous ai présentés la semaine dernière. La commission mixte paritaire a trouvé un équilibre qui tient compte des apports des deux chambres.
Je tiens à vous remercier pour la qualité de vos travaux, mesdames, messieurs les sénateurs, et je félicite tout particulièrement Catherine Di Folco pour ce résultat.
Les textes organique et ordinaire qui sont présentés à votre assemblée à l’issue des travaux des commissions mixtes paritaires répondent bien à notre objectif commun, puisqu’ils permettent de décaler les élections partielles tout en fixant une borne claire dans le temps pour leur organisation.
Les circonstances sanitaires particulières pourront ainsi être prises en compte pour l’organisation d’élections sur le territoire national, en particulier de la campagne électorale, moment essentiel de la démocratie – ce n’est certainement pas à des parlementaires que je l’apprendrai. Ce décalage de l’élection ne sera mis en œuvre que lorsque la situation sanitaire l’exigera.
Vous avez souhaité ajouter des modalités particulières pour cette période épidémique, qu’il s’agisse du dispositif de double procuration, de la hausse du plafond des dépenses ou encore des éclairages qui peuvent être apportés par les agences régionales de santé.
Le Gouvernement a bien relevé également l’introduction d’un recours possible pour les cas où certains estimeraient que l’organisation des élections tarde trop.
Les échanges entre les deux chambres, comme par ailleurs les échanges avec le Gouvernement, nous ont paru riches et constructifs. Ils ont permis l’élaboration du texte qui vous est présenté ce soir.
Dans le contexte de crise sanitaire et de pandémie que nous connaissons, l’ensemble de ces mesures temporaires permettra que la vie démocratique de notre pays se poursuive et s’adapte sans jamais – c’est là l’essentiel – être remise en cause.
M. Thani Mohamed Soilihi applaudit.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, si la crise sanitaire inédite bouleverse depuis le début de cette année notre vie, à la fois sociale, économique et démocratique, elle a également révélé la formidable capacité d’adaptation des élus, tant au niveau local que national, pour maintenir une écoute attentive aux besoins de nos concitoyens.
Aujourd’hui, la deuxième vague de l’épidémie requiert de nouvelles adaptations dans le fonctionnement de nos institutions nationales et locales. C’est ainsi que les deux projets de loi, l’un organique, l’autre ordinaire, qui nous ont été soumis prévoient la possibilité de reporter les élections partielles. Certaines d’entre elles sont déjà prévues, d’autres pourraient intervenir dans le cas où des scrutins, notamment municipaux, seraient invalidés.
La navette parlementaire a permis d’enrichir ces deux textes, et je suis heureux que les commissions mixtes paritaires aient été conclusives.
Parmi les apports issus des débats au sein de nos deux assemblées, je souhaite saluer en premier lieu deux dispositions introduites par l’Assemblée nationale.
La première permettra qu’un même mandataire dispose de deux procurations au lieu d’une seule, comme le prévoit le droit en vigueur. La seconde prévoit de majorer les plafonds de dépenses de 5 % par mois pour tenir compte de l’allongement de la durée de la campagne si les conditions sanitaires ne permettent pas d’organiser l’élection partielle dans les délais de droit commun, à savoir trois mois pour l’ensemble des élections, à l’exception des élections partielles au sein des conseils d’arrondissement, pour lesquelles le délai est de deux mois.
En second lieu, je me félicite que la commission des lois du Sénat ait proposé l’établissement de rapports épidémiologiques par les agences régionales de santé afin de permettre une évaluation de la situation sanitaire des circonscriptions concernées par le report d’une élection partielle. En effet, cette territorialisation de l’information permettra de mieux prendre en compte les circonstances locales et d’organiser plus rapidement les élections partielles dans les circonscriptions où la situation sanitaire le permet.
Dans un souci de transparence, les rapports des agences régionales de santé, qui suivent quotidiennement l’évolution de l’épidémie, seront établis et rendus publics tous les quinze jours jusqu’à l’organisation de l’élection partielle. Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ces rapports seront élaborés par l’administration territorialement compétente.
En dernier lieu, je me réjouis que le Sénat ait consacré le droit pour les personnes vulnérables d’établir leur procuration depuis leur domicile sans justificatif et sur simple demande adressée aux autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou par voie électronique. Je me réjouis également qu’il ait rappelé l’obligation pour l’État de fournir aux communes concernées des équipements de protection adaptés pour les électeurs et les membres des bureaux de vote.
Madame la ministre, mes chers collègues, compte tenu de ces apports et de la qualité des textes initiaux, le groupe Les Indépendants votera ces textes qui permettront de concilier au mieux les principes de sincérité du scrutin et de préservation de la santé publique.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire a permis aux élus d’adapter les pratiques, au niveau tant local que national, pour maintenir une écoute attentive aux besoins de nos concitoyens.
Toutefois, la circulation active du virus sur l’ensemble du territoire et les risques importants de propagation de l’épidémie qui pourraient résulter de l’organisation de scrutins électoraux ont conduit à adapter le calendrier électoral à plusieurs reprises. Suivant l’avis du conseil scientifique covid-19, nous avons notamment reporté le second tour des élections municipales du 22 mars au 22 juin 2020, les élections consulaires de mai 2020 à mai 2021, le renouvellement des six sénateurs des Français de l’étranger et les élections départementales partielles qui auraient pu intervenir pendant la période d’état d’urgence sanitaire.
Nous examinons ce soir les conclusions des deux CMP qui se sont tenues cet après-midi afin d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de deux projets de loi : un projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles, et un projet de loi relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales. Ces deux textes poursuivent le même objectif : reporter des élections partielles qui auront lieu dès que la situation sanitaire le permettra, et au plus tard le 13 juin 2021.
Plusieurs élections partielles sont concernées. Deux sièges sont vacants à l’Assemblée nationale dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais et la quinzième circonscription de Paris. Huit élections sénatoriales de septembre 2020 ont été contestées devant le Conseil constitutionnel, et donc annulées. À l’échelle locale, selon les dernières données fournies par le Gouvernement, sont concernées des élections municipales partielles dans 161 communes, les élections dans les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille et les élections à la métropole de Lyon, ainsi que l’élection des membres de 28 commissions syndicales de sections de communes.
Ces scrutins partiels auront lieu dès que la situation sanitaire le permettra – selon la formule consacrée – au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d’organisation des agences régionales de santé.
Je tiens à mon tour à saluer la qualité du travail fourni par les rapporteurs des deux chambres, Mmes Catherine Di Folco et Catherine Kamowski. Elles ont su identifier les éventuels points de divergence afin de trouver un consensus sur ce texte essentiel à la vie démocratique.
Je souhaite également souligner les différents apports des deux rapporteurs, à savoir l’extension des dispositions des projets de loi aux communes de la Nouvelle-Calédonie ; la création d’une voie de recours spécifique pour que les électeurs puissent contester au sein de leur circonscription la décision de l’autorité administrative qui refuserait de convoquer les élections partielles alors que la situation sanitaire le permettrait ; l’obligation pour l’État de fournir aux communes concernées des équipements de protection adaptés pour les électeurs et les membres des bureaux de vote ; la possibilité d’avoir deux procurations par mandataire ; enfin, la majoration des dépenses électorales de 5 % par mois.
Compte tenu de ce travail de qualité et de ces avancées, le groupe RDPI votera en faveur des textes issus des travaux des commissions mixtes paritaires.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme nous le constatons péniblement depuis de nombreuses semaines, la pandémie de covid-19 confronte nos sociétés à une série de défis à relever : des défis sanitaires, bien entendu, mais aussi économiques et sociaux. Cette crise met également à l’épreuve nos institutions démocratiques.
Depuis désormais plus de neuf mois, la gouvernance est souvent faite de mesures provisoires et extraordinaires. Les circonstances le justifient, mais avec malheureusement le risque que l’exception et la suspension des règles paraissent devenir la norme.
Aussi, il nous revient de protéger notre démocratie et nos institutions, de les consolider dans leur fondement afin qu’elles traversent l’épisode que nous vivons sans se briser. Comme le rappelait solennellement le président Larcher la semaine dernière dans cet hémicycle, il est impératif que nos institutions soient à même de tenir leur rôle et leurs fonctions.
Nous avons toujours affiché notre soutien aux élus locaux, qui réussissent à faire vivre la démocratie locale en dépit des circonstances. Je tiens à leur renouveler ma profonde gratitude pour leur dévouement et leur persévérance à faire vivre nos territoires et soutenir nos concitoyens.
Outre l’exercice des fonctions et les prises de décision, se pose également le problème de la désignation de ceux qui exercent des fonctions publiques électives. Le calendrier électoral ignore la crise sanitaire ; c’est donc à nous de l’adapter et d’en repenser les modalités pour que cette pandémie ne soit pas synonyme de suspension de toute forme de vie démocratique, mais qu’elle révèle au contraire nos capacités d’adaptation et notre persévérance à ne jamais renoncer à l’une des activités essentielles de notre modèle de société.
Le Sénat y travaille, puisqu’il a constitué une mission d’information pour évaluer la faisabilité du vote par correspondance, en particulier en vue des élections régionales et départementales de 2021 – nous aurons l’occasion d’en débattre à la fin du mois de janvier.
Pour autant, la raison impose de s’en tenir à une position simple : l’isoloir n’est pas qu’un symbole, il est une garantie de l’exercice des droits du citoyen. À l’heure des réseaux sociaux, des objets connectés en tout genre et de la commercialisation de nos données personnelles, l’isoloir est sans doute l’un des derniers lieux où chaque concitoyen fait un choix libre de toute influence, seul avec sa conscience.
Pour ces raisons, en l’état de nos connaissances et de nos travaux, le report des échéances électorales apparaît comme la seule solution susceptible de préserver notre démocratie de toute forme de dépréciation. Si les conditions sanitaires ne permettent pas de constituer des bureaux de vote sans risque, alors il faut attendre.
Nous n’affirmons pas qu’il faut attendre indéfiniment, mais au moins le temps que nous puissions organiser les scrutins, non pas seulement dans des conditions sanitaires satisfaisantes, mais aussi dans des conditions démocratiques à la hauteur de notre République, autrement dit qui garantissent un scrutin fiable, sincère et respectant le caractère personnel et secret du vote.
MM. Loïc Hervé et Christian Bilhac applaudissent.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous nous sommes livrés à un examen « express » de ces deux textes qui, nous l’espérons, permettront de répondre aux situations des deux élections législatives partielles qui vont devoir se tenir et à celle des centaines de communes qui attendent de pouvoir organiser des élections. Je pense notamment aux communes sous le régime de la délégation spéciale, qui n’a pas vocation à durer. On ne peut laisser des territoires et des citoyens sans représentant ; cela est d’autant plus vrai pour les exécutifs locaux.
Les élections ne doivent pas être confisquées. Nous avons déjà évoqué notre mécontentement face au manque d’anticipation du Gouvernement dans la gestion des conséquences de la crise et la nécessité de changer les méthodes de travail. Les conditions d’examen parlementaire doivent permettre un travail serein, imposant un temps de réflexion collective, surtout sur un sujet aussi important que la vie démocratique.
Nous serons vigilants quant à la prise en compte de l’impératif d’organisation des élections partielles au plus vite, c’est-à-dire dès que la situation sanitaire le permettra. L’incertitude plane sur la résorption de l’épidémie et cela perturbe inévitablement le fonctionnement des institutions, mais nous ne sommes plus dans la surprise, et l’exécutif se doit de donner un cadre pour la tenue des élections afin d’être au plus près du droit commun. L’exception – en l’occurrence, le report – ne peut devenir la norme.
Ce cadre doit reposer sur des évaluations chiffrées de l’évolution de l’épidémie. Le Sénat avait voté des dispositions prévoyant la publication de données épidémiologiques locales par les ARS concernées tous les quinze jours jusqu’à l’élection. Nous saluons le maintien par la CMP de ces dispositions qui permettront d’apprécier la situation sanitaire.
Ce cadre doit également donner les moyens aux communes d’organiser des élections dans de bonnes conditions sanitaires afin que les citoyennes et citoyens ne se sentent pas en danger lorsqu’ils seront appelés à exercer leur droit. L’abstention est un fléau que la crise a aggravé. Alors que nous sommes en capacité d’anticiper le calendrier électoral, il est crucial de soutenir la participation. Cela implique des adaptations, comme la facilitation des procurations et la majoration des dépenses des candidats, qui doivent eux-mêmes se trouver en capacité d’adapter leur façon de faire campagne.
Ces adaptations visent à faire vivre la citoyenneté et à encourager la participation dans un cadre sécurisé et aussi stable que possible. La perturbation du calendrier implique déjà un chamboulement important. Veillons à ne pas l’accentuer.
Les inquiétudes relatives aux élections départementales et régionales sont légitimes. Le sujet des élections partielles complexifie les projections d’organisation, car le calendrier électoral doit garder un rythme régulier et éviter les embouteillages. Nous attendons le projet de loi concernant ce report en particulier, qu’il est temps de fixer, madame la ministre.
La convocation des élections revient à l’exécutif et à ses représentants, mais le travail entourant cette tenue se doit d’intégrer les parlementaires que nous sommes, tout comme les élus locaux, dans le respect des impératifs de transparence et d’évaluation et afin d’éviter toute dérive arbitraire ou improvisation.
Nous voterons donc ces textes, tout en prenant en considération l’ensemble des points de vigilance que j’ai soulevés.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, une fois encore pendant cette crise sanitaire, députés et sénateurs sont parvenus à un accord dans l’examen de deux textes initiés par le Gouvernement, et c’est heureux. Il s’agissait d’un projet de loi organique et d’un projet de loi relatifs aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles, et aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales. Il est important de mentionner les conditions et les délais dans lesquels ils ont été adoptés.
Mardi matin, la commission des lois examinait le texte arrivé de l’Assemblée nationale. Mardi, en fin d’après-midi, nous adoptions le texte. Aujourd’hui, il y a tout juste quatre heures, avec nos collègues du Palais Bourbon, nous parvenions à un accord sur ce texte. Et à présent, nous examinons les conclusions de cette commission mixte paritaire. La Haute Assemblée a rarement connu un processus parlementaire aux délais aussi contraints.
Madame la ministre, je souhaiterais – cette demande est unanimement partagée sur ces travées, me semble-t-il – que la crise sanitaire ne serve pas de prétexte à délibérer dans de telles conditions à l’avenir !
Avant de revenir sur les dispositions adoptées en séance et conservées en commission mixte paritaire, je tiens à saluer le travail de nos deux rapporteurs : Mme Catherine Di Folco au Sénat et Mme Catherine Kamowski à l’Assemblée nationale. Grâce à leur ouverture d’esprit et leur sens du bicamérisme, nous sommes parvenus à trouver un accord.
Dans le cadre de l’examen de ce projet de loi et de ce projet de loi organique, les deux chambres ont partagé les mêmes objectifs : les élections partielles doivent être organisées une fois que la crise sanitaire le permettra, et au plus tard le 13 juin 2021. Autrement dit, il s’agit d’une date butoir.
J’aimerais indiquer, dans la droite ligne de ce qu’a rappelé notre rapporteur, les mesures adoptées dans notre hémicycle et conservées en commission mixte paritaire.
Il s’agit tout d’abord de la territorialisation de l’information sanitaire, en exploitant davantage les données fournies par les ARS. A contrario du conseil scientifique, qui rend « des recommandations générales sur les conditions d’organisation », au niveau national, les ARS sont les mieux à même de fournir des données épidémiologiques chiffrées, de la manière la plus objective qui soit, car tenant compte des circonstances sanitaires locales. Ainsi, elles transmettront des avis tous les quinze jours, qui permettront d’évaluer la possibilité d’organiser ou pas des élections partielles.
Ensuite, la commission mixte paritaire a conservé la création d’une voie de recours, afin que tout électeur puisse demander à l’autorité administrative d’organiser des élections partielles lorsque la situation sanitaire le permet. Le préfet dispose alors de quinze jours pour lui répondre, son silence valant rejet. Il appartiendra au juge des référés de se prononcer sous quarante-huit heures sur la possibilité d’organiser ou pas les élections.
Enfin, une disposition adoptée par l’Assemblée nationale et que nous avions déjà autorisée à l’occasion de l’organisation des élections municipales concerne la possibilité pour un électeur de disposer de deux procurations.
Cependant, nous regrettons que ces textes ne s’appliquent pas uniquement aux vacances intervenues avant le 16 février dernier, c’est-à-dire avant la fin de l’état d’urgence sanitaire, comme nous le proposions. Le consensus bicaméral s’est finalement porté sur la date du 13 mars 2021.
Par ailleurs, comme nous l’avions demandé dès l’examen en première lecture, mardi dernier, le Gouvernement nous a assuré qu’il serait impossible d’organiser trois élections dans la même journée, à savoir les municipales, les départementales et les régionales. Le calendrier électoral sera heureusement adapté en conséquence.
Forts de ces fructueux échanges avec nos collègues de l’Assemblée nationale, nous sommes parvenus à trouver un accord en commission mixte paritaire. Je tiens, de nouveau, à saluer et à remercier nos collègues députés.
Ainsi, les sénatrices et les sénateurs du groupe Union Centriste voteront en faveur du texte établi par la commission mixte paritaire sur ce projet de loi et ce projet de loi organique, en espérant ne plus avoir à examiner de pareils textes reportant les élections à l’avenir…
Mme Maryse Carrère et M. Stéphane Artano applaudissent.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons pour la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur les projets de loi relatifs aux délais d’organisation des élections législatives et municipales partielles.
Autant le dire d’emblée, il n’y aura pas de suspense, puisque la commission mixte paritaire de ce jour a été conclusive. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera ces projets de loi.
J’aurais pu m’en tenir à ces trois phrases.
Néanmoins, comme mon collègue Didier Marie en première lecture, je vais vous faire part de quelques regrets pour hier et de quelques points de vigilance pour demain.
Mon premier regret concerne le temps trop long pris par le Gouvernement pour saisir le Parlement de ces projets de loi. Le ministère de l’intérieur aurait pu se soucier bien plus tôt de la vacance d’une circonscription dans le Pas-de-Calais. Il aurait pu également anticiper la nécessité d’organiser des élections municipales partielles.
Le Gouvernement nous invite donc à donner une base juridique solide aux décisions administratives qu’ont pu prendre certains préfets, comme celui du Pas-de-Calais. Il nous propose aussi de légitimer ses propres décisions, lorsqu’il a ajourné sine die l’organisation des élections municipales partielles. Nous le ferons, madame la ministre.
Deuxième regret, alors que tout le monde dans cet hémicycle connaît la gravité de la crise, et que nous évoquons souvent l’impact sanitaire, économique et social de la pandémie, les conséquences démocratiques de la covid-19 ne sont pas suffisamment prises en compte.
La vacance de deux circonscriptions législatives dans le Pas-de-Calais et à Paris prive des dizaines de milliers de nos concitoyens d’un député. Or, pour faire face à la crise et à ses conséquences, nos compatriotes gagneraient à avoir à leurs côtés tous leurs élus, qu’ils soient locaux, nationaux ou européens.
En effet, dans la période difficile que nous traversons, beaucoup de nos concitoyens ont besoin d’un député pour les accompagner dans leurs démarches et pour les aider dans leurs relations avec l’administration, par exemple.
Vous l’aurez compris, madame la ministre, une circonscription sans député, ce n’est ni souhaitable pour les administrés ni sain pour la démocratie. Il faut donc remédier à cette situation dans les meilleurs délais. En un mot, il faut déconfiner la démocratie, ce qui sera d’autant plus facile que le Président de la République et le Gouvernement ont annoncé la sortie progressive et par étape du confinement.
Si l’état d’urgence sanitaire est levé le 16 février prochain, alors il n’y aura plus de raison objective de ne pas organiser ces élections partielles dans la foulée.
Troisième regret, madame la ministre, notre groupe a présenté en première lecture des amendements qui auraient permis de fixer un calendrier et des modalités plus clairs, plus lisibles et plus compréhensibles. Nous n’avons pas été suivis et nous le regrettons.
Venons-en aux points de vigilance pour demain ! Le premier concerne le suivi territorial de la pandémie. Mme le rapporteur a proposé de nous en remettre à des rapports épidémiologiques rendus par les ARS pour apprécier la situation sanitaire des territoires concernés, au cas par cas. Je salue cette initiative fort heureuse.
Nous formons le vœu que les agences régionales de santé désignées pour coordonner la campagne de vaccination disposent aussi du temps et des moyens humains pour réaliser ces rapports dans les règles de l’art. Nous serons très attentifs à ce que la priorité donnée par le Gouvernement à la campagne de vaccination ne relègue pas loin derrière la remise de ces rapports. Madame la ministre, nous comptons sur votre vigilance à ce sujet.
Le deuxième point de vigilance sur lequel je souhaite attirer votre attention, c’est que nous attendons de la part de l’exécutif l’information la plus claire, précise et complète possible, dès la levée de l’état d’urgence sanitaire, sur les calendriers qu’il retiendra pour organiser les scrutins. Le volet démocratique sera aussi important que le volet économique et social pour la sortie progressive de la crise.
Le troisième point de vigilance porte sur la nécessaire information qui doit circuler entre les préfets et les candidats aux élections. Les préfets doivent informer tous les candidats déclarés et ceux qui se seront déclarés, le moment venu, dans les meilleures conditions. En effet, certaines situations se sont révélées peu satisfaisantes, lorsque des candidats déclarés aux élections législatives ont appris a posteriori les décisions de report et de prorogation de la campagne électorale qui avait démarré.
En conclusion, je veux vous dire, madame la ministre, que le vote favorable que notre groupe va émettre ce soir est un acte de responsabilité. Le même esprit de responsabilité a présidé aux travaux de la commission mixte paritaire de ce jour. C’est encore ce même esprit que tous les sénateurs et tous ceux qui se succèdent au banc des ministres ont en partage.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons ce soir pour discuter des conclusions de la commission mixte paritaire qui s’est tenue plus tôt dans la journée sur ces deux textes.
Ces derniers procèdent à un certain nombre d’ajustements du droit électoral, dans le contexte particulier de la crise sanitaire que nous traversons.
À cet égard, je commencerai par dire que nous regrettons les délais extrêmement brefs dans lesquels nous avons été conduits à nous prononcer sur ces sujets.
La procédure législative a bel et bien été réduite à sa plus simple expression : les textes sont arrivés en commission devant les députés lundi dernier, ont été votés par notre assemblée ce mardi et discutés en commission mixte paritaire cet après-midi même !
Certains ont déjà rappelé qu’il était impératif que leur adoption intervienne d’ici la fin du mois de décembre, puisque l’objectif est de permettre le report des élections législatives partielles de la sixième circonscription du Pas-de-Calais.
Bien évidemment, nous ne sommes pas en période ordinaire, mais tout de même ! Cette précipitation révèle un certain manque d’anticipation de la part du Gouvernement.
Au demeurant, je tiens à souligner qu’il n’est pas particulièrement rare que surviennent des élections partielles.
En dépit des réserves que nous exprimons quant à la méthode, force est de constater que la situation sanitaire nous engage effectivement à opérer plusieurs aménagements du calendrier électoral.
La règle habituelle des trois mois impartis pour organiser des élections partielles se conjugue en effet assez mal avec les problématiques soulevées par la deuxième vague de l’épidémie.
Alors même qu’il est envisagé, à la suite du rapport de M. Jean-Louis Debré, de reporter les élections départementales et régionales pour des raisons sanitaires, il serait en effet pour le moins incohérent de laisser se poursuivre le déroulement des élections partielles comme à l’accoutumée.
D’ailleurs, dans certains cas, comme a pu le relever notre collègue Catherine Di Folco dans son excellent rapport, l’autorité administrative a déjà pu annuler certaines élections partielles en se fondant sur la théorie des circonstances exceptionnelles.
Cette solution n’a cependant pas été adoptée partout, d’où l’intérêt de l’intervention du législateur. Notre assemblée l’a reconnu, en adoptant unanimement ces textes il y a deux jours.
Notre vote, s’il souscrit aux objectifs généraux des deux projets de loi, s’est accompagné d’un certain nombre de modifications et d’améliorations, qui ont heureusement été en partie maintenues à l’issue des discussions en commission mixte paritaire.
Plus précisément, notre souci a été de mieux concilier le respect des principes constitutionnels gouvernant l’organisation des élections en général avec la question particulière du report prévu des élections partielles.
Pour cela, nous avons ajouté plusieurs garde-fous visant à garantir que l’autorité administrative organisera, dès que cela sera raisonnable d’un point de vue sanitaire, les élections partielles concernées.
Nous avons tout d’abord rapproché des territoires le lieu de préparation des recommandations d’experts qui seront formulées en perspective des élections partielles. En effet, alors que le texte d’origine prévoyait la consultation du conseil scientifique, nous lui avons préféré les agences régionales de santé, plus proches du terrain.
Ensuite, nous avons créé une voie de recours pour que tout électeur puisse demander au sous-préfet d’organiser l’élection partielle lorsque la situation sanitaire le permet. Sans réponse de celui-ci dans un délai de quinze jours, la demande sera considérée comme rejetée, ouvrant la voie à un référé-liberté devant le juge administratif qui statuera en quarante-huit heures.
Enfin, figurent dans les textes que nous discutons ce soir les dispositions relatives à la facilitation des procurations à domicile. En cohérence avec nos positions passées sur ce sujet, nous avons également proposé des garanties supplémentaires afin d’assurer le bon déroulement du scrutin, en prévoyant la distribution de protections aux personnes vulnérables.
En définitive, notre assemblée a donc bien reconnu l’opportunité de procéder à cet aménagement du calendrier électoral, tout en regrettant qu’il soit organisé en dernière minute. Ce type de changement n’est évidemment pas un acte anodin pour le fonctionnement de la République, mais la situation actuelle n’est pas, il faut en convenir, anodine.
Bien évidemment, notre groupe se réjouit du caractère conclusif de la commission mixte paritaire.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, ainsi que de la reprise de plusieurs apports du Sénat, notre groupe votera ces projets de loi, fruits d’un travail parlementaire mené en bonne intelligence, sans toutefois perdre de vue la nécessaire vigilance qu’il convient de maintenir sur ces questions vitales au bon fonctionnement de notre processus démocratique.
M. Loïc Hervé, Mme Maryse Carrère et M. Stéphane Artano applaudissent.

La discussion générale commune est close.
Nous passons à la discussion, dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire, du projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement. En outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
I. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 178 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les sièges vacants de députés donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
I bis. –
Supprimé
II. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 322 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 précitée, les sièges de sénateurs devenus vacants avant le 13 mars 2021 donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
II bis. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au deuxième alinéa des articles L.O. 498, L.O. 525 et L.O. 553 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
II ter. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au dernier alinéa du II de l’article 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la vacance du tiers des sièges survenue avant le 13 mars 2021 au sein de l’assemblée de la Polynésie française donne lieu à un renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française organisé dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
II quater. – Par dérogation au délai de trois mois prévu à la première phrase du troisième alinéa de l’article 193 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
II quinquies. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, applicable à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en vertu de l’article 12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, les vacances survenues au sein de cette assemblée avant le 13 mars 2021 donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
II sexies. – Pour l’application du présent article, la situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l’agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle.
Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les données épidémiologiques mentionnées au premier alinéa du présent II sexies sont rendues publiques par l’administration concernée localement.
III. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.

Sur l’article unique du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’article ?…
Le vote est réservé.

Personne ne demande la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble du projet de loi organique.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 50 :
Le Sénat a adopté.
Nous passons à la discussion, dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement. En outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Délais d'organisation des élections législatives sénatoriales et municipales partielles ainsi que des élections des membres des commissions syndicales
Projet de loi relatif aux délais d'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales
I. – Pour l’application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
II. – Pour l’application de l’article L. 272-6 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 avril 2021 au sein d’un conseil d’arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
II bis. –
Supprimé
II ter. – Pour l’application des I et II du présent article, la situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l’agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle.
Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les données épidémiologiques mentionnées au premier alinéa du présent II ter sont rendues publiques par l’administration concernée localement.
II quater. – Tout électeur peut saisir l’autorité administrative compétente en vue de la convocation des électeurs pour une élection partielle mentionnée au présent article.
Le silence gardé par l’autorité administrative pendant quinze jours vaut rejet de la demande de convocation des électeurs.
Tout électeur peut contester la décision de l’autorité administrative devant le juge des référés, dans les conditions prévues à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
III. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.
I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique :
1° Aux élections partielles mentionnées à l’article 1er de la présente loi et aux I et II bis à II quinquies de l’article unique de la loi organique n° … du … relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles ;
2° Aux élections des membres des commissions syndicales mentionnées à l’article 2 de la présente loi.
Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.
II. – Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.
Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
III. – À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.
IV. – Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin.
Les dépenses résultant du présent IV sont à la charge de l’État.
Pour les élections partielles mentionnées à l’article 1er de la présente loi ou dans la loi organique n° … du … relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles, les plafonds de dépenses prévus à l’article L. 52-11 du code électoral sont majorés de 5 % par mois pour chaque période d’un mois entamée au-delà du délai de convocation prévu par le code électoral.
Par dérogation au délai de trois mois prévu à l’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 151-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les élections des membres des commissions syndicales peuvent être organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
Pour l’application du premier alinéa du présent article, la situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l’agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection.
Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les données épidémiologiques mentionnées au deuxième alinéa sont rendues publiques par l’administration concernée localement.

Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.

Personne ne demande la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 14 décembre 2020 :
À quinze heures et, éventuellement, le soir :
Nouvelle lecture du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif au Conseil économique, social et environnemental (texte n° 129, 2020-2021) ;
Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851-31-3 du code de la sécurité intérieure (texte de la commission n° 209, 2020-2021) ;
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la répartition des sièges de conseiller à l’assemblée de Guyane entre les sections électorales (texte de la commission n° 207, 2020-2021).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt heures quinze.