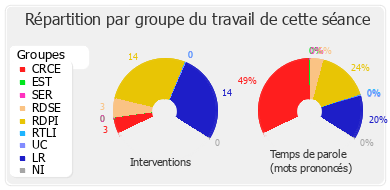Séance en hémicycle du 31 mars 2011 à 15h00
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures, sous la présidence de Mme Catherine Tasca.

La séance est reprise.

J’informe le Sénat que la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a fait connaître qu’elle a d’ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu’elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au prix du livre numérique, actuellement en cours d’examen.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu ultérieurement lorsque le Gouvernement formulera effectivement sa demande.

L’ordre du jour appelle l’examen de la proposition de résolution, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution par Mme Annie David et les membres du groupe CRC-SPG, relative à la mise en conformité du droit français concernant le régime des astreintes et le système de forfaits en jours sur l’année, considérés par le Comité européen des droits sociaux comme violant différentes dispositions de la Charte sociale européenne révisée (proposition n° 328 rectifié).
La parole est à M. Guy Fischer, auteur de la proposition de résolution.

Madame la présidente, monsieur le ministre chargé des affaires européennes, mes chers collègues, je commencerai par vous rappeler que la Charte sociale européenne est un traité du Conseil de l’Europe qui sauvegarde les droits sociaux et économiques de l’homme.
Adoptée en 1961, ratifiée par la France en 1973 et révisée en 1996, cette charte vise, selon ses propres termes, à garantir les droits sociaux et économiques de l’homme en énonçant des droits et des libertés qu’un processus particulier de contrôle est censé garantir.
Ce contrôle a été confié au Comité européen des droits sociaux, dont la fonction est de statuer en droit sur la conformité des situations nationales avec la Charte sociale européenne, le protocole additionnel de 1988 et la Charte sociale européenne révisée. Il peut prendre deux formes différentes : une procédure de contrôle sur la base de rapports nationaux, mais aussi – et c’est de cela dont il s’agit dans cette proposition de résolution – une procédure dite de « réclamation ». Celles-ci peuvent être engagées par les organisations non gouvernementales dotées du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe et inscrites sur une liste établie à cette fin par le Comité gouvernemental, la Confédération européenne des syndicats, l’Organisation internationale des employeurs ou encore les organisations d’employeurs et les syndicats de l’État concerné.
La procédure de réclamation se déroule ainsi : la réclamation déposée par un acteur habilité est examinée par le Comité qui, si les conditions de forme sont remplies, décide de sa recevabilité. Une fois la réclamation déclarée recevable, une procédure écrite se déroule avec échange de mémoires entre les parties, le Comité pouvant décider, s’il l’estime nécessaire, de procéder à des auditions publiques.
À l’issue de ce parcours, le Comité adopte une décision, appelée « décision sur le bien-fondé de la réclamation », qu’il communique aux parties ainsi qu’au Comité des ministres.
C’est à l’issue de cette procédure que, dans sa décision sur le bien-fondé en date du 23 juin 2010, le Comité européen des droits sociaux a considéré que notre législation en matière de temps de travail et, plus spécifiquement, la règle des forfaits annuels en jours ainsi que celle relative aux astreintes n’étaient pas conformes à la Charte sociale européenne révisée.
Je le sais, dans notre pays, la question de la durée hebdomadaire du temps de travail n’a cessé de faire l’objet d’une polémique entre, d’une part, ceux qui attaquent et dénoncent les mesures de réduction du temps de travail, sans d’ailleurs jamais les remettre en cause, et, d’autre part, ceux qui, comme moi, se réjouissent que l’on ait permis à l’immense majorité des salariés de disposer de plus de temps libre.
Les Français, ceux qui, pour reprendre la formule présidentielle, « se lèvent tôt pour travailler », ceux qui connaissent les conséquences de leur activité professionnelle sur leur état de santé ou sur leur espérance de vie, ne s’y trompent d’ailleurs pas. Ils restent très majoritairement favorables aux 35 heures.
Selon un sondage réalisé par l’institut Harris Interactive pour le compte du journal L’Humanité et publié le 7 janvier dernier, 56 % des personnes intéressées se déclarent opposées à une mesure législative ayant pour effet de retourner aux 39 heures. Et pour cause !
On apprend en effet dans ce sondage très instructif que 55 % des personnes sondées estiment que cela entraînerait une détérioration de leurs conditions de travail. Des conditions qui sont déjà dégradées au point que, dans notre pays, les troubles musculo-squelettiques, les TMS, représentent plus de 70 % des maladies professionnelles reconnues. Selon les données de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, un total de 8, 4 millions de journées de travail est perdu chaque année à cause des TMS, ce qui génère un coût social de 847 millions d’euros par an !
Et c’est sans compter les conséquences financières de l’explosion du mal-être au travail, les fameux troubles psycho-sociaux également dus au travail.
Qu’il s’agisse de conséquences physiques ou psychiques, les cadences de travail accrues, la pression permanente qui pèse sur les salariés, le chantage à la délocalisation ou au licenciement et certaines organisations du travail ou du management pèsent sur la santé des salariés, comme la mission d’information sur le mal-être au travail, créée par la commission des affaires sociales de notre Haute Assemblée, l’a bien démontré.
Toujours selon ce sondage, 63 % des personnes interrogées estiment convenable la durée hebdomadaire de travail des salariés français. Un constat que ne partage pas l’actuel secrétaire général de l’UMP M. Jean-François Copé qui, en visite à Beaune le 8 décembre 2010, déclarait : « Les Français ne travaillent pas assez. Nous ne tiendrons pas le coup si nous ne remettons pas en cause les 35 heures ! »
Ce discours bien connu, parfaitement rodé, au point de faire presque autorité, est celui que porte le patronat. À tel point qu’en janvier dernier Mme Laurence Parisot n’hésitait pas à déclarer : « Ne pas voir que la durée du travail a un effet sur la compétitivité dans notre pays, c’est refuser de voir la réalité en face. » Cette déclaration faisait suite à la remise, la veille, d’un rapport commandé par M. Éric Besson à l’institut économique COE-REXECODE, connu pour sa proximité d’avec le MEDEF, rapport qui expliquait que « La France est moins compétitive que l’Allemagne car le coût du travail y est plus élevé », allant jusqu’à préconiser de supprimer l’horaire légal de travail.
Au demeurant, cette préconisation, les gouvernements de droite ont déjà commencé à la concrétiser, et ce dès 2003, mais j’y reviendrai plus longuement tout à l'heure.
Or cette analyse est, nous le savons aujourd’hui, erronée. Elle reposait à la fois sur une erreur matérielle quant au calcul du coût du travail en France et sur un postulat dogmatique : le travail serait trop cher dans notre pays.
Il faut dire que cette explication a le double « mérite » de justifier la désindustrialisation de notre pays sans avoir à réfléchir sur le rôle toxique des actionnaires sur l’économie et de permettre l’obtention de réductions ou d’atténuations de cotisations sociales qui ne servent, au final, qu’à accroître la rentabilité, au seul bénéfice des actionnaires.
La réalité est tout autre et le président-directeur général de Bosch – entreprise qui possède d’ailleurs un établissement à Vénissieux –l’a confirmé lors de son audition récente par la commission des affaires économiques du Sénat : les salariés outre-Rhin lui coûtent plus cher que les salariés français !
Si vous attaquez à ce point les 35 heures, c’est que vous espérez obtenir en échange des réductions artificielles et non justifiées du coût du travail, afin de servir les seuls intérêts du capital et des actionnaires.
Car, n’en doutons pas, les économies ainsi réalisées n’iront pas à l’amélioration des outils de production ni au renforcement des sommes dédiées à la recherche et au développement. Elles n’iront pas non plus aux salaires puisqu’elles n’auront qu’une finalité : l’accroissement des dividendes versés aux actionnaires, lesquels ont déjà profité, cette année, d’une explosion de leur rémunération.
Par ailleurs, on l’a vu lors du débat sur les retraites, l’idée que les progrès techniques, l’augmentation continue de la productivité et le partage des richesses puissent servir au progrès social vous est insupportable.
Les 35 heures, parce qu’elles ont pour fonction première de réduire le temps consacré au travail, au profit d’activités « non productives », vous insupportent. C’est d’ailleurs pourquoi, méthodiquement, loi après loi, vous n’avez eu de cesse de tenter de réduire la portée de cette avancée sociale.
Initialement limité aux cadres intermédiaires, le forfait annuel en jours, qui constitue un système particulier de rémunération, sans référence horaire et sans durée maximale hebdomadaire de travail, est aujourd’hui progressivement devenu applicable à tous les salariés.
En 2000, nous avions voté contre cette disposition, considérant que, avec la suppression des bornes horaires journalières et hebdomadaires, disparaissaient certaines protections collectives importantes. Pour autant, nous convions bien que le cadre législatif de l’époque devait pouvoir évoluer pour tenir compte de l’autonomie propre à l’activité professionnelle des cadres, tout en leur permettant, à eux aussi, de bénéficier, des effets positifs de la loi sur la réduction du temps de travail.
Force est de constater que, dans bien des cas, les entreprises n’ont pas respecté leurs engagements. Elles ont vu dans cette législation le moyen d’imposer aux cadres, au nom de leur autonomie, des amplitudes journalières de travail très importantes, tout en leur imposant les règles applicables aux salariés non-cadres.
Je pense particulièrement aux horaires collectifs de début de journée et à un cas précis dans la grande distribution de l’ameublement et du bricolage, où un cadre autonome fut licencié pour non-respect des horaires de début de poste, alors même que son appartenance à la catégorie des cadres autonomes, couplée à l’existence d’une convention de forfait annuel en jours, était de nature à lui laisser une certaine latitude quant aux horaires imposés aux salariés non-cadres. La chambre sociale de la Cour de cassation lui a donné raison dans un arrêt rendu le 15 novembre 2006, ce qui n’a toutefois pas empêché son licenciement.
Je pense encore aux difficultés que rencontrent aujourd’hui les salariés, cadres ou non-cadres, pour obtenir de leurs employeurs le paiement dû en cas de dépassement du nombre de jours de travail prévu par la convention.
Monsieur le ministre, vous n’êtes pas sans savoir que la jurisprudence joue actuellement contre les salariés concernés puisque les juges de la Cour de cassation, comblant un vide juridique actuel, appliquent à ces contentieux la même règle que celle qui est relative à la preuve du dépassement des heures supplémentaires, à savoir le partage de la preuve. C’est ce que montre cette affaire dans laquelle un ingénieur commercial export ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année avec son employeur avançait le dépassement de son forfait de 215 jours pour demander le paiement de jours complémentaires. La Cour de cassation, dans son arrêt en date du 23 septembre 2009, a statué en ces termes : « La preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir. » Au final, ce salarié a obtenu gain de cause, mais c’est rarement le cas, ne serait-ce que parce qu’il est plus difficile pour un salarié que pour son employeur de faire la démonstration de son travail effectif.
Si la situation est complexe pour les cadres, qui sont protégés, en quelque sorte, par leur autonomie dans l’exécution de leurs tâches, que dire de la situation des cadres intégrés, voire des salariés dans leur ensemble ? Car la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, dite « loi Fillon 2 », et celle du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, que certains appellent la « loi Bertrand », ont toutes deux eu pour effet d’étendre le forfait annuel en jours à des salariés qui, jusqu’alors, n’étaient pas concernés.
Monsieur le ministre, je ne reviendrai pas sur la manière dont, méprisant les partenaires sociaux, vous avez imposé, dans la loi de 2008, un titre II relatif au temps de travail, non contenu dans l’accord national interprofessionnel que votre projet de loi était censé transposer.
Il n’en demeure pas moins que, pour beaucoup d’observateurs, cette loi est, en quelque sorte, une loi de revanche. En effet, si vous avez pris grand soin de ne pas supprimer directement les 35 heures, vous avez permis, en étendant les forfaits annuels en jours à tous les salariés, qu’il puisse ne plus être fait référence à cette durée légale. Et, pour ce faire, vous n’avez pas hésité à bouleverser la hiérarchie des normes entre la loi, les accords de branche et les accords d’entreprise.
En effet, la loi de 2008 donne, pour les règles régissant l’organisation du travail et la fixation du salaire, la priorité aux accords entre employeurs et salariés. Comme le souligne M. Marc Véricel, professeur de droit privé à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne, « le bouleversement est d’autant plus significatif que le rôle prioritaire est accordé, d’abord, aux accords négociés dans les entreprises et, ensuite seulement, à ceux qui sont conclus au niveau des branches d’activité et que le salarié se voit conférer la possibilité de renoncer lui-même à toutes dispositions protectrices légales ou conventionnelles dans plusieurs cas ».
Autrement dit, la loi de 2008 poursuit le processus de dérégulation de la législation relative au temps de travail.
Monsieur le ministre, depuis plus d’une décennie, votre majorité a totalement débordé la loi instaurant les 35 heures, au point qu’aujourd’hui plus de 10 % des salariés, toutes professions confondues, sont assujettis aux forfaits annuels en jours.
La loi de 2008 présente de très nombreux avantages… Mais pour qui ? Pour les employeurs ! Parce qu’il n’est plus fait référence à une durée hebdomadaire de travail, les employeurs ne sont plus tenus, pour les salariés soumis aux forfaits annuels en jours, au paiement des heures supplémentaires, ce qui leur permet de réaliser de belles économies. Le slogan présidentiel « travailler plus pour gagner plus » est ici profondément contredit puisque les heures de travail excédant la durée journalière légale de huit heures ne déclenchent le droit à aucune majoration de salaire, à aucun paiement d’heures supplémentaires.
Avec cette disposition, l’employeur dispose de la possibilité d’imposer des journées toujours plus longues au salarié, même si cela doit nuire à sa santé, et ce sans avoir à payer les majorations dont il aurait dû s’acquitter si le salarié ne relevait pas du régime du forfait annuel en jours. Le rythme de travail du salarié devient ainsi la seule variable d’ajustement de l’activité de l’entreprise, avec les conséquences sanitaires, sociales et familiales que l’on devine.
Le Comité européen des droits sociaux n’a eu de cesse de dénoncer cette situation : en 2000, alors que ce système ne s’adressait qu’à certaines catégories de cadres, en 2003, alors que votre majorité avait étendu les forfaits annuels en jours à l’ensemble des cadres, ou encore en 2009, après que l’article 19 de votre loi eut étendu ce forfait à tous les salariés « dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ». Cette formulation, des plus floues, prépare sans doute une nouvelle extension !
Or, si le Comité européen des droits sociaux a rappelé son opposition à ce système, c’est qu’il considère que ce dernier viole l’article 2, alinéa 1, et l’article 4, alinéa 2, de la Charte sociale européenne révisée, qui garantit le droit pour les salariés à ne pas travailler au-delà d’une « durée raisonnable », ainsi que le « droit à une rémunération équitable ». Convenez, monsieur le ministre, mes chers collègues, qu’il s’agit là de principes importants, je dirai même fondamentaux.
C’est cette conviction qui nous a conduits à déposer cette proposition de résolution, considérant qu’il appartenait au Gouvernement de tout mettre en œuvre pour que notre législation soit, enfin, conforme à la Charte sociale européenne révisée de 1961, que notre pays a ratifiée le 9 mars 1973.
Les principes contenus dans cette charte qui constituent la protection minimale des salariés européens ne peuvent continuer à être violés par l’un des pays fondateurs de l’Union européenne. Les désirs du MEDEF quant à la réduction du coût du travail ou à l’amoindrissement des protections collectives des salariés, à commencer par les horaires collectifs de prises et de fins de fonctions, ne peuvent avoir pour conséquence de dégrader la santé des salariés.

Or, c’est bien sûr cela que porte le reproche du Comité européen des droits sociaux.
L’application du forfait annuel en jours étendue à tous les salariés entraîne un rythme et une amplitude de travail déraisonnables. En pratique, le nombre maximal de jours travaillés peut aller, compte tenu des limites prévues actuellement dans la loi, jusqu’à 282 jours par an, à raison d’une durée hebdomadaire de travail pouvant atteindre 78 heures ! Voilà ce que le CEDS estime déraisonnable et qui doit changer !
Il faut également que le Gouvernement prenne toutes les mesures qui s’imposent pour faire cesser la violation de l’article 4, alinéa 2, de la Charte quant au droit des salariés à une rémunération équitable, et ce pour deux raisons.
Tout d’abord, parce qu’il s’agit du principe qui, croyait-on, était celui qu’avait édicté par le Président de la République : ceux qui travaillent plus longtemps que les autres doivent percevoir une rémunération complémentaire. Il ne s’agit là, après tout, que de l’application de l’adage selon lequel « tout travail mérite salaire » !
Ensuite, parce que la garantie pour les salariés de percevoir une juste rémunération, fonction de la réalité de la quantité de travail qu’ils accomplissent, participe de la responsabilisation des employeurs, jusqu’alors peu soucieux des amplitudes horaires qu’ils imposent.
En conclusion, j’évoquerai le second élément de cette proposition de résolution, à savoir la nécessaire modification des règles concernant l’astreinte.
Monsieur le ministre, selon une formule souvent employée, l’astreinte est une « zone grise » puisqu’il ne s’agit ni d’un temps de travail ni d’un temps de repos. En effet, l’article L. 3121-1 du code du travail issu de la loi du 13 juin 1998 définit la durée de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». D’une certaine manière, c’est un « ni-ni » : ni repos ni temps de travail, car, même si le salarié n’est pas, au moment considéré, sous l’autorité de l’employeur, il ne peut toutefois pas vaquer librement à ses occupations puisque, par définition, le salarié doit pouvoir être joint et se déplacer suffisamment promptement pour intervenir sur son lieu de travail.
Pour le Comité européen des droits sociaux, cette situation paradoxale n’est pas conforme aux principes édictés dans la Charte sociale européenne révisée au motif que « les périodes d’astreinte pendant lesquelles le salarié n’a pas été amené à intervenir au service de l’employeur, si elles ne constituent pas un temps de travail effectif, ne peuvent néanmoins être, sans limitation, assimilées à un temps de repos au sens de l’article 2 de la Charte, sauf dans le cadre de professions déterminées ou dans des circonstances particulières et selon des mécanismes appropriés ».
Qu’il s’agisse de l’application du forfait annuel en jours ou des astreintes, notre pays viole, depuis des années, les dispositions contenues dans la Charte sociale européenne révisée. Cette situation doit cesser et le Gouvernement doit donc agir pour que notre législation nationale se conforme enfin à cette charte dont chacun aura compris qu’elle est la seule protection des salariés et de nos concitoyens face à une Europe de la dérégulation et de la concurrence libre et non faussée.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG. – Mme Raymonde Le Texier applaudit également.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de résolution vise à intégrer dans notre droit les dispositions contenues dans la Charte sociale européenne révisée, selon les recommandations du Comité européen des droits sociaux, ce dernier ayant pointé que notre législation en matière de forfait en jours et d’astreinte viole les principes de cette charte.
Une fois de plus, l’expression des uns et des autres démontre, si toutefois il pouvait y avoir un doute, que la question du temps de travail est un puissant révélateur des différences de nature entre la droite et la gauche. Là où la droite fait de l’augmentation du temps de travail au moindre coût pour l’entreprise l’alpha et l’oméga de sa politique de l’emploi, la gauche place l’homme au cœur de ses réflexions et s’efforce de penser l’emploi dans toutes ses dimensions : formation initiale et continue, accès des jeunes au marché de l’emploi, réflexion autour des aménagements en termes de carrière et d’ergonomie pour permettre aux seniors de rester dans l’emploi, travail autour de la réindustrialisation…
À gauche, nous pensons surtout que la question du temps de travail ne peut être déconnectée des enjeux sociaux qui l’accompagnent : le travail est structurant, pour l’homme comme pour la société, s’il donne la stabilité pour construire ailleurs. Le temps est une richesse qui nourrit l’épanouissement personnel comme la dimension collective. Il y a un temps pour travailler, mais aussi un temps libéré pendant lequel les parents transmettent aux enfants les valeurs, la confiance et les outils qui leur permettront de s’inscrire dans la société au sein de laquelle la citoyenneté prend sens et les liens humains se nouent.
En réduisant la question de l’emploi au temps de travail, la droite considère implicitement l’homme comme un coût qu’il faut amortir en l’utilisant au maximum. C’est en vertu de cet objectif qu’elle a détourné de son objet le système des forfaits jours mis en place dans la loi relative à la réduction négociée du temps de travail.
Ce système s’adressait à une catégorie de salariés précise, les cadres autonomes, au sens de l’ancien article L. 212-15-3 du code du travail, et permettait, en échange d’une réduction effective du temps de travail, d’organiser la rémunération du salarié sans référence horaire et sans durée maximale hebdomadaire du travail. Il s’agissait de mettre en place un régime de forfait sur l’année, lequel se déclinait soit en heures, soit en un nombre de jours limité par un accord collectif.
Avec les lois du 17 janvier 2003 et du 20 août 2008, le Gouvernement a fait sauter toutes les protections dont l’existence de ce « forfait jours » est assortie. Conçu au départ pour des catégories d’emploi spécifiques, celui-ci a été étendu par la droite quasiment à tous les salariés, la notion de salariés autonomes étant suffisamment floue pour être utilisée selon le bon plaisir de l’employeur.
Au lieu de garantir une réduction du temps de travail, la loi ouvre la possibilité de déroger au nombre maximal de jours travaillés, par le biais d’une convention individuelle. Un salarié peut donc renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Dans une telle organisation, un salarié n’est plus protégé que par la directive européenne 2003/88/CE, laquelle prévoit : une période minimale de repos de 11 heures consécutives, ce qui implique une amplitude journalière maximale de 13 heures ; une durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur quatre mois consécutifs ; une durée quotidienne maximale de travail de nuit de 8 heures sur 24 heures...
Le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe observe que, dans un tel cadre, les salariés peuvent être occupés jusqu’à 78 heures par semaine. Les conventions collectives n’offrent plus de protection suffisante, puisque, par le biais d’une convention individuelle, le salarié peut déroger à la durée de travail annuelle fixée à 218 jours, pour atteindre 282 jours dans certains cas. Notre collègue Guy Fischer l’a signalé tout à l’heure, mais il me semble utile de le rappeler.
Une telle situation est porteuse de dérives tant pour la société que pour le salarié. C’est en effet au prix de sa santé, de son repos, de son équilibre familial qu’il pourra « grappiller quelques sous » à son employeur. La droite au pouvoir s’en lave les mains puisque, selon elle, cela ne dépend que du libre choix du salarié. Mais, lorsque le travail n’est pas rémunéré à sa juste valeur et que la situation est inégalitaire, comme c’est le cas entre un patron et son employé, on n’a pas le choix et l’on est rarement libre de refuser sans dommages collatéraux !
Pis, en échange de ses congés, le salarié n’obtiendra qu’une revalorisation de 10 %, là où la rémunération des heures supplémentaires classiques doit être majorée de 25 % à 50 %, en fonction du nombre d’heures effectuées.
Le fumeux « travailler plus pour gagner plus » s’étale ici en majesté : travailler au-delà du raisonnable profitera surtout à l’employeur, coûtera cher au salarié en termes de qualité de vie et entretiendra le fonctionnement absurde de notre marché de l’emploi, un marché où les 25-54 ans voient leurs conditions de travail se dégrader et leurs droits se réduire comme peau de chagrin pendant que les jeunes et les seniors continuent à être exclus et que le chômage augmente année après année.
Le Comité européen des droits sociaux a relevé une autre injustice : la période d’astreinte n’est pas assimilée à un temps de travail. Selon le Comité, en effet, « l’absence de travail effectif, constatée a posteriori pour une période de temps dont le salarié n’a pas eu la libre disposition, ne constitue pas dès lors un critère suffisant d’assimilation de cette période à une période de repos ».
Assimiler un temps d’astreinte à un temps de repos relève donc de l’abus et constitue une violation du droit à une durée raisonnable du travail prévu dans l’alinéa 1 de l’article 2 de la Charte sociale révisée. Ce temps d’astreinte devrait donc soit donner lieu à une rémunération, forfaitaire ou en nature, soit prendre la forme d’un repos compensateur.
Placée une nouvelle fois en face de sa politique de casse sociale, la droite se sert de l’Europe comme alibi : le Gouvernement n’a fait que retranscrire une directive européenne. Certes, mais, nous l’avons constaté avec d’autres textes, il existe des marges de manœuvre pour la traduction dans le droit national d’une directive européenne. L’interprétation systématique en défaveur des salariés et de leurs protections est un choix du Gouvernement ; la transposition de la directive Services en est une illustration.
La gauche rappelle que l’Europe peut être différente. La Charte sociale révisée est un garde-fou insuffisant, mais qui a le mérite de poser des limites. Pourquoi ne pas mettre autant d’énergie à s’emparer de ces textes plus protecteurs ?
C’est sciemment que le Gouvernement a choisi d’ignorer les principes de cette Charte, son dogmatisme assimilant le respect des salariés à de l’entrave à la libre entreprise, la protection des droits à des freins à la production, le refus de l’exploitation à de la fainéantise déguisée…
Il n’en reste pas moins que les décisions du Comité européen des droits sociaux peuvent être invoquées par tout juge français pour motiver une décision. Le Gouvernement ne souhaitant manifestement pas mettre en conformité la législation nationale avec les principes de cette Charte, syndicats et salariés devront faire appel aux juges pour que les garanties auxquelles ils ont droit, en matière de santé, d’équilibre familial, de sécurité au travail et de juste rémunération, soient prises en compte.
Le Gouvernement, au lieu de remplir son rôle de protection, a mis entre les mains de certains employeurs un « forfait jours » très éloigné des dispositions originelles qui avaient présidé à sa création. Les salariés et les syndicats n’auront donc d’autre choix que de chercher réparation auprès des juges.
Tel qu’il a été transformé par la majorité gouvernementale, ce « forfait jours » nuit gravement aux droits des salariés.
C’est pourquoi le groupe socialiste votera cette proposition de résolution, qui vise à réintégrer dans notre droit des mesures de protection issues de la Charte sociale européenne.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 23 juin dernier, le Comité européen des droits sociaux a rappelé une fois de plus que la loi française concernant le forfait annuel en jours ainsi que le régime des astreintes n’était pas, en plusieurs points, conforme à la Charte sociale européenne révisée que nous avons ratifiée en 1973.
Cette situation n’est pas nouvelle puisque la dernière décision du Comité européen des droits sociaux ne fait que rappeler celle qu’il avait rendue en 2000 à l’occasion de la réclamation n°9/2000 introduite par la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres, la CFE-CGC.
Cette situation a perduré après l’adoption de la loi dite « Fillon 2 » du 17 janvier 2003, qui a étendu le forfait annuel en jours à une nouvelle catégorie de cadres, les cadres dits « intégrés ». Vous saviez pourtant que l’application du forfait annuel en jours n’était pas conforme à l’article 2 de la Charte. Elle n’est pas non plus conforme à son article 4, qui concerne le droit à une rémunération équitable.
Pour ce qui est des astreintes, la situation n’est guère plus glorieuse. En effet, le Comité européen des droits sociaux a, dans sa décision sur leur bien-fondé, remise le 23 juin dernier, considéré qu’il s’agissait d’une violation de l’alinéa 1 de l’article 2 de la Charte. Là encore, mes chers collègues, ce n’est pas nouveau !
En 2003, déjà, la CGT avait engagé une procédure de réclamation contre la France, précisément sur le régime des astreintes. Le Comité européen des droits sociaux avait conclu à une violation par la France de la Charte sociale révisée.
Certes, la loi du 17 janvier 2003 a ajouté que, exception faite de la période d’intervention, l’astreinte est décomptée sur le temps de repos. Mais cela ne suffit pas à empêcher que notre code du travail soit en contradiction avec les principes contenus dans la Charte.
La question que soulève cette proposition de résolution va au-delà du débat sur les 35 heures ou sur le bien-fondé du régime des astreintes. Elle nous conduit à nous interroger sur la place que nous entendons donner au seul traité actuellement en vigueur dans l’Union européenne protégeant les salariés : la Charte sociale européenne révisée.
Néanmoins, c’est une protection bien faible au regard de la logique qui préside à la construction européenne, celle de la libre concurrence entre les États, au détriment des peuples qui les composent. Chacun se souvient de la manière dont vous avez imposé un traité constitutionnel européen, contre l’avis de nos concitoyennes et concitoyens qui l’avaient repoussé, le considérant, à raison, comme trop libéral.
Chacun mesure également aujourd’hui les effets désastreux de cette politique sur les services publics, que vous démantelez un à un, précisément pour satisfaire, dites-vous, les exigences de la Commission européenne et les théoriciens de la loi du marché.
Ce sont d’ailleurs les seuls cas où les principes européens ont une force contraignante. Il n’en est pas de même pour les décisions rendues par le Comité européen des droits sociaux : les États membres, ceux qui ont ratifié la Charte sociale européenne révisée, et qui ont donc accepté de se soumettre au contrôle du CEDS, peuvent continuer, décision après décision, à s’affranchir des règles qu’elle a posées !
Pourtant, lorsqu’il s’agit de transposer une directive européenne, même si celle-ci contient des mesures rétrogrades pour les salariés, Mme Nora Berra le dit elle-même : « Il est de notre devoir de mettre notre droit national en conformité avec les obligations résultant du droit de l’Union européenne. »
Autrement dit, il est impératif que le Parlement soit saisi en urgence, même s’il travaille dans des conditions déplorables et dénoncées comme telles sur toutes les travées de notre assemblée, dès lors qu’il s’agit de transposer la directive Services !
En revanche, le fait que notre pays compte onze ans de retard pour la mise en conformité de notre droit national avec des principes protégeant les salariés et que, durant ces onze ans, notre législation ait évolué dans un sens aggravant l’ignorance de ces principes semble, chers collègues de la majorité, ne vous émouvoir que modérément !
Ne trouvez-vous pas curieux que des sanctions existent pour punir les États membres empêchant la libre concurrence, génératrice de bien des souffrances, alors que, dans le même temps, ces mêmes pays peuvent tranquillement bafouer les droits des salariés censément garantis par la Charte ?
Cela en dit long sur la conception que se font certains de la construction européenne, voyant l’Union comme un espace dédié d’abord et avant tout à l’économie. Pour notre part, nous ne souscrivons pas à cette logique.
On ne saurait laisser demeurer les dispositions contenues dans notre droit interne et qui ignorent la Charte sociale européenne révisée. En effet, elles contribuent indirectement à affaiblir les droits sociaux des salariés, qui, avec le forfait annuel en jours, peuvent être exposés à des durées de travail déraisonnables, dangereuses pour leur état de santé, à les priver de la rémunération des heures supplémentaires qu’ils effectuent et, pour ce qui est des astreintes, à limiter leur liberté concernant leurs déplacements ou leurs activités alors que la loi considère qu’ils ne travaillent pas.
Cette situation, mes chers collègues, est insupportable à double titre : tout d’abord parce que l’on voit bien que les dispositions concernées ont en commun de faire primer les besoins des entreprises et des employeurs sur les droits légitimes des salariés, mais aussi parce qu’elle dure depuis des années sans que vous décidiez jamais de respecter la Charte.
Le fait qu’il n’existe pas aujourd’hui de mécanisme de sanction en cas de non-respect de la Charte ou des décisions du CEDS ne doit pas, ne peut pas justifier que le Gouvernement reste inactif.
Nos concitoyens, qui subissent au quotidien les effets négatifs d’une Europe dont la seule loi est le libéralisme, qui supportent un amoindrissement progressif des droits et des protections sociales ne comprennent pas, et ils ont raison, que la France opère une sélection quant aux mesures européennes qui leur sont applicables en fonction du contenu de celle-ci.
En ratifiant la Charte sociale européenne révisée, notre pays a pris un engagement moral à l’égard d’autres pays, mais surtout vis-à-vis des salariés : celui de leur garantir que les principes, les droits inscrits dans la Charte – aussi insuffisants soient-ils – seraient respectés. C’est cette parole donnée que la présente proposition de résolution entend rappeler au Gouvernement.
C’est pourquoi les sénatrices et sénateurs du groupe CRC-SPG voteront cette proposition de résolution dont notre collègue Annie David a pris l’initiative.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la présente proposition de résolution conteste le bien-fondé de notre législation concernant deux domaines importants du droit du travail : le forfait annuel en jours et le régime des astreintes.
La convention de forfait permet au cadre ou au salarié autonome d’organiser lui-même son temps de travail, celui-ci étant déterminé pour le mois en incluant les heures supplémentaires. La gestion administrative de la paie s’en trouve simplifiée.
L’astreinte, quant à elle, permet à l’employeur de recourir, si besoin, à un salarié qui reste joignable en dehors de son temps de travail effectif.
Pour appuyer sa thèse de non-conformité de notre droit à la Charte sociale européenne, Mme David évoque plusieurs décisions du Comité européen des droits sociaux. Je tiens à rappeler qu’il s’agit de déclarations de principe qui, si elles appellent à la réflexion, n’engagent pas la France.
Dans l’état actuel de notre droit, les deux dispositifs ont en commun d’être assortis de solides garanties afin de protéger le salarié. C’est pourquoi j’estime la présente proposition infondée.
En ce qui concerne le système du forfait en jours, Mme David cite comme contraires à la Charte sociale européenne les différentes lois sur le forfait en jours, y compris la loi l’ayant créé. Je rappelle pourtant que le forfait en jours a été créé par Martine Aubry dans la loi de 2000 généralisant les 35 heures : au départ, c’est donc une idée de la gauche ! §
Les gouvernements de notre majorité ont ensuite apporté de la souplesse et, au contraire de ce qui est allégué, des garanties qui n’existaient pas.
Ainsi, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail prévoit, comme pour tout forfait, que le salarié doit avoir donné son accord, formalisé par un écrit.
Elle organise un entretien annuel individuel entre l’employeur et ses salariés, entretien qui permettra d’assurer un suivi de la charge de travail et de veiller à l’équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle. Le comité d’entreprise sera également consulté chaque année sur la charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait sur l’année.
La loi Aubry 2 avait fixé une limite à la durée annuelle du travail : 218 jours. Si le salarié travaillait plus, il devait récupérer les jours travaillés supplémentaires dans les trois premiers mois de l’année suivante. Mais, dans les faits, c’était loin d’être le cas : le dépassement chaque année pouvait être indéfiniment reporté d’une année sur l’autre, et ce sans majoration de salaire.
La loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat a représenté une première avancée : elle a permis au salarié de bénéficier d’une majoration de 10 % pour les jours travaillés en plus, pour l’année 2009.
La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a étendu cette majoration au-delà de la seule année 2009. Le salarié en bénéficie désormais de manière durable.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un maximum fixé par l’accord collectif qui prévoit le forfait en jours. Ce sont les partenaires sociaux qui sont décideurs. Ce plafond doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés. La limite absolue est donc de 282 jours. Lorsque l’accord ne précise rien, la limite est fixée à 235 jours.
Je précise que la majoration dont bénéficiera le salarié qui travaillera au-delà de 218 jours ne sera pas imposable et ne sera pas soumise à charges sociales salariales.
La loi du 20 août 2008 a introduit de la souplesse, permettant aux employeurs de sortir du carcan des 35 heures et aux salariés qui le souhaitent d’augmenter leur pouvoir d’achat. Contrairement à ce qu’affirme Mme David, elle n’enfreint pas le principe de « durée de travail raisonnable » : les limites ont été clairement posées. Il suffit pour s’en convaincre de se reporter à la décision du Conseil constitutionnel du 7 août 2008, qui n’a pas invalidé les dispositions visées.
En ce qui concerne maintenant le régime des astreintes, Mme David fait valoir que, selon le Comité européen des droits sociaux, l’astreinte ne peut être assimilée à une période de repos et, de plus, ne devrait pas pouvoir avoir lieu le dimanche.
Outre les réserves que je viens de formuler sur la portée des avis du Comité, je tiens à souligner que la mise en place des astreintes s’accompagne de garanties : elles doivent être prévues par des accords collectifs étendus ou des accords d’entreprise ou d’établissement, qui en fixent le mode d’organisation, notamment leur rythme ou le nombre maximal d’astreintes au cours d’une même période... À défaut d’accord collectif, les conditions de mise en place sont fixées par l’employeur, mais il devra consulter et informer le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, ainsi que l’inspecteur du travail.
De plus, l’astreinte étant une sujétion pour le salarié, celui-ci reçoit obligatoirement une contrepartie : elle pourra prendre la forme d’une compensation pécuniaire ou d’un repos.
Un document de suivi doit être remis à chaque salarié en fin de mois, sous peine d’une amende de 750 euros.
Ainsi, que ce soit sur le sujet des forfaits en jours ou sur celui des astreintes, notre droit est particulièrement protecteur des intérêts du salarié. Le groupe UMP votera donc contre la proposition de résolution. Il ne partage pas la vision alarmiste de Mme David et du groupe CRC-SPG, qui retiennent surtout de la souplesse de nos dispositifs une atteinte au sacro-saint principe des 35 heures.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai d’abord eu beaucoup de plaisir à écouter M. Fischer, que je suis heureux de retrouver, car nous avons souvent, lorsque j’exerçais mes précédentes responsabilités, travaillé et échangé sur les questions sociales. J’ai retrouvé, dans sa présentation de la proposition de résolution déposée par Annie David et le groupe CRC-SPG, son souci d’exhaustivité et de précision.
Pour autant, il me permettra de ne pas être d’accord avec lui – ce n’est pas la première fois ! –, y compris sur l’analyse juridique.
Avant d’entrer dans le détail de l’état de notre droit, permettez-moi de formuler trois remarques préliminaires.
La première a trait au rôle du Comité européen des droits sociaux. Je sais à quel point le groupe CRC-SPG est attaché au rôle de chacun et il dénonce souvent les rôles excessifs qui peuvent être impartis à des comités d’experts. Donc, ne nous y trompons pas : le Comité européen des droits sociaux est un comité d’experts et non une juridiction. De fait, ses prises de position ne tiennent pas compte de l’ensemble des dispositions contraignantes de notre ordre juridique – vous l’avez très bien rappelé, madame Kammermann –, notamment des directives de l’Union européenne, auxquelles la France se conforme évidemment.
Ma deuxième remarque porte sur la situation de fait, car c’est finalement ce qui nous importe réellement : quelle est la situation des cadres dans notre pays ? Les cadres français travaillent-ils plus ou moins que leurs voisins européens ? Notre législation est-elle plus ou moins contraignante que celle des autres pays de l’Europe ?
De ce point de vue, l’INSEE nous apporte un éclairage intéressant. Les cadres soumis au « forfait jours » déclarent travailler en moyenne 44 heures et demie par semaine. Autrement dit, toutes les études démontrent que les cadres français ont plutôt bénéficié de la réduction du temps de travail et, surtout, sont dans une situation largement plus favorable que leurs homologues de la plupart des pays européens. Ce n’est pas un argument en soi, mais c’est malgré tout un élément qui mérite d’être versé à nos débats.
Ma troisième remarque sera pour vous inviter à un petit effort de mémoire. Je suis particulièrement heureux de la formuler en présence de M. Mauroy, qui a beaucoup œuvré sur le terrain des lois sociales, selon une approche certes différente de la nôtre.
Ma formation est celle d’un historien. Il n’est pas excessif, me semble-t-il, d’essayer de nous souvenir des décisions qui ont été prises voilà dix ou onze ans. Les « forfaits jours » ne sont pas une invention de la droite : ils ont été instaurés par la loi Aubry 2.
Je veux bien que, tout d’un coup, dix ans après, on les pare de tous les méfaits, mais il faut tout de même avoir un peu de mémoire et de cohérence ! Il y a tout de même de quoi être un peu étonné de vous entendre ainsi critiquer le dispositif des « forfaits jours », que vous avez conçu, proposé et mis en place, et dont les lois de 2003 et de 2008 n’ont, par ailleurs, nullement remis en cause l’esprit.
Je crois qu’il n’était pas inutile de se livrer à ce petit exercice de mémoire collective.
Alors, l’état de notre droit représente-t-il des atteintes au principe de « durée raisonnable du travail », d’une part, et au principe de « droit à une rémunération équitable », d’autre part ?
S’agissant de la « durée raisonnable du travail », il existe – vous l’avez d’ailleurs rappelé les uns et les autres – une obligation de conclure individuellement une convention par écrit pour mettre en place un système de forfait en jours, convention qui s’inscrit elle-même dans le cadre d’un accord collectif. Ces dispositifs sont de nature à être protecteurs.
Il faut également avoir en tête l’obligation de respecter les dispositions relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Je souhaite aussi mentionner la limite en nombre de jours travaillés dans l’année, également fixée par l’accord collectif mettant en place les forfaits.
S’agissant maintenant du « droit à une rémunération équitable », la loi du 20 août 2008 prévoit un entretien individuel annuel portant notamment sur la rémunération. De plus, la rémunération du temps de travail supplémentaire résultant de la renonciation à des jours de repos doit être majorée d’au moins 10 %.
Ainsi, les dispositions issues de cette loi non seulement préservent le système antérieur, mais renforcent l’état de notre droit en la matière.
Monsieur le président Fischer, j’ai trouvé très intéressante votre intervention sur les « temps gris ». La prise en compte de la spécificité de ces temps est précisément au cœur du projet de révision de la directive sur le temps de travail. Elle doit nous permettre de clarifier la situation.
Au total, notre avis n’est donc évidemment pas le même sur le sujet. La réglementation du temps de travail repose sur un système que nous n’avons pas choisi, mais qui n’est attentatoire ni à une « durée raisonnable de travail », ni au « droit à une rémunération équitable ».
Il est d’ailleurs frappant de constater que, le 2 février dernier, le comité des ministres du Conseil de l’Europe a décidé de ne pas adresser de recommandation à la France. Il a également considéré que la Charte sociale européenne ne nous plaçait pas en porte-à-faux par rapport à notre droit interne. Notre législation constitue un équilibre entre souplesse et protection, en donnant toute sa place à la négociation collective.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Personne ne demande plus la parole ?…
Nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution.
Le Sénat,
Vu l’article 34-1 de la Constitution,
Vu les articles 1er à 6 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution,
Vu le chapitre VIII du Règlement du Sénat,
Considérant l’article 11 du Préambule de la Constitution de 1946,
Considérant l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958,
Considérant l’article 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu la Charte sociale européenne de 1961, ratifiée par la France le 9 mars 1973,
Vu le Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives de 1995, ratifié par la France le 7 mai 1999
Vu la Charte sociale européenne révisée de 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999
Souhaite la mise en conformité de la législation nationale relative aux forfaits annuels en jours – mentionnés aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail – et relative au régime des astreintes – défini à l’article L. 3121-5 du code du travail – avec la Charte Sociale Européenne révisée de 1996.

Mes chers collègues, la conférence des présidents ayant décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote, je mets aux voix l’ensemble de la proposition de résolution.
J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Je rappelle que l'avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 178 :
Le Sénat n'a pas adopté.
Mes chers collègues, avant d’aborder le dernier point de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quinze.
(Texte de la commission)

Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à l’urbanisme commercial.
La parole est à M. le président de la commission.

Mes chers collègues, dans la mesure où il nous reste quatre-vingt-deux amendements à examiner et où M. le secrétaire d’État chargé du logement a bien voulu accepter que la discussion soit prolongée de deux heures, je me permets de vous demander d’être aussi concis que possible dans la présentation de vos amendements et d’éviter les explications de vote, afin que nous puissions nous prononcer sur l’ensemble de ce texte avant dix-huit heures.
CHAPITRE IER
Les documents d'aménagement commercial
(Division et intitulé nouveaux)

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen, au sein du chapitre Ier, des amendements déposés à l’article 1er.

Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 53 est présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 75 rectifié est présenté par M. Merceron, Mmes Gourault, Létard et les membres du groupe Union centriste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Remplacer le mot :
peuvent
par le mot :
doivent
La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l’amendement n° 53.

Cet amendement vise à conférer un caractère contraignant à la prise en compte des critères énoncés au III de cet article et servant à définir, dans le cadre de l’élaboration des DAC – documents d’aménagement commercial –, les secteurs susceptibles d’accueillir des équipements commerciaux.
Puisque nous avons cherché, à l’occasion de débats nourris, à fixer des conditions précises, autant que nos travaux servent à quelque chose !
D’un point de vue pratique, ces conditions n’ont rien de révolutionnaire ni même d’insurmontable puisqu’elles reprennent pour partie les critères d’évaluation à partir desquels les commissions départementales d’aménagement commercial devaient se prononcer, ainsi que les conditions pouvant déjà figurer au sein des DAC, sans compter que les conditions énumérées ici sont strictement cohérentes avec les objectifs fixés au DAC et mentionnés à l’alinéa 1 de cet article.
Enfin, pour donner une véritable efficacité à la notion de localisation préférentielle des commerces, il convient de lever l’ambiguïté introduite par l’emploi du verbe « pouvoir », qui n’a pas lieu d’être.
Nous vous proposons ainsi de rendre obligatoires la définition des critères dans le DAC.

La parole est à M. Jean-Claude Merceron, pour présenter l’amendement n° 75 rectifié.

Il semble indispensable que les autorités compétentes en matière d’urbanisme commercial soient libres de déterminer les conditions d’implantation commerciale dans les zones périurbaines.
En fonction des besoins locaux et du niveau d’exigence des maires, lesdites conditions fixées dans le DAC seront plus ou moins sévères. Or, aux termes de la rédaction actuelle, le document d’aménagement commercial peut ne fixer aucune condition : nulle obligation n’est prévue en la matière, pas même une simple réflexion… Pourtant, chacun s’accorde à dire qu’il faut changer !
Cet amendement ne vise pas à rendre plus strictes les conditions d’implantation puisque, je le répète, les autorités compétentes sont libres de fixer leurs prescriptions en fonction des contingences locales.
En revanche, rendre obligatoire, dans le cadre du DAC, la détermination des conditions d’implantation, c’est s’assurer que les élus ne feront pas l’économie d’une réflexion sur la transposition pratique des « orientations » en « prescriptions » et que chacune d’entre elles sera au moins discutée, adaptée aux besoins des populations et appliquée !
Défavorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n° 54, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
notamment par voie ferrée ou fluviale
La parole est à Mme Odette Terrade.

L’article 1er vise à définir la nouvelle architecture de l’urbanisme commercial, qui met fin au système de double autorisation en intégrant l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun.
Ainsi, il est ici préconisé qu’au sein du document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale soit inclus un document d’aménagement commercial qui fixe les orientations en termes d’implantation commerciale au regard d’objectifs liés à l’aménagement de l’espace, au développement de commerces de proximité, ainsi qu’à des facteurs de développement durable tels que la présence de transports ou la consommation économe de l’espace.
À ce stade, nous sommes parfaitement en accord avec une telle évolution des missions des schémas de cohérence territoriale.
Pourtant, il est stipulé ensuite que, au-delà de ces orientations, ce document délimite les centralités urbaines qui relèvent de l’intervention des communes et les autres secteurs où l’implantation de commerces est assujettie au respect de conditions fixées par le DAC, lesquelles peuvent être liées à la localisation préférentielle de commerces. Nous avons déjà eu l’occasion de dire notre soutien à cette évolution.
Ces conditions peuvent également être liées au respect de la diversité des fonctions urbaines, de la définition de normes de qualité paysagère, ainsi qu’à l’organisation de l’accès et du stationnement des véhicules ou de la livraison des marchandises.
Dans ce cadre, et au regard de la catastrophe écologique que représentent souvent ces zones commerciales installées au milieu de terres agricoles, suffisamment éloignées des zones d’habitation pour obliger les consommateurs à utiliser leur voiture, nous considérons que la question de la livraison des marchandises devrait faire l’objet d’un examen spécifique.
Si le camion reste souvent incontournable pour effectuer les derniers kilomètres, nous estimons utile qu’il soit précisé ici que ces commerces doivent s’implanter préférentiellement dans les lieux où la livraison des marchandises peut s’opérer par voie ferrée ou fluviale. Une telle précision nous paraît pertinente au regard des engagements contractés par la France, notamment au travers du Grenelle de l’environnement, et destinés à permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Ma chère collègue, je ne connais pas beaucoup de commerces de détail qui soient desservis par voie ferrée ou fluviale ! Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 76 rectifié bis, présenté par M. Merceron, Mme Gourault, MM. Deneux et Soulage, Mme Férat, M. Jarlier, Mme Morin-Desailly et M. Amoudry, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- la localisation préférentielle des commerces et services dans le tissu urbain existant, notamment par la réhabilitation des friches industrielles ou commerciales et la valorisation des réserves foncières disponibles sur le secteur concerné.
La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

Aujourd'hui, il est souvent moins onéreux de construire une « boîte à chaussures » sur un terrain périurbain encore vierge que de réhabiliter une friche.
Or il semble indispensable et de bon sens, à l'heure où la limitation de la consommation des espaces agricoles et de l'étalement urbain constitue un objectif légal, de favoriser la valorisation du foncier existant.

Les SCOT et les DAC prévoient d’ores et déjà de telles obligations. La commission est donc défavorable à cet amendement.
Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement y est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 82 rectifié, présenté par M. Merceron, Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le document d'aménagement commercial est irrégulier dès lors que les prescriptions des quatre alinéas précédents n'y sont pas précisées, ou qu'elles ne permettent manifestement pas de répondre aux exigences mentionnées au premier alinéa.
La parole est à M. Jean-Claude Merceron.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 122, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
d’une même zone
par les mots :
d’un même secteur
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 123, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au sein d’un secteur délimité en application du 2° du II, le document d'aménagement commercial peut fixer un plafond global de surface hors œuvre nette pour chacune des catégories de commerces identifiée au IV.
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement vise à éviter la concentration dans un secteur périphérique des commerces indispensables à la vitalité des centralités urbaines.
Il s’agit de fixer un plafond global de surface hors œuvre nette pour chacune des catégories que nous avons évoquées ce matin.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Nous l’avons toujours dit, sur ce texte, nous raisonnons par plancher ; je pense notamment à celui des 1 000 mètres carrés. Or il s’agit ici d’instaurer un plafond.

Nous voterons cet amendement, car il permettra d’améliorer la situation.
Notons que, dans certains SCOT, ce type de prescriptions existe d’ores et déjà. C’est une bonne pratique qui mérite d’être encouragée par la loi.
Vous le voyez, monsieur le rapporteur, nous accueillons avec bienveillance certains de vos amendements. Puissiez-vous parfois agir de même avec les nôtres !
Sourires
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 129, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les commerces non spécialisés à prédominance alimentaire sont considérés comme des commerces alimentaires.
La parole est à M. le rapporteur.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement puisqu’il est défavorable au principe de la typologie en la matière.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 84 rectifié, présenté par M. Merceron, Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le document d’aménagement commercial est évalué au moins tous les six ans, et si nécessaire, révisé. Le cas échéant, les modalités simplifiées de cette révision sont définies par décret en Conseil d’État.
La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

Il semble important de prévoir une révision régulière des DAC, afin de s'assurer de leur adéquation à l'évolution très rapide des modes de consommation et de leur pertinence.
Il suffit de voir le succès des Carrefour Market et le boom des achats par Internet livrés directement au consommateur pour se convaincre que la loi doit inciter les élus à évaluer régulièrement leur DAC.

Cet amendement est satisfait par l’article L. 122-14 du code de l’urbanisme. Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir le retirer.
Effectivement, la disposition existe d’ores et déjà. Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 84 rectifié est retiré.
L'amendement n° 12, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le document d'aménagement commercial est révisé tous les six ans. Les modalités simplifiées de cette révision sont définies par décret en Conseil d'État.
La parole est à M. François Patriat.

Par cet amendement, il est proposé d'apporter la souplesse nécessaire pour s'adapter aux évolutions du commerce.
Imposer une révision du DAC tous les six ans permettra aux élus de garder la main sur l'urbanisme commercial. Il semble en outre nécessaire de réviser régulièrement ce document.

S’il est naturellement indispensable d’évaluer un document tous les six ans, on ne peut en imposer la révision ! Dans certains cas, en effet, celle-ci se révélerait parfaitement inutile.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1 er est adopté.

L'amendement n° 18, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, après les mots : « des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, » sont insérés les mots : « les opérations d'aménagement commercial qui conduisent à la création d'un ensemble d'une surface de plus de 500 mètres carrés, ».
La parole est à M. François Patriat.

Aujourd'hui, conformément aux articles L. 122-1-15 et R. 122-5 du code de l'urbanisme, les opérations dont le SHON est supérieur à 5 000 mètres carrés doivent être directement compatibles avec le SCOT.
Il est proposé d'abaisser ce seuil à 500 mètres carrés pour ce qui concerne les opérations commerciales.
Une telle disposition est conforme à la logique que nous soutenons depuis hier soir et selon laquelle il convient, d’une part, de sécuriser le DAC, d’autre part, de rendre opposables toutes les décisions d’aménagement commercial de plus de 500 mètres carrés.

Je ne reviendrai pas sur notre discussion concernant les effets de seuil. Quoi qu’il en soit, le seuil proposé ici est manifestement beaucoup trop bas.
Mon cher collègue, le SCOT n’a pas vocation à se substituer au PLU en devenant directement applicable pour les opérations d’aménagement de cette taille.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Le plan local d’urbanisme d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale, comprend les dispositions prévues aux I à IV de l’article 1er dans ses orientations d’aménagement et de programmation et dans son règlement.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Collomb et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le plan local d’urbanisme comprend les dispositions prévues aux I à IV de l’article 1er dans ses orientations d’aménagement et de programmation et dans son règlement. Il délimite les centralités urbaines et les secteurs définis aux 1° et 2° du II.
Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement du plan local d’urbanisme d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le territoire est couvert par un schéma de cohérence territoriale, doivent être compatibles avec le document d’aménagement commercial conformément à l’article L. 123–1–9 du code de l’urbanisme.
La parole est à M. François Patriat.

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi impose l’obligation d’intégrer les dispositions prévues aux I à IV de l’article 1er uniquement lorsque ces PLU ne sont pas couverts par un SCOT.
Le présent amendement, déposé par notre collègue Gérard Collomb, vise à généraliser cette obligation pour l’ensemble des PLU, qu’ils soient couverts ou non par un SCOT.
S’ils sont couverts par un SCOT, l’amendement prévoit que les orientations d’aménagement et de programmation, ainsi que le règlement du PLU, doivent être compatibles avec le SCOT, notamment avec le document d’aménagement commercial.
Enfin, si le document d’aménagement commercial du SCOT détermine les orientations relatives aux objectifs du premier alinéa de l’article 1er de la proposition de loi et localise, en conséquence, les centralités urbaines et les secteurs définis aux 1° et 2° du paragraphe II de l’article 1er, il appartient au PLU d’affiner ces localisations par une délimitation précise au sein de son règlement et de ses orientations d’aménagement et de programmation.

L'amendement n° 56, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
I. - Supprimer les mots :
, dont le territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale,
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement du plan local d'urbanisme d'un établissement public de coopération intercommunale compétent, dont le territoire est couvert par un schéma de cohérence territoriale, doivent être compatibles avec le document d'aménagement commercial conformément à l'article L. 123–1–9 du code de l'urbanisme.
La parole est à Mme Odette Terrade.

Pour notre part, nous ne sommes pas hostiles au principe posé par cet article d’intégration dans les PLU communautaires d’un volet « aménagement commercial », qui serait prescriptif.
Cependant, nous ne voyons pas pourquoi cette obligation serait limitée aux règlements des PLU intercommunaux dont le territoire ne serait pas couvert par un schéma de cohérence territoriale.
En effet, la volonté d’intégrer l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun indique que tous les documents d’urbanisme sont habilités à comporter des dispositions relatives à l’urbanisme commercial.
Le présent amendement vise ainsi à généraliser l’obligation pour l’ensemble des PLU communautaires d’intégrer une prescription en matière d’urbanisme commercial telle qu’elle est prévue par l’article 1er de la présente proposition de loi, et ce qu’ils soient couverts ou non par un schéma de cohérence territoriale.

L'amendement n° 106, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Remplacer la référence :
IV
par la référence :
III
La parole est à M. le secrétaire d'État.

L'amendement n° 106 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 39 rectifié et 56 ?

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi dispose que c’est par exception, en l’absence de SCOT, qu’un PLU peut faire office de DAC. Il n’est pas envisageable de prévoir deux DAC, à deux échelles différentes, le premier au niveau du SCOT et le second au niveau du PLU. L’objectif est bien de faire en sorte que le DAC soit élaboré au niveau du SCOT, le PLU devant être compatible avec les dispositions du SCOT.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
Dans le droit positif actuel, le PLU doit obligatoirement être mis en conformité avec le SCOT.
Aussi le Gouvernement émet-il également un avis défavorable sur ces amendements, afin d’éviter toute redondance.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1 er bis A est adopté.
I. – Un établissement public de coopération intercommunale qui n’est pas compétent pour élaborer un plan local d’urbanisme et dont le territoire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale peut élaborer, dans le respect des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, un document d’aménagement commercial communautaire qui couvre l’intégralité de son territoire et comprend les dispositions prévues aux paragraphes I à IV de l’article 1er de la présente loi. Ce document est élaboré conformément aux dispositions figurant aux articles L. 123-6 à L. 123-12 du code de l’urbanisme. Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent être rendus compatibles avec le document d'aménagement commercial communautaire dans un délai de trois ans.
II. – Les procédures de révision, révision simplifiée, modification et modification simplifiée mentionnées à l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, ainsi que la mise en compatibilité prévue à l’article L. 123-14 du même code, s’appliquent au document d’aménagement commercial communautaire.
III. – Au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la délibération portant approbation du document d’aménagement commercial communautaire, de la dernière délibération portant révision complète de ce document ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent paragraphe, l'établissement public de coopération intercommunale débat des résultats de son application et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public. À défaut d'une telle délibération, le document d’aménagement commercial communautaire est caduc.
IV. – Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale comprenant un document d’aménagement commercial ou un plan local d'urbanisme intercommunal comprenant les dispositions prévues à l’article 1er bis A de la présente loi est approuvé ultérieurement, la décision qui approuve ce schéma ou ce plan abroge le document d'aménagement commercial communautaire.

L'amendement n° 58, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1, première phrase
Supprimer les mots :
et dont le territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale
II. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. - Lorsqu'un plan local d'urbanisme intercommunal comprenant les dispositions prévues à l'article 1er bis A de la présente loi est approuvé ultérieurement, la décision qui approuve ce plan abroge le document d'aménagement commercial communautaire.
La parole est à Mme Odette Terrade.

Nous ne souhaitons pas que l’adoption d’un SCOT entraîne mécaniquement l’abrogation du DAC communautaire.
En effet, nous estimons que le DAC communautaire et le SCOT ne doivent pas être exclusifs l’un de l’autre, mais que ces deux documents d’urbanisme de niveau différent doivent se compléter au titre du principe de subsidiarité.
Cela suppose notamment, comme nous l’avons défendu précédemment, que le rôle du DAC d’un SCOT soit revu, afin que celui-ci ne soit pas prescriptif à la parcelle près, mais qu’il se contente de localiser les différents espaces qui pourront accueillir des équipements commerciaux.
Par ailleurs, la procédure de révision triennale de ce DAC communautaire est suffisante ; s’il n’est pas révisé tous les trois ans, il devient caduc.
Si l’adoption d’un SCOT se traduisait par l’obsolescence du DAC communautaire – ce qui n’est absolument pas dit –, il suffirait alors de laisser s’éteindre le DAC communautaire au terme de ces trois années.
Si nous insistons pour que le DAC communautaire soit réalisé dans de bonnes conditions, avec l’adhésion de l’ensemble des maires des communes membres de l’EPCI, nous estimons aussi qu’il convient de ne pas toujours s’imposer des contraintes juridiques excessives : un DAC communautaire peut parfaitement être un outil utile qu’il pourrait être dommage d’abroger simplement parce qu’un SCOT aurait été élaboré à un niveau supérieur.

Cet amendement s’inscrivant dans le droit-fil de l’amendement n° 56, qui a été repoussé, la commission y est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 57, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Après les mots :
code de l'urbanisme
insérer les mots :
et après accord des conseils municipaux des communes concernées
La parole est à Mme Odette Terrade.

Le présent article prévoit que, en l’absence de SCOT et de PLU intercommunal, tout établissement public de coopération intercommunale peut élaborer un document d’aménagement commercial communautaire, document comportant des dispositions analogues à celles qui figurent dans le DAC d’un SCOT tel qu’il est mentionné à l’article 1er de la présente proposition de loi.
Ainsi, ce document d’aménagement communautaire aurait pour objet, comme le DAC d’un SCOT, de délimiter, comme nous l’avons vu, de manière extrêmement précise, voire à la parcelle près, les secteurs où peuvent se créer des zones d’implantation commerciale et les secteurs où cela est impossible, y compris en subordonnant cette possibilité à l’exigence du respect d’un certain nombre de critères.
Ainsi, nous estimons que, si des communes membres d’un EPCI n’ont pas fait le choix de déléguer à cet établissement la réalisation d’un PLU intercommunal, ce n’est pas pour que l’EPCI puisse, sans les consulter, réaliser une sorte de PLU intercommunal commercial.
Comprenons-nous bien : nous ne sommes pas opposés, par principe, aux DAC intercommunaux ; au contraire, nous y sommes plutôt favorables, mais à la seule condition que les communes, par le biais d’une délibération au sein des différents conseils municipaux concernés, aient donné leur accord pour la réalisation de ce DAC.

Les auteurs de l’amendement proposent que chacune des communes membres de l’EPCI, fussent-elles deux cents, dispose d’un droit de veto sur l’élaboration du DAC communautaire. La commission ne peut accepter qu’une seule commune puisse mettre à mal ce projet.
Bien évidemment, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 105, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Remplacer la référence :
IV
par la référence :
III
La parole est à M. le secrétaire d'État.

L'amendement n° 105 est retiré.
L'amendement n° 16, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme peuvent élaborer un schéma d'aménagement commercial pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale.
La parole est à M. François Patriat.

Dans un souci de mutualisation des moyens, notamment en milieu rural, il est proposé d'offrir la possibilité aux EPCI qui le souhaiteraient de transférer leur compétence en matière de réalisation du schéma d’aménagement commercial au syndicat mixte du SCOT.
En ces temps de réduction des dépenses des collectivités locales prônée à grand renfort pour respecter la révision générale des politiques publiques, il importe que les intercommunalités mutualisent leurs moyens.

Je comprends le souci de mutualisation des moyens exprimé par les auteurs de cet amendement, mais l’élaboration d’un schéma d’aménagement commercial ne peut être déléguée. J’ajoute que la mutualisation des moyens est d’ores et déjà possible, sans qu’il soit besoin d’adopter cette disposition, plus contraignante qu’il n’y paraît.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1 er bis B est adopté.
Dans la région d'Île-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse, lorsqu'une commune n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale ou, si elle est membre d'un tel établissement, lorsque le territoire de ce dernier n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme intercommunal ou par un document d'aménagement commercial communautaire, les dispositions mentionnées aux I à IV de l'article 1er peuvent être intégrées au plan local d'urbanisme communal.

L'amendement n° 104, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Remplacer la référence :
IV
par la référence :
III
La parole est à M. le secrétaire d'État.

L'amendement n° 104 est retiré.
L'amendement n° 79 rectifié bis, présenté par M. Merceron, Mme Gourault, M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
peuvent être
par le mot :
sont
La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

La présente proposition de loi visant à améliorer sensiblement l'urbanisme commercial, il semble opportun de rendre obligatoire, pour les collectivités concernées par le présent article, le respect des dispositions prévues aux paragraphes I à IV de l'article 1er.

Mon cher collègue, le niveau communal n’est pas systématiquement le niveau le plus cohérent pour l’élaboration d’un DAC, contrairement au SCOT. Élaborer un DAC au niveau communal irait totalement à l’encontre de la philosophie que nous défendons.
L'article 1 er bis C est adopté.
Au cours de l'élaboration du document d'aménagement commercial mentionné à l'article 1er, du plan local d'urbanisme comportant les dispositions prévues aux articles 1er bis A ou 1er bis C ou du document d'aménagement commercial communautaire prévu par l'article 1er bis B, le président de l'établissement public en charge de l'élaboration de ce document recueille l'avis de tout organisme compétent en matière de commerce qui en fait la demande. –
Adopté.

J’indique que l’article 2 a été réservé jusqu’après l’examen de l’article 5.
Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, élaborés par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvés avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être complétés, dans un délai de trois ans à compter de cette date, pour comprendre les dispositions prévues par les articles 1er et 1er bis A.
Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent est en cours d'élaboration ou de révision, l'approbation de ce schéma ou de ce plan reste soumise au régime antérieur à la loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 110, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, élaborés par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvés avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être complétés pour comprendre les dispositions prévues respectivement par les I à III de l'article 1er et le 1er bis A au plus tard le 1er janvier 2016.
II. – Alinéa 2, première phrase :
Après les mots :
ou de révision
insérer les mots :
et que le projet de schéma ou de plan a été arrêté dans un délai de six mois avant la publication de la présente loi
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Cet amendement vise à fixer au 1er janvier 2016 la date butoir au-delà de laquelle les SCOT et les PLU élaborés par un EPCI compétent devront être complétés pour comprendre les dispositions prévues dans ce texte.

L'amendement n° 124, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Les plans locaux d’urbanisme élaborés par un établissement public de coopération intercommunale compétent et les schémas de cohérence territoriale approuvés…
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement vise à aligner les délais pour l’intégration des DAC dans les SCOT et les PLU intercommunaux sur celui qui a été fixé par la loi Grenelle 2, ce qui paraît souhaitable.
La commission émettra un avis favorable sur cet amendement, sous réserve que le Gouvernement accepte de le rectifier en remplaçant, dans le I, les mots « respectivement par les I à III de l’article 1er et le 1er bis A » par les mots : « par les articles 1er et 1er bis A ».

Monsieur le secrétaire d'État, acceptez-vous de rectifier l’amendement du Gouvernement dans le sens souhaité par la commission ?

Je suis donc saisie d’un amendement n° 110 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, élaborés par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvés avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être complétés pour comprendre les dispositions prévues par les articles 1er et 1er bis A au plus tard le 1er janvier 2016.
II. – Alinéa 2, première phrase :
Après les mots :
ou de révision
insérer les mots :
et que le projet de schéma ou de plan a été arrêté dans un délai de six mois avant la publication de la présente loi
La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Ce matin, nous avons longuement discuté de l’un de nos amendements visant à accorder un délai supplémentaire pour l’entrée en vigueur d’une disposition. Il nous a été répondu qu’il n’était pas possible de nous donner satisfaction. Aussi, j’estime qu’il est incohérent de fixer, dans le cas présent, ce délai relativement important. J’observe que M. le rapporteur n’est pas constant dans ses analyses !
Exclamations sur les travées de l ’ UMP.
Je souhaite apporter un élément d’information complémentaire.
Sur l’initiative du président de la commission de l’économie, la loi Grenelle 2 a fixé des délais pour l’élaboration des SCOT.
Par cet amendement, nous souhaitons tout simplement, par cohérence avec ces délais, fixer au 1er janvier 2016 la date butoir pour l’intégration des DAC par les SCOT et les PLU intercommunaux.
L'amendement est adopté.
L'article 2 bis est adopté.

L'amendement n° 45, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :
Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour le cas où plusieurs documents d’aménagement commercial ont été élaborés par des établissements publics de coopération intercommunale, l’approbation du schéma de cohérence territoriale n'est possible qu’après harmonisation de ces documents d’aménagement commercial dans un seul document qui devra couvrir, au moins, l’ensemble du territoire défini pour le schéma de cohérence territoriale conformément au I de l’article 1er.
Plusieurs établissements publics de coopération intercommunale chargés des schémas de cohérence territoriale peuvent élaborer en commun un document d’aménagement commercial portant sur l’ensemble des territoires ainsi définis. Ils doivent justifier des interactions entre ces territoires.
La parole est à M. Gérard Cornu.

Certains SCOT couvriront sans doute un territoire trop petit pour pouvoir prendre en considération le commerce lié soit au bassin de vie, soit aux effets de ville-centre.
Cet amendement vise donc notamment à offrir la possibilité à plusieurs EPCI chargés de l’élaboration d’un SCOT de choisir la référence à un seul DAC, afin de mieux organiser les transitions à venir.

Mon cher collègue, votre amendement est satisfait à la fois par le droit en vigueur et par la rédaction actuelle de la proposition de loi. Aussi, je vous saurais gré de bien vouloir le retirer.
J’apporterai une précision complémentaire à l’argumentation de M. le rapporteur.
En fait, la première partie de l’amendement est effectivement satisfaite.
Quant à la seconde partie, elle nous paraît très complexe à mettre en œuvre, notamment en matière de modification d’un SCOT. En effet, si un DAC est élaboré sur plusieurs SCOT, la révision d’un seul d’entre eux entraînera des complications multiples dans la mesure où tous les SCOT devront être alors révisés, ce qui, vous l’imaginez bien, monsieur le sénateur, sera particulièrement complexe.
I. – Dans le délai de deux mois à compter de la transmission au préfet de la délibération approuvant un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme intercommunal ou un document d’aménagement commercial communautaire, celui-ci peut notifier, par lettre motivée, au président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au document lorsque les dispositions de celui-ci portent une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ou sont incompatibles avec les objectifs des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme ou des documents d’aménagement commercial voisins. Dans ce cas, le document ne devient exécutoire qu’après publication et transmission au préfet de la délibération apportant les modifications demandées.
II. – Au premier alinéa de l’article L. 122-5-1 du code de l’urbanisme tel qu’il résulte de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, après les mots : « de développement rural, », sont insérés les mots : « d’équipement commercial et de localisation préférentielle des commerces, ».

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 61, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Supprimer les mots :
portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ou
La parole est à Mme Odette Terrade.

À l’image de ce qui se pratique pour les PLU et les SCOT, le présent article soumet les DAC, y compris les DAC communautaires, au contrôle préfectoral avant leur entrée en vigueur.
L’article L. 122–11 du code de l’urbanisme énumère précisément les principes dont le non-respect autorise le préfet à bloquer l’entrée en vigueur d’un PLU ou d’un SCOT ou à en exiger des modifications.
C’est le cas notamment lorsque les dispositions d’un SCOT sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
L’article 3 de la proposition de loi étend la liste des motifs susceptibles de justifier le refus du préfet d’autoriser l’entrée en vigueur d’un SCOT ou d’un PLU. Le préfet devra ainsi veiller à ce que les DAC ou les documents en tenant lieu ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
Nous estimons, pour notre part, qu’une telle spécification constitue une source majeure d’insécurité juridique pour les DAC.
Ainsi, par principe, et notamment au regard des dispositions introduites par M. le rapporteur, relatives à la notion de typologie des commerces pouvant intégrer les conditions permettant ou non l'installation d'une implantation commerciale, un DAC constituera nécessairement une atteinte caractérisée à la liberté d'entreprendre.
Cela laisse donc une marge d'appréciation au préfet que nous estimons bien trop importante, car elle lui permet, au final, d'exercer un contrôle non pas de légalité sur les DAC, mais bien d'opportunité. Au titre d'une telle mesure, ce sont bien l'ensemble des DAC qui pourraient être bloqués par les préfets.
Nous considérons donc que les motifs actuels permettant aux préfets de s'opposer à l'entrée en vigueur d'un SCOT, d'un PLU ou d'un DAC communautaire sont largement suffisants.
Pour cette raison, nous vous proposons, mes chers collègues, de limiter aux dispositions actuelles le contrôle du préfet et, par conséquent, de renoncer à un contrôle ex ante du préfet sur les documents d'urbanisme visés fondé sur une « atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ».

L'amendement n° 71 rectifié bis, présenté par MM. Cornu, Reichardt et Pointereau, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Remplacer les mots :
portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ou
par les mots :
, au vu de l'avis émis par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat du territoire concerné,
La parole est à M. Gérard Cornu.

Les chambres consulaires, notamment les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat, ont une qualité d’expertise reconnue. Elles me semblent donc les mieux à même de donner un avis sur le caractère disproportionné ou non d’une atteinte à la liberté d’entreprendre.
Tel est l’objet de cet amendement.

Comme je l’ai déjà souligné au cours de la discussion, il est difficile, en matière d’urbanisme commercial – et nous rencontrons, avec cette proposition de loi, la même difficulté – de trouver un juste équilibre entre la concurrence et l’aménagement du territoire. Or, même si ces deux éléments semblent manifestement inconciliables, ils sont pourtant compatibles. Le préfet doit donc pouvoir porter une appréciation sur ces deux exigences.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 61.
Quant à l’amendement n° 71 rectifié bis, il est satisfait par le droit actuel. En effet, le préfet peut s’appuyer sur les avis des chambres consulaires pour rendre son avis. Aussi demanderai-je à notre collègue Gérard Cornu de bien vouloir le retirer.

L’amendement n°71 rectifié bis est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 61 ?
Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 3 est adopté.

CHAPITRE II
Les autorisations d'implantation commerciale
(Division et intitulé nouveaux)
Pour l'application des conditions mentionnées au II de l'article 1er, les seuils de surface hors œuvre nette mentionnés aux II et III du même article et au I de l'article 5 s'appliquent aux demandes de permis de construire ayant pour objet :
1° La création d’un commerce ou d’un ensemble commercial continu ou discontinu résultant soit d’une construction nouvelle, soit du changement de destination d’un immeuble existant ;
2° L'extension d'un commerce ou d'un ensemble commercial continu ou discontinu ayant déjà atteint ce seuil déterminé ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
3° En fonction de la typologie définie au IV de l’article 1er, le changement de secteur d’activité commerciale, d’un commerce ou d’un ensemble commercial continu ou discontinu ayant déjà atteint ce seuil déterminé.

Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 125, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les conditions fixées par le document d’aménagement commercial en application du 2° du I de l’article 1er s’appliquent aux permis de construire ou d’aménager et aux déclarations préalables ayant pour objet :
1° La création d'un commerce ou d'un ensemble commercial continu ou discontinu résultant soit d'une construction nouvelle, soit du changement de destination d'un immeuble existant, lorsque la surface hors œuvre nette de cette construction ou de cet immeuble excède le seuil de surface défini par le document d'aménagement commercial ou conduit au dépassement du plafond de surface mentionné au III de l’article 1er ;
2° L'extension d'un commerce ou d'un ensemble commercial continu ou discontinu lorsque ce commerce ou cet ensemble commercial a déjà atteint ce seuil déterminé, doit le dépasser par la réalisation du projet ou conduit au dépassement du plafond de surface mentionné au III de l’article 1er ;
3° Le changement de secteur d'activité commerciale d'un commerce ayant déjà atteint ce seuil déterminé ou conduisant au dépassement du plafond de surface mentionné au III de l’article 1er.
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement précise la manière dont s’appliquent les conditions fixées par le DAC dans les secteurs périphériques en matière de développement commercial.
Il permet de prendre en compte non seulement les différents types d’autorisations d’urbanisme que nous avons déjà évoqués ce matin, qu’il s’agisse d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une déclaration préalable, mais aussi les plafonds de surface par catégorie de commerces que nous avons fixés.

L'amendement n° 80 rectifié bis, présenté par M. Merceron, Mme Gourault, MM. Deneux et Soulage, Mmes Férat et Morin-Desailly et M. Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
aux II et III
par les mots:
au II
La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

L'amendement n° 117, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer les mots :
et au I de l’article 5.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Il s’agit d’un amendement de coordination avec les dispositions qui ont été adoptées à l’article 5.

L'amendement n° 114, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le secrétaire d'État.

L'amendement n° 114 est retiré.
L'amendement n° 97 rectifié, présenté par M. P. Dominati et Mme G. Gautier, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer les mots :
En fonction de la typologie définie au IV de l’article 1er,
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 117 ?

La commission est défavorable à l’amendement n° 117, qui est un amendement de cohérence avec la nouvelle rédaction de l’article 5.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. L’amendement n° 125 est intéressant. Nous avions d’ailleurs tenté de passer un deal sur cet amendement relatif au droit de suite des implantations commerciales. Dès lors que nous n’avons pas eu la typologie, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée. Pour nous, c’était l’un ou l’autre, mais là ce sera sans doute fromage et dessert pour la commission !
Sourires

La parole est à M. François Patriat, pour explication de vote sur l’amendement n° 125.

L’amendement n° 125 est important dans la mesure où il concerne le changement de secteur d’activité commerciale prévu au 3° de l’article 4 A.
Dans la rédaction actuelle, vous n’avez pas prévu de dispositif permettant de contrôler les changements de destination, ce qui pose problème. Or, les promoteurs immobiliers des biens commerciaux n’étant pas, la plupart du temps, les usagers des locaux, il faut, vous le savez comme moi, monsieur le rapporteur, revoir toutes les dispositions législatives relatives aux baux commerciaux et aux conditions de cession. Telle est la lacune essentielle de ce texte. En effet, vous ne faites rien pour faire évoluer les structures fondamentales du secteur.
Certes, vous avez proposé, bien tardivement, il faut l’avouer, un amendement tendant à soumettre les changements de destination à une déclaration préalable. Toutefois, la référence que vous avez introduite renvoie à un décret ; nous reviendrons ultérieurement sur cette discussion lors de l’examen de l’amendement n° 126.
Dès lors, nous ne pouvons être satisfaits de votre proposition à moins, évidemment, que vous ne soyez en mesure de nous fournir des précisions sur le décret visé.
C’est pourquoi nous nous abstiendrons sur cet amendement.
L'amendement est adopté.

En conséquence, l'article 4 A est ainsi rédigé, et l'amendement n° 117 n'a plus d'objet.

L'amendement n° 17, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 4 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les demandes de permis de construire déposées pour les implantations commerciales visées au 2° du II de l'article 1er de la présente loi sont envoyées à l'établissement public visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme qui rend un avis sur la demande dans un délai d'un mois.
Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. En cas d'avis défavorable, la demande est soumise à la commission régionale d'aménagement commercial qui statue dans un délai de deux mois dans la formation prévue à l'article 5 de la présente loi. Son avis s'impose au maire chargé de délivrer le permis de construire.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment pour ce qui concerne les pièces supplémentaires à joindre au dossier de demande de permis de construire dans les cas visés au I de l'article 5 de la présente loi.
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

Cet amendement prévoit de soumettre les demandes de permis de construire et d’aménagement à une instruction sécurisée, qui permet ainsi au président de l’établissement chargé du SCOT d’exercer un véritable contrôle de l’application des directives contenues dans le DAC.
En outre, en cas de conflit entre une commune et l’EPCI chargé du SCOT, il reviendra à la commission régionale d’arbitrer le différend.
Nous estimons qu’il est risqué de confier aux seuls maires la responsabilité de décider, par le biais d’une autorisation d’urbanisme exclusivement, de la validité d’une implantation commerciale.
C’est pourquoi un dispositif de double instruction, que nous demandons depuis le début de la discussion, permettrait de doter cette autorisation d’une légitimité renforcée, puisque, dans le cadre du SCOT, le DAC prévoit des règles destinées à préserver l’équilibre commercial sur le territoire.
En outre, il était devenu courant de voir des dossiers de demande de permis de construire et d’implantation être acceptés par les instances collégiales de décision, ce qui a donné lieu à la construction et à l’aménagement de projets très éloignés de ceux qui étaient présentés dans les dossiers sur lesquels les élus s’étaient prononcés ; nombre d’entre vous ont certainement connu cette situation. La procédure devenait donc tout à fait inutile dans la mesure où il était impossible de revenir sur la décision, une fois le permis délivré et l’équipement construit.
Pour tenter de limiter ces abus, nous proposons qu’un décret en Conseil d’État précise la nature des pièces nécessairement jointes au dossier de demande de permis de construire, afin d’éviter la multiplication des opérations immobilières de promoteurs, qui ne reposent sur aucune demande réelle d’implantation.
Enfin, vous le savez, malgré le régime de compatibilité existant entre le PLU et le SCOT, il arrive que les documents soient contradictoires sur certains territoires pour des raisons qui tiennent à la date à laquelle ils ont été révisés. C’est pourquoi il nous semble nécessaire de sécuriser les dispositions du DAC en sollicitant l’avis du président du SCOT.

Cette procédure nous paraît excessivement lourde, voire, je le dis, totalement inutile.
C’est la première fois, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels, que l’on demande une double instruction : tous les permis de construire devraient être visés par l’établissement chargé de l’élaboration du SCOT. Cela implique d’ailleurs de doter cet établissement des moyens nécessaires en personnels et en ingénierie ! Le maire est capable de traiter cette question, d’autant que, ne l’oublions pas, le PLU doit être mis en compatibilité avec le SCOT.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Une double instruction du permis de construire me paraît légèrement contradictoire avec l’ambition de simplification de l’urbanisme qui nous anime aujourd’hui.
En conséquence, le Gouvernement a également émis un avis défavorable sur cet amendement.

À vouloir tout simplifier, vous complexifiez la procédure et libéralisez à tout crin ! Or cela va entraîner un certain nombre de problèmes juridiques, alors que nous proposons précisément de les éviter.
Monsieur le secrétaire d’État, vous pourrez compter, dans un proche avenir, si vous êtes encore à la tête de ce ministère, le nombre de contentieux ainsi créés.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 126, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 4 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les secteurs où le document d'aménagement commercial pose des conditions relatives à la localisation préférentielle des commerces en fonction de la typologie définie au IV de l'article 1er, le changement de secteur d’activité d’un commerce fait l’objet d’une déclaration préalable telle que prévue par l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme.
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement vise tout simplement à soumettre les changements de secteur commercial à déclaration préalable, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Il s’agit là d’un apport substantiel à cette proposition de loi.
Le Gouvernement étant toujours défavorable à la typologie, il est évidemment défavorable à cet amendement.

Je veux de nouveau revenir sur la question du changement de destination.
Un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leur dimension, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. Ce décret précise que, dans les cas où les clôtures sont également soumises aux déclarations préalables, les constructions soumises à déclaration préalable sont, aux termes du décret du 5 janvier 2007, visées par deux articles du code de l’urbanisme. Or, dans ces articles, il n’est jamais fait mention d’aucune autre procédure que celle qui conduit à la construction d’un ouvrage.
À défaut d’inscrire explicitement que le changement de destination avec l’arrivée d’un commerçant dans un nouveau local est soumis à déclaration préalable, comment allez-vous faire ? Ce n’est pas possible, sauf à changer le décret.
Un locataire signant un bail commercial, doit-il procéder à une déclaration préalable avant de signer le bail ? Dès lors, pourquoi ne pas réformer la législation relative aux baux commerciaux pour le préciser explicitement, afin d’éviter que les acteurs ne soient pris au dépourvu ?
Il est absolument insuffisant de renvoyer à cet article du code de l’urbanisme la question du changement d’activité. Certes, vous comprenez l’enjeu, monsieur le rapporteur, mais la solution proposée sera inopérante sur le terrain.
Nous avons la preuve que la suppression de toute autorisation d’exploitation pose de sérieux problèmes. M. le secrétaire d’État nous a dit tout à l’heure qu’il ne voulait pas complexifier la situation ; pour notre part, comme l’a indiqué notre collègue Claude Bérit-Débat, nous voulons trouver des solutions pour éviter les problèmes.
Même si nous sommes ravis de constater que vous avez, enfin, admis que la question des changements d’activité est fondamentale, nous sommes, en revanche, très sceptiques sur l’efficacité de vos propositions, monsieur le rapporteur.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 4 A.
I. – En l'absence de plan local d'urbanisme, les décisions prises sur une demande de permis de construire ou d'aménager portant sur une implantation commerciale d'une surface supérieure aux seuils fixés en application du II et du III de l'article 1er doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale.
Il en est de même lorsqu’un schéma de cohérence territoriale a été approuvé ou modifié pour comprendre les dispositions mentionnées au I de l’article 1er jusqu’à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme avec ces dispositions.
II. – Dans le cas visé à l'article 1er bis B, les décisions prises sur une demande de permis de construire ou d’aménager portant sur un commerce d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés de surface hors œuvre nette, au sens du code de l’urbanisme, doivent être compatibles avec le document d’aménagement commercial communautaire.

L'amendement n° 81 rectifié bis, présenté par M. Merceron, Mme Gourault, MM. Deneux et Soulage, Mmes Férat et Morin-Desailly et M. Amoudry, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer les mots :
et du III
La parole est à M. Jean-Claude Merceron.
L'article 4 est adopté.
Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial continu ou discontinu, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
1° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès aux divers établissements ;
2° Soit sont situés dans un ensemble cohérent de bâtiments conçus en vue de l'implantation de commerces ;
3° Soit font l'objet d'une gestion ou d'un entretien communs d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voies de circulation, aires de stationnement, chauffage collectif ou espaces verts ;
4° Soit sont réunis par une structure juridique commune.

L'amendement n° 113, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Nous proposons une nouvelle rédaction de l’ensemble commercial qui corresponde à celle qui existe déjà, afin d’éviter d’éventuels changements jurisprudentiels en la matière. Sur le fond, cette modification ne change rien quant à la définition d’un ensemble commercial.

Aux termes du texte de la commission, forme un ensemble commercial « un ensemble cohérent de bâtiments conçus en vue de l’implantation de commerces ». Le Gouvernement souhaite remplacer ce critère en considérant comme ensemble commercial un ensemble de bâtiments « conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ». La définition retenue par le Gouvernement est donc plus restrictive.
Or l’objectif de cette proposition de loi étant de renforcer les outils de régulation de l’implantation des grands ensembles commerciaux en périphérie, il me paraît souhaitable de maintenir la définition adoptée par la commission de l’économie, qui est d’ailleurs celle que les députés avaient retenue.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 4 bis est adopté.
I. – Lorsqu'un territoire n'est couvert ni par un schéma de cohérence territoriale comportant un document d'aménagement commercial, ni par un plan local d'urbanisme comprenant les dispositions prévues aux articles 1er bis A et 1er bis C, ni par un document d'aménagement commercial communautaire, les permis de construire portant sur l'implantation, l'extension ou la réouverture d'un commerce de détail ou d'un ensemble commercial sont délivrés avec l'accord de la commission régionale d'aménagement commercial :
1° Lorsque la surface hors œuvre nette de ce commerce de détail ou de cet ensemble commercial est supérieure à 1 000 mètres carrés ;
2° À la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, après délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de cet établissement, lorsque la surface hors œuvre nette de ce commerce de détail ou de cet ensemble commercial est comprise entre 300 et 1000 mètres carrés et que l'implantation commerciale a lieu dans une commune de moins de 20 000 habitants.
Les pharmacies, les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles, les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal et les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports d'une surface maximale de 2 500 mètres carrés ne sont pas soumis à l'accord de la commission régionale d'aménagement commercial.
II. – À l'issue d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le seuil mentionné au 1° du I est ramené à 300 mètres carrés de surface hors œuvre nette.
III. – Lorsqu'elle se prononce en application du I ci-dessus, la commission régionale d'aménagement commercial fonde sa décision, qui doit être motivée, sur les exigences mentionnées au I de l’article 1er. Cette décision est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, s'il existe.
Pour l'application du présent article, la commission régionale d'aménagement commercial est composée :
- du président du conseil régional, ou de son représentant,
- du président du conseil général du département où se trouve la commune d'implantation, ou de son représentant,
- du maire de la commune d'implantation ou d'un conseiller municipal qu'il désigne,
- du président du syndicat mixte ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale chargé d'élaborer le schéma de cohérence territoriale, ou de son représentant ; à défaut du conseiller général de la commune d'implantation,
- du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou de son représentant ; à défaut du conseiller général de la commune d'implantation ; à défaut, du maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation, ou de son représentant,
- du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation, ou de son représentant,
- d'une personnalité qualifiée en matière de développement durable et d'aménagement du territoire,
- d'un représentant de l'État,
- d'un représentant d'associations de protection des consommateurs.
La commission est présidée par le représentant de l’État dans la région, ou son représentant, qui ne prend pas part au vote.
Lorsqu'un projet d'implantation, d'extension ou de réouverture d'un commerce implique le dépôt de demandes de permis de construire à la mairie de deux communes limitrophes appartenant à deux régions différentes, il est créé une commission interrégionale d'aménagement commercial composée des membres de la commission régionale d'aménagement commercial de chacune des deux régions concernées et présidée par le préfet de la région dans laquelle se situe la majeure partie du projet.
Aucun membre de la commission régionale d'aménagement commercial ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel, direct ou indirect, ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

Je suis saisie de quinze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 112, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Lorsqu'un territoire n'est couvert ni par un schéma de cohérence territoriale comportant un document d'aménagement commercial, ni par un plan local d'urbanisme comprenant les dispositions prévues aux articles 1er bis A et 1er bis C, ni par un document d'aménagement commercial communautaire, les dispositions des chapitres Ier et II du titre V du Livre VII du code de commerce sont applicables.
II. - Il en est de même lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, approuvé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ne comprend pas les dispositions définies aux I et II de l'article 1er.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer lors de la discussion générale, le Gouvernement souhaite que l’on revienne aux dispositions prévues dans la loi de modernisation de l’économie, la loi LME, pendant la période transitoire.
Je vous rappelle que, sous ce régime, intervient la CDAC, la commission départementale d’aménagement commercial, et, en cas de recours, la CNAC, la commission nationale d’aménagement commercial.
Il est proposé de créer dans ce texte une institution nouvelle, la CRAC, la commission régionale d’aménagement commercial. Cela signifie que coexisteront le régime LME, si je puis dire, le régime prévu dans le présent texte, qui s’appuie sur les SCOT, ainsi qu’un troisième régime transitoire.
C’est la raison pour laquelle je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, d’en rester à la procédure actuelle, issue de la loi LME, pour éviter une succession de procédures qui, me semble-t-il, ne rend pas notre droit des plus simples.

L'amendement n° 62, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1 et alinéa 6, première phrase
Remplacer le mot :
régionale
par le mot :
départementale
II. – Alinéas 7 à 19
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Odette Terrade.

Par cet amendement, nous proposons le maintien de la CDAC en raison de la pertinence de l’échelon départemental, tout en modernisant le rôle de cette dernière.

L'amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Merceron, Mmes Gourault, Létard et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
1 000 mètres carrés
par les mots :
300 mètres carrés
2° En conséquence, alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

L'annonce de la date à laquelle le seuil passe de 1000 mètres carrés à 300 mètres carrés, mentionnée à l'alinéa 5, comporte un risque important d'effets d'aubaine : le dépôt précipité ou prématuré de permis d'aménager ou de construire, dans ces zones, et pour la surface plafond.
Nous l’avons vu avec le photovoltaïque : l’annonce entraîne l’aubaine. On donne ainsi le bâton pour se faire battre !
Il semble, en revanche, opportun pour les zones rurales, majoritairement concernées par l'alinéa 1er, qu'un seuil inférieur à celui qui existe pour les zones périurbaines couvertes par un SCOT soit fixé, puisque la préservation du paysage et la maîtrise de la consommation des espaces agricoles sont des préoccupations qui les touchent particulièrement.
Pour ces raisons, il est indispensable de ramener, dès l'entrée en vigueur de la loi, le seuil de 1 000 mètres carrés à 300 mètres carrés, prévu à l'alinéa 2, et, en conséquence, de supprimer l'alinéa 5.

L'amendement n° 63, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le nombre :
par le nombre :
La parole est à Mme Odette Terrade.

Nous proposons de ramener la surface de 1 000 mètres carrés à 300 mètres carrés.
En effet, pourquoi différer le retour à ce dernier seuil de trois ans et complexifier ainsi le texte en prévoyant deux régimes différents, alors qu’on peut adopter dès maintenant un régime unique ?
Pour notre part, nous proposons de retenir le seuil de 300 mètres carrés d’emblée sans en différer l’application dans le temps. Ainsi, lorsqu’un territoire n’est couvert par aucun document d’aménagement commercial, tout permis de construire concernant une surface de construction hors œuvre nette supérieure à 300 mètres carrés doit être soumis à la commission régionale d’aménagement commercial, afin que celle-ci donne ou non son accord.
Les territoires qui, à l’avenir, ne seront couverts par aucun de ces documents d’urbanisme – un SCOT comportant un DAC ou un PLU comprenant les dispositions prévues aux articles 1er bis A et 1er bis C ou DAC communautaire – deviendront rapidement des exceptions. Il ne s’agit donc pas de remettre en cause le principe de la suppression du régime de double autorisation comme règle générale. Il est d’ailleurs prévu dans la rédaction actuelle de revenir au seuil de 300 mètres carrés dans trois ans. J’imagine que ce délai permettra précisément de s’assurer que de tels territoires constitueront des exceptions. Mais, au fond, est-ce bien utile ?
Qu’on ne vienne pas nous dire que le présent amendement est partiellement satisfait ! Il ne l’est pas, car, dans sa rédaction actuelle, le texte laisse une brèche ouverte dans ces territoires durant trois ans encore, un délai qui, je vous l’assure, est bien suffisant pour produire des dégâts supplémentaires, d’autant que les failles induites par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ont été bien repérées et exploitées.
À l’issue de l’adoption de cette loi, le Gouvernement avait promis un texte dans les six mois. Or nous sommes en mars 2011 ! Voilà donc bientôt trois ans que nous attendons !
Tout comme les six mois annoncés se sont transformés en trois ans, j’aurais pu vous proposer, monsieur le secrétaire d’État, de réduire le délai de trois ans à six mois ! Toutefois, mes chers collègues, ne faisons pas de comptes d’apothicaire, d’autant que les pharmacies ne sont pas soumises à l’avis de la commission régionale d’aménagement commercial !
Sourires

Avec ce texte, l’opportunité nous est donnée de mener une action efficace pour redonner le contrôle aux élus en matière d’urbanisme commercial.
Tel est le sens du présent amendement.

L'amendement n° 20, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
1 000 mètres carrés
par les mots :
500 mètres carrés
La parole est à M. François Patriat.

L’article 5 permet d'envisager la transition avec l'actuelle réglementation issue de la loi LME, le temps que les collectivités compétentes se dotent d'un document d'aménagement commercial.
Comme nous l’avons déjà indiqué, il est hors de question pour nous de sacrifier tout dispositif d’autorisation d’implantation des établissements commerciaux de moins de 1 000 mètres carrés. C’est pourquoi nous vous proposons, mes chers collègues, d’aménager les dispositions prévues pour faire en sorte que les maires disposent de réels pouvoirs de régulation.
Suivant cette logique, nous souhaitons que le seuil au-delà duquel l'avis de la commission régionale d'aménagement commercial est automatiquement sollicité soit abaissé à 500 mètres carrés, comme nous l’avons déjà mentionné ce matin.

L'amendement n° 118, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Il s’agit d’un amendement de repli, au cas où l’amendement n° 112 que nous avons défendu précédemment ne serait pas – par malheur ! – adopté.
Le présent amendement vise à supprimer la référence aux 300 mètres carrés pour conserver le seuil de 1 000 mètres carrés dans les territoires non encore couverts par un document d’aménagement commercial dans le cadre d’un SCOT ou d’un PLU.

L'amendement n° 21, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
après délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de cet établissement,
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

Le présent article prévoit, dans la période de transition, la mise en place d’un dispositif qui ne nous satisfait pas, ainsi que François Patriat et moi-même l’avons déjà souligné à différentes reprises.
Toutefois, mes chers collègues, vous avez les moyens de limiter les dégâts en votant avec nous cet amendement, pour faire en sorte que les maires disposent de réels pouvoirs de régulation.
Pour faciliter les procédures, nous proposons que les maires et les présidents d’EPCI puissent solliciter l’avis de la commission régionale d’aménagement commercial sans attendre la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public.

L'amendement n° 22, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
et que l'implantation commerciale a lieu dans une commune de moins de 20 000 habitants
La parole est à M. François Patriat.

L’argumentation que je viens d’exposer vaut également pour cet amendement, madame la présidente.

L'amendement n° 44 rectifié, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 9
Remplacer les mots :
où se trouve la
par les mots :
de la
II. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
; à défaut du conseiller général de la commune d'implantation,
III. – Alinéa 12
Supprimer les mots :
; à défaut du conseiller général de la commune d'implantation ; à défaut, du maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation, ou de son représentant,
IV. – Alinéas 16
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gérard Cornu.

Je propose une modification rédactionnelle de l’alinéa 9 de l’article 5.
Par ailleurs, je souhaite alléger la rédaction des alinéas 11 et 12, car les différents représentants de la CRAC sont déjà précisés.
Enfin, l’alinéa 16 est inutile. La représentation des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat a été supprimée, car, désormais, le projet ne doit plus être apprécié en termes économiques. Il faut en tirer les mêmes conséquences pour les associations de protection des consommateurs : la présence d’un représentant issu de ces organisations n’est plus pertinente aujourd’hui.

L'amendement n° 69 rectifié, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
pour chaque département
La parole est à M. Gérard Cornu.

M. Gérard Cornu. Cet amendement devrait faire plaisir à notre collègue Odette Terrade !
Sourires

En effet, nous souhaitons la présence de personnalités qualifiées pour chaque département, afin que chacune de celles-ci ait une connaissance approfondie du territoire concerné.

L'amendement n° 46, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La commission régionale d’aménagement commercial siège au chef-lieu du département de la commune d’implantation du projet qu’elle doit examiner.
La parole est à M. Gérard Cornu.

Cet amendement prévoit que la commission doit siéger dans le chef-lieu du département de la commune d’implantation du projet qu’elle doit examiner, afin d’en faciliter la gestion. Mais il relève peut-être du domaine réglementaire...

L'amendement n° 47, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans ce cas, la commission régionale d'aménagement commercial siège au chef-lieu du département de la commune d'implantation où se situe la majeure partie du projet.
La parole est à M. Gérard Cornu.

Cet amendement s’inscrit dans le droit fil de l’amendement précédent et en constitue la suite logique.

L'amendement n° 24, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Un arrêté conjoint des ministres de l'aménagement du territoire et du développement durable fixe les critères qui doivent être respectés pour la nomination des personnalités qualifiées prévues par le présent article.
La parole est à M. François Patriat.

Le texte prévoit que siège au sein de la commission régionale d'aménagement commercial une personnalité qualifiée en matière de développement durable et d'aménagement du territoire.
Nous souhaitons que les qualifications de cette personnalité dans ces deux domaines soient précisées par arrêté, afin que l’appartenance de cette dernière à des associations de protection des consommateurs ou de défense de l'environnement reconnues soit spécifiée.

L'amendement n° 127, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
- La commission régionale d'aménagement commercial prend sa décision par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
La commission régionale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement vise simplement à préciser la procédure de décision des CRAC, en s'inspirant de celle qui est aujourd’hui appliquée au sein des CDAC.

L'amendement n° 95 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Bockel et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les décisions rendues par les commissions régionales ou interrégionales d'aménagement commercial peuvent faire l'objet de recours. Le Conseil d'État est la juridiction compétente pour statuer sur les recours déposés contre les décisions des commissions régionales ou interrégionales d'aménagement commercial.
La parole est à M. Jacques Mézard.

Par cet amendement, nous souhaitons compléter l’article 5 en indiquant que, dans l’hypothèse où les commissions régionales d’aménagement commercial seraient créées, les décisions qu’elles rendront pourront faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, qui serait alors la juridiction compétente pour statuer.
Je rappelle que nous cherchons à limiter l’accumulation des recours successifs. Seule une saisine directe du Conseil d’État permettrait à la justice administrative de se prononcer plus rapidement sur les dossiers de recours et de fixer, en outre, une jurisprudence univoque.
Je note d’ailleurs que, au travers de l’amendement n° 112, M. le secrétaire d’État a indiqué qu’il souhaitait le maintien des institutions actuelles, à savoir les CDAC et la CNAC, qui serait facilité par la volonté du Gouvernement de confier de nouveau au Conseil d’État le contentieux des décisions rendues par la CNAC en premier et dernier ressort.
En la matière, on assiste à des aller et retour qui sont particulièrement dommageables pour ceux qui souhaitent accélérer les procédures.
Initialement, les recours contre la CNAC étaient confiés au Conseil d’État. Puis, au travers d’un nouveau texte, ils relèvent maintenant de la compétence des tribunaux administratifs. Aujourd’hui, le Gouvernement indique qu’il souhaite revenir à un recours devant le Conseil d’État. Voilà qui est peu cohérent !
C’est la raison pour laquelle il nous semble vraiment nécessaire de fixer, une fois pour toutes, la règle, en confiant cette compétence au Conseil d’État.

Je ne reviendrai pas sur la longue discussion que nous avons eue ce matin : nous sommes convenus qu’il fallait faire disparaître le plus rapidement possible les CDAC et la CNAC, puisque celle-ci, tout le monde l’a affirmé, est une « machine à dire oui ». Il est donc grand temps de mettre fin à un système totalement à bout de souffle.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 112 du Gouvernement.
S’agissant de l’amendement n° 62, la commission a déjà expliqué les raisons pour lesquelles elle est favorable aux CRAC et donc défavorable, en la matière, au maintien des CDAC.
En conséquence, elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Les amendements n° 86 rectifié, 63 et 20 font écho à la longue discussion que nous avons eue au sujet des seuils lors de l’examen de l’article 1er ; je n’y reviendrai donc pas.
La commission a émis un avis défavorable sur ces trois amendements.
En revanche, c’est avec une immense joie que la commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 118 du Gouvernement, comme elle s’y était engagée.
Concernant l’amendement n° 21, il appartient aux communes de décider de saisir les CRAC si elles estiment que leur territoire est menacé par une implantation commerciale. Pour des seuils de surface de cet ordre, prévoir une saisine systématique de la CRAC me paraît une précaution totalement disproportionnée.
C’est pourquoi la commission est défavorable à cet amendement.
De même, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 22, mais, je le répète, je ne reviendrai pas sur la discussion que nous avons eue ce matin au sujet des seuils.
Concernant les amendements n° 44 rectifié et 69 rectifié, la commission est favorable aux nouvelles rédactions proposées par notre collègue Gérard Cornu.
En revanche, elle lui demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 46, car il relève du domaine réglementaire ; de même que l’amendement n° 47, qui en constitue la suite logique.
Par ailleurs, je suis heureux d’annoncer à notre collègue François Patriat que la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 24.
Certes, il aurait été préférable de le rectifier, comme vous vous y étiez engagé à le faire en commission, mon cher collègue. Mais, puisque nous sommes pressés par le temps pour achever l’examen de cette proposition de loi, nous acceptons cet amendement en l’état.
L’amendement n° 95 rectifié bis vise à faire du Conseil d’État la juridiction compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des CRAC. En l’état actuel du droit, cette possibilité n’est ouverte que pour la CNAC. Or, vous le savez, mon cher collègue, pour cause d’engorgement du Conseil d’État, nous avons déjà dû revenir sur une telle disposition. Aussi, les décisions des commissions régionales d’aménagement commercial n’ont pas vocation à faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Je tiens tout d’abord à dire à quel point je suis heureux d’avoir obtenu un avis favorable de la commission. Vous le voyez, monsieur Patriat, le groupe socialiste et le Gouvernement sont ainsi à égalité !
Sourires.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 62, 86 rectifié, 63, 20, 21 et 22.
Concernant l’amendement n° 44 rectifié, il s’en remet à la sagesse du Sénat.
Par ailleurs, il est défavorable aux amendements n° 69 rectifié et 46, ainsi, j’en suis désolé, monsieur Cornu, qu’à l’amendement n° 47.
Il a également émis un avis défavorable sur l’amendement n° 24 du groupe socialiste, ainsi que sur l’amendement n° 127 de la commission.
Enfin, je demanderai à M. Mézard de bien vouloir retirer l’amendement n° 95 rectifié bis dans la mesure où un décret visant à faire du Conseil d'État le premier et dernier recours est en cours de rédaction.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.

Non, je le retire, madame la présidente, de même que l’amendement n° 47.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 5 est adopté.
I. – Le projet de document d'aménagement commercial d'un schéma de cohérence territoriale, les dispositions d'un plan local d'urbanisme élaborées en application de l'article 1er bis A ou 1er bis C ou le projet d'aménagement commercial communautaire peuvent être soumis pour avis, à l’initiative du préfet ou du président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, à la commission régionale d’aménagement commercial. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas notifié par la commission dans un délai de deux mois à compter de leur transmission.
Pour l’application de l’alinéa précédent, les six élus membres de la commission régionale d’aménagement commercial sont :
– le président du conseil régional ou son représentant ;
– le président du conseil général du département où se trouve l’établissement public de coopération intercommunale ou son représentant ;
– le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale chargé de l’élaboration du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou du document d’aménagement commercial, ou son représentant ;
– les présidents de l'organe délibérant des trois établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme les plus peuplés de la région ou, à défaut, le maire de chacune des trois communes les plus peuplées de la région, ou leurs représentants.
II. –
Non modifié


Ces deux amendements sont certes identiques, mais ils ne sont pas motivés par les mêmes raisons !
Pour ma part, je suis très favorable à la CRAC délibérative, alors que je ne l’étais pas à la CRAC consultative, tout simplement pour éviter les confusions. Cependant, M. le rapporteur ayant répondu à mes souhaits, tant en ce qui concerne le changement de nom pour mieux différencier l’une et l’autre qu’en ce qui concerne la présence d’une personnalité qualifiée et d’un représentant de l’État, je retire cet amendement.

Je le retire également, madame la présidente.

L'amendement n° 103 est retiré.
L'amendement n° 55, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase :
Après le mot :
préfet
insérer les mots :
, d'un maire concerné
La parole est à Mme Odette Terrade.

Cet amendement vise à donner aux maires des communes couvertes par les documents d’urbanisme visés par l’article 2 la capacité de solliciter l’avis de la CRAC sur tout projet de document d’aménagement commercial, qu’il se situe au niveau du SCOT ou à celui de l’intercommunalité, dès lors qu’il aurait un impact direct sur le territoire de leurs communes.
En effet, il convient de ne pas désavantager les communes au profit des intercommunalités, qui n’ont pas la même approche des situations locales ; un maire pourrait donc parfaitement avoir le sentiment que sa commune est lésée par l’un de ces documents d’urbanisme sans qu’il lui soit permis de contester celui-ci, ce qui, d’un point de vue purement démocratique, n’est pas satisfaisant.
S’il est vrai que, par le passé, les communes ont souvent rivalisé pour attirer à elles les commerces, source importante de recettes fiscales, la disparition de la taxe professionnelle notamment les place, de même que les EPCI, dans une situation nouvelle.
Ainsi, donner cette possibilité au maire constituerait un dernier verrou pour s’assurer que les DAC prennent en compte tous les acteurs et l’ensemble des réalités locales, sans pour autant exposer la CRAC à la saisine systématique de l’un des maires concernés, car, bien entendu, les intercommunalités restent, avant tout, des espaces de coopération.

Donner à chaque maire le pouvoir de saisir la CRAC consultative aurait pour effet l’engorgement total de celle-ci.
La commission est donc défavorable à cet amendement, qui va totalement à l’encontre de l’esprit du texte.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 59, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1, première phrase
Remplacer le mot :
régionale
par le mot :
départementale
II. – Alinéas 2 à 7
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Odette Terrade.

Cet amendement traduit nos interrogations sur la suppression des commissions départementales d’aménagement commercial.
En effet, si nous sommes d’accord pour que soit supprimée progressivement la double autorisation en matière commerciale et pour que le caractère commercial soit pleinement intégré dans les prescriptions des documents locaux d’urbanisme, notamment des SCOT, nous sommes plus circonspects sur cet aspect du texte.
Étant donné l’architecture retenue par la proposition de loi, ces commissions ont plus ou moins vocation à disparaître, qu’elles soient départementales ou régionales. Pourquoi alors, dans cette phase transitoire, ne pas laisser subsister les commissions départementales qui fonctionnent déjà et auxquelles une jurisprudence est associée, plutôt que d’installer de nouvelles commissions ?
De plus, nous estimons qu’en termes d’aménagement commercial le niveau départemental est bien plus pertinent que le niveau régional et correspond mieux aux bassins de vie, notamment au regard de la volonté de réduire les déplacements et l’étalement urbain.
Nous regrettons de manière incidente que la commission régionale ne soit pas autorisée, comme l’était la commission départementale, à auditionner toute personne dont l’avis présente un intérêt, afin d’éclairer sa décision.
De telles auditions permettent d’enrichir les débats de ces commissions, et il serait dommage de les priver d’expertises extérieures.
Ce serait d’autant plus regrettable que, du fait de la composition des CRAC, la charge du représentant régional, appelé à siéger pour l’ensemble des projets d’implantation commerciale au niveau régional, sera particulièrement lourde.
Enfin, je rappelle que M. le rapporteur estimait que le maintien des CDAC aurait correspondu à une transition plus douce vers le nouveau régime ; nous sommes parfaitement d’accord avec cet argument, et nous regrettons que cette voie n’ait pas été privilégiée.

L'amendement n° 131, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1, première phrase
Après les mots :
commission régionale
insérer le mot :
consultative
II. - Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- une personnalité qualifiée dans le domaine du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
- un représentant de l'État.
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement répond à la demande de notre collègue Gérard Cornu : il vise à rectifier le nom de la CRAC consultative et modifie également sa composition.

L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Fouché, Houel, Grignon, B. Fournier, Vasselle, Doublet et Laurent, Mmes G. Gautier, Panis et Hummel, MM. Belot et Revet, Mme Sittler, M. Cléach, Mme Malovry et MM. Beaumont et Lefèvre, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
- le président du conseil régional ou son représentant, s'ils ne sont pas élus dans le département d'implantation ;
- le président du conseil général du département où se trouve la commune d'implantation, ou son représentant, s'ils ne sont pas élus de l'arrondissement concerné et s'ils ne sont pas membres de l'éventuelle intercommunalité concernée ;
La parole est à M. Michel Houel.

Cet amendement de précision a pour objet d’inscrire explicitement dans la proposition de loi l'incompatibilité s’appliquant aux membres de la commission ayant un intérêt direct ou indirect dans l'affaire en délibération.

La commission est, naturellement, défavorable à l’amendement n° 59 : il n’est pas question de revenir à l’échelle départementale.
Quant à l’amendement n° 41 rectifié, il pourrait avoir pour conséquence d’amputer la CRAC consultative de deux membres sur six. Par ailleurs, l’analyse des dossiers serait appauvrie, puisqu’elle ne bénéficierait plus du regard de la région et des départements. La commission a donc également émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 59, 131 et 41 rectifié.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 41 rectifié est retiré.
L'amendement n° 60, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
qui fonde son avis sur le respect des exigences mentionnées au I de l'article 1er
La parole est à Mme Odette Terrade.

Cet amendement vise à indiquer explicitement les critères selon lesquels la CRAC rendra son avis motivé sur un projet de DAC lorsqu’elle sera saisie.
En effet, si nous concevons parfaitement que ces nouvelles structures puissent émettre un avis sur les projets de DAC, encore faut-il connaître les critères selon lesquels cet avis sera rendu.
Dans ce cadre, il nous apparaît logique que la CRAC formule son avis au regard des objectifs définis pour les documents d’aménagement commercial par l’article 1er de la présente proposition de loi et qu’ainsi seuls les documents ne respectant pas les objectifs légaux d’un DAC puissent faire l’objet d’un avis négatif.
En outre, je profite de cette occasion pour vous faire remarquer, mes chers collègues, que la présente proposition de loi n’indique aucunement quelles seraient les conséquences d’un avis défavorable, ce qui, vous l’accorderez, crée un vide législatif particulièrement gênant.

Il n’y a absolument aucune raison de réduire ainsi la compétence de la CRAC consultative.
Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 2 est adopté.

L'amendement n° 48, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 431-2 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet architectural porte sur la construction de bâtiments affectés au commerce, il décrit dans une étude d’impact et paysagère jointe au dossier de demande les effets en termes d’aménagement du territoire attendus du projet dans la zone de chalandise qu’il définit. »
La parole est à M. Gérard Cornu.

Le rapatriement de l’urbanisme commercial dans le droit commun de l’urbanisme ne doit pas se faire au détriment de la capacité des élus d’apprécier l’impact d’une activité commerciale sur la parcelle d’implantation d’un futur projet et autour de celle-ci.
En effet, un projet peut parfaitement répondre aux exigences propres à la parcelle à construire, mais avoir des effets imprévisibles pour le territoire d’implantation, effets qu’il n’aurait, par ailleurs, pas été possible d’anticiper dans les documents d’aménagement commercial.
Cet amendement prévoit donc que tout permis de construire portant sur du commerce doit comporter un dossier d’étude d’impact et paysagère.

Cet amendement étant satisfait par le droit en vigueur, je demande à notre collègue de bien vouloir le retirer.

M. Gérard Cornu. Étant sollicité tant par M. le rapporteur que par M. le secrétaire d’État, je le retire, madame la présidente.
Sourires

L'amendement n° 48 est retiré.
L'amendement n° 49, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu'une demande est déposée en application de l’article 5 de la présente loi, le pétitionnaire peut ne déposer que la seule étude d’impact et paysagère.
En cas d’accord délivré par la commission régionale d’aménagement commercial, le pétitionnaire dispose d’un délai de six mois pour compléter sa demande de permis de construire, dont le délai d’instruction court à compter de la remise des pièces nécessaires.
En tout état de cause, cet accord ne peut être contesté par les tiers qu’à l’occasion d’un recours contre le permis de construire.
La parole est à M. Gérard Cornu.

Cet amendement vise à alléger la charge des dossiers présentés par les opérateurs, afin, notamment, d'en réduire les coûts d’instruction.
Il s’agit de limiter la présentation devant la commission régionale d’aménagement commercial à la seule étude d’impact et paysagère, laquelle permet d’apprécier la compatibilité du projet avec les principes et les critères de la loi, sans nécessairement obliger à réaliser le dossier de permis de construire dans son entier.
Toutefois, j’ai bien l’impression que cet amendement connaîtra le même sort que le précédent...
Sourires
Nouveaux sourires.

Notre collègue est non pas pessimiste, mais, tout simplement, averti ! Il sait que son amendement est déjà satisfait par le droit en vigueur. Aussi lui demanderai-je de bien vouloir le retirer.
(Suppression maintenue)
CHAPITRE III
Dispositions diverses
(Division et intitulé nouveaux)
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 122-2 est ainsi rédigé :
« Dans les communes où s'applique le premier alinéa et à l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, il ne peut être délivré de permis de construire ou d'aménager portant sur une implantation commerciale d'une surface hors œuvre nette supérieure à 1 000 mètres carrés, au sens du code de l'urbanisme. » ;
2° L'article L. 123-1-5 est ainsi modifié :
a) Le 7° bis est ainsi rédigé :
« 7° bis Prévoir des règles visant à maintenir la diversité commerciale dans chaque quartier et à préserver les espaces nécessaires aux commerces de proximité ; » ;
b) Il est ajouté un 17° ainsi rédigé :
« 17° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. » ;
3° L'article L. 214-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que les cessions de parts ou actions d'une société civile ou commerciale dont l'activité principale est la gestion d'un fonds artisanal ou d'un fonds de commerce lorsque ces cessions ont pour objet un changement de secteur d'activité. » ;
b) La première phrase du dernier alinéa complétée par la référence : « et L. 213-14. » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-2, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
5° L'article L. 425-7 est abrogé ;
6° À l'article L. 740-1, la référence : « L. 425-7 » est remplacée par la référence : « L. 425-8 ».

L'amendement n° 26, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. François Patriat.

La simplification proposée ici pourrait avoir pour effet de réduire les capacités d'action des villes, puisque celles-ci perdront la faculté de désigner « les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif », au profit de la capacité à fixer des règles générales zone par zone.
La référence à « l'îlot » présentait pourtant un intérêt tout à fait important pour faire face à la conversion de rues entières à la mono-activité.
Nous souhaitons donc le maintien du dispositif actuel, particulièrement utile dans les grandes agglomérations.

M. Dominique Braye, rapporteur. La commission souhaite que notre collègue puisse rentrer chez lui heureux !
Sourires
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 28, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et à l'implantation de très petites entreprises artisanales
La parole est à M. François Patriat.
Sourires

L'objet de cet amendement est de doter les collectivités du pouvoir de préserver la diversité commerciale dans les villes et les villages. La situation des petites entreprises, dont l'activité ne peut être qualifiée automatiquement de « commerciale », mais qui dispensent des services aux autres entreprises, est parfois très critique : en l'absence de toute législation de type « Small Business Act », elles sont exclues des appels d'offres et, le plus souvent, elles peinent à s'installer dans les territoires les mieux équipés et les plus valorisés, ne faisant pas le poids face aux grandes entreprises et aux multinationales qui sont pourtant leurs partenaires et clients.
Dans les faits, les élus ont toutes les peines du monde à conserver des zones mixtes dans lesquelles on trouve des grandes entreprises, des petites entreprises et du commerce.
Dans les sites concernés par les grappes d’entreprises, il faut pourtant prévoir l’implantation d’imprimeries, d’entreprises de maintenance, d’artisans ou encore de petites entreprises de restauration, telles les entreprises de traiteurs.
Aujourd'hui, la qualification commerciale fait peser un risque sur les décisions des collectivités qui souhaiteraient inciter à l’implantation d’un immobilier adapté aux activités de type cuisines, entrepôts, plateaux techniques, tournages vidéo ou techniques de l’information.
C'est la raison pour laquelle nous proposons de mentionner ici que, en cas de réalisation d'une opération d'aménagement, un pourcentage de cette opération peut être prévu pour la réalisation de commerces et d'immobilier destinés à l'accueil des très petites entreprises ou industries.

L’idée est intéressante.
Mon cher collègue, la commission peut être favorable à votre amendement à condition que vous supprimiez les termes « très petites », car cette mention est source de contentieux. En effet, elle peut faire l’objet d’interprétations juridiques différentes et peut être considérée comme discriminatoire.
Si l’amendement est rectifié dans le sens proposé par M. le rapporteur, le Gouvernement y sera favorable.

Monsieur Patriat, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par M. le rapporteur ?

Je suis donc saisie d’un amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
et à l'implantation d'entreprises artisanales
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 32 rectifié, présenté par M. Botrel et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au quatrième alinéa de l'article L. 123-13, après les mots : « une zone agricole » sont insérés les mots : «, sauf pour reclasser les habitations des zones Nh, »
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

Cet amendement vise à simplifier la gestion et l'évolution des plans locaux d'urbanisme dans les communes rurales, qui sont nombreuses à les avoir adoptés. Il s’agit – c'est un fait incontestable – de vrais outils de planification d'urbanisme communal.
Pourtant, une faille existe, et non des moindres, pour les habitations des exploitants classées en zone A, c'est-à-dire faisant parties intégrantes de l'exploitation : les résidents de ces habitations peuvent changer de statut, tout en continuant à y habiter.
En effet, un agriculteur peut prendre sa retraite ou changer de métier, tout en demeurant dans sa maison. Cette situation peut concerner également le conjoint non-agriculteur après le décès du conjoint exploitant, voire les héritiers.
Les travaux que ces personnes souhaitent effectuer sur leur habitation nécessitent un permis de construire. Or la validité d'une telle demande était refusée jusqu'à la loi Grenelle 2, au motif que seuls les agriculteurs peuvent bénéficier d'un permis de construire en zone A.
Depuis lors, cette loi a permis que le zonage de ces habitations soit requalifié par la création d'un pastillage spécifique, qui a eu pour effet de reclasser ces constructions en zone Nh et de leur permettre d'obtenir, le cas échéant, un permis de construire.
Or cette possibilité présente un inconvénient majeur : celui d'être soumise à une procédure de révision du PLU, qui est lourde par sa durée – trois ans au minimum – et par son coût pour la collectivité. De plus, l'évolution actuelle des structures agricoles nécessite que la démarche soit fréquente, voire récurrente.
Il va de soi que ni les élus locaux, qui s'épuisent dans l'élaboration des PLU, ni les personnes concernées, ni les conjoints, ni les héritiers ne peuvent se satisfaire d'une telle situation. Le délai est par trop contraignant pour les pétitionnaires.
Cette situation est également paradoxale, puisque les communes qui n'ont pas fait l'effort de se doter d'un PLU ne sont pas concernées par ces inconvénients.
Sur ce point particulier, les plans locaux d'urbanisme constituent une véritable difficulté pour les communes agricoles qui en sont dotées, d'autant que les habitations concernées, souvent anciennes, bien antérieures au PLU, ne menacent en rien la préservation des terres agricoles.
Aussi, afin de faire du PLU un outil réellement opérationnel et efficace dans son utilisation, il conviendrait que le changement de classification, justifié par la modification du statut des personnes qui y résident, puisse s'opérer non par la procédure de révision du PLU, comme le prévoit le Grenelle 2, mais par celle de la révision simplifiée, beaucoup plus adaptée.
Tel est le sens de cet amendement.

Les dispositions prévues dans cet amendement n’ayant aucun lien avec le texte en discussion, la commission y est défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 29, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, les cessions des murs des fonds concernés ainsi que les cessions de parts ou actions d'une société civile ou commerciale dont l'activité principale est la gestion d'un fonds artisanal ou d'un fonds de commerce lorsque ces cessions ont pour objet un changement de secteur d'activité. » ;
La parole est à M. François Patriat.

L'article 6 procède à des aménagements intéressants.
Toutefois, en ce qui concerne le droit de préemption prévu à l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, la commission a omis de préciser que la cession des murs des commerces doit aussi pouvoir faire l'objet de ce droit de préemption, sans quoi l'ensemble de la démarche peut être voué à l'échec.
Cet amendement vise donc à remédier à cet oubli.

Les murs ne font pas partie des fonds de commerce. La préemption de ces derniers ne peut donc pas porter sur les murs, sauf à prévoir deux procédures distinctes.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 111, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le secrétaire d'État.
L'article 6 est adopté.
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour insérer les articles 1 à 6 de la présente loi dans le code de l'urbanisme. Cette codification est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
L'ordonnance prévue au présent article doit être prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Je tiens à revenir sur cet article, qui autorise le Gouvernement à prendre les mesures de codification nécessaires par voie d’ordonnance.
Tout d’abord, il est regrettable qu’un effort supplémentaire de codification n’ait pas été réalisé dans le présent texte. Faut-il rappeler que c’est au Parlement de faire la loi ? Si le sujet de l’urbanisme commercial est technique et complexe, la substantifique moelle de cette proposition de loi n’a rien de compliqué et aurait pu faire l’objet d’une codification rigoureuse au sein même de ce texte.
Il s’agit avant tout de réintégrer le droit de l’urbanisme commercial dans le code de l’urbanisme et donc de le sortir du code de commerce, le tout en rénovant la gouvernance. Ne pas présenter directement les modifications des codes sous-jacentes, n’est-ce pas finalement un bon moyen de se ménager des marges de manœuvre dans la traduction concrète de ce texte ?
C’est malheureusement devenu une habitude pour bien des textes. Déjà, l’article 25 de la loi portant engagement national pour l’environnement, la loi Grenelle 2, permet au Gouvernement de prendre des mesures par ordonnance en matière d’urbanisme, mettant ainsi le Parlement devant le fait accompli.
Pourtant, la majorité actuelle prônait, lors de la dernière réforme constitutionnelle, le rééquilibrage entre les pouvoirs et un rôle d’initiative plus important pour le Parlement. On voit aujourd’hui que tel n’est pas le cas.
C'est pourquoi notre groupe tenait à rappeler son opposition à cette pratique.
L'article 7 est adopté.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 30, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 464-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 464 -2 -1. - Lorsqu'une entreprise soumise aux dispositions du titre V du livre VII du présent code abuse de sa position dominante sur un marché local ou de sa puissance d'achat sur ce marché ou de l'état de dépendance économique d'un de ses fournisseurs sur ce marché, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise dans les conditions définies à l'article L. 464-2, enjoindre à l'entreprise de résilier les accords à l'origine du pouvoir de marché qui a permis les abus constatés ou lui imposer la cession de surfaces commerciales afin de rétablir une concurrence suffisante sur le marché local en cause. »
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

Vous l’avez compris, mes chers collègues, nous pensons que ce texte ne permettra pas de lutter contre les situations de monopole et de concentration excessive constatées dans de nombreuses zones de chalandise. Dans ces dernières, certains abus peuvent être commis.
Par exemple, les prix dans une grande surface monopolistique peuvent dépasser de près de 10 % ceux qui sont constatés sur l’ensemble de la France, ou certaines pratiques peuvent se faire jour, comme des recours abusifs, la préemption du foncier commercial disponible pour gêner l'arrivée de concurrents, des menaces sur les fournisseurs pour dissuader ces derniers de diversifier leurs canaux de distribution ou leur imposer des conditions commerciales inéquitables.
Il est donc essentiel que nous nous dotions des outils susceptibles de remettre en cause les situations acquises et non pas seulement de nature à réguler les nouvelles installations.
En cas d'abus constaté par l'Autorité de la concurrence, celle-ci devrait pouvoir garantir le rétablissement et l'accroissement de la concurrence dans la zone de chalandise concernée, de façon rapide, éventuellement en imposant une cession d'actifs sur un marché local où la trop grande concentration conduit à un affaiblissement irrémédiable de la situation concurrentielle.
Outre son effet correcteur lorsqu'elle sera mise en œuvre, cette prérogative aura, du seul fait de son existence connue des acteurs, un effet dissuasif pour prévenir les comportements abusifs.
Tel est le sens de cet amendement.

L'amendement n° 92 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 464-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 464-2-1 – Lorsqu’une entreprise soumise aux dispositions du titre V du livre VII du présent code abuse de sa position dominante sur un marché local ou de sa puissance d’achat sur ce marché ou de l’état de dépendance économique d’un de ses fournisseurs sur ce marché, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise dans les conditions définies à l’article L. 464-2, enjoindre à l’entreprise de résilier les accords à l’origine du pouvoir de marché qui a permis les abus constatés ou lui imposer la suppression de surfaces de ventes afin de rétablir une concurrence suffisante sur le marché local en cause. »
La parole est à M. Jacques Mézard.

Cet amendement vise le même objectif que l’amendement précédent.
Je le rappelle, dans le rapport de la commission, il était indiqué très clairement qu’il fallait lutter contre les situations de monopole. Ces dernières peuvent surgir en cas non seulement de nouveau projet, mais aussi de déspécialisation et de changement de destination, ce qui crée de véritables problèmes sur le terrain.
Nous pensons que le seul moyen de lutter efficacement contre ce phénomène est celui qui est proposé au travers de ces deux amendements.

Ces deux amendements n’ont aucun rapport avec le texte en discussion, qui porte sur l’urbanisme.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Cornu et Pointereau, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 214-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant le délai indiqué au premier alinéa du présent article, la commune peut réaliser un bail précaire ou mettre le fonds en location-gérance dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. »
La parole est à M. Gérard Cornu.

Cet amendement vise à rendre possible la mise en œuvre du régime de la location-gérance ainsi que du bail précaire par la commune dans l'attente de la rétrocession du fonds.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 7.
L'amendement n° 31, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - En centre-ville ou dans les zones touristiques, les commerçants et artisans peuvent se réunir au sein d'un groupement d'intérêt commercial et artisanal.
Ce groupement est fondé à l'initiative des commerçants, artisans ou des élus locaux, en concertation avec la commune, la chambre de commerce et de d'industrie ou de la chambre des métiers et de l'artisanat.
Il est consulté sur les projets de réorganisation du commerce dans la commune. Il peut proposer un schéma de développement et de stratégie commerciale. Il peut être consulté sur les projets d'urbanisme locaux. Il peut aussi dynamiser le commerce de proximité par toutes animations et initiatives.
Son fonctionnement repose sur une cotisation volontaire de ses adhérents, fixée par le conseil d'administration. Si 60 % des commerçants et artisans de la zone délimitée en concertation avec la commune adhèrent au groupement, la cotisation devient obligatoire pour tous.
II. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du I.
La parole est à M. François Patriat.

Le présent amendement tend à créer une structure professionnelle destinée, dans un périmètre défini, à permettre aux commerçants et artisans de travailler ensemble, sur le seul fondement du volontariat, en les dotant des moyens juridiques nécessaires.
L'amendement n'est pas adopté.
(Supprimé)

L'amendement n° 128, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Un décret en Conseil d’État fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d’urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinées à des commerces et ceux destinés à des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.
La parole est à M. le rapporteur.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 130, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 7 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 582-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 582-2. - Le propriétaire des murs où est exploité un commerce doit veiller à ce que ce commerce, vacant ou non, ouvert sur la voie publique, présente toujours une bonne apparence et contribue à la préservation de l’aspect et de la bonne tenue des voies fréquentées dans le respect de l’image de la ville. »
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 7 bis.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du II de l'article L. 145-2, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
2° Le titre V du livre VII est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est intitulé : « Chapitre Ier: Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce » et comprend l'article L. 750-1-1 ;
b) Les sections 1 et 2 du chapitre Ier sont abrogées ;
c) La section 3 du chapitre Ier est remplacée par un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre I er bis
« Les observatoires régionaux d'équipement commercial et l'observatoire national de l'aménagement commercial
« Art. L. 751-9. – L'observatoire national de l'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire national en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1, et notamment l'impact des implantations nouvelles et existantes sur la concurrence dans les zones de chalandise. Il met ces données à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que de l'Autorité de la concurrence. Il publie un rapport public annuel.
« Art. L. 751-10. – Les observatoires régionaux d'équipement commercial collectent les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale. » ;
d) Le chapitre II est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 762-1, les mots : « et non soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 » sont supprimés.
II. – Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : «, de l'article L. 752-1 et des textes pris pour son application » sont supprimés.
III. – Le XXIX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est abrogé.
IV. – Au 2° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, les mots : « par l'article L. 752-1 du code de commerce et » sont supprimés.
V. – Après le mot : « implantée », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation est supprimée.
VI. – À la fin du huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les mots : « au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».
VII. – Après le mot : « commercial », la fin du dernier alinéa de l'article L. 3132-25-2 du code du travail est ainsi rédigée : « situé sur leur territoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 115 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. – Aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du I de l’article L. 752-1, les mots : « de vente » sont remplacés par les mots : « hors œuvre nette ».
II. – Au I de l’article L. 752-2, les mots : « de vente » sont remplacés par les mots : « hors œuvre nette ».
III. – L’article L. 752-6 est ainsi modifié :
1° Au a du 1° de l’article L. 752-6, les mots : « l’animation urbaine, rurale et de montagne » sont remplacés par les mots : « la revitalisation des centres villes et le maintien d’une offre commerciale répondant aux besoins quotidiens des habitants » ;
2° Le b du 1° de l’article L. 752-6 est complété par les mots : « notamment au regard des enjeux de limitation des obligations de déplacement » ;
3° Le a du 2° de l’article L. 752-6 est complété par les mots : « notamment en termes de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages et de l’architecture ».
IV. – Au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 752-15, les mots : « de vente » sont remplacés par les mots : « hors œuvre nette ».
La parole est à M. le secrétaire d'État.

L'amendement n° 64, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Odette Terrade.

Il s'agit d’un amendement de cohérence avec les amendements qui visaient à maintenir les CDAC.

L'amendement n° 83 rectifié bis, présenté par M. Merceron, Mmes Gourault et Létard, MM. Deneux et Soulage, Mme Férat, M. Jarlier, Mme Morin-Desailly et MM. Amoudry et Dubois, est ainsi libellé :
Alinéa 9, deuxième phrase
Après les mots :
leurs groupements,
insérer les mots :
de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie,
La parole est à M. Jean-Claude Merceron.

L’amendement n° 83 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 72 rectifié ter, présenté par MM. Cornu, Reichardt, Pointereau, Nègre, Merceron et Chatillon, Mmes Gourault et Létard et MM. Demuynck, Bernard-Reymond, Amoudry et Dubois, est ainsi libellé :
Alinéa 9, deuxième phrase
Après les mots :
groupements, ainsi que
insérer les mots :
des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et
La parole est à M. Gérard Cornu.

L'amendement n° 36 rectifié bis, présenté par Mme Lamure, MM. Houel, Bécot, Lefèvre, Bailly, Chatillon et Revet, Mme Panis et MM. B. Fournier, Leroy et Nègre, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par seize alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 751 -10. - I. - Les observatoires régionaux d’aménagement commercial collectent les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1 du code de commerce.
« II. - L’observatoire régional d'aménagement commercial est constitué par arrêté préfectoral.
« Il a pour mission :
« 1° D'établir un inventaire des équipements commerciaux par commune, par département, par région et par taille des surfaces de vente, suivant la typologie des commerces ;
« 2° D’identifier les pôles commerciaux structurants à l’échelle de la région ;
« 3° D’élaborer tous les trois ans un rapport, rendu public.
« Le préfet installe l’observatoire régional d’aménagement commercial.
« Chacune des productions de l’observatoire régional d’aménagement commercial est transmise par le Préfet ou son représentant, aux collectivités qui élaborent et évaluent des documents d’urbanisme ainsi qu’à la Commission régionale d’aménagement commercial.
« III. - L’observatoire régional d’aménagement commercial est composé, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :
« 1° D'élus locaux ;
« 2° De représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ;
« 3° De représentants des services de l’État ;
« 4° De représentants des activités commerciales et artisanales ;
« 5° De représentants des consommateurs ;
« 6° De personnalités qualifiées.
« IV. - L’observatoire régional d’aménagement commercial dispose chaque année des sources d’informations nécessaires à la conduite de sa mission, notamment des fichiers de permis de construire. Les modalités de collecte et de traitement d’information par l’observatoire seront précisées par décret. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Cet amendement précise les missions et la composition de l’observatoire régional d’aménagement commercial.
Il tend, notamment, à modifier la dénomination de celui-ci en remplaçant les termes « d’équipement » par les termes « d’aménagement ».

L'amendement n° 65, présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
VII. - Les contreparties accordées aux salariés en raison de l'application de l'article L. 3132-25-2 du code de travail ne peuvent être inférieures, sauf accord collectif plus favorable, à une rémunération égale au moins au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et à un repos compensateur équivalent en temps.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
L'article L. 3132-25-3 du code du travail est abrogé.
La parole est à Mme Odette Terrade.

Le présent article est un article de conséquence.
L’examen de cette proposition de loi nous permettant de mener un travail sur les conditions d’implantation commerciale et leurs conséquences en termes tant urbanistiques qu’économiques, nous estimons que la dimension sociale devrait être traitée.
Aujourd’hui, force est de constater que, d’un point de vue social, ces zones de développement commercial présentent souvent des régressions caractérisées. Ainsi, le travail du dimanche y est monnaie courante. À moins de croire que le travail du dimanche constitue une amélioration des conditions de travail des salariés, il est difficile de prétendre que les objectifs fixés par cet article sont atteints.
Nous demandons donc, contrairement à ce qui se pratique à l’heure actuelle, que le travail fourni ce jour-là soit l’objet d’une rémunération égale au moins au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et à un repos compensateur équivalent en temps.
Cette disposition va dans le sens d’une amélioration des conditions de travail des salariés.

En cohérence avec la position que nous avons exprimée sur les CRAC, la commission est défavorable aux amendements n° 115 rectifié et 64.
En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 72 rectifié ter, qui a été excellemment défendu
Sourires
Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 64.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 72 rectifié ter, il s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Enfin, il est défavorable aux amendements n° 36 rectifié bis et 65.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 8 est adopté.

Nous en revenons à l’examen des amendements n° 4, 5, 2 et 3, précédemment réservés.
L'amendement n° 4, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° et à la première phrase du 2° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 300 ».
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

Madame la présidente, cet amendement concerne les critères de seuil, tout comme les amendements n° 5, 2 et 3 qui vont venir en discussion. Aussi, lorsqu’ils seront présentés, me contenterai-je de dire qu’ils sont défendus. Peut-être, à l’instar de ce qu’elle vient de faire pour l’amendement de notre collègue Gérard Cornu, la commission émettra-t-elle alors un avis favorable sur nos amendements !
À cet égard, j’aimerais faire, madame la présidente, un rappel au règlement.
En effet, la manière dont nous examinons cette proposition de loi est surréaliste, alors que celle-ci revêt une grande importance. Dans mon département, je sais qu’un certain nombre de chefs d’entreprise et d’élus sont attentifs à nos débats d’aujourd'hui. Il est donc inacceptable – je le dis avec force – que la commission veuille en finir d’un coup de torchon magique !

Je vous donne acte de votre rappel au règlement, mon cher collègue.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 4 ?

M. Dominique Braye, rapporteur. Bien que cet amendement ait été excellemment défendu
Sourires
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 5, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés ; »
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 2, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 752-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans les cœurs de villes, la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant. »
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 3, présenté par MM. Patriat, Bérit-Débat, Bourquin, Courteau et Daunis, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 752-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans les zones urbaines sensibles, la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant. »
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 212-6, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Commissions d’aménagement cinématographique
« Paragraphe 1
« Commission départementale d’aménagement cinématographique
« Art. L. 212 -6 -1. – Une commission départementale d’aménagement cinématographique statue sur les demandes d’autorisation d’aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.
« Art. L. 212 -6 -2. – I. – La commission départementale d’aménagement cinématographique est présidée par le préfet.
« II. – La commission est composée :
« 1° Des cinq élus suivants :
« a) Le maire de la commune d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ;
« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;
« c) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
« d) Le président du conseil général ou son représentant ;
« e) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation.
« Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au 1° du présent II, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d’influence cinématographique concernée ;
« 2° De trois personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.
« Lorsque la zone d’influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt.
« III. – À Paris, la commission est composée :
« 1° Des cinq élus suivants :
« a) Le maire de Paris ou son représentant ;
« b) Le maire de l’arrondissement du lieu d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ou son représentant ;
« c) Un conseiller d’arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
« d) Un adjoint au maire de Paris ;
« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d’Île-de-France ;
« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.
« La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision.
« IV. – La personnalité qualifiée en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques mentionnée aux 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur une liste établie par lui.
« Art. L. 212 -6 -3. – Tout membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique informe le préfet des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.
« Aucun membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.
« Art. L. 212 -6 -4. – Les conditions de désignation des membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Paragraphe 2
« Commission nationale d’aménagement cinématographique
« Art. L. 212 -6 -5. – La commission nationale d’aménagement cinématographique comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
« Art. L. 212 -6 -6. – La commission nationale d’aménagement cinématographique est composée :
« 1° D’un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, président ;
« 2° D’un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« 3° D’un membre de l’inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
« 4° D’un membre du corps de l’inspection générale des affaires culturelles ;
« 5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;
« 6° De trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de consommation, d’urbanisme, de développement durable, d’aménagement du territoire ou d’emploi. Le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l’urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.
« Art. L. 212-6-7. – Tout membre de la commission nationale d’aménagement cinématographique informe le président des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.
« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.
« Art. L. 212-6-8. – Les conditions de désignation des membres de la commission nationale d’aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après l’article L. 212-6, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Autorisation d’aménagement cinématographique » comprenant un paragraphe 1 intitulé : « Projets soumis à autorisation » et comprenant les articles L. 212-7 à L. 212-8 et un paragraphe 2 intitulé : « Décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique » et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 212-7, les mots : «, préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n’est pas exigé, » sont supprimés ;
4° Après l’article L. 212-8, il est inséré un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-8-1. – Les projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la commission départementale d’aménagement cinématographique qu’à la condition d’être accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 212-9, les mots : « commercial statuant en matière » sont supprimés ;
6° L’article L. 212-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-10. – L’instruction des demandes d’autorisation est faite par les services déconcentrés de l’État. » ;
7° Après l’article L. 212-10, sont insérés deux articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 et un paragraphe 3 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-10-1. – I. – La commission départementale d’aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
« Le préfet ne prend pas part au vote.
« II. – La commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
« Les membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d’autorisation déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.
« La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.
« Art. L. 212 -10 -2. – L’autorisation d’aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé.
« L’autorisation est accordée pour un nombre déterminé de places de spectateur.
« Une nouvelle demande d’autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de places de spectateur. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
« L’autorisation d’aménagement cinématographique n’est ni cessible ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue.
« Paragraphe 3
« Recours contre la décision de la commission d’aménagement cinématographique
« Art. L. 212-10-3. – À l’initiative du préfet, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l’article L. 212-6-2, de celui visé au e du même 1° ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la commission nationale d’aménagement cinématographique. La commission nationale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
« La saisine de la commission nationale d’aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.
« Art. L. 212-10-4. – Avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale d’aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise, et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d’assiette auprès de la commission départementale d’aménagement cinématographique.
« Art. L. 212-10-5. – Le maire de la commune d’implantation membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique dont la décision fait l’objet du recours est entendu, à sa demande, par la commission nationale d’aménagement cinématographique.
« Art. L. 212-10-6. – Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la commission nationale d’aménagement cinématographique.
« Art. L. 212-10-7. – Le président de la commission nationale d’aménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. L. 212-10-8. – En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d’autorisation par la commission nationale d’aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
« Art. L. 212-10-9. – Les commissions d’aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
« Lorsqu’une autorisation s’appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique présenté par le pétitionnaire, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l’article L. 212-23.
« Art. L. 212-10-10. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ;
8° Après l’article L. 212-10, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;
9° Avant l’article L. 212-11, il est inséré un article L. 212-10-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-10-11. – Les agents du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l’exploitation illicite d’un nombre de places de spectateur, au regard de la présente section, établissent un rapport qu’ils transmettent au préfet du département d’implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques.
« Le préfet peut mettre en demeure l’exploitant concerné de ramener le nombre de places de spectateur à l’autorisation d’aménagement cinématographique accordée par la commission d’aménagement cinématographique compétente dans un délai d’un mois. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l’établissement exploité illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.
« Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues au deuxième alinéa.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Les demandes d’autorisation déposées en application de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.
Les membres de la commission nationale d’aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d’aménagement cinématographique à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent membres de la commission nationale d’aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.

L'amendement n° 66, présenté par M. Ralite, Mmes Gonthier-Maurin et Labarre, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 17 à 19
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° De trois personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, dont un représentant des salles classées art et essai, un représentant des petites et moyennes exploitations et un représentant de la grande exploitation. Ces personnalités sont nommées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
« ...° D'un représentant de l'Agence pour le développement régional du cinéma.
II. - En conséquence, alinéas 27 à 29
Procéder au même remplacement.
La parole est à Mme Odette Terrade.

Madame la présidente, si vous le permettez, je présenterai brièvement les amendements n° 66 et 67 en même temps.
En effet, ces deux amendements visent à assurer une représentation plurielle des professionnels du cinéma au sein tant de la commission départementale d’aménagement cinématographique que de la commission nationale d’aménagement cinématographique.
Nous souhaitons que soient représentées, parmi les personnalités qualifiées nommées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC, les salles classées « art et essai », les petites et moyennes exploitations, ainsi que les grandes.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 67, présenté par M. Ralite, Mmes Gonthier-Maurin et Labarre, MM. Renar, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 35, première phrase
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
neuf
II. - Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° De trois personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques dont un représentant des salles classées art et essai, un représentant des petites et moyennes exploitations et un représentant de la grande exploitation. Ces personnalités sont proposées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et désignées par le ministre chargé de la culture. »
La parole est à Mme Odette Terrade.

L'amendement n° 120, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 35
1° Première phrase
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
neuf
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéas 78 à 82
Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :
9° Après l’article L. 414-3, il est inséré un article L. 414-4 ainsi rédigé :
« – Les agents mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l’exploitation illicite d’un nombre de places de spectateur, au regard des dispositions de l’article L. 212-10-2, établissent un rapport qu’ils transmettent au préfet du département d’implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné. »
10° Après le chapitre IV du titre II du livre IV, il est inséré une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre V
« Dispositions particulières relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques
« . – Le préfet peut, dans un délai d’un mois après réception du rapport mentionné à l’article L. 414-4, mettre en demeure l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de places de spectateur au nombre figurant dans l’autorisation d’aménagement cinématographique accordée par la commission d’aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l’établissement exploité illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
11° Après le chapitre III du titre III du livre IV, il est inséré une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre IV
« Infractions aux dispositions relatives à l’implantation des établissements de spectacles cinématographiques
« . – Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues à l’article L. 425-1. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.
Il s’agit d’un amendement de clarification rédactionnelle, tendant à réorganiser l’écriture, à droit constant, d’un certain nombre d’articles.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 67.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 8 bis est adopté.

L'amendement n° 34, présenté par MM. Lagauche, Botrel, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 8 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « La commune » sont insérés les mots : « ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre »
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

Cet amendement vise à permettre aux établissements publics de coopération intercommunale de subventionner notamment des cinémas situés en milieu rural, ce qui leur est impossible de faire à l’heure actuelle.
Cet amendement, qui est proposé par notre collègue Serge Lagauche, me semble important pour développer l’attractivité d’une ville et le maillage culturel d’un pays.
C’est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à le voter.

Cet amendement étant sans rapport avec ce texte relatif à l’urbanisme commercial, la commission y est défavorable.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
I. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application de la présente loi et précise sa date d’entrée en vigueur qui intervient, au plus tard, un an après sa promulgation.
II. – Les demandes d’autorisation déposées en application du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt –
Adopté.

Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. François Patriat, pour explication de vote.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sommes parvenus, à un rythme effréné, au terme de l’examen de ce texte.
Au lieu de régler les problèmes posés par l’application des dispositions de la loi LME sur les territoires, cette proposition de loi conforte, en fin de compte, la dérégulation complète du secteur.
En effet, en assimilant l’autorisation d’implantation à un simple permis de construire, vous interdisez aux responsables locaux tout pouvoir d’orientation et de régulation commerciale, au risque de créer de véritables zones d’anarchie d’implantation.
Nos entrées de ville sont déjà passablement meurtries par l’abandon et le laisser-aller dont elles ont été victimes pendant des années. Il nous faut désormais de la planification et des règles, et c’est ce qui fait défaut.
Les sénateurs socialistes, comme bien d’autres parlementaires, vous ont proposé, mes chers collègues, des amendements de raison pour, d’une part, instaurer une réelle régulation au travers d’une procédure d’instruction sécurisée dans le cadre des plans locaux d'urbanisme et des schémas de cohérence territorial et, d’autre part, permettre aux maires et présidents d’intercommunalités de disposer des outils nécessaires pour prévenir les situations de monopole et de mono-activité sur un territoire.
Lorsque nous parlons de « concurrence régulée », vous entendez « interdiction », et vous nous accusez d’être opposés à la liberté de commercer. Or poser des règles pour prévenir des abus n’équivaut pas à interdire.
Si l’on veut lutter contre les monopoles, il faut pouvoir aider les maires à agir en ce sens, ce que cette proposition de loi ne permet pas.
Concernant les textes européens, vous les utilisez comme argument pour ne rien faire. Pourtant, ils nous autorisent à faire mieux au nom de l’intérêt général, que vous n’avez pas pris en compte. Mais peut-être n’avons-nous pas la même vision de l’intérêt général et des moyens à mobiliser pour le bien de la collectivité ?
Avec cette proposition de loi, vous prenez le risque de plonger les élus locaux dans le désarroi le plus total. Nous doutons de l’efficacité des solutions que vous nous proposez. À l’origine, ce texte avait un objectif louable ; au final, il ne résoudra rien.
Nous vous avons proposé des solutions : à 99, 99 %, vous les avez toutes rejetées ! Nous voterons donc contre cette proposition de loi, tout en constatant avec satisfaction que bon nombre de nos collègues qui appartiennent à la majorité commencent à ressentir et comprendre les méfaits de la loi LME.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le texte qui est soumis à notre vote constitue une avancée majeure en matière de réglementation des implantations commerciales.
On peut se satisfaire de la suppression des autorisations commerciales et de l’insertion de la réglementation des implantations commerciales dans le droit de l’urbanisme.
En inscrivant les objectifs et en conditionnant certaines implantations commerciales à certaines « prescriptions » d’urbanisme dans les documents d’aménagement commercial, on donne la possibilité aux élus, grâce à de nouveaux outils, de maîtriser le développement anarchique des zones commerciales qui enlaidissent nos entrées de ville.
Je salue l’un des rares apports de notre discussion en séance publique, consistant à laisser aux SCOT le soin de localiser les aires d’implantations commerciales et aux PLU, lorsqu’ils existent, de les délimiter. Cela permet de redonner aux maires, dans le cadre des PLU, la maîtrise de l’organisation commerciale.
Parce que les implantations urbaines ne sont soumises qu’aux objectifs du DAC, alors que les zones périurbaines font l’objet de prescriptions plus strictes, nous saluons également l’apport de ce texte dans la revitalisation de nos centres-villes.
Les élus disposent désormais d’une boîte à outils plus complète.
Certes, ils avaient déjà, depuis quarante ans, des outils efficaces, comme les POS, les PLU et les seuils d’autorisation, qui leur permettaient de réguler les implantations commerciales. Mais ce n’est pas tant les outils que leur sous-utilisation par les élus qui les ont rendus si peu efficaces face à l’enlaidissement des entrées de ville.
En résumé, la qualité des entrées de ville et leurs fameuses « boîtes à chaussures » devraient changer avec ces nouveaux outils réglementaires, à condition que les élus s’en emparent et ne se décident pas uniquement en fonction de considérations fiscales. C’est pour cette raison que nous avons souhaité aller plus loin, en favorisant la réflexion des élus avant qu’ils n’opèrent un choix, afin d’améliorer la portée pratique de la loi.
Mais, face à des objectifs qu’elle semblait partager – je pense en particulier à la nécessité de faciliter et non pas de compliquer la bonne exécution du texte à l’échelon local –, la commission, notamment son rapporteur, s’est montrée fermée à la discussion. J’espérais au moins une ouverture en séance publique.
J’ajoute qu’un sujet de cette importance aurait mérité que nous y consacrions plus de temps, et je regrette la précipitation dans laquelle nos débats se sont déroulés.
De ce fait, le texte est encore imparfait. Heureusement, l’esprit qui l’anime en sauve les imperfections, et c’est pour cette raison que nous le voterons.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, au regard de l’ampleur des débats auxquels a donné lieu l’examen de cette proposition de loi, nous ne pouvons qu’en déduire qu’il était urgent de revenir sur les questions d’urbanisme commercial, à la suite de l’adoption de la loi LME de 2008.
À ce titre, je dois dire, une nouvelle fois, notre satisfaction de voir que le constat d’échec de cette loi est partagé sur plusieurs travées de cet hémicycle. À l’époque, le groupe CRC-SPG, qui faisait déjà une telle analyse, se sentait un peu seul.
Cette proposition de loi part d’une bonne intention, celle de réintroduire l’urbanisme commercial dans le droit commun de l’urbanisme, en supprimant le système de double autorisation administrative, et de renforcer le rôle des élus en matière d’urbanisme commercial.
Pour autant, aucune de ces dispositions ne permettra de répondre concrètement au développement anarchique des zones commerciales, sources de nuisances, de pollutions et d’un modèle de développement inverse de celui que nous prônons.
Ainsi, pour ne prendre qu’un seul exemple, nous regrettons amèrement qu’aucun des amendements tendant à abaisser les seuils d’autorisation à 300 mètres carrés, voire à 500 mètres carrés, n’ait été adopté. Voilà une disposition qui aurait pourtant permis aux élus de reprendre la main.
De plus, comme l’a souligné M. le rapporteur, il ne faut pas oublier que ce sont les contraintes européennes visant à instaurer une concurrence « libre et non faussée » qui ont conduit le législateur, au travers des lois qui se sont succédé, à retirer aux élus leur pouvoir en matière d’urbanisme commercial, notamment leur capacité à exercer une sorte de test économique avant l’implantation des commerces. Là encore, nous déplorons que notre assemblée n’ait pas remis en cause la pertinence de cet objectif.
Bien pis, les avancées significatives proposées par M. le rapporteur en matière de localisation préférentielle des commerces selon leur typologie ont été accueillies par des amendements de suppression émanant de nos collègues de la majorité sénatoriale et du Gouvernement.
Sur le fond, nous considérons que ce texte s’inscrit tout à fait dans le cadre de la réforme territoriale visant à dévitaliser les institutions démocratiques de proximité que sont les communes ou les départements, et ce de deux manières : d’une part, et malgré les efforts de M. le rapporteur, en faisant du SCOT un « super PLU commercial » et, d’autre part, en supprimant les commissions départementales d’aménagement commercial. Vous le savez, nous combattons ces réformes qui ont pour seul objectif d’éloigner les citoyens des lieux de pouvoir et de décision.
Nous restons, pour notre part, très attachés à l’échelon communal, notamment en ce qui concerne très précisément le droit des sols. Ainsi, nous estimons que la compétence du PLU ne peut être transférée qu’avec l’accord des conseils municipaux et qu’aucun autre document d’urbanisme ne devrait pouvoir identifier de manière parcellaire la destination des sols. À ce titre, je le répète, nous prenons acte des efforts accomplis par M. le rapporteur pour présenter une disposition plus acceptable.
Toutefois, en dépit des avancées réalisées, nous considérons que ce texte contribue à la mise en place de la réforme des collectivités territoriales. Et c’est pour cette unique raison que les sénateurs du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche ne pourront pas lui accorder leurs voix. Nous voterons donc contre cette proposition de loi.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, au cours de la discussion générale, nous avons souligné qu’il nous paraissait tout à fait positif de vouloir s’acheminer vers une autorisation administrative unique, le permis de construire. De ce postulat, un certain nombre d’objectifs pouvaient recueillir un consensus assez large. En outre, nous avons noté la volonté affichée par la commission dans son rapport de lutter contre les monopoles.
Au terme de l’examen de cette proposition de loi, nous sommes conduits à formuler une conclusion toute différente. D’ailleurs, à l’instar de mon collègue Claude Bérit-Débat, je déplore la manière dont les débats se sont déroulés et regrette que nous nous soyons heurtés à un mur de béton – c’est le cas de le dire !
En conséquence, au regard tant des souhaits que nous avons formulés, en particulier en matière de lutte contre les monopoles, que des préconisations techniques prévues dans ce texte mais qui nous semblent strictement inapplicables sur le terrain, le groupe du RDSE, dans sa très grande majorité, s’abstiendra.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
La proposition de loi est adoptée.

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au prix du livre numérique.
La liste des candidats établie par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : M. Jacques Legendre, Mmes Colette Mélot, Catherine Dumas, Catherine Morin-Desailly, MM. David Assouline, Serge Lagauche et Jack Ralite.
Suppléants : M. Jean-Pierre Leleux, Mmes Lucienne Malovry, Marie-Thérèse Bruguière, Françoise Férat, Françoise Cartron, M. Claude Bérit-Débat et Mme Françoise Laborde.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 5 avril 2011 :
À neuf heures trente :
1. Questions orales.
À quatorze heures trente et le soir :
2. Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la bioéthique (n° 304, 2010-2011).
Rapport de M. Alain Milon, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 388, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 389, 2010-2011).
Avis de M. François-Noël Buffet, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 381, 2010-2011).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à dix-huit heures cinq.