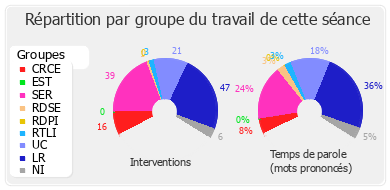Séance en hémicycle du 4 juillet 2018 à 14h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Candidature à une commission
- Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (voir le dossier)
- Discussion en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission (voir le dossier)
- Communication relative à des commissions mixtes paritaires
- Lutte contre les violences sexuelles et sexistes
La séance
La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

J’informe le Sénat qu’une candidature pour siéger au sein de la commission des lois a été publiée.
Cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (projet n° 487, texte de la commission n° 590, rapport n° 589, rapport d’information n° 574).
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d’État.
M. le président de la commission des lois, Mme la rapporteur, ainsi que M. François Patriat applaudissent.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois – cher Philippe Bas –, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes – chère Annick Billon –, madame la rapporteur – chère Marie Mercier –, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, le projet de loi dont nous allons débattre aujourd’hui, qui a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, est le fruit d’un long travail engagé bien avant l’élection du Président de la République. En effet, lors de sa campagne, il avait pris l’engagement de faire de l’égalité entre les femmes et les hommes la grande cause nationale de son quinquennat.
Cette promesse a été tenue dès le discours prononcé le 25 novembre dernier intronisant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles subies quotidiennement par des millions de femmes comme première priorité de cette grande cause quinquennale.
Ce projet de loi constitue une réponse, que je crois efficace et concrète, aux attentes exprimées cet automne, lors du tour de France de l’égalité, la plus grande consultation citoyenne jamais organisée par un gouvernement, avec plus de 830 ateliers sur l’ensemble du territoire. Aussi, je voudrais de nouveau devant vous remercier les 55 000 participantes et participants qui ont contribué à enrichir le projet du Gouvernement, faisant de ce texte la première grande loi citoyenne du quinquennat.
Malgré les avancées enregistrées au cours des deux dernières décennies, les statistiques restent désespérément stables d’année en année. Pire encore, en dépit du récent mouvement que l’on a appelé de libération de la parole ou de libération de l’écoute, la réalité et l’ampleur de ces violences sont certainement toujours sous-estimées, notamment parmi les plus jeunes d’entre nous. Pour des enfants, parler des violences dont ils sont victimes et être assurés qu’on les croira lorsqu’ils les dénoncent reste bien trop souvent insurmontable.
Je note par ailleurs que l’absence de données fiables relatives aux violences sexuelles commises sur les hommes montre bien le poids du tabou ou du déni qui contribue à rendre ces actes indicibles, et donc invisibles.
Le temps de l’omerta est révolu et il est de notre responsabilité collective de faire reculer toutes ces formes de violence. Je sais que toutes et tous, ici, vous partagez cette conviction, et c’est avec détermination et humilité que le Gouvernement présente aujourd’hui devant la Haute Assemblée ce projet de loi.
Je ne peux pas ne pas évoquer ici, au Sénat, devant vous, la mémoire de Jean-Claude Boulard, qui fut sénateur, et qui nous a quittés voilà quelques semaines. Il m’a fait entrer en politique et je puis témoigner du fait qu’il avait, chevillée au corps, la conviction de l’utilité du bicamérisme, puisqu’il disait, permettez-moi de le citer : « Lorsque j’écris un texte, je le fais toujours lire deux fois par deux groupes différents de personnes, parce qu’on est toujours plus intelligent à plusieurs que seul. »
Applaudissements.
Merci pour lui !
Je tiens à saluer la qualité de vos travaux sur ce sujet sensible ; elle illustre notre souci commun de défendre l’intérêt des plus vulnérables.
Je crois que le point commun de vos travaux et des nôtres, c’est qu’ils sont fondés sur le même constat : trop peu d’agresseurs sont poursuivis et sanctionnés. Alors que 10 % des victimes de violences sexuelles portent plainte, il y a urgence à agir pour renforcer leur protection et garantir l’exercice de leurs droits.
Chacun sait ici l’importance de ces objectifs qui nous réunissent : mieux prévenir les violences, bien sûr, mieux protéger les victimes et, en ce qui concerne ce projet de loi, mieux sanctionner les agresseurs.
Nous avons naturellement des divergences sur les moyens de répondre à ces exigences, mais je ne doute pas une seconde de votre engagement pour faire en sorte que nous parvenions ensemble à un texte qui soit le plus efficace possible.
Je voudrais d’ailleurs souligner que nos propositions présentent certaines similitudes. C’est le cas, par exemple, sur l’allongement des délais de prescription à trente ans, sur l’extension de la surqualification d’inceste aux victimes majeures, sur l’aggravation des sanctions encourues pour l’atteinte sexuelle. Il m’apparaît que, au-delà de certaines divergences d’opinion légitimes, il y a des dispositions sur lesquelles nous pourrons nous rejoindre au cours des débats.
Le texte que vous allez examiner, qui a été amélioré en première lecture par l’Assemblée nationale, est, je le crois, un texte fort permettant de mieux protéger les victimes de violences sexistes et sexuelles, notamment parce qu’il apporte des réponses juridiques fortes à des réalités qui, trop longtemps, sont restées dans les angles morts des politiques publiques. Je pense ici à la disposition visant à sanctionner le harcèlement dit « de rue ».
Lors de sa campagne, le Président de la République s’était engagé sur ce sujet, répondant à l’attente très forte exprimée par nos concitoyens et, bien sûr, par nos concitoyennes. Je rappelle qu’une étude très récente de l’IFOP nous a appris que 8 jeunes femmes sur 10 ont peur de sortir seules dans la rue le soir, en France, en 2018… Et je me permets de vous avouer ici mon étonnement de constater que cette mesure tant attendue ne fait pas consensus, ou du moins semble ne pas faire consensus dans cet hémicycle. En effet, au terme des débats qui ont déjà eu lieu, il semblerait que vous ne partagiez pas l’avis du Gouvernement sur l’importance de sanctionner ces agissements subis chaque jour par des millions de personnes, quels que soient leur genre, leur orientation sexuelle ou leur identité.
Vous proposez de faire du harcèlement de rue un délit. Je m’interroge sur ce choix, car je crois, mais nous en débattrons, que cela n’est pas applicable. J’ai en tête l’échec de la loi belge, qui a bien montré les limites de ce type de dispositif, avec seulement trois plaintes déposées, toutes classées sans suite. Ne refaisons pas les mêmes erreurs et soyons pragmatiques pour être efficaces.
C’est pour cette raison que le Gouvernement a choisi de proposer une nouvelle infraction, celle de l’outrage sexiste, qui pourra être sanctionnée par une contravention en flagrance par les 10 000 policiers de la sécurité du quotidien. Je regrette que nous ne puissions pas débattre de cette proposition aujourd’hui dans l’hémicycle.
Sincèrement, je trouve dommage de réduire cette question, c’est-à-dire la lutte contre l’insécurité spécifique vécue par les femmes, qui est, de mon point de vue, majeure, à une simple question de procédure. C’est d’autant plus regrettable que nous partageons la même conviction. Oui, les relations entre les femmes et les hommes peuvent s’établir en confiance, doivent s’établir en confiance ; il est de notre responsabilité de permettre le respect mutuel que chacun mérite, femme ou homme, et ce partout dans la société, à commencer par l’espace public, où chacune et chacun doit pouvoir être libre d’aller et de venir sans crainte.
Ce respect mutuel doit aussi être garanti sur Internet. C’est pourquoi nous proposons de mettre fin à ce sentiment d’impunité que peuvent ressentir des agresseurs en ligne se cachant derrière l’écran et derrière l’anonymat pour donner libre cours à la misogynie.
Les jeunes sont massivement touchés par ces violences en ligne, mais pas uniquement eux : plus de trois quarts des adolescents ne savent pas comment réagir face au cybersexisme -76 %, selon l’étude du Centre Hubertine Auclert.
Il nous faut répondre de manière forte à ce phénomène, qui est aussi destructeur dans le monde virtuel que dans le monde réel. Toutes ces formes de violence qui se développent dangereusement doivent être sanctionnées. Tel est l’objet de l’article 3 du projet de loi, qui tend à adapter notre arsenal juridique à ces nouvelles possibilités qu’Internet offre aux agresseurs.
Cet article vise particulièrement les « raids numériques », c’est-à-dire la publication par plusieurs personnes différentes de propos sexistes et violents, proférés à l’encontre d’une même cible. Une telle forme de violence n’entre pas aujourd’hui dans les définitions actuelles du harcèlement, qui est constitué par la répétition de faits par une même personne.
L’article 3 du projet de loi va donc élargir la définition du harcèlement pour y intégrer cette notion de concertation et punir désormais ces raids numériques qui, jusqu’à présent, contribuaient à donner le sentiment qu’Internet pouvait être une zone de non-droit, ce que nous ne pouvons pas tolérer.
Nous voulons donc envoyer un message clair aux harceleurs en ligne, à ceux qui incitent ou prennent part à ces opérations de déferlement de haine en ligne, en disant qu’elles seront désormais clairement punies par la loi.
À l’occasion de la première lecture de ce projet de loi au Sénat, le Gouvernement souhaite réaffirmer sa volonté d’adapter la répression aux nouvelles formes que les violences sexuelles et sexistes peuvent prendre. Avec la garde des sceaux, Nicole Belloubet, nous avons donc souhaité soumettre à la discussion d’autres sujets d’une importance croissante dans le débat public et proposé un certain nombre de mesures.
La première mesure, adoptée sur l’initiative des députés de la majorité, vise à réprimer le fait d’utiliser une substance portant atteinte à l’intégrité de la victime ou d’abuser de l’état d’ivresse dans lequel elle se trouve. De tels agissements constitueront désormais une circonstance aggravante des infractions sexuelles.
La limite, c’est le consentement, et il n’est pas tolérable en France, en 2018, que cette notion de consentement ne soit pas universelle. C’est pourquoi nous proposons que le fait d’administrer, à l’insu de la victime, une substance qui vise à altérer son discernement devienne un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, et de sept ans d’emprisonnement quand les victimes sont des personnes vulnérables.
La deuxième disposition que nous vous proposons d’étudier consiste à réprimer les photos prises « sous les jupes des filles », ce qui comble un vide juridique, encore une fois. Elle vise à sanctionner la captation d’images, dites « impudiques », à l’insu de la personne. C’est un phénomène trop répandu, en hausse, notamment dans les transports en commun. Ce sujet nous est remonté au cours des échanges que nous avons continué à mener depuis la présentation du projet de loi, et qui sont venus enrichir notre réflexion.
Ces faits de voyeurisme ne sont pas réprimés aujourd’hui. Comme le cyberharcèlement, comme le harcèlement de rue, ils n’entrent pas aujourd’hui dans les infractions existantes. Nous proposons donc de créer un nouveau délit, puni de un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende en cas de circonstances aggravantes.
Quelle que soit la manière dont elles s’exercent, ces violences sexistes et sexuelles ont un impact considérable sur la vie des victimes, de l’angoisse éprouvée quotidiennement dans une rue, parfois déserte, sur le chemin du travail, jusqu’aux psychotraumas les plus sévères. On sait aujourd’hui que les viols causent des traumatismes similaires à ceux qui sont consécutifs à des actes de torture.
Les conséquences des violences sexuelles sur la santé physique et mentale sont d’autant plus graves que les victimes sont jeunes. C’est la raison pour laquelle, comme l’évoquera, je pense, ma collègue garde des sceaux, deux des quatre dispositions de notre projet de loi concernent les infractions sexuelles commises sur mineur.
L’allongement à trente ans du délai de prescription applicable aux crimes commis à l’encontre des mineurs est un rouage essentiel d’une meilleure protection des plus vulnérables. Votre assemblée semble partager cette conviction, ce dont je ne peux que me réjouir.
Je sais que la dernière réforme de la prescription est récente, avec la loi Fenech-Tourret de 2017, mais l’évolution que nous proposons est nécessaire, je le crois, pour mieux prendre en compte la difficulté des victimes à révéler les faits, notamment en raison du phénomène d’amnésie traumatique, mais aussi à cause de la difficulté de verbaliser et de judiciariser ces faits.
Je suis donc heureuse que nous fassions le même constat, conformément aux recommandations de la mission de consensus menée l’an dernier, sous la direction de Flavie Flament et de Jacques Calmettes, sur l’initiative de ma prédécesseure, la sénatrice Laurence Rossignol, que je salue.
Nous souhaitons cependant rétablir par voie d’amendement l’allongement du délai de prescription applicable à l’ensemble des crimes sur mineurs, dont le meurtre, par souci de cohérence et pour faciliter l’exercice de poursuites judiciaires de nombreuses années après les faits.
Nous vous proposons même d’améliorer encore cette disposition afin d’éviter l’impunité des personnes qui commettent, pendant de très longues périodes, ces crimes sur des mineurs, de façon répétée. Ainsi, pour éviter que les faits les plus anciens ne soient prescrits, nous proposons que la commission de nouveaux crimes interrompe la prescription des crimes les plus anciens. Il peut s’agir, par exemple, de faits d’inceste commis sur plusieurs générations.
Notre droit, je le crois, doit reconnaître l’exceptionnelle gravité des crimes qui sont commis sur les mineurs. C’est pourquoi non seulement nous créons des conditions plus favorables à la libération de la parole des victimes, mais encore nous renforçons cet arsenal juridique.
Nous souhaitons donc renforcer la protection des mineurs et mieux sanctionner leurs agresseurs.
Vous connaissez la position du Gouvernement à l’égard des modifications apportées à l’article 2, dont la rédaction avait été précisée et améliorée par l’Assemblée nationale, et dont l’objectif unique est bien d’éviter au maximum les acquittements des auteurs d’infractions sexuelles.
À cet égard, je voudrais d’abord souligner l’importance du maintien du caractère interprétatif de la première disposition de l’article 2, qui permet d’échapper à la non-rétroactivité de la loi pénale. Ainsi, le juge pourra s’en saisir dès la promulgation de la loi pour toute affaire, y compris en cours, ce qui peut concerner des millions de victimes du fait de l’allongement des délais de prescription. C’est le caractère interprétatif de l’article qui permet justement cela.
Je souhaite rappeler que nous nous rejoignons, me semble-t-il, mais les débats nous le dirons, sur la nécessité d’affirmer qu’un mineur en dessous d’un certain âge n’est jamais consentant à un acte sexuel avec un majeur. Il s’agit là, je le pense, d’un véritable enjeu de civilisation. Nous en sommes toutes et tous convaincus.
Pour autant, vous connaissez nos réserves sur votre proposition d’instaurer une présomption de contrainte, qui est une option présentant, de notre point de vue, des risques d’inconstitutionnalité. C’est ce que nous a démontré le Conseil d’État.
Enfin, nous partageons votre souci d’améliorer les modalités de la mise en œuvre de la question subsidiaire. Comme l’a rappelé le président de votre commission des lois, Philippe Bas, le Sénat prend le temps du travail, de la réflexion, et, même si ce point semble être un détail, son importance juridique est essentielle.
J’en viens à l’un des points importants de notre discussion. Depuis plusieurs mois, un certain nombre d’associations de protection de l’enfance, mais aussi de professionnels du droit, de la santé, ou de travailleurs sociaux nous interpellent et échangent avec nous sur les risques que pourrait présenter la disposition relative à l’augmentation des peines encourues pour atteinte sexuelle avec pénétration.
Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, vous avez relayé les mêmes préoccupations et vous avez fait le choix, lors de vos travaux en commission, de supprimer cette mesure proposée par le Gouvernement dans le but d’éviter des acquittements.
Je suis heureuse de vous annoncer que, fidèles à l’esprit de concertation qui nous a animés tout au long de l’élaboration de notre projet de loi, nous avons écouté et entendu ces inquiétudes pour finalement prendre en compte les réserves exprimées, y compris par les sénatrices et les sénateurs.
Aussi, parce qu’il ne veut pas brouiller le message que porte ce texte, le Gouvernement a fait le choix de ne pas réintroduire cette disposition lors de la première lecture au Sénat, et nous ne le ferons pas non plus à l’occasion des prochaines discussions de ce texte. Nous suivons donc les avis que vous avez souhaité rendre et les dispositions que vous avez souhaité prendre en commission des lois du Sénat.
Ce choix, je le crois, c’est celui de la cohérence et de la raison. Nous voulons toutes et tous mieux protéger tous les enfants, et nous ne voulons pas prendre le risque, si infime soit-il, d’envoyer un mauvais message aux agresseurs ou d’exposer ne serait-ce qu’une seule victime à la possibilité d’une déqualification du crime qu’elle aurait subi.
Nous pensions que cette disposition était utile ; après vous avoir écoutés, nous avons donc décidé, Mme Belloubet et moi-même, de nous en remettre à la sagesse de votre assemblée.
Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, dimanche dernier, une figure du combat pour les droits des femmes est entrée au Panthéon, après être entrée dans l’histoire de notre pays comme dans le cœur des Françaises et des Français.
Lors de nos débats, nous essaierons de nous montrer dignes de l’héritage que nous a légué Simone Veil, particulièrement à nous, les femmes.
Simone Veil disait souvent qu’il suffit d’écouter les femmes. C’est dans cet état d’esprit, à l’écoute, que nous entendons nous placer lors des débats que nous aurons ensemble. Je crois que nous pourrons alors collectivement être fiers d’agir en faveur des droits des femmes, à l’heure où, insidieusement, ils sont remis en cause, partout dans le monde, mais aussi, ne l’oublions pas, à notre porte.
Essayons d’être à la hauteur de l’attente de nos concitoyennes et de nos concitoyens, à la hauteur de notre ambition commune de mieux prévenir, de mieux sanctionner toutes ces formes de violence qui procèdent toujours de la volonté de soumettre, de détruire l’autre en instrumentalisant son corps, qu’il s’agisse d’une femme, d’un enfant, et même d’un homme.
Faisons en sorte aujourd’hui, partout, à chaque instant, que toutes et tous soient mieux protégés, que les agresseurs soient davantage condamnés et que le signal envoyé par la République française soit extrêmement clair à cet égard : nous nous tenons avec les victimes, pour la condamnation des agresseurs.
Au-delà des clivages, il nous appartient à toutes et à tous d’en faire un moment marquant d’une avancée de notre droit et de l’Histoire.
Applaudissements sur les travées du groupe La République en Marche, du groupe Union Centriste, du groupe Les Républicains et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois – cher Philippe Bas –, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes – chère Annick Billon –, madame la rapporteur – chère Marie Mercier –, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je vais reprendre les éléments que ma collègue Marlène Schiappa vient d’évoquer devant vous, s’agissant d’un texte que nous portons conjointement.
La lutte contre les violences sexistes et sexuelles constitue pour le Gouvernement une politique prioritaire des années à venir. Ce texte en est la traduction concrète.
Ses dispositions répondent à la volonté ferme, exprimée par le Président de la République dans son discours du 25 novembre dernier, de mobiliser l’ensemble de nos moyens pour que, sur le sujet des violences faites aux femmes et aux enfants, désormais « la honte change de camp ».
Le texte que nous portons, dans sa version enrichie par les apports des députés qui l’ont adoptée le 16 mai dernier, doit permettre d’améliorer très significativement notre arsenal législatif répressif concernant les violences faites aux femmes et aux enfants.
Quels sont les objectifs du texte ? Comme Mme Schiappa vient de le préciser, il s’articule autour de quatre articles.
En premier lieu, s’inspirant de l’excellent rapport de la mission de consensus Flament-Calmettes, l’article 1er allonge le délai de prescription de l’action publique des crimes de nature sexuelle ou violente commis sur les mineurs, en le faisant passer de vingt ans à trente ans à compter de la majorité de ces derniers. Cette modification est apparue indispensable afin de laisser davantage de temps aux victimes pour porter plainte et faciliter la répression de ces actes, notamment lorsqu’ils sont incestueux.
Cet allongement de la prescription, il faut le souligner, est tout d’abord cohérent avec l’augmentation générale des délais de prescription, telle qu’elle a été opérée par la loi du 27 février 2017. Avant cette réforme, qui a porté le délai de prescription de dix ans à vingt ans pour l’ensemble des crimes, le délai de prescription des crimes sexuels sur mineurs était déjà de vingt ans, donc plus long que celui de la prescription de droit commun. Il n’est donc pas absurde de rétablir une différence temporelle qui préexistait entre la prescription des crimes de droit commun et celle des crimes sexuels sur mineurs.
Cet allongement est ensuite essentiel pour donner aux victimes le temps nécessaire à la dénonciation des faits, en prenant notamment en compte les mécanismes de la mémoire traumatique, et éviter ainsi l’impunité de leurs auteurs. Le délai de trente ans commençant à courir à compter de la majorité de la victime, il permettra ainsi à cette dernière de révéler les faits jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de quarante-huit ans, au lieu de trente-huit ans actuellement.
À l’Assemblée nationale, plusieurs amendements prévoyant l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur des mineurs ont été écartés par les députés, conformément à la demande du Gouvernement, compte tenu notamment du risque très élevé de censure constitutionnelle. En effet, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 22 janvier 1999 sur le traité portant statut de la Cour pénale internationale, n’a admis l’imprescriptibilité que pour les crimes « touchant l’ensemble de la communauté internationale », ce qui n’est pas le cas des crimes commis à l’encontre des mineurs, en dépit de leur extrême gravité.
L’article 2 prévoit l’introduction de trois mesures relatives à la caractérisation des infractions sexuelles afin de répondre à l’incompréhension suscitée par des affaires judiciaires récentes dans lesquelles des fillettes de onze ans ont, du moins dans un premier temps, été considérées comme ayant consenti à des rapports sexuels avec des hommes majeurs.
Tout d’abord, en matière de viol et d’agression sexuelle, l’article 2, tel qu’il a été modifié par l’Assemblée nationale, complète l’article 222-22-1 du code pénal afin de préciser : « Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale […] ou la surprise […] sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ».
Ensuite, en matière d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, cet article double les peines encourues, à hauteur de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, lorsqu’un acte de pénétration sexuelle a été commis par le majeur.
Enfin, l’article 2 prévoit qu’en cas de comparution devant la cour d’assises pour des faits de viol sur mineur de quinze ans, la question subsidiaire sur la qualification d’atteinte sexuelle devra obligatoirement être posée par le président de la cour d’assises si l’existence de violences, contrainte, menace ou surprise est contestée.
Au terme de l’examen par les députés de cet article 2, l’esprit de ses dispositions a été conservé.
En revanche, tous les amendements tendant à créer une présomption légale ou à créer un seuil spécifique à treize ans ont reçu un avis défavorable du Gouvernement, tant pour des raisons constitutionnelles qu’en opportunité. Ils ont donc été rejetés par l’Assemblée nationale.
Sur la question de l’âge, tout d’abord, il ne nous est pas paru possible de prévoir des règles spécifiques pour les mineurs de treize ans, car cela aurait conduit à la fixation d’un double seuil d’âge – quinze ans pour préciser les notions de contrainte et de surprise ; treize ans dans d’autres cas –, ce qui aurait rendu la réforme particulièrement complexe, voire illisible, en tout cas difficilement compréhensible pour l’opinion publique.
Surtout, la fixation d’un seuil de treize ans donnerait, à tort, l’impression qu’une atteinte sexuelle commise par un majeur sur un mineur plus âgé, notamment sur des mineurs de quatorze ans et quelques mois ou d’un peu moins de quinze ans, serait licite ou tolérable, ce qui n’est évidemment pas acceptable.
Un seul et unique seuil doit être fixé par le code pénal, et c’est celui de quinze ans.
Je reviens à la question de la présomption, dont ma collègue vous a déjà parlé. Comme l’a relevé le Conseil d’État dans son avis, l’institution de présomptions légales en matière criminelle semble contraire aux exigences constitutionnelles de respect de la présomption d’innocence. Des présomptions sont acceptables en matière contraventionnelle, voire pour certains délits, mais certainement pas pour des crimes.
L’article 2 a en outre été complété par plusieurs dispositions nouvelles introduites par voie d’amendements à l’Assemblée nationale. Je ne m’étendrai pas sur toutes ces dispositions, mais je souhaite dire quelques mots de certaines d’entre elles qui me paraissent directement inspirées des travaux menés par le Sénat dans la proposition de loi qui a été examinée et débattue au mois de mars dernier.
Il en est ainsi de l’extension de la surqualification d’inceste aux victimes majeures, de l’aggravation de cinq à sept ans de la peine d’emprisonnement encourue en matière d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, ou encore de l’aggravation des peines d’emprisonnement de cinq à sept ans pour le délit de non-assistance à personne en danger et de trois à cinq ans pour le délit de non-dénonciation de mauvais traitements, lorsque ces délits sont commis sur un mineur de quinze ans.
Enfin, en ses articles 3 et 4, ce projet de loi prévoit un ensemble de dispositions destinées, dans le contexte post Weinstein de « libération de la parole », à améliorer notre législation en matière de lutte contre toute forme de harcèlement, qu’il soit commis sur internet ou dans la rue. Marlène Schiappa vous en a déjà présenté l’économie générale.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ces éléments de présentation du projet de loi étant posés, je vous ferai maintenant part de quelques observations du Gouvernement sur le travail de la commission des lois du Sénat.
Même s’il existe bien sûr des divergences entre le Gouvernement et le Sénat, je dois tout d’abord insister, à l’instar de ma collègue, sur la particulière qualité du travail conduit par la commission des lois, qui s’explique notamment par l’intérêt que la Haute Assemblée porte depuis plusieurs années à la question des violences sexuelles commises sur les femmes et sur les enfants.
Cet intérêt a notamment donné lieu à un rapport d’information du 7 février dernier intitulé Protéger les mineurs victimes d ’ infractions sexuelles et, je l’ai évoquée à l’instant, à l’adoption, le 27 mars dernier, de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles.
Cet intérêt résulte également des travaux accomplis par la délégation aux droits des femmes du Sénat. Je souhaite donc ici vivement remercier votre rapporteur, Marie Mercier, et les membres de la délégation, du travail de longue haleine qu’ils réalisent sur ces sujets.
J’évoquerai les convergences avant d’aborder les divergences.
L’attention particulière que le Sénat porte aux questions dont nous traitons conduit à ce qu’il existe, sur de nombreux points, d’importantes convergences de vue et d’analyse entre le Sénat et le Gouvernement, concernant précisément les quatre mesures phares du projet de loi. Ainsi votre commission est-elle favorable à une augmentation de vingt à trente ans de la prescription des crimes de nature violente ou sexuelle commis sur des mineurs, n’était une divergence minime concernant la liste de ces crimes, divergence qui, j’en suis persuadée, pourra être surmontée.
De même, votre commission accepte, dans son principe et dans la quasi-intégralité de sa rédaction, la disposition interprétative précisant la notion de contrainte ou de surprise en cas d’atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans. Cela permettra – tel est bien son objectif – aux juridictions de retenir plus facilement et plus fréquemment les qualifications de viol et d’agression sexuelle.
Par ailleurs, votre commission accepte l’évolution de la définition relative à l’élément de répétition des faits caractérisant le délit de harcèlement sexuel, ce qui permettra de sanctionner les harcèlements numériques commis par plusieurs internautes.
Enfin, votre commission accepte le principe de la création d’une infraction d’outrage sexiste pouvant être réprimée par la procédure de l’amende forfaitaire.
Ces convergences de vue me semblent plus importantes que nos différences.
La première divergence concerne la question de la présomption de culpabilité.
S’agissant des violences sexuelles commises sur des mineurs de quinze ans, votre commission propose, dans certains cas, la création d’une présomption de contrainte, donc de culpabilité. Cependant, cela ne nous semble pas possible au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles.
Comme l’a indiqué le Conseil d’État dans son avis, l’instauration d’une présomption en la matière serait très difficilement compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui, en dehors du champ contraventionnel, lorsque les faits peuvent raisonnablement induire la vraisemblance de l’imputabilité – c’est le cas, par exemple, des infractions au code de la route relevant de cette catégorie –, n’admet qu’« à titre exceptionnel » l’existence d’une présomption de culpabilité en matière répressive.
Pour que la présomption de culpabilité soit jugée constitutionnelle, le Conseil d’État a rappelé qu’il fallait deux éléments : d’une part, qu’elle ne revête pas de caractère irréfragable, d’autre part, qu’elle assure le respect des droits de la défense, c’est-à-dire qu’elle permette au mis en cause de rapporter la preuve contraire. Ces exigences seraient nécessairement d’autant plus fortes si une telle présomption devait être instituée pour un crime.
Au demeurant, toujours selon le Conseil d’État, la même présomption, s’agissant d’un crime, excéderait très certainement « les limites raisonnables » dans lesquelles la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales enserre les présomptions de droit ou de fait en matière pénale, compte tenu de la gravité de l’enjeu et de la difficulté pour le mis en cause de se défendre en pratique.
J’ajoute que ce principe a été encore réaffirmé récemment à l’échelon européen par la directive du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence. Pour ces motifs, l’option de l’instauration d’une présomption de contrainte, même simple, ne me semble pas possible.
La deuxième divergence a trait à l’outrage sexiste, dont votre commission souhaite faire un délit et non une contravention. Le Gouvernement n’y est pas favorable, estimant qu’une incrimination contraventionnelle permettra une répression plus rapide et plus efficace des faits.
Par ailleurs, si cette contravention est créée par la loi, alors que cela relève en principe du décret, c’est parce qu’une loi nous semble, en tout état de cause, nécessaire. Elle est nécessaire pour établir des amendes forfaitaires minorées, celles-ci n’étant aujourd’hui possibles, aux termes de la loi, que pour les contraventions au code de la route. Elle l’est aussi pour prévoir la peine complémentaire de stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Plutôt que de procéder en deux temps et de modifier la loi pour prendre ensuite un décret, tout régler dans la loi a paru une solution plus efficace et plus opportune au regard de la dimension symbolique de l’incrimination.
La troisième divergence porte sur le fait que le Gouvernement estime que ce texte ne doit pas être un projet de loi d’orientation et de programmation.
Enfin, il existe une dernière divergence, mais, sur ce point, comme Marlène Schiappa l’a souligné, la position du Gouvernement a évolué. La question était de savoir s’il convenait de porter de cinq à dix ans d’emprisonnement la peine encourue en cas d’atteintes sexuelles commises sur un mineur de quinze ans lorsque ces faits sont commis avec pénétration.
Le Gouvernement estimait que cette aggravation, qui lui avait été proposée par le Conseil d’État dans son avis, était opportune et justifiée pour affirmer avec force l’interdiction absolue de toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de quinze ans, que cette relation constitue un viol ou qu’elle n’en constitue pas un.
Cette aggravation venait ainsi compléter la définition interprétative facilitant l’établissement de la contrainte ou de la surprise qui caractérisent le viol. Pour le Gouvernement, cela s’inscrivait dans une logique d’instauration d’un continuum répressif, que nous défendons ensemble.
Cette aggravation a cependant été mal comprise par certaines associations, qui ont cru y déceler une possibilité accrue de correctionnalisation des crimes de viol en délits d’atteinte sexuelle. Je l’affirme encore une fois devant vous : cette perception est erronée, le Gouvernement ayant exclusivement souhaité renforcer les sanctions relatives aux violences sexuelles commises sur les mineurs.
Avec mes collègues Agnès Buzyn et Marlène Schiappa, nous avons pris le temps de recevoir ces associations pour échanger avec elles et leur expliquer la démarche voulue par le Gouvernement sur ce point. Ces échanges ont été très riches, très francs, sans doute même enrichissants de part et d’autre.
Plusieurs des représentants de ces associations nous ont dit comprendre notre démarche, mais nous ont indiqué redouter que, à vouloir trop bien faire, notre projet perde en lisibilité auprès de leurs membres et des victimes qu’elles côtoient sur le terrain chaque jour. Or l’intention du Gouvernement n’est certainement pas de susciter l’incompréhension de nos concitoyens ; elle est de travailler conjointement avec l’ensemble des forces de la société civile à l’affirmation et à la mise en place d’une dynamique sociétale globale de renforcement de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Pour atteindre ce but, nous devons être unis. Il nous est donc apparu nécessaire, à ma collègue Marlène Schiappa et à moi-même, de rassurer sur ce point le milieu associatif. Votre commission des lois a proposé de supprimer cette disposition relative à l’atteinte sexuelle avec pénétration du projet de loi. Le Gouvernement, à la réflexion, accepte cette suppression, car il estime essentiel que ce projet de loi ne soit pas mal compris et mal perçu par ceux-là mêmes dont le rôle est fondamental dans la lutte contre les violences sexuelles commises sur les mineurs.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale, reprenant du reste une proposition initialement formulée par le Sénat, a porté de façon générale de cinq à sept ans d’emprisonnement la peine prévue en cas d’atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans, qu’il y ait ou non pénétration. Dans la logique d’instauration d’un continuum répressif que j’évoquais précédemment, une telle aggravation peut paraître suffisante.
Pour ces raisons, le Gouvernement ne proposera pas de revenir sur cette suppression. Il n’a donc déposé des amendements que sur les points sur lesquels demeuraient les plus importantes différences d’appréciation avec votre commission.
J’ajoute, pour finir, que le Gouvernement a déposé trois amendements qui ont pour objet d’améliorer le projet de loi sur trois sujets.
Le premier amendement améliore l’article 1er sur la prescription, en permettant de prendre en compte la situation des personnes commettant de façon répétée des violences sur les mineurs. Il prévoit ainsi que la commission d’un nouveau crime avant la prescription d’un précédent crime interrompra cette prescription et permettra ainsi de poursuivre et condamner la personne pour l’ensemble de ses actes.
Les deux amendements suivants complètent le projet de loi par deux dispositions : l’une permet de sanctionner comme circonstance aggravante et comme délit spécifique l’utilisation de la « drogue du violeur » ; l’autre permet de réprimer les faits de voyeurisme par un nouveau délit de captation d’images impudiques.
Ces dispositions viennent combler des lacunes de notre droit pénal en matière de lutte contre les infractions sexuelles, qui ont été portées à la connaissance du ministère de la justice par diverses juridictions depuis plusieurs mois.
Ces dispositions ne figuraient pas dans le projet de loi initial, car il avait été alors décidé que celui-ci ne traiterait que des quatre réformes annoncées par le Président de la République dans son discours du mois de novembre 2017, à savoir la prescription, le viol sur mineur, le harcèlement sexuel sur internet et l’outrage sexiste.
La première lecture à l’Assemblée nationale s’est principalement focalisée sur ces quatre questions. Considérant que l’examen du texte devant le Sénat constitue une étape importante et précieuse de la discussion parlementaire, il a paru opportun au Gouvernement de proposer l’adoption de ces dispositions à la Haute Assemblée, dont j’espère qu’elles recevront l’approbation.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi que je vous présente avec Marlène Schiappa répond à une attente forte de nos concitoyens et vise à renforcer les moyens juridiques à disposition de l’autorité judiciaire pour lui permettre de faire respecter au quotidien les droits des femmes et des enfants en mettant fin au sentiment d’impunité des auteurs de violences sexuelles et sexistes.
Ce texte constitue une avancée majeure pour atteindre ce but que nous nous sommes collectivement fixé.
Au-delà de certaines divergences, je crois que, sur l’essentiel, nous devrions pouvoir nous rejoindre. C’est en tout cas le vœu que je forme, car cela répond à une véritable attente.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi qu ’ au banc des commissions.

Madame la présidente, madame le garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, que celles-ci concernent les femmes ou les hommes, les mineurs ou les majeurs, est un sujet sociétal gigantesque qui nous tient particulièrement à cœur.
Ce sujet n’est pas nouveau. Nous en avons déjà débattu, notamment dans le cadre du groupe de travail pluraliste de la commission des lois sur les infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs, qui a étroitement associé la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Le sujet a également été longuement évoqué lors de l’examen de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles, présentée par le président de la commission des lois et adoptée le 27 mars dernier à la quasi-unanimité.
Ce projet de loi a l’objectif louable et ambitieux de mieux lutter contre les violences sexuelles et sexistes : il propose à cette fin d’allonger certains délais de prescription, de mieux réprimer les viols commis à l’encontre des mineurs, ou encore de mieux réprimer les faits de harcèlement sexuel ou moral, notamment lorsqu’ils sont commis sur internet.
La commission des lois a tenu à aborder ce texte dans un esprit constructif. Nous partageons tous les mêmes objectifs que le Gouvernement.
Il est indispensable de continuer le combat contre les violences sexuelles et sexistes, violences qui touchent en majorité les femmes, mais aussi et trop souvent les mineurs, filles comme garçons.
Comme le Gouvernement, nous considérons qu’il est essentiel de lutter contre les comportements sexistes dont sont victimes les femmes dans l’espace public. Ces comportements anciens sont trop souvent tolérés, banalisés, voire intégrés par les femmes elles-mêmes, qui ont tendance à adapter leurs comportements et leurs déplacements en fonction de ce risque.
Comme le Gouvernement, nous considérons que les violences sur internet ne sont pas virtuelles. Bien que peu médiatisées, elles n’en restent pas moins réelles, avec des conséquences psychiques et physiques tout aussi dramatiques.
Si la commission des lois a partagé sans réserve les objectifs du projet de loi, elle a néanmoins eu à cœur d’améliorer l’efficacité de certaines mesures et, évidemment, de reprendre l’ensemble des dispositions que le Sénat avait adoptées le 27 mars dernier lors du vote de la proposition de loi de Philippe Bas.
Certaines de ses dispositions avaient déjà été reprises à l’Assemblée nationale.
Ainsi, l’article 2 du projet de loi a été modifié afin d’étendre la surqualification pénale de l’inceste aux viols et autres agressions sexuelles commis à l’encontre de majeurs. C’est la proposition n° 14 du rapport d’information.
De même, l’article 2 du projet de loi, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, aggrave les peines encourues pour le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans. C’est la proposition n° 15 du rapport d’information.
Enfin a également été adoptée à l’Assemblée nationale l’aggravation des peines en cas de non-assistance ou de non-dénonciation d’actes de mauvais traitements, ce qui correspond à l’article 6 bis de la proposition de loi sénatoriale.
Nous nous en félicitons, tout en regrettant néanmoins que ces travaux n’aient pas été cités.
L’ensemble des modifications apportées en commission des lois ont été guidées par la volonté de rendre plus efficace ce texte : nous ne voulons pas de mesures purement symboliques, au détriment non seulement des règles constitutionnelles, mais aussi de l’efficacité de la loi.
Que retenir de l’examen en commission des lois ?
La commission a d’abord adopté l’allongement à trente ans du délai de prescription pour les crimes sexuels et violents commis à l’encontre des mineurs. Elle a également adopté, sur l’initiative de François-Noël Buffet, une disposition innovante visant à faciliter le recours à l’obstacle de fait insurmontable, qui vise à suspendre la prescription. Elle a modifié le régime de prescription de l’infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l’encontre des mineurs afin de reporter le point de départ du délai de prescription.
Concernant le harcèlement sexuel et moral, notamment commis sur internet, la commission a approuvé les modifications de l’Assemblée nationale en les enrichissant. Elle a ainsi adopté une disposition permettant de mieux lutter contre le cyberharcèlement en conférant de nouvelles obligations aux plateformes en la matière.
Concernant l’outrage sexiste, la commission des lois en a approuvé le principe tout en refondant le dispositif. En effet, elle n’a pas jugé opportun d’en faire une contravention : comme l’a rappelé le Conseil d’État au Gouvernement, la création d’une contravention relève du pouvoir réglementaire, et non du pouvoir législatif.
Au regard de la gravité des faits et de la complexité des éléments constitutifs de l’infraction, qui devront être constatés par les policiers et gendarmes, la commission des lois a jugé plus pertinent d’en faire un délit.
Néanmoins, afin de permettre une constatation en flagrant délit et une sanction rapide, la commission des lois a prévu l’application de la procédure de l’amende forfaitaire en matière délictuelle pour cette infraction.
Concernant la répression des viols, commis sur majeurs ou sur mineurs, la commission des lois a approuvé, en en améliorant la rédaction, l’extension de la définition du viol adoptée par l’Assemblée nationale aux actes de pénétration forcés, commis non pas sur la victime, mais sur l’auteur des faits, au détriment de la victime : il s’agit des fellations réalisées de force sur de jeunes mineurs, qui n’étaient jusqu’à présent pas considérées comme un viol.
Concernant la répression des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs, le Gouvernement est revenu sur ses premières déclarations. Initialement en effet, il avait annoncé la création d’une présomption irréfragable de non-consentement attachée à un seuil d’âge pour les mineurs. Une telle annonce, un peu précipitée, se dispensait d’une réflexion sur les pratiques judiciaires ou d’une évaluation de l’arsenal pénal existant.
À l’inverse, la commission des lois a choisi de prendre le temps de la réflexion avant d’annoncer une évolution de la loi : par la création d’un groupe de travail pluraliste, elle a proposé son analyse des défaillances actuelles dans la répression des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs. Pourquoi un arsenal pénal si vaste est-il aussi peu connu et mobilisé ? Pourquoi les crimes sexuels font-ils autant l’objet d’une correctionnalisation ? Ce n’est pas parce que la loi est incomplète, et la seule création de nouvelles dispositions de nature pénale n’y changerait rien.
Évidemment, comme nous l’avions déjà souligné dans notre rapport d’information, le Conseil d’État a considéré que de telles dispositions paraissaient contraires à plusieurs dispositions constitutionnelles. Il a rappelé que la jurisprudence du Conseil constitutionnel empêchait toute création de présomption irréfragable de culpabilité, surtout en matière criminelle. Or la création d’une infraction qui reviendrait à créer une présomption irréfragable de culpabilité pour tout majeur ayant une relation sexuelle avec un mineur de quinze ans porterait une atteinte disproportionnée au principe de la présomption d’innocence et aux droits de la défense.
Comme l’a rappelé le Conseil d’État, la seule circonstance que l’auteur « ne pouvait ignorer l’âge de la victime » ne répond pas à l’exigence constitutionnelle relative à l’élément intentionnel en matière criminelle.
En conséquence, le Gouvernement a renoncé à son projet initial pour proposer la création d’une disposition interprétative concernant la contrainte morale ou la surprise pour les viols commis sur les mineurs de moins de quinze ans et la création d’une circonstance aggravante pour le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans en cas d’acte de pénétration sexuelle.
La commission des lois a choisi de modifier la disposition interprétative. Elle a supprimé la circonstance aggravante pour le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans en cas d’acte de pénétration sexuelle. En effet, une telle disposition crée une possibilité supplémentaire de requalification du viol en atteinte sexuelle et accroît donc le risque de correctionnalisation. Le viol reste un crime.
Surtout, la commission des lois a choisi d’aller plus loin : elle a décidé de protéger tous les mineurs victimes de viols, pas seulement ceux de moins de quinze ans, pas seulement ceux de moins de treize ans.
En conséquence, elle a proposé la création d’une présomption de contrainte qui inverse la charge de la preuve en matière de viol sur mineurs, lorsque ceux-ci sont incapables de discernement ou en cas de différence d’âge significative entre l’auteur et la victime mineure. Ce sera à l’agresseur de prouver qu’il n’y a pas eu contrainte !
Cette disposition, plus souple que l’instauration d’une présomption simple reposant sur un seuil d’âge des victimes, permet de s’adapter à la diversité des situations et, surtout, de protéger tous les mineurs.
Il convient de faire très attention à toute modification de la loi pénale : nous ne pouvons instrumentaliser son évolution au profit d’une communication politique ! Nous ne pouvons pas non plus simplifier de manière excessive le code pénal au risque d’affaiblir la protection actuelle des mineurs ! À cet égard, la commission des lois a également supprimé tous les « neutrons législatifs ».
Enfin, la commission des lois a réparé les oublis du projet de loi. Ce texte ne parle en effet que de la réponse pénale. Or la prévention des violences est essentielle ! Cela doit être la priorité. C’est pourquoi elle a proposé que ce projet de loi porte véritablement les orientations de la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Je ferai miens les propos de Lamartine, qui a vécu en Saône-et-Loire : « J’ai eu le courage et le chagrin de vous déplaire, mais de vous déplaire pour vous servir. » Là, il s’agit de servir les victimes de violences sexuelles.

La parole est à Mme la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, saisie pour avis.

Madame la présidente, madame le garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues, je concentrerai mon propos sur les dispositions de l’article 2 qui ont plus particulièrement fait débat, dans un contexte marqué par la vive émotion causée par deux décisions judiciaires.
Rappelons que nous partageons tous un même objectif, celui de mieux protéger les enfants contre les prédateurs sexuels, même si nous ne nous accordons pas nécessairement sur les moyens.
L’objectif de la délégation est aussi de rendre impossibles de nouvelles affaires de Pontoise et de Meaux.
Pourquoi ces affaires sont-elles survenues ? Parce que la définition du viol repose sur des critères – violence, menace, contrainte, surprise – qui font une large place à l’appréciation subjective du magistrat ou du juré. En outre, ces critères conduisent immanquablement à juger le comportement de la victime. Cette mise en cause d’une responsabilité supposée de la victime est d’ailleurs propre au viol : on ne reprocherait pas à quelqu’un qui s’est fait voler sa voiture d’en avoir une !
Quand il s’agit de victimes adultes, ces questionnements sont déjà très perturbants et injustes. Quand il s’agit d’enfants, ils sont inadmissibles, car ils conduisent à s’interroger sur leur prétendu consentement. Comment imaginer qu’un enfant puisse consentir à une pénétration sexuelle par un adulte ?
Au terme de ses travaux, la délégation a acquis une conviction : les critères du viol ne sont tout simplement pas pertinents quand il s’agit d’enfants. La seule solution protectrice est d’instaurer dans le code pénal un seuil d’âge en deçà duquel toute relation sexuelle avec pénétration entre un adulte et un mineur serait un crime, sanctionné à la hauteur de sa gravité. Les critères de menace, violence, contrainte ou surprise n’entreraient plus en ligne de compte, et le consentement de la victime ne serait plus évoqué.
La délégation a fixé ce seuil à treize ans plutôt qu’à quinze ans. Cet âge nous a semblé la limite universellement admise de l’enfance. De plus, nous avons souhaité séparer le débat législatif du débat moral : quand on envisage un seuil de quinze ans, on en vient implicitement à un débat sur l’âge auquel on peut admettre que des jeunes aient une vie sexuelle. Or ce n’est pas le rôle du législateur.
Nous avons eu aussi comme préoccupation d’éviter des plaintes contre un jeune majeur qui aurait des relations sexuelles avec un adolescent plus jeune.
En ce qui concerne les droits de la défense, nous avons considéré que le seuil de treize ans garantit un écart d’âge suffisant entre victime et agresseur et que ce dernier pourra démontrer qu’il ne pouvait connaître l’âge de la personne avec laquelle il a eu un rapport sexuel.
Nous ne sommes pas convaincus de l’inconstitutionnalité supposée de notre proposition, qui nous a régulièrement été opposée. Notre proposition est confortée par des spécialistes éminents. Dans une tribune récente, ils « réclament avec force la création d’un crime formel de violences sexuelles à enfants quand un adulte a une relation avec une personne mineure de moins de treize ans ». C’est très exactement ce que propose la délégation !
Le texte dont nous débattons répond-il à nos exigences ? Tout d’abord, la délégation n’était pas favorable à la création des circonstances aggravantes permettant de réprimer de dix ans d’emprisonnement le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans avec pénétration sexuelle. Le viol est un crime, et il est inadmissible qu’il soit jugé et sanctionné à la sauvette, comme un délit.
Cette disposition a été supprimée à juste titre du texte par la commission des lois, mais la solution retenue pour la définition du viol ne changera rien à la situation actuelle. En effet, la notion de contrainte morale, dans l’appréciation du viol, laisse une part trop grande à la subjectivité.
Pour nous, se référer à une différence d’âge « significative » entre victime et agresseur ou à l’incapacité de discernement du mineur n’empêchera pas le débat sur le consentement de l’enfant. Cette mesure n’empêcherait donc pas de nouvelles affaires du type de celle de Pontoise.
Pour conclure, la solution que nous défendons nous semble être la plus protectrice des jeunes victimes. Combien de scandales faudra-t-il encore avant que le législateur ne crée une nouvelle infraction réprimant le crime de violence sexuelle commis sur un enfant ?
Mes chers collègues, au moment de l’examen de l’article 2, je vous demanderai de bien avoir à l’esprit l’enjeu de votre vote : les dispositions proposées permettront-elles réellement de protéger nos enfants contre les prédateurs sexuels et de garantir une condamnation des agresseurs à la hauteur de la gravité des faits ?
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, j’ai eu l’occasion de m’exprimer sur les violences sur mineurs lors de l’examen de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles et dans le cadre du groupe de travail sur les infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs.
J’évoquerai aujourd’hui tout d’abord les femmes. « Il n’y a pas de secrétariat d’État aux miracles » disait Françoise Giroud un an après la création du secrétariat d’État à la condition féminine en 1974. En la matière, le temps est nécessaire, et nécessairement long. La domination masculine résiste parce qu’elle est universelle. Elle constitue, avec la prohibition de l’inceste, le point commun à toutes les cultures, à toutes les sociétés, quel que soit le lieu, quelle que soit l’époque.
Pour Françoise Héritier, cette hiérarchie entre les sexes résulte d’une construction culturelle et ne correspondait pas initialement à une réalité biologique. Les hommes se sont approprié le corps de la femme pour mieux maîtriser la fécondité. On aurait ainsi longtemps accepté que le corps des femmes appartienne aux hommes et que les femmes soient les seules responsables du désir qu’elles suscitent, au point que cette soumission en serait devenue « paradoxale », selon le terme employé par Bourdieu.
Elle serait paradoxale parce que la domination masculine s’exprimant par une violence douce, insidieuse, elle a été intégrée par les femmes elles-mêmes. Les violences sexistes et sexuelles qu’elles subissent quotidiennement sont si ordinaires que les femmes s’y résignent, considérant que ces humiliations, ces agressions sont inhérentes à leur condition.
Votre projet de loi, madame la ministre, madame la secrétaire d’État, répond à la volonté de voir la honte changer de camp et d’en finir avec cette résignation. Les hommes doivent prendre conscience que les violences faites aux femmes, fussent-elles insensibles ou invisibles, ne sont pas l’expression de l’éternelle masculinité.
Ce texte, qui s’inscrit dans le cadre de la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes, érigée en grande cause du quinquennat, fait suite à deux affaires d’agression sexuelle sur des mineures de onze ans et à l’affaire dite « Weinstein ».
Vos objectifs, madame la ministre, sont unanimement partagés par le Sénat. Les moyens de les atteindre, on vient encore de l’entendre, sont discutés. Les débats auront lieu, je m’en réjouis. Le Gouvernement a suffisamment expliqué les raisons de son choix juridique, qui divergent parfois du point de vue de la délégation aux droits des femmes, de la commission et des auteurs de certains amendements, notamment sur le seuil de treize ans. Je n’y reviens pas.
Pour ma part, j’aborderai plusieurs sujets.
J’évoquerai tout d’abord le délai de prescription. Je redis que le compromis qui a été trouvé, lequel fait consensus, permet d’intégrer la problématique de l’amnésie post-traumatique. Il permet également la cohérence des prescriptions.
Ensuite, le texte affirme le caractère continu de l’infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l’encontre de mineurs et instaure ainsi une forme d’imprescriptibilité. C’est pourquoi nous avons déposé un amendement de suppression.
Une forme de compromis avait été trouvée sur la question du seuil dans le cadre des travaux du groupe de travail et lors de l’examen de la proposition de loi pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles. La proposition du Gouvernement ne contient aucune divergence de fond et d’objectif. Le débat est exclusivement technique et juridique. L’objectif est de protéger efficacement les enfants, notamment contre les prédateurs sexuels.
J’évoquerai maintenant la présomption de contrainte. Pourquoi ne peut-on pas fixer un seuil à treize ans ? L’instauration d’une présomption de contrainte en deçà de treize ans créerait une zone grise en termes de répression pénale, laquelle pourrait inciter à se reposer exclusivement sur la qualification pénale d’atteinte sexuelle et donc mobiliser insuffisamment la qualification pénale de viol. Or telle n’est pas notre intention.
La création d’une telle présomption ferait aussi courir le risque que les juridictions ne reconnaissent plus l’existence d’une contrainte morale pour les victimes mineures de plus de treize ans.
Par ailleurs, instituer une présomption légale en matière criminelle serait bien sûr contraire aux exigences conventionnelles et constitutionnelles de respect de la présomption d’innocence. Ce point ne souffre aucune contestation pour tous les juristes. Oui, nous partageons les objectifs, mais ne prenons pas le risque de ne pas les atteindre à cause d’une discussion juridique.
Enfin, je voudrais avec vous me réjouir des articles 2 bis A et 2 bis°B. Le second mériterait d’ailleurs d’être rétabli, malgré son caractère infralégislatif, puisqu’il s’agit…

Je conclus, madame la présidente, sur ce dernier point, la protection des mineurs handicapés.
Je rappelle ici que plus de 80 % des petites filles mineures atteintes d’un trouble mental font l’objet avant leur majorité d’atteintes sexuelles graves, que 91 % des mineurs autistes, filles ou garçons, font l’objet des mêmes violences. Il n’y a plus lieu de polémiquer sur les moyens juridiques. Nous avons un très bon dispositif, adoptons-le !
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – Mme Nassimah Dindar applaudit également.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, si un important travail a été effectué jusqu’ici par les associations féministes et celles qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles, ainsi que par les délégations aux droits des femmes des deux chambres du Parlement, le sentiment prévalant est toujours celui de la maltraitance des victimes et de l’impunité des agresseurs.
Le texte qui nous est soumis propose d’apporter une réponse législative à ce qui est surtout un immense chantier social et sociétal à ses balbutiements…

Quoi que l’on puisse penser de ses dispositions, la première chose qui frappe, c’est son relatif manque d’envergure.
Qui peut vraiment penser que quatre modifications législatives suffiront pour lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles ? Elles peuvent au mieux lancer un processus permettant de mieux aborder ces questions, mais elles ne s’attaqueront pas à la racine du mal. La réalité de notre société, qui méconnaît encore souvent la gravité, la fréquence et la prégnance des violences sexistes et sexuelles, devrait nous inciter à plus d’ambition.
La parole féminine qui s’est exprimée ces derniers mois et les hashtags #MeToo et #BalanceTonPorc qui ont déferlé sur les réseaux sociaux sont venus nous rappeler que les violences sexistes et sexuelles s’exercent sur nos concitoyennes de manière massive, sans distinction de milieu social ou professionnel. Ce mouvement, souvent présenté comme une libération de la parole des femmes, nous interroge d’abord sur le silence qui l’a précédé et qui, quoi qu’on dise, s’impose toujours à l’immense majorité des victimes.
Ces problématiques ne sont pas nouvelles. Elles ont d’ailleurs été évoquées ici même, en février 2017, lors d’un débat lancé sur mon initiative sur le thème : « Violences sexuelles : aider les victimes à parler ». Modifier la loi, est-ce la réponse ? Le législateur ne peut certes plus occulter le problème, mais c’est aussi la société tout entière, femmes et hommes ensemble, qui se doit d’apporter des réponses à ces atteintes majeures à l’intégrité même du corps féminin.
Cette histoire remonte à loin. Longtemps soumise à une domination masculine sans partage, considérée d’abord comme reproductrice, comme objet de convoitise sexuelle, la femme continue de subir les effets de sa supposée « infériorité » sociale. En témoignent entre autres l’inégalité salariale entre les femmes et les hommes, le peu de place que les femmes occupent en politique, dans les conseils d’administration, à la tête des entreprises, aux postes à responsabilité. Les exemples sont nombreux, jusqu’à la circulation de la parole féminine elle-même sans cesse interrompue, ici… §et là. Les violences sexistes et sexuelles découlent d’une perception globale, directe ou indirecte, de la femme comme objet plutôt que comme sujet, perception que nombre de femmes elles-mêmes ont fini par intérioriser.
Leur silence face aux violences sexistes et sexuelles n’est pas étranger à cette situation, même si des garçons mineurs sont également agressés sexuellement, violés, mais en nombre toutefois inférieur à celui des femmes.
Ce n’est pas un hasard si, en France, une femme victime de viol sur dix porte plainte contre son agresseur. Ce chiffre est certes impressionnant, mais il ne peut être imputé à la seule faiblesse supposée de notre arsenal législatif. Ce silence est lié aussi à ce qu’il convient d’appeler la culture du viol, qui consiste à faire porter à la victime d’une agression une partie de la culpabilité.
Pour démonter cette culture du viol, il est nécessaire de rappeler inlassablement qu’une victime de harcèlement ou d’agression sexuelle n’est jamais responsable de ce qu’elle subit ! Il est indispensable de développer l’information et la prévention dans les écoles, les universités, les administrations, les entreprises, pour que les citoyennes et les citoyens puissent appréhender clairement ce qui relève d’une infraction sexuelle, le repérer, y réagir et surtout le dénoncer.
Si tout cela n’est pas accompagné d’une valorisation de la place de la femme dans la société, les efforts déployés pourraient se révéler vains. Éducation et manuels scolaires ont un rôle important à jouer en la matière en faisant évoluer leur contenu.
On ne peut pas se dispenser non plus, pour les victimes osant parler, d’un véritable accompagnement au moment du dépôt de la plainte, puis tout au long de la procédure.
De même, si la police et la justice ne sont pas dotées des moyens financiers et des formations nécessaires à cette mission, il est à craindre que tout cela ne soit qu’un coup d’épée dans l’eau.
Toutes ces questions méritent débat. Nos divergences seront probablement nombreuses. Convenons toutefois toutes et tous que ce sujet doit définitivement cesser d’être un tabou. La parole libérée des femmes doit nous pousser à nous saisir enfin de cette question à bras-le-corps.
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, du groupe socialiste et républicain et du groupe La République En Marche.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, notre République se doit de protéger tous les siens et tout particulièrement les plus faibles. Elle se doit de poser des interdits, de sanctionner les infractions, surtout les plus inacceptables, mais elle doit aussi et surtout les prévenir.
Votre texte, madame la ministre, affiche cette ambition.
Pour ma part, j’évoquerai tout particulièrement les violences sexuelles sur mineurs, sujet difficile dont la gravité ne doit pas masquer la complexité, quand bien même chacun de nous peut souhaiter une réponse simple, forte et juste aux yeux de tous.
Ces actes destructeurs pour les victimes et leurs familles suscitent un rejet si violent qu’ils emportent toute raison et font apparaître la réflexion comme une absence de condamnation.
Le sujet n’est pas nouveau au Sénat, qui vient d’adopter une proposition de loi issue des travaux d’un groupe de travail transpartisan pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles, sous la responsabilité de Marie Mercier.
Je me réjouis que le texte du Gouvernement et cette proposition de loi se rejoignent sur plusieurs points, preuve indéniable de notre volonté commune sur toutes nos travées de mieux combattre les violences sexuelles.
Je pense à l’allongement de la prescription à trente ans, à l’aggravation des peines encourues pour le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans, à l’aggravation des peines en cas de non-assistance ou non-dénonciation d’actes de mauvais traitement, ou encore la meilleure répression du harcèlement en ligne.
Un article cristallise toutefois les débats, l’article 2, sur lequel portera l’essentiel de mon propos.
Cet article introduit dans la définition du viol une protection particulière pour les mineurs de quinze ans. Les notions de contrainte et de surprise, constitutives d’un viol, pourront « être caractérisées par l’abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ».
Cette disposition interprétative va dans le bon sens, et je m’en réjouis. Toutefois, la proposition de notre rapporteur est plus protectrice envers les mineurs – tous les mineurs – et plus sévère à l’encontre des accusés. En effet, elle inverse la charge de la preuve en matière de viol sur mineurs lorsque ceux-ci sont incapables de discernement ou en cas de différence d’âge significative entre l’auteur et la victime mineure. Il appartiendrait donc, selon la proposition de notre rapporteur, à l’accusé de démontrer l’absence de contrainte.
Cette présomption de contrainte permettrait d’assurer la protection de tous les mineurs, quel que soit leur âge, qu’ils aient douze ans ou qu’ils en aient seize, s’ils manquent de maturité ou de discernement. L’âge n’est pas synonyme de maturité ou de discernement.
D’aucuns proposent d’instaurer un seuil d’âge à treize ans. Si la fixation d’un seuil peut être a priori considérée comme un renforcement de la protection et la sacralisation d’un interdit sociétal, elle dégrade en revanche la protection des mineurs au-delà de ce seuil. Le juge pourra en effet considérer ce seuil comme une limite, ce qui pourrait l’inciter à privilégier la qualification d’atteinte sexuelle au détriment de la qualification pénale de viol.
Comment pourrons-nous alors expliquer aux familles concernées que leur enfant victime de violences sexuelles à treize ans et six mois sera moins protégé qu’une victime de douze ans et onze mois ? Ne prenons-nous pas le risque d’assister à la même puissante incompréhension que celle qui a jailli lors de l’affaire dite « de Pontoise » ?
Le Défenseur des droits et la Défenseure des enfants ont d’ailleurs indiqué ne s’être jamais montrés très favorables à l’introduction d’un seuil d’âge dans la loi, en précisant qu’il convenait d’être extrêmement prudent sur toute disposition qui introduirait une certaine automaticité dans l’application de la loi pénale.
Le Gouvernement a renoncé, après l’avis du Conseil d’État du 15 mars 2018, à instaurer un seuil, eu égard aux risques d’inconstitutionnalité, que notre rapporteur a parfaitement exposés, et sur lesquels je ne reviendrai pas.
Cet avis du Conseil d’État me convainc qu’on peut difficilement laisser croire à l’opinion publique qu’un seuil constituerait une réponse magique, malgré l’aspect très séduisant d’une telle idée.
Notre rapporteur est parvenue à trouver un équilibre fragile entre la nécessaire répression des infractions sexuelles, en particulier à l’encontre des mineurs, et le respect de la cohérence du droit pénal, de la conformité à la Constitution. Je salue son courage et la qualité de son travail.
Par ailleurs, l’article 2 prévoit que, parmi les délits d’atteinte sexuelle, ceux qui sont commis sans pénétration seront punissables de sept ans de prison, contre cinq ans aujourd’hui, et ceux qui sont commis avec pénétration, de dix ans de prison.
Le risque, en rapprochant la peine encourue en cas de viol et en cas d’atteinte sexuelle avec pénétration, est que les affaires de viols sur mineur dans lesquelles contrainte et surprise seraient compliquées à établir soient trop facilement requalifiées en délits d’atteinte sexuelle. Ainsi, ce qui était jugé hier comme un crime en cour d’assises pourrait être communément considéré demain comme un délit au tribunal correctionnel.
Il faut avoir à l’esprit que, en moyenne, une procédure pour viol dure environ six ans tandis qu’une procédure pour agression sexuelle dure environ deux ans. Et qu’un jury populaire n’est pas une garantie de fermeté dans la sanction, loin de là.
Aussi, pour certaines victimes, le choix d’accélérer le processus peut être libérateur. Pour d’autres, un viol jugé en correctionnelle serait plus difficile à surmonter, car elles n’auraient pas le sentiment d’avoir été aussi bien entendues qu’après un procès aux assises.
Je le dis ici : la correctionnalisation n’est pas en soi une renonciation, mais il convient de ne pas excessivement l’encourager.
C’est pourquoi nous soutenons la suppression de cette circonstance aggravante, car sa création, si elle n’est pas accompagnée d’un renforcement des moyens des tribunaux, aurait comme conséquence une correctionnalisation massive.
Madame la garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, sanctionner est une exigence, mais cela ne suffit pas. Notre devoir de législateurs est aussi de prévenir et de protéger. Aussi, je regrette l’absence d’un volet plus global allant au-delà de la seule réponse pénale.
En effet, cela a été rappelé, 11 % des victimes de viols ou d’agressions sexuelles seulement portent plainte. La grande majorité des victimes n’a ni la force ni l’endurance d’engager des recours. Ainsi, s’il existe déjà un arsenal juridique, force est de constater qu’il est en réalité peu mobilisé. Le problème n’est pas tant lié à un quelconque vide juridique qu’aux difficultés à mettre en œuvre la loi et à accompagner les victimes dans leur reconstruction.
Par ailleurs, on constate des insuffisances liées à un manque criant de moyens de la justice et à la saturation de la chaîne pénale. Il nous faut adapter l’organisation de la justice et renforcer ses moyens pour lui permettre de juger dans des conditions décentes.
On constate également des insuffisances liées au manque de formation. À cet égard, je salue les dispositifs de pré-plainte en ligne, qui lèveront sans doute quelques craintes de la part des victimes.

Madame la garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nul n’a le monopole du cœur ou de l’indignation. Nul ici ne sous-estime la complexité du sujet, mais nul ici ne peut nier que chacun de nous porte comme un devoir, une conviction, une volonté la protection farouche de tous les mineurs.
Aussi, sur un tel sujet, il appartiendra à chacun, en son âme et conscience, mais avec raison et discernement, de se prononcer.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, mes chers collègues, dimanche, vous l’avez rappelé, madame la ministre, la nation française a rendu hommage à Simone Veil, à ce qu’elle était, à son histoire, mais aussi à ce qu’elle a fait.
En 1975, une nouvelle étape pour les droits des femmes était franchie avec la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse. Ce fut un parcours long et chaotique, semé d’embûches, qui a ravivé les franges les plus conservatrices de la société et marqué le septennat de Valéry Giscard d’Estaing.
Si on se retourne un peu sur notre histoire récente, on constate que le mandat de chaque Président de la République a été marqué par des avancées pour les droits des femmes.
Le général de Gaulle a instauré le droit de vote des femmes en 1944 et légalisé la contraception avec la loi Neuwirth en 1967. Georges Pompidou a fait inscrire dans la loi le principe « à travail égal, salaire égal » en 1972. On doit à Valéry Giscard d’Estaing, je l’ai dit, la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse ; à François Mitterrand le remboursement de l’IVG par la sécurité sociale en 1982, l’ouverture du congé parental aux deux parents en 1984, la loi sur l’égalité professionnelle, la première femme Premier ministre et le premier ministère des femmes de plein droit ; à Lionel Jospin et à Jacques Chirac la loi sur la parité et la loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ; à Nicolas Sarkozy l’inscription du principe de parité dans la Constitution. Quant à François Hollande, il a permis l’adoption du mariage pour tous, et donc pour toutes. Enfin, en 2016, a été adoptée la loi de notre collègue Laurence Rossignol visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, que je ne pouvais oublier.
Nous attendions donc avec intérêt de connaître l’ambition du président Macron, après que les affaires de Pontoise et de Melun, concernant des fillettes de onze ans et des hommes adultes, ont secoué l’opinion. Le 25 novembre dernier, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, nous avons pris connaissance de ses priorités et appris que l’égalité entre les hommes et les femmes serait érigée en grande cause nationale du quinquennat.
Au final, votre projet de loi a déçu, vous le savez, madame la ministre. C’est une petite loi pour une grande cause, d’autant plus qu’il n’y en aura vraisemblablement pas d’autre, même si nous espérons le contraire. Nous relevons une contradiction aussi : le fameux « et en même temps » permet au Président de la République de soutenir ce texte tout en s’opposant à la directive européenne prévoyant un allongement du congé de paternité.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Votre projet de loi avait une finalité essentielle : la lutte contre toutes les formes de violences sexuelles et sexistes. Il était attendu, à la suite de l’affaire Weinstein et des mouvements #BalanceTonPorc et #MeToo.
Rappelons quelques chiffres effroyables : en 2016, en France, 93 000 femmes auraient été victimes de viols et/ou de tentatives de viols. Au cours de sa vie, une femme sur sept et un homme sur vingt-cinq subira une violence sexuelle, 40 % avant l’âge de quinze ans pour les femmes, 60 % pour les hommes.
Ce texte contient néanmoins quelques apports, comme l’allongement du délai de prescription et la nouvelle incrimination d’outrage sexiste, mais ils ne suffisent pas à effacer les points contestables, et ils sont nombreux. Vous avez ainsi renoncé à instaurer un seuil d’âge minimum en dessous duquel toute relation sexuelle d’un mineur avec une personne majeure est interdite, pour des raisons que vous avez tenté d’expliquer tout à l’heure et sur lesquelles nous reviendrons évidemment au cours du débat, réduisant ainsi à néant tout dispositif qui aurait sans doute permis d’éviter les affaires de Pontoise et de Melun.
Pis, vous avez créé une circonstance aggravante en cas d’atteinte sexuelle avec acte de pénétration sexuelle sur mineur de quinze ans. Vous avez indiqué tout à l’heure y renoncer. Tant mieux, car il y avait un fort risque d’orienter des viols vers la correctionnalisation. La commission des lois l’a supprimée, vous la suivez, c’est heureux.
Aujourd’hui, madame la garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, vous devez vous interroger : peut-on avoir raison contre tout le monde ? Chacun de nous peut d’ailleurs s’interroger, mais, en l’occurrence, c’est vous qui êtes en charge de ce texte. Comment pouvez-vous aujourd’hui refuser de criminaliser l’agression sexuelle avec pénétration sur mineur de treize ans alors que tout le monde vous alerte et vous demande de le faire ? Pourquoi rester sourdes à la demande de la délégation aux droits de femmes et de notre groupe de créer cette incrimination nouvelle ? Nous la défendrons dans le débat, car elle est très importante. C’est l’adulte qui est responsable, jamais l’enfant. Ce point ne souffre pas de discussion. De la même façon, nous combattrons la notion de maturité sexuelle suffisante, laquelle a été introduite de manière choquante par la commission des lois.
Le groupe socialiste et républicain sera, comme toujours, constructif. Nous présenterons une cinquantaine d’amendements et nous aborderons toutes les problématiques – la prévention, le cyberharcèlement, le cybersexisme.
Nous souhaitons, madame la garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, que vous puissiez démontrer, comme Mme Schiappa l’a dit en ouverture de notre débat, que la réflexion collective est finalement toujours plus productive que la réflexion individuelle et nous espérons que vous ne serez pas sourdes aux propositions du Sénat.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – Mme Nassimah Dindar applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, mes chers collègues, qu’elles concernent les mineurs ou les majeurs, qu’elles se déroulent sur internet ou dans la rue, toutes les violences sexuelles et sexistes doivent être dénoncées et combattues avec fermeté.
Pour cela, il apparaît nécessaire de mieux sensibiliser et éduquer l’ensemble de la société à cette problématique qui connaît un développement croissant. Aussi, nul ne saurait remettre en question, au sein de cet hémicycle, les objectifs poursuivis par ce projet de loi.
Sur un sujet complexe, on ne peut pas apporter une réponse hâtive. Il y va de la qualité de la loi. Je me félicite donc que la commission des lois de notre assemblée, dans sa sagesse, ait pris le temps de la réflexion avec la création d’un groupe de travail pluraliste sur les infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs.
Car il apparaît clairement que, si ce projet de loi contient des évolutions importantes du code pénal, son effectivité et sa clarté nécessitent en revanche des améliorations.
Ainsi, la commission des lois a notamment réparé des oublis majeurs du projet de loi en le complétant par des volets relatifs à la prévention des violences sexuelles et sexistes et à l’accompagnement des victimes, déjà prévus par le Sénat lors de l’adoption, au mois de mars 2018, de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles.
Afin de faciliter les poursuites criminelles en matière de viol commis à l’encontre de mineurs, la commission des lois a choisi de protéger tous les mineurs, sans distinction d’âge, en inversant la charge de la preuve en matière de viol sur mineurs lorsque ceux-ci sont incapables de discernement ou en cas de différence d’âge significative entre l’auteur et la victime mineure.
La commission a également prévu de transformer la contravention d’outrage sexiste en un délit, puni d’une amende de 3 750 euros, et de mieux lutter contre le cyberharcèlement en conférant de nouvelles obligations aux plateformes et aux hébergeurs sur internet.
Madame la ministre, madame la secrétaire d’État, malgré la gravité du sujet, je conclurai par un petit clin d’œil, en appelant le ministre de l’éducation nationale, qui vient d’offrir Les Fables de La Fontaine à tous les élèves de CM2, à une explication de texte, notamment sur ces trois vers de La Laitière et le Pot au lait, après que Perrette a renversé son pot de lait :
« Sa fortune ainsi répandue,
Va s’excuser à son mari,
En grand danger d’être battue. »
Autres temps, autres mœurs…
Sourires.

Madame la garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce texte de loi, tel que modifié par la commission des lois.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, sur des travées du groupe socialiste et républicain, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains, ainsi qu ’ au banc des commissions.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, madame la rapporteur, mes chers collègues, dans Totem et tabou, Freud présentait le tabou comme « le plus vieux code non écrit de l’humanité », destiné à préserver les personnes importantes ou, au contraire, vulnérables, telles que les enfants, par la transmission de règles morales implicites assimilées inconsciemment par les individus. Si l’inceste figure parmi ces interdits universels, force est de constater que la seule existence de ce tabou n’est pas suffisante pour empêcher la transgression de cet interdit.
Dans nos sociétés contemporaines, différentes lois pénales ont donc explicité ces interdits et ont progressivement protégé les mineurs des violences sexuelles dont ils peuvent être les victimes.
Les différentes auditions menées par notre groupe de travail, piloté par notre collègue Marie Mercier, ont permis de souligner la nécessité de parler de ces violences particulières et de l’importance de les faire sortir de la zone d’ombre où le tabou les maintient parfois. C’est pourquoi, de façon générale, nous nous félicitons de toutes les occasions données au législateur d’évoquer les violences sexuelles commises sur mineurs, dans l’espoir que les débats tenus dans cet hémicycle servent de caisse de résonance et participent à la prévention de ces actes, que nous appelons de tous nos vœux.
Je voudrais à ce titre rappeler, parmi les constats dressés par notre rapporteur, l’aspect éludé par ce projet de loi que sont les violences sexuelles exercées par des mineurs sur d’autres mineurs. Comme le montre une étude, à Paris, 44 % des mis en cause pour un viol commis sur un mineur sont également mineurs et, parmi eux, 42 % avaient entre dix et quatorze ans au moment des faits. Ces quelques données montrent, me semble-t-il, l’importance que nous devons porter à l’éducation préventive auprès des plus jeunes quant au respect du corps d’autrui, et la vigilance qui incombe aux adultes encadrant les mineurs au moment de la découverte de leur sexualité. Elles posent également la question de l’accompagnement des enfants coupables de telles violences sexuelles.
Madame la garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les interventions des uns et des autres montrent qu’il n’y a pas aujourd’hui d’opposition à l’objectif fixé par le deuxième titre de ce projet de loi. Cela devrait augurer de débats apaisés. Les seuls désaccords qui persistent concernent en réalité les modalités pénales de cette protection et la latitude accordée aux juridictions dans cette tâche.
C’est pourquoi nous nous interrogeons sur la pertinence de l’intégration des deux premiers titres du projet de loi à un texte également consacré à la lutte contre les violences sexistes, s’inscrivant, lui, dans le cadre de la politique du Gouvernement de promotion de l’égalité entre les sexes. Certains aspects de la réforme de la justice, qui sera examinée à l’automne, auraient mérité d’être discutés avec la question du risque de correctionnalisation lié à la création d’un délit d’atteinte sexuelle avec acte de pénétration – je pense à la création des tribunaux criminels.
Sur l’allongement du délai de prescription de vingt à trente ans, je vous avais fait part de mon cheminement lors de l’examen de la proposition de loi, adoptée au Sénat le 27 mars dernier. Si cet allongement est acceptable dans une perspective protectrice à l’égard des victimes, en revanche, la transformation en une imprescriptibilité déséquilibrerait considérablement l’échelle des prescriptions, adossée à celle des peines.
Concernant le cœur du projet de loi et la question de la fixation d’un seuil d’âge en dessous duquel une pénétration sexuelle commise par un majeur sur un mineur devrait être systématiquement regardée comme un viol, mon groupe est particulièrement partagé.
La multiplication de seuils parallèles à celui déjà fixé par l’article 227-25 du code pénal relatif à l’atteinte sexuelle est de nature à créer des confusions.
Les exigences constitutionnelles et conventionnelles relatives à la présomption d’innocence ne facilitent pas la rédaction de cette disposition, en raison de l’impossibilité d’établir des présomptions en matière criminelle.
D’un autre côté, il y a les arguments tout à fait compréhensibles des victimes mineures de violences sexuelles qui considèrent qu’une interdiction absolue aurait permis de mieux les protéger.
Nous sommes donc majoritairement favorables à la rédaction équilibrée proposée par notre rapporteur, mais certains d’entre nous soutiendront la proposition d’établir un seuil à l’âge de treize ans. Il faut d’ailleurs souligner que ces deux dispositions ne sont pas contradictoires, mais complémentaires.
Toujours au titre Ier, notamment à l’article 2 bis C, nous soutiendrons les dispositions venant alourdir les peines en cas de non-assistance et de non-dénonciation des crimes et délits commis contre l’intégrité corporelle des mineurs de quinze ans, qui reprennent, là aussi, les travaux effectués par notre groupe de travail.
Enfin, nous tâcherons de nous inspirer de l’héritage discret, mais décisif, de Simone Veil au moment d’évoquer la lutte contre les violences sexistes.
S’inscrivant dans la même « maternité », ma collègue Françoise Laborde et les autres membres de la délégation aux droits des femmes ont formulé des propositions intéressantes visant à diversifier les outils de lutte contre les violences sexistes.
Nous soutenons, bien entendu, les dispositions venant condamner les raids numériques. En revanche, si certains d’entre nous sont favorables à l’élargissement de la définition du harcèlement sexuel proposé par l’Assemblée nationale, d’autres craignent qu’elle ne vienne créer la confusion avec le délit d’outrage sexiste proposé à l’article 4, le risque étant, comme l’a souligné le Défenseur des droits, que l’on vienne « contraventionnaliser » le harcèlement sexuel par l’ajout des comportements à connotation sexiste à la définition du harcèlement. Nous soutenons les améliorations introduites par notre rapporteur sur ce point.
Sur le nouvel outrage sexiste, si nous sommes en plein accord avec l’objectif de faire cesser ces comportements intolérables, nous sommes plus partagés sur les réponses à apporter à ces agissements. La réponse législative que nous apportons m’apparaît difficilement applicable, puisqu’elle repose en grande partie sur du flagrant délit.
Pour conclure, le groupe du RDSE, fidèle à sa tradition, votera selon ses sensibilités et selon le sort réservé à ses amendements.
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et sur des travées du groupe Union Centriste.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la ministre, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, madame la rapporteur, chère Marie, mes chers collègues, membre du bureau de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, c’est avec espoir et attention que j’ai étudié puis amendé ce projet de loi dont on ne peut qu’approuver les intentions, puisqu’il vise à lutter contre certaines violences sexuelles et sexistes.
Je ne reviendrai pas longuement sur l’article 1er du projet de loi. Ses dispositions me paraissent adéquates et conformes aux attentes des victimes.
En effet, l’allongement du délai de prescription pour les infractions sexuelles commises sur les mineurs participe d’une véritable reconnaissance de la difficulté pour une victime de ces agressions de les admettre et de porter plainte. Allonger à trente ans la durée de la prescription en la rendant identique à celle qui s’applique, entre autres, aux crimes de guerre démontre aux victimes l’importance accordée à leur souffrance.
L’article 2, visant à renforcer la répression des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs, qu’il s’agisse de viols ou d’agressions sexuelles, et tendant à élargir la surqualification pénale d’inceste, doit être examiné avec beaucoup d’attention et de délicatesse.
La proposition de la commission des lois visant à créer une présomption de contrainte en inversant la charge de la preuve en matière de viol sur mineurs mérite d’être examinée avec intérêt, car elle introduit la notion d’incapacité de discernement du mineur et la différence d’âge significative.
Cela laisse entendre également que c’est à la personne majeure de faire preuve de discernement. Cette disposition est primordiale et a toute mon approbation, car elle permet de protéger les victimes mineures, toutes les victimes mineures sans seuil d’âge.
En ce qui concerne la création d’une contravention pour outrage sexiste, je note que le texte lui accorde une véritable place dans notre code pénal, ce que le projet de loi initial ne s’était pas résolu à déterminer.
Peut-être les violences dont sont victimes les femmes et parfois les hommes dans la rue, les transports en commun, au travail, à la maison, cesseront-elles enfin d’être considérées comme anecdotiques. Il est important, ne serait-ce que d’un point de vue moral, de leur accorder une véritable considération.
Cette infraction permettra de faire prendre conscience aux auteurs de la gravité de l’agression dont ils se rendent coupables, et ce serait déjà un bon début. Pour que la dissuasion soit effective, je suis favorable à la transformation de la contravention en délit.
Cependant, je doute que la création de cette infraction soit réellement dissuasive ou que le paiement d’une amende et, éventuellement, l’accomplissement d’un stage soient suffisants pour empêcher la récidive.
Il me semble plutôt que, pour ce qui est des insultes, des sifflets, des moqueries, il est avant tout question d’éducation et de prévention.
Nous devons avoir à cœur de protéger les victimes d’agressions sexuelles ainsi que les victimes de sexisme, j’y suis particulièrement sensible et je sais que, dans cet hémicycle, nous le sommes tous.
Vous l’aurez compris, j’ai tout de même un certain nombre de réserves à émettre sur ce texte, et la première d’entre elles est son manque d’ambition sur un point essentiel. Un volet est totalement absent du projet de loi, madame la garde des sceaux, madame la secrétaire d’État : qu’en est-il de la lutte contre l’inégalité salariale entre les hommes et les femmes à compétences et à poste égaux ? Ne pensez-vous pas qu’il s’agit également là d’une violence sexiste à l’égard des femmes ?
Vous nous l’avez rappelé, madame la garde des sceaux, le président Emmanuel Macron déclarait, le 25 novembre dernier, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, que l’égalité entre les femmes et les hommes serait la « grande cause du quinquennat ». J’avais formé à cet égard beaucoup d’espoirs.
Peut-être le Gouvernement compte-t-il agir en ce sens dans les prochains mois ? Nous l’espérons. Si tel est le cas, vous pourrez compter sur l’engagement et la détermination des sénatrices et des sénateurs de cet hémicycle pour répondre aux questions que soulève ce sujet majeur.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste, ainsi qu ’ au banc des commissions.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, madame la rapporteur, mes chers collègues, pendant les cinq minutes qui me sont imparties, je me concentrerai sur l’article 2 du projet de loi. L’examen des articles nous permettra de nous exprimer sur les autres aspects du projet de loi.
Il y a quelques mois, le grand public découvrait un angle mort dans la protection des enfants contre les violences sexuelles, un angle mort que les spécialistes connaissaient, je le précise, afin de lever les suspicions de ceux qui pensent que nous légiférons sous la pression des faits divers ou des médias. Cet angle mort se résume ainsi : en l’absence de violence, menace, contrainte ou surprise, la qualification de viol ne peut être retenue à l’occasion d’une relation sexuelle avec pénétration d’un majeur sur un enfant, et c’est la qualification d’atteinte sexuelle sur mineur qui est retenue. Cette qualification délictuelle est jugée en correctionnelle ; elle n’est pas criminelle et n’est donc pas jugée en cour d’assises.
Or je considère, et nous sommes nombreux à partager ce point de vue, qu’une relation sexuelle avec pénétration entre un majeur et un mineur doit être un crime et non un délit, qu’il est indispensable qu’un seuil d’âge, en l’occurrence treize ans, soit fixé et qu’il ne saurait être question ni de maturité sexuelle ni de discernement d’un enfant qui consentirait à un acte sexuel avec un adulte.
Lorsque nous parlerons de l’outrage sexiste, vous nous direz probablement, madame la ministre, que cette contravention a une vertu éducative et qu’elle pose un interdit clair et lisible. Si ce raisonnement, que je partage, est fondé pour l’outrage sexiste, il l’est, a fortiori, pour le crime de violences sexuelles sur enfant.
Depuis l’automne dernier, nous avons tous, à un moment ou à un autre, été d’accord, le Président de la République, les délégations aux droits des femmes du Sénat et de l’Assemblée nationale, vous-même, les experts, les professionnels, les associations, les magistrats, je pense particulièrement au procureur Molins, pour fixer un seuil dit de non-consentement et punir comme un viol une relation sexuelle entre mineur et majeur.
Or, où en sommes-nous aujourd’hui ? Cette volonté a été torpillée à la fois par le Conseil d’État et par la commission des lois de notre assemblée. Deux arguments ont tourné en boucle : l’inconstitutionnalité pour cause d’irréfragabilité d’une prétendue présomption et l’absence de l’intentionnalité de l’auteur.
L’argument de l’inconstitutionnalité n’est, à mon sens, pas sérieux. D’une part, la rédaction soumise au Conseil d’État n’est pas celle que nous vous proposons aujourd’hui. Nous nous étions fourvoyés sur la voie de l’extension du viol. Nous suivons aujourd’hui une tout autre logique. On ne pourra donc pas opposer l’avis du Conseil d’État à l’amendement que nous vous soumettons.
De surcroît, et je m’adresse plus particulièrement et respectueusement à vous, madame la garde des sceaux, le Conseil d’État n’est pas le clone du Conseil constitutionnel.

La loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, dite loi HADOPI, ou encore la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, dite loi Burka, pour ne donner que ces deux exemples, ont prouvé que le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel pouvaient diverger. Et je cite à cet égard Jean-Marc Sauvé qui soulignait, à l’occasion d’un colloque de droit constitutionnel : « Sous le ciel de la Constitution, plusieurs analyses […] peuvent donc coexister, même si, cela va de soi, le Conseil constitutionnel a le dernier mot. »
Les arbitrages rendus par le Gouvernement n’ont pas pris en compte la subtilité du droit constitutionnel et ont donné au Conseil d’État le premier et le dernier mot.
En ce qui concerne l’exigence d’une intention qui, comme le disait Aristote, fait la culpabilité et le délit, je ne vois pas en quoi la création d’un crime de violences sexuelles sur enfant y porterait atteinte. Il n’y a pas de pénétration involontaire, alors qu’il y a, en effet, des homicides involontaires. Je ne vois pas davantage comment un pénis peut se trouver involontairement dans l’anus, le vagin ou la bouche d’un enfant.

En revanche, j’ai bien identifié un argument qui revient chez ceux qui combattent ce crime de violences sexuelles : la crainte de traîner aux assises un auteur qui ne serait pas coupable, car il serait la victime d’une Lolita. À ce propos, j’ouvrirai une petite parenthèse : la jeune Lolita de Nabokov était bien une victime de violences sexuelles, et je m’étonne que l’on ne parle jamais des « Lolitos », madame Schiappa, alors que les petits garçons représentent un quart des victimes, d’après l’enquête Violences et rapports de genre, dite Virage, et qu’ils le sont majoritairement au cours de leur minorité.
En bref, alors qu’on devrait légiférer pour mieux protéger les enfants, on légifère en réalité dans le souci de protéger des auteurs de pénétrations sur enfants…

… au motif qu’ils auraient « ignoré » qu’ils pénétraient un enfant.
Mes chers collègues, madame la garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, dans cette affaire, le droit constitutionnel et les principes généraux du droit pénal sont dévoyés. Ils ne sont que les alibis de la résistance d’une minorité active de notre société à poursuivre devant les assises les prédateurs auteurs de violences sexuelles sur enfants.
J’ai noté que le Gouvernement n’a pas déposé d’amendement rétablissant les alinéas 14 et 15 de l’article 2. Vous avez même annoncé que vous retiriez cette infraction d’atteinte sexuelle avec pénétration, c’est bien. Dès lors, que reste-t-il de cet article ? Une aggravation des peines et des dispositions interprétatives. Tant mieux, mais nous sommes loin des ambitions annoncées.
Entre le dépôt du projet de loi, la lecture à l’Assemblée nationale et aujourd’hui, la société s’est mobilisée. Un sondage publié hier indique que, si nous allons plus loin, nous serons soutenus par les Français. C’est pourquoi, madame la garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, je tente de vous convaincre d’émettre un avis favorable sur notre amendement créant un crime de violence sexuelle sur enfant, et vous invite, mes chers collègues, à l’adopter le moment venu.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, et sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe Union Centriste.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, madame la rapporteur, mes chers collègues, ce projet de loi vise à mieux lutter contre les violences sexuelles et sexistes. À cette fin, il propose d’allonger certains délais de prescription, de mieux sanctionner les viols commis à l’encontre des mineurs, de mieux réprimer les faits de harcèlement sexuel ou moral, notamment lorsqu’ils sont commis en ligne, et de verbaliser les outrages sexistes.
Le groupe Les Indépendants souscrit pleinement aux objectifs fixés par ce texte. Nul ici ne peut en contester la légitimité, car nous sommes tous convaincus de la nécessité de donner un coup d’arrêt à un certain nombre de violences qui continuent à se produire, allant parfois jusqu’à l’inhumain. Trop souvent et en trop grand nombre, les mineurs demeurent victimes d’infractions sexuelles ou, plus largement, de violences à caractère sexuel.
Au sein de notre assemblée, mes chers collègues, la commission des lois a apporté une contribution décisive au débat au travers, d’une part, d’un rapport d’information intitulé Protéger les mineurs victimes d ’ infractions sexuelles, présenté en février 2018 par notre collègue Marie Mercier, et, d’autre part, d’une proposition de loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles. Ces deux contributions furent le fruit d’un groupe de travail, dont j’ai fait partie, mis en place en octobre 2017.
Toutefois, je voudrais vous faire part d’un certain nombre de remarques.
En premier lieu, comme je l’avais déjà évoqué non seulement en commission, mais également à cette tribune, j’aurais souhaité, à titre personnel, que la notion d’imprescriptibilité figurât à l’article 1er. Cette imprescriptibilité, j’en reste persuadé, permettrait que la parole des victimes soit enfin libérée.
En deuxième lieu, je regrette que le Gouvernement ait fait le choix de la procédure accélérée. Sur une question aussi grave et complexe, qui engage l’avenir de notre société à travers nos enfants, il eût été préférable de laisser le temps du débat au Parlement.
En troisième lieu, je déplore que le Gouvernement n’ait pas associé le Sénat à l’élaboration de ce projet de loi, alors que, précisément, la commission des lois avait constitué un groupe de travail pluraliste sur ce sujet.
Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants partage la même ambition que le Gouvernement. Il votera donc en faveur de ce texte, dont l’effectivité et la clarté ont été améliorées par la commission des lois du Sénat.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires et sur des travées du groupe Union Centriste, ainsi qu ’ au banc des commissions.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteur, chère Marie Mercier, « La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits ». Plus que jamais, notre action doit être guidée par l’article 1er de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, proposée par Olympe de Gouges à l’Assemblée nationale en 1791.
C’est dans cet esprit, je le sais, que notre collègue Marie Mercier a travaillé avec responsabilité et détermination sur ce projet de loi, afin de le renforcer et d’en faire un véritable outil au service des femmes et des jeunes filles de France en particulier.
Je tiens à lui témoigner mon total soutien et ma reconnaissance pour la tâche qu’elle a su accomplir, parfois dans des conditions difficiles, mais jusqu’au bout, sans jamais abandonner. Merci, chère collègue !
Aujourd’hui, il est urgent d’agir pour lutter efficacement contre les violences sexuelles et sexistes. Au premier trimestre de 2018, les services de police ont traité environ 170 affaires par jour. Sur ces trois mois, le nombre des viols a augmenté de 12 %.
La montée des violences envers les femmes doit nous alarmer, tant le respect de leur intégrité physique et psychologique est devenu un véritable enjeu de société. Ces violences peuvent frapper chacun d’entre nous, au sein de notre environnement, de nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, et touchent, il faut le rappeler, toutes les catégories sociales.
Un crime sexuel n’est pas seulement une abomination. Il constitue aussi un violent et profond traumatisme chez sa victime, parfois jeune. Comment accepter plus longtemps que la prescription intervienne au bout de vingt ans ? Vingt années ne suffisent pas toujours pour purger la peur et refermer les plaies. Il est donc indispensable de porter ce délai à trente ans.
Au sein de la commission des lois, il nous a d’ailleurs paru nécessaire d’empêcher la prescription de courir avant que la victime puisse elle-même dénoncer les faits aux autorités. Nous devons aider les victimes à libérer leur parole, afin qu’elles puissent engager des poursuites pénales pouvant aboutir à des résultats concrets.
Bien évidemment, notre collègue Marie Mercier a été particulièrement attentive à la question des viols commis sur les mineurs, crimes particulièrement monstrueux qui traumatisent à jamais de jeunes enfants ou de jeunes adultes en construction. C’est la raison pour laquelle la commission des lois a validé sa proposition de « présomption de contrainte » pour les actes sexuels les impliquant, déjà votée par le Sénat en mars dernier.
Par ailleurs, il est grand temps de faire comprendre que les femmes ne sont pas des objets. En ce sens, la transformation de l’outrage sexiste en délit permettra de garantir aux femmes le respect de chacune d’entre elles sur la voie publique, à condition, bien évidemment, que davantage de moyens financiers et humains y soient consacrés.
Mes chers collègues sénateurs et sénatrices, soyons unis pour combattre tout ce que les femmes subissent dans certaines villes et dans certains quartiers, des pressions, aussi psychologiques que physiques, qui les contraignent à accepter l’enfermement et qui les placent sous la dépendance masculine, allant même parfois jusqu’à les rendre invisibles.
Il n’a jamais été aussi urgent d’envoyer un signal clair et fort à toutes les femmes, à toutes les jeunes filles, pour qu’elles sachent que la loi et la République sont à leur côté et ne les abandonneront jamais, afin de les protéger et de préserver leur liberté d’être et de vivre.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste, ainsi qu ’ au banc des commissions.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, madame la rapporteur, mes chers collègues, beaucoup d’entre vous le savent, j’ai consacré une part importante de ma vie publique à la protection de l’enfance, comme ministre en charge notamment de la famille et comme président de conseil départemental. J’ai ainsi eu l’honneur de défendre devant le Parlement, en 2007, la loi refondant la protection de l’enfance, adoptée à l’unanimité des deux chambres.
Puisque Mme la secrétaire d’État et plusieurs d’entre vous, chers collègues, nous ont invités à être dignes de l’héritage de Simone Veil, je m’efforcerai, moi aussi, d’être à la hauteur de la fidélité que je lui dois, ayant été l’un de ses plus proches collaborateurs – je pense être le seul dans ce cas au sein de notre assemblée.
Je n’ai qu’un objectif aujourd’hui, protéger les enfants et, plus précisément, protéger tous les enfants, et pas seulement une partie d’entre eux. Et je pense que la solution proposée par la commission des lois est la plus protectrice de toutes.
Je veux rappeler que le droit pénal français est déjà un droit très protecteur de l’enfant victime, même si nous pouvons bien sûr encore l’améliorer, en particulier sur la prescription et sur la caractérisation de la contrainte qui entre dans la définition du viol ; j’y reviendrai.
Aujourd’hui, le viol d’un enfant, c’est vingt ans de prison ; l’agression sexuelle d’un enfant, dix ans ; l’atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans, cinq ans. Fort heureusement, les magistrats sont généralement d’une grande sévérité pour réprimer ces crimes et ces délits graves. C’est d’ailleurs le moins que l’on puisse attendre face à l’intolérable. Nous proposons d’aller encore plus loin.
Il peut, certes, y avoir des décisions de justice choquantes. Mais le meilleur moyen de corriger les erreurs d’une justice qui reste une œuvre humaine n’est pas de modifier la loi pénale quand elle est déjà sévère, c’est de rénover et de réformer la justice, comme le Sénat l’a proposé depuis plusieurs années, et de la réformer vigoureusement.
Si nous devions modifier la loi pénale chaque fois que le réquisitoire d’un procureur ou le jugement d’un tribunal nous choque, alors nous ferions fausse route et nous serions, de surcroît, inefficaces. Dans un État de droit, la régulation du fonctionnement des tribunaux se fait par l’appel et la cassation.
À la suite d’un avis très rigoureux du Conseil d’État, le Gouvernement a dû renoncer à créer une présomption irréfragable de culpabilité, c’est-à-dire une présomption qui ne permet pas à l’accusé d’apporter la preuve de son innocence, pour tout acte sexuel avec pénétration commis par une personne majeure sur une personne mineure de quinze ans. L’Assemblée nationale l’a suivi. En effet, nos droits fondamentaux prévoient, et c’est à notre honneur, que même le pire des assassins a le droit de plaider sa cause et de tenter de démontrer son innocence pour se disculper. Un tel principe ne saurait connaître de dérogation et n’en a jamais connu dans notre République. Il n’en connaît d’ailleurs nulle part en Europe.
Tout automatisme dans la sanction d’un crime est un déni de justice. Le rôle du juge consiste à réunir les preuves du crime et à apprécier la réalité de l’intention criminelle. La présomption irréfragable de culpabilité ferait de lui une sorte de greffier, voire de robot, constatant des faits sans avoir de responsabilité d’appréciation pour les qualifier ou non de crimes. Dans des affaires si graves, il faut pourtant entendre chacun, respecter les droits de la défense de l’accusé et vérifier la réalité du crime avant d’enfermer pour vingt ans un individu. C’est parce que cette fonction aura été bien remplie que la peine sera légitime, si lourde soit-elle, et nous souhaitons bien sûr qu’elle soit lourde quand la victime est un enfant.
Ces principes ont une force considérable. Le Gouvernement l’a admis, comprenant qu’il ne suffisait pas de bonnes intentions pour faire de bonnes lois. Il a donc inventé une formule consistant à éclairer la cour d’assises sur l’interprétation de la notion de contrainte morale, qui permet de définir un viol sans violence ni menace.
Cette proposition est nettement meilleure que la précédente, mais elle comporte deux faiblesses : d’une part, l’introduction d’un seuil d’âge, quel qu’il soit, ne permet pas de protéger tous les enfants ; d’autre part, c’est une simple disposition interprétative, sans portée juridique, qui aurait pu relever en réalité d’une instruction de la Chancellerie aux procureurs.
La solution adoptée par notre assemblée le 27 mars dernier, à l’unanimité moins trois voix, me paraît bien meilleure, car elle est plus sévère pour l’agresseur. Aujourd’hui, l’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que le procureur de la République ait prouvé sa culpabilité. Notre solution consiste à énoncer une présomption simple de contrainte morale quand le discernement de la jeune victime, quel que soit son âge, rend impossible un consentement libre et éclairé.
Cette présomption de viol imposerait à l’agresseur de prouver son innocence, sa culpabilité étant présumée jusqu’à preuve contraire. Il y aurait donc bien une inversion de la charge de la preuve. La différence d’âge entre l’agresseur et la victime serait également prise en compte. Un agresseur de trente ans ne pourrait jamais se prévaloir de l’éventuel discernement d’une victime de douze ans pour s’exonérer de son crime. Cette solution est beaucoup plus rigoureuse pour l’accusé et beaucoup plus protectrice pour la victime que la proposition actuelle du Gouvernement.
Certains de nos collègues, qui ont pourtant voté la proposition de loi adoptée par le Sénat en mars dernier, ont considéré qu’il fallait en réalité reprendre la proposition initiale du Gouvernement, en décidant que « constitue un crime puni de vingt ans de prison, tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant de moins de treize ans ».
Mes chers collègues, je vous invite à être cohérents par rapport au vote de mars. La mise en œuvre d’une telle proposition apporterait aux enfants une fausse protection : comment pourrait-on justifier que la protection d’un enfant de « treize ans moins un jour » soit différente de celle d’un enfant de « treize ans plus un jour » ? Accepterions-nous qu’une relation amoureuse entre deux mineurs prenne soudain un caractère criminel, simplement parce que l’aîné des deux aura fêté son dix-huitième anniversaire ? Que décideront les juges en cas d’agression sexuelle sur des enfants de treize à quinze ans si le législateur marque lui-même la nécessité de différencier ces victimes au regard de la loi pénale ?
Nous avons bien sûr à nous préoccuper de la constitutionnalité de ce que nous votons, car, la Constitution, ce sont les droits fondamentaux des Français. C’est ainsi que nous continuerons à mériter d’être considérés comme la chambre de la réflexion, de la sagesse, des libertés, mais aussi comme une assemblée réellement protectrice de l’enfance en danger.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe Les Indépendants – République et Territoires. – Mme Josiane Costes applaudit également.
Madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je tiens à apporter quelques éléments de réponse à certaines de vos interventions.
Monsieur le président de la commission des lois, vous avez tout à fait raison de rappeler que notre droit est déjà fourni en ce qui concerne non seulement la protection de l’enfance, mais aussi, plus largement, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C’est précisément parce que notre droit est déjà fourni en la matière que le projet de loi dont nous débattons aujourd’hui est court. C’est aussi parce que la loi est déjà dense que nous entendons travailler sur ce qui, dans le passé, voilà encore dix, vingt ou trente ans, pouvait sembler indicible ou relever de la fatalité et qui, désormais, entre dans les radars des politiques publiques. Je pense notamment au harcèlement de rue ou aux phénomènes de raid numérique et de cyberharcèlement. Je vous remercie donc de ce rappel. J’y insiste, c’est justement parce que notre droit est fourni que ce projet de loi est un texte court et, je pense, efficace.
Il nous a été adressé une interpellation sur la question de l’éducation. J’avais déjà eu l’occasion de m’exprimer à cet égard. Le projet de loi que nous portons, avec Nicole Belloubet, vise à renforcer la condamnation des violences sexistes et sexuelles. C’est vraiment l’objet de ce texte. Il n’y a pas de volets préventifs, parce que ces derniers soit sont déjà dans la loi, soit relèvent de politiques publiques et pas du législatif. S’ils sont absents du projet de loi, cela ne veut pas dire qu’ils soient absents de l’action du Gouvernement. Je pense notamment à la mise en œuvre de lois déjà existantes.
Vous le savez toutes et tous, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, la loi prévoit que l’éducation à la vie affective et sexuelle fait partie des sujets abordés dans le monde éducatif. Cette loi n’est pas mise en œuvre. Nous avons travaillé, avec Jean-Michel Blanquer, sur un audit depuis maintenant plusieurs mois, mené auprès des établissements et des rectorats, qui nous a révélé ce que nous pressentions déjà et qui nous était remonté par les acteurs de terrain, à savoir que cette loi n’est pas mise en œuvre. Nous avons donc lancé une circulaire à l’adresse des recteurs, demandant à chacun de faire appliquer cette loi, qui prévoit trois séances d’éducation à la vie affective et sexuelle par année scolaire. Nous leur avons aussi adressé un catalogue mentionnant l’ensemble des associations qui ont un agrément pour intervenir en milieu scolaire. Nous avons par ailleurs relancé une tournée d’interpellations auprès des associations, afin que ces séances puissent être mises en œuvre et menées réellement par des personnes compétentes et spécialistes.
En outre, nous créons des référents « égalité » : à partir de la prochaine rentrée scolaire, un référent ou une référente « égalité » sera présent dans chaque établissement scolaire, notamment pour prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Avec la mallette des parents, nous communiquerons avec les parents sur ces questions de manière très claire.
Vous le voyez, il y a une volonté, de la part de mon collègue Jean-Michel Blanquer et de la mienne, d’agir pour l’éducation face aux violences sexistes et sexuelles, même si la question ne relève pas du présent projet de loi.
De la même manière, vous avez appelé notre attention sur les dispositions concernant l’égalité salariale. Par définition, celles-ci ne figurent pas dans un texte qui vise à mieux condamner les violences sexistes et sexuelles. Néanmoins, nous avons pris un certain nombre de dispositions importantes, qui ont été, il est vrai, très peu relayées dans les médias, et je le déplore, dans le cadre du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, défendu par Muriel Pénicaud. Une fois que la loi sera promulguée, du moins si la mesure votée à l’Assemblée nationale est maintenue, les employeurs des entreprises les plus importantes auront l’obligation de calculer et de publier les écarts de salaires. C’est un pas important vers la transparence des inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Ces employeurs disposeront alors de trois ans pour résorber ces écarts de salaires ; passé ce délai, ils s’exposeront à des pénalités financières.
Ce sont des dispositions très importantes. Cela fait plusieurs générations que les inégalités de salaires entre les femmes et les hommes sont interdites par la loi. Mais cela fait aussi des générations que la loi n’est pas appliquée et que l’écart des salaires entre les femmes et les hommes oscille entre 9 % et 27 %. Le Gouvernement a pris ces dispositions pour lutter fermement contre de telles inégalités. Ce sont des dispositions législatives. Je vous fais grâce des dispositions des politiques publiques, afin que nous ayons le temps d’entrer dans le cœur des débats, mais je suis bien sûr à la disposition de toute sénatrice ou de tout sénateur qui souhaiterait que nous puissions évoquer ce sujet en parallèle.
Madame de la Gontrie, vous avez fait l’inventaire de ce qui a pu être fait par les précédents présidents de la République, que nous saluons tous, ainsi que leurs ministres respectifs. Je me permets d’ajouter, pour que l’inventaire soit complet, deux textes importants qui n’ont pas été cités : d’une part, évidemment, la loi de Najat Vallaud-Belkacem, qui a apporté de nombreuses avancées pour l’égalité entre les femmes et les hommes ; d’autre part, la loi Copé-Zimmermann, qui a permis de faire progresser la France sur les questions touchant à la place des femmes dans la gouvernance des entreprises.
On dit, en Corse, que c’est à la fin de la cueillette que l’on compte les figues. Il est donc un peu tôt, six mois après le lancement de la grande cause du quinquennat, pour faire un bilan de celle-ci, puisque, comme son nom l’indique, elle est quinquennale. Je propose que nous fassions le bilan et le droit d’inventaire à la fin du quinquennat. D’ores et déjà, un certain nombre de dispositions ont été prises et sont en cours de mise en œuvre. Sont ici en débat l’allongement des délais de prescription, le harcèlement de rue, la meilleure condamnation des violences sexuelles. Je pense aussi aux contrats locaux en matière de lutte contre les violences conjugales, mis en place, dans chaque département, sur notre initiative, autour des préfets. Il y aura un partage d’informations entre la police, la justice, les travailleurs sociaux, les élus locaux, afin de mieux repérer, en amont, les femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales et de pouvoir les écarter du domicile conjugal.
Vous avez mentionné la Constitution. Les députés de la majorité, avec le Gouvernement, proposent d’inscrire l’égalité des sexes dans la Constitution. Je ne reviendrai pas sur les dispositifs prévus en termes d’égalité salariale. Je mentionnerai le congé maternité pour toutes les femmes, dont nous avions eu l’occasion de débattre au Sénat. C’est à mes yeux une avancée importante que de protéger l’ensemble des femmes dans leur maternité, quelle que soit la profession ou le statut qu’elles exercent, notamment pour les agricultrices et pour les professions libérales.
Je crois, madame de la Gontrie, avec tout le respect que je vous dois, que vous confondez le congé parental et le congé de paternité.
La directive de la Commission européenne visait le congé parental et non le congé de paternité. En revanche, le Gouvernement a commandé un rapport à l’IGAS, l’Inspection générale des affaires sociales, …
… dans le but d’améliorer justement le congé de paternité.
Par ailleurs, le Gouvernement mène un certain nombre de campagnes d’information. L’une, pour laquelle il investit 4 millions d’euros d’investissement, sera diffusée sur les écrans à partir de la rentrée afin d’interpeller les témoins. Nous avons conscience du rôle clé joué par les témoins de violences sexistes et sexuelles, qu’il s’agisse de violences intrafamiliales ou de harcèlement de rue. C’est un combat culturel que nous devons mener.
J’évoquerai également le plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les universités, que nous avons lancé, avec Frédérique Vidal, il y a trois mois de cela, et qui vise à mieux identifier et mieux pénaliser ces violences sexistes et sexuelles. Nous avons lancé en avril, avec Olivier Dussopt, un plan de lutte similaire dans la fonction publique, dont l’objectif est d’avoir désormais un double système de sanctions, comprenant notamment davantage de sanctions disciplinaires à l’égard des auteurs de violences sexistes et sexuelles. Je n’oublierai pas le plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail, que nous avons mené, avec Muriel Pénicaud, à la suite de sept mois de concertation des partenaires sociaux, sous l’égide du Premier ministre, afin d’instaurer une obligation d’information contre les violences sexistes et sexuelles au travail, de mettre en place des cellules RH d’alerte dans toutes les entreprises et de prévoir des formations importantes dans ce domaine.
Je mentionnerai aussi la plateforme de dialogue avec les policiers, la question des plaintes en ligne ou la formation de tous les professionnels, dès la crèche, comme cela a été indiqué par le Président de la République quand il a lancé la grande cause nationale du quinquennat.
Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, si nous sommes ici en train de débattre de la meilleure condamnation des violences sexistes et sexuelles, du cyberharcèlement au viol sur les mineurs en passant par le harcèlement de rue, ce n’est pas un hasard, ce n’est pas en réponse à l’actualité. Ce projet de loi avait été annoncé de longue date et faisait partie des engagements de campagne du Président de la République. Nous le présentons aujourd’hui pour nous mettre justement en conformité avec les engagements pris.
Applaudissements sur des travées du groupe La République En Marche et du groupe Union Centriste.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ajouterai quelques mots, pour aller, d’abord, dans le sens de ce que vous souligniez, madame Benbassa : ce que nous voulons tous, ici, c’est faire en sorte que l’on cesse de considérer la femme comme objet, mais qu’on la regarde plutôt comme sujet. Tel est bien l’objectif de notre discussion.
Madame Billon, je reviendrai sur le courrier que vous avez eu la gentillesse de m’adresser hier, auquel je réponds ici oralement. Vous proposez, comme vous l’avez rappelé voilà quelques instants, de prévoir la mention d’un crime de pénétration sexuelle sur mineur de treize ans. Bien sûr, cela pourrait avoir le mérite de la clarté, de la simplicité et je comprends que vous puissiez faire cette proposition.
Si nous ne l’avons pas retenue, c’est pour un certain nombre de raisons.
La première s’attache à la dissociation entre mineur de treize ans et mineur de quinze ans, que j’ai évoquée dans mon propos introductif, et au souhait de ne pas complexifier la situation par une différenciation liée à l’âge.
La seconde raison, bien que vous ne la considériez pas comme telle, s’attache au fait qu’il pourrait paraître difficile de créer une infraction purement formelle en matière criminelle, c’est-à-dire sans prise en compte de l’élément intentionnel. J’ai bien entendu ce que vous avez indiqué de manière extrêmement concrète, mais il n’empêche qu’il semble toujours important d’apprécier la réalité de l’intention criminelle, pour reprendre un propos du président de la commission des lois.
Surtout, la création d’une telle infraction présenterait, j’ai eu l’occasion de le dire également, l’inconvénient de ne pas pouvoir s’appliquer aux faits qui ont déjà été commis, puisque, vous le savez, il y a un principe à valeur constitutionnelle intangible de non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère. Je ne vois pas très bien comment on pourrait pallier cette difficulté. La force de la disposition interprétative que nous proposons serait évidemment d’être d’application immédiate, à la fois pour les affaires en cours et pour les affaires passées, même non encore découvertes.
Madame Gatel, vous avez évoqué deux points qui ont retenu mon attention, insistant de nouveau sur le risque de correctionnalisation. Bien que nous ayons supprimé la disposition retenant votre proposition, nous n’y reprenions pas la question de l’atteinte sexuelle avec pénétration. Je le redis, l’intention du Gouvernement n’est absolument pas d’aboutir à une correctionnalisation des crimes de viol. Soyons clairs, elle est bien de sanctionner les crimes de viol en tant que crimes. C’est la raison pour laquelle nous proposons une disposition sur la notion de contrainte ou de surprise, afin de faire en sorte, évidemment, que le viol soit plus aisément pris en compte en tant que crime.
Il est en effet toujours nécessaire d’avoir un continuum dans le domaine répressif, ce qui n’exclut pas les questions préventives, qu’a traitées Marlène Schiappa. Telle était notre volonté. La preuve en est, et je m’adresse à Mme la sénatrice Carrère, que, dans le projet de loi que je vous présenterai à l’automne, j’ai souhaité que nous puissions mettre en place des tribunaux criminels départementaux, parce que, je le répète, notre intention est bien que les crimes soient jugés en tant que crimes et qu’ils ne puissent pas être, pour toutes sortes de raisons, déqualifiés pour être jugés en tant que délits. C’est, pour nous, un objectif fondamental, et je souhaitais de nouveau le préciser.
Vous évoquez en outre, madame Gatel, la nécessité de renforcer les moyens de la justice. J’aurai l’occasion d’y revenir, ils seront effectivement renforcés, jamais assez, certes, mais en tout cas de manière extrêmement volontariste par le gouvernement actuel : plus de 1, 6 milliard d’euros, 6 500 emplois, etc.
Madame Rossignol, si j’ai pu apprécier l’hommage que vous avez rendu au Conseil constitutionnel et au Conseil d’État, les distinguant bien l’un et l’autre, en revanche, je suis vraiment en désaccord profond avec la phrase que vous avez prononcée quand vous avez énoncé que le Gouvernement avait le souci de protéger les auteurs des violences à enfants.
Je vous prie de m’excuser si je n’ai pas repris exactement vos termes. En tout cas, cette phrase-là, j’ai cru l’entendre.
Je ne commenterai pas plus avant. Vous savez bien que telle n’est évidemment pas la volonté du Gouvernement, je voulais juste le rappeler devant vous.
Monsieur le président Bas, je dois vous rendre hommage pour ce que vous avez le courage de dire quand vous énoncez que, dans un État de droit, la régulation des cours et des tribunaux se fait d’abord par l’appel et par la cassation, et pas nécessairement par les journaux ou par un projet de loi. Notre souhait, notre intention est évidemment de combler les failles qui peuvent exister dans notre arsenal juridique et, ce faisant, de concourir, comme vous le disiez, madame la rapporteur, à servir les victimes des violences sexuelles.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

J’informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination et du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence sont parvenues à un accord.
En revanche, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie n’est pas parvenue à un accord.

Nous reprenons l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DES MINEURS CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
Chapitre Ier A
Dispositions relatives aux orientations de la politique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes
(Division et intitulé nouveaux)

L’amendement n° 18 rectifié, présenté par Mmes de la Gontrie, Rossignol, Lepage, Blondin et Cartron, M. Courteau, Mmes M. Filleul, Jasmin, Monier, Meunier, Conway-Mouret et Lubin, MM. J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, conduisent une politique active de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, entendues comme l’ensemble des violences commises à raison du sexe de la victime, et pouvant prendre la forme de violences physiques, du harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles, du viol, d’injures, de violences psychologiques, du mariage forcé, des mutilations sexuelles féminines ou encore de la prostitution et de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Ils mobilisent l’ensemble de leurs compétences à l’élaboration et à la mise en œuvre de cette politique, et s’assurent de la mise en place d’outils efficaces pour le suivi et l’évaluation de l’ensemble de leurs actions.
La politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles comporte notamment :
- Des actions de prévention des violences sexistes et sexuelles ;
- Des actions permettant une juste condamnation des agresseurs ;
- Des actions destinées à protéger toutes les victimes, mineures et majeures, de violences sexistes et sexuelles.
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Cet amendement vise à affirmer un principe : le caractère transversal et obligatoire de la politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui relève à la fois de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Le diagnostic a été posé par différentes autorités : le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, la délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, mais aussi la commission des lois du Sénat, dans le cadre d’un travail non partisan mené voilà quelques mois.
Si nous voulons être efficaces, nous devons prévoir cette transversalité et consacrer des moyens à la hauteur, avec toujours trois objectifs caractéristiques, rappelés dans cet amendement : la prévention, bien sûr, la condamnation des agresseurs, mais aussi l’accompagnement des victimes. C’est pour cela qu’il nous a paru important que, en tête de ce texte, figurent cette ambition et ce principe de travail pour plus d’efficacité.

Ma chère collègue, je partage complètement l’objectif de cet amendement, mais, comme je l’avais indiqué en commission, il aurait davantage sa place dans le rapport annexé à l’article 1er A du projet de loi. Il n’est en effet pas possible de mentionner à deux endroits différents du texte la politique que l’État et les collectivités territoriales doivent mener contre les violences sexuelles et sexistes. Aussi, j’émets un avis favorable sous réserve de cette rectification.
Madame la sénatrice, je comprends l’objet de votre amendement, qui est de garantir le caractère transversal et obligatoire de la politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et les moyens à y consacrer.
Vous savez que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, je l’ai détaillée auparavant, est une priorité de l’action du Gouvernement. Mais force est de constater que, dans cet amendement, ne figure aucune obligation précise définie à la charge de l’État ou des collectivités. La disposition proposée n’a donc pas de caractère normatif.
Le présent texte est l’un des piliers d’un dispositif global et cohérent, dans le cadre de la grande cause nationale du quinquennat annoncée par le Président de la République. Je ne reviendrai pas sur les dispositions que j’ai déjà citées. Le fait que le secrétariat d’État dont j’ai la charge soit rattaché au Premier ministre garantit ce travail interministériel et le caractère transversal de la lutte nécessaire contre les violences sexistes et sexuelles, qui est la première priorité de cette grande cause du quinquennat. Le fait que nous défendions conjointement ce projet de loi, avec la garde des Sceaux, en est une illustration parmi d’autres que j’ai mentionnées précédemment.
En ce qui concerne les moyens, je signalerai que notre budget, pour 2018, s’élève à près de 30 millions d’euros, soit le budget le plus élevé jamais atteint. Il sera exécuté en totalité, puisque le Président de la République s’est engagé à ce que chaque budget voté soit un budget exécuté, pour avoir un budget sincère, par opposition au précédent budget, jugé insincère par la Cour des comptes. Ce sont 420 millions d’euros qui sont mobilisés en interministériel par l’ensemble du Gouvernement. Ainsi, le dispositif « téléphone grand danger » est financé par le ministère de la justice, à hauteur de 900 000 euros par an, les centres « psychotrauma », par le ministère de la santé, les plateformes de signalement des violences, par le ministère de l’intérieur, etc.
J’en profite pour préciser que, contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là, il n’y a aucune baisse des subventions versées aux associations nationales de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Certaines ont même été augmentées : par exemple, le Collectif féministe contre le viol recevra 60 000 euros supplémentaires pour l’année qui vient. J’ai déjà évoqué la campagne de sensibilisation financée à hauteur de 4 millions d’euros, ce qui en fait une campagne de grande ampleur pour mener ce combat culturel. Je mentionnerai l’appel à projets, d’un montant de un million d’euros, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles au travail dans l’ensemble des régions de France, afin de couvrir et de mailler véritablement le territoire. Il s’agit de faire en sorte que ces politiques publiques ne soient pas trop souvent concentrées sur Paris ou sur la région parisienne, en vue d’apporter des réponses à la spécificité de chaque territoire en métropole et outre-mer.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Madame de la Gontrie, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° 18 rectifié dans le sens proposé par Mme le rapporteur ?

Madame la présidente, madame la rapporteur, j’accepte tout à fait cette proposition de rectification qui consiste à déplacer l’amendement, sachant que, par l’amendement suivant, le Gouvernement propose de supprimer le rapport annexé. Mais nous verrons bien !

Je suis donc saisie d’un amendement n° 18 rectifié bis, présenté par Mmes de la Gontrie, Rossignol, Lepage, Blondin et Cartron, M. Courteau, Mmes M. Filleul, Jasmin, Monier, Meunier, Conway-Mouret et Lubin, MM. J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :
Après l’alinéa 1 :
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, conduisent une politique active de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, entendues comme l’ensemble des violences commises à raison du sexe de la victime, et pouvant prendre la forme de violences physiques, du harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles, du viol, d’injures, de violences psychologiques, du mariage forcé, des mutilations sexuelles féminines ou encore de la prostitution et de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Ils mobilisent l’ensemble de leurs compétences à l’élaboration et à la mise en œuvre de cette politique, et s’assurent de la mise en place d’outils efficaces pour le suivi et l’évaluation de l’ensemble de leurs actions.
La politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles comporte notamment :
- Des actions de prévention des violences sexistes et sexuelles ;
- Des actions permettant une juste condamnation des agresseurs ;
- Des actions destinées à protéger toutes les victimes, mineures et majeures, de violences sexistes et sexuelles.
Je rappelle que cet amendement porte désormais sur le rapport annexé à l’article 1er A.
La parole est à M. le président de la commission.

Il convient, madame la présidente, de réserver le vote de cet amendement ainsi rectifié, compte tenu du fait que l’amendement suivant, s’il était adopté, pourrait le rendre sans objet eu égard à son nouvel emplacement dans le texte.

Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la réserve est de droit, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de réserve formulée par la commission ?

La réserve est ordonnée.
En conséquence, le vote sur l’amendement n° 18 rectifié bis est réservé.
Le rapport sur les orientations de la politique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, annexé à la présente loi, est approuvé.
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES
(Division et intitulé nouveaux)
La loi d’orientation et de programmation renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes s’inscrit dans le cadre de l’article 34 de la Constitution, selon lequel « des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État ».
La lutte contre les violences sexuelles appelle une stratégie globale reposant sur quatre piliers : prévenir les violences sexuelles ; favoriser l’expression et la prise en compte de la parole des victimes le plus tôt possible ; améliorer la répression pénale des infractions sexuelles ; disjoindre la prise en charge des victimes d’infractions sexuelles du procès pénal.
Davantage que des évolutions législatives, la mise en œuvre de cette politique implique une revalorisation notable et durable des crédits et des effectifs qui lui sont alloués.
I. – PRÉVENIR LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES
A. – Mieux évaluer et connaître le nombre d’infractions sexuelles commises
Comme le souligne le plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants (2017-2019) : « La persistance des violences s’explique notamment du fait de leur invisibilité. Ce déni collectif face aux violences faites aux enfants est renforcé par l’absence de données statistiques ».
D’où la nécessité d’améliorer le recensement des violences sexuelles subies par les mineurs, notamment les plus fragiles, afin de les rendre visibles et de lever un tabou.
Des enquêtes de victimation régulière permettront d’estimer la prévalence et l’incidence des violences sexuelles infligées aux mineurs, d’évaluer les faits ne faisant pas l’objet d’une plainte et d’identifier les facteurs déterminants d’un dépôt de plainte. Des enquêtes de victimation spécifiques aux personnes handicapées seront également conduites, prenant en compte leur vulnérabilité et leur risque élevé d’exposition à ces violences.
Les recherches scientifiques sur les psycho-traumatismes et les mécanismes mémoriels consécutifs à un fait traumatique doivent être encouragées : à cette fin, les connaissances scientifiques doivent être largement diffusées afin de favoriser un consensus médical facilitant leur prise en compte.
L’observatoire national de la protection de l’enfance et le réseau des observatoires départementaux jouent également un rôle essentiel pour mieux connaître ces phénomènes trop souvent abordés à partir des seules statistiques judiciaires.
B. – Mener une politique de sensibilisation tous azimuts
La prévention des violences sexuelles et sexistes impose une politique ambitieuse de sensibilisation de toute la société.
Les parents, tout d’abord, doivent prendre conscience des comportements qu’il convient d’éviter à l’égard de leurs enfants. Cette sensibilisation à la parentalité débutera dès la naissance des enfants, par une information dispensée dans les maternités.
Les enfants, ensuite, doivent recevoir une véritable éducation à la sexualité. Il convient de garantir les moyens d’assurer cette obligation légale d’enseignement sur tout le territoire.
Une politique active doit par ailleurs être menée en direction des hébergeurs de contenus pornographiques sur internet. L’accès précoce des enfants à la pornographie engendre en effet des conséquences désastreuses sur leurs représentations de la sexualité, et notamment du consentement. Des dispositions répressives ont été instituées depuis 1998. Il convient de dédier une unité de police spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité au relevé des infractions commises par les hébergeurs afin de poursuivre ces derniers.
II. – FAVORISER L’EXPRESSION ET LA PRISE EN COMPTE DE LA PAROLE DES VICTIMES LE PLUS TÔT POSSIBLE
A. – Lutter contre le faible taux de signalement à la justice des agressions sexuelles
Les obstacles à la révélation à la justice des agressions sexuelles doivent être identifiés et levés.
Il importe de mettre les victimes, et en premier lieu les enfants, en capacité de prendre conscience de leurs droits, de l’anormalité des violences sexuelles qu’ils peuvent subir et de l’existence d’interdits, comme l’inceste, qui ne doivent pas être transgressés. À cet effet, des réunions d’information et de sensibilisation seront organisées dans les établissements scolaires par des professionnels : associations, policiers ou gendarmes, personnels de santé…
Les adultes, qu’il s’agisse des parents et des proches des enfants ou des professionnels à leur contact, doivent être informés et sensibilisés pour qu’ils assument l’obligation légale de signalement des violences sexuelles commises à l’encontre des mineurs et qu’ils apprennent à mieux les repérer.
Des outils formalisés permettant l’identification de situations de maltraitance et des protocoles de réponses seront mis en place pour aider les professionnels au contact des mineurs. Conformément au plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants (2017-2019), un référent hospitalier sur les violences faites aux enfants sera nommé dans chaque établissement de santé.
Des temps et des espaces de parole sanctuarisés seront instaurés à l’école, auprès des professionnels de santé et à certaines étapes de la vie d’un enfant, pour faciliter le signalement d’évènements intrafamiliaux.
Les conseils départementaux ont un rôle essentiel à jouer, au titre de leur compétence en matière de protection de l’enfance, que la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a conforté.
La libération de la parole des mineurs sera accompagnée d’une meilleure utilisation des outils nationaux d’écoute et d’aides aux victimes, qui devront faire l’objet d’une stratégie nationale concertée de communication.
Ces campagnes nationales de communication s’appuieront sur une plate-forme numérique de référence pour les violences sexuelles, afin d’informer les victimes sur les modalités simplifiées de dépôt de plainte et les différents lieux de signalement possibles.
B. – Faciliter le dépôt de plainte et accompagner les victimes en amont de leurs démarches judiciaires
Par la diffusion de consignes claires à l’ensemble des enquêteurs, le droit de voir sa plainte enregistrée sera garanti à chaque victime.
De même, des structures adaptées au recueil de la parole des mineurs, comme par exemple les salles « Mélanie », seront développées afin de permettre à chaque victime de voir sa parole recueillie dans les meilleures conditions.
Les moyens dédiés à la formation des enquêteurs pour l’accueil et l’écoute des plaignants seront augmentés.
La présence de psychologues et d’assistantes sociales sera généralisée dans les unités de police ou de gendarmerie.
III. – AMÉLIORER LA RÉPRESSION PÉNALE DES INFRACTIONS SEXUELLES COMMISES À L’ENCONTRE DES MINEURS
A. – Mieux traiter les affaires de violences sexuelles commises à l’encontre des mineurs
Afin de réduire les délais des enquêtes et de traiter le flux considérable de contenus pédopornographiques, les moyens et les effectifs de la police judiciaire et scientifique seront renforcés.
Les moyens des juridictions seront eux aussi renforcés pour :
– lutter contre les délais excessifs de traitement par la justice des infractions sexuelles ;
– éviter la requalification en agression sexuelle ou en atteinte sexuelle d’un crime de viol en raison du seul encombrement des cours d’assises ;
– faciliter l’audiencement des infractions sexuelles en matière correctionnelle, éviter le recours à des procédures simplifiées, voire expéditives, de jugement de certaines infractions et prohiber tout recours aux jugements en comparution immédiate ;
– tirer les conséquences de l’allongement des délais de prescription de l’action publique ;
– mettre en place des matériels adaptés, tels que la visio-conférence pour l’organisation des confrontations, afin de réduire les risques de traumatisme supplémentaires pour les victimes ;
– augmenter les budgets consacrés aux frais de justice afin de pouvoir faire appel à des experts, notamment psychiatres, et régler leurs honoraires dans des délais corrects.
B. – Mieux accompagner les victimes de violences sexuelles
Les moyens des bureaux d’aide aux victimes seront renforcés pour accompagner chaque victime d’infractions sexuelles par une association d’aide aux victimes, dès le dépôt de plainte.
Un accès des victimes aux unités médico-judiciaires et aux unités d’accueil pédiatriques médico-judiciaires des établissements de santé sera garanti sur l’ensemble du territoire.
Parce que tout médecin est susceptible d’examiner une victime d’infractions sexuelles, la formation en médecine légale des étudiants en médecine sera renforcée.
C. – Adapter l’organisation et le fonctionnement de la justice judiciaire
La formation de l’ensemble des professionnels du droit susceptibles d’être au contact des victimes d’infractions sexuelles, qu’il s’agisse des magistrats ou des avocats, sera renforcée.
Les spécialisations des magistrats seront encouragées, tout comme l’identification de pôles d’instruction spécialisés. Dans les juridictions les plus importantes, une chambre spécialisée sera créée pour traiter ce contentieux.
Des moyens seront mobilisés pour notifier en personne, par exemple par un délégué du procureur ou une association d’aide aux victimes, chaque décision de classement sans suite intervenant à la suite d’une plainte pour violence sexuelle.
IV. – DISJOINDRE LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES D’INFRACTIONS SEXUELLES DU PROCÈS PÉNAL
A. – Offrir une alternative au procès pénal
La reconstruction des victimes est trop souvent associée à la seule réponse pénale, jusqu’à en devenir une injonction pour elles. Il est nécessaire de disjoindre le temps du procès pénal du temps de la plainte.
Le dépérissement des preuves, l’absence d’identification de l’auteur ou son décès empêchent objectivement de nombreuses victimes d’obtenir un procès pénal.
En conséquence, le procès pénal ne doit pas être présenté aux victimes comme la solution incontournable permettant une reconstruction, ni par les enquêteurs, ni par les professionnels de santé.
Afin de proposer aux victimes d’autres prises en charge que celles ancrées dans une procédure judiciaire, il convient en premier lieu de désacraliser le recours au procès pénal dans les discours de politique publique et de présenter de manière transparente aux victimes les finalités et les modalités d’une procédure judiciaire.
Le temps du procès pénal doit être distingué du temps de la plainte. Les victimes doivent toujours être entendues et reçues par les services enquêteurs même en cas de prescription de l’action publique. Chaque violence dénoncée par une victime doit faire l’objet d’une plainte et d’une enquête, même si les faits apparaissent prescrits. En effet, l’enquête préalable est nécessaire pour constater ou non la prescription et peut permettre d’identifier des infractions connexes qui ne seraient pas prescrites.
Dans le ressort de certains tribunaux de grande instance, même en cas de faits largement et évidemment prescrits, les victimes de viols commis pendant leur enfance peuvent, avec l’autorisation du parquet, venir témoigner dans un lieu spécialisé, dans le même cadre d’écoute, d’attention et d’enquête que les victimes de faits plus récents. Les personnes mises en cause sont alors invitées à répondre aux questions des enquêteurs dans le cadre d’une audition libre, voire à participer à des confrontations lorsque les victimes en expriment le besoin. Cette pratique répond à un double objectif, thérapeutique pour aider les victimes à se reconstruire, et opérationnel pour identifier, le cas échéant, un auteur potentiellement toujours « actif ». Ce protocole de prise en charge des victimes pour des faits prescrits sera généralisé sur l’ensemble du territoire, dans tous les services spécialisés de police judiciaire.
B. – Accompagner le processus de reconstruction des victimes d’infractions sexuelles
La justice pénale ne peut plus être l’unique recours des victimes. D’autres voies que le procès pénal, permettant la reconnaissance et la reconstruction des victimes, doivent être développées. Il convient ainsi d’encourager le recours à la justice restaurative et de faciliter la réparation des préjudices subis.
Les victimes doivent, d’une part, être informées de l’existence des mesures de justice restaurative prévues à l’article 10-1 du code de procédure pénale, par exemple une médiation, afin de pouvoir y recourir si elles le souhaitent, d’autre part, se les voir systématiquement proposées lorsque les faits sont prescrits ou lorsque les preuves de la culpabilité de l’auteur manquent.
Les victimes doivent en outre être informées de la possibilité d’obtenir une réparation civile des dommages subis, y compris lorsque les faits sont prescrits sur le plan pénal. À cet effet, il convient de sensibiliser les associations et les professionnels de santé chargés de leur accompagnement.
Une réflexion doit être menée sur le champ d’application de l’article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui accorde actuellement le bénéfice de l’aide juridictionnelle aux victimes de viols, sans condition de ressources, afin de l’étendre à d’autres infractions sexuelles.
Des parcours de soins et de prise en charge cohérents doivent être mis en place pour les victimes de violences sexuelles, et en particulier pour les mineurs. Conformément aux engagements du quatrième plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, la Haute autorité de santé publiera un protocole national de prise en charge ainsi qu’une cartographie de l’offre de prise en charge spécialisée des victimes de violences sexuelles. Les connaissances scientifiques en matière de traitement des psychotraumatismes doivent être plus largement diffusées auprès des professionnels de santé.
Il est enfin nécessaire de concrétiser la création du centre national de ressources et de résilience qui permettrait de briser le tabou des douleurs invisibles et de structurer une offre institutionnelle de parcours de résilience pour les victimes d’infractions sexuelles.

L’amendement n° 124, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Supprimer cet article et le rapport annexé.
II. – En conséquence, supprimer le chapitre Ier A et son intitulé.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Le présent amendement vise à supprimer l’article 1er A du projet de loi adopté en commission des lois du Sénat, parce que le texte n’a pas pour objectif d’être un projet de loi d’orientation et de programmation.
En revanche, le Gouvernement part d’un certain nombre de constats, qui ont également été dressés par Mme la rapporteur, notamment en ce qui concerne la prévention, comme je l’évoquais voilà quelques instants. À ce titre, nous rappelons que ce texte est l’une des pierres angulaires de l’engagement pris par le Président de la République de faire de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles le début de sa grande cause nationale du quinquennat. Mais ce n’est pas, bien sûr, l’alpha et l’oméga de cette grande cause du quinquennat, c’est l’un des piliers d’un édifice que nous commençons, ensemble, à bâtir.
Le 25 novembre dernier, le Président de la République, lorsqu’il a décrété la grande cause du quinquennat, a également présenté un plan d’action ambitieux, avec des mesures extrêmement fortes, dont celles que j’ai rappelées, qui ont été complétées par le comité interministériel réuni par le Premier ministre le 8 mars dernier et à l’issue duquel plus de soixante-quinze mesures interministérielles importantes ont été présentées.
Les mesures élaborées en concertation avec les partenaires sociaux et les organisations patronales pour faire reculer les violences sexistes portent sur la diffusion de la culture de l’égalité à l’école, je n’y reviens pas, sur les grands plans de formation initiale et continue des forces de l’ordre, des personnels soignants, des magistrats, des enseignants, conformément aux objectifs de la circulaire de mars dernier, sur le lancement de la plateforme de signalement en ligne gérée par les forces de l’ordre pour informer et orienter les victimes de violences sexistes et sexuelles, et sur l’ouverture, d’ici à la fin de l’année, à titre expérimental, de dix centres de soins de psychotraumatismes pour les victimes de violences.

Je viens de demander exceptionnellement l’autorisation à Mme le rapporteur de m’exprimer à sa place. Pour nous, cet article est très important.
Madame la secrétaire d’État, heureusement que vous avez procédé à une concertation, c’est le contraire qui aurait été surprenant ! Toutefois, dans notre démocratie, il me semble essentiel, au sujet d’une politique aussi importante pour la prévention des souffrances endurées par des personnes vulnérables, que vous puissiez vous adosser à un débat ayant lieu au sein de la représentation nationale. Pour cela, l’instrument adéquat, c’est la loi d’orientation et de programmation. Il ne suffit pas en effet que les associations, les syndicats et toutes les forces vives du pays aient participé à une concertation pour que la représentation nationale apporte son soutien à une politique.
Nous voulons que la politique se discute au sein du Sénat et de l’Assemblée nationale. C’est la raison pour laquelle nous tenons beaucoup à maintenir le caractère de loi d’orientation et de programmation que nous avions déjà donné à notre proposition de loi au mois de mars dernier.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.

Nous soutenons évidemment l’amendement de Mme de la Gontrie et ne sommes pas favorables à la proposition du Gouvernement. Les aspects que vous avez développés sont importants, madame la secrétaire d’État. Sur toutes les travées de cette assemblée, quelles que soient nos sensibilités politiques, nous sommes tous très engagés en faveur de la prévention de ces violences sexistes et sexuelles. Vous parlez d’ambitions, madame la secrétaire d’État. Mais les ambitions nécessitent que des moyens soient débloqués. Vous me permettrez d’être extrêmement dubitative à ce sujet. Vous affirmez qu’il n’y a pas eu de baisse des subventions aux associations féministes. Ce n’est pas le retour que nous avons sur les territoires.
Comme vous le savez, madame la secrétaire d’État, les associations féministes mènent des actions de service public, auxquelles je sais que vous êtes sensible. Avec la libération de la parole, ces associations voient un nombre croissant de femmes victimes les interpeller et solliciter leur intervention. Elles ont donc besoin, au minimum, de moyens constants, et idéalement de moyens supplémentaires.
Ces associations souffrent de la suppression des emplois aidés, d’un manque de reconnaissance et d’une insuffisance de moyens.
Faut-il rappeler ici que l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, l’AVFT, a dû suspendre sa permanence téléphonique en raison d’un accroissement des plaintes ? On parle de mieux former les policiers et les magistrats, mais, quand on les écoute, on voit aussi qu’il est nécessaire de débloquer des moyens. Les engagements sont importants, mais s’ils ne s’accompagnent pas des moyens humains et financiers, ils restent de simples paroles sans conséquence concrètes.
Pour cette raison, nous ne suivrons pas le Gouvernement.
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain.

Madame la ministre, madame la secrétaire d’État, l’exposé des motifs de votre amendement est pour le moins sobre. Le présent projet de loi n’a pas pour objectif d’être une loi d’orientation et de programmation, et c’est précisément son défaut ! Il manque en effet une telle loi pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, car nous savons tous ici qu’il ne suffit pas de réformer le code pénal, d’aggraver les peines ou de faciliter les incriminations pour que les violences sexuelles à l’encontre des femmes et des enfants diminuent mécaniquement.
En amont, tout le travail de prévention, d’accompagnement des victimes, de mobilisation des services de police, de formation de la justice exige d’autres ambitions. Pour l’instant, il ne s’agit pas de la grande loi servant la grande cause du quinquennat, mais d’une petite loi contenant quelques mesures importantes comme l’allongement des délais de prescription, l’aggravation des peines et des dispositions interprétatives.
Pour qu’elle devienne une grande loi, il faudrait l’adosser – je reprends les mots du président Philippe Bas – à un programme ambitieux, à une mobilisation de la société et du Parlement pour garantir, dans les années à venir, l’indispensable mobilisation interministérielle.
Car, voyez-vous, le Parlement n’est pas simplement une encombrante institution par laquelle il faut passer régulièrement, c’est aussi une force et un point d’appui pour les ministres quand ils réalisent des grandes choses.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

On peut certes comprendre l’objet de cet amendement présenté par Mme la secrétaire d’État, en dépit de sa brièveté.
Je rejoins le président et la rapporteur de la commission des lois sur la question des moyens. Nous avons beaucoup parlé de prévention. L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics peuvent intervenir, mais nous sommes malheureusement confrontés à de nombreux drames humains sur nos territoires.
Je partage l’avis des deux oratrices qui m’ont précédé sur le manque de moyens humains et financiers. Les associations et les bénévoles, auxquels on peut rendre hommage, font ce qu’ils peuvent, à tous les niveaux, mais les actions de prévention restent malheureusement très limitées, comme différentes personnes auditionnées par la délégation aux droits des femmes nous l’ont confirmé.
Sur ces problèmes très importants, il faut se donner les moyens. En termes de prévention, les personnels des forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie, font tout ce qu’ils peuvent dans les brigades de proximité de nos départements respectifs, mais ils ne sont pas toujours formés, malheureusement.
Je me rallie donc à l’avis du président de la commission des lois.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Avec votre bienveillance, madame la présidente, je voudrais signaler ce qui pourrait s’apparenter à un problème technique. Je me permets d’interroger le président de la commission des lois à ce sujet, car, si j’ai bien compris, il serait peut-être préférable que d’autres amendements soient également intégrés dans l’annexe.
Or, si nous votons maintenant sur ces amendements, le débat sur l’annexe sera derrière nous. Dès lors, ne devrions-nous pas, comme l’a suggéré tout à l’heure le président de la commission des lois, réserver le vote sur l’annexe ? Les amendements pourraient ainsi être examinés, et peut-être approuvés, et nous pourrions ensuite nous prononcer sur l’intégralité de l’annexe.

Monsieur le président de la commission, réservons-nous le vote sur l’ensemble des amendements en lien avec l’annexe ?

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Je pourrais demander de réserver le vote sur l’annexe, mais je le ferais vraiment par courtoisie à l’égard des auteurs de ces amendements, qui auraient pu prendre les devants en rédigeant leurs amendements de telle manière qu’ils s’intègrent d’emblée au rapport.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie le conteste.

Si nos collègues acceptaient de rectifier leurs amendements pour qu’ils viennent modifier le contenu du rapport faisant l’objet de l’annexe, je pourrais alors demander cette réserve.

Cher président de la commission des lois, n’inversons pas les rôles, nous avons déposé des amendements, et nous souhaitons qu’ils soient approuvés. J’ai cru comprendre que la commission préférerait qu’ils soient intégrés dans l’annexe. Ce n’est pas notre demande.
Laissons donc les choses en l’état. Nous nous prononcerons, les amendements seront probablement rejetés et ce sera triste, car ils sont très intéressants.
Je regrette toutefois que vous n’ayez pas utilisé la porte que j’avais ouverte, monsieur le président.

Nous poursuivons donc l’examen des amendements selon l’ordre prévu initialement.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote sur l’amendement n° 124.

Je plaide fortement pour l’idée d’une loi de programmation et d’orientation. J’espère que tous les sénateurs partageront cette thèse et que le Gouvernement nous entendra.
Depuis des années, certains d’entre nous militent sur ces sujets de violences faites aux femmes, dans le domaine du logement, de la prévention, de l’avertissement, du soutien aux associations, de la culture et de l’éducation. Le travail à accomplir est immense.
En dépit des législations successives, le nombre de cas ne cesse de s’accroître. On apprend dans la presse qu’une dame s’est rendue plusieurs fois au commissariat et qu’elle a fini par mourir faute de réactions, parce que les personnes qui accueillent les plaignants dans les commissariats et les gendarmeries n’ont manifestement pas la formation suffisante.
Pour avoir suivi l’aide aux victimes dans les années 2000, je me souviens que l’on annonçait déjà à l’époque une formation systématique de ces « accueillants ». Elle n’a toujours pas lieu. Si la loi n’en fait pas une obligation pour les services publics, si l’on ne lance pas un appel à la mobilisation collective, comment les départements vont-ils réagir avec des ressources de plus en plus comptées ? Comment répondre aux attentes si l’on fait la politique de l’autruche sur les moyens nécessaires ?
Après avoir amélioré le projet de loi, le Sénat a raison d’exiger que l’on passe maintenant rapidement à cette nouvelle étape. Sinon, ce seront encore des morts, des souffrances et des années perdues !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.

Je mets aux voix l’ensemble constitué de l’article 1er A et du rapport annexé, modifié.
L ’ article 1 er A et le rapport annexé sont adoptés.

L’amendement n° 55 rectifié bis, présenté par Mmes Conway-Mouret, de la Gontrie, Rossignol, Lepage, Blondin et Cartron, M. Courteau, Mmes M. Filleul, Jasmin, Monier, Meunier et Lubin, MM. J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État se fixe pour objectif d’augmenter, sur tout le territoire et dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution, l’offre d’hébergement dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale et dans les établissements d’accueil mères-enfants pour favoriser la prise en charge des femmes victimes de violences ainsi que celle de leurs enfants mineurs, quel que soit leur âge.
La parole est à Mme Michelle Meunier.

La France a ratifié le 4 juillet 2014 la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et les violences domestiques. L’obligation de créer un nombre suffisant de centres d’hébergement fait partie des engagements de la convention.
En France, 400 000 femmes ont été victimes de violences conjugales, physiques et/ou sexuelles, au cours des deux dernières années, selon une étude de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales parue en 2016. La faiblesse des ressources de certaines femmes, l’absence de réseau de solidarité familiale ou amicale et la difficulté à trouver rapidement des logements adaptés constituent souvent des obstacles majeurs à la volonté des femmes d’échapper aux violences dont elles sont victimes, au sein du couple, marié ou non, mais également en risque de mariage forcé ou bien encore victimes d’autres violences telles que l’esclavage domestique ou la traite des êtres humains. La stratégie de l’agresseur est souvent d’isoler ces femmes victimes de leurs familles et de leurs amis.
L’offre d’hébergement dédiée aux femmes victimes de violences et les possibilités de relogement qui leur sont offertes sont des clés indispensables dans le parcours de sortie des violences conjugales selon le site du secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes. Pourtant, ces places restent insuffisantes. Afin d’aider toutes les femmes victimes, l’augmentation des places d’hébergement devra se poursuivre et se renforcer pour répondre aux besoins.

La commission avait émis un avis favorable sur cet amendement, mais sous réserve d’une rectification consistant à l’intégrer dans l’annexe à l’article 1er A. Comme nous venons de voter l’annexe, nous ne pouvons pas réintégrer cet amendement et je suis donc malheureusement tenue de donner un avis défavorable.
Madame la sénatrice, votre engagement est connu de longue date sur cette question de la défense des femmes victimes de violences. Je partage bien évidemment l’intégralité du constat que vous avez formulé, à la fois sur la pénurie des hébergements, mais également sur la difficulté d’extraire les femmes des domiciles conjugaux, toute la stratégie de l’agresseur consistant, comme vous l’avez très bien démontré, à les isoler et à les maintenir sous emprise. Néanmoins, l’objet de l’article que vous proposez d’insérer, aussi louable soit-il, ne crée pas d’obligation précise à la charge de l’État et des collectivités et ne revêt donc pas de caractère normatif.
Je tiens toutefois à préciser que l’ensemble du Gouvernement est mobilisé pour l’hébergement des femmes victimes de violences et pour les mettre à l’abri. C’est l’un des axes prioritaires de la lutte contre les violences et pour la protection des femmes et des enfants. Ce sera l’un des objectifs majeurs des contrats locaux contre les violences conjugales que j’évoquais tout à l’heure, qui seront conclus auprès de chaque préfet, dans chaque département, au plus près de la réalité de chaque territoire.
J’ajoute que nous avons annoncé en comité interministériel, le 8 mars dernier, la garantie de 5 000 nouvelles places d’hébergement pour les femmes victimes de violences et que le Gouvernement travaille au développement d’une plateforme de géolocalisation de ces lieux d’hébergement pour les femmes victimes de violences. Trop souvent, quand on travaille sur cette question, on méconnaît la réalité, en temps réel, des places qui sont disponibles.
Nous sommes donc en train de travailler à cette plateforme de géolocalisation, qui sera accessible aux travailleurs sociaux, à la police, à la justice, aux élus locaux et qui permettra de savoir en temps réel le nombre de places disponibles dans tel centre d’hébergement. L’objectif est de pouvoir mettre au plus tôt à l’abri des femmes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales et, in fine, de sauver des vies.
En conséquence, l’avis est défavorable.

Tout d’abord, monsieur Bas, je ne comprends pas très bien pourquoi vous n’avez pas été en situation de nous fédérer en proposant une modification de notre façon de délibérer, alors que la commission partageait, me semble-t-il, les objectifs des auteurs de cet amendement. Le Sénat, c’est aussi un état d’esprit qui consiste à essayer de converger et de s’accorder quand on le peut.
Nous vous soutenions dans l’idée d’une forme de programmation et d’orientation et nous regrettons de ne pas avoir pu y introduire cette question majeure de l’hébergement, première marche vers l’autonomisation et la protection.
C’est aussi pour cela que je plaidais tout à l’heure pour une loi d’orientation. L’hébergement a besoin d’un financement pérenne, pas seulement de places. Si l’on ne prévoit pas la suite de l’hébergement immédiat, on est bloqué.
Je prends un exemple concret. Depuis maintenant quatre années, le programme « HLM accompagnés » permet de financer, grâce à la Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS, et à une partie des crédits du Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, le FNAVDL, cet accompagnement pour les femmes, en particulier les femmes victimes de violences.
Or, tous les ans, ce programme reste expérimental, les organismes étant obligés de déposer de nouveau les projets, avec des critères et des paperasses à n’en plus finir. Globalement, on ne parvient pas à atteindre la masse critique de logements sur l’ensemble du territoire – il en faut partout, pas seulement là où les gens sont très mobilisés.
Tous les ans, lors du budget, je dépose des amendements visant à ce que le programme HLM accompagnés soit pérennisé par un mécanisme financier, au moins pour les femmes victimes de violence. On peut discuter du mécanisme, j’en ai proposé un, les organismes d’HLM en ont proposé d’autres, mais il en faut un.
Ces lois d’orientation et de programmation ne répondent pas au plaisir de planifier, mais nous sommes en permanence confrontés à de fausses annonces. Pour moi, c’est la méthode de l’action publique qui est en cause, car d’autres gouvernements ont également procédé de la sorte.
Pour l’instant, le Gouvernement n’a pris aucun engagement.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

La parole est à Mme Marie-Françoise Perol-Dumont, pour explication de vote.

Mme Marie-Françoise Perol-Dumont. Madame la ministre, madame la secrétaire d’État, refuser cet amendement, c’est se satisfaire d’une situation d’iniquité patente dans notre pays. Parfois, des volontés locales, émanant principalement des départements, ont permis de mettre en place des solutions palliatives, comme la réservation de places en hôtel social. Outre que ces financements reposent exclusivement sur l’impôt local, via les départements, ils créent une situation très inique, car ils dépendent de la volonté politique de tel ou tel pouvoir local. Je ne comprends donc pas que vous ne puissiez pas suivre cet amendement.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

La question de l’hébergement des femmes victimes de violences, et surtout des enfants, qui sont également victimes de ces violences lorsque la famille doit quitter le domicile, peut venir en complément de la mise en œuvre de la loi sur l’éviction du conjoint violent.
Souvent, il est encore difficile aujourd’hui d’imposer au conjoint violent de quitter le domicile conjugal. En cohérence avec la mise à l’abri des personnes victimes grâce au téléphone grand danger, on pourrait imaginer des politiques ciblées à mettre en œuvre au niveau des territoires. Les départements en prennent souvent l’initiative, mais un dispositif devrait être prévu dans la loi.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Je soutiens les interventions précédentes. Les départements investissent, certes, mais, nous le savons, nous manquons cruellement de logements et la solution de l’hôtel coûte très cher aux collectivités.
Malheureusement, nous assistons aujourd’hui à une mise en cause très grave des sociétés d’HLM, ce qui ne va pas arranger la situation.
Ma collègue a raison de souligner que les violences faites aux femmes touchent l’ensemble de la famille, y compris les enfants.
Le Gouvernement devrait approuver un tel amendement, gage de politiques pérennes et de soutien réel.
Je regrette que le président de la commission et la rapporteur n’aient pas trouvé de solution et qu’ils émettent finalement un avis défavorable sur un amendement dont ils semblaient approuver les objectifs. Je regrette aussi la timidité du Gouvernement, qui dit en substance : « Circulez, il n’y a rien à voir », les dispositifs sont déjà en place, alors que ce n’est pas la réalité.

Je reconnais que les débats de procédure ont un intérêt limité, mais, à plusieurs reprises, il a été reproché à la commission des lois de ne pas avoir trouvé de solution pour rendre possible le vote de cet amendement. Or c’est exactement le contraire : la commission des lois a proposé une solution que les auteurs de l’amendement ont refusée. Vous avez été témoins, tout à l’heure, mes chers collègues, de l’expression de ma disponibilité pour donner une dernière chance à cet amendement.

Je dois rappeler des règles simples, qui sont celles du débat parlementaire. Cet amendement n’a pas de valeur normative, c’est ce qu’on appelle un « neutron législatif », une pure déclaration d’intention. Or nous ne pouvons pas introduire dans la loi des dispositions n’ayant pas valeur de règles de droit, sauf à contrevenir à l’article 41 de la Constitution.
Nous avons tellement voulu laisser sa chance à cet amendement qu’au lieu de lui opposer l’irrecevabilité de l’article 41, nous avons dit à ses auteurs qu’ils avaient peut-être une chance de le sauver s’ils acceptaient de l’intégrer au rapport fixant les orientations de la politique de lutte contre les violences sexuelles, le texte du Gouvernement étant transformé en loi d’orientation et de programmation. La disposition contenue dans l’amendement pourrait alors être approuvée au même titre que le rapport d’une loi de programme.
Je suis vraiment désespéré de ne pas avoir pu vous convaincre.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Sourires.

Nous avons fait tous les gestes nécessaires, et même au-delà, alors que la solution la plus simple aurait été de vous dire de cesser d’inscrire dans nos débats des amendements irrecevables, car n’ayant aucune consistance législative. Je rappelle que le Conseil constitutionnel invoque d’office cette irrecevabilité, même quand elle n’est pas mentionnée dans les motifs de la saisine.
Nous avons tellement souhaité vous aider que nous vous avons même indiqué la marche à suivre. J’ai encore réitéré notre offre tout à l’heure, mais vous l’avez rejetée.
De grâce, ne venez pas dire que la commission des lois n’a pas tout fait pour vous permettre d’avancer sur la voie de l’adoption de cet amendement !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

J’ai bien entendu les arguments du président de la commission des lois, mais le plus important, dans ce débat, me semble d’alerter sur les moyens aujourd’hui mis à disposition de la lutte contre les violences faites aux femmes, et aux hommes aussi parfois.
Comme nos collègues l’ont souligné, il n’y a pas suffisamment de moyens, et il y en a même de moins en moins.
Je vous conseille de vous déplacer dans des centres d’hébergement pour femmes et enfants, mes chers collègues. Les conditions dans lesquelles on les reçoit sont effrayantes.
Nous débattons d’un texte sur les violences sexuelles et sexistes, donnons-nous aussi les moyens de répondre à ces violences !
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Je mets aux voix l’amendement n° 55 rectifié bis.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et républicain.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 188 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la prescription
I. – L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code pénal ».
II. – Le premier alinéa de l’article 9-1 du code de procédure pénale est supprimé.
III
« Le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où tous les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par le présent article ont cessé. »

L’article 1er fait partie de ceux sur lesquels il y a consensus : l’allongement du délai de prescription est une évolution positive, qui avait été préconisée dès 2017 par la mission de consensus coprésidée par Flavie Flament et le magistrat Jacques Calmettes et réunie à la demande de notre collègue Laurence Rossignol, alors ministre chargée des droits des femmes.
Ces travaux ont largement contribué à faire évoluer les positions et à déverrouiller les blocages qui existaient. Cette évolution n’allait pas de soi il y a encore quelques mois : souvenons-nous des débats au cours de l’examen de la loi dite Fenech-Tourret sur la réforme de la prescription en matière pénale !
Il s’agit bien évidemment d’une avancée attendue par les victimes, en particulier pour celles qui, en raison de leur âge ou de leurs liens familiaux avec l’auteur des agressions, ont été incapables de révéler sur le moment les violences subies. En outre, les victimes sont parfois atteintes d’une amnésie traumatique qui les empêche de parler.
Nous nous devions de prendre en compte, dans la loi, ces situations dramatiques pour permettre aux personnes concernées d’engager une procédure judiciaire, mais aussi pour mieux sanctionner les auteurs de viol et prévenir la récidive.
Faut-il aller jusqu’à l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les mineurs, défendue par certains, y compris parmi les sénateurs ? La délégation aux droits des femmes ne s’est pas prononcée sur ce point.
Nous avons entendu les propos du Gouvernement, mais il ne doit pas y avoir de tabou en la matière. Nous savons que le débat reste vivace entre ceux qui pensent que l’imprescriptibilité doit être réservée aux crimes contre l’humanité et ceux qui estiment qu’elle serait tout à fait légitime dans ces situations.
Ne fermons pas la porte à une telle évolution et laissons la réflexion se poursuivre. Peut-être y arrivera-t-on aussi ! Pour l’heure, la délégation soutient l’article 1er, qui va dans le sens des recommandations qu’elle a formulées dans ses travaux récents sur les violences faites aux femmes.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.

Le Parlement a été saisi à plusieurs reprises ces dernières années de textes relatifs à la prescription, celle des crimes commis sur les mineurs, bien sûr, mais aussi le régime général de la prescription en matière pénale, qui a été réformé en 2017.
J’ai été mobilisée sur ces textes, qui sont parfois guidés par l’émotion légitime suscitée par l’impunité dont bénéficient encore bien trop d’auteurs de violences sexuelles.
Forte de ce travail et des rencontres que j’ai pu faire avec différents acteurs, tant associatifs que judiciaires, je dois dire que ma position a évolué sur la question particulière des violences sexuelles subies par les enfants.
Bien sûr, on pourra allonger la prescription jusqu’à la faire disparaître, cela ne garantira jamais à une victime qui parle vingt ou trente ans après les faits d’obtenir justice.
Il faut faire preuve d’honnêteté en la matière : que restera-t-il après un temps si long ? Quelle enquête digne de ce nom pourra être menée ? Et que ressentira la victime, qui aura enfin pu parler et qui verra son agresseur relaxé faute d’éléments suffisants ?
Ces questions, il me semble qu’il est de notre responsabilité de ne pas les éluder. Nous ne devons pas faire croire aux victimes que l’allongement de la prescription serait un remède miracle.
L’accompagnement des personnes qui parlent très longtemps après les faits me paraît être particulièrement important, et ce tout au long de la procédure. Il faut recueillir leurs plaintes dans de bonnes conditions, mais surtout les préparer à ce que la vérité judiciaire, dictée par les principes de l’État de droit, contredise la vérité intime de ce qu’elles ont vécu.
Même si je ne suis pas une spécialiste, j’ai aussi des doutes sur l’amnésie post-traumatique, puisque les experts ne sont pas d’accord entre eux sur cette question. Mme Salmona défend cette idée, mais celle-ci est largement débattue dans le monde scientifique, c’est du moins ce que j’ai pu lire.
Marques d ’ acquiescement sur les bancs de la commission.

Je soutiendrai donc l’allongement de la prescription proposé par l’article 1er, tout en étant convaincue que la priorité, qui doit être celle de tous, est d’aider les victimes à parler plus tôt. C’est à cette condition que nous serons véritablement à leurs côtés.

Consensus ne veut pas forcément dire unanimité ! Même si je me réjouis de l’allongement des délais de prescription à trente ans à compter de la majorité de la victime, je reste convaincue qu’il ne faut pas fixer de limite à l’action publique à l’égard de ces crimes.
Du point de vue des victimes, ce couperet n’est pas compréhensible. Je persiste donc dans cette conviction et la manière dont nous l’abordons, toujours un peu plus nombreux à réclamer cette imprescriptibilité, me conforte.
Cette prise de conscience dépasse les travées de notre assemblée. Madame la garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, l’opinion publique est prête à envisager cette imprescriptibilité : IPSOS vient en effet de publier un sondage, qui révèle que 70 % des Françaises et des Français sont favorables à l’imprescriptibilité du viol, quand il est commis sur un mineur.
Je tiens aussi à rappeler un chiffre : 37 % des victimes de violences sexuelles lorsqu’elles étaient mineures ont subi des amnésies traumatiques qui ont duré jusqu’à quarante ans.
Bien sûr, je suis attentive aux arguments de celles et de ceux qui tiennent à distinguer les crimes contre l’humanité, seuls à ce jour à demeurer imprescriptibles. Avec tout le respect dû aux victimes de ces atrocités, ne peut-on pas établir une analogie avec les violences sexuelles sur les enfants ? Ces enfants devenus adultes n’ont-ils pas le droit, aussi, d’être reconnus comme victimes plusieurs années après les faits ?
Je comprends les arguments expliquant que les preuves seront difficiles à apporter et que cela sera peut-être vécu comme une double peine par les victimes. Mais laissons-leur au moins la possibilité d’engager les poursuites !
Aujourd’hui, 16 % des femmes et 5 % des hommes déclarent avoir subi des viols ou tentatives de viols au cours de leur vie. Les chiffres sont de plus en plus terrifiants et, si les violences subies pendant l’enfance meurtrissent, les violences sexuelles détruisent plus encore. La victime est surexposée à d’autres violences et elle peut développer des comportements à risque contre elle-même et contre la société. Si la victime n’est pas réparée, elle peut souffrir de ce continuum de violence tout au long de sa vie.
Vous l’aurez compris, je suis favorable à l’imprescriptibilité de ces crimes.
Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain. – M. Yvon Collin applaudit également.

Je remercie mes collègues qui ont travaillé sur ce projet de loi, en lien avec la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
La qualité d’une civilisation se mesure au respect qu’elle porte aux plus faibles de ses membres et la femme blessée dans son corps en fait partie.
Les violences faites aux femmes touchent aux droits fondamentaux que sont l’égalité et la dignité. Elles doivent faire l’objet d’une attention particulière, aussi bien dans la prise en charge des victimes que sur le plan de la prévention et de la répression de ces actes.
Le législateur doit garder en ligne de mire que son seul objectif est de protéger les femmes et les enfants de toutes les violences sexuelles.
Le Sénat – je m’en réjouis – a fait évoluer le projet de loi, de telle sorte que soit notamment ajouté un volet relatif à la prévention des violences sexuelles et sexistes et à l’accompagnement des victimes.
Il a aussi entendu réprimer plus efficacement les infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs, notamment en allongeant le délai de prescription à trente ans à compter de la majorité de la victime et en affirmant le caractère continu de l’infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles qu’ils subissent.
Ces mesures vont dans le bon sens.
Enfin, comme l’ont fait un certain nombre de collègues, j’attire votre attention sur le problème majeur de l’éducation, aussi bien celle des hommes que celle des femmes. C’est aussi ce combat qu’il faudra mener !
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – Mme la rapporteur applaudit également.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 12 rectifié ter, présenté par Mmes Meunier et Préville, MM. Jeansannetas, Vaugrenard et Bérit-Débat, Mme Conway-Mouret, MM. Tissot, Lalande, Roger et Iacovelli, Mme Jasmin, MM. Courteau, Duran et Mazuir, Mme Ghali, MM. Antiste et Daudigny, Mmes Tocqueville, Van Heghe et Guillemot, MM. P. Joly et Madrelle, Mme Monier, M. Manable, Mme Grelet-Certenais, M. J. Bigot et Mme Perol-Dumont, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers
par les mots :
est imprescriptible
La parole est à Mme Michelle Meunier.

L’amendement n° 68 rectifié, présenté par MM. Poadja et Canevet et Mmes Guidez, Vullien, Goy-Chavent et Tetuanui, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou à compter du jour où un syndrome d’amnésie post-traumatique est médicalement constaté
La parole est à M. Gérard Poadja.

D’après un rapport de 2015 intitulé Impacts des violences sexuelles de l ’ enfance à l ’ âge adulte, près de 37 % des victimes de ces crimes peuvent développer une situation d’amnésie post-traumatique. Cette situation remet en cause la capacité effective de ces victimes à déposer plainte dans les délais de prescription définis par la loi.
C’est pour cette raison que je propose à notre Haute Assemblée de reporter le point de départ du délai de prescription en cas de constat par un médecin de l’existence d’une amnésie post-traumatique.
Madame la secrétaire d’État, le 15 mai 2018, vous répondiez à mon collègue député Philippe Dunoyer qu’un tel amendement reviendrait à inscrire dans le code pénal une prescription indéterminée. Il n’en est rien !
Cet amendement reviendrait à inscrire dans le code pénal un délai de prescription de trente ans, qui serait effectif à partir de la majorité des victimes ou à la date du constat d’une situation d’amnésie post-traumatique. Comme Philippe Dunoyer vous l’avait indiqué, il est parfaitement raisonnable de penser que, en l’état actuel des connaissances scientifiques, nous pouvons inscrire cette disposition dans la loi.

L’amendement n° 84 rectifié quater, présenté par MM. Buffet, Cambon, Charon, Daubresse et Duplomb, Mmes Eustache-Brinio, Puissat et Raimond-Pavero, MM. Sol, Chaize, Grosdidier, H. Leroy, Rapin et J.M. Boyer, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Huré, Houpert, Bizet, Mayet, Mouiller, Milon, Paccaud et Bonhomme, Mme Micouleau, MM. Lefèvre et Sido, Mme Gruny, M. Joyandet, Mme F. Gerbaud, MM. Laménie et Savary, Mme Lopez, MM. B. Fournier et Pierre, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Pellevat, Mmes Garriaud-Maylam et Delmont-Koropoulis et MM. Revet, Cuypers et Savin, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’action publique des crimes mentionnés aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible.
La parole est à M. François-Noël Buffet.

Le sujet de la prescription est évidemment sensible. Le texte qui nous est soumis prévoit de la porter de vingt à trente ans. De son côté, l’amendement que je présente souhaite fixer une imprescriptibilité.
Certains nous opposent l’incapacité de pouvoir apporter des preuves, le moment venu. D’autres nous disent que le droit à l’oubli est nécessaire et qu’il existe un problème constitutionnel, seuls les crimes contre l’humanité pouvant bénéficier de l’imprescriptibilité.
Le crime sexuel commis à l’encontre des mineurs est d’une nature très différente du crime de sang, pour lequel la présence d’une victime permet d’engager les procédures pénales et les moyens scientifiques nécessaires.
Dans le cas du crime sexuel commis à l’encontre des mineurs, c’est le temps qui est le principal ennemi : la victime est souvent dans l’incapacité de révéler rapidement les faits et il faut souvent attendre que sa situation soit stabilisée pour qu’elle puisse enfin parler et que les procédures puissent être engagées.
Je rappelle que le crime contre l’humanité a été créé, en particulier, parce que l’on craignait de ne plus avoir les preuves des abominations commises pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est bien cette difficulté majeure, qui a abouti à la création de cette incrimination.
La violence sexuelle sur mineur est un crime qui provoque des dégâts énormes dans le cerveau des victimes, marquées à vie, en particulier parce que cela touche à l’intime le plus profond.

Les scientifiques vous le diront ! Je n’en suis pas un, mais nous le savons bien !
Or on ne connaît pas le moment où les victimes pourront révéler l’horreur qu’elles ont subie. Il faut donc leur laisser le temps de pouvoir le faire.
Si l’on se place du côté de la protection des victimes, en particulier mineures, l’imprescriptibilité s’impose.
Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain. – M. Yvon Collin applaudit également.

L’amendement n° 127, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
II bis. – L’article 9-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crimes commis sur des mineurs prévus par l’avant-dernier alinéa de l’article 7, la prescription est également interrompue en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. »
II ter. – L’article 706-47 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : «, précédés ou accompagnés d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, » sont supprimés ;
2° Le 2° est complété par les mots : « et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévu par l’article 222-10 du même code ».
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Même si je ne partage pas toujours les conséquences juridiques des propos qui viennent d’être tenus, ils montrent très clairement l’importance du sujet dont nous débattons maintenant.
L’amendement que le Gouvernement vient de déposer a pour objet de reporter le point de départ du délai de prescription dans certaines circonstances.
Il améliore, de façon très sensible, l’efficacité des dispositions de l’article 1er du projet de loi, qui porte de vingt à trente ans la prescription des crimes commis sur les mineurs, en permettant, dans certains cas, un allongement très significatif de cette prescription.
Il prend en compte la situation des personnes qui commettent des crimes de façon répétée sur les mineurs. Il prévoit que la commission d’un nouveau crime intervenant avant la prescription d’un autre, qui le précède, interrompra la prescription, qui recommencera donc à courir pendant un nouveau délai de trente ans.
Cela permettra de poursuivre et de condamner la personne pour l’ensemble de ses crimes, pas seulement pour les derniers commis. Il ne s’agit donc pas d’une imprescriptibilité ; vous le savez, nous estimons qu’une telle mesure serait inconstitutionnelle.
J’ajoute que cet amendement ne revient pas à rouvrir des prescriptions déjà acquises. C’est ce qui fait que l’amendement que nous vous proposons ne soulève, du point de vue du Gouvernement, aucun problème de nature constitutionnelle.
Par ailleurs, cet amendement étend la prescription de trente ans aux crimes de violences sur mineur ayant entraîné une mutilation. Cela permet notamment d’incriminer, et donc de réprimer, l’excision. Cette prescription est également étendue aux crimes de meurtre ou d’assassinat commis sur un mineur.
Toutefois, dans un souci de cohérence et de lisibilité de notre droit, ces ajouts ne sont pas insérés à l’article 7 du code de procédure pénale, comme le proposait l’Assemblée nationale, mais dans l’article 706-47 qui vise toutes les infractions sexuelles et auquel renvoie cet article.
Je crois que cet amendement répond à des objectifs qui sont partagés par le Gouvernement et l’Assemblée nationale, ainsi que, je le crois, par le Sénat. C’est pourquoi j’espère qu’il fera l’objet d’un large consensus.

Le sous-amendement n° 138 rectifié, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 127, alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
II bis. – L’article 9–2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crimes mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « ou tout fait mentionné à l’alinéa précédent » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot « article », sont insérés les mots : «, à l’exception des dispositions prévues par le sixième alinéa, ».
La parole est à Mme le rapporteur.

Ce sous-amendement permet de clarifier la rédaction de l’amendement du Gouvernement et de lever toute ambiguïté.

Les mesures proposées par les amendements n° 12 rectifié ter, 68 rectifié et 84 rectifié quater ont déjà été rejetées à de nombreuses reprises par le Sénat. Elles posent en effet de nombreuses difficultés. Nous avons eu des débats nourris, sincères, profonds, et le sujet en vaut évidemment la peine.
Pourquoi seuls les crimes contre l’humanité sont-ils imprescriptibles ? Parce que le nombre massif de victimes et l’ampleur des actes réprimés permettent facilement, même des dizaines d’années après les faits, de procéder à des condamnations sans erreur possible, ce qui est très important.
Cela n’est pas le cas pour les crimes sexuels commis contre les mineurs, aussi horribles soient-ils. Par nature, il n’y a pas suffisamment de preuves dans un cas individuel pour condamner, cinquante ans après les faits, un acte sexuel, qu’il soit ou non commis sur un mineur. Quelles réponses et preuves imagine-t-on recueillir cinquante ans après la commission des faits ? De plus, même si des preuves pouvaient être réunies, comment l’accusé pourrait-il se défendre ? Quel alibi pourrait-il évoquer ?
La prescription a pour objectif d’empêcher les erreurs judiciaires, en interdisant que des procès ne se tiennent dans des conditions empêchant le bon exercice des droits de la défense. Même le plus odieux des criminels doit pouvoir se défendre, ce qui n’empêche en rien son éventuelle condamnation.
Surtout, même si la personne est déclarée coupable, quel est le sens donné à la condamnation plus de cinquante ou soixante ans après les faits ? Au mieux, il y aura une dispense de peine, ce qui sera encore plus difficile à supporter pour la victime.
Mme Laurence Rossignol proteste.

Enfin, je rappelle que, depuis une décision du 22 janvier 1999, le Conseil constitutionnel a souligné qu’« aucun principe de valeur constitutionnelle n’interdit l’imprescriptibilité pour les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale », ce qui semble réserver l’imprescriptibilité aux seuls crimes graves affectant l’ensemble de la communauté internationale.
De surcroît, il serait contraire au principe d’égalité devant la loi pénale de prévoir l’imprescriptibilité pour certains crimes de droit commun, tout en continuant à prévoir un régime de prescription pour d’autres délits encourant les mêmes peines. On ne pourra envisager l’imprescriptibilité des crimes sexuels que le jour où la France renoncera à l’idée de prescription pour toutes ces infractions. Or il semble que la prescription ait, encore aujourd’hui, toute sa pertinence, notamment pour éviter des erreurs judiciaires et des mises en cause tardives.
Vous l’aurez compris, la commission est défavorable aux amendements n° 12 rectifié ter, 68 rectifié et 84 rectifié quater. En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 127 du Gouvernement, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 138 rectifié.
Le Gouvernement est également défavorable aux amendements n° 12 rectifié ter, 68 rectifié et 84 rectifié quater.
Il est favorable au sous-amendement n° 138 rectifié présenté par Mme la rapporteur, que je remercie pour son travail constructif.

Madame la présidente, en application de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, je demande la priorité de vote de l’amendement n° 127 du Gouvernement, ainsi que du sous-amendement n° 138 rectifié de la commission des lois.

Je rappelle qu’aux termes de l’article 44, alinéa 6, de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement.
Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission ?

La priorité est ordonnée.
En conséquence, le sous-amendement n° 138 rectifié et l’amendement n° 127 seront mis aux voix avant les autres amendements en discussion commune.
La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.

En tant qu’historienne, je suis choquée par l’imprescriptibilité. Il serait tout de même extraordinaire d’arrêter de graduer les événements selon leur gravité. Il ne faut pas tout confondre, car cela nuirait à la nécessaire pédagogie.
Je ne veux pas vous contredire, monsieur Buffet, mais l’imprescriptibilité n’a pas été créée pour la raison que vous évoquez et on ne peut pas mettre sur le même plan un viol et un crime contre l’humanité, qui constituent tous deux, il est vrai, des crimes extrêmement graves.
En étendant l’imprescriptibilité, vous nous empêcherez d’appréhender correctement les événements historiques. Je ne comprends vraiment pas comment l’on peut proposer une telle mesure.
M. Max Brisson applaudit.

Être violé lorsque l’on est enfant est d’une violence inouïe. C’est un arrachement brutal d’une partie de soi. C’est ensuite la sidération dans un mélange de dégoût, de honte, de faute et de peur. C’est l’absence à soi-même qui s’installe sans l’avoir commandée, un effacement, comme un instinct de survie.
Un enfant violé ne parle pas, il ne le peut pas, il est empêché, parce que l’infamie vient d’un adulte, souvent d’un proche. Pour l’enfant, c’est la nausée, née du trouble et de l’outrage ultime.
L’enfant, s’il est très jeune, ne pleure même pas, il n’est nul besoin de lui faire peur, il ne parlera pas, il n’a pas les mots, il ne sait pas dire. D’ailleurs, où, quand et à qui parlerait-il ? Puis, le mécanisme d’oubli se met en place, consciemment ou non.
Comme je l’ai dit, l’enfant est amputé à jamais. Sa vie ne sera pas ce qu’elle aurait dû être. À l’extérieur, tout a souvent l’air normal, avec peut-être une fêlure dans le regard. À l’intérieur, on sait maintenant, cela est scientifiquement prouvé, qu’il y a des lésions irréversibles sur le cerveau, qui engendrent, avec l’âge, des maladies dégénératives.
Bref, l’enfant violé l’est pour toujours ! Dès le début, l’enfant a appris à vivre avec et met en place des stratégies d’évitement, de déni, de refoulement. C’est la réponse irrationnelle au choc initial, et cela tout au long de sa vie.
Comment survivre, sinon ? Parler est si difficile, il y a quelque chose de honteux à le dire, à l’évoquer, à ce que les autres vont imaginer. C’est vous dans des images choquantes et c’est terriblement gênant.
Si les parents ne sont pas les violeurs, c’est comme une barrière infranchissable. Comment le leur dire ? Alors on attend, on oublie. Et puis cela revient toujours et encore et, à la faveur d’événements particuliers, déclencheurs, on commence à s’exprimer et à parler.
Alors oui, il faut du temps, beaucoup de temps parfois. Laissons à toutes celles et tous ceux qui, enfants, furent victimes de violences sexuelles le temps de se sentir prêts à porter plainte, parce que c’est justice ! Nous nous devons de permettre cela.
Notre société si civilisée se doit de protéger les enfants, en envoyant un signal fort : les pervers – il s’agit bien de cela, n’est-ce pas ? – doivent pouvoir être poursuivis sans limite de temps grâce à l’imprescriptibilité.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires. – M. Yvon Collin applaudit également.

L’histoire a son poids, elle a été, un moment, suivie par le droit, mais le temps passe et les sociétés évoluent. Le droit n’est pas une fin, il n’est qu’un moyen.
Nous devons utiliser le droit pour protéger et l’imprescriptibilité protège les plus faibles d’entre nous, ceux qui sont touchés de la manière la plus violente qui puisse exister. C’est la raison pour laquelle je défends ce principe.
Madame la garde des sceaux, je ne partage pas votre point de vue. Votre amendement porte en lui l’imprescriptibilité. Vous avez présenté son mécanisme : la répétition d’une infraction permettra de lever la prescription éventuelle du premier crime commis. Qu’est-ce d’autre que de l’imprescriptibilité ?
Le problème, madame la garde des sceaux, c’est que vous laissez de côté, sur le bord de la route, la personne qui aura été victime une seule fois. La victime de ce qui reste une abomination n’aura pas droit à l’imprescriptibilité que vous mettez en place ! C’est en cela que votre amendement introduit une complexité.
Les avancées que vous proposez sont plutôt positives et je les comprends. Mais, sous cet angle, vous venez à l’imprescriptibilité en oubliant une victime, celle qui n’aura peut-être pas eu la « chance » – et ce terme est évidemment à mettre entre guillemets – d’avoir été violée par un criminel en série !

Voilà environ dix-huit mois, le Parlement a élaboré la proposition de loi dite Fenech-Tourret, qui, devenue la loi portant réforme de la prescription en matière pénale, a accru les délais de prescription.
La question de l’imprescriptibilité ou de l’allongement du délai de prescription des viols sur mineurs était sous-jacente, mais le débat n’a jamais été mené à son terme, ce qui explique notre discussion de ce jour. Les oppositions à l’allongement des délais de prescription étaient tellement vigoureuses et solides qu’elles ont, à l’époque, contraint les associations de victimes à attendre une meilleure occasion.
Quand nous avons lancé la mission présidée par Flavie Flament et Jacques Calmettes, nous étions face à deux positions figées : ne rien toucher ou choisir l’imprescriptibilité.
Cette mission de consensus, qui a bien mérité ce nom, a proposé un allongement de dix ans du délai de prescription des viols sur mineurs. C’est la position que je soutiendrai aujourd’hui. Pour autant, cela ne règle pas la question de l’imprescriptibilité, qui reste posée.
À ce titre, je voudrais dire à ma collègue Esther Benbassa que, si l’argument de l’histoire est un argument fort, je ne crois pas, et ce même si je n’entends pas la voter, que l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs dégraderait en aucune façon les crimes contre l’humanité. L’histoire ne se juge pas qu’au montant des peines encourues pour chaque crime !
Monsieur le président de la commission, je ne suis pas certaine que, sur le plan psychologique, votre demande d’inverser les votes ait été une bonne décision… Nous ferons comme vous le souhaitez, mais ce débat doit avoir lieu et ceux qui veulent voter en faveur de l’imprescriptibilité devraient pouvoir le faire.
Le groupe socialiste et républicain votera l’amendement du Gouvernement – Marie-Pierre de la Gontrie s’exprimera dans un instant sur le sujet –, mais certains d’entre nous voteront l’imprescriptibilité et d’autres, comme moi, s’abstiendront.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Ce type de débat est, j’imagine, relativement rare dans cet hémicycle. Nous voyons bien que les engagements politiques n’ont rien à voir avec la réflexion que, chacun, nous menons de manière – on peut le dire – intime.
Les propos que vient de tenir Laurence Rossignol sont assez justes : sans doute devons-nous prendre le temps de ce débat.
Je ne sais pas quel sera le résultat du vote. Je sais que la proposition du Gouvernement est une piste intéressante, car la pluralité de victimes dans le temps est une donnée que nous connaissons, permettant parfois que les auteurs soient confondus et, donc, condamnés.
De ce point de vue, nous donnerons un avis favorable à l’amendement du Gouvernement et au sous-amendement de la commission, qui l’enrichit et l’améliore.
S’agissant du reste, en tant que juriste, et puisque nous sommes ici pour faire la loi, j’aurai tendance à considérer que l’échelle des peines et des prescriptions compte. Effectivement, réserver l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité est une règle tout à la fois constitutionnelle – peut-être Mme la garde des sceaux le rappellera-t-elle – et juste.
Mais, on le voit bien, nous parlons d’autre chose ! Notre collègue François-Noël Buffet l’a parfaitement exprimé, dans le fond, nous ne savons pas ! Nous ne savons pas !
Je suis censée donner une explication de vote, ce que je fais en indiquant le vote favorable de mon groupe sur l’amendement du Gouvernement et le sous-amendement de la commission des lois. Pour le reste, chacun d’entre nous se positionnera personnellement, avec l’espoir de choisir la solution la plus efficace possible pour que les auteurs de ces crimes soient poursuivis.
À titre personnel, je ne voterai pas l’imprescriptibilité, mais je comprends – et regrette de ce fait l’utilisation du règlement à l’appui de ce débat – que chacun de nous, indépendamment de son appartenance politique au fond, puisse être partagé sur ce vote.
Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain, et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Afin que tout soit très clair, mes chers collègues, je précise que, si l’amendement du Gouvernement est adopté, les amendements n° 12 rectifié ter et 84 rectifié quater n’auront plus d’objet.
La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Je rejoins les interventions de Laurence Rossignol et Marie-Pierre de la Gontrie. Ce que nous touchons là, ce n’est pas le cœur du sujet, mais c’est l’immense difficulté dans laquelle celui-ci nous place, sa très grande complexité du fait même qu’il est de l’ordre de l’innommable, de l’indicible. Quoi de plus grave, dans une société, que de toucher à un enfant ? Rien n’est plus grave !
Je comprends donc que, spontanément ou de manière réfléchie, on puisse considérer qu’un tel franchissement vers l’innommable mérite l’imprescriptibilité – c’est tellement dur à penser que j’ai du mal à le dire !
Toutefois, pour avoir beaucoup travaillé avec Marie Mercier, beaucoup entendu et écouté – nous sommes nombreux dans ce cas ici –, je suis parvenue au constat suivant : pour qu’un crime soit jugé, un coupable condamné, dans un temps qui est celui de l’infini, il faut amener la preuve de la culpabilité ; or, mes chers collègues, d’une manière qu’il convient d’appeler réaliste, comment peut-on imaginer laisser croire à un enfant que la justice sera en capacité, dans cinquante ou soixante ans, de fournir la preuve de la culpabilité du présumé coupable ? Nous risquons même, il faut le dire, de créer à nouveau une illusion !
Pour ma part, j’apprécie la proposition du Gouvernement. Comme l’a souligné François-Noël Buffet, c’est une manière – le sujet est trop grave pour employer le terme « astucieuse » – extrêmement intelligente et pertinente d’offrir la possibilité, à une victime, de venir se raccrocher à un recours qui sera, lui, recevable.
Enfin, je ne sais pas quelle est la hiérarchie des douleurs et des malheurs. Nous avons parlé des crimes contre l’humanité et nul ne peut les mettre en cause. Mais, alors qu’une famille pourra éventuellement bénéficier d’une imprescriptibilité parce que son enfant a été violé – ce qui est juste –, qu’ira-t-on dire à celle qui n’en bénéficiera pas si son enfant a été tué ?
J’en appelle vraiment à la raison et à l’évaluation de l’impact, même si j’entends et respecte les questionnements de mes collègues.

J’avoue que je suis troublée par l’amendement du Gouvernement.
L’imprescriptibilité, pour moi, c’est l’inversion de la charge de la preuve. C’est tout à fait net ! On fait en sorte que la victime n’ait plus à se justifier et puisse passer le reste de sa vie à survivre.
J’ai bien noté, madame la ministre, la volonté du Gouvernement d’aménager les délais de prescription, en rendant possible l’interruption du délai en cas de commission du même crime par le même auteur contre d’autres mineurs.
C’est là que je rejoins les arguments de notre collègue François-Noël Buffet : il y a quelque chose d’inacceptable dans ce pas que vous nous proposez de faire !
Je suis donc très confuse. Je pense que je ne pourrai pas voter contre votre amendement, mais, profondément, intrinsèquement, je ne l’approuve pas. Je souhaite que les choses soient clairement dites et que l’on réponde aux demandes des victimes s’agissant de la prescription de ces crimes.

Ce sujet, on le voit bien, est extrêmement difficile. Toutes et tous, nous nous plaçons plutôt sur le registre des sentiments, du sentiment d’horreur en particulier. À partir du moment où l’on se situe sur ce champ, on ne parvient plus à développer un jugement objectif.
Il ne s’agit pas d’affirmer que tel ou tel crime est plus horrible que tel autre. Mais je fais partie de celles et ceux qui jugent la gradation nécessaire. L’imprescriptibilité doit concerner les crimes contre l’humanité, qui, comme leur nom l’indique, touchent l’humanité entière. L’histoire nous offre, hélas, suffisamment d’exemples, qui appartiennent certes au passé – parfois récent –, mais qui peuvent se reproduire.
Cette première remarque n’enlève rien à l’horreur que nous inspirent les viols commis contre les enfants. Le sujet n’est pas là !
Par ailleurs, j’attire l’attention de mes collègues sur un point : dans notre réflexion sur la protection de l’enfance, nous ne devons pas croire que le choix de l’imprescriptibilité, ou non, réglera la question. Celle-ci est évidemment beaucoup plus complexe.
Nous l’avons vu dans les débats très mouvementés à l’Assemblée nationale, avec un projet gouvernemental qui partait d’éléments objectifs, mais qui a dérapé. Soyons donc vigilants, un débat va suivre sur l’article 2 et, à mon avis, il permettra de mieux cadrer le problème qui nous est posé.
Enfin, si nous allons voter contre l’imprescriptibilité – dans le cas, bien sûr, où l’on nous laisse nous prononcer sur la question ; j’ai bien compris que les amendements correspondants risquaient de tomber –, je voudrais de plus amples explications sur la visée de l’amendement gouvernemental.
En le lisant et en le relisant, madame la ministre, je le perçois comme une façon d’introduire l’imprescriptibilité, à laquelle, je le rappelle, nous sommes opposés. Ayant un peu de difficulté à bien appréhender les choses, j’apprécierais que vous puissiez nous donner quelques éléments supplémentaires pour prendre la véritable mesure de votre proposition. Cela nous permettrait de mieux nous situer.

S’agissant de cet amendement du Gouvernement, et du sous-amendement de la commission des lois, je peux partager tous les témoignages particulièrement émouvants qui ont été portés au débat.
Les textes de cette nature nous posent de réels cas de conscience, car tout y est juridique. Nous avons confiance en la justice, nous respectons la séparation des pouvoirs, mais, d’un autre côté, nous devons voter la loi.
Le projet de loi tend à porter de vingt à trente ans la prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs – et nous savons, malheureusement, que ces situations existent. Dans l’objet de l’amendement, il est aussi question de lutter contre l’impunité des auteurs de ces crimes, étant précisé que, parfois, ce sont de très jeunes enfants qui sont victimes de ces prédateurs.
Mais il faut aussi évoquer tout le travail de fond, d’investigation, de prévention qui doit être mené à tous les niveaux – il y a la dimension sociale, mais il y a aussi l’éducation nationale, par exemple. Toutes les bonnes questions doivent être posées !
C’est pourquoi, après avoir entendu les explications du président de la commission des lois et de la rapporteur, j’irai dans leur sens, tout en insistant sur la complexité de notre tâche. Nous sommes ici sur une matière très juridique, mais, comme on a coutume de le dire, nous faisons confiance à la justice !

Nous avons eu un débat fort long sur la prescription, voilà un an, à l’occasion de l’adoption d’un texte. Nous nous étions arrêtés sur l’idée que vingt ans à compter de la majorité, c’était déjà un bon pas.
Je crains que nous ne donnions beaucoup d’illusions aux victimes, en leur laissant penser que, trente ans après leur majorité, on pourra apporter la preuve de faits dont elles ont été victimes. Or être obligé de quitter les assises en ayant vu celui que l’on a accusé, celui qui nous a blessé, être acquitté, c’est souvent pire que de constater que l’affaire ne peut plus être poursuivie au motif qu’elle est prescrite.
Je comprends bien, madame la ministre, que dans un cas comme celui du prêtre pédophile lyonnais, où il y avait prescription pour certains faits et pas pour d’autres, l’adoption de votre amendement permettrait de tous les sanctionner. Mais, je suis à peu près convaincu que toutes les victimes pour lesquelles les faits sont prescrits pourront témoigner aux assises, et qu’il en sera nécessairement tenu compte par le jury.
Quoi qu’il en soit, je comprends bien le sens de votre amendement et je voudrais rassurer Mme Michelle Meunier : l’imprescriptibilité, on en prend le chemin !
Le délai de prescription est passé de vingt à trente ans. L’amendement gouvernemental ouvre cette nouvelle possibilité, que je comprends parfaitement sur le plan de la psychologie. Enfin, dans le texte établi par la commission, une disposition a été ajoutée à un autre article du projet de loi, sur proposition de notre collègue François-Noël Buffet : si un expert médecin vient apporter la preuve que la victime a subi une amnésie post-traumatique, il y a un obstacle, de fait, à la révélation des faits ; dans ce cas, il sera possible d’engager des poursuites au-delà même du délai de trente ans.
Le vrai sujet est ailleurs, d’après moi. Un enfant qui est victime aujourd’hui, à dix ans, pourra se plaindre de ces faits à sa majorité, dans huit ans, puis pendant trente ans. Voyez l’âge qu’il aura, mes chers collègues. J’espère que tout ce temps aura été mis à contribution pour faire de la prévention, pour éviter que la question ne se pose !
Quoi qu’il en soit, il y a bien remise en cause du droit de la prescription. Je rappelle que, dans certains États, celle-ci n’existe pas. D’ailleurs, indépendamment des faits – délits ou crimes –, elle est par définition insupportable aux yeux des victimes. Une victime ne supportera jamais la prescription, et c’est compréhensible !

J’ai indiqué en préambule que j’étais favorable à l’allongement du délai de prescription, tout en nuançant mes propos. Il me semble que, voilà quelques années, nous étions tous majoritairement contre l’allongement de ce délai, mais qu’un consensus se dessine aujourd’hui autour des trente ans.
Je voudrais que Mme la ministre apporte quelques précisions quant aux exceptions. Si on lit et on relit cet amendement, on constate qu’il tend vers l’imprescriptibilité… Si, en définitive, c’est une imprescriptibilité qui est proposée, alors je veux être sûre que l’amendement a bien fait le tour de tout ce qui peut être imprescriptible !
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Pour avoir examiné, entendu, accompagné de nombreuses victimes de viols ou d’incestes, je peux dire que ces patients sont complètement cabossés. Pour eux, le monde ne sera plus jamais à l’endroit. Ils prennent perpétuité !
Que faut-il faire pour ces victimes ? Il faut libérer la parole le plus tôt possible et donner des moyens, de sorte qu’une fois cette parole libérée, elles puissent se reconstruire et, différemment, continuer une vie. Ces personnes veulent entendre : « Je vous crois » quand elles déposent leur plainte. Voilà ce qu’elles attendent ; ce n’est pas forcément une réponse pénale.
Un jour, une patiente m’a dit : « Je n’ai plus que deux ans ». « Pourquoi deux ans ? », lui ai-je demandé. « Deux ans pour déposer plainte. Après, ça sera prescrit, et il faut que j’y aille… »
Cette date butoir l’obligeait à libérer la parole, l’obligeait à expliquer le drame et les sévices qu’elle avait subis. La prescription peut donc aussi aller dans le sens de la résilience chez nos patients.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.

J’ai hésité à reprendre la parole après l’intervention que vient de faire Marie Mercier, que je remercie pour les arguments nouveaux portés au débat.
Je veux juste saluer celles et ceux qui, parmi vous, mes chers collègues, se sont exprimés sur ce sujet vraiment très difficile. Ce type de débats honore réellement le Sénat, y compris par l’expression de doutes, d’hésitations de la part de plusieurs d’entre vous.
Mme Angèle Préville a exposé, avec beaucoup de sensibilité, les souffrances des victimes et elle n’a pas été la seule à le faire, bien sûr.
Mais, au fond, il me semble qu’agir sur la prescription ne doit pas se faire en fonction de l’horreur que nous inspire une catégorie de crimes. La prescription n’est pas un instrument de mesure de l’abomination. Si on veut la modifier, c’est pour être utile à la victime. Voilà la vraie question qui nous est posée et il faut la considérer, je pense, avec réalisme.
Deux éléments me paraissent dignes d’être pris en considération.
Le premier élément a été énoncé par plusieurs d’entre vous et repris, à l’instant, par Marie Mercier. Il s’agit de la question du moment précis où l’on doit porter plainte.
Notre débat sur la prescription n’efface évidemment pas la priorité que les pouvoirs publics doivent donner, dans leur politique, à l’accueil, à l’information, à l’accompagnement des victimes, car ce n’est pas dans trente ans qu’il faut porter plainte, c’est aujourd’hui, demain ou, au plus tard, la semaine prochaine !
Il est absolument fondamental d’inciter au dépôt de plainte, de l’accélérer et d’accompagner la victime pour qu’elle puisse être accueillie dans de bonnes conditions. Ne laissons pas croire, parce que nous parlons de la prescription, que c’est la solution que nous allons apporter au problème de la réparation en justice demandée par la victime !
Le second élément consiste à veiller à ne pas faire courir aux victimes le risque d’intenter un procès conduisant au rejet de leur plainte.
C’est déjà bien d’être entendu et de pouvoir déposer plainte, mais c’est tout de même mieux d’obtenir satisfaction devant la cour d’assises ! Or cela ne sera pas le cas de la plupart des plaintes qui seront déposées trop longtemps après les faits – et ce peut être avant même vingt ou trente ans.
Malgré tout, la prise en compte de cas particuliers me paraît judicieuse.
Nous proposons de passer le délai de prescription de vingt à trente ans, mais nous proposons aussi deux mesures additionnelles.
D’une part, suivant la proposition du Gouvernement, le délai de prescription courrait à partir du dernier crime connu. Dans le cas d’un violeur en série qui aurait sévi pendant quinze ans, la prescription commencerait, non pas à l’arrivée à la majorité de la première victime, mais à partir du dernier crime commis. Ce point m’apparaît important, et c’est pourquoi la commission a choisi de se rallier à cette solution.
D’autre part, sur proposition de notre collègue François-Noël Buffet, adoptée par la commission, en cas d’amnésie post-traumatique constatée par un expert médical, à la demande du tribunal, le délai de prescription serait rouvert. Il me semble que, bon an mal an, on arrive ainsi à un compromis satisfaisant, qui renforce les droits de la victime souffrant de l’amnésie post-traumatique et ne vient pas perturber la hiérarchie des crimes au regard des règles de la prescription.
Je souhaite juste répondre à quelques interrogations.
L’amendement du Gouvernement ne tend pas à l’imprescriptibilité juridique. Ce que nous proposons de mettre en place est un mécanisme déjà connu dans notre droit : il s’agit d’un nouveau cas interruptif d’une procédure, ainsi que M. le président Philippe Bas l’a expliqué.
Lorsque des viols sont commis par un même auteur, on interrompt la prescription. Cela entraîne un glissement dans le temps, qui permet à des victimes qui auraient été violées longtemps auparavant de pouvoir espérer un jugement éventuel de leur violeur. Pour autant, ce délai, par définition juridique, est toujours borné dans le temps et, en ce sens, il diffère de l’imprescriptibilité, laquelle ne connaît pas ce bornage temporel.
Autant nous sommes là dans un processus favorable aux victimes, le glissement dans le temps permettant à la victime la plus ancienne de pouvoir demeurer présente dans le processus et de bénéficier activement de ces dispositions juridiques, autant il y a bien toujours un bornage dans le temps.

Madame la présidente, j’aurais souhaité pouvoir répondre à Mme la ministre…

Mon cher collègue, dans la mesure où vous êtes déjà intervenu pour expliquer votre vote, il ne m’est pas possible de vous donner à nouveau la parole.

Dans ce cas, j’interviendrai plus tard, madame la présidente, car je ne voudrais pas vous faire commettre une entorse au règlement !
Le sous-amendement est adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 127, modifié.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.
Je vous rappelle que l’avis de la commission est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 189 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, les amendements n° 12 rectifié ter et 84 rectifié quater n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° 68 rectifié.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 19 rectifié, présenté par Mmes de la Gontrie, Rossignol, Lepage, Blondin et Cartron, M. Courteau, Mmes M. Filleul, Jasmin, Monier, Meunier, Conway-Mouret et Lubin, MM. J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Au premier alinéa de l’article 9-1 du code de procédure pénale, les mots : « à l’article 706-47 du présent code et » sont supprimés.
La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Cet amendement étant partiellement satisfait par celui du Gouvernement, que nous venons d’adopter, nous le retirons.

L’amendement n° 19 rectifié est retiré.
Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les amendements n° 72 et 102 rectifié bis sont identiques.
L’amendement n° 72 est présenté par MM. de Belenet, Patriat et les membres du groupe La République En Marche.
L’amendement n° 102 rectifié bis est présenté par Mmes Benbassa et Cohen, M. Collombat, Mme Assassi, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli et Mme Apourceau-Poly.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Arnaud de Belenet, pour présenter l’amendement n° 72.

Dans la continuité de nos derniers votes, et par coordination pour ainsi dire, nous proposons de supprimer les alinéas 6 et 7 de l’article 1er qui créent une forme d’infraction continue de non-dénonciation de mauvais traitements notamment commis sur mineur, en repoussant le point de départ du délai de prescription de l’action publique à compter du jour où tous les éléments constitutifs de l’infraction réprimée ont cessé.
Il nous semble que le caractère continu de l’infraction instaurerait par voie de conséquence une forme d’imprescriptibilité.
Nous vous proposons donc de supprimer ces deux alinéas, en cohérence avec nos précédents votes.

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 102 rectifié bis.

Le code pénal prévoit que « le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
Introduit sur l’initiative de notre commission des lois, les alinéas 6 et 7 de l’article 1er entendent compléter ce dispositif en affirmant le caractère continu de l’infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l’encontre des mineurs, par le biais du report du point de départ du délai de prescription au jour où la situation illicite prend fin.
Nous considérons que cette disposition reviendrait à introduire de nouveau une forme d’imprescriptibilité, ce qui ne nous paraît pas souhaitable, d’abord, en raison du principe de proportionnalité des peines, mais surtout pour des raisons de principe.
Aujourd’hui, seuls les crimes contre l’humanité et les crimes de génocide sont imprescriptibles. Mettre au même niveau l’infraction de non-dénonciation des agressions sexuelles semble pour le moins inopportun.
Nous demandons en conséquence la suppression des alinéas 6 et 7.
Il est tout de même très curieux que l’imprescriptibilité revienne sans arrêt dans nos débats. C’est vraiment un réel problème dont il faudrait discuter.

L’amendement n° 139, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
III. – Le premier alinéa de l’article 434-3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le mot : « eu » est supprimé ;
2° Après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé, ».
La parole est à Mme le rapporteur.

Cet amendement vise à clarifier la disposition adoptée par la commission des lois. Il s’agit de faire du délit de non-dénonciation de mauvais traitements, privations et atteintes sexuelles commises à l’encontre d’un mineur ou d’une personne vulnérable un délit continu et non plus un délit instantané.
Tant que l’infraction aura lieu, c’est-à-dire tant que la personne continue de ne pas informer des infractions en cours, la prescription ne commencera pas à courir.

L’amendement n° 21 rectifié, présenté par Mmes de la Gontrie, Lepage, Rossignol, Blondin et Cartron, M. Courteau, Mmes M. Filleul, Jasmin, Monier, Meunier, Conway-Mouret et Lubin, MM. J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après le mot :
compter
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de la majorité de la victime. »
La parole est à Mme Laurence Rossignol.

Cet amendement vise à reporter le point de départ du délai de prescription de ce délit de non-dénonciation pour le situer à la majorité de la victime.

L’amendement n° 20 rectifié, présenté par Mmes Lepage, Rossignol, de la Gontrie, Blondin et Cartron, M. Courteau, Mmes M. Filleul, Jasmin, Monier, Lubin, Meunier et Conway-Mouret, MM. J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
tous les
par les mots :
un ou plusieurs
La parole est à Mme Claudine Lepage.

Cet amendement vise à préciser celui que vient de présenter Mme Mercier, qui reprend l’article 6 de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles.
Mme Mercier proposait d’affirmer le caractère continu de l’infraction de non-dénonciation des privations, mauvais traitements et violences sexuelles sur mineurs et personnes vulnérables.
Le caractère continu de l’infraction permet une amélioration de la protection des victimes en reportant le point de départ du délai de prescription de l’action publique. Cependant, conditionner ce report à la cessation de tous les éléments constitutifs de l’infraction pourrait limiter le renforcement de la protection souhaitée par Mme la rapporteur à cause de la fragilité juridique de cette rédaction. En effet, certains éléments constitutifs de l’infraction ne peuvent cesser – je ne vous relis pas l’article du code pénal. Je ne vois pas comment la connaissance des faits, élément essentiel de cette infraction, pourrait cesser. L’objet de cet amendement et donc de proposer une rédaction qui reflète une traduction juridique plus fidèle et plus sûre.

Sur les amendements identiques n° 72 et 102 rectifié bis visant à supprimer le régime dérogatoire de prescription tel qu’il a été adopté en commission, c’est une demande de retrait au profit de l’amendement n° 139. À défaut, l’avis sera défavorable.
Même demande de retrait pour l’amendement n° 21 rectifié ; à défaut, avis défavorable.
Enfin, la commission demande également le retrait de l’amendement n° 20 rectifié au profit de l’amendement n° 139. À défaut, avis défavorable.
Madame la présidente, si vous le voulez bien, je me prononcerai pour commencer sur l’amendement n° 139 de la commission, qui concerne la prescription du délit de non-dénonciation de mauvais traitements ou d’agressions sexuelles sur mineur.
Le Gouvernement s’était opposé à l’adoption de cette règle de prescription dérogatoire lors des débats à l’Assemblée nationale en faisant notamment observer que cette disposition lui paraissait sans portée juridique. Cet amendement est différent, car il ne traite pas de la prescription, mais il tend à réécrire l’article 434-3 du code pénal afin de faire de ce délit un délit continu : tant que les mauvais traitements se poursuivent et en l’absence de toute dénonciation, le délit sera commis et la prescription ne commencera donc à courir qu’à la cessation des mauvais traitements.
Si, actuellement, le délit de non-dénonciation de mauvais traitements est instantané, il est constitué chaque fois que se commettent des mauvais traitements ou des agressions et que la personne qui en a connaissance ne les signale pas.
Lorsque les violences ou les agressions sont habituelles et répétées dans le temps, chaque fait nouveau crée une nouvelle obligation de dénoncer et, par conséquent, un nouveau délai de prescription, lequel est désormais de six ans. Il n’est donc peut-être pas indispensable d’en faire un délai continu. Cela étant, en cas de mauvais traitements sur un mineur, identifier de façon isolée chaque infraction commise sur la victime n’est pas toujours très simple. Dès lors, il me semble qu’ériger le délit de non-dénonciation en délit continu peut se justifier. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement donnera un avis de sagesse sur l’amendement de la commission.
Par voie de conséquence, et comme Mme la rapporteur, je demande le retrait des amendements n° 72, 102 rectifié bis, 21 rectifié et 20 rectifié.

Oui, madame la présidente.
Il faut qu’on se comprenne bien, tant le sujet est délicat. Par cet amendement, nous proposons que, lorsqu’une victime veut que soient engagées des poursuites contre quelqu’un qui a été témoin de violences ou de mauvais traitements sans intervenir, le délai de prescription soit aligné sur le délai de prescription des mauvais traitements eux-mêmes, par exemple des violences sexuelles. En effet, il est assez logique que la victime dépose plainte en même temps contre l’auteur et contre celui qui s’est abstenu en laissant faire. Il me paraît donc cohérent de faire débuter simultanément les délais de prescription de l’action contre les faits eux-mêmes et de l’action contre la non-dénonciation.
Je ne suis pas totalement convaincue par ce qui m’a été dit, mais peut-être ne maîtrisé-je pas totalement cette question…

L’amendement de la commission, et vous l’avez salué, madame la garde des sceaux, vise effectivement à créer un délit continu. Mais, tout à l’heure, nous avons considéré que certains faits d’infraction sexuelle devaient être prescrits par délai de trente ans.
Imaginez un enfant victime d’actes incestueux que la famille ne dénoncerait qu’au bout de plusieurs années. Cet enfant est victime certes de l’auteur de ces faits, mais aussi de leur non-dénonciation par l’entourage, qui a favorisé ce grave traumatisme. Pourquoi ne ferait-on pas courir le délai de prescription à compter de la connaissance de l’infraction ? Cela supposerait de remplacer, dans l’amendement de la commission, les mots « ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé » par les mots « tant que ces infractions ne sont pas prescrites ».
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, les amendements n° 21 rectifié et 20 rectifié n’ont plus d’objet.

Ma chère collègue, l’amendement n° 139 de la commission visait à proposer une nouvelle rédaction pour les alinéas 6 et 7 de l’article 1er, cependant que les amendements n° 20 rectifié et 21 rectifié tendaient, eux, à modifier la rédaction de l’alinéa 7. Par conséquent, je vous confirme bien qu’ils n’ont plus d’objet. Il vous aurait fallu déposer des sous-amendements à l’amendement de la commission pour qu’il en aille autrement.
Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
L ’ article 1 er est adopté.

L’amendement n° 28 rectifié bis, présenté par Mmes de la Gontrie, Lepage, Rossignol, Blondin et Cartron, M. Courteau, Mmes M. Filleul, Jasmin, Monier, Meunier, Conway-Mouret et Lubin, MM. J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « à l’article 434-3 du code pénal et ».
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Le monde est bien fait puisque cet amendement traite précisément du délit de non-dénonciation de mauvais traitements.
Pour ce type de délit, l’action publique se prescrit au bout de six ans. Je vous laisse calculer l’âge de la victime. Par cet amendement, nous proposons de prolonger ce délai de prescription de l’action publique en fixant comme point de départ la majorité de la victime, de manière qu’elle puisse à ce moment-là engager des poursuites.

Cet amendement a le même objet que l’amendement n° 21 rectifié, examiné précédemment : faire courir le délai de prescription de l’infraction de non-dénonciation de mauvais traitements ou d’agressions sexuelles sur mineurs ou personnes vulnérables à partir de la majorité des victimes.
Cet amendement manque de clarté. Il n’est pas possible de reporter le point de départ du délai de prescription à la majorité de la victime, sans autre précision, puisque le délit de non-dénonciation est un délit sans victime directe. Il ne faut pas confondre le délit de non-dénonciation avec les délits ou les crimes qui n’ont pas été dénoncés.
Je vous suggère donc de retirer votre amendement ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

Nous ne demandions qu’à être convaincus. Pour autant, nous ne le sommes pas. Sans doute une notion de droit doit-elle m’échapper.

Merci de le souligner, monsieur le président de la commission, vous qui notez régulièrement nos copies de droit civil…
Donc, le délit de non-dénonciation est un délit sans victime directe…
Faisons simple : dans le cas d’un enfant victime, entre six et neuf ans, d’abus sexuels de la part de son beau-père sans que l’autre parent intervienne, le délit de non-dénonciation serait réalisé. Le délai de prescription étant de six ans, l’action publique s’éteint quand l’enfant atteint l’âge de quatorze ans. Or, dans la mesure où il bénéficie de la possibilité de faire partir le délai de prescription du crime à sa majorité, pourquoi cette faculté ne lui serait-elle pas offerte s’agissant du délit de non-dénonciation de ce même crime ?
Je veux bien être convaincue, mais, pour le moment, je n’ai rien entendu qui me ferait changer d’avis.

J’ai envie de rejoindre Mme Rossignol sur ce point. L’amendement que nous venons d’adopter propose une construction juridique intéressante : le point de départ du délai de prescription pour l’auteur d’un délit court à compter de la cessation d’un crime commis par un autre. C’est assez innovant, mais c’est assez déconcertant. Si nous faisions courir ce délai à compter de la majorité, notre production juridique y gagnerait en qualité.

Je ne comprends pas comment l’on peut affirmer que l’enfant victime de privations, de mauvais traitements, d’agressions ou d’atteintes sexuelles ne serait pas recevable à se constituer partie civile à l’égard de celui qui n’a pas dénoncé ces faits, leur non-dénonciation ayant permis la continuation de ce qu’il subit. L’argument peut être tout simplement de considérer la non-dénonciation comme un délit devant être prescrit dans le temps de sa commission, au bout de six ans en tant que délit continu, sans rouvrir ce délai à la majorité de l’enfant.
On peut vouloir refuser une prolongation du délai de prescription, mais qu’on ne dise pas que l’enfant n’est pas victime : il est incontestablement une victime ! Ou alors, franchement, je désespère de la justice française.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
L ’ amendement est adopté.

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
L’article 706-48 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une telle expertise peut également être ordonnée pour apprécier l’existence d’un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, en application de l’article 9-3 du code de procédure pénale. »

L’amendement n° 128, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
La commission a introduit cette disposition visant à permettre une expertise pour apprécier l’existence d’un obstacle de fait insurmontable pendant la prescription, par exemple une amnésie post-traumatique. Nous proposons sa suppression, car elle ne présente pas, selon nous, d’utilité juridique.
En effet, l’article 9-3 du code de procédure pénale prévoit que l’existence d’un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique est une cause de suspension de la prescription. Il est inutile de préciser dans l’article 708-48 du code de procédure pénale qu’une expertise peut être ordonnée pour vérifier l’existence d’un tel obstacle ; cette possibilité va de soi. Une telle disposition n’est pas normative.
Au surplus, l’article 708-48 ne traite que des expertises diligentées dans des procédures qui portent sur des crimes ou délits de nature sexuelle ou violente commis contre les mineurs prévus à l’article 708-47. Or l’existence d’un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique peut se présenter dans n’importe quelle affaire. Il est dès lors injustifié de faire référence à cette hypothèse uniquement pour certaines procédures.

Avis défavorable.
Il est maladroit de considérer cette disposition comme inutile juridiquement, ce qu’elle n’est pas, alors même que le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale comportait, avant son passage devant notre commission, plusieurs dispositions qui avaient davantage leur place dans une circulaire que dans une loi pénale.

Nous avons déjà voté cette disposition lors de l’examen, voilà quelques mois, de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles. À l’époque, le Gouvernement l’avait rejetée, en disant vouloir y revenir « plus tard » – je reprends les termes employés. Présentement, le Gouvernement n’en veut toujours pas.
Quelle est la réalité ? L’amnésie post-traumatique peut être aujourd’hui scientifiquement établie. C’est une période pendant laquelle la victime est dans l’impossibilité absolue de pouvoir révéler ce qu’elle a vécu. Cette révélation interviendra à un moment indéterminé à la faveur d’un événement particulier que nous ne sommes pas capables de définir précisément. Au moment où cet événement intervient, la victime revit immédiatement l’ensemble du drame dont elle a été victime.
Ce que nous demandons, c’est que le juge saisi du procès puisse saisir les médecins compétents en la matière – un, deux ou trois, peu importe – pour se faire confirmer l’existence ou non de ce traumatisme, qui, je le répète, peut aujourd’hui être établi sur des critères scientifiques – je n’entre pas dans le détail, mais l’accord sur ce point est assez clair.
À la faveur de cette expertise judiciaire, si l’amnésie post-traumatique est établie, elle constitue ce qu’on appelle « un obstacle insurmontable » qui suspend la prescription. La procédure d’information judiciaire peut alors continuer et les poursuites être engagées. C’est très important pour les victimes d’amnésie post-traumatique. C’est la raison pour laquelle je voterai contre cet amendement du Gouvernement tendant à supprimer un dispositif qui constitue en tout état de cause une avancée.
Je profite des quelques secondes qui me restent pour revenir sur l’amendement n° 127 du Gouvernement qui a été adopté : la prescription, qu’elle soit glissante ou suspendue, constitue dans les faits – qu’on le veuille ou non – un chemin vers l’imprescriptibilité.

Je mets aux voix l’amendement n° 128.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 190 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’article 1er bis.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 191 :
Le Sénat a adopté.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 22 rectifié, présenté par Mmes Rossignol, de la Gontrie, Lepage, Blondin et Cartron, M. Courteau, Mmes M. Filleul, Jasmin, Monier, Meunier, Conway-Mouret et Lubin, MM. Jacques Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si des faits pouvant constituer une infraction relevant des articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-6-1, 222-6-3 à 222-12, 222-14, 222-14-1, 222-14-3 à 222-15, 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal sont signalés après l’extinction du délai de prescription, le procureur de la République peut diligenter une enquête visant à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription n’est pas écoulé. »
La parole est à Mme Martine Filleul.

Le présent amendement vise à traduire la recommandation n° 7 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes en modifiant l’article 41 du code de procédure pénale pour donner la possibilité au procureur d’ouvrir une enquête, même en cas de prescription, en matière d’infraction sexuelle. Comme l’a souligné Mme la rapporteur, Marie Mercier, « c’est déjà la pratique dans nombre de parquets, notamment à Paris ».
En la matière, nous affirmons que la loi peut généraliser les bonnes pratiques, d’autant que l’amendement prévoit une disposition non pas obligatoire, mais bien facultative : le procureur de la République « peut » diligenter une enquête. L’emploi du verbe « pouvoir » et non du verbe « devoir » souligne bien qu’il s’agit d’une possibilité ouverte aux parquets. Il s’agit donc d’inscrire dans le code de procédure pénale une méthode d’investigation déjà existante, mais encore contingente selon les territoires et les politiques pénales menées par chaque procureur.
Cet amendement ne crée pas un « effet a contrario » en sous-entendant « qu’il n’est pas possible de diligenter des enquêtes en cas de prescription », comme cela a pu être affirmé en commission des lois. Il ne prévoit pas qu’une victime de faits prescrits n’a plus le droit de porter plainte en dehors des infractions listées. Simplement, en matière d’infractions sexuelles, comme le recommande le rapport annexé au projet de loi, le fait de mener des investigations pour vérifier que l’agresseur n’a pas fait d’autres victimes est encouragé. Cet amendement participe donc à la lutte contre l’impunité des agresseurs sexuels.

Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 73 rectifié b is est présenté par Mmes Billon et Vullien, MM. Henno, Laugier, Bockel, Janssens, Longeot et Delahaye, Mme de la Provôté, MM. Canevet et Kern, Mme Goy-Chavent, M. Cazabonne, Mme Dindar, MM. Louault, Delcros, Moga et Médevielle, Mmes Tetuanui, Létard, Joissains, Garriaud-Maylam, Vérien, Boulay-Espéronnier, L. Darcos et de Cidrac, M. Brisson, Mme Jasmin, M. Cadic et Mme Bonfanti-Dossat.
L’amendement n° 85 rectifié est présenté par Mme Laborde, M. Arnell, Mme M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty et Guérini, Mme Jouve et MM. Labbé, Léonhardt, Menonville et Requier.
L’amendement n° 103 rectifié bis est présenté par Mmes Cohen et Benbassa, M. Collombat, Mme Assassi, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli et Mme Apourceau-Poly.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas où des faits semblant constitutifs des infractions relevant des articles 221-1 à 222-10, des articles 222-14 à 222-14-1, des articles 222-22 à 222-31-2 et des articles 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal sont signalés après l’extinction du délai de prescription, il peut diligenter une enquête visant à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription n’est pas écoulé. »
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 73 rectifié bis.

Le présent amendement vise à modifier l’article 41 du code de procédure pénale pour donner explicitement la possibilité au procureur d’ouvrir une enquête, même en cas de prescription, en matière d’infractions sexuelles.
Même si elle n’aboutit pas sur le plan pénal, l’ouverture d’une enquête peut avoir un caractère réparateur pour les victimes, quand elle leur permet d’entendre des aveux, voire de recevoir des excuses de la part de leur agresseur, dans un contexte où ce dernier ne peut pas être poursuivi en raison de la prescription de l’action publique. Elle permet aussi, dans certaines circonstances, de vérifier que l’auteur présumé des faits dénoncés n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription ne serait pas écoulé. L’enjeu peut donc être également d’éviter l’impunité d’éventuels prédateurs sexuels.

La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 85 rectifié.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 103 rectifié bis.

Un élément me paraît important à ajouter pour la défense de cet amendement identique : lors des auditions menées par la délégation aux droits des femmes, il a été souligné – le procureur de la République de Paris, François Molins, l’a également dit – que l’écoute de la parole des victimes leur permet aussi de se reconstruire.
Si la parole des femmes s’est libérée, comme le montre l’augmentation des plaintes pour viol et agression sexuelle – 25 % entre septembre et décembre 2017 et 36 % entre janvier et avril 2018 –, le dépôt de plainte relève tout de même d’un véritable parcours du combattant, plus exactement de la combattante.
Cela étant, il faudrait améliorer la formation des professionnels et accorder une attention toute particulière à l’aménagement des locaux des commissariats pour préserver un minimum d’anonymat et d’intimité.
En outre, la répétition étant pédagogique, dit-on, je ne m’en priverai pas : il est important d’allouer des moyens aux associations qui aident les victimes.

Ces amendements visent à inscrire dans la loi la possibilité pour le procureur de diligenter des enquêtes sur des faits d’infractions sexuelles prescrits. Nous comprenons la volonté des auteurs de ces amendements. Néanmoins, comme cela a été souligné, c’est déjà la pratique dans nombre de parquets, notamment à Paris. Le rapport d’information du groupe de travail de la commission des lois propose d’ailleurs que tous les parquets suivent ce même protocole. Cela prouve bien qu’il n’est pas besoin d’une quelconque modification du code de procédure pénale pour l’envisager.
Surtout, cette disposition serait contre-productive, puisqu’elle créerait un effet a contrario : cela sous-entendrait qu’il n’est pas possible de diligenter des enquêtes en cas de prescription. Or, tous les jours, des enquêteurs diligentent des actes d’enquête sur des faits prescrits, justement pour vérifier que d’autres faits, eux, ne le sont pas !
Dans la mesure où, de surcroît, les amendements limitent l’application de cette possibilité aux infractions sexuelles, une telle mesure constituerait vraiment un signal contre-productif.
La commission a donc émis un avis défavorable.
J’entends les propos de Mme la sénatrice Cohen concernant la formation et l’adaptation des locaux pour accueillir les victimes.
Je comprends la motivation de ces amendements. Pour autant, d’un point de vue purement juridique, leur apport ne me paraît pas absolument nécessaire. En effet, la prescription n’empêche ni le dépôt de plainte ni la réalisation d’une enquête : en application de l’article 15-3 du code de procédure pénale, « la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infraction à la loi pénale ».
L’officier de police judiciaire ne peut donc pas refuser de recevoir une plainte pour un motif qui serait tiré de la prescription des faits et devra mener une enquête. La question d’une éventuelle prescription ne sera appréciée que dans un second temps, non par le policier, mais par le procureur de la République, qui pourra ainsi décider, soit de classer la plainte sans suite, soit de la retenir puis de la classer s’il estime que les faits sont prescrits.
De plus, cette solution va évoluer du fait de l’adoption de l’amendement n° 127 du Gouvernement, car celui-ci prévoit que la commission de nouveaux crimes sera une cause d’interruption de la prescription des crimes les plus anciens. Il sera désormais indispensable d’enquêter sur les faits les plus anciens et apparemment prescrits, pour vérifier si leur prescription n’a pas été interrompue.
Ces amendements étant satisfaits par l’amendement n° 127, j’en sollicite le retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
J’ajoute que la direction des affaires criminelles pourra élaborer un guide des bonnes pratiques pour les enquêtes sexuelles, qui ne relève pas, me semble-t-il, du niveau législatif.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

J’ai bien écouté Mme la garde des sceaux et Mme la rapporteur, mais leurs explications me paraissent assez paradoxales.
Madame la garde des sceaux, vous indiquez que l’adoption de l’amendement n° 127 permettra d’interrompre la prescription en cas de nouvelle infraction. Encore faut-il qu’une enquête ait lieu. Vous l’avez fort bien dit, ce n’est qu’au moment de l’engagement des poursuites, voire de l’instruction que l’éventuelle prescription est appréciée, et non au moment de l’enquête policière. Reste qu’il faudra une enquête, sinon votre amendement n° 127 n’aura aucune portée et il ne sera pas possible de rouvrir la procédure pour des victimes anciennes.
Madame la rapporteur, on ne peut pas dire, d’un côté, que c’est un protocole utile, nécessaire aux victimes, à tel point qu’il figure dans le rapport que nous avons adopté à l’issue de vos travaux, et que certains parquets le suivent, et, de l’autre, affirmer que ce n’est pas le cas de la totalité d’entre eux et qu’il ne faut pas le prévoir dans un texte. Je ne vois pas du tout où est la logique.
Nous sommes plusieurs parlementaires à avoir déposé un amendement analogue. Je souhaiterais donc faire une suggestion à Mme la garde des sceaux : vous pourriez indiquer que vous vous apprêtez à prendre une circulaire pour signaler aux parquets qu’il convient de ne pas opposer une éventuelle prescription pour refuser d’ouvrir une enquête préliminaire. Dans ce cas, on pourrait considérer qu’il n’est pas nécessaire de l’inscrire dans la loi.
Madame la sénatrice, je vous remercie de votre suggestion. C’est effectivement ce que j’ai proposé, peut-être d’une manière qui n’était pas suffisamment claire : lorsque je parlais d’un guide des bonnes pratiques, je pensais évidemment à une circulaire qui serait adressée aux procureurs et qui serait publiée. C’est un engagement que je prends devant vous.

Sous le bénéfice de ces explications, madame de la Gontrie, l’amendement n° 22 rectifié est-il maintenu ?

Je remercie Mme la garde des sceaux d’avoir pris l’engagement qu’une circulaire serait publiée. Il faut en effet que les personnes concernées en aient connaissance. Dans ces conditions, je retire notre amendement.

L’amendement n° 22 rectifié est retiré.
Madame Billon, l’amendement n° 73 rectifié bis est-il maintenu ?

Compte tenu de l’engagement de Mme la garde des sceaux, je retire l’amendement.

L’amendement n° 73 rectifié bis est retiré.
Je me tourne vers les auteurs de l’amendement n° 85 rectifié. Que décidez-vous ?

L’amendement n° 85 rectifié est retiré.
Madame Cohen, l’amendement n° 103 rectifié bis est-il maintenu ?

L’amendement n° 103 rectifié bis est retiré.
Chapitre II
Dispositions relatives à la répression des infractions sexuelles sur les mineurs
I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222-22-1 est ainsi modifié :
a)
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 222-22 peuvent être caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire. » ;
2° L’article 222-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « ou sur la personne de l’auteur » ;
b)
« La contrainte est présumée lorsque l’acte de pénétration sexuelle est commis par un majeur sur la personne d’un mineur incapable de discernement ou lorsqu’il existe une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur des faits. » ;
3° et 4°
Supprimés
5° Le paragraphe 3 de la section 3 est ainsi modifié :
a) À la fin de l’intitulé, les mots : « commis sur les mineurs » sont supprimés ;
b) L’article 222-31-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « sur la personne d’un mineur » sont supprimés ;
– au 3°, les mots : « le mineur » sont remplacés par les mots : « la victime ».
I bis. – L’article 227-25 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 227 -25. – Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »
II et II bis. –
Supprimés
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 351 est ainsi rédigé :
« Art. 351. – S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires.
« Lorsque l’accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d’atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans si l’existence de violences ou d’une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats. » ;
2°
« Art. 351 -1. – Le président ne peut poser une ou plusieurs questions prévues aux articles 350 ou 351 que s’il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l’accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense. »

En dépit d’un consensus indéniable sur la nécessité de protéger les enfants de toute forme de violence, notamment sexuelle, le présent article a suscité de nombreux et vifs débats. Poser un interdit clair et précis dans le droit en ce qui concerne les relations sexuelles entre un adulte et un enfant afin de mieux sanctionner les auteurs et de protéger davantage les victimes, telle était l’ambition initiale du texte.
Mes chers collègues – faut-il le rappeler ? –, notre pays a ratifié la convention internationale des droits de l’enfant de 1989, qui précise très clairement que les États doivent « protéger l’enfant contre toute forme de violence, […], y compris la violence sexuelle ». La France a également ratifié en 2010 la convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, appelée « convention de Lanzarote », qui impose la criminalisation de tous les types d’infractions à caractère sexuel perpétrées contre des enfants et qui dispose que les États membres doivent adopter des dispositions législatives spécifiques et prendre des mesures en vue de prévenir la violence sexuelle. Tout cela est intégré aux objectifs du programme de développement durable à l’horizon 2030.
Je rappelle qu’un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles. Dans 80 % des cas, l’auteur de l’infraction est une personne du cercle de confiance de la victime.
Au début de l’année, nous avons tous été heurtés par les décisions qui ont été prises lors des affaires de Pontoise et de Meaux, d’où la volonté d’élaborer cette loi.
Face à l’ampleur de ce phénomène, il relève de notre devoir de législateur de garantir dans la loi la protection pleine et entière des enfants. Toucher à un enfant est interdit, un point c’est tout ! Il me semble que le texte issu de l’Assemblée nationale ne répond pas pleinement à cet objectif premier. À nous de le modifier en vue d’y parvenir.
Mmes Martine Filleul et Michelle Meunier applaudissent.

L’article 2 du projet de loi est celui qui fait le plus débat.
Les récentes affaires judiciaires, évoquées par Maryvonne Blondin, les revendications des associations et représentants des victimes, le choix initial du Gouvernement témoignent de la nécessité d’une protection totale et absolue de nos enfants face aux violences sexuelles. C’est en ce sens, et après de nombreux travaux, que la délégation aux droits des femmes a décidé de proposer la création d’une nouvelle infraction : le crime de pénétration sexuelle sur mineur de moins de treize ans par un adulte.
Cette proposition est-elle inconstitutionnelle ? Les juristes et magistrats que nous avons consultés ont répondu non.
La nouvelle infraction proposée n’est pas irréfragable, puisque, comme pour le délit d’atteinte sexuelle, il n’y aurait pas d’automaticité de la culpabilité. En effet, l’accusé pourra toujours apporter la preuve qu’il ne connaissait pas l’âge de la victime.
En matière d’intentionnalité, maintenant, la démonstration est simple, car, comme l’a rappelé Laurence Rossignol, le simple fait d’introduire son pénis dans l’orifice d’un enfant est clairement une action volontaire et intentionnelle, comme l’a conclu la Chambre des Lords au Royaume-Uni en 2008. De plus, nos voisins anglais et danois ont inscrit des articles similaires dans leur législation depuis maintenant plus de dix ans, sans que jamais une violation des droits fondamentaux ait été soulevée.
Certains nous ont reproché la création d’une zone grise, entre treize et dix-huit ans. Au contraire ! Il s’agit d’une gradation dans la protection des mineurs : aggravation de la peine de viol pour les mineurs de moins de dix-huit ans, inversion de la charge de la preuve pour démontrer « violence, menace, contrainte ou surprise » avant quinze ans et interdiction totale en dessous de treize ans.
Je vous invite, mes chers collègues, à voter la proposition de la délégation aux droits des femmes, car elle permet une protection totale de nos enfants contre les prédateurs sexuels. Agissons aujourd’hui ensemble et laissons à la sagesse du Conseil constitutionnel le soin d’arbitrer entre les attentes de notre société et notre Constitution !
Mmes Martine Filleul et Marie-Pierre Monier applaudissent.

L’article 2, dont nous engageons la discussion, a pour objet de mieux sanctionner les viols commis à l’encontre des mineurs.
En quelques mois, nous sommes passés d’une grande attente, d’une réelle prise de conscience dans l’opinion, à une désillusion.
Les faits graves jugés à Pontoise et à Meaux ont ému. La société attendait de nous que nous puissions mieux protéger ses enfants de onze ans, de treize ans, mais aussi, soyons-en certaines et certains, ses enfants de quinze ans, contre les atrocités de certains adultes. Nos concitoyens attendaient que la loi rappelle fortement et clairement que la société protège ces enfants des prédateurs sexuels. Ils attendaient que ceux-ci ne puissent échapper à l’accusation de crime.
Madame la secrétaire d’État, vos annonces de l’automne ont donc été positivement perçues. Nous allions éliminer l’idée du consentement d’un enfant aux relations sexuelles avec un adulte. Nous allions renforcer la criminalisation de ces actes, ce qui répondait aux préoccupations des victimes et des associations militant dans ce domaine. Trop souvent, en effet, ces associations ont dénoncé les insidieux procédés à l’œuvre dans les méandres des commissariats et des tribunaux. De telles méthodes conduisaient parfois à la correctionnalisation de ces crimes, « pour gagner du temps, pour que la défense coûte moins cher, pour éviter l’aléa du jury… » Bref, pour de bien mauvaises raisons, en somme, les agresseurs arrivaient, eux, à échapper à la peine que les violences qu’ils avaient commises méritaient.
Aujourd’hui, j’ai le sentiment d’un rendez-vous manqué. Au gré de l’avis du Conseil d’État, vous avez contorsionné vos ambitions, pourtant claires : vous avez adapté la notion de consentement, tant et si bien qu’elle est devenue floue et qu’elle est désormais soumise à l’interprétation des juges. Nous sommes, selon moi, assez loin de la grande loi que vous revendiquez.
En matière de droits et de protection de l’enfant, il n’y a rien de plus efficace que la loi qui s’énonce aisément : « Personne n’a le droit de te faire du mal. Aucun adulte ne peut avoir une relation sexuelle avec toi, et, si tu te sens en danger, c’est le rôle de tous les adultes de te protéger. » C’est avec de telles dispositions que nous aurions pu engager un beau programme de sensibilisation, de pédagogie, avec les professionnels de l’enfance.
Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain.

Madame la garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, Michelle Meunier vient de le rappeler : avec le Président de la République, vous nous avez annoncé, il y a quelques mois, une grande avancée juridique.
Madame la garde des sceaux, vous le savez, et on le mesure chaque fois qu’il en est question, il est toujours extrêmement compliqué et difficile de toucher au droit pénal.
Ce dont il faut se féliciter, dans ce débat, c’est que, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, nous visons tous le même but. Mais la question est de savoir comment on y parvient !
À mon sens, une erreur a été commise depuis le début – je n’en fais grief à personne –, celle de se situer dans l’article du code pénal relatif aux agressions sexuelles et au viol. Dès lors, sur l’ensemble des travées, on s’est demandé comment faire pour poser que, à l’égard d’un enfant, la contrainte est présumée.
Le Conseil d’État affirme que l’on ne peut pas adopter de telles dispositions. A-t-il raison, a-t-il tort ? Qu’importe ! Vous avez entrepris de trouver autre chose. Mais, en réalité, là est l’erreur de départ.
La seule réponse consiste à dire : nous en sommes tous convaincus, il existe, dans cette société, un interdit en vertu duquel un adulte ne peut pas avoir de relation sexuelle avec un enfant mineur d’un certain âge. Pour notre part, nous pensons que l’âge de treize ans est le bon. Nous vous proposons donc, avec d’autres, un amendement qui tend à ajouter un article dans le code pénal, pour instituer un nouveau crime : la violation de cette interdiction d’avoir des relations sexuelles avec un enfant. Ainsi, nous pourrons répondre à ce que le Président de la République a annoncé le 25 novembre 2017.
Madame la garde des sceaux, madame la secrétaire d’État, nous vous offrons l’occasion de donner satisfaction au Président de la République.
Monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, il me semble que, au sein de la commission des lois, nous avons fait la même erreur, en « calant » notre rédaction sur celle du viol avec la notion de contrainte.
Pour ce qui concerne les atteintes sexuelles, que les procureurs poursuivent parfois en tant que délits, je vous rappelle qu’elles sont sans violence : ce n’est pas la même chose, mais c’est souvent cette notion qui est utilisée, afin d’éviter à la victime et à ses parents un débat relatif au consentement.

M. Jacques Bigot. Dans les cours d’assises, certains adultes, notamment des jurés, pensent encore qu’un enfant de dix ans peut avoir séduit et provoqué un adulte, qu’il peut avoir donné un consentement. Nous affirmons que ce n’est pas possible : l’adulte est responsable !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Mme Annick Billon applaudit également.

L’article 2 du projet de loi suscite bien des interrogations de la part des professionnels de l’enfance, des familles et des professionnels de santé ; à juste titre d’ailleurs, car le fait qu’un viol puisse être requalifié en délit d’atteinte sexuelle, alors même qu’il y a eu pénétration sexuelle, a soulevé l’indignation de nombre d’entre nous.
Pouvons-nous envisager un seul instant qu’un mineur consente librement à des relations sexuelles avec un majeur, alors même qu’il n’a ni la maturité ni le discernement nécessaires pour accepter de tels actes ? Pouvons-nous faire comme si l’acte sexuel subi par un mineur était sans conséquence pour son équilibre psychique et physique ?
La délégation aux droits des femmes a souhaité fixer à treize ans l’âge en deçà duquel un enfant ne peut consentir à un acte sexuel. Elle a ainsi créé une présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle sur un mineur.
En tant que vice-présidente de la délégation aux droits des femmes, j’ai cosigné, bien entendu, notre rapport conjoint, et je salue tous les travaux menés durant cette année sur ce sujet si grave, sous la houlette de la présidente de la délégation, Mme Annick Billon. Je pense notamment à certaines auditions, qui étaient presque insoutenables.
Cela étant, je me rallierai à la proposition de la commission. Je n’agis pas, comme me l’a dit l’une de mes collègues, par simple discipline de groupe – à mon âge, je pense être capable de prendre mes responsabilités, et j’aurais fait de même si le président et la rapporteur avaient appartenu à un autre groupe politique –, mais parce que la commission des lois a décidé, pour sa part, de protéger tous les mineurs, quel que soit leur âge, en inversant la charge de la preuve en matière de viol sur mineurs, lorsque ceux-ci sont incapables de discernement, ou en cas de différence d’âge significative entre l’auteur et la victime mineure.
Au-delà des débats de juristes, lesquels sont, bien entendu, nécessaires, je souhaite redire avec force qu’un enfant n’est pas un objet sexuel, que nous lui devons une protection absolue et que nous devons sanctionner avec une extrême fermeté ceux qui abusent de sa vulnérabilité, de sa fragilité et de sa crédulité. Ainsi, la France sera à la hauteur des enjeux de civilisation contenus dans la convention internationale des droits de l’enfant, que notre pays a ratifiée il y a presque trente ans jour pour jour et qui s’impose à nous comme une évidence.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Face à ces violences sexuelles insupportables, qui se développent dans nos pays depuis de nombreuses années, il est temps de faire preuve de clarté. On ne peut plus rester dans l’entre-deux sur de tels sujets. Il faut dire clairement qu’aucun enfant ne peut donner son consentement de façon éclairée à un acte sexuel ; il faut dire clairement qu’il est interdit, pour un adulte, de faire subir un acte sexuel, une pénétration à un enfant.

Une fois que l’on a dit cela, ce n’est pas la peine d’essayer de trouver des tortillages juridiques pour nous expliquer que l’on ne peut pas vraiment énoncer d’interdiction, mais qu’il faut tout de même tenir compte de tel ou tel critère. Non !
Si, au XXIe siècle, on n’est pas capable de donner, de manière totale, claire et nette, un contenu législatif à ces deux réalités, ne vous étonnez pas qu’il existe un doute profond sur ce qui fait société, sur ce qui fait sens dans nos Républiques et dans nos démocraties.
Marques d ’ approbation sur des travées du groupe socialiste et républicain.

Il s’agit là, non d’un phénomène gravitant autour d’autres crimes, mais d’un crime spécifique, qui renvoie à un interdit absolu.
Cela étant, est-ce qu’une personne soupçonnée de ce crime perdrait les moyens de se défendre ? On ne lui enlève aucun droit à cet égard ! D’ailleurs, sa seule défense sera d’expliquer, soit que ce n’était pas lui, soit qu’il avait des raisons objectives de croire que ce n’était pas un enfant. Mais, dès lors, il doit apporter des preuves claires et nettes qu’il pouvait réellement se tromper ! Ce n’est pas du tout la même logique.
On sait les désastres psychologiques subis par les garçons et les filles qui ont vécu de tels traumatismes ; on sait que ces traumatismes peuvent se reproduire et se transmettre. Si ces enfants éprouvent la moindre once de culpabilité ; si, faute d’un interdit absolu, on estime qu’ils ont été potentiellement consentants, au motif qu’ils n’ont pas manifesté leur désaccord, les troubles psychologiques seront durables, ils se transmettront de génération en génération, et ces personnes auront un mal fou à retrouver une place normale dans la société.
Si la Constitution française n’est pas capable d’apporter cette garantie, il est urgent de la modifier en ce sens. À mes yeux, c’est plus important que d’y introduire toute une série de mesures, relatives à la proportionnelle ou autres.
Mme Françoise Laborde applaudit.

J’en suis convaincue, le Conseil constitutionnel ne pourra pas dire autre chose que cela.
Nous devons voter ces dispositions. C’est un vote de civilisation, un vote historique. Il ne faut surtout pas commencer à se noyer dans des détails de seconde zone ; et, si ces détails existent, il est temps de les écarter !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – M. Bruno Sido et Mme Dominique Vérien applaudissent également.

Je me permets de prendre la parole pour essayer de tirer quelques conclusions de notre débat sur ce point.
En écoutant les interventions qui se sont succédé, je constate que nous ne sommes d’accord ni sur les données de base ni sur la réalité du droit applicable. Or, si l’on veut légiférer, il faut au moins que l’on sache quelle situation nous voulons changer.
Premièrement, j’entends dire qu’il faut absolument interdire les relations sexuelles entre un adulte et un mineur. Mais cette interdiction figure déjà dans le code pénal.

Tant mieux ! Cela étant, cette disposition prive de leur fondement beaucoup des interventions précédentes.

De quelles sanctions est assortie cette interdiction ? Tout dépend de la nature de l’acte : si c’est un viol, c’est vingt ans d’emprisonnement ; si c’est une agression sexuelle, c’est dix ans ; si c’est une atteinte sexuelle, c’est cinq ans ; et des circonstances aggravantes peuvent augmenter un peu la peine.
Deuxièmement, j’entends dire qu’il ne faut pas que le consentement de la victime puisse servir à épargner la condamnation de l’agresseur.
Mes chers collègues, je vous rassure, notre code pénal ne prévoit pas que l’on prenne en considération le consentement de la victime. Vous ne le saviez peut-être pas : c’est pourtant le code pénal, tel qu’il s’applique dans notre pays, et ce, fort heureusement, non depuis un, deux ou trois ans, mais depuis des décennies !
Au moment de légiférer, il me semble important de savoir que l’on n’est pas en train de construire à partir de zéro, à partir de rien.
De plus, je me permets de vous rappeler que, lors de la dernière année pendant laquelle le décompte a été effectué, c’est-à-dire en 2016, on a dénombré 396 condamnations pour viol, par un adulte, sur mineur.
L’affaire de Pontoise et l’affaire de Melun ont causé beaucoup d’émotion. Moi aussi, j’ai été scandalisé, je dois vous le dire.
Or, à Pontoise, le tribunal correctionnel a pris la décision de ne pas statuer sur un délit, afin que, si les faits étaient constitués, la cour d’assises puisse se prononcer sur un viol. La justice a donc réparé elle-même ce que la presse avait interprété comme un dysfonctionnement. Pour ma part, je ne connais pas cette affaire. J’ai été ému, mais j’ai pris un tant soit peu de recul, et je me suis dit que, pour se prononcer, il fallait bien connaître tout le dossier judiciaire, ce qui n’était pas mon cas. En tout état de cause, j’observe que le tribunal a pris des mesures.
Quant à Melun, sitôt que la cour d’assises a rendu cette décision qui nous a laissés stupéfaits, le procureur a fait appel.

À présent, que doit-on faire ? Sur la base de ce que je viens de vous dire – je défie quiconque de démentir ces explications –, on se rend compte qu’il ne s’agit pas de refonder notre droit pénal, pour ce qui concerne les viols commis sur des mineurs par des adultes : il s’agit simplement de l’améliorer. Les fondations sont solides, elles sont justes. La justice fonctionne dans l’écrasante majorité des cas ; et, quand elle dysfonctionne, elle sait se corriger elle-même.
Gardons à l’esprit que nous ne sommes pas là pour nous faire plaisir. La présomption irréfragable nous permet peut-être de brandir l’expression d’une volonté politique forte d’empêcher la commission de tels actes, parce qu’ils sont abominables et odieux – pas un seul d’entre nous n’ira dire le contraire.

Toutefois, il faut rappeler qu’une Constitution, ce n’est pas n’importe quoi.
Je n’ai pas inventé l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et je ne m’en prévaux pas. Mais, tout de même, le Conseil constitutionnel en a tiré des conclusions à plusieurs reprises, et encore récemment, dans sa décision du 16 septembre 2011. Cette dernière est on ne peut plus claire : elle rappelle que, « en vertu de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, » – texte que nous chérissons tous ici – « tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable ; »…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. …. qu’il en résulte qu’en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, […], dès lors qu’elles ne revêtent pas de caractère irréfragable », c’est-à-dire dès lors que l’accusé n’est pas condamné avant même le procès…
Exclamations sur des travées du groupe socialiste et républicain.

À mon sens, tous les artifices de rédaction que l’on pourra inventer ne dissimuleront pas cette réalité : quand il suffit que soient réunies des conditions d’âge et de fait pour que l’on puisse condamner un accusé sans prendre en considération la réalité de l’événement qui s’est produit, on viole tout simplement des droits fondamentaux. Or nous avons à défendre, non seulement les victimes, mais aussi les droits de la défense, parce que ces droits sont au cœur même de l’organisation de notre société et des principes fondamentaux que nous avons tous en partage !
Mes chers collègues, c’est la raison pour laquelle votre commission, qui est inspirée des mêmes sentiments que vous, qui veut aller dans la même direction, se heurtant à l’impossibilité de créer une présomption irréfragable, a décidé de créer une présomption simple.
Au fond, nous ne sommes pas si éloignés les uns des autres : en vertu de la présomption simple, l’accusé est sommé de prouver son innocence, et la victime n’a pas à prouver sa culpabilité. C’est déjà beaucoup ! Mme la garde des sceaux elle-même doute que nous puissions le faire ; mais, au moins, nous allons aussi loin qu’il nous a paru possible d’aller, et nous sommes efficaces.
En effet, au-delà de toutes les questions de grands principes, que je rappelle, car je suis sûr que vous les approuvez, comme moi, et que, pour vous non plus, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’est pas secondaire, nous avons le devoir de protéger tous les enfants.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Or la solution proposée par la commission des lois, c’est la solution la plus protectrice !
Protestations sur des travées du groupe socialiste et républicain.

Je remercie d’ailleurs Mme Darcos de l’avoir reconnu : si vous instaurez un seuil d’âge, par exemple à treize ans, que ferez-vous de l’enfant de treize ans et un jour ?
Nouvelles protestations sur les mêmes travées.

Comment justifierez-vous, auprès de ses parents, qu’il n’a pas la même protection que l’enfant de douze ans et onze mois ?
Que ferez-vous quand un mineur, entretenant une relation amoureuse avec une très jeune fille, atteindra l’âge de dix-huit ans ? Pendant un an, il aura été traité comme un jeune soupirant, et, à partir de son dix-huitième anniversaire, il deviendra un criminel !

(Marques d ’ indignation sur des travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.) On ne peut pas construire le droit pénal sur de bonnes intentions : on doit le construire sur une conscience claire des réalités du droit applicable, des réalités du fonctionnement de la justice et de la protection des droits de l’homme et du citoyen !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Élisabeth Doineau applaudit également.

Nous sommes au cœur du débat et, à mon sens, malgré toute l’emphase du ton qu’il a employé, M. le président de la commission n’a pas entendu les arguments qui ont été développés.
Toutes et tous, nous sommes en train de parler de la protection des enfants. Nous parlons de mineurs. Or que constatons-nous dans le droit, tel qu’il existe aujourd’hui ? Malgré un certain arsenal juridique, des affaires éclatent. Des mineurs subissent des viols, et leurs agresseurs ne sont pas condamnés à la hauteur du crime qu’ils ont commis.

Mme Laurence Cohen. Mes chers collègues, on nous invite à chercher un dispositif qui ne subira pas le couperet du Conseil d’État ou du Conseil constitutionnel. Pour ma part, je vous pose la question suivante : la société va-t-elle, aujourd’hui, affirmer clairement qu’un adulte ne peut pas avoir un rapport sexuel avec un enfant ? Voilà l’interdit qui doit être posé !
Très bien ! sur des travées du groupe socialiste et républicain.

Actuellement, en vertu de la jurisprudence, la protection existe seulement en dessous de sept ans !

Pour ma part, je considère qu’un enfant ne saurait consentir d’une manière ou d’une autre.
Pour sortir de ce piège, la solution, que nous sommes plusieurs à proposer, c’est de ne pas s’en tenir à la notion de viol telle que définie pour des adultes : il ne faut pas se référer à ces quatre caractéristiques que sont la violence, la contrainte, la menace, la surprise. Sinon, en creux, cela signifierait qu’un enfant pourrait consentir.

S’il n’y a ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise, on induit, en somme, qu’un enfant peut consentir à un rapport sexuel. Eh bien, à mon sens, ce n’est pas possible ! Il faut s’imaginer quelle est la maturité psychologique, quelle est la maturité sexuelle d’un enfant. Nous parlons des enfants !
J’avais déposé une proposition de loi fixant un seuil à quinze ans. Mais, depuis, j’ai évolué : il me semble que, dans cet hémicycle, nous pouvons atteindre un consensus autour d’un seuil de treize ans, …

Mme Laurence Cohen. … en créant une infraction sortant de la notion de viol. En deçà de cet âge, il faut vraiment parler d’interdit absolu !
Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain. – Mmes Esther Benbassa et Michèle Vullien applaudissent également.

Monsieur le président de la commission des lois, il n’y a pas ici, d’un côté, ceux qui connaissent le droit et qui donnent des cours et, de l’autre, ceux qui l’ignorent et qui seraient là pour apprendre.

Mme Laurence Rossignol. Il n’y a pas non plus ceux qui s’attachent à défendre la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et ceux qui s’essuieraient les pieds dessus. Nous sommes tous attachés aux droits de la défense et à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Cela étant dit, je n’arrive pas à comprendre pourquoi vous vous opposez avec tant d’insistance à la création d’un crime de violence sexuelle sur enfant.

Il me semble qu’il y a un malentendu entre nous : nous n’en sommes plus à essayer d’étendre la définition du viol pour créer des présomptions, a fortiori irréfragables. Nous avons abandonné cette voie, dans laquelle nous avons été nombreux à nous fourvoyer au départ, pour revenir à une autre approche juridique, qui consiste simplement à qualifier de crime une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de treize ans.
À cet égard, il n’y a pas de présomption. Devant une cour d’assises, après que le parquet aura engagé des poursuites – il bénéficiera toujours de l’opportunité des poursuites –, l’auteur pourra faire valoir tous les moyens de défense qui sont à sa disposition.
Je le dis très clairement : cette histoire de présomption est, au mieux, une erreur, au pire une manipulation !
En cet instant, de quoi parlons-nous ? Pensons-nous que, pour poser un interdit clair quant aux relations sexuelles entre un majeur et un mineur de moins de treize ans, il faut recourir à la qualification de crime ? Ou bien pensons-nous qu’il faut s’en tenir, comme c’est le cas dans le code pénal actuel, au seul domaine délictuel ?

Bien entendu, il y a également la qualification de viol ; mais il s’agit précisément de cas dans lesquels les caractéristiques du viol ne sont pas réunies.

Ce que vous proposez, c’est une interprétation de la contrainte morale, qui figure d’ailleurs déjà dans le code pénal : il s’agit justement de l’article suivant celui qui est relatif au viol.
Arrêtons de nous faire peur avec ce qui n’existe pas. La seule question est la suivante : avons-nous, oui ou non, besoin de la qualification de crime pour poser un interdit clair pour toute la société ? Si la réponse est oui, c’est ce que nous proposons ; si la réponse est non, c’est ce que vous proposez.
Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – Mme Annick Billon, M. Jean-François Longeot et Mme Michèle Vullien applaudissent également.

Nous le savons tous, ce sujet est celui qui a le plus ému et qui a suscité le plus grand nombre de débats.
Bien sûr, il ne faut faire à personne le procès, a priori, de ne pas viser le même but que les autres. Mais il y a ici des indices d’une appréhension différente de ce qu’il convient d’interdire ou non.
M. le président de la commission nous a donné un cours…

… relatif au code pénal. J’ai moi-même eu l’occasion de faire une première année de droit pénal, ce qui m’a replongée dans d’autres activités…
Cela étant, monsieur le président de la commission, un amendement, qui viendra juste après en discussion, permet d’éclairer votre état d’esprit.

La commission des lois a introduit, parmi les critères qui doivent être constatés, le fait de « disposer de la maturité sexuelle suffisante ». On va donc débattre, dans quelques instants dans cet hémicycle, avant d’en débattre un jour devant des juridictions, du fait de savoir si un enfant a disposé ou non de la « maturité sexuelle suffisante ». Je serais curieuse d’entendre, non vos explications – je n’ai pas à vous les demander –, mais votre interprétation de ces termes, car je crains de comprendre.
Effectivement, il y a peut-être des petites filles qui ne sont pas totalement claires ; qui n’ont pas pensé à mettre une petite culotte, alors qu’il y a un homme dans la pièce… §Chers collègues, c’est du vécu ! Il s’agit là d’affaires que nous avons vu plaider devant des cours d’assises. Il faut savoir ce que c’est qu’un père exposant, devant une cour d’assises, telle ou telle intention qu’il a supposée à sa petite fille… Assumez cette réalité-là !
J’en reviens au présent article. Nous avons effectivement à décider, ce soir, si, pour toujours, nous considérons ou non qu’il est impossible, pour un adulte, d’avoir une relation sexuelle avec pénétration, chaque élément devant être démontré, avec un enfant mineur de treize ans. Ceux qui voteront contre ces dispositions estimeront somme toute que, comme on le dit dans mon ancien métier, les circonstances de l’espèce permettent parfois d’excuser de tels actes…
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Pierre Louault et Mme Michèle Vullien applaudissent également.

Que dire ? Il est tout bonnement impossible de se taire.
Marie-Noëlle Lienemann vient de s’exprimer avec énormément d’émotion.

Chère collègue, si je peux simplement utiliser les mots que je veux, cela me facilitera la tâche.
Chère Marie-Noëlle Lienemann, je comprends parfaitement le registre que vous avez employé. Mais il est dommage que vous n’ayez pu être présente lors de la discussion générale.

Je serais fort heureuse de pouvoir terminer mon propos !
Lors de la discussion générale, j’ai tenu, comme beaucoup d’entre nous, un propos qui était lourd, pour les hommes et les femmes que nous sommes : derrière les mots que nous employons, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des familles, et chacun d’entre nous a croisé des personnes dont la vie a été brisée.
Marie Mercier a parlé, non seulement avec son cœur, mais aussi forte de son expérience de médecin. Or nous en sommes tous convaincus : dans cet hémicycle, personne n’oserait dire que notre société peut tolérer des actes insensés, innommables, inacceptables envers un enfant.
Je ne suis pas juriste ; je n’emploierai donc pas d’arguties juridiques pour dire que je ne suis pas d’accord avec le seuil de treize ans qui nous est proposé. En effet, je considère que, dans notre société, aucun crime d’ordre sexuel, aucune atteinte sexuelle ne peuvent être commis envers un enfant, quel que soit son âge. Pour moi, un enfant, ce n’est pas seulement celui qui va avoir treize ans demain : un enfant peut avoir quatorze ou quinze ans.

Je dois assumer la responsabilité qui est la mienne, et qui est semblable à la vôtre, et je ne donne de leçons de morale à personne ; mais jamais je n’oserai sortir d’ici en ayant fixé un seuil de treize ans que la société estimerait infranchissable, pour aller affronter des parents dont l’enfant, âgé de treize ans et demi ou de quatorze ans, aura eu à subir les violences dont nous parlons.

Jamais je ne le ferai, car, comme vous, je considère qu’un enfant est sacré.
Comme vous, j’ai beaucoup réfléchi, beaucoup écouté ; et j’ai rejoint la proposition de Marie Mercier. Un enfant, c’est tellement sacré que, lorsque de telles atteintes sont commises sur un mineur, qu’il ait treize, quinze, seize, ou dix-sept ans, c’est à l’accusé de supporter la charge de la preuve !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mmes Josiane Costes et Élisabeth Doineau applaudissent également.

Il est important de réintroduire de la sérénité dans ce débat, d’autant que, quelles que soient nos positions, nous sommes tous d’accord pour protéger nos enfants, pour protéger nos mineurs.
Nous avons déjà débattu de ce sujet au sein de la délégation aux droits des femmes. Nous avons eu du mal à savoir quel seuil il fallait déterminer, et même s’il fallait en fixer un ou bien, tout simplement, conserver la minorité telle qu’elle est définie aujourd’hui.
Toutes, à un moment donné, nous avons posé cette question : qu’est-ce qui aurait changé, dans le cas de Pontoise, si un seuil d’âge avait existé ? Je crois l’avoir moi-même posée à Mme Schiappa lors de son audition.
Puisque nombre de nos collègues s’appuient sur cet exemple, je poserai cet après-midi cette question : qu’est-ce qui aurait changé pour la victime si elle avait eu quatorze ou quinze ans ? Le drame aurait été exactement le même, si ce n’est que la médiatisation aurait peut-être été – je parle au conditionnel – un peu moins forte. Le drame subi par la victime, lui, aurait été le même si elle avait eu un an, deux ans ou trois ans de plus ! Il s’agissait de toute façon d’un cas grave, impliquant une mineure.
N’étant pas juriste, j’ignore si l’irréfragabilité s’applique ou non ; je ne veux pas entrer dans ce débat, car je manquerais d’arguments.
En revanche, très sincèrement, je crois qu’il faut se demander si le drame est moindre pour un enfant de quatorze ans. Pour moi, non : nous devons défendre avec la même force nos mineurs de quatorze ans, de treize ans, de six ans et de dix-sept ou dix-huit ans ! Tant qu’ils ne sont pas majeurs, ils ne sont pas majeurs, et, par définition, le discernement appartient à la personne majeure, à la personne adulte. La commission des lois a très bien intégré cela, et je soutiens pleinement sa position : il ne faut pas fixer de seuil d’âge !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Josiane Costes applaudit également.

Je parlerai non de droit, mais de sociologie.
Un sociologue allemand, Norbert Elias, a écrit un très beau livre sur le processus de civilisation, La Civilisation des mœurs. Il y explique ce phénomène tout simple : nous sommes pris dans un processus sous l’effet duquel, avec le temps, des choses permises par le passé ne le sont plus, parce qu’un processus collectif de domestication porte la société vers un adoucissement.
C’est exactement de cela que nous parlons : un moment arrive où des choses que l’on avait pu considérer comme normales ne le sont plus ou on ne peut plus considérer qu’elles le seraient. En l’espèce, il ne s’agit pas seulement d’un changement de degré, mais un peu de nature. D’où notre proposition : il s’agit de faire en sorte que des choses qu’on pouvait se représenter par le passé ne soient plus acceptables pour le futur.
En ce sens, cette forme de sacralisation que nous proposons par le passage au crime pour les moins de treize ans va dans le sens de l’histoire, qui fait que, de plus en plus, nos enfants nous sont sacrés. Tel est le pas que nous vous demandons de franchir ce soir, ni plus, ni moins : aller vers autre chose, d’une autre façon, pour reconnaître le pas que nous avons franchi en matière de civilisation dans la défense de nos enfants. Ce soir, c’est notre responsabilité collective !
Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain. – Mme Michèle Vullien applaudit également.

Je pense qu’il faut dissiper un malentendu – il m’a semblé en percevoir un dans le propos de Mme Gatel.
Il n’est pas question pour le groupe socialiste et républicain d’affaiblir les dispositions actuelles du code pénal, s’agissant notamment des atteintes sexuelles sur les moins de quinze ans. Dans notre proposition, ces dispositions sont conservées.
Marques d ’ approbation sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Nous voulons renforcer notre arsenal pénal pour lutter contre toute forme de prédation sur les enfants de cet âge particulier.
Je ne comprends pas l’objection fondée sur la notion de présomption irréfragable ; monsieur le président Bas, nous l’avons abandonnée ! Nous avons imaginé, avec des juristes et des instances compétentes, un nouveau dispositif, qui renforce la protection des enfants de notre pays. Nous vous demandons d’intégrer cette argumentation.
Mes chers collègues, ayons conscience d’être regardés : en venant au Sénat, comme j’écoutais une grande chaîne de radio, j’ai entendu qu’on parlait de nos débats. Allons donc juste au bout de cette volonté – partagée, je n’en doute pas – de protéger nos enfants, en lui permettant de s’appuyer sur un dispositif pénal rénové !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Mmes Laurence Cohen, Françoise Laborde et Michèle Vullien applaudissent également.

Mme Annie Guillemot. Notre collègue de Cidrac a demandé ce que notre système aurait changé pour la petite fille de Pontoise. Eh bien, comme vient de l’expliquer le président de notre groupe, l’agresseur aurait été immédiatement condamné, parce qu’avoir une relation sexuelle avec une mineure de moins de treize ans aurait été un crime !
Marques d ’ approbation sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Ma chère collègue, je suis d’accord avec vous : que l’on ait vingt ans, quarante ans, cinquante ans ou moins, un viol est un viol. Mais, aujourd’hui, l’agresseur de la petite fille de Pontoise n’a pas pu être condamné, les faits n’ayant pas été qualifiés de viol. En effet, selon la législation actuelle, comme Laurence Rossignol l’a expliqué, au moins un critère sur les quatre prévus doit être satisfait. Avec le dispositif que nous proposons, l’agresseur serait aujourd’hui condamné, parce que pénétrer une petite fille de moins de treize ans serait un crime !
À partir de treize ans, le texte, tel qu’il est rédigé par Mme la rapporteur, nous convient très bien.
Mes chers collègues, je constate moi aussi, à l’aide de ma tablette, que tous les médias sont en train de parler de nous et de ce que nous faisons ici.
Nous ne vous demandons pas de dire qu’un même geste est moins grave si le mineur a seize ou dix-huit ans. Là n’est pas le problème. Il s’agit de décider que, en dessous de treize ans, on ne cherchera pas si l’enfant était consentant, on ne cherchera pas à qualifier un viol : un majeur qui fait cela à un enfant de moins de treize ans sera un criminel, et il sera condamné comme tel !
M. Jean-François Longeot applaudit.

Voilà ce que je puis répondre à Mme de Cidrac, avec laquelle je suis au demeurant d’accord.
Je siège aujourd’hui comme secrétaire du Sénat et, n’appartenant pas à la commission des lois, je découvre les oppositions. Je vous avoue que je ne les comprends pas : nous allons dans le même sens !

Madame Gatel, le tribunal de Pontoise a considéré qu’aucun des quatre critères n’était satisfait.
Nous savons que des enfants, garçons ou filles, ont des relations sexuelles à partir de quatorze ans sans qu’il y ait viol. Au-dessus de treize ans, nous laissons donc les tribunaux juger selon la loi actuelle, comme le propose Mme Mercier ; il n’y a aucune difficulté à cet égard. En revanche, madame Gatel, en dessous de treize ans, nous considérons qu’un ou une enfant n’est pas mature et ne peut pas dire oui ou non !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Mmes Esther Benbassa et Michèle Vullien applaudissent également.

Loin de moi l’intention de donner des leçons, mais je crains que, dans ces débats, nous n’oubliions un certain nombre de choses, et même l’essentiel.
L’essentiel, c’est l’enfant et sa famille. Comment voulez-vous vous reconstruire, reconstruire le milieu familial, lorsque vous savez qu’un viol serait considéré comme un délit, non comme un crime ?
Il me paraît vraiment impératif de séparer le débat juridique – sur ce plan, M. le président de la commission des lois est dans son rôle – du débat moral. À combien de scandales devra-t-on malheureusement encore assister avant que nous ne nous décidions à créer une nouvelle infraction réprimant le crime de violences sexuelles ?
Parce que je suis tout de même un peu Bisontin et que Victor Hugo est né à Besançon, je terminerai en lui empruntant ces mots : « Lorsque je vois un enfant, j’éprouve de la tendresse pour ce qu’il est et du respect pour ce qu’il va et ce qu’il peut devenir. »
Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe socialiste et républicain. – M. le président de la commission des lois applaudit également.

Je voudrais juste vous rappeler ces deux principes : le consentement doit être absolu et le discernement ne peut pas avoir d’âge.
Évidemment, un petit enfant n’est pas discerné. Mais, je vous le dis en tant que médecin, les enfants ont une sexualité, une sexualité qui est à eux et dont l’adulte ne doit jamais se mêler. Dolto n’a jamais dit cela.
Pourquoi voulez-vous qu’une petite jeune fille de seize ans sache ce qu’elle fait et qu’une autre de quatorze ans et demi ne le sache pas ? Ce n’est pas cela, la réalité. La réalité, c’est une sorte de clair-obscur ; on ne peut pas l’enfermer dans des règles ni des cases.
Mes chers collègues, vous pensez que, en fixant un seuil à treize ans, vous sanctuariserez l’enfance. Je crois vraiment que vous vous trompez. En réalité, vous affaiblirez de facto la protection des jeunes de treize à quinze ans
Marques de dénégation sur les travées du groupe socialiste et républicain.

J’entends la rumeur qui court sur certaines travées, mais j’essaierai malgré tout de poursuivre mon raisonnement.
Les juges sont là pour juger, pour apprécier les cas. Dans l’affaire de Pontoise – au demeurant, elle n’a pas été jugée –, avec le système de présomption de contrainte que nous proposons, en cas de non-discernement, en cas de grande différence d’âge, le parquet aurait décidé qu’il y avait viol et n’aurait donc pas correctionnalisé.
Que faire pour des parents d’enfants de treize ans et un jour ? Bien sûr, c’est simpliste, en tout cas simple, de fixer un seuil à treize, douze ou onze ans. Mais l’écueil du seuil est énorme !
Par comparaison, je l’admets, la souplesse que nous proposons est inconfortable. Elle n’est pas facile à admettre, tant il est plus simple qu’on écrive dans les journaux : les sénateurs se sont prononcés sur treize ans ! Allons-nous vraiment faire cela, pour nous faire retoquer ensuite ?
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Oui, nous nous ferions retoquer, sans quoi le Gouvernement aurait poursuivi dans la voie qu’il proposait ! Pourquoi n’a-t-il pas poursuivi ? Parce qu’il a réalisé, sous le contrôle du Conseil d’État, qu’on ne pouvait pas fixer une telle règle.
Il faut pourtant protéger les enfants, tous les enfants vulnérables : les petites jeunes filles de seize et dix-sept ans, et aussi les jeunes hommes, que l’on oublie souvent. Pour cela, il faut se garder des solutions simplistes.
Mes chers collègues, notre but ultime est de protéger tous les enfants, tous les mineurs, parce que nous ne voulons pas qu’ils commencent leur vie avec une cicatrice qu’ils porteraient toute leur existence. C’est pourquoi nous avions proposé la présomption de contrainte, un dispositif subtil assurant le respect de tous les enfants, de tous les mineurs !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mmes Josiane Costes et Françoise Gatel applaudissent également.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour un rappel au règlement.

Madame la présidente, je souhaite faire un rappel au règlement, ayant été mise en cause et devant présider nos travaux après la suspension de la séance, ce qui m’empêchera de répondre.
Madame Gatel, pour certaines raisons, je n’étais pas dans l’hémicycle lors de votre intervention dans la discussion générale, mais sachez que je vous ai écoutée. J’ai entendu tous vos arguments, dont celui qui concerne la séparation des âges. J’étais en train de bouillir devant ma télévision – vous me connaissez –, parce que je ne comprenais pas.
Je ne comprends pas, parce que nous ne réduisons en rien la protection que vous avez prévue à partir de treize ans. Tous seront protégés par la loi telle qu’elle existe ou telle que vous l’aurez modifiée. En revanche, pour les enfants de moins de treize ans, nous renforçons le mécanisme. Non, ma chère collègue, mon argumentation n’était pas fondée sur l’émotion !

Acte vous est donné de ce rappel au règlement, ma chère collègue.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt heures quinze, est reprise à vingt-et-une heures quarante-cinq, sous la présidence de Mme Marie-Noëlle Lienemann.