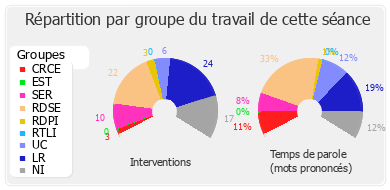Séance en hémicycle du 29 avril 2014 à 14h30
Sommaire
- Désignation d'un vice-président du sénat
- Modification de l'ordre du jour (voir le dossier)
- Rappel au règlement (voir le dossier)
- Révision des condamnations pénales (voir le dossier)
- Taxe communale sur la consommation finale d'électricité (voir le dossier)
- Statut des stagiaires (voir le dossier)
La séance
La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Jean-Claude Carle.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle la désignation d’un vice-président du Sénat, en remplacement de M. Didier Guillaume.
Je rappelle au Sénat que le groupe socialiste et apparentés a présenté la candidature de Mme Christiane Demontès.
Le délai prévu par l’article 3 du règlement est expiré et la présidence n’a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame Mme Christiane Demontès vice-présidente du Sénat.
Applaudissements.

La liste des vice-présidents du Sénat s’établit donc ainsi : Mme Bariza Khiari, M. Jean-Pierre Raffarin, Mme Christiane Demontès, MM. Thierry Foucaud, Jean-Léonce Dupont, Jean-Patrick Courtois, Charles Guené et Jean-Claude Carle.

Par lettre en date de ce jour, M. Jean Claude Gaudin, président du groupe UMP, a demandé le retrait de l’ordre du jour de l’espace réservé à son groupe du mercredi 30 avril de la suite de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer les sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage.
Acte est donné de cette demande.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, mon rappel au règlement se fonde sur l’article 39 de notre règlement.
Dans sa déclaration de politique générale, dont il a été donné lecture dans notre hémicycle, le Premier ministre a affirmé qu’il souhaitait ardemment travailler avec la Haute Assemblée ; il s’est déclaré éminemment respectueux des traditions et du mode du travail du Sénat, ainsi que des avis de celui-ci.
Aussi, monsieur le président, je ne vous cache pas notre étonnement devant l’organisation prévue pour nos travaux de ce soir. En effet, alors que l’Assemblée nationale se prononcera cette après-midi par un vote sur le programme de stabilité présenté par le Premier ministre, celui-ci n’a pas voulu qu’un vote ait lieu au Sénat.

Monsieur Guillaume, je vous rappelle que ce programme de stabilité, prévu par une loi de 2010, a fait l’objet d’un vote, en 2011, sous le gouvernement de François Fillon. Il est vrai qu’aucun vote n’est intervenu au printemps de 2012, mais c’est que le Parlement ne siégeait pas pendant la campagne présidentielle.
En 2013, déjà, Jean-Marc Ayrault n’a pas voulu soumettre son programme de stabilité au vote du Sénat. À entendre les propos de M. le Premier ministre, plutôt positifs à l’égard de notre assemblée, on avait cru que le fait ne se reproduirait pas. Or voici qu’aucun vote n’est prévu ce soir !
Dans ces conditions, monsieur le président, les sénateurs de mon groupe souhaitent que M. le président du Sénat prenne l’initiative de réunir la conférence des présidents dans l’après-midi, afin qu’elle demande au Premier ministre de revenir sur sa décision et de soumettre son programme de stabilité au vote du Sénat.

Nous comprenons bien pourquoi le Premier ministre ne souhaite pas s’exposer à un vote du Sénat. Seulement, il ne s'agit pas d’une déclaration de politique générale : le programme qu’il va nous présenter annonce plusieurs projets de loi qui seront soumis à notre vote au cours du printemps, en particulier le projet de loi de finances rectificative.

Pourquoi ne pas faire voter le Sénat ce soir, puisque, en tout état de cause, il votera sur les différents textes qui mettront en application le programme de stabilité ? Cette méthode n’a pas beaucoup de sens politique !
Que le Premier ministre prenne l’initiative de se présenter devant le Sénat, c’est très bien ; mais qu’on ne réunisse pas la Haute Assemblée seulement pour la forme. Si le Sénat ne se prononce pas par un vote alors que l’Assemblée nationale le fait, nous aurons le sentiment qu’il n’est pas aussi respecté que le Premier ministre en a pris l’engagement dans sa déclaration de politique générale.
M. Jean-Claude Lenoir acquiesce.
Mme Cécile Cukierman s’esclaffe.

, nous faisons confiance au Premier ministre, qui a annoncé vouloir restaurer le lien entre le Gouvernement et le Sénat. C’est pourquoi nous sommes certains que le Premier ministre entendra notre appel !
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.
La parole est à M. Didier Guillaume.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, que n’aurions-nous pas entendu si le Premier ministre ne venait pas ce soir devant le Sénat, comme vous l’avez souhaité, chers collègues de l’opposition, pour présenter le programme de stabilité ! Vous auriez dit : il n’y en a que pour l’Assemblée nationale, le Sénat est bafoué.

Pour ma part, je suis très heureux que le Premier ministre et le Gouvernement, après s’être présentés devant l’Assemblée nationale, se présentent devant le Sénat, et qu’ils le fassent dans la foulée.
Ce qui compte, mes chers collègues, c’est le discours du Premier ministre et le débat qui, ensuite, s’ouvrira entre nous.
Marques d’ironie sur les travées de l'UMP.

Au cours de ce débat, tous les groupes auront le loisir d’exposer leur position.

Nous savons très bien que, dans la procédure prévue à l’article 50-1 de la Constitution, le Sénat n’est pas forcément appelé à voter. On peut le regretter, ou non, toujours est-il que c’est ainsi.

M. Didier Guillaume. Il n’en reste pas moins que nous aurons, ce soir, un débat intéressant. Quant au groupe UMP, qui est partisan de réaliser des économies, je ne doute pas qu’il sera fier de soutenir le Premier ministre et le Gouvernement ; ce sera la politique des petits pas !
Sourires.

En effet, réduire la dépense publique, c’est aussi ce qu’ils proposent !

L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe RDSE, la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive (proposition n° 412, texte de la commission n° 468, rapport n° 467).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la garde des sceaux.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le débat qui s’ouvre porte sur une proposition de loi présentée par les députés radicaux de gauche ; elle a été inscrite à l’ordre du jour de la Haute Assemblée sur la demande des sénateurs du RDSE, qui sont majoritairement, mais pas exclusivement, des radicaux de gauche. (Sourires.)
Cette proposition de loi, qui vise à améliorer les procédures de révision des condamnations pénales, a été enrichie et renforcée par l’Assemblée nationale, qui l’a adoptée à l’unanimité. Sans doute les députés de tous les groupes ont-ils été inspirés par ce propos très fort de La Bruyère : « Un coupable puni est un exemple pour la canaille ; un innocent condamné est l’affaire de tous les honnêtes gens ».

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Vive La Bruyère !
Sourires.
La présente proposition de loi s’inscrit dans l’histoire des procédures de révision en France.
Cette histoire, longue, a connu une dynamique constante, marquée par des épisodes retentissants, dont nous avons tous à l’esprit les plus fameux : je pense, notamment, au combat victorieux de Voltaire pour la réhabilitation de Jean Calas et au magnifique « J’accuse… ! » d’Émile Zola, qui a ouvert la voie à la réhabilitation du capitaine Dreyfus.
La procédure de révision, qui permet de corriger les erreurs judiciaires, est une obsession des philosophes, mais aussi de tous les honnêtes gens, c’est-à-dire des citoyens ordinaires. Abstraction faite de quelques parenthèses, elle a connu un mouvement continu d’amélioration de ses procédures.
Cette procédure existe depuis l’Ancien Régime, puisque, en vertu de l’ordonnance criminelle de 1670, une personne injustement condamnée pouvait solliciter du Conseil du roi une lettre de révision. Elle a été supprimée, très brièvement, sous la Révolution. C’est un fait étonnant, mais qui s’explique : les hommes de la Révolution croyaient fortement à l’infaillibilité du jury populaire, un principe qui peut nous paraître étrange aujourd’hui.
Moins d’un an après avoir été abolie, elle a été rétablie par la Convention. Inscrite dans notre code de l’instruction criminelle depuis 1808, elle a fait l’objet de plusieurs réformes, qui toutes ont visé à l’élargir ou à l’approfondir. Je pense en particulier à la loi du 29 juin 1867, qui a étendu la révision aux affaires correctionnelles, et à la loi du 8 juin 1895, qui a affirmé la nécessité de prendre en considération un fait nouveau ou une pièce inconnue à l’époque du procès.
La dernière loi qui a réformé la procédure de révision est la loi du 23 juin 1989, issue d’une proposition présentée par Michel Sapin. Alors que, jusqu’à cette date, le garde des sceaux faisait fonction de commission de recevabilité en examinant les requêtes, la loi de 1989 a judiciarisé la totalité de la procédure. En outre, elle a prévu que le fait nouveau ou la pièce nouvelle pouvait ne pas établir l’innocence du condamné, mais seulement faire naître un doute sur sa culpabilité.
La proposition de loi que vous allez examiner s’inscrit dans la logique d’amélioration de la procédure de révision. C’est néanmoins un texte difficile, qui soulève des questions délicates pour la simple raison qu’il vise à concilier deux impératifs contradictoires : d’une part, la quête permanente de la vérité judiciaire et la lutte contre l’erreur ; d’autre part, un principe tout aussi important et intangible, à savoir l’autorité de la chose jugée.
Il est important, bien entendu, de s’assurer qu’aucun innocent n’est condamné. C’est pourquoi des moyens doivent être disponibles pour éviter les erreurs judiciaires et, le cas échéant, pour corriger la condamnation d’une personne qui ne serait pas coupable.
Toutefois, il est important également, dans l’intérêt du corps social, de la victime et de l’accusé lui-même, de créer des conditions mettant un terme au procès. C’est toute la différence entre les anciens systèmes archaïques de vengeance privée, avec leur spirale sans fin, et le procès pénal : ce dernier, une fois toutes les voies de recours utilisées, pose définitivement une décision. Il a donc aussi une fonction d’apaisement dans la société, car il vient un temps où la procédure doit s’achever.
Il a fallu trouver un chemin entre ces deux contraintes, chemin d’autant plus rocailleux et difficile que la vérité judiciaire n’est pas nécessairement la vérité. En effet, nous le savons tous, que l’on soit juré populaire ou que l’on soit un magistrat qui juge en robe, nul ne peut prétendre à l’infaillibilité.
Notre droit lui-même pose le principe de l’intime conviction, qui permet que des décisions en correctionnelle ou aux assises soient prises sans qu’une preuve formelle vienne établir la culpabilité. Or, à partir du moment où cette règle est posée, même si le principe du doute qui doit profiter à l’accusé est tout aussi fort, il s’ensuit que la vérité judiciaire n’est pas forcément absolue. Il faut l’admettre et avoir le courage d’ouvrir des voies pour que des procédures de révision permettent éventuellement de corriger une condamnation prononcée à tort.
Nous avons retenu dans ce texte de loi un certain nombre de dispositions majeures. Je ne les exposerai pas toutes, car je ne doute pas que M. le rapporteur explicitera dans le détail les plus importantes ou les plus complexes d’entre elles.
Parmi ces mesures majeures, se trouvent notamment deux dispositions visant à garantir, en amont, la possibilité de la révision du procès : il s'agit, d’une part, d’éviter les destructions intempestives de scellés, qui sont des preuves nécessaires, et, d’autre part, d’assurer l’enregistrement des procès, notamment aux assises pour les affaires criminelles.
Voilà des années que, dans son rapport annuel, la Cour de cassation déplore la destruction de scellés qui auraient permis à la cour de révision de se prononcer de façon plus éclairée. Il y a donc un vrai problème, que le Sénat n’ignore pas, d'ailleurs, puisque votre assemblée a été, il y a plusieurs mois, à l’initiative d’une proposition de loi qui nous a permis de débattre de la question. À l’époque, je vous avais exposé les dispositions que le Gouvernement comptait mettre en place pour assurer la conservation des scellés dans de bonnes conditions et procéder à bon escient à leur éventuelle destruction.
À partir du moment où un texte de loi prévoit la conservation des scellés, il est important de s’interroger sur les conditions de cette conservation. Le texte transmis au Sénat prévoyait une destruction limitée et un système équilibré de conservation de scellés. Ces derniers ne seraient pas conservés systématiquement, mais la personne mise en cause pourrait en demander le maintien ; en cas de désaccord avec le parquet, la chambre d’instruction a reçu la compétence d’arbitrage.
Nous en discuterons tout à l’heure, la commission des lois du Sénat a adopté un amendement visant à élargir le champ de la demande de conservation des scellés, le texte de l’Assemblée nationale ne concernant que les scellés d’affaires criminelles, sous réserve bien entendu qu’ils ne soient plus nécessaires à la manifestation de la vérité.
La prolongation du délai de conservation des scellés aura un coût pour nos juridictions. Dans la mesure où il s’agit d’une proposition de loi, ce texte n’est pas obligatoirement assorti d’une étude d’impact. En tant que garde des sceaux, responsable du bon fonctionnement de nos juridictions, j’ai eu le souci de faire évaluer les effets d’une telle mesure. J’ai donc demandé à la direction des services judiciaires d’estimer le mode de conservation des scellés, son coût, les besoins en termes de surfaces, et de mesurer ce que coûteraient leur conservation et leur destruction.
La direction des services judiciaires s’est rendue dans vingt-huit tribunaux de grande instance et dans vingt-deux cours d’appel. Il est apparu que seules 41 % des décisions de destruction de scellés dans les tribunaux de grande instance sont respectueuses des consignes strictes qui ont été précisées par les circulaires, et 65 % dans les cours d’appel. Il ne s’agit pas de mettre en cause nos juridictions, qui sont souvent amenées à prendre des décisions rapidement, d’autant que certains scellés occupent de la place et que leur conservation a un coût.
En tout état de cause, je l’ai dit devant les députés, je suis décidée à assumer le coût de la disposition prévue par l’Assemblée nationale. Sur une dizaine d’années, nous aurons besoin de 160 mètres carrés supplémentaires pour la conservation des scellés, mais aussi d’un peu plus de six magistrats et d’une quinzaine de fonctionnaires. Compte tenu de l’importance de la conservation de ces pièces pour les procédures de révision, c’est une dépense à laquelle nous ferons face.
Néanmoins, je vous le dis tout de suite, car je sais que vous êtes aussi respectueux que moi de la bonne gestion de nos budgets, compte tenu des discussions que nous avons eues sur la nécessaire rationalisation de la gestion des scellés, nous compenserons ces coûts, notamment en dématérialisant certains scellés très encombrants qu’il n’est pas indispensable de conserver en l’état compte tenu des affaires en cause.
Par ailleurs, nous améliorerons, notamment pour les affaires correctionnelles, les procédures de ventes de scellés qui ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité. Nous prendrons donc un certain nombre de dispositions qui permettront, en rationalisant davantage la gestion, d’économiser sur ce que coûte aujourd'hui la conservation parfois assez peu encadrée de certains scellés.
À la suite d’une QPC, d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a rendu une décision il y a un peu moins de deux semaines, le 11 avril dernier, supprimant une disposition du code de procédure pénale qui autorisait le procureur à décider de la destruction de scellés au motif que les textes ne prévoyaient aucun recours.
Dans le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, que le Sénat a adopté, j’ai rétabli par voie d’amendement à l’Assemblée nationale la possibilité pour le procureur de décider de la destruction des scellés, mais en instaurant une disposition de recours.
Cet amendement ayant été adopté par les députés, je souhaite un plein succès à la commission mixte paritaire qui examinera ce texte bientôt !

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Ne remuez pas le fer dans la plaie, madame la garde des sceaux !
Sourires.
Monsieur le président de la commission, les points de vue entre les deux chambres finiront très probablement par converger !
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Certes, mais Portalis exerçait ses fonctions sous Napoléon Bonaparte, consul à vie. Heureusement, la France a connu depuis lors des régimes un peu plus démocratiques !
Sourires.
Je dirai maintenant un mot de l’enregistrement systématique des audiences d’assises. Ce dispositif me paraît nécessaire pour garantir en amont la possibilité de révision. J’ai souligné à l’Assemblée nationale qu’il nous fallait cependant en mesurer l’impact et j’ai fait estimer le coût d’une telle mesure. J’avoue qu’il m’est plus difficile d’accepter les coûts des enregistrements systématiques que ceux de la prorogation de la conservation des scellés – nous aurons l’occasion d’en débattre plus longuement à la faveur de l’examen des articles.
Le Sénat a également modifié la formulation concernant le « moindre doute » pour des motifs que j’entends parfaitement et que tout législateur, député ou sénateur, peut comprendre, à savoir l’exigence d’une écriture qui soit la plus sobre et la plus acérée possible.
Il est vrai que l’expression « le moindre doute » est une formulation plus littérale que juridique.
Néanmoins, il est important de considérer les raisons pour lesquelles les parlementaires qui ont élaboré la proposition de loi ont retenu cette formule. Je l’ai souligné, la dernière loi ayant modifié les procédures de révision date de 1989. Elle prévoit très clairement que tout élément nouveau faisant naître un doute suffit à ouvrir la révision et qu’il n’est pas nécessaire que cet élément établisse d’emblée l’innocence de la personne condamnée.
Entre 1989 et 2013, il y a eu, pour environ 3 500 saisines en révision, quelque 9 annulations de condamnations criminelles et 43 annulations de condamnations correctionnelles. Les parlementaires ont donc souhaité insister sur le fait que le doute doit permettre l’instruction de la requête en révision, afin d’améliorer encore le dispositif et d’obtenir des résultats plus probants.
C’est la raison pour laquelle ils ont souhaité insister en introduisant dans la loi la notion de « moindre doute ». Lors de l’examen de la loi de 1989, le Sénat avait déjà sévi, si j’ose dire, puisqu’il avait supprimé, au travers d’un amendement de Michel Dreyfus-Schmidt, la formulation adoptée par l’Assemblée nationale, qui évoquait un « doute sérieux ».
Mesdames, messieurs les sénateurs, je connais votre aversion pour ces adjectifs qui visent à préciser les choses, mais qui vous heurtent et vous hérissent du point de vue d’une sémantique juridique stricte et de l’orthodoxie légistique. Néanmoins, si vous ne souhaitez pas rétablir la notion de « moindre doute », puis-je vous demander de poser clairement, afin que les travaux parlementaires fassent foi, que tout doute, quelle que soit son importance, sa profondeur, son intensité ou son envergure, doit permettre d’examiner la requête ?
Par ailleurs, cette proposition de loi prévoit également d’instaurer, au sein de la Cour de cassation, un organe particulier, à savoir une cour unique de révision et de réexamen. Cette disposition est tout à fait intéressante, puisque, à ce jour, une telle instance n’existe pas.
Cette cour serait composée de dix-huit magistrats, dont cinq composeraient la commission d’instruction. Celle-ci aurait pour compétence de statuer à la fois sur les demandes en révision et sur les demandes en réexamen, quand bien même il s’agit de deux procédures différentes : la procédure de révision d’une condamnation est enclenchée dès lors qu’apparaît un doute, tandis que la procédure de réexamen a été instaurée en France à la suite d’une condamnation prononcée à l’encontre de notre pays par la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH, en raison du doute qui pesait non pas sur la culpabilité du requérant, mais sur le caractère équitable du procès au terme duquel il avait été condamné.
Cette proposition de loi prévoit également d’améliorer les procédures en cours, dans la mesure où elle tend à permettre à la personne condamnée, avant même que celle-ci ne saisisse la cour de révision et de réexamen d’une demande en révision, de demander des investigations complémentaires.
Cette faculté mettrait pratiquement sur un pied d’égalité les personnes démunies et celles qui bénéficient de moyens d’investigation plus importants ou d’un plus grand soutien médiatique. Certaines affaires, bien qu’elles ne suscitent aucun émoi médiatique, pourraient à bon droit faire l’objet d’une révision.
Enfin, cette proposition de loi prévoit que les victimes seront désormais prévenues dès l’ouverture de la procédure de révision, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, puisqu’elles ne le sont qu’à partir du moment où la révision a été enclenchée.
Par ailleurs, le requérant sera obligatoirement assisté par un avocat à tous les stades de la procédure. Cela lui permettra d’être mieux défendu dès lors qu’il souhaitera remettre en cause une condamnation. Je rappelle que, actuellement, en l’absence de toute représentation par un avocat, les personnes ayant introduit une instance devant la cour de révision développent elles-mêmes leurs arguments pour convaincre ses membres.
Le sujet traité par cette proposition de loi est difficile et délicat, mais il est d’une très grande noblesse. La force et la grandeur de la justice, c’est l’autorité dont elle fait preuve pour que le procès pénal s’impose à la société, mais c’est aussi, dans une plus grande mesure encore, l’acceptation de sa propre faillibilité Or donner à la société et à nos concitoyens les moyens de contester une erreur judiciaire éventuelle, c’est indiscutablement renforcer la démocratie.
C’est ce qu’affirmait déjà Émile Zola lorsqu’il défendait le capitaine Dreyfus. Outre son magnifique « J’accuse… ! », il expliquait dans sa Lettre à la jeunesse comment l’erreur judiciaire est une force en marche, au sens où elle interpelle les consciences. Une fois que ces consciences sont interpellées, elles se mobilisent, elles mettent en œuvre tous leurs moyens de façon que la justice soit rétablie, que la justice soit dite.
Mesdames, messieurs les sénateurs, c’est cette œuvre que vous allez accomplir encore cette après-midi.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Applaudissements sur les travées du RDSE.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la procédure pénale est le rempart de la liberté des citoyens. Ainsi, c’est dans le domaine de la justice et dans le code de procédure pénale que les valeurs fondamentales de la République trouvent leur traduction la plus éclatante.
« La vérité est en marche, et rien ne l’arrêtera » écrivait Émile Zola en 1898. C’est dans le même esprit d’une recherche constante de la vérité, du respect de la personne humaine, que s’inscrit l’examen de la proposition de loi de notre collègue député Alain Tourret portant réforme de la procédure de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive. Elle fait suite à la mission d’information conduite par celui-ci et son collègue Georges Fenech, et il me plaît de souligner le travail exceptionnel qu’ils ont accompli durant un an. Je tenais à leur rendre hommage et à les remercier de leur contribution.
Il était dès lors naturel que leurs travaux se traduisissent par la proposition de loi dont nous sommes saisis.
Une décision de justice est revêtue de l’autorité de la chose jugée lorsque toutes les voies de recours ont été utilisées et que les délais fixés par la loi pour les exercer sont épuisés. C’est une exigence de sécurité quand on sait que la force de la chose jugée est encore plus grande en matière criminelle, dans la mesure où le jury populaire est réputé infaillible.
Toutefois, il arrive que, postérieurement à une décision passée en autorité de la chose jugée, il se révèle qu’une erreur de fait commise par la cour d’assises ou par le tribunal correctionnel a eu pour effet la condamnation d’un innocent. Elle constitue alors une injustice insupportable, qui frappe et scandalise à la fois le condamné et l’opinion. Dès lors, il est indispensable qu’il existe une procédure exceptionnelle permettant de réviser les condamnations.
En France, une telle procédure de révision existe depuis longtemps, avec l’ordonnance criminelle de 1670, qui permettait d’obtenir du Conseil du roi des « lettres de révision ». Elle fut supprimée à la Révolution, puis rétablie en 1808.
Les cas d’ouverture étaient alors déjà les trois premiers cas précisément définis qui figurent encore dans le code de procédure pénale : la condamnation de deux personnes pour un même crime par deux jugements différents ; la condamnation pour l’homicide d’une personne qui se révèle ensuite être toujours vivante – ce cas ne s’est jamais présenté, me semble-t-il ; enfin, la condamnation ultérieure d’un témoin à charge pour faux témoignage.
En 1867, la révision est étendue aux délits. En 1895, le législateur se décide à créer un quatrième cas d’ouverture, qui permet en principe de couvrir toutes les hypothèses où un innocent a été condamné : c’est le fameux « fait nouveau ou élément inconnu au jour du procès » de nature à établir l’innocence du condamné et qui constitue le cas de révision de loin le plus utilisé. Il contient en réalité les trois autres.
Enfin, l’affaire Mis et Thiennot a conduit Robert Badinter en 1983 à proposer un nouveau projet de loi, qui n’aboutira pas, puis Michel Sapin à déposer une proposition de loi, qui débouchera sur la loi du 23 juin 1989 relative à la révision des condamnations pénales.
Les apports de cette loi sont nombreux et importants, notamment la substitution du « doute sur la culpabilité » à la certitude de « l’innocence » pour permettre la révision et la juridictionnalisation complète de la procédure, alors que, auparavant, le garde des sceaux avait la lourde charge de filtrer les requêtes.
Enfin, en 2000, l’affaire Hakkar a conduit le Parlement à introduire la procédure de réexamen d’une décision pénale, consécutivement au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme.
La proposition de loi que nous examinons se fonde essentiellement sur le constat suivant : la loi de 1989 n’a pas abouti à une augmentation significative du taux de succès des recours en révision. Sur les raisons de ce taux homéopathique, les avis peuvent être partagés ; je vous dirai mon opinion tout à l’heure.
Depuis 1989, seulement 2, 65 % des demandes sont parvenues à la cour de révision, soit 84 sur 3 358. Celle-ci a procédé à l’annulation de 52 condamnations pénales – 9 criminelles et 43 correctionnelles –, madame la garde des sceaux l’a rappelé. Il arrive donc fréquemment qu’elle ne fasse pas droit aux pourvois, pourtant déjà filtrés par la commission de révision, soit parce qu’elle estime que l’élément présenté comme nouveau ne l’est pas, soit parce que celui-ci ne suscite pas de doute sur la culpabilité du condamné.
En outre, les auteurs de cette proposition de loi font valoir à juste titre que le code de procédure pénale ne fixe pas la composition de la cour et que la procédure suivie n’est pas non plus définie de manière précise. Dès lors, le présent texte tend à réformer en profondeur la juridiction et la procédure de révision.
La commission des lois a approuvé les grands axes de cette réforme. Elle a toutefois procédé à quelques modifications importantes.
À titre préliminaire, j’indique qu’elle n’a pas modifié les deux premiers articles relatifs à l’amélioration des moyens matériels susceptibles d’être utilisés dans le cadre de l’examen d’une demande de révision.
Mme la garde des sceaux a évoqué à l’instant le problème des scellés ; nous y reviendrons à l’occasion de l’amendement déposé par le Gouvernement. Les auteurs de la proposition de loi proposent d’allonger à cinq ans renouvelables, au lieu de six mois, la durée de conservation des scellés criminels, à la demande du condamné. Cet allongement est unanimement salué comme une avancée pour préserver des preuves indispensables afin de remédier aux erreurs judiciaires.
Par ailleurs, la proposition de loi prévoit l’enregistrement sonore systématique des débats des cours d’assises, ce qui permettra dans certains cas à la juridiction de révision d’apprécier plus facilement le caractère réellement « nouveau du fait ou de l’élément inconnu ».
J’en viens à l’article 3, qui constitue le cœur de la réforme. Il prévoit d’abord de fusionner les instances de révision et celles de réexamen.
Dans la mesure où les deux voies de recours portent atteinte à l’autorité de la chose jugée, sont mises en œuvre par des juridictions similaires et suivent une procédure relativement proche, il est préférable de fusionner ces deux juridictions.
Certes, la révision porte sur des questions de fait, alors que le réexamen ne porte sur une question de droit. Toutefois, la commission a finalement approuvé cette fusion, tout en adoptant un amendement visant à remédier à sa conséquence la moins opportune : l’examen des demandes en réexamen par la commission d’instruction.
En effet, il s’agit seulement de constater l’existence d’un arrêt de la CEDH et le respect du délai d’un an. Notre commission a donc adopté un amendement tendant à permettre au président de cette commission de statuer par ordonnance pour rejeter les demandes en réexamen ou les renvoyer immédiatement à la cour de révision et de réexamen.
La deuxième modification importante concerne la composition de la cour. Celle-ci serait formée de 18 magistrats nommés pour trois ans, à raison de trois pour chaque chambre de la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle étant président de la cour et de la formation de jugement.
Cinq de ces magistrats seraient désignés en son sein pour constituer la commission d’instruction. Ce dispositif a deux avantages : premièrement, la composition de la cour est désormais fixée par la loi ; deuxièmement, il assure une plus grande diversité de vues. Il faut souligner que les questions abordées par la cour ne supposent pas de grandes connaissances juridiques.
La question posée – l’élément nouveau met-il en doute la culpabilité du condamné ? – place la cour de révision dans une situation quelque peu comparable à celle d’un jury. En outre, les magistrats des autres chambres de la Cour de cassation, du fait de leur parcours antérieur, sont rarement ignorants en matière de procédure pénale ! La commission a donc approuvé cette nouvelle composition.
Troisième modification importante : l’appréciation du « doute » que fait naître le fait nouveau ou l’élément inconnu au jour du procès sur la culpabilité du condamné.
Il est proposé de transférer entièrement à la formation de jugement de la cour de révision l’appréciation de ce doute, alors que, actuellement, la commission de révision examine également cet aspect.
Il s’agit ainsi de mieux distinguer les rôles des deux instances, afin d’éviter que, quand la première juge la demande recevable et que la seconde la rejette, l’opinion y voie une contradiction de la cour avec elle-même. La commission a approuvé cette modification.
En revanche, la notion de « moindre doute » soulève davantage de difficultés.
Tout d’abord, il est vrai que la chambre criminelle s’est plusieurs fois fondée sur la notion de « doute sérieux ». Néanmoins, elle l’a fait justement pour assouplir l’examen de la requête, à une époque où le code de procédure pénale prévoyait que seule la conviction de l’innocence du condamné pouvait justifier la révision.
Ensuite, l’appréciation de la cour de révision a toujours varié, selon que de nouveaux débats devant une autre juridiction sont possibles ou ne le sont plus. S’ils le sont, l’appréciation est alors plus indulgente que dans le cas où la cour doit statuer en dernier ressort sans renvoi.
Enfin, n’essayons pas de qualifier le doute : celui-ci ne se divise pas. Notre regretté collègue Michel Dreyfus-Schmidt avait à juste titre déposé un amendement, adopté par le Sénat, visant à supprimer l’adjectif « sérieux » qui qualifiait le doute dans le texte initial de la loi de 1989. Il ne serait pas plus raisonnable aujourd’hui d’introduire la formule « le moindre doute ».
En réalité, les magistrats cherchent à établir si le fait nouveau ou l’élément inconnu est susceptible, ou non, de remettre en cause l’édifice intellectuel qui a mené à la condamnation. Le fait d’ajouter « moindre » à « doute » n’aura aucun effet. C’est le doyen Carbonnier qui considérait l’adjectif comme « l’acné du style juridique »... La commission a donc supprimé le mot « moindre ».
Quatrième modification, si la proposition de loi tend à conserver les quatre cas d’ouverture déjà existants et à placer simplement le plus utilisé – le fait ou élément nouveau – en premier, la commission des lois a supprimé les trois derniers cas d’ouverture. En effet, si ces derniers sont le reflet de l’histoire et peuvent éventuellement, à ce titre, intéresser des étudiants, ils sont tous contenus dans le premier par le renvoi à un fait nouveau. Les magistrats et praticiens que j’ai entendus ont d’ailleurs été unanimes sur ce point.
Concernant les personnes autorisées à présenter un recours en révision, la proposition de loi tend à compléter la liste actuelle en ajoutant le procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux. En effet, il n’est pas illogique que le parquet puisse déclencher la révision sans avoir à passer par le ministre de la justice. Pour tenir compte de l’évolution de la société, le recours serait élargi à la personne liée à lui par un PACS, à son concubin et à ses petits-enfants.
Par ailleurs, la proposition de loi tend à préciser les pouvoirs d’investigation de la commission d’instruction – nous aurons d’ailleurs à examiner des amendements qui ont été déposés sur ce point – et de la formation de jugement.
Actuellement, la plupart des actes d’investigation effectués lors de la phase d’instruction sont des demandes d’expertises et des auditions de témoins. Un débat existe toutefois sur la possibilité de prendre des mesures telles qu’une garde à vue à l’encontre de tiers soupçonnés d’avoir un lien avec l’affaire. Le texte de la proposition de loi n’est pas suffisamment clair à cet égard.
Il nous a semblé que ce genre d’actes ne relève pas de la compétence de la cour de révision, d’autant que la proposition de loi prévoit la possibilité de demander à un procureur de la République d’ouvrir une information dans les cas où de tels actes sont nécessaires.
Dès lors, la commission a adopté un amendement tendant à préciser que les mesures d’investigation qui peuvent être effectuées par la cour, en particulier par la commission d’instruction, sont toutes celles qui correspondent aux prérogatives du juge d’instruction, à l’exclusion de la mise en examen, de la garde à vue et de l’audition libre. Parallèlement, elle a précisé les conséquences de la saisine du procureur de la République lorsqu’il apparaît qu’un tiers pourrait être impliqué dans la commission des faits : après avoir mené des investigations, celui-ci pourra toujours ouvrir une information judiciaire.
La proposition de loi reprend en outre, en les précisant, les dispositions actuelles relatives à la suspension éventuelle de l’exécution de la condamnation par la commission d’instruction ou la formation de jugement
Pensons au précédent malheureux de l’affaire Leprince : Dany Leprince avait été libéré par la commission de révision, puis réincarcéré lorsque la cour de révision avait rejeté sa demande en révision.
Dès lors, les députés ont souhaité instaurer une possibilité pour le parquet de faire appel de la décision de la commission d’instruction et, symétriquement, une voie de recours pour le condamné. Ce dispositif ne répond pas vraiment à la difficulté posée, dans la mesure où la commission d’instruction pourrait toujours décider de la suspension de la condamnation, alors même qu’il est parallèlement proposé dans le texte de réduire son rôle en matière d’appréciation de la requête.
La commission a donc prévu que toute demande de suspension sera examinée par une tierce instance, la chambre criminelle.
Enfin, le plan de l’article 3 de la proposition de loi nous a semblé manquer de cohérence. C’est la raison pour laquelle la commission en a modifié en profondeur l’architecture, afin de rendre la procédure plus lisible.
Telles sont, mes chers collègues, les mesures proposées par ce texte et les principales modifications que la commission des lois y a apportées. La commission vous proposera également d’adopter quelques amendements supplémentaires de coordination.
Au-delà des conclusions de la commission, la proposition de loi appelle de ma part deux ou trois observations.
Aucun amendement n’a été déposé pour demander la révision des décisions d’acquittement évoquée à l’occasion d’une actualité récente. Toutefois, il ne serait pas convenable de ne pas évoquer l’amendement déposé, lors des débats à l’Assemblée nationale, par M. Georges Fenech, et qui a été rejeté. Pour ma part, je n’y suis pas favorable.
Tout d’abord, le principe non bis in idem veut que l’on ne puisse pas être deux fois poursuivi ou condamné pour les mêmes faits. Ce principe apparaît également dans le protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme, qui engage la France. Enfin, une telle possibilité irait à l’encontre du principe de la prescription, dès lors que la demande en révision n’est soumise à aucun délai. Paradoxalement, une personne acquittée pourrait alors être rejugée, à l’inverse d’un criminel non découvert pendant le délai de prescription.
Blackstone, jurisconsulte anglais au XVIIIe siècle, déclarait : « Mieux vaut dix coupables en liberté qu’un innocent en prison ». L’unanimité des personnes entendues partage ce sentiment. Il n’y a pas de société parfaite et les erreurs judiciaires sont toujours possibles. Il fallait toute l’audace de Moro-Giafferi pour déclarer : « Je ne connais comme erreurs judiciaires que les acquittements que j’ai obtenus ».
Sourires.

Ce texte comble une lacune du droit, car n’y aurait-il qu’un seul innocent en prison, la présente proposition de loi serait encore la bienvenue.

Toutefois, les erreurs judiciaires, si douloureuses soient-elles, ne sont pas telles que la justice aurait à en rougir. L’objet de la proposition de loi est de les réduire, mais l’émotion provoquée dans l’opinion par certaines affaires ne saurait faire oublier l’évidence : la République peut supporter avantageusement dans ce domaine toute comparaison avec les autres pays ayant adhéré à la Convention européenne des droits de l’homme.
Mes chers collègues, je vous propose ainsi d’adopter cette réforme sous réserve des modifications proposées.
Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste et du groupe écologiste – M. Jean-Jacques Hyest applaudit également.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le sujet dont nous débattons cet après-midi est l’une des questions essentielles posées à la conscience : en dépit du double degré de juridiction et de l’existence de la Cour de cassation, l’erreur est humaine ; l’erreur fait partie de l’histoire.
Madame la garde des sceaux, vous avez parlé avec tant de force de cette question de conscience que j’ai quelques scrupules à intervenir après vous.
Je voudrais tout d’abord remercier chaleureusement à la fois notre collègue député M. Tourret, qui a déposé cette proposition de loi, et M. le rapporteur Nicolas Alfonsi. J’ai été témoin, pour avoir partagé quelques auditions avec ce dernier, du travail considérable, minutieux et détaillé qu’il a accompli et qu’il vient de nous exposer avec beaucoup de force. Cher Nicolas Alfonsi, nous partageons vos convictions, en particulier la dernière partie de votre propos.
Je me permettrai d’insister sur quelques points.
Tout d’abord, l’avantage de ce texte est de créer une juridiction unique. Chacun sait ici la différence qui existe entre le réexamen et la révision : le réexamen est dû à des décisions de justice, notamment celles de la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH.
J’ajoute qu’il était nécessaire d’inscrire dans la loi la définition et la constitution de cette juridiction unique. En effet, comme l’a dit d’ailleurs Mme Lazerges, que vous avez auditionnée en 2011, mes chers collègues, des avocats ont évoqué « la composition aléatoire de la cour de révision ». La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que les organes de ce type devaient être établis selon la volonté et la décision du législateur.
Il y aura donc dix-huit magistrats, qui représenteront les six chambres de la Cour de cassation, dont cinq seront chargés de l’instruction, qui examineront seulement la recevabilité objective de la demande. Seule la formation de jugement jugera et appréciera, en particulier le fait nouveau sur lequel je reviendrai.
Je tiens à le souligner, monsieur le rapporteur, grâce à votre initiative, et si nous vous suivons – j’espère que ce sera le cas –, il sera inscrit dans la loi que la formation de jugement sera présidée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Nous avons eu quelques débats sur la place qui serait donnée à l’ensemble des chambres : certains considèrent qu’une prééminence devrait être concédée à la chambre criminelle ; d’autres ont avancé qu’il serait judicieux de réunir les positions des représentants des différentes chambres. Toutefois, il apparaît juste et logique que la formation de jugement soit présidée par le président de la chambre criminelle.
Je voudrais ensuite souligner que, grâce à votre initiative, monsieur le rapporteur, les trois, puis quatre motifs traditionnels de la révision seront réduits à un seul.
Il est vrai que, comme cela a déjà été dit, le premier n’a jamais été utilisé. Il s’agit du cas de l’homicide dans lequel la personne concernée est toujours vivante. Naturellement, cela pourrait inspirer quelques œuvres littéraires, mais aucun débat judiciaire n’en est pour le moment résulté.
Sourires.

La deuxième situation est celle des condamnations inconciliables, si un nouveau jugement condamne pour les mêmes faits une personne différente de celle qui a été accusée. Cependant, de même que la réapparition de la personne censée avoir été assassinée, le jugement destiné à condamner une autre personne pour les mêmes faits serait, lui aussi, incontestablement un fait nouveau.
Quant au faux témoignage, qui est le troisième cas, si l’un des témoins, postérieurement à la condamnation, apparaissait comme ayant procédé à un faux témoignage, le fait nouveau serait également avéré.
C’est pourquoi, avec la grande logique qui est la vôtre, vous nous proposez de simplifier tout cela, avec la seule mention de « faits nouveaux ». Je pense que vous avez raison. Ainsi, on s’en tiendrait à ce qu’a judicieusement écrit le législateur dans la loi du 23 juin 1989 : s’il vient à se produire ou se révéler « un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné », la révision est possible.
Je voulais également souligner tous les apports de la proposition de loi.
Le requérant pourrait demander des actes d’investigation auprès du procureur de la République, puis de la commission d’instruction, ce qui est nouveau. L’élargissement des requérants possibles s’étendrait aux petits-enfants, incluant désormais les personnes pacsées ou les concubins.
L’approfondissement du droit des parties serait confirmé, puisque le requérant aurait la parole en dernier. En outre, la partie civile aurait la possibilité d’intervenir, non seulement avec l’intervention d’un avocat, mais avec l’assistance et la présence de ce dernier lors de l’audience.
Enfin, je n’insiste pas sur les améliorations matérielles dont vous avez parlé et sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir, comme vous l’avez exposé, madame la garde des sceaux, s’agissant de la conservation des scellés et de l’enregistrement sonore des débats en cour d’assises.
Vous avez également précisé, monsieur Alfonsi, et je vous en remercie, quels étaient les pouvoirs d’investigation de la cour de révision et de réexamen.
Pour éviter que les mêmes personnes soient juges et parties, vous nous proposez, avec sagesse, que les actes coercitifs, telle la garde à vue, ne relèvent pas de la compétence de la cour de révision. Ils seraient du ressort du procureur de la République, lequel pourrait ordonner de nouvelles investigations, par le biais d’une enquête préliminaire par exemple, et, le cas échéant, ouvrir une information judiciaire.
Je tiens aussi à insister sur une autre de vos propositions, qui m’apparaît tout à fait juste et susceptible d’améliorer le texte. La demande de suspension de l’exécution de la condamnation peut émaner soit du condamné, soit de la commission d’instruction, soit de la formation de jugement. Pour éviter qu’une même instance intervienne deux fois, vous proposez que la décision concernant cette demande soit prise par la chambre criminelle de la Cour de cassation, ce qui m’apparaît judicieux. En tout cas, cette suggestion mérite que nous en discutions à l’occasion de l’examen des amendements.
Je ne saurai finir sans aborder à mon tour les questions relatives aux adjectifs qualificatifs.
M. Jean-Jacques Hyest s’exclame.
Sourires.

… tout comme je suis conscient, madame Cukierman, de notre égale affection pour l’ensemble des mots de la langue française !
Il n’y a aucune raison de privilégier les substantifs et les verbes au détriment des adverbes et des adjectifs auxquels nous serions rétifs.
Sourires.

Néanmoins, tout dépend de l’ordre dans lequel nous nous situons. Or il est tout à fait exact qu’en matière juridique, les adjectifs peuvent assombrir les notions employées, leur ôter leur efficacité, leur lisibilité, leur « intelligibilité », pour reprendre le terme du Conseil constitutionnel, et, pour tout dire, leur clarté.
Voilà quelques jours – je sais que Mme Cukierman s’en souvient –, nous avons débattu du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, pour lequel certains de nos collègues députés tenaient absolument à ce que l’on emploie l’expression « égalité réelle ».
De même, certains voulaient naguère que l’on parle de « laïcité positive ». Le terme « laïcité », leur avions-nous répondu, se suffisait à lui-même, avait sa propre force. C’est aussi le cas du mot « égalité ». Personne n’a jamais prétendu que la devise de la République française devait devenir « liberté réelle, égalité réelle, fraternité réelle » ! Nous comprenons bien les termes de cette devise – la liberté, l’égalité, la fraternité –, dans toutes leurs acceptions.
Ainsi notre cher ami Michel Dreyfus-Schmidt, à qui vous avez rendu hommage, monsieur le rapporteur, madame la garde des sceaux, et qui, malheureusement, nous a quittés, avait-il fait la chasse au terme « sérieux » dans l’expression un « doute sérieux ». Il avait à lui seul la faculté de faire durer quatre à cinq jours l’examen d’un texte prévu pour deux jours, tant étaient grandes sa force d’argumentation et son énergie…
Tel est le paradoxe, mes chers collègues, de verbes comme « devoir » ou d’une expression comme « sans doute ». Vous le savez bien, quand on emploie l’expression « sans doute », c’est précisément qu’il y a un doute, tout comme l’emploi de « certainement » signifie que ce n’est pas certain et celui de « sûrement » que ce n’est pas sûr !

Vous avez raison, madame Cukierman ! Je vois que vous suivez mon propos et j’en suis extrêmement flatté.
Toujours est-il que le terme « doute » se suffit à lui-même et, au regard des interventions de Mme le ministre et de M. le rapporteur quant à la nécessité de se battre contre l’erreur judiciaire et contre toute possibilité qu’un innocent puisse être condamné, un doute, le plus petit soit-il, pose de fait problème et justifie la révision. J’y insiste donc, ce terme se suffit à lui-même !
Mes chers collègues, je crois en avoir assez dit. Je conclurai simplement en réitérant mes remerciements à M. Alain Tourret et à notre rapporteur.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du groupe CRC et du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, madame la ministre, mes chers collègues, comme toujours, ou comme très souvent, nous pouvons saluer l’apport des propositions de loi dans notre ordre juridique, ainsi que le travail rédactionnel du Sénat et de sa commission des lois. À chaque lecture d’un texte, c’est une amélioration sensible que nous apportons, tant en termes de rédaction que sur le fond.
La proposition de loi en discussion vise à faire œuvre de justice, et même de belle justice, puisqu’il est question de réparer les erreurs judiciaires.
Qu’il soit un professionnel de la justice, un citoyen ou une citoyenne temporairement en charge d’une mission de justice, l’être humain est toujours faillible. Il est soumis à ses préjugés – le comble pour un juge –, à ses passions, à ses faiblesses. Il est manipulable ou manipulateur. Bref, il est humain !
Or la justice est un idéal, et nos lois doivent tendre à la rendre la moins sujette à caution possible. Il faut donc rendre une justice humaine en mettant des garde-fous à l’humain.
La Révolution française s’est faite non seulement sur l’organisation des pouvoirs ou le vote des finances publiques, mais aussi sur l’organisation des lois et de la justice. Depuis toujours, en effet, la société aspire à une justice « parfaite », idéale, qu’elle émane des dieux ou de Dieu, avec les rituels des ordalies, ou des hommes, avec les ordonnances ou les codes.
Pour cela, il ne suffit pas de supprimer la torture, d’établir les droits de la défense, de reconnaître la place des victimes, de supprimer la peine de mort. Les décisions de justice doivent aussi être irréprochables, acceptables et acceptées aussi bien par la société qui juge et condamne que par celui qui est condamné.
En outre, le condamné doit toujours être le coupable. Un seul innocent condamné, et c’est la confiance dans la bonne marche de notre société qui s’effrite ! Chaque crime ou délit doit être résolu. Chaque coupable d’une rupture dans notre pacte sociétal doit être jugé, condamné, amendé et libéré.
L’ultime parapet avant que la justice et, donc, la société ne se retrouvent en faute, c’est de permettre la révision d’une décision de justice.
Comme le rappellent le rapport de M. Alain Tourret pour l’Assemblée nationale et celui de M. Nicolas Alfonsi pour le Sénat, l’antique procédure de révision permettant de s’assurer qu’aucune erreur judiciaire ne perdurait, surtout si des faits nouveaux étaient découverts, n’est pas, n’est plus satisfaisante aujourd'hui, et ce malgré plusieurs réformes, dont les plus récentes remontent déjà à 1989 et 2000.
Il faut en effet que le doute – je ne sais pas s’il doit être petit ou grand – profite même au condamné, même à celui qui a été jugé par les citoyens. C’est là l’apport le plus important de cette proposition de loi : la réaffirmation du fait que douter n’est pas condamner. Douter, c’est réexaminer les faits, donc refaire le procès.
Toutefois, cette proposition de loi va plus loin encore, en facilitant une nouvelle discussion au travers de la conservation des preuves, qui est un élément essentiel lors d’une procédure de révision et de réexamen, tout autant que la mémoire des débats.
Nous possédons depuis longtemps des moyens d’enregistrement fiables, et pour un faible coût, de l’ensemble des débats, mais nous nous étions jusqu’ici abstenus, en tant que législateurs, d’ouvrir largement cette possibilité. Le texte répare, là aussi, un oubli dommageable.
Enfin, il met fin à une absurdité de notre système juridique. Alors que la Convention européenne des droits de l’homme est issue des réflexions de grands juristes dont certains, comme René Cassin, étaient français, nous n’avions pas dans notre code de procédure spécifique de réexamen. C’est maintenant chose faite !
Reste que pour minimiser le risque d’erreurs judiciaires, surtout pour les crimes, l’obligation de motiver les jugements des cours d’assises, telle qu’elle est issue de la loi du 10 août 2011, doit devenir effective et, surtout, efficace. Comme le souligne notre rapporteur, le contenu de la motivation reste succinct et varie d’une juridiction à l’autre, ce qui est totalement contraire à notre État de droit.
Nous comptons donc sur votre vigilance, madame la garde des sceaux, pour rappeler cette nécessité absolue : l’intime conviction n’est pas simplement une intuition, une lubie. Elle repose sur une réflexion, certes collective, mais qui peut être couchée sur le papier. Si la réflexion précède l’écriture, l’écriture approfondit la réflexion.
D’ailleurs, il faut sans doute s’interroger sur la nature des délibérés d’assises face à cette obligation de motivation. Le vote sur la culpabilité doit-il intervenir avant la motivation couchée par écrit ou la motivation, avec ce qu’elle devrait comprendre de résumé des charges et décharges, ne devrait-elle pas constituer les prémisses du jugement ?
Je ne serai hélas plus là pour vous proposer un texte en ce sens ou le voter, et si vous m’autorisez à déborder un peu de mon temps de parole, monsieur le président, je veux profiter de cet instant pour vous dire, ainsi qu’à Mme la ministre et à tous mes collègues, au revoir.
Exclamations.

Nos oppositions politiques et idéologiques, lorsque nous les utilisons habilement, respectueusement, en faisant preuve d’intelligence collective, font honneur au travail parlementaire.
Je vous remercie, mes chers collègues, de votre écoute, de votre accueil et de votre dévouement à la chose publique, à notre République et à notre démocratie. §

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord, en tant que représentant du département de la Seine-et-Marne, de saluer ma collègue Hélène Lipietz, qui a fortement animé les travaux de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest. Je crois que nous pouvons rendre hommage à son activité législative. Celle-ci a été brève, mais dense, quand l’activité législative de certains d’entre nous est au contraire très longue, mais assez peu dense.
Sourires.
Nouveaux sourires.

Non, je n’en citerai pas !
Pour en revenir aux points qui ont été longuement développés par Mme la garde des sceaux et M. le rapporteur, la réforme des deux procédures de révision permettant exceptionnellement de contester une décision pénale, alors même que le jugement est devenu définitif, est bien évidemment utile. Ces mécanismes présentaient effectivement de nombreux dysfonctionnements.
Cette réforme est le fruit des préconisations d’un rapport de MM. Alain Tourret et Georges Fenech. Peut-être faudrait-il d’ailleurs citer de temps en temps ce dernier… Ce serait juste !
M. le président de la commission des lois acquiesce.

Notre collègue Nicolas Alfonsi a par ailleurs su mettre en musique ce rapport de nos collègues députés consacré à la révision des condamnations pénales, avec sa finesse et sa connaissance du droit que nous admirons.

Actuellement, la révision d’un procès pénal est possible selon deux procédures : la demande de révision et la demande de réexamen d’une décision pénale consécutive au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH. Précisons que très peu de demandes sont formulées au titre de cette seconde procédure !
Depuis 1989, date de la dernière loi portant révision du procès pénal, on n’a compté que 84 décisions conduisant à la saisine de la Cour de révision, qui a prononcé 51 décisions d’annulation et 33 décisions de rejet. Il ne faut pas nécessairement s’en offusquer : cela signifie peut-être, en fin de compte, que la justice se trompe moins souvent qu’on ne le dit.
Mme la garde des sceaux acquiesce.

Il n’empêche que certaines affaires, souvent médiatisées, nous imposent d’examiner de nouveau cette question de la révision.
Je signale au passage qu’il fut un temps où il n’existait pas d’appel des condamnations criminelles. Monsieur Mézard, souvenez-vous des débats de l’époque : c’est précisément le Sénat qui avait plaidé pour l’élargissement de l’appel aux décisions des cours d’assises !
Cette disposition a-t-elle changé grand-chose ? On peut émettre les mêmes doutes qu’au sujet de la motivation. Pour Hélène Lipietz, mieux la motivation est faite, moins la décision est contestable. Néanmoins, on sait très bien comment les motivations sont formulées, y compris en correctionnelle !
M. Jacques Mézard opine.

Le présent texte simplifie et clarifie la procédure de révision des procès pénaux pour faciliter, lorsque cela est justifié, l’aboutissement des procédures.
À cette fin, l’article 3 unifie et homogénéise les deux procédures en vigueur. C’est une bonne chose. Une juridiction unique doit être créée, la Cour de révision et de réexamen, composée d’une commission d’instruction des demandes en révision et d’une formation de jugement. Il est tout de même étonnant qu’une telle instance n’ait pas été conçue plus tôt !
Deux autres modifications s’inscrivent également dans une logique de simplification et de lisibilité de la procédure.
Concernant la demande en révision, il faut rappeler que, si le procureur général peut actuellement faire une demande en réexamen à la suite d’une décision de la CEDH, dans ce cadre, seuls trois types de requérants peuvent engager la demande : le garde des sceaux ; le condamné ou son représentant légal ; son conjoint, un parent, etc.
L’unification de la procédure va désormais permettre au procureur général d’engager une demande en révision.
Concernant la demande en réexamen, la commission des lois a allégé la procédure, en supprimant l’obligation pour la commission d’instruction des demandes en révision et réexamen, ou CIDRE, de saisir la formation de jugement. Voilà néanmoins un nouveau sigle ! On en invente tous les matins, et même tous les après-midi !
Sourires.

Puisque le jugement au fond dépend du simple constat de l’existence d’un arrêt de la CEDH justifiant le réexamen du procès, notre commission propose que le président statue par ordonnance. Cette disposition va de soi. Il n’est pas nécessaire d’alourdir les procédures.
Mme la garde des sceaux a longuement évoqué l’article 1er, relatif à la conservation des scellés. Je serai donc bref sur ce point.
La conservation des scellés a un coût, c’est vrai. Dans certaines juridictions, des progrès restent à accomplir dans ce domaine. Même s’il s’agit d’un sujet important, ce n’est pas nécessairement un chantier prioritaire, il faut le reconnaître, compte tenu des nombreuses tâches à mener à bien. Certains avancent que les progrès des investigations scientifiques permettront à l’avenir de mener de nombreuses révisions. C’est possible ! Toutefois, je le répète, ce dossier n’est pas, pour l’heure, le plus important, même si la présente proposition de loi apporte, en la matière, des améliorations, que vous avez vous aussi saluées.
J’indique simplement que la systématisation de l’enregistrement sonore des débats des cours d’assises engendrera une masse considérable de fichiers. Cette mesure est sans doute indispensable. Peut-être pourra-t-elle être mise en œuvre progressivement. Sans doute trouverez-vous des solutions par redéploiement, si tant est qu’il y ait des crédits à redéployer dans le budget de la justice !
Sourires.

L’article 3 renforce par ailleurs les droits des requérants. Notre commission a notamment lié l’assistance et la représentation par un avocat, toutes deux désormais obligatoires, pour que les actes de la procédure soient bien effectués par celui-ci. Elle a renforcé les pouvoirs d’investigation de la CIDRE et de la formation de jugement de la Cour de révision. Elle a enfin confié la compétence de suspension de la condamnation à la seule chambre criminelle. Ce sont là des dispositions importantes.
S’y ajoutent les dispositifs repris via la nouvelle procédure de révision, qui pourront, bien entendu, faire eux aussi l’objet de débats. Je songe notamment au « fait nouveau » ou « élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ».
Mes chers collègues, souvenez-vous du débat que le Sénat avait consacré à l’expression « doute sérieux ». Certains d’entre nous y avaient pris part. Le président de la commission des lois l’a rappelé, sur la proposition de Michel Dreyfus-Schmidt, la Haute Assemblée avait fini par supprimer cette formule, au motif que, soit il y avait un doute, soit il n’y en avait pas.
Aujourd’hui, l’Assemblée nationale propose l’expression « moindre doute ». Je n’entrerai pas dans ce débat linguistique et juridique. Je précise simplement que, dans les faits, les circonstances permettant la révision du procès restent inchangées. Peut-être la continuité de la jurisprudence de la Cour de révision permettra-t-elle de déterminer avec plus de précision s’il existe un doute plus ou moins grand. Quoi qu’il en soit, je soutiens la position de la commission, qui refuse les termes de « moindre doute ».
Il faut également prendre en compte d’autres aspects non négligeables, comme la réparation intégrale des condamnations injustifiées et la publicité des décisions. Ces dispositions sont, elles aussi, indispensables.
Déposée par nos collègues députés, améliorée par la commission des lois du Sénat et par son rapporteur, cette proposition de loi obtiendra, j’en suis sûr, le soutien de la grande majorité des membres de la Haute Assemblée. En tout cas, elle emporte l’adhésion de ceux du groupe UMP !
Applaudissements.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, il faut avant tout constater que la révision des condamnations pénales reste d’une rareté extrême.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1989, qui résultait, comme le texte qui nous est soumis cette après-midi, de l’initiative parlementaire, seules neuf condamnations criminelles ont été révisées. Neuf révisions seulement en vingt-cinq ans ! On peut s’en féliciter. Toutefois, il est permis de douter qu’il n’y ait eu, dans notre pays, que neuf erreurs judiciaires en un quart de siècle.
En réalité, on le sait, plusieurs obstacles s’opposent à la mise en œuvre de la procédure de révision. La présente proposition de loi apporte de nombreuses améliorations à ces procédures, par l’instauration d’une juridiction unique chargée indifféremment des demandes en révision et en réexamen. En matière de révision, le présent texte apporte également des modifications, par le renforcement des conditions d’exercice de ce recours.
Une étape importante a été franchie en 1989. La loi alors adoptée a, d’une part, judiciarisé l’intégralité de la procédure, et, d’autre part, affirmé très clairement le principe selon lequel la révélation d’un fait nouveau ou d’un élément inconnu au jour du procès peut être prise en compte non seulement lorsqu’elle démontre l’innocence, mais aussi lorsqu’elle fait naître un doute sur la culpabilité. Tous les orateurs qui viennent de se succéder à cette tribune l’ont souligné, c’est là un progrès considérable.
Globalement, il faut bien le reconnaître, depuis les premiers textes datant du début du XIXe siècle jusqu’à la dernière loi, adoptée en 2000, laquelle renforce la protection de la présomption d’innocence, la procédure de révision a été continuellement élargie.
La présente proposition de loi, inscrite à l’ordre du jour du Sénat sur l’initiative du RDSE, est issue du travail de qualité effectué par les députés Georges Fenech et Alain Tourret.
Pourtant, la tâche est plus délicate qu’il n’y paraît au premier abord. Il convient en effet de concilier deux impératifs contraires, mais inhérents au fonctionnement même de notre système judiciaire : d’un côté, le souci de la vérité, c’est-à-dire cette impérieuse nécessité de lutter contre l’erreur judiciaire et de savoir la réparer lorsqu’elle survient, ce qui n’est pas simple ; de l’autre, le respect de l’autorité de la chose jugée.
Nous, législateurs et démocrates, le savons bien : une fois que la justice s’est prononcée sur le sort d’un accusé ou d’un prévenu, l’autorité de la chose jugée constitue un principe essentiel au maintien de l’ordre juridique. C’est un pilier essentiel de l’État de droit, mais aussi une garantie de la paix sociale.
Cependant, dans certains cas, ce principe ne peut être invoqué par les magistrats comme un obstacle au réexamen d’une affaire, car il n’est pas de pire injustice que de voir un innocent en prison. C’est de la capacité de notre système judiciaire et de notre devoir de législateur de reconnaître et de réparer nos propres erreurs et nos défaillances, qu’elles soient ou non imputables à un juge, à un enquêteur ou à un fait extérieur. Cet enjeu est essentiel : de ce dispositif dépend la confiance que chacun de nos concitoyens place dans la justice de notre pays.

Nous souscrivons donc sans réserve au constat dressé par les auteurs de cette proposition de loi, quant à la nécessité, également soulignée chaque année dans les rapports de la Cour de cassation, de réformer la procédure actuelle dans un sens favorable aux victimes d’erreurs judiciaires.
Le principal apport de cette proposition de loi, c’est la création d’une juridiction unique de révision et de réexamen.
Aujourd'hui, trois organes de révision coexistent – je n’y reviendrai pas. La création d’une cour unique présente à ce titre plusieurs avantages.
Premièrement, elle ne remet pas en cause la pertinence de la distinction entre le recours en révision et le recours en réexamen consécutif au prononcé d’un arrêt de la CEDH.
Deuxièmement, dans un souci d’impartialité, elle permet de mieux séparer le stade de l’instruction et celui du jugement, en distinguant deux formations.
Troisièmement, garantir l’effectivité du recours en révision, c’est donner à la justice les moyens d’instruire les demandes en révision tout en veillant à encadrer suffisamment ces nouveaux droits dans le respect du contradictoire.
Dans les faits, la Cour de cassation se heurte aujourd’hui à de nombreux obstacles, lorsqu’elle est chargée d’instruire les demandes en révision de nature criminelle. À cet égard, le présent texte comprend des mesures de bon sens, permettant de lever certains d’entre eux. Je pense notamment à la systématisation de l’enregistrement sonore des débats.
Notre rapporteur, Nicolas Alfonsi, a accompli un travail très important sur le texte qui nous est parvenu de l’Assemblée nationale. Je tiens à mon tour à saluer la qualité du rapport qu’il a rédigé, ainsi que la pertinence des nombreux amendements qu’il nous a proposés en commission, lesquels ont été adoptés sans difficulté.
Néanmoins, j’insisterai sur l’une des modifications auxquelles nos débats de commission ont été consacrés : il s’agit de la notion de « doute ».
Dans notre droit positif, le fait nouveau ou l’élément inconnu doit être « de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ». Le texte adopté par les députés indique, quant à lui, que le fait nouveau ou l’élément inconnu est « de nature à établir l’innocence du condamné, ou à faire naître le moindre doute sur sa culpabilité ».
Il s’agit évidemment de propositions tout à fait différentes, même si les nuances peuvent paraître mineures. Nous avons précisément souhaité les examiner de près, et notre commission des lois a considéré, à juste titre, que l’expression « moindre doute » n’était pas satisfaisante d’un point de vue juridique et a donc adopté un amendement de notre rapporteur tendant à supprimer le mot « moindre ».
L’alternative est élémentaire : il y a un doute ou il n’y en a pas. Le « moindre doute » n’existe pas en matière pénale.
Avec l’ajout de cet adjectif, nos collègues députés avaient probablement souhaité inciter les magistrats à se montrer moins sévères qu’ils ne sont supposés l’être actuellement dans leur appréciation du doute. Au contraire, il nous paraît préférable de les laisser décider souverainement si le fait nouveau fait naître ou non un doute dans leur esprit quant à la culpabilité du condamné.
Ainsi, mes chers collègues, ces précisions étant ajoutées, le groupe UDI-UC votera cette proposition de loi, qui procède d’une évolution nécessaire des procédures de révision et de réexamen, en espérant que les apports importants du Sénat soient préservés et figurent effectivement dans le texte qui sera définitivement adopté par le Parlement.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du RDSE, du groupe socialiste et du groupe écologiste.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, il est bon parfois de se souvenir que l’infaillibilité n’est pas dans la nature humaine.
Pour cette raison, il est nécessaire que tout système trouve en lui-même ses propres correctifs. Les procédures de révision et de réexamen des condamnations pénales définitives, qui font l’objet d’une réforme dans la présente proposition de loi, font partie de ces correctifs multiples prévus par notre législation.
Notre système juridique prévoit en effet depuis bien longtemps des procédures destinées à pallier les dysfonctionnements ou les erreurs de la justice. Un encadrement strict de ces procédures nécessaires permet de ne pas porter une atteinte disproportionnée au principe de l’autorité de la chose jugée.
Ce principe du droit donne « force de vérité légale », selon la formule d’Henri Capitant, à une décision de justice devenue définitive par l’épuisement des voies de recours. Comme notre rapporteur l’a souligné, l’autorité de la chose jugée est la condition de l’extinction des litiges, de la paix sociale et de la stabilité de l’ordre juridique. Tout ceci participe de la confiance dans la justice, qui, une fois qu’elle s’est prononcée, ne peut indéfiniment être remise en cause.
Ce principe posé, il ne faut néanmoins pas oublier que cette confiance passe également par la capacité du système judiciaire à rectifier et à réparer une erreur judiciaire ou, plus généralement, un dysfonctionnement. J’emploie ici le terme « erreur » au sens large, si je puis dire, car toute décision dommageable ne procède pas nécessairement d’un manquement ou même d’une faute. Sans qu’il y ait manquement d’un magistrat, des éléments nouveaux ou inconnus au moment de la décision peuvent en effet apparaître et renverser les éléments de preuve initialement retenus.
La législation française, tout comme celles des autres pays européens, n’accepte donc pas, heureusement, qu’une erreur de fait ou de droit – monsieur le président de la commission, je n’ajouterai pas ici d’adjectif qualificatif ! §–, imputable ou non à un juge, soit ignorée au nom de l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’elle est de nature à faire douter de la culpabilité du condamné. Preuve que c’est non pas seulement au moment de la décision, mais aussi après, durant l’exécution de cette dernière, que le doute doit profiter à l’accusé.
Aujourd’hui, cependant, le constat du caractère restrictif de la procédure de révision et du problème d’intelligibilité et d’accessibilité des deux procédures a permis de dégager un consensus au sein des professionnels du droit et des élus sur la nécessité d’en modifier les dispositions.
La Cour de cassation, dans ses rapports annuels, appelle de ses vœux une réforme du système actuel. De même, les cinquante personnes auditionnées dans le cadre de la mission d’information menée par nos collègues députés ont indiqué de façon presque unanime qu’il était nécessaire de changer la législation.
Si cette réforme est bienvenue, mes chers collègues, elle doit s’efforcer de respecter l’équilibre entre, d’une part, la nécessité de réparer l’erreur judiciaire, et, d’autre part, l’exigence de ne pas remettre abusivement en cause la chose jugée. En se gardant justement d’ébranler l’autorité de la chose jugée ou de créer un troisième degré de juridiction – c’était un risque –, cette proposition de loi respecte, à mon sens, cet équilibre.
Ainsi, la refonte de l’architecture globale de l’examen des demandes tendant à revenir sur une décision pénale définitive, l’élargissement de la liste des personnes fondées à agir et la clarification des droits des parties ne peuvent être que bénéfiques.
La proposition de loi n’oublie pas de créer les conditions matérielles nécessaires à la recherche de la vérité judiciaire, en réformant la durée de conservation des scellés criminels et en systématisant l’enregistrement sonore des débats en cours d’assises. Nous reconnaissons la pertinence de l’ensemble de ces modifications.
Parce que le sujet n’est pas simple, comme toujours lorsque la loi que nous créons est susceptible d’avoir un impact direct sur les libertés individuelles, la discussion en séance nous permettra certainement d’approfondir plusieurs points.
Un débat intéressant en commission nous a déjà permis de nous accorder sur l’inutilité de qualifier le doute sur la culpabilité de l’accusé créé par le fait nouveau ou l’élément inconnu.
En effet, la commission des lois, sur l’initiative de notre rapporteur, a choisi de revenir sur la notion de « moindre doute » votée à l’Assemblée nationale. Cette notion était destinée à inciter les magistrats à apprécier plus largement le doute. Notre commission a opportunément préféré laisser à ces derniers une liberté d’appréciation, en évitant de le qualifier.
Si je partage l’objectif de plus grande ouverture des recours visé par nos collègues députés, je pense aussi qu’il vaut mieux laisser une certaine liberté d’appréciation aux magistrats quant aux dossiers qui leur sont soumis. Rien ne leur interdira de considérer que tout doute, toute incertitude sur la culpabilité d’un condamné doit pouvoir ouvrir à ce dernier la voie d’un nouveau procès. Dès lors, ce qualificatif semble effectivement inutile.
Nous nous apprêtons à discuter d’un certain nombre d’amendements, dont certains ont pour objet d’ouvrir encore un peu plus les conditions du recours en révision, et nous serons bien entendu attentifs à l’ensemble des arguments qui seront évoqués.
En attendant, en l’état, nous voterons ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, à six reprises depuis le règne de Louis XIV, le législateur a cherché une voie étroite pour lutter efficacement contre les erreurs judiciaires, tout en évitant de faire de la révision un troisième degré de juridiction.
Il est en effet juste, dans un État de droit, de prévoir une procédure exceptionnelle, permettant de revenir sur l’autorité de la chose jugée, lorsqu’elle a pour but de faire triompher la vérité ou d’assurer les droits fondamentaux.
C’est donc une nouvelle page de l’histoire de la justice qui s’écrit aujourd’hui, d’une justice plus respectueuse de la présomption d’innocence, mais également de l’innocence elle-même, lorsqu’elle est injustement bafouée.
Je souhaite tout d’abord saluer l’initiative de la commission des lois de l’Assemblée nationale de confier, en juillet 2013, pour la première fois au cours de cette législature, à un avocat, le député Alain Tourret, et à un magistrat, le député Georges Fenech, de sensibilités politiques différentes, une mission d’information sur la révision des condamnations pénales.
À partir d’une cinquantaine d’auditions de hauts magistrats de la Cour de cassation, d’avocats, de chercheurs, de juristes, de sociologues, de condamnés réhabilités, de victimes, d’experts scientifiques, ainsi que de nombreuses contributions et de l’expertise des deux corapporteurs, la mission d’information a rédigé en décembre 2013 un important rapport. Celui-ci inspire très directement cette proposition de loi, déposée par Alain Tourret et plusieurs de ses collègues membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste de l’Assemblée nationale.
Ces travaux parlementaires, dépassionnés de tous faits divers et dépaysés de tout sectarisme, ont ainsi permis de trouver un consensus sur une réforme législative réclamée par la Cour de cassation elle-même au fil de ses rapports annuels.
Que nous disent les statistiques ? Elles sont éloquentes : sur les 3 358 demandes dont a été saisie la commission de révision, seules 84 ont été adressées à la cour de révision. Quelque 9 condamnations criminelles seulement, et 43 condamnations correctionnelles ont été annulées.
Notre collègue Jean-Jacques Hyest le rappelait, les statistiques du deuxième degré de juridiction créé en matière criminelle par la loi de 2000 indiquent, par comparaison, que de 2003 à 2005 quelque 1 262 personnes ont été jugées en appel d’une condamnation criminelle, dont 64 ont finalement été acquittées. On mesure ainsi l’ampleur de l’angle mort : 9 révisions, contre 64 acquittements en appel en trois ans, en matière criminelle !
Notre commission des lois a, pour l’essentiel, approuvé la réforme législative que nous examinons aujourd’hui en séance publique et qui tend à réformer la procédure de révision afin d’améliorer les chances d’aboutir de ces requêtes, lorsqu’elles sont justifiées.
Je voudrais, après le président de la commission des lois, relever l’importance de la création de cette nouvelle juridiction unique de révision et de réexamen, dont la composition est déterminée par la loi, ainsi que le souhaitait la CEDH, de la clarification des attributions de la commission d’instruction et de celles de la cour de révision et de réexamen, ainsi que des dispositions offrant une définition plus précise du droit des parties dans la procédure.
Au nom du groupe socialiste, je tiens également à saluer l’important travail de cohérence rédactionnelle réalisé par notre rapporteur, notamment à l’article 3 de la proposition de loi, proposant une meilleure lecture du texte. Il a permis de bien distinguer successivement les demandes en révision ; la composition de la cour de révision et de réexamen ; la procédure, avec pour la première fois, à la suite d’un amendement du rapporteur, la généralisation de l’assistance à l’audience par un avocat ; la décision de la cour de révision et de réexamen ; les demandes de suspension ; les demandes d’actes préalables ; enfin, les modalités de réparation à raison d’une condamnation.
Nous arrivons maintenant à ce moment de bravoure qu’est la question de l’appréciation du doute.
Madame la garde des sceaux, j’ai suivi la même démarche que vous : je me suis penché sur le compte rendu des travaux en séance de l’Assemblée nationale. Un passage est particulièrement intéressant, qui date du 27 février dernier. Le député Tourret pose la question suivante : « Quel doute pour quel fait nouveau ? Quelle notion retenir, celle de doute raisonnable, de doute sérieux ? ». Lors de la réforme de 1989, notre regretté collègue Michel Dreyfus-Schmidt – il le cite lui aussi – avait, à juste titre, déposé un amendement, adopté par le Sénat, visant à supprimer l’adjectif « sérieux » dans la qualification du doute.
En février dernier, nos collègues députés n’ont pas souhaité supprimer la qualification du doute. Je cite à nouveau le rapporteur Tourret : « Nous n’avons pu que constater que la jurisprudence, ne tenant pas compte de la volonté du législateur, s’appliquait toujours à imposer un doute sérieux, quand elle ne demandait pas à la personne jugée de dire qui était le véritable coupable. Comment s’étonner, dès lors, qu’il n’y ait pas de révision ? Nous avons choisi la notion du moindre doute. »
Je ne partage pas cette analyse et je continue à considérer, avec M. le rapporteur et la majorité des membres de la commission des lois, qu’il est inopportun de qualifier le doute. Je pense que nos travaux en séance publique seront suffisamment clairs en la matière, et nous pourrons donc nous en remettre avec confiance à la Cour de cassation.
À cet égard, la clarification proposée des attributions de la commission d’instruction évite les doublons et l’autocensure quant à la qualification du doute ; c’est un point important. Mme Anzani, ancienne présidente de la Commission de révision des condamnations pénales, la future commission d’instruction, en atteste. À ce stade, on constate une autocensure des magistrats, de peur de voir les mêmes faits qualifiés différemment par la Cour de révision. La procédure proposée par la commission des lois est donc susceptible de réduire les discussions sur la nature du doute.
Pour terminer, mes chers collègues, permettez-moi d’insister rapidement sur deux points.
Tout d’abord, je veux souligner que mon collègue Jean-Pierre Michel, retenu aujourd'hui dans son département, est satisfait de voir que la question des scellés est traitée ici, même si elle ne concerne que les scellés criminels. Le 1er août 2013, celui-ci avait d’ailleurs déposé une proposition de loi sur ce sujet. Lors de la discussion des amendements, nous essaierons d’avancer encore en la matière.
Si l’appel d’un arrêt de la cour d’assises a constitué un progrès colossal, la généralisation des enregistrements sonores des débats d’une cour d’assises qui nous est proposée, suivant en cela les préconisations des députés – vous avez bien fait de laisser les parties concernées décider du recours à l’enregistrement audiovisuel – marque, elle aussi, un progrès indéniable. L’air de rien, cette mesure sera également de nature à favoriser un réexamen en cas de doute.
Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe socialiste – vous attendez tous, mes chers collègues, de connaître notre position, avec une angoisse à peine dissimulée ! §…
Nouveaux sourires.

… pense que les dispositions prévues dans ce texte sont de nature à donner vie – enfin ! – au principe posé par la loi du 23 juin 1989, en substituant le doute sur la culpabilité à la certitude de l’innocence.
Par conséquent, nous voterons cette proposition de loi avec beaucoup d’enthousiasme. §

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la justice humaine est imparfaite ; elle se trompe. Et comme elle est humaine, elle a infiniment de mal à reconnaître ses erreurs. Pourtant, quoi de plus insupportable qu’un innocent condamné ?
L’erreur judiciaire au pénal est une tragédie pour tous les acteurs de la procédure : celui qui en est victime et ses proches, bien sûr, mais aussi les juges, les enquêteurs et les avocats.
Ce sont des innocents détenus, parfois pendant des années, pour des faits qui leur sont étrangers. D’ailleurs, l’actualité assez récente nous en a donné des exemples particulièrement frappants.
Ce sont des proches détruits par une procédure judiciaire lourde, aux reflets parfois kafkaïens : des formalités interminables pour obtenir un permis de visite, des parloirs difficiles d’accès et parfois interdits aux familles... Chaque fois, la justice se trouve éclaboussée et remise en cause dans son professionnalisme, sa vérité ; la vie d’un innocent, ainsi que celle de sa famille, est irrémédiablement blessée.
Face à ce qui est toujours une tragédie, la procédure de révision constitue le cinquième et dernier acte – l’acte final qui doit permettre de trancher ce nœud gordien.
En matière de révision, les garanties de l’individu n’ont cessé d’avancer par à-coups, au gré des scandales judiciaires qui ont secoué et embrasé l’opinion. Par exemple, l’affaire dite « du courrier de Lyon » a entraîné la loi de 1867, qui a instauré la révision après décès et la révision sans renvoi.
Sous la IIIe République, les affaires Borras et Vaux, contemporaines de l’affaire Dreyfus, furent à l’origine de la loi du 8 juin 1895, qui permit la révision pour fait nouveau et offrit la possibilité au condamné innocenté de demander réparation à l’État.
Plus proche de nous, l’affaire Seznec a donné lieu à la réforme de 1989, qui a élargi l’ouverture au « doute sur la culpabilité du condamné » à la suite d’une extraordinaire campagne de presse. Pourtant, depuis cette dernière réforme majeure, il est significatif de constater – certains de mes collègues l’ont rappelé – que seules neuf condamnations criminelles ont été révisées.
À cet égard, les chiffres sont éloquents. Permettez-moi de vous les rappeler. Chaque année, environ 150 condamnés saisissent la cour de révision. En vingt ans, près de 3 000 condamnés ont ainsi demandé l’annulation de leur condamnation. Parmi eux, la commission a estimé que seuls 75 dossiers transmis à la Cour de révision répondaient aux critères.
Au final, la Cour de révision a annulé 45 condamnations, y compris celles qui sont délictuelles, soit 1, 5 % des demandes, ce qui peut d'ailleurs se concevoir, comme l’ont souligné certains de mes collègues. Parmi elles, huit seulement concernaient des affaires criminelles ; trois condamnations ont été annulées et les personnes concernées sont actuellement en attente de procès. Dans le même temps, la demande de certains condamnés a été rejetée par la Cour de révision ; je ne reviendrai pas sur certaines affaires célèbres.
À n’en pas douter, il s’agit d’un signe du bon fonctionnement de notre système judiciaire, qui repose, à la différence des systèmes judiciaires anglo-saxons, sur la procédure inquisitoire. Enquête au préalable approfondie, recherche exhaustive de la vérité, prise en compte scientifique des éléments collectés, communication de tout le dossier à la défense, preuve libre, intime conviction encadrée, second degré de juridiction : la procédure inquisitoire paraît, en effet, mieux protéger les innocents que ne le fait la procédure accusatoire, chère aux Anglo-Saxons.
Toutefois, il s’agit également d’un signal quant à la nécessité d’améliorer la procédure de révision, son accès, son organisation, ses moyens d’information, afin de nous prémunir, autant que faire se peut, contre toutes les erreurs judiciaires. Récemment, l’affaire Nelly Haderer a ému le grand public. Des traces d’ADN du principal suspect, définitivement acquitté en 2008, au cours d’un troisième procès, ont été identifiées, avec les conséquences que l’on peut imaginer.
Ce n’est pourtant pas la réaction immédiate, forcément émotionnelle et parfois irréfléchie, qui doit guider la réflexion sur la procédure de révision. Cette dernière doit être particulièrement encadrée, au nom de la sécurité juridique, et rester une voie d’exception.
Le législateur que nous sommes doit parfois faire le choix de la sagesse et de la mesure, au risque d’être, dans un premier temps, incompris, en dépit du mouvement naturel qui nous pousse à nous révolter contre les injustices.
Aujourd’hui, parce que, comme l’écrivait François Mauriac, « la civilisation d’un peuple se mesure à sa justice », je souhaite saluer l’initiative du député radical de gauche Alain Tourret et de ses collègues du groupe RRDP, c'est-à-dire radical, républicain, démocrate et progressiste, ainsi que du député Georges Fenech, une initiative qui est le fruit d’un long travail minutieux et qui a permis de dégager les enjeux de la réforme de notre procédure de révision.
Il est remarquable de noter, en ces temps particuliers où l’opinion du plus grand nombre fait la loi, où les faits divers sont sans cesse érigés en exemples de l’insuffisance de la loi pénale, que cette proposition de loi est non pas une loi de circonstance, mais un texte issu de la réflexion du législateur et de la concertation des divers acteurs de la justice. De nombreuses auditions ont été organisées et un travail important de réflexion a été engagé.
À cet égard, permettez-moi de saluer le travail de notre collègue Nicolas Alfonsi, qui représente, je tiens à le lui dire aujourd'hui, la quintessence de l’intelligence parlementaire.
Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe écologiste.

Le texte procède à une réforme globale des procédures de révision et de réexamen, à la fois proportionnée, nécessaire et respectueuse des grands principes de notre droit pénal.
D’autres intervenants l’ont souligné, la question des scellés constitue une avancée ; il reste, madame la garde des sceaux, à trouver les moyens – ce n’est pas forcément facile ! – de mettre en place une organisation face à la demande qui en découlera. Il en est de même pour la systématisation de l’enregistrement sonore des débats des cours d’assises.
Certaines erreurs judiciaires sont révélées des décennies après les faits. Qui ne se souvient de l’affaire Dils, commencée en 1986 et qui fut conclue peu ou prou en 2002, avec l’acquittement en appel de Patrick Dils et le début du procès de Francis Heaulme ? Il deviendra plus aisé, au cours de l’examen de la demande en révision, de statuer sur le fait nouveau ou l’élément inconnu au jour du procès qui la fonde.
Plus directement liés aux procédures de révision et de réexamen, la création d’une instance unique, la cour de révision et de réexamen, la codification des pouvoirs de cette cour de révision, le renforcement des droits de la partie civile et du condamné, la possibilité pour les parties de se faire communiquer le dossier, la possibilité pour le requérant de demander, préalablement au dépôt d’une demande en révision et au cours de l’instruction de son affaire, de faire procéder à tous les actes qui lui semblent nécessaires et l’élargissement de la liste des requérants autorisés à former un recours en révision ou en réexamen constituent autant de minutieuses avancées procédurales, qui permettront à notre système judiciaire de garantir l’efficacité des procédures de révision et de réexamen.
Les modifications procédurales contenues aujourd’hui dans cette proposition de loi marquent ainsi de véritables avancées pour notre justice, si forte et si faillible à la fois.
C’est pourquoi le groupe RDSE votera sans aucune réserve et avec conviction le texte proposé par les députés et amendé avec soin par le rapporteur Nicolas Alfonsi, une proposition de loi que nous avons inscrite à l’ordre du jour de l’espace réservé de notre groupe.
Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste . – M. Yves Détraigne applaudit également.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le droit positif en matière de révision des condamnations pénales a pu, par certains aspects, se révéler inadapté aux réalités judiciaires ou encore être en marge de certaines avancées notables en matière de protection des droits et libertés fondamentaux.
Oscillant entre la nécessaire autorité juridique associée aux décisions de justice – qui plus est, celles qui portent condamnation pénale à l’encontre de personnes physiques –, et le risque, fort heureusement minime, mais ô combien insupportable, de l’erreur judiciaire, le droit à la révision d’un procès doit pourtant suivre l’évolution des époques.
Au début de la Ve République, quelquefois en outre-mer, certaines condamnations pénales ont malheureusement pu laisser planer un doute sur l’indépendance ou l’impartialité de la juridiction ayant prononcé la condamnation. Je fais ainsi directement référence, vous l’aurez compris, mes chers collègues, à cette célèbre formule du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des recherches historiques sérieuses ont montré que ce fut le cas de la condamnation criminelle de feu Pouvanaa Oopa, père du nationalisme polynésien, au sens noble du terme, ancien député de la Polynésie française lors de son arrestation de 1958, puis élu sénateur de la Polynésie française de 1971 à 1977, c'est-à-dire à son retour d’exil forcé.
J’y mets une empathie certaine, car, en plus d’avoir été mon illustre aîné au sein de la Haute Assemblée, je fais référence, à ma connaissance, au seul sénateur de notre histoire pour lequel la Chancellerie est saisie d’une demande de révision de procès, laquelle fait d’ailleurs l’unanimité de la classe politique polynésienne, ce qui n’est pas souvent le cas, vous en conviendrez, mes chers collègues.
Sourires.

À cet égard, je profite de ma présence à la tribune pour vous remercier de l’annonce publique que vous avez faite en février dernier, madame la garde des sceaux, en vue d’avancer de manière significative dans ce dossier de révision affectant toute la Polynésie française, sous l’empire des dispositions nouvelles que nous examinons aujourd’hui.
Cette première observation faite, permettez-moi d’ores et déjà, mes chers collègues, de poser ici le cadre des deux seuls amendements que j’ai déposés, à l’article 3 de la proposition de loi.
Certaines archives couvertes par le secret-défense, qui n’ont pu être consultées par les historiens, peuvent également contenir des éléments de preuve supplémentaires révélant des pressions politiques exercées sur la cour qui a prononcé la condamnation.
Il importe donc que l’introduction de la demande de révision d’une condamnation pénale tienne compte des manquements avérés à l’indépendance ou à l’impartialité de la cour qui a prononcé la condamnation en dernier ressort.
Le droit national serait ainsi mis en conformité avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, qui pose les exigences du procès équitable.
De plus, certaines demandes de révision d’une condamnation pénale peuvent intervenir longtemps après le prononcé de la condamnation.
La proposition de loi qui nous est soumise ouvre le droit de révision aux enfants et petits-enfants du condamné. Or, dans certains cas, les faits nouveaux peuvent être mis au jour dans des délais beaucoup plus longs, notamment lorsque les faits en question apparaissent dans des documents couverts par la législation sur les archives, éventuellement après que s’est écoulé le temps de trois ou quatre générations.
C’est ce qui m’a conduit à déposer un amendement tendant à ce que la demande de révision puisse être introduite par les ayants droit de la troisième génération, c'est-à-dire les arrière-petits-enfants de la personne condamnée.
Enfin, il peut arriver que certaines condamnations aient fait l’objet d’une publicité importante, dans un contexte politique ou militaire reconnu, portant ainsi atteinte à la mémoire ou à la réputation du condamné ou aux intérêts moraux et patrimoniaux de sa famille. Il serait souhaitable que, dans un tel cas, la procédure de révision d’une condamnation pénale puisse bénéficier d’une publicité d’égale ampleur. Il ne me paraîtrait absolument pas choquant que, à l’occasion de travaux parlementaires ultérieurs, une ouverture puisse se faire en ce sens.
Pour conclure, je tiens ici à saluer cette initiative de nos collègues de l’Assemblée nationale, qui tombe véritablement à point nommé. Je la voterai donc, avec les membres de mon groupe.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
(Non modifié)
L’article 41-4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, lorsqu’une procédure s’est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d’assises, le procureur de la République ou le procureur général qui envisage d’ordonner la remise au service des domaines ou à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, ou la destruction des objets placés sous main de justice dans le cadre de cette procédure en avertit au préalable par écrit le condamné. Celui-ci dispose, à compter de la notification de cet avertissement, d’un délai de deux mois pour lui faire part de son opposition éventuelle. En cas d’opposition, si le procureur de la République ou le procureur général n’entend pas renoncer à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice, il saisit par voie de requête la chambre de l’instruction, qui se prononce dans un délai d’un mois. Dans les cas mentionnés au présent alinéa, le procureur de la République ou le procureur général réexamine tous les cinq ans, dans les mêmes formes, l’opportunité de procéder à la remise ou à la destruction des objets placés sous main de justice. »

L'amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Après l’article 41-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-6 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
Par dérogation aux alinéas précédents
par les mots :
Art. 41 -6 . – Par dérogation aux articles 41-4 et 41-5
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Je me suis déjà expliquée tout à l’heure à la tribune sur cet amendement, qui concerne la destruction des scellés. Il s’agit d’un amendement de coordination entre le présent texte et le texte d’habilitation relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Il convient en effet de tenir compte d’une décision QPC du Conseil constitutionnel en date du 11 avril 2014 par laquelle a été censuré le dernier alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, auquel la présente proposition de loi renvoyait.
Par ailleurs, l’Assemblée nationale a adopté, dans le projet de loi de modernisation et de simplification, des dispositions visant l’article 41-5 du code de procédure pénale.
Nous proposons donc la création d’un article 41-6 dans ledit code, afin d’introduire les dispositions prévues par ce texte pour les scellés.

La commission n’a pas pu examiner cet amendement.
Je rappelle que des circulaires du ministère datant, me semble-t-il, de 2010 et 2011, soit avant que ce texte ne soit déposé, avaient anticipé le problème de la conservation des scellés. J’avoue d’ailleurs avoir été quelque peu perturbé en découvrant, à la lecture d’un article du journal Le Monde, que l’Assemblée nationale délibérait sur le même sujet. J’ai donc pensé qu’il y aurait sans doute quelques corrections à apporter. C’est, madame la garde des sceaux, ce que vous faites à travers cet amendement de coordination et d’anticipation, auquel je suis personnellement favorable.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 3, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
cour d’assises,
insérer les mots :
ou par un tribunal correctionnel pour un délit puni d’au moins sept ans d’emprisonnement,
La parole est à M. René Vandierendonck.

Il ne paraît pas cohérent de réformer la procédure de révision des condamnations pénales en matière de crimes et de délits sans, dans le même temps, étendre aux délits les plus graves les modifications des règles de conservation des scellés, d’autant que le phénomène de correctionnalisation aboutit à qualifier de délits un certain nombre d’actes.
C’est pourquoi, en retenant un quantum de peine assez élevé – les délits punis d’au moins sept ans de prison –, nous demandons que la dérogation visée à cet article concerne également les peines les plus lourdes prononcées par un tribunal correctionnel.
Je souhaiterais, en tout cas, connaître la position de Mme la garde des sceaux sur cette question.

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
J’y étais, à titre personnel, opposé, anticipant sans doute les propos que vous avez tenus à la tribune, madame la ministre, sur l’augmentation du nombre de demandes qui ne manquera pas de survenir si nous étendons la conservation des scellés aux délits punissables de sept ans d’emprisonnement, et sur le coût en résultant.
Je comprends la préoccupation de l’auteur de cet amendement, qui redoute que la correctionnalisation de certaines affaires, notamment dans le domaine sexuel, soit de nature à faire disparaître beaucoup de scellés.
Mais il faut aussi songer aux problèmes que pourrait poser cette mesure en termes d’administration de la justice. Les délits punissables d’une peine de sept ans d’emprisonnement étant tout de même très nombreux, on peut craindre notamment que les procureurs ne soient assaillis de milliers de demandes.
La commission s’est néanmoins prononcée en faveur de cet amendement.
Nous comprenons parfaitement votre préoccupation, monsieur Vandierendonck. Sur le principe, il est en effet difficile d’admettre que soient exclues du dispositif les condamnations à sept ans de prison et plus prononcées par un tribunal correctionnel.
Toutefois, je ne vous cache pas qu’une telle mesure aurait, elle aussi, comme l’enregistrement systématique des audiences de cour d’assises, des effets importants. De fait, si les cours d’assises rendent environ 3 000 décisions par an, ce sont 50 000 décisions rendues par les tribunaux correctionnels qui seraient concernées par l’ouverture du dispositif aux délits que vous visez dans cet amendement.
J’admets toutefois le caractère paradoxal de cet argument, car rejeter votre amendement reviendrait à mettre de côté un nombre important de décisions de justice, alors que nous voulons au contraire poser philosophiquement et éthiquement le principe d’une révision toujours possible. Et je rappelle que les condamnations correctionnelles peuvent faire l’objet d’une révision depuis la loi de 1867.
Dans l’immédiat, je vous suggérerai de retirer votre amendement, monsieur le sénateur, mais nous ne comptons pas en rester là. Vous vous souvenez sans doute que nous avons eu, ici même, voilà plusieurs mois, une discussion à ce sujet. Je m’étais alors engagée à réfléchir sur ces questions ; c’est chose faite. Un groupe de travail a été mis en place, qui devrait rendre ses conclusions prochainement. Nous aurons ensuite à prendre des décisions par voie de décret et de circulaire afin de rationaliser, comme je l’ai souligné précédemment, la gestion des scellés.
À l’aune, notamment, de la proposition de loi de Jean-Pierre Michel, que vous avez mentionnée tout à l’heure, je propose que nous retravaillions sur ces questions.
Pour ma part, j’ai en effet du mal à accepter que pour des motifs d’ordre essentiellement pécuniaire, nous renoncions à intégrer des décisions judiciaires dans le dispositif. Il reste que nous ne pouvons faire preuve de légèreté et ignorer les effets d’une telle mesure, car nous ne rendrions alors service ni aux justiciables, ni à la société, ni à l’institution judiciaire.
Sous le bénéfice de ces informations et de cet engagement, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.


Cet amendement vise à permettre à la partie civile d’être consultée sur la conservation des scellés.
Lors de mon entretien avec des représentants de l’Union syndicale des magistrats, on m’a en particulier fait valoir qu’une personne condamnée pouvait tout à fait avoir un intérêt à voir disparaître certaines pièces à conviction, dans la perspective d’une requête en révision, dès lors que la disparition de ces pièces serait de nature à faire naître ou renforcer le doute sur sa culpabilité. C’est d’autant plus vrai que le parquet, qui est en charge des scellés – nous aurons l’occasion de revenir sur ce point, madame la garde des sceaux –, n’est pas nécessairement celui qui a la connaissance la plus approfondie du dossier.
Ainsi, non sans vous avoir indiqué l’origine de ma démarche, je propose que la partie civile soit informée du sort des scellés.

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
C’est, me semble-t-il, abuser du parallélisme des formes que de considérer que, dès lors que l’on donne le droit aux condamnés de s’opposer à la destruction des scellés, il faudrait impérativement retrouver un équilibre en donnant un pouvoir équivalent à la partie civile. Or, à partir du moment où une condamnation définitive est intervenue, la partie civile est étrangère au procès en révision.
Peut-on vraiment imaginer une situation où la partie civile, ainsi placée sur un pied d’égalité avec le condamné, serait appelée à s’interroger pour savoir si celui-ci, faisant preuve d’un comportement particulièrement pervers, ne s’opposerait pas à la destruction des scellés dans la perspective d’une éventuelle révision au cours de laquelle la conservation de ces scellés pourrait lui être défavorable ? N’est-ce pas aller tout de même très loin ?
Dans ces conditions, il ne me semble guère opportun d’accroître la charge de travail du procureur. Car c’est bien lui qui demande l’autorisation de détruire les scellés. S’ils ne sont pas détruits, la chambre de l’instruction est saisie. Toute cette procédure représente pour les parquets et l’ensemble des services judiciaires des tâches dont on peut faire l’économie.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. L’hypothèse est en effet peu probable puisqu’il s’agira nécessairement d’une personne condamnée.
J’en profite pour exprimer très clairement l’approche du Gouvernement en matière de politique d’aide et d’accompagnement des victimes, et de gouvernance à cet égard. Nous pensons cette gouvernance en tant que telle : les victimes ont des droits. Dans le projet de réforme pénale qui vous sera soumis prochainement, ces droits seront rassemblés et renforcés.
Nous avons également pris un certain nombre de mesures en faveur des victimes en augmentant d’emblée de 25, 8 % le budget qui leur est consacré.
Nous avons également ouvert des bureaux d’aide aux victimes dans tous nos tribunaux de grande instance : cent bureaux ont ainsi été ouverts en une seule année.
Récemment, j’ai décidé d’expérimenter des dispositions intéressantes d’une directive européenne, qui portent notamment sur l’accompagnement individualisé des victimes, bien avant sa transposition obligatoire en décembre 2015.
Nous nous soucions donc beaucoup de l’accompagnement et de la prise en charge des victimes, de leurs droits et de leur protection. Je dirais presque que nous menons cette action de façon autonome, au regard de l’observation tout à fait pertinente que vient de faire M. le rapporteur. Nous ne devons pas réhabituer la société à ce parallélisme entre la victime, ou la partie civile, et la personne mise en cause, sauf à ce que notre institution judiciaire perde l’essentiel de sa dimension démocratique.


Il convient de faire la guerre aux adjectifs inutiles et, en l’occurrence, de supprimer l’adjectif « éventuelle ». En effet, dès lors que le condamné fait savoir son opposition, celle-ci n’est plus éventuelle. Il s’agit donc d’un amendement de bon sens.
Favorable également : cet amendement tend à améliorer le texte.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 6, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2, troisième phrase
Après le mot :
saisit
insérer les mots :
, dans un délai d'un mois,
La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Cet amendement tend à prévoir que le procureur de la République dispose d’un délai d’un mois pour saisir éventuellement la chambre de l'instruction.

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Quelle est, en résumé, la procédure ? Le procureur avertit le condamné de la destruction de scellés ; celui-ci dispose alors de deux mois pour s’y opposer ; le procureur de la République peut ensuite saisir la chambre de l’instruction, qui dispose d’un délai d’un mois pour répondre.
Cet amendement a pour objet de raccourcir le délai de réponse du procureur, au nom d’un parallélisme qui n’a pas de raison d’être : si le procureur n’agit pas pendant un mois, les scellés ne seront pas détruits.
Par conséquent, s’il était adopté, cet amendement serait source de difficultés pour les services, qui auraient à agir, comme un juge d’instruction en matière de mise en liberté provisoire, dans un délai assez bref et, de ce fait, à gérer leur calendrier avec des contraintes supplémentaires.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable, en invoquant exactement les mêmes raisons que celles que vient d’exposer M. le rapporteur.
L'article 1 er est adopté.
(Non modifié)
L’article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, les débats de la cour d’assises font l’objet d’un enregistrement sonore sous le contrôle du président. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l’audition ou la déposition de ces dernières fassent l’objet, dans les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel. » ;
2° À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « de révision de la Cour de cassation, devant la Cour de cassation saisie d’une demande en révision » sont remplacés par les mots : « d’instruction des demandes en révision et en réexamen, devant la cour de révision et de réexamen » ;
3° Au cinquième alinéa, la référence : « à l’article 623 (3°) » est remplacée par la référence : « au 4° de l’article 626-5 ».

L'amendement n° 16, présenté par M. Alfonsi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « devant la commission de révision de la Cour de cassation, devant la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « devant la cour de révision et de réexamen » ;
II. – Alinéa 5
Remplacer la référence :
par la référence :
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 2 est adopté.
I. – Le titre II du livre III du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Titre II
« DES DEMANDES EN RÉVISION ET EN RÉEXAMEN
« Chapitre I er
« Des demandes en révision et en réexamen
« Art. 622. – La révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsqu’après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.
« Art. 622-1. – Le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour le condamné, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la convention précitée ne pourrait mettre un terme. Le réexamen d’un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.
« Art. 622-2. – La révision et le réexamen peuvent être demandés :
« 1° Par le ministre de la justice ;
« 2° Par le procureur général près la Cour de cassation ;
« 3° Par le condamné ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal ;
« 4° Après la mort ou l’absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel.
« La révision peut en outre être demandée par les procureurs généraux près les cours d’appel. »
« Chapitre II
« De la cour de révision et de réexamen
« Art. 623. – La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la cour de révision et de réexamen. Celle-ci est composée de dix-huit magistrats de la Cour de cassation, dont le président de la chambre criminelle, qui préside la cour de révision et de réexamen. Les dix-sept autres magistrats sont désignés, par l’assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
« Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par trois de ses membres.
« Dix-sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé est désigné suppléant du président de la chambre criminelle.
« Art. 623-1. – La cour de révision et de réexamen désigne en son sein, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, cinq magistrats titulaires et cinq magistrats suppléants composant la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen. Cette dernière désigne en son sein un président. Les magistrats qui siègent au sein de la commission d’instruction et leurs suppléants ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen.
« Les treize autres magistrats composent la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, qui statue en révision ou en réexamen. La formation de jugement est présidée par le président de la chambre criminelle.
« Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la commission d’instruction et la formation de jugement.
« Ne peuvent siéger au sein de la commission d’instruction et de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour de révision et de réexamen, ont, au sein d’autres juridictions, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité du requérant.
« Chapitre III
« De la procédure suivie devant la cour de révision et de réexamen
« Art. 624. – La demande en révision ou la demande en réexamen est adressée à la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen, qui se prononce sur sa recevabilité.
« Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la commission ou son délégué peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.
« La commission peut ordonner l’exécution d’un supplément d’information confié à l’un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues par le présent code, à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande, à l’exception de l’audition de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
« Après avoir recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l’instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat, le requérant ou son avocat ayant la parole le dernier, la commission saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen si la demande lui paraît recevable.
« La commission statue par une décision motivée non susceptible de recours. Cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique.
« Art. 624-1. – Lorsque la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d’une demande en réexamen, son président statue par ordonnance. Il saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes formées dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article 622-3 pour lesquelles il constate l’existence d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme établissant une violation de la convention applicable au condamné.
« Art. 624-2. – Lorsque la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d’une demande en révision en application de l’article 622, elle prend en compte l’ensemble des faits nouveaux ou des éléments inconnus sur lesquels ont pu s’appuyer une ou des requêtes précédemment présentées et saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes pour lesquelles elle estime qu’un fait nouveau s’est produit ou qu’un élément inconnu au jour du procès s’est révélé.
« Lorsque les éléments nouveaux laissent apparaître qu’un tiers pourrait être impliqué dans la commission des faits, la commission en avise sans délai le procureur de la République compétent, qui effectue les investigations nécessaires et peut ouvrir une information judiciaire, laquelle ne peut être confiée à un magistrat ayant déjà connu de l’affaire. Le procureur de la République ou le juge d’instruction ne peut saisir un service ou un officier de police judiciaire ayant participé à l’enquête à l’origine de la condamnation du demandeur.
« Art. 624-3. – Si la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen estime que l’affaire n’est pas en l’état, elle ordonne l’exécution d’un supplément d’information confié à l’un ou à plusieurs de ses membres aux fins de procéder, directement ou par commission rogatoire, dans les formes prévues par le présent code, à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande, à l’exception de l’audition de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
« Lorsque l’affaire est en état, la formation de jugement de la cour l’examine au fond et statue, par un arrêt motivé non susceptible de recours, à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l’instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision ou le réexamen est demandé ou de son avocat. Le requérant ou son avocat ont la parole le dernier.
« Le président de la cour peut, au cours des débats, demander l’audition par la formation de jugement de toute personne utile à l’examen de la demande.
« Art. 624-4. – Pour l’application du présent titre, le requérant est représenté dans la procédure et assisté au cours des débats par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, commis d’office. Si la demande en révision ou en réexamen n’a pas été déclarée manifestement irrecevable en application du deuxième alinéa de l’article 624 et que le requérant n’a pas d’avocat, le président de la commission d’instruction lui en désigne un d’office. La victime peut être représentée dans la procédure et assistée au cours des débats par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, commis d’office.
« Art. 624-5. – Le requérant peut, au cours de l’instruction de sa demande, saisir la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires pour l’instruction de sa requête. La commission statue sur la demande, par une décision motivée et non susceptible de recours, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
« Art. 624-6. – Le requérant et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l’article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande de délivrance de cette dernière.
« Chapitre IV
« De la décision de la cour de révision et de réexamen
« Art. 624-7. – La formation de jugement de la cour de révision et de réexamen rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée, sauf lorsqu’il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du condamné.
« S’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée. Toutefois, en cas de demande en réexamen et si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, elle renvoie le requérant devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.
« S’il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d’amnistie, de décès, de contumace ou de défaut d’un ou de plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale, en cas de prescription de l’action ou de la peine, la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen, après l’avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s’il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; dans ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.
« Si l’impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu’après l’arrêt de la cour de révision et de réexamen annulant l’arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit au troisième alinéa.
« Si l’annulation de la décision à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être pénalement qualifié, aucun renvoi n’est prononcé.
« L’annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire.
« Chapitre V
« Des demandes de suspension de l’exécution de la condamnation
« Art. 625. – La commission d’instruction et la formation de jugement peuvent saisir la chambre criminelle d’une demande de suspension de l’exécution de la condamnation. Le condamné peut également demander la suspension de l’exécution de sa condamnation à la commission d’instruction et à la formation de jugement, qui transmettent sa demande à la chambre criminelle. Les membres de la chambre criminelle qui siègent au sein de la cour de révision et de réexamen ne prennent pas part aux débats ni à la décision.
« La chambre criminelle, lorsqu’elle ordonne la suspension de l’exécution de la condamnation, peut décider que cette suspension est assortie de l’obligation de respecter tout ou partie des conditions d’une libération conditionnelle prévues aux articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d’un placement sous surveillance électronique mobile.
« Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel celui-ci est placé. Le juge de l’application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues à l’article 712-6.
« Ces obligations et interdictions s’appliquent pendant une durée d’un an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la chambre criminelle.
« En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l’application des peines peut saisir la chambre criminelle pour qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution de la condamnation. Il peut décerner les mandats prévus à l’article 712-17 et ordonner l’incarcération provisoire du condamné en application de l’article 712-19. La chambre criminelle doit alors se prononcer dans un délai d’un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l’exécution de la condamnation, elle peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.
« Si la formation de jugement de la cour, statuant en réexamen, annule la condamnation sans ordonner la suspension de son exécution, la personne qui exécute une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu’à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans le délai d’un an à compter de la décision d’annulation de la cour de révision et de réexamen. Faute de décision de la Cour de cassation ou de la juridiction du fond dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu’elle ne soit détenue pour une autre cause. Pendant ce même délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées dans les conditions prévues aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen a renvoyé l’affaire devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, les demandes de mise en liberté sont examinées par la chambre de l’instruction de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l’intéressé.
« Chapitre VI
« Des demandes d’actes préalables
« Art. 626. – La personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit par une décision pénale définitive ou, en cas d’incapacité, son représentant légal ou, en cas de décès ou d’absence déclarée, les personnes mentionnées au 4° de l’article 622-2 qui envisagent de saisir la cour de révision et de réexamen d’une demande en révision peuvent saisir le procureur de la République d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à tous actes qui leur paraissent nécessaires à la production d’un fait nouveau ou à la révélation d’un élément inconnu au jour du procès. La demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu’elle concerne une audition, préciser l’identité de la personne dont l’audition est souhaitée.
« Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d’un mois.
Chapitre VII
« De la réparation à raison d’une condamnation
« Art. 626-1. – Sans préjudice du chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de l’organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent à la suite d’une révision ou d’un réexamen accordé en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s’est librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.
« Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.
« À la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions mentionnées à la section 9 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du présent code.
« La réparation est allouée par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle réside l’intéressé et suivant la procédure prévue aux articles 149-2 à 149-4. Si la personne en fait la demande, la réparation peut également être allouée par la décision d’où résulte son innocence. Devant la cour d’assises, la réparation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l’assistance des jurés.
« Cette réparation est à la charge de l’État, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
« Si le demandeur le requiert, l’arrêt ou le jugement d’où résulte l’innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile du condamné, s’il est décédé ou déclaré absent ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu’il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
« Les frais de la publicité mentionnée à l’avant-dernier alinéa sont à la charge du Trésor.
II. – Le titre III du même livre III est abrogé.

L'amendement n° 1, présenté par M. Tuheiava, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après le mot :
condamné
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, à faire naître un doute sur sa culpabilité ou à remettre en question le caractère indépendant et impartial de la juridiction ayant prononcé la condamnation.
La parole est à M. Richard Tuheiava.

Cet amendement vise à apporter une modification de fond à l’article 622 du code de procédure pénale en prévoyant un cas supplémentaire de révision, et non pas de réexamen, si un fait nouveau, inconnu jusqu’alors, vient remettre en question le caractère indépendant ou impartial de la juridiction ayant prononcé la condamnation.
L'objet du présent amendement est de conformer le droit national en matière de révision des condamnations pénales aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit de tout individu à être jugé par un tribunal indépendant et impartial.
Il convient en effet de ne pas attendre une mise en cause de la responsabilité de l’État et sa condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme pour permettre une révision.
Il existe un certain nombre de cas d'espèce dans lesquels l'indépendance de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut être sérieusement contestée, des pièces et des écrits couverts par le secret-défense attestant sa partialité.
Il existe également des dossiers potentiels de demande de révision desquels il ressort que les règles du code de l'organisation judiciaire ou du code de procédure pénale violent l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne, par exemple l'exercice par un même juge des fonctions d'instruction, puis des fonctions de juge, ou encore la prise de l'acte d'accusation au domicile d'un ancien gouverneur.

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, non parce qu’elle est insensible aux événements qu’évoque son auteur, mais parce que, s’il était adopté, cet amendement bouleverserait pratiquement l’ensemble du texte.
Le doute pose déjà problème. Remettre en plus en question le caractère indépendant et impartial de la juridiction ayant prononcé la condamnation nous conduirait à faire remonter vers les juridictions de réexamen tout le mal-jugé.
Y a-t-il un fait nouveau dans les informations que vous évoquez, mon cher collègue ? Cela paraît extrêmement difficile à apprécier ! Certes, on conçoit bien l’émotion que suscite, même cinquante ans après, ce qui a pu se passer dans les territoires de la Polynésie française. Nous sommes, les uns et les autres, désireux qu’une solution soit trouvée face au sentiment un peu subconscient dont je devine qu’il persiste dans la population.
Toutefois, à notre profond regret, nous ne pouvons pas, je le répète, émettre un avis favorable sur l’amendement que vous avez déposé, car nous n’avons pas les moyens juridiques d’y répondre, sauf à bouleverser le texte.
Peut-être faudrait-il que Mme le garde des sceaux, à qui vous avez déjà adressé une question écrite, réfléchisse aux moyens de trouver une solution à ce douloureux problème ?
Monsieur Tuheiava, vous vous doutez bien que nous comprenons tout à fait l’intention qui est la vôtre. Simplement, nous traitons aujourd'hui de sujets d’une nature différente, comme l’a d’ailleurs indiqué à l’instant M. le rapporteur.
Dans cette proposition de loi, il s’agit de s’appuyer sur des faits précis, des éléments nouveaux, des pièces inconnues au moment de l’audience, susceptibles d’introduire un doute et de justifier une révision. Pour votre part, vous évoquez plutôt des éléments à caractère juridique, à savoir l’impartialité de la juridiction ayant prononcé la condamnation.
Le droit actuel prévoit des procédures de recours. Toutefois, celles-ci sont évidemment encadrées dans des délais. Vous pointez en l’occurrence la découverte tardive d’une possibilité de mettre en doute l’impartialité de la juridiction. Pour l’instant, seuls le pourvoi en cassation et le recours à la Cour européenne des droits de l’homme autorisent ces recours ; mais, dans ces deux cas, il y a des délais. Si la découverte a lieu plus de six mois après le jugement – c’est le délai qui s’applique s’agissant de la Cour européenne des droits de l’homme –, nous sommes effectivement désarmés.
Je vous propose de continuer à travailler sur cette question, car, même si les cas sont peu nombreux, ils seront toujours extrêmement douloureux. Il serait donc bon que nous parvenions à élaborer une réponse efficace.
Pour l’heure, je vous prie de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur le sénateur, car il ne correspond pas au véhicule législatif que nous examinons aujourd'hui.

L'amendement n° 1 est retiré.
L'amendement n° 15, présenté par M. Alfonsi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le réexamen peut être demandé dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme.
II. – Alinéa 30, seconde phrase
Remplacer les mots :
au premier alinéa de l’article 622-3
par les mots :
à l'article 622-1
La parole est à M. le rapporteur.

Cet amendement a pour objet de corriger une omission dans le texte de la commission tel qu’il a été adopté lors de sa réunion la semaine dernière.
L'amendement est adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 13, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer les mots :
ses enfants, ses parents, ses petits-enfants
par les mots :
ses parents, ses descendants ou alliés en ligne directe ou indirecte
La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Cet amendement vise à étendre la liste des personnes habilitées à demander la révision d’un procès aux parents, aux descendants, ainsi qu’aux alliés en ligne directe ou indirecte de la personne condamnée. Ainsi, dans l’affaire Seznec, ce sont non pas les petits-enfants, mais les petits-neveux de Joseph Seznec qui ont porté la dernière demande en révision.
Si l’on veut que la mémoire des morts soit lavée de l’infamie que constitue une condamnation injuste – et la vérité met parfois beaucoup de temps à se faire jour –, il convient d’ouvrir au maximum la possibilité de révision.

L'amendement n° 2, présenté par M. Tuheiava, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Après le mot :
petits-enfants
insérer les mots :
ou arrière-petits-enfants,
La parole est à M. Richard Tuheiava.

Le présent amendement, qui va dans le même sens que le précédent, a pour objet de préserver les intérêts moraux et patrimoniaux des ayants droit au troisième degré d'une personne condamnée à tort.
Il existe en effet des cas dans lesquels les faits nouveaux n'ont pu être découverts qu'à l'occasion de l'accès à des fonds d'archives officielles, voire classées secret-défense. Or l'accessibilité à des documents secret-défense n'est permise qu'au moyen d'une dérogation du Gouvernement ou au terme d'un délai légal dépassant au moins deux degrés de descendance, c'est-à-dire cinquante ans et plus.
Il est donc juste et équitable, outre le droit de saisine dont dispose la Chancellerie, de faciliter l'exercice du droit à révision d'une condamnation pénale en étendant celui-ci jusqu'aux ayants droit du troisième degré.

La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements, qui, dans l’esprit de leurs auteurs, répondent, je pense, à des préoccupations un peu différentes.
Je rappelle que le texte autorise désormais à agir, outre les personnes visées à l’actuel article 623 du code de procédure pénale, le partenaire lié au condamné par un pacte civil de solidarité, son concubin et ses petits-enfants. Cela fait déjà beaucoup !
Bien que l’on comprenne votre proposition, chers collègues, il vous faut trouver d’autres moyens d’obtenir satisfaction, car il n’est pas possible d’étendre encore cette liste. Ce serait extrêmement difficile à gérer ! Je me mets toujours à votre place, madame la garde des sceaux, mais peut-être ai-je tort… §
Ces amendements n’ont pas tout à fait le même objet, même s’ils visent tous deux à étendre la liste des personnes habilitées à introduire une procédure de révision.
Madame Lipietz, je suis au regret d’émettre un avis défavorable sur votre amendement, dont l’objet est très large, pour les raisons que j’ai énoncées tout à l’heure à la tribune, à savoir que, pour la société elle-même, il y a un moment où le procès pénal doit être terminé.
La contestation d’une condamnation doit évidemment bénéficier de moyens et de temps plus importants que toutes les étapes de recours d’un procès pénal. Cependant, il faut à un moment considérer que l’affaire n’a presque plus d’effet.
C’est évidemment pour leur permettre de laver une mémoire que vous souhaitez autoriser les arrière-arrière-arrière-petits-enfants à introduire une procédure de révision. Toutefois, d’autres voies permettent d’obtenir un tel résultat ; je pense en particulier à la recherche historique. Il faut bien considérer que, au bout d’un certain temps, il n’y a plus de « matière fiable » sur le plan judiciaire.
J’émets en revanche un avis favorable sur l’amendement présenté par M. Tuheiava, qui vise à inclure les arrière-petits-enfants dans la liste des personnes habilitées.
Vous avez eu raison, monsieur le sénateur, d’évoquer le secret-défense et l’inaccessibilité des documents classés. Que se passe-t-il en cas de condamnation manifestement injuste ? Je précise que le fait de dire qu’une condamnation est manifestement injuste n’équivaut pas à un jugement : seule une procédure judiciaire peut permettre d’établir qu’il y a eu erreur judiciaire. Je pense par exemple aux affaires Seznec ou Pouvanaa a Oopa.
Il y a le temps des archives qui ne sont pas immédiatement accessibles, il y a le temps de la mémoire, de l’affect, et il y a le temps de l’action. Personnellement, je ne suis pas choquée par l’idée que c’est la génération des arrière-petits-enfants qui va sortir de l’écrasement, de la dimension affective, pour envisager l’action. Le délai est d'ailleurs relativement court : soixante ans pour les petits-enfants, et environ vingt de plus pour les arrière-petits-enfants. Voilà pourquoi j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 2.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 14, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 18, première phrase
Remplacer le mot :
dix-sept
par le mot :
dix-huit
La parole est à Mme Hélène Lipietz.

Cet amendement vise à faire correspondre le nombre de suppléants au nombre de membres de la cour de révision et de réexamen. Actuellement, la proposition de loi prévoit dix-huit titulaires et seulement dix-sept suppléants.
Dix-huit membres et dix-huit suppléants, cela peut paraître considérable, mais je rappelle que, pour qu’un magistrat puisse siéger à la cour de révision et de réexamen, il faut que, dans l’affaire concernée, il n’ait pas fait d’acte de poursuite ou d’instruction ni participé à une décision sur le fond. C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir un panel assez large afin de disposer de magistrats au-dessus de tout soupçon.

Je pense que les auteurs de l’amendement ont commis une erreur de lecture. La confusion vient peut-être du fait que le conseiller de la chambre criminelle dont le rang est le plus élevé peut suppléer le président. À mon sens, la rédaction actuelle ne pose aucun problème.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’aurais l’opportunité de vous être agréable, madame Lipietz, dans la mesure où la rédaction actuelle et celle que vous proposez sont, de mon point de vue, équivalentes. Cependant, il serait quelque peu démagogique de vous dire oui uniquement parce que j’ai envie de vous être agréable !
Rires et exclamations.
Je pensais à des débats ultérieurs…
J’émets donc, moi aussi, un avis défavorable.


Sans être plus « sérieux » que le précédent – tous les amendements le sont –, cet amendement soulève une question beaucoup plus angoissante quant à l’avenir de la réforme.
Tous les rapports sur lesquels se sont appuyés les auteurs de la proposition de loi soulignent que, dans une procédure de demande en révision ou en réexamen, la première marche, c'est-à-dire l’examen de la recevabilité de la demande, est souvent la plus difficile à franchir.
Puisque nous allons discuter de la notion de doute, il me paraît extrêmement important de réaffirmer solennellement que la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen se prononce sans préjudice de l’examen au fond. Il ne faut pas qu’il y ait encore des demandes rejetées au motif qu’aucun élément sérieux n’est apporté, car cela revient à clore la discussion avant même qu’elle n’ait été ouverte.

La commission a émis un avis défavorable.
L’alinéa 26 de l’article 3 dispose que, « lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la commission ou son délégué peut la rejeter par une ordonnance motivée ». Il peut s’agir, par exemple, d’une même requête déposée systématiquement tous les six mois. Ajouter « Sans préjudice de l’examen au fond » au début de la phrase introduirait de la confusion. Il est en effet évident que, à ce stade, le président de la commission d’instruction ne se livre pas à un examen poussé de l’affaire : il se contente de déterminer si la demande est manifestement irrecevable.
Je pense, moi aussi, que la précision que vous souhaitez apporter, madame Lipietz, n’améliorerait pas le texte et je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, mon avis sera défavorable.
Dans les rapports que vous avez évoqués, nous n’avons pas trouvé ce que vous affirmez y avoir lu. Nous avons eu seulement connaissance d’avis exprimés, notamment, par des auxiliaires de justice.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 8, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Remplacer les mots :
une infraction
par les mots :
l'infraction ayant conduit à la condamnation dont la révision ou le réexamen est demandé
La parole est à Mme Hélène Lipietz.

, je rappelle les termes de l’alinéa 27 : « La commission [d’instruction] peut ordonner l’exécution d’un supplément d’information […] aux fins de procéder […] à tout acte d’information utile à l’instruction de la demande, à l’exception de l’audition de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». Cet amendement vise à spécifier qu’il s’agit de « l’infraction ayant conduit à la condamnation dont la révision ou le réexamen est demandé ».
En effet, si nous conservons la rédaction actuelle, la commission d’instruction ne pourra entendre, afin d’obtenir un supplément d’information, que des personnes « toutes blanches », qui n’ont jamais commis d’infraction. Nous pensons qu’il faut préciser qu’une personne soupçonnée d’avoir commis l’infraction en cause ne doit pas être entendue à ce stade de la procédure.

Ce matin, la commission, qui n’a pas pu entendre Hélène Lipietz au sujet de cet amendement, a émis un avis défavorable et, à ce stade, j’avoue ma perplexité.
C’est nous qui avons précisé que la commission d’instruction a tout pouvoir pour procéder à des investigations, à l’image de celui que l’article 81 du code de procédure pénale confère au juge d’instruction. Cependant, nous avons également prévu des exceptions, en indiquant que cette commission ne pourrait procéder à « l’audition de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ». En réalité, il s’agit de l’hypothèse où il y a un suspect, et c’est alors au procureur de la République qu’il revient d’effectuer les investigations nécessaires et d’ouvrir éventuellement une information judiciaire.
La commission d’instruction n’est pas un troisième degré de juridiction. Elle ne peut donc procéder à des actes tels que la convocation d’avocats ou la mise en garde à vue. C'est la raison pour laquelle nous avons introduit la disposition que vous proposez de modifier, madame Lipietz. Quelque chose m’échappe dans votre amendement. Vous souhaitez limiter l’exception aux personnes soupçonnées d’avoir commis l’infraction en cause. Quel scénario envisagez-vous ? Un faux témoignage ? Je le répète, je suis assez perplexe. Peut-être pourrez-vous nous éclairer, madame la garde des sceaux.
À titre personnel, je ne suis pas opposé au débat, mais je pense qu’il ne faut pas pousser trop loin les pouvoirs d’investigation de la commission d’instruction, dans la mesure où celle-ci ne constitue pas un troisième degré de juridiction. C’est au degré de juridiction normal, c'est-à-dire au procureur de la République, qu’il appartient d’agir le cas échéant.
Le rapporteur a raison de dire que le sujet mérite d’être examiné avec plus de précision. Le travail de réécriture accompli par le rapporteur et approuvé par la commission a permis d’éviter un mélange de genres qui aurait été préjudiciable à tout le monde. La commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen ne doit pas procéder à des mises en garde à vue ni à un certain nombre d’auditions.
L’amendement est d’une autre nature. Il s'agit de permettre à la commission d’instruction d’auditionner une personne même si elle est soupçonnée d’avoir commis une infraction dès lors que cette personne est susceptible de lui apporter des éléments de nature à éclairer son jugement. Le Gouvernement est plutôt favorable à cet amendement. Nous pensons par exemple au cas, évoqué à l’instant par le rapporteur, d’une personne qui n’est pas l’auteur de l’infraction en cause mais a fait un faux témoignage ayant contribué à la condamnation. Il est bon que la commission d’instruction puisse entendre une telle personne.
Il me semble en outre que cela permettrait de gagner du temps. Or ce sont des condamnations souvent lourdes, ayant conduit à de longues incarcérations, qui sont ici visées.
C’est ce qui me conduit à émettre un avis favorable.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 19, présenté par M. Alfonsi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 46
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
La cour de révision et de réexamen peut également ordonner la suppression des mentions figurant dans les fichiers de police judiciaire, dans le fichier automatisé des empreintes digitales, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques et dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, si, compte tenu de la finalité de ces fichiers, la conservation de ces données n’apparaît plus nécessaire. Dans le cas prévu par le cinquième alinéa du présent article, la suppression de ces mentions est obligatoirement ordonnée.
La parole est à M. le rapporteur.

Le texte actuel de l’alinéa 46 de l’article 3 prévoit la destruction des scellés après que la cour de révision a déclaré l’innocence de l’intéressé. Or un certain nombre de fichiers, notamment le fichier automatisé des empreintes digitales ou le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, ne sont pas nécessairement effacés à la suite d’une telle décision.
Les auteurs de la proposition de loi, suivis par l’Assemblée nationale, ont bien repris les dispositions de l’article 625 du code de procédure pénale, mais, dans certains cas, l’innocence peut être si évidente à la suite de la procédure de révision que l’inscription dans ces fichiers ne se justifie plus. Il convient donc de permettre à la cour de révision, en cas d’annulation de la condamnation, d’ordonner la suppression des mentions figurant dans ces différents fichiers.
Nous avons réfléchi ensemble à ces questions, monsieur le rapporteur, et le Gouvernement juge que votre proposition est bienvenue.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 9 rectifié, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 65, première phrase
Supprimer le mot :
son
La parole est à Mme Hélène Lipietz.

C’est un amendement purement rédactionnel : il est évident qu’il s’agit du recours de l’État.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 10, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I.- Alinéa 65, première phrase
Supprimer les mots :
la partie civile,
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Hélène Lipietz.


J’appelle donc également en discussion les deux amendements suivants.
L'amendement n° 11, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I.- Alinéa 65, première phrase
1° Après le mot :
dénonciateur
insérer les mots :
calomnieux ou mensonger
2° Après le mot :
témoin
insérer les mots :
ou la personne qui s'est rendue coupable de l'infraction mentionnée à l'article 434-11 du code pénal,
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 12, présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I.- Alinéa 65
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le recours ne peut être exercé qu'après la condamnation de la personne pour les infractions mentionnées à cet alinéa.
II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, madame Lipietz.

L’amendement n° 10 concerne la partie civile. Il est prévu dans le texte que la réparation de l’erreur judiciaire est à la charge de l’État, ce qui paraît logique, et que l’État peut faire un recours contre un certain nombre de personnes qui sont désignées, la partie civile étant la première mentionnée. Or il peut arriver que des personnes se soient portées partie civile parce qu’elles étaient, de bonne foi, persuadées que la personne qui leur était présentée était bien leur agresseur ou l’assassin de leur enfant.
À mon sens, il est donc dangereux de prévoir que l’État peut se retourner contre la partie civile, car les victimes d’infractions ou leurs ayants droit auront la crainte de devoir rembourser l’État s’il y a une erreur judiciaire, alors qu’elles n’y seront pour rien.
L’amendement n° 11 concerne le dénonciateur. On parle toujours des dénonciateurs calomnieux, mais il y a aussi des dénonciateurs mensongers, c'est-à-dire ceux qui prétendent qu’il y a eu un crime ou un délit, alors que ce qu’ils dénoncent n’existe que dans leur esprit. Il me paraît donc nécessaire de préciser que le dénonciateur peut être soit calomnieux, soit mensonger.
Par ailleurs, au-delà des faux témoins, il importe de prévoir une possibilité de recours contre les personnes qui se rendent coupables de l’infraction prévue à l’article 434-11 du code pénal, c’est-à-dire celles qui s’abstiennent de témoigner alors qu’elles ont connaissance de la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée pour un crime ou un délit. Si cette personne n’agit pas pour faire état de l’innocence de la personne qui vient d’être condamnée, elle participe à l’erreur judiciaire, ce qui justifie que l’État puisse aussi se retourner contre elle.
Enfin, l’amendement n° 12 vise à rendre impossible tout recours tant que la personne contre laquelle l’État veut se retourner n’a pas été condamnée pour les infractions mentionnées, c’est-à-dire faux témoignage, dénonciation calomnieuse ou mensongère ou non-divulgation des éléments de preuve de l’innocence d’un accusé.

L’amendement n° 10 vise à exclure la possibilité pour l’État de se retourner contre la partie civile lorsqu’il a dû dédommager un condamné reconnu innocent à l’issue d’une procédure de révision.
Il est vrai que cette possibilité serait quelque peu singulière si la partie civile n’avait pas commis de faute, mais ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque le texte de l’alinéa 65 vise bien le cas où c’est par la faute de la partie civile, du dénonciateur ou du faux témoin que la condamnation a été prononcée. Dès lors, il est légitime que la partie civile soit, le cas échéant, appelée à réparer, et la commission est donc défavorable à cet amendement.
L’amendement n° 11 recueille le même avis. Il prévoit de préciser, d'une part, que le dénonciateur contre lequel l’État peut se retourner est calomnieux ou mensonger, faisant ainsi référence aux deux infractions prévues par les articles 226-10 et 434-26 du code pénal, d'autre part, que l’État peut également se retourner contre les personnes qui, connaissant l’innocence d’un accusé d’infraction, se sont volontairement abstenues de témoigner.
Il ne me paraît pas forcément pertinent de loger une personne qui se serait abstenue de témoigner de l’innocence d’un accusé à la même enseigne qu’un dénonciateur calomnieux ou un faux témoin qui, eux, ont directement causé la condamnation fautive.
Enfin, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 12.
Madame la sénatrice, vous avez eu raison de présenter ces amendements ensemble, car ils relèvent du même esprit.
Je vous rappelle simplement qu’on ne peut exonérer la partie civile lorsqu’elle a été, par sa faute, à l’origine de l’erreur, tout simplement parce que c’est actuellement l’état du droit commun. En effet, en cas de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe, il est possible de se retourner contre la partie civile. Pour ces raisons, je suis défavorable à l’amendement n° 10.
L’amendement n° 11 tend à prévoir la possibilité de sanctionner quelqu’un pour une faute par omission. Il est vrai que le fait de témoigner, lorsque l’on dispose d’éléments qui permettent d’éclairer la justice, est un devoir civique. Toutefois, il paraît difficile de sanctionner une personne qui, parce qu’elle n’a pas témoigné, n’a pas permis d’éviter une condamnation. Pour cette raison, je partage l’avis défavorable de la commission.
Il en va de même concernant l’amendement n° 12.

La parole est à M. Philippe Bas, pour explication de vote sur l’amendement n° 10.

Comme l’ont très justement dit Mme la garde des sceaux et M. le rapporteur, il faut s’opposer à ces amendements qui reposent pour l’essentiel sur un malentendu, en particulier l’amendement n° 10. L’idée qu’une partie civile devrait être exonérée de sa responsabilité pour faute est tout à fait abusive. Le texte précise bien que la condamnation résulte d’une faute commise, le cas échéant, par la partie civile : ce n’est pas une simple erreur de sa part, c’est beaucoup plus grave. Il ne s’agit évidemment pas de dissuader des personnes de se porter partie civile.
Je pense donc que cet amendement est totalement inutile et que Mme Lipietz serait bien inspirée de le retirer.

Compte tenu de l’heure, je vais le retirer, ainsi que les deux suivants, mais je ne suis pas convaincue par les arguments qui me sont opposés. En effet, la faute de la partie civile me semble très difficile à établir.
L'article 3 est adopté.
(Non modifié)
À la fin du quatrième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, les mots : « et la cour de révision et devant la commission de réexamen des condamnations » sont remplacés par les mots : « d’instruction des demandes en révision et en réexamen et devant la cour de révision et de réexamen ». –
Adopté.
(Non modifié)
À l’article L. 1125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « au troisième alinéa » est remplacée par les références : « aux troisième et dernier alinéas ». –
Adopté.
(Non modifié)
Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° À l’article L. 451-1, les mots : « de révision des décisions pénales, de la commission de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme » sont remplacés par les mots : « d’instruction des demandes en révision et en réexamen » ;
2° À l’article L. 451-2, après le mot : « révision », sont insérés les mots : « et de réexamen ».

L'amendement n° 17, présenté par M. Alfonsi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° À l’article L. 451-1, les mots : « de la commission de révision des décisions pénales, de la commission de réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme » sont remplacés par les mots : « de la cour de révision et de réexamen » ;
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 5 est adopté.
(Non modifié)
Le livre II du code de justice militaire est ainsi modifié :
1° L’article L. 222-17 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « Cour de cassation saisie d’une demande en révision » sont remplacés par les mots : « commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen, la cour de révision et de réexamen » ;
b) Au cinquième alinéa, la référence : « 3° de l’article 623 » est remplacée par la référence : « 4° de l’article 626-5 » ;
2° L’article L. 233-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cassation » est remplacé, deux fois, par les mots : « révision et de réexamen » et la référence : « 625 » est remplacée par la référence : « 626 » ;
b) À la seconde phrase du second alinéa, la référence : « 626 » est remplacée par la référence : « 626-12 ».

L'amendement n° 18, présenté par M. Alfonsi, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « de cassation » sont remplacés par les mots : « de révision et de réexamen » ;
II. - Alinéa 4
Remplacer la référence :
par la référence :
III. - Alinéa 6
Remplacer la référence :
par la référence :
IV. - Alinéa 7
Remplacer la référence :
par la référence :
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 6 est adopté.
(Non modifié)
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. –
Adopté.
(Non modifié)
I. – La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel.
II. – Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement à son entrée en vigueur demeurent valables.
Les demandes en révision dont est saisie la commission de révision des condamnations pénales ou la chambre criminelle statuant comme cour de révision et sur lesquelles il n’a pas encore été statué à cette date sont transmises, respectivement, à la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen et à la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen.
Les demandes en réexamen dont est saisie la commission de réexamen et sur lesquelles il n’a pas encore été statué sont transmises à la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen. –
Adopté.

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans le texte de la commission, modifié.

L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe RDSE, la discussion de la proposition de loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité au bénéfice des communes, présentée par M. Jacques Mézard et les membres du groupe RDSE (proposition n° 415, texte de la commission n° 476, rapport n° 475).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Jacques Mézard, auteur de la proposition de loi.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État chargé de la réforme territoriale, mes chers collègues, la proposition de loi que nous avons déposée vise à réparer ce que nous considérons comme une erreur.
Lors de la discussion du dernier projet de loi de finances rectificative, en décembre 2013, nous avons eu la surprise de découvrir des modifications très substantielles adoptées in extremis par l’Assemblée nationale. Ce n’était pas la première fois : cela s’était déjà produit en 2012, avec le fameux amendement sur la péréquation.
Monsieur le secrétaire d’État, cette mesure sortie au dernier moment du chapeau gouvernemental – mais vous n’étiez pas, alors, membre du Gouvernement – pénalise financièrement les collectivités locales, et cela de façon tout à fait inacceptable.
La taxe communale sur la consommation finale d’électricité, la TCCFE, constitue depuis 2010 une ressource du budget de nombreuses communes de plus de 2 000 habitants.
Je le dis d’emblée, car c’est un point important pour le débat qui s’engage, cette taxe n’est pas et n’a jamais été une ressource affectée, elle n’est pas associée à l’exercice d’une compétence en matière d’électricité, même si une telle confusion a pu s’installer du fait du possible transfert de cette ressource aux autorités organisatrices de la distribution d’électricité, les AODE.
Actuellement, le syndicat interdépartemental d’électricité, l’EPCI ou le département qui exerce la compétence d’AODE perçoit systématiquement le produit de la TCCFE pour les communes de moins de 2 000 habitants. Les autres communes, celles de plus de 2 000 habitants, perçoivent en principe cette taxe, mais celle-ci peut également être perçue par l’organisme de coopération ou le département, en cas de délibérations concordantes des instances concernées.
Notre texte vise tout simplement à maintenir les dispositions relatives à la perception de la TCCFE que je viens de décrire, c’est-à-dire à revenir à la situation antérieure à l’adoption de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2013.
Je rappelle que l’article 22 de ce projet de loi de finances rectificative, devenu l’article 45 de la loi définitive, prévoyait le transfert systématique de la TCCFE à l’autorité exerçant la compétence d’AODE, quelle que soit la taille de la commune.
À l’époque, le Sénat s’était opposé à cette modification qui semblait priver les communes d’une ressource tout à fait substantielle, et cela est aujourd’hui confirmé. Nous avions ainsi adopté un très sage amendement de notre rapporteur général qui supprimait l’automaticité du transfert de la TCCFE.
L’ambition des membres du groupe RDSE, auteurs de cette proposition de loi, est donc simple : maintenir, pour l’instant, les règles de perception de la TCCFE afin de ne pas déstabiliser les finances communales.

Je remercie M. le rapporteur général qui, par l’amendement qu’il a fait adopter en commission des finances, a permis que cette proposition de loi assure pleinement le retour à la situation antérieure, puisqu’il a rétabli la « cristallisation » de la situation des communes qui avaient transféré la TCCFE avant le 31 décembre 2010, comme le prévoyait la loi avant les modifications du dernier collectif budgétaire.
Que les choses soient claires, monsieur le secrétaire d’État : les auteurs de cette proposition de loi ne prétendent pas offrir une solution à la question du financement de la transition énergétique, mais le transfert systématique de la TCCFE aux AODE n’en constitue pas une non plus. Un projet de loi en préparation sur la transition énergétique devra, nous semble-t-il, répondre à cette question, de même que les prochaines lois de finances.
Il ne s’agit pas non plus de figer pour toujours la situation, mais, dans l’attente d’une refonte globale du financement des collectivités territoriales, de la fiscalité locale et de la fiscalité énergétique, il ne faut pas éroder davantage les ressources de nos communes et de nos intercommunalités, dont beaucoup ont déjà bien du mal à faire face à leurs obligations.

J’entends bien les arguments de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, qui plaide pour une montée en puissance du rôle des syndicats dans le financement de la transition énergétique…

Mais nous ne l’oublions pas !
Nous faisons face à un problème très important, eu égard à l’ampleur des sommes en jeu. Nos communes, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ont besoin d’être rassurées sur ce point. La décision prise par l’Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement n’a été précédée d’aucune concertation, et les communes n’ont pas eu les moyens de se préparer à l’impact d’une telle mesure.
Je me suis penché sur le cas de la commune dont je suis un simple conseiller municipal, n’étant pas adepte du cumul horizontal, monsieur le secrétaire d’État, mais n’ayant rien contre le cumul vertical. Pour une commune de 30 000 habitants, la perte résultant de cette mesure s’élève à 645 000 euros, c’est-à-dire pratiquement 4 % du produit des impôts locaux. Je serais heureux de savoir comment on peut se préparer à affronter un tel choc en l’absence de toute concertation préalable.
Une telle situation est inacceptable et il faut donc prendre les dispositions nécessaires pour y remédier. Lors de l’examen de la précédente proposition de loi inscrite à notre ordre du jour, nous avons parlé de la révision des procès. En l’occurrence, c’est une procédure législative qu’il faut réviser, et le plus vite sera le mieux !
Je dois abréger mon propos pour ne pas perdre de temps, mais je crois que vous avez compris l’essentiel, monsieur le secrétaire d’État. Vous risquez de me répondre que le Gouvernement est défavorable à cette proposition de loi. Du moins, je le suppute, car je commence à connaître les réactions gouvernementales. Vous nous renverrez au prochain projet de loi de finances rectificative en nous expliquant qu’y figureront les dispositions nécessaires, mais nous ne saurons pas lesquelles… Or, si le Gouvernement nous sert une idée du même tonneau que la précédente, nous aurons de quoi nous inquiéter !
Je ne vois pas l’intérêt de repousser de plusieurs mois une décision que nous pouvons prendre aujourd’hui, sauf à considérer que c’est au Gouvernement lui-même de réparer sa faute, plutôt que de laisser la Haute Assemblée le faire. Cependant, il nous appartient aussi de contrôler l’action du Gouvernement et cette proposition de loi est une expression de ce contrôle. Une erreur a été commise, que l’Assemblée nationale, où le groupe dominant a l’habitude de voter les propositions du Gouvernement, a avalisée : eh bien, il est temps de réaffirmer qu’il n’est pas possible de procéder d’une telle manière.
Il y a une discussion interne au Sénat sur les montants globaux en jeu, dont l’évaluation varie entre 350 millions d’euros et 700 millions d’euros. Compte tenu des ponctions aujourd’hui effectuées aux dépens des collectivités locales, en particulier par la baisse de la dotation globale de fonctionnement – c’est un autre débat ! –, un certain nombre de communes se trouvent dans une situation financière terrible. On peut, on doit considérer que les collectivités locales – dont vous étiez un éminent représentant avant d’entrer au Gouvernement, monsieur le secrétaire d’État –doivent faire tous les efforts nécessaires, mais il faut qu’elles soient en mesure de s’y préparer ; cela suppose de ne pas procéder d’une manière aussi brutale et – j’ose le dire – inconséquente.
Tel est l’objet de notre proposition de loi. Je ne vois vraiment pas pourquoi il faudrait attendre plusieurs mois, car le rôle du Parlement consiste à dire les choses et à déposer des propositions de loi qui permettent de réparer des erreurs de ce type.
Applaudissements sur les travées du RDSE et de l’UMP . – M. Jean Besson applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Jacques Mézard et des membres du groupe RDSE vise, pour l’essentiel, à défaire le dispositif de l’article 45 du projet de loi de finances rectificative pour 2013, qui prévoit le transfert automatique de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie.
Lors de la discussion de cet article, j’avais présenté, en tant que rapporteur général de la commission des finances, un amendement revenant sur l’automaticité de ce transfert, que le Sénat avait adopté à une très large majorité, …

… mais qui n’a malheureusement pas été repris par nos collègues députés.
Or, quelques semaines seulement après l’adoption définitive de la loi de finances rectificative, nous avons entendu s’exprimer une forte inquiétude des maires, relayée par les associations d’élus. C’est à cette inquiétude que la proposition de loi de nos collègues entend répondre. J’indique, au passage, qu’une proposition de loi très proche a été déposée, il y a quelques jours, par le groupe socialiste.
Ces quelques rappels introductifs conduisent à lever tout suspense quant à mes conclusions sur cette proposition de loi : chacun comprendra que je partage pleinement la volonté de ses auteurs.
La taxe communale sur la consommation finale d’électricité représente une recette importante pour les communes puisque son produit s’est élevé en 2013 à près de 1, 4 milliard d’euros. Elle est perçue par les communes, mais les EPCI, les syndicats intercommunaux ou les départements peuvent s’y substituer s’ils exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité.
Deux cas sont à distinguer : pour les communes de moins de 2 000 habitants, la perception par l’organisme de coopération ou le département est de droit ; pour les autres communes, la perception par l’organisme de coopération ou le département est soumise à délibérations concordantes des instances concernées. En pratique, de nombreuses communes de plus de 2 000 habitants, bien qu’ayant transféré la compétence d’autorité organisatrice, conservent le produit de la taxe.
L’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013 a prévu le transfert automatique, au 1er janvier 2015, de la perception de la taxe communale à l’EPCI, au syndicat ou au département ayant la compétence d’autorité organisatrice, quelle que soit la population de la commune considérée. Cette autorité pourrait ensuite reverser aux communes jusqu’à 50 % du produit de la taxe perçue sur leur territoire, après délibérations concordantes des instances concernées. On rappellera que cette possibilité de reversement n’était pas plafonnée jusqu’à présent.
La mise en œuvre du dispositif de la loi de finances rectificative pour 2013 entraînerait donc une perte de recettes significative pour les communes.
Le chiffre de 750 millions d’euros, avancé par le Gouvernement, et largement repris, est cependant légèrement surévalué selon nous. En effet, ce montant correspond au total du produit de la taxe perçu par les communes de plus de 2 000 habitants, mais de nombreuses villes, notamment les plus grandes, ont conservé la compétence d’autorité organisatrice et ne seraient donc pas concernées par le transfert. En conséquence, et d’après les informations que j’ai pu recueillir, les sommes transférées seraient de l’ordre de 250 millions d’euros.
À cette perte de recettes s’ajouterait cependant celle résultant du plafonnement à 50 % du reversement des syndicats à leurs communes membres, perte qui s’élèverait à au moins 75 millions d’euros.
Au total, le montant du transfert qui résulterait de la mise en œuvre du dispositif voté en loi de finances rectificative pour 2013 est probablement plus proche de 350 millions d’euros que des 750 millions avancés par le Gouvernement. Cela n’enlève rien, au demeurant, à l’appréciation que chacun peut porter sur l’opportunité d’un transfert qui représenterait, quoi qu’il en soit, des sommes très significatives.
À cet égard, les raisons qui avaient conduit la commission des finances à proposer la suppression du transfert automatique cet automne me semblent encore pleinement valables.
En premier lieu, nous n’étions pas favorables à une perte de recette pour les communes – qui le serait aujourd’hui ? – dans un contexte financier contraint et sans qu’une amélioration sensible de la performance de l’action publique puisse en être attendue de manière certaine.
En deuxième lieu, nous estimions que les dispositions en cause avaient fait l’objet d’une concertation insuffisante.
Enfin, nous avions des doutes quant à la pertinence du transfert : la taxe n’étant pas affectée, il n’y a pas de raison pour que sa perception soit liée à l’exercice d’une compétence. De plus, il semble prématuré d’attribuer la taxe aux syndicats, la répartition des compétences en matière de transition énergétique n’étant pas encore déterminée.
Il convient également de noter que le transfert de la perception de la taxe implique que le « coefficient multiplicateur », c’est-à-dire en quelque sorte son taux, soit fixé par l’autorité organisatrice et, donc, harmonisé sur son territoire. Or il semblerait que les villes de plus de 2 000 habitants aient, en moyenne, un coefficient multiplicateur inférieur à celui des autorités organisatrices ; l’harmonisation prévue par la mesure gouvernementale pourrait donc se traduire indirectement par une hausse de la pression fiscale.
Nos débats en commission l’ont montré, il existe, au sein même des différents groupes politiques, des positions diverses sur cette question. Certains de nos collègues voulaient, dans le prolongement de la loi de finances rectificative, aller plus loin dans la concentration de la ressource au niveau des autorités organisatrices, tandis que d’autres souhaiteraient, à l’inverse, revenir sur des situations existantes et redonner plus de choix aux communes, y compris celles de moins de 2 000 habitants.
J’ai indiqué il y a quelques instants les arguments qui me semblent aller à l’encontre de la première option, celle de la loi de finances rectificative.
La seconde option me semble également problématique. En effet, en redonnant une liberté de choix aux communes déjà engagées dans une démarche de mutualisation de la ressource, elle pourrait, vous l’aurez compris, déstabiliser de manière importante certaines autorités organisatrices, notamment celles qui ont engagé des programmes d’investissement importants.
Je vous propose donc de retenir un point d’équilibre, qui consiste à revenir à la situation antérieure à la loi de finances rectificative pour 2013, conformément à la volonté des auteurs de la proposition de loi que nous examinons.
La commission des finances a, dans cet esprit, adopté la proposition de loi après l’avoir modifiée sur un seul point, qui concerne le mécanisme dit de « cristallisation ». Les dispositions antérieures à la loi de finances rectificative pour 2013 prévoyaient que les communes de plus de 2 000 habitants ayant transféré la taxe avant le 31 décembre 2010 ne pouvaient plus revenir sur ce transfert. Il s’agit en quelque sorte d’un « effet cliquet », qui serait ainsi acté. Afin de ne pas remettre en cause les situations existantes, ce qui pourrait fragiliser certaines autorités organisatrices, la commission des finances a souhaité réintroduire ce mécanisme pour apporter la souplesse nécessaire.
Bien entendu, je conçois qu’à l’avenir les évolutions européennes et les choix qui seront effectués pour le financement de la transition énergétique puissent nous conduire, monsieur le secrétaire d’État, à reposer la question de la perception de la taxe. Cela devra toutefois être accompli dans le cadre d’une réflexion globale sur la mise en œuvre des politiques locales en matière d’énergie et faire l’objet d’une large concertation, permettant de prendre pleinement en compte la situation financière des communes concernées.
Pour l’heure, mes chers collègues, le texte qui vous est proposé aboutit à une solution équilibrée, puisqu’il revient à une situation dont personne ne se plaignait vraiment, il faut bien le dire ! C’est la raison pour laquelle je vous invite à l’adopter en l’état.
Applaudissements.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi que nous examinons ce soir a pour objet de revenir sur une partie des dispositions introduites par l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013 portant sur la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité au sein du bloc communal et à compter des impositions de 2015.
Ces dispositions avaient un double objectif.
En premier lieu, il s’agissait, pour les EPCI à fiscalité propre, d’harmoniser les modalités de perception de la TCCFE entre les différentes intercommunalités – métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes – tout en clarifiant les modalités de perception de cette taxe par les communautés urbaines et les métropoles, au moment, on s’en souvient, où les discussions du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles transféraient de plein droit à ces nouvelles intercommunalités la compétence « concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ».
Il s’agissait, en second lieu, de lier la perception de la TCCFE à l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de distribution d’électricité, que cette compétence soit exercée par une commune, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un syndicat d’électrification.
Monsieur le président Mézard, le Gouvernement reconnaît volontiers, ce soir, que l’impact de ces mesures a été sous-estimé. Je partage un certain nombre de vos préoccupations liées à ces dernières. D’abord, parce qu’elles diminuent parfois sensiblement les recettes communales, avec un reversement obligatoire aux syndicats et, parfois, une baisse des redevances versées par ERDF – Électricité Réseau Distribution France. Ensuite, parce qu’il y a lieu d’examiner ce sujet en lien avec celui de la transition énergétique, la question des ressources devant être envisagée conjointement avec celle de la répartition des compétences. Nous aurons, vous le savez, dans les mois qui viennent, à parler de la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités territoriales.
Dans un contexte où, vous l’avez dit, monsieur le rapporteur général François Marc, les ressources des collectivités sont de plus en plus contraintes, le Gouvernement a donc entendu les craintes qui sont les vôtres.

Mme Anne-Marie Escoffier, alors ministre déléguée aux collectivités locales, l’avait clairement indiqué, en réponse à votre collègue Jacqueline Gourault, lors de la séance des questions d’actualité du 20 février dernier. Dès le mois de mars, conformément à l’engagement qu’elle avait pris, Mme Escoffier a donc lancé une concertation avec toutes les associations d’élus concernées en vue de revoir les conditions d’affectation de la taxe sur la consommation finale d’électricité.
Le Gouvernement s’est engagé et s’engage à nouveau ce soir à ce que des réponses soient apportées dans le cadre du prochain collectif budgétaire, qui vous sera soumis cet été.
Si je vous confirme ce soir cet engagement, le Gouvernement ne peut, logiquement, être favorable au moyen que vous avez choisi d’utiliser, à savoir celui d’une proposition de loi ordinaire pour porter des dispositions fiscales.

Car c’est en loi de finances que l’introduction de ces mesures afférentes aux modalités d’institution et de perception de la TCCFE doit trouver sa place.

Vous avez raison, monsieur le sénateur, sur le plan constitutionnel, ce n’est pas nécessaire ; je l’ai moi-même vérifié. Il est vrai que, d’un strict point de vue constitutionnel, le choix d’une loi de finances ne s’impose pas. Cependant, si l’on s’en tient à une logique de bonne gestion financière, il est quand même plus acceptable, pour le Gouvernement comme pour le Parlement, j’en suis sûr, de faire figurer ce genre de dispositions dans une loi de finances plutôt que dans une loi ordinaire.

La loi de finances ne résout pas les problèmes des collectivités locales !

En premier lieu, sur ce point précis, la loi organique privilégie la voie de la loi de finances en ce qui concerne les impositions affectées. L’acte même d’affectation a vocation « à être autorisé par la loi de finances de l’année ».
Au-delà du droit, il paraît plus logique en matière fiscale – financière, en tout cas – de privilégier le support des lois de finances.
En second lieu, il paraît également préférable, pour des raisons d’efficacité, de modifier les dispositions controversées avant le 1er octobre prochain, date à laquelle les collectivités et leurs groupements devraient normalement délibérer au sujet des transferts de produits de cette taxe.

Je dis bien « avant le 1er octobre ». Nous avons donc un peu de temps : nous avons l’été, et le collectif budgétaire.

Le projet de loi de finances rectificative annoncé ici même par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale paraît, en conséquence, être le vecteur le plus approprié et le plus sûr juridiquement pour apporter les modifications souhaitables et qui iront sans doute dans le sens que vous souhaitez, monsieur le président Mézard, monsieur le rapporteur général.
Par ailleurs, sur le fond, votre proposition de simple retour au droit préexistant reste à expertiser.
Le délai supplémentaire qui nous est laissé d’ici à l’été nous permettra donc, dans la concertation, de définir précisément les meilleures modalités de perception de cette taxe, d’autant que nous convergeons largement non seulement sur le diagnostic du problème que vous posez à travers cette proposition de loi, mais aussi sur les solutions à y apporter.
Dans l’attente du projet de loi de finances rectificative, le Gouvernement souhaite donc le rejet de ce texte. Et je réitère, en terminant, l’engagement du Gouvernement d’associer le plus étroitement possible les associations d’élus, bien sûr, mais d’abord le Parlement, et au premier chef le Sénat, à l’élaboration des mesures relatives à cette taxe communale sur l’électricité.
M. François Patriat applaudit.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, cher André Vallini, mes chers collègues, je suis particulièrement satisfait que nous, sénateurs et sénatrices, puissions nous saisir de nouveau de la question des règles relatives à la perception de la TCCFE, après les difficultés rencontrées en décembre dernier.

En effet, nous nous en souvenons tous, notre opposition aux dispositions prises dans le projet de loi de finances rectificative pour 2013 n’avait pas été entendue, notamment en raison du rejet du texte au Sénat. Or les arguments que nous avions alors avancés me semblent toujours pertinents. C’est pourquoi je tiens à saluer l’initiative de Jacques Mézard et de ses collègues du RDSE.

– n’avaient pas fait l’objet d’un dialogue et avaient été insérés unilatéralement dans le texte.
Il est essentiel de revenir sur cette situation et je me réjouis que nous relancions le débat aujourd’hui. Je nuancerai toutefois mon propos en disant qu’il est sans doute prématuré de modifier l’équilibre de cette taxe alors que vont démarrer les discussions sur le projet de loi relatif à la transition énergétique.
Il n’y a pas eu de concertation avec les élus, mais ceux-ci ont rendu publiques leurs revendications, notamment dans une lettre de l’Association des maires de France adressée en février 2014 au ministre délégué au budget. Ils y exprimaient leurs inquiétudes liées à la perte de recettes induite par la loi de finances rectificative pour 2013, perte estimée à 400 millions d’euros pour les communes. Bien que difficile à évaluer, cette perte de recettes est, en tout cas, significative et elle viendrait aggraver encore la situation budgétaire des communes, qui évoluent déjà dans un environnement contraint, et alors même qu’il faut s’attendre à une baisse des dotations aux collectivités territoriales.
L’objectif de la disposition inscrite dans le projet de loi de finances rectificative était de lier systématiquement l’exercice de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité à la perception de la taxe. () Or, il convient de le rappeler, la TCFE n’est pas liée à l’exercice d’une compétence et représente une ressource fiscale importante pour les communes.
Lier obligatoirement l’exercice de la compétence à la perception de la taxe ne me semble ni nécessaire ni pertinent dans le contexte actuel, c'est-à-dire avant la discussion du projet de loi sur la transition énergétique.

Je comprends les deux positions en présence : d’un côté, celle du Sénat tout entier, de l’autre, celle du Gouvernement, seul. Certains défendent la concentration des ressources au niveau de l’autorité exerçant la compétence organisatrice de la distribution publique d’électricité ; d’autres défendent la liberté laissée aux communes de toutes tailles de décider si elles souhaitent conserver ou non la compétence et la perception de la taxe en matière de distribution publique d’électricité. Le débat est donc celui du lien entre le transfert de compétence et le transfert de moyens.
Nous, écologistes, pensons qu’il convient d’adapter les ressources aux besoins et de maintenir une certaine souplesse dans les relations entre les communes et les intercommunalités lorsque celles-ci exercent une compétence. Pour le moment, il me semble donc judicieux de laisser aux communes, dont les organes délibérants sont élus démocratiquement, l’appréciation de la situation.
Je dis « pour le moment », car mon positionnement en faveur de cette proposition de loi s’explique aussi par une attente assumée en vue du débat à venir sur la transition énergétique. Nous pourrons rediscuter de cela avec le Gouvernement.
En effet, la question de la répartition des compétences dans le cadre de la transition énergétique n’ayant pas été tranchée, il me semble prématuré de modifier la répartition des ressources liées à la TCFE au 1er janvier 2015. Au contraire, je serais tenté de me montrer, une fois de plus, pragmatique : un bouleversement des équilibres budgétaires pour les communes ne me semble pas indispensable à l’heure actuelle et il me paraît plus sage d’attendre que soient discutées les modalités de mise en œuvre de cette transition énergétique.
Alors que le Président de la République a annoncé sa volonté de diviser par deux la consommation d’électricité d’ici à 2050, les collectivités vont avoir un rôle important à jouer. Les écologistes soutiennent que les intercommunalités sont l’échelon le plus pertinent pour gérer des enjeux de taille tels que la rénovation thermique ou l’efficacité énergétique.
Par ailleurs, il pourrait apparaître utile de réaffecter progressivement la TCFE vers les actions de maîtrise de la demande en énergie, par exemple, afin que l’énergie finance l’énergie.
La transition énergétique est un enjeu de taille pour les territoires. C’est pourquoi il est indispensable que les collectivités soient associées aux discussions sur le sujet, de même que le Sénat, monsieur le secrétaire d'État. La transition énergétique représente aussi, bien sûr, une belle opportunité en termes de création d’emplois.
Quoi qu'il en soit, les écologistes du Sénat voteront ce texte, extrêmement précis et sérieux, qui répond à un véritable problème que rencontrent les communes, quelle que soit leur taille. Ils espèrent être, très bientôt, pleinement et réellement associés au débat sur la transition énergétique, dans le cadre duquel nous ne manquerons pas d’aborder de nouveau ces enjeux. §

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, cette proposition de loi, dont l’objet est de revenir sur les dispositions de l’article 45 de la loi de finances rectificative de décembre 2013, est une excellente initiative, et je tiens à en remercier le RDSE, en particulier son président, Jacques Mézard.
Je serai très clair : le groupe UMP y est totalement favorable. Nous la voterons en l’état, modifiée par l’amendement consensuel du rapporteur général François Marc, et combattrons toutes les autres initiatives, qu’elles tendent à aller un peu plus loin ou, au contraire, à « déshabiller » les syndicats d’électricité.
Nous adoptons cette position pour trois raisons.
En premier lieu, il me faut revenir sur l’origine bizarre de cet absurde article 45, que je serais tenté de qualifier d’ubuesque. Il s’agissait d’une initiative de certaines communautés urbaines du nord de la France, ...

... espérant mettre la main sur une partie de la recette de la TCFE. On les comprend !
À l’arrivée, que s’est-il passé ? On a retiré 350 millions d’euros de recettes aux communes de plus de 2 000 habitants pour les donner aux syndicats d’électricité, lesquels, je le dis très nettement, n’en veulent pas !

M. Ladislas Poniatowski. On me dira qu’on a toujours envie d’obtenir des recettes. Eh bien, non ! Nous, syndicats d’électricité, gérons – parfois bien, parfois difficilement – les problèmes qui surgissent et qui relèvent clairement de notre compétence. Et si nous ne voulons pas de ces recettes, c’est parce que nous ne voulons pas de conflits entre les villes et les syndicats d’électricité...
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

En deuxième lieu, je voudrais insister sur le rôle des syndicats d’électricité.
Dans notre pays, les réseaux d’électricité sont en mauvais état, qu’il s’agisse des réseaux de moyenne tension, qui sont de la compétence d’ERDF, ou de ceux de basse tension, qui sont de notre compétence.Si, monsieur le secrétaire d’État, les réseaux sont en mauvais état, et je les connais mieux que vous !

Nous avons donc absolument besoin de nos recettes – mais non, j’y insiste, de celles que je viens d’évoquer – pour faire face, à la fois, aux problèmes de chutes de tension, de surcharge des transformateurs et de réseaux de fils nus de moyenne et basse tension, qui sautent à la première tempête.
En troisième lieu, nous devons faire face au problème des énergies renouvelables.
M. Placé a insisté sur le futur débat relatif à la transition énergétique, qui nous conduira à évoquer l’ensemble des enjeux, l’un d’eux étant l’état des réseaux.
En France, on augmente le nombre d’éoliennes. Pour les petites fermes de quatre ou cinq éoliennes, ce n’est pas un problème : elles se raccordent au réseau de moyenne tension. En revanche, lorsqu’on multiplie les panneaux photovoltaïques, il faut les raccorder aux réseaux basse tension !
Tous les syndicats d’électricité sont confrontés à ce problème : renforcer les réseaux pour faire face à ce nouvel enjeu, dont nous débattrons dans quelques mois.
Je me permets de rappeler ces points, mes chers collègues, car je considère – et tel sera l’argument que j’invoquerai si nous avons le temps d’aborder la discussion des articles – que la remise à plat de la TCFE ne pourra se faire qu’en lançant un débat simultané sur la CSPE – contribution au service public de l’électricité–, laquelle deviendra un instrument explosif. C’est à ce moment-là qu’il faudra remettre à plat ces deux taxes payées par le consommateur final, particulier ou entreprise, et non pas aujourd’hui, au travers de cette « petite » proposition de loi. Vous n’aurez même pas le temps de le faire, monsieur le secrétaire d’État, à l’occasion d’un débat sur un collectif budgétaire. Il faudra un débat financier.
Je vous ai bien entendu, monsieur le secrétaire d’État, mais nous allons néanmoins voter ce texte. Il sera vraisemblablement adopté, compte tenu du consensus qui paraît se dégager et du rejet de la réforme par les présidents de syndicats d’électricité, à quelque famille politique qu’ils appartiennent.

Mais qu’en fait-on après ?
J’ai bien compris la position du Gouvernement. J’espère que cette proposition de loi sera votée, mais elle sera gelée en attendant d’être présentée à l’Assemblée nationale et restera, en attendant, lettre morte, ce que je regrette sincèrement, croyez-le bien, monsieur Mézard !
Voter ce texte maintenant constituera malgré tout un geste fort, surtout s’il est adopté, comme je le pense, à la quasi-unanimité. §
M. Charles Guené remplace M. Jean-Claude Carle au fauteuil de la présidence.

Vous avez eu la gentillesse de rappeler, monsieur le secrétaire d’État, que j’avais posé, le 20 février dernier, une question relative à ce problème technique, mais néanmoins crucial pour de nombreuses collectivités territoriales, des nouvelles modalités de répartition de la part communale de la TCFE.
Beaucoup de choses ont été dites, et je ne répéterai pas les propos de mes collègues. Mais il faut bien comprendre que cette mesure entraînerait une perte de recettes très importante pour les communes de plus de 2 000 habitants. Le groupe UDI-UC rejette clairement cet article 45 du collectif de décembre 2013, qui n’a donné lieu à aucune concertation.
Je souhaite revenir sur des points qui ont été peu développés.
Tout d’abord, cet article 45 prévoit, certes, la possibilité d’un reversement de 50 % du produit de la taxe, mais sur l’initiative du syndicat, donc de l’autorité concédante, à l’occasion d’un vote en ce sens.
Ensuite, il faut bien mesurer que les taux appliqués par les communes et les syndicats sont parfois très différents.

Par conséquent, si le transfert a lieu, les 50 % reversés ne correspondront pas forcément aux 50 % que les communes percevaient. Le taux appliqué par le syndicat peut en effet être inférieur à celui qu’appliquait la collectivité territoriale.
J’ai fait le calcul pour mon département : sur une recette évaluée à 3 millions d’euros, la perte s’élèverait à plus de 2 millions. Il s’agit donc d’une mesure très préjudiciable aux communes de plus de 2 000 habitants.
Par ailleurs, les situations des syndicats sont très hétérogènes selon les départements.
Dans certains départements, on pourrait comprendre que les autorités concédantes reçoivent une partie de cette taxe, dans la mesure où elles financent des travaux dans les communes de plus de 2 000 habitants. Cela se produit ! Mais, dans de nombreux territoires, la charge des travaux réalisés dans les communes de plus de 2 000 habitants repose entièrement sur la commune, avec une très faible participation du syndicat d’électrification.

Si l’article 45 n’était pas supprimé, les communes continueraient d’assumer cette charge sans percevoir les recettes !
Il faut aussi prendre en compte la diversité des situations des syndicats d’électricité. Je vous le concède, monsieur le secrétaire d’État, il s’agit là d’un argument justifiant la nécessité de poursuivre la concertation jusqu’à l’examen d’un prochain projet de loi de finances.
Enfin, le projet de loi relatif à la transition énergétique devrait également permettre d’imputer aux collectivités une part du financement de cette transition. Je n’y insiste pas, car tous les orateurs l’ont souligné.
La proposition de loi de notre collègue Jacques Mézard répond à la question que j’avais posée et à l’engagement qu’avait pris Mme Escoffier. Il faut, en outre, saluer le travail effectué par la commission des finances autour du rapporteur général François Marc, laquelle nous propose une rédaction plus conforme à l’idée d’un retour à la situation antérieure au vote de l’article 45.
Le groupe UDI-UC, dans sa grande majorité, soutiendra cette proposition de loi. Le Gouvernement préfère le véhicule d’une loi de finances. Pourquoi pas ? Mais sachez, monsieur le secrétaire d’État, que nous serons vigilants et n’hésiterons pas, alors, à déposer des amendements tendant à supprimer cet article 45.
Deux points sont à prendre en considération.
Tout d’abord, d’une manière générale, les élus, parmi lesquels les sénateurs, veulent revenir à la situation antérieure.
Ensuite, rien ne peut se faire sans les communes, leurs groupements, les communautés de communes et les communautés d’agglomération. Il faut donc débattre de ces questions, de manière précise et approfondie, avec les communes et leurs intercommunalités. §

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je serai bref afin que nous puissions avancer rapidement et voter ce texte.
Le rapport et la présentation de la proposition de loi de nos collègues du groupe RDSE ont d’ores et déjà montré quels étaient les principaux enjeux. Je ne souhaite évidemment pas intervenir de manière redondante. Mais, puisque l’actualité a quelque peu bousculé l’ordre du jour de la séance, en nous mettant en situation de débattre ce soir – sans doute ne serons-nous pas, alors, aussi unanimes ! §–, permettez-moi de pointer quelques faits saillants.
L’objectif de ce texte, que nous approuvons, est de revenir sur une disposition de la loi de finances rectificative de décembre 2013, sur laquelle nous étions intervenus, et qui a « réorganisé » la perception des taxes locales sur l’électricité en attribuant aux organismes de coopération intercommunale la totalité du produit de ces taxes.
Si elle était appliquée, cette mesure – prise, je le rappelle, sans concertation – ne serait pas sans incidence budgétaire. Le rapport fait d’ailleurs largement état des sommes concernées, lesquelles s’élèvent directement à plusieurs centaines de millions d’euros, ce qui n’est pas négligeable dans un climat général de réduction globale des concours de l’État aux collectivités territoriales, réduction dont nous avons pu voir qu’elle serait, jusqu’en 2017, la pierre angulaire des relations entre celui-là et celles-ci...
Je rejoins le président Mézard pour dire que cette réforme était irrecevable, inadmissible.
J’ai également bien noté la perte de recettes correspondant à cette mesure représentait 4 % des impôts locaux perçus par sa commune. Le comble serait de constater à la fois une perte de recettes pour les communes et une harmonisation par le haut des niveaux de taxation pour les usagers !
Rappelons-le, cette opération permet aussi à l’État, qui applique la TVA aux taxes locales, d’envisager quelques menues « recettes de poche » complémentaires. Ainsi, au-delà de la volonté de s’attaquer au trop fameux « millefeuille » territorial en privant les communes de plus de 2 000 habitants du produit de la taxe sur l’électricité, l’objectif était peut-être aussi d’assurer quelques recettes de plus au budget général de l’État !
À la vérité, si la disposition incriminée par la proposition de loi est une illustration de la conception générale des relations entre l’État et les collectivités territoriales, le contenu du pacte de stabilité dont nous débattrons ce soir en est une autre !
Il est en effet demandé aux collectivités locales de fournir un effort financier particulièrement significatif, alors même que certaines équivoques sont loin d’être levées. Je ne m’attarde pas sur ce sujet afin de ne pas rallonger mon propos, mais il faudrait aussi parler de la perte d’un moyen d’intervention sociale pour les collectivités. On sait que certains chômeurs ne peuvent pas toujours payer leur électricité. Or c’est l’une des caractéristiques de la perception des taxes sur l’électricité que de permettre de repérer les foyers qui connaissent les situations les plus délicates en matière d’énergie, de prévenir ces situations et d’y porter remède le cas échéant.
La proximité entre le contribuable et le lieu de perception de la taxe est aussi inscrite dans les principes de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, avec tout ce que cela implique. Elle constitue le levier d’une action au plus près des intérêts mêmes des citoyens.
Monsieur le secrétaire d'État, vous avez dit opter pour la formule du projet de loi de finances rectificative et ne pas vouloir l’adoption de la proposition de loi qui nous est soumise. Cela revient aussi à se priver de cette proximité. C’est pourquoi nous soutiendrons la démarche du RDSE et voterons ce texte.
Il est temps que tout cela cesse. Voilà plus de trente ans, les lois de décentralisation ont fait accéder les collectivités locales à l’âge adulte, s’inscrivant en cela dans le lent mais inexorable processus d’émancipation des communes et des autres niveaux de pouvoir local engagé il y a plus de deux cents ans et qui est l’un des fondements de notre République.
Ce sont ces mêmes principes de transparence et de démocratie qui sont à la base de notre rejet du programme de stabilité.
Pour l’heure, je le répète, nous voterons cette proposition de loi dans le texte issu des travaux de la commission. §

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je m’exprimerai également au nom de ma collègue Delphine Bataille.

Beaucoup a été dit. Je ne reviens pas sur les remarques du rapporteur général, que nous faisons nôtres, ce qui me permet de résumer mon propos à quelques points.
Je tiens à souligner que, loin d’être une mesure technique, la disposition relative à cette taxe prévue par cette proposition de loi est majeure. Elle recouvre à la fois des enjeux financiers pour les collectivités territoriales – 1, 7 milliard d’euros, dont 400 millions d’euros pour les communes de plus de 2 000 habitants –, des enjeux relatifs à la répartition de cette compétence très importante entre les différents niveaux de collectivités, des enjeux liés à la transition énergétique, ce qui nous amènera à débattre bientôt au fond de questions qui ont trait directement à la perception et à la répartition de cette taxe.
C’est la raison pour laquelle, même si de mon point de vue des discussions approfondies sur ces sujets s’imposent, il me semble opportun de revenir à la situation initiale en adoptant cette proposition de loi. §

M. Francis Delattre . Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, eu égard à cette belle unanimité, je renonce, moi aussi, à mon temps de parole.
Bravo ! et applaudissements.

Madame Bataille, j’ai cru comprendre que vous renonciez également à votre temps de parole...

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.

L'amendement n° 4 rectifié ter, présenté par M. Richard, Mme Claireaux, MM. Kaltenbach, Reiner, Kerdraon, Poher, J. Gillot et Vaugrenard, Mme Durrieu, M. D. Bailly, Mmes Génisson et Bourzai, MM. Courteau et Raoul, Mme D. Gillot et MM. Vincent et J.C. Leroy, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-2 . – Il est institué, au profit des communes une taxe communale sur la consommation finale d'électricité, relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière.
« Le bénéfice de cette taxe peut être transféré à un établissement public de coopération intercommunale ou à un département par décision des communes membres, exprimée par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
« Les communes de moins de 2 000 habitants peuvent, par convention, déléguer la perception de la taxe communale prévue au premier alinéa à l’établissement public de coopération intercommunale ou au département exerçant en leur nom la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité visée à l'article L. 2224-31. La convention prévoit le montant de frais de perception que peut prélever l’établissement public ou le département délégataire lors du reversement du produit de la taxe à la commune. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Maurice Vincent.

L'amendement n° 4 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 5 rectifié ter, présenté par M. Richard, Mme Claireaux, MM. Kaltenbach, Reiner, Kerdraon, J. Gillot et Vaugrenard, Mme Durrieu, M. D. Bailly, Mmes Génisson et Bourzai, MM. Courteau et Raoul, Mme D. Gillot et MM. Vincent, Poher et J.C. Leroy, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 5212-24 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les communes d’un syndicat intercommunal ont transféré à cet établissement public le bénéfice de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, cette taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. Il en va de même si les communes d’un département ont transféré le bénéfice de cette taxe au département. L’organe délibérant de l’établissement public ou le conseil général fixe le tarif applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 5214-23 est ainsi rédigé :
« La communauté de communes peut, en outre, percevoir la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun ; »
3° Le troisième alinéa de l’article L. 5215-32 est ainsi rédigé :
« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun ; »
4° Le troisième alinéa de l’article L. 5216-8 est ainsi rédigé :
« La communauté d’agglomération peut, en outre, percevoir la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Maurice Vincent.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 5212-24 est ainsi rédigé :
« Lorsqu’il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, prévue à l’article L. 2333-2, est perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s’il exerce cette compétence, et de la commune. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions prévues à l’article L. 5212-24-1. » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 5212-24 est supprimée ;
3° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23 est ainsi rédigé :
« La communauté de communes peut en outre, percevoir, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions ; » ;
4° Le second alinéa du 1° de l’article L. 5215-32 est ainsi rédigé :
« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions ; » ;
5° Le second alinéa du 1° de l’article 5216-8 est ainsi rédigé :
« La communauté d’agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l’article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d’agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions ; ».
II. – Le VII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigés :
« VII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales lorsque ces établissements publics exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224-31 du même code. »

Je ne suis pas convaincu par l’argumentaire du Gouvernement sur la question du support législatif. Je dirai amicalement au secrétaire d’État que, selon moi, tout le dossier ne lui a pas été transmis. En effet, il n’y a aucun motif de choisir un autre support que celui dont nous débattons. En creusant le dossier, il comprendra qu’il ne dispose pas aujourd’hui de toute l’information sur ce sujet.
Pour m’être absenté quelques instants de l’hémicycle, je n’ai pas pu défendre les amendements que j’avais déposés, mais, lorsque nous approfondirons ces questions, nous nous rendrons compte que le montage antérieur à la loi de finances rectificative ne tenait pas et n’était ni équilibré ni stable. En effet, je ne vois pas pourquoi l’on traite une commune de 1 999 habitants différemment d’une commune de 2 001 habitants. Si nos syndicats d’électricité ont la confiance des communes – et mon expérience me permet de savoir qu’ils l’ont –, nous n’aurons aucun mal à convaincre les communes de procéder à un partage de la recette. Pour tout sénateur, le principe, ce doit être que le partage des recettes communales avec une intercommunalité est décidé par les communes membres à la majorité qualifiée et non pas par un vote subreptice au Parlement. §

Monsieur Richard, j’ai précisé au cours de la discussion générale que l’argumentation sur le support juridique – loi de finances plutôt que loi ordinaire – était discutable et que je l’abordais moi-même avec beaucoup de réserves.
Mesdames, messieurs les sénateurs, par respect pour le Parlement, j’avais prévu de répondre scrupuleusement à chacun des orateurs qui se sont exprimés et j’avais pris des notes à cette fin. Néanmoins, je m’abstiendrai de le faire pour vous laisser le temps de voter cette proposition de loi. §
L'article 1 er est adopté.
Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Les conséquences financières résultant pour l’État de l’alinéa précédent sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. André Vallini.
L'amendement est adopté.

En conséquence, l'article 2 est supprimé.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans le texte de la commission, modifié.
La proposition de loi est adoptée.

Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures vingt-cinq, est reprise à dix-huit heures trente-cinq.

L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe socialiste et apparentés, de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires (proposition n° 396, texte de la commission n° 459, rapport n° 458).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d'État.
Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai plaisir à défendre devant le Sénat, après l’avoir fait devant l’Assemblée nationale voilà quelques mois, la proposition de loi tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires.
Faire de la jeunesse une priorité, c’est d’abord agir pour améliorer l’avenir social et professionnel des jeunes.
Grâce aux emplois d’avenir et aux contrats de génération, le nombre de jeunes inscrits à Pôle emploi a baissé de 14 400 depuis un an ; au mois de mars, il a atteint son plus bas niveau depuis octobre 2012. Ces premiers résultats, même s’ils sont insuffisants, nous encouragent à poursuivre nos efforts en mobilisant l’ensemble des outils dont nous disposons.
Nous savons bien que les jeunes doivent être mieux préparés à leur insertion professionnelle : ils doivent acquérir, dès l’école et l’université, les compétences nécessaires dans leur domaine. À cet égard, la professionnalisation des diplômes, dans l’enseignement secondaire ou supérieur, le développement de l’alternance, sous statut scolaire ou non, comme celui des stages doivent être encouragés.
La question des stages s’est imposée dans le débat public ces dernières années, les stages apparaissant à la fois comme une nécessité pour mieux professionnaliser les parcours de formation initiale et, malheureusement, comme une pratique parfois synonyme d’abus qui pénalisent les jeunes.
Depuis 2006, il faut s’en féliciter, une prise de conscience collective a permis l’encadrement progressif des stages par des mesures législatives et réglementaires, le plus souvent prises en réponse à l’interpellation des jeunes eux-mêmes. Chacun se souvient en effet des jeunes qui ont manifesté, munis d’un masque blanc, pour protester contre les conditions dans lesquelles certains accomplissaient leurs stages.
Après l’élaboration d’une charte des stages, non contraignante, l’évolution vers une réelle réglementation a été engagée. C’est ainsi que l’obligation de conventionnement a été instaurée en 2006 et la gratification rendue obligatoire, en 2008, pour les stages de plus de trois mois dans le secteur privé ; en 2009, cette durée a été réduite à deux mois et l’obligation étendue aux stages effectués dans la fonction publique d’État.
Par ailleurs, les stages hors cursus ont été interdits en 2010, mais malheureusement un décret publié ultérieurement autorise de nombreuses exceptions, en contradiction avec l’esprit de la loi.
En outre, un délai de carence a été instauré pour l’accueil des stagiaires ; ceux-ci se sont vu ouvrir l’accès aux avantages du comité d’entreprise et la prise en compte de leur ancienneté dans l’entreprise en cas d’embauche a été prévue à la suite de la négociation menée par les partenaires sociaux en 2011.
La réglementation française issue de ces avancées, malgré ses insuffisances, fait figure d’exemple à l’échelon européen ; ses principes sont aujourd’hui au cœur des échanges qui accompagnent l’élaboration d’une recommandation du Conseil de l’Union européenne relative à un cadre de qualité pour les stages.
Si donc ces dispositions vont dans le bon sens, elles présentent un caractère parcellaire et ont été élaborées au coup par coup. En outre, elles sont affaiblies par des exceptions qui empêchent de lutter efficacement contre les abus, d’autant plus que les contrôles et les sanctions sont insuffisants. Enfin, elles laissent subsister de nombreux vides juridiques du point de vue des protections dont peuvent bénéficier les stagiaires.
Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de franchir une nouvelle étape. De ce point de vue, la proposition de loi est utile, d’autant plus que le contexte est propice à des avancées.
Elle est utile, d’abord, parce qu’elle procède enfin à la simplification que les établissements et les employeurs réclament depuis des années.
De fait, la situation actuelle est complexe : trois vagues législatives se sont succédé, en 2006, 2009 et 2011, sans parler de la demi-douzaine de textes réglementaires, dont certains sont contradictoires avec la loi. Malgré cette abondance de textes, de nombreuses dispositions d’application manquent. Ajoutez à cela une codification partielle éclatée entre le code de l’éducation et le code du travail et vous aurez tous les facteurs d’une complexité et d’une instabilité juridiques qui posent des problèmes aux acteurs de terrain, au détriment des jeunes.
Plus précisément, la proposition de loi procède à un regroupement des dispositions relatives aux stages et à une recodification dans le seul code de l’éducation, au sein d’une partie spécifique commune aux enseignements secondaire et supérieur ; en effet, l’intention du législateur était, depuis l’origine, d’accompagner dans les mêmes conditions les élèves et les étudiants.
Cette opération de simplification, équilibrée, vise un double objectif : le développement des stages de qualité dans les cursus et la lutte contre les abus associée à l’amélioration des droits des stagiaires.
Soyons clairs : un stage est un atout dans un parcours de formation. En effet, les stages facilitent l’accès au premier emploi : un tiers des jeunes diplômés déclarent avoir reçu une proposition d’embauche à l’issue d’un stage, et la moitié de ceux qui ont accepté une telle proposition ont ensuite signé un CDI. Les stages constituent une première expérience professionnelle appréciée des employeurs et peuvent aider les étudiants à affiner leurs choix d’orientation.
Ainsi, on a constaté qu’un étudiant qui peut faire état sur son curriculum vitae d’un stage, accompli dans une entreprise, une association ou une structure publique, a une chance d’être embauché supérieure de 60 % à celle d’un étudiant dont le curriculum vitae ne comporte aucune expérience de travail.
Or, malgré d’indéniables progrès accomplis en la matière ces dernières années, les stages demeurent encore mal répartis selon les niveaux d’étude et selon les filières.
En moyenne, 32 % des étudiants à l’université ont suivi un stage ; mais s’ils sont 61 % dans ce cas en deuxième année de master, ils sont seulement 3 % en première année de licence, alors que c’est le moment où l’on peut encore, à la lumière d’une expérience professionnelle, modifier son projet d’orientation sans perdre d’année. Par ailleurs, si 90 % des étudiants en licence professionnelle et en DUT ont été stagiaires, les jeunes ayant accompli un stage dans les formations générales, en particulier dans les filières de sciences humaines et sociales, où l’insertion professionnelle est plus complexe, sont moins nombreux.
Il reste donc à agir pour développer les stages dans toutes les formations.
C’est pourquoi la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a érigé la place des stages et la professionnalisation des cursus en critère d’évaluation des formations dans le cadre de la nouvelle procédure d’accréditation des établissements.
La proposition de loi que nous examinons ce jour précise utilement, quant à elle, les missions de l’établissement d’enseignement chargé d’accompagner l’étudiant dans sa recherche de stage. De fait, de nombreux jeunes rencontrent encore de grandes difficultés pour trouver un stage, en l’absence de réseau personnel et familial. En matière de recherche de stages, le service public doit être le réseau de ceux qui n’en ont pas !
La commission des affaires sociales du Sénat a souhaité renforcer les prérogatives des établissements d’enseignement, en prévoyant que les conseils d’administration de ceux-ci décideront des modalités de suivi des stagiaires les plus adaptées. Le Gouvernement est favorable à cette mesure, car il est nécessaire que les lycées, les universités et les écoles se saisissent pleinement de l’enjeu que représente le développement de stages de qualité.
La présente proposition de loi va à l’essentiel et ramène le stage à ce qu’il doit être : une période de formation. De cette définition, qui fait l’unanimité parmi les partenaires sociaux comme parmi vous, mesdames, messieurs les sénateurs, et ce quelles que soient les travées sur lesquelles vous siégez, il faut tirer toutes les conséquences.
Si le stage est un temps de formation, il ne peut pas être accompli en dehors d’un cursus ou après l’obtention du diplôme. Par ailleurs, il doit obligatoirement s’accompagner d’un volume minimal de formation, que le Gouvernement propose de fixer par décret à 200 heures par an.
Si le stage est un temps de formation, il doit être préparé en amont et évalué en aval en fonction d’objectifs pédagogiques préalablement définis par le tuteur de stage et l’organisme de formation, sous la responsabilité de ce dernier.
Si le stage est un temps de formation, rien ne justifie qu’il dure plus de six mois ; au-delà, en effet, sa pertinence pédagogique n’est pas démontrée, sans compter que, dans certaines formations, les stages longs freinent le développement de l’alternance, dont la pédagogie est plus adaptée aux durées supérieures à six mois.
Pour ce qui concerne justement l’alternance, je souhaite son doublement dans l’enseignement supérieur à l’horizon de 2020 : elle procure un véritable contrat de travail à des jeunes souvent issus de milieux modestes, lesquels peuvent ainsi poursuivre leurs études, et constitue une formule pédagogique bien adaptée à certains jeunes, qu’elle conduit à la réussite.
Si le stage est un temps de formation, il doit bénéficier d’un double suivi, par un enseignant et par un tuteur désigné au sein de l’organisme d’accueil, afin de garantir au jeune l’acquisition de véritables compétences. Ce double suivi est rendu obligatoire par la proposition de loi.
Si le stage est un temps de formation, le stagiaire doit être mieux protégé, sans pour autant être assimilé à un salarié : la gratification n’est pas un salaire, ni la convention de stage un contrat de travail. Telle est la conception, cohérente, sur laquelle repose le présent texte.
La proposition de loi vise aussi à lutter contre les abus qui, sans être majoritaires, contribuent à entretenir un sentiment de défiance des jeunes vis-à-vis du monde du travail.
Dans cet esprit, elle encadre le recours excessif aux stages que l’on peut observer de manière isolée et dans certains secteurs particuliers que nous connaissons. Pour cela, elle prévoit un taux maximal de stagiaires en fonction des effectifs salariés ; ce plafond sera fixé par décret et adapté à la taille de l’entreprise, les entreprises de moins de vingt salariés bénéficiant en outre d’un dispositif spécifique.
Le principe de ce plafond a suscité de nombreux débats à l’Assemblée nationale et, je crois, au sein de la commission des affaires sociales du Sénat.
Cette limitation vise à réduire les abus qui existent dans quelques secteurs bien identifiés, sans pour autant pénaliser l’offre de stages proposée par la majorité des entreprises. Elle a aussi pour objet d’assurer un encadrement de qualité aux stagiaires dans les entreprises. À cet égard, le décret qui est actuellement préparé, en concertation avec tous les partenaires concernés, alignera le nombre de stagiaires pouvant être simultanément suivis par un même tuteur sur celui des stagiaires pouvant être simultanément suivis par un même maître d’apprentissage, qui est de trois.
Certains souhaitent que la fixation de ce plafond soit renvoyée à un accord de branche : le Gouvernement pense, au contraire, que, en matière de protection sociale, c’est bien à la loi de faire respecter l’intérêt général sur l’ensemble du territoire. Que les entreprises et les branches s’emparent de l’enjeu des stages pour négocier des accords de qualité, nous ne pouvons, par ailleurs, qu’y être favorables.
La proposition de loi tend également à protéger les jeunes contre les dérives qui conduisent à substituer les stages à l’emploi, en renforçant les moyens de l’inspection du travail pour sanctionner les abus éventuels et en prévoyant une information du stagiaire, de l’établissement et des représentants du personnel de l’entreprise en cas d’infraction. Pour permettre le bon déroulement des stages, tous les acteurs doivent être responsabilisés, y compris les jeunes.
Le présent texte vise, enfin, à améliorer le statut, les conditions d’accueil et les droits des stagiaires, tout d’abord en prévoyant des autorisations d’absence et en étendant aux stagiaires les protections relatives aux durées maximales de présence et aux périodes de repos ; en envisageant, ensuite, la possibilité pour l’établissement d’enseignement de valider le stage qui aurait été interrompu avant son terme, afin de ne pas pénaliser le jeune dans son parcours ; en mettant en place, enfin, une exonération d’impôt sur le revenu pour les gratifications versées aux stagiaires, comme c’est déjà le cas pour les salaires perçus par les apprentis. Cette dernière disposition a été nouvellement introduite, à l’issue du débat à l’Assemblée nationale.
Avant de conclure, je souhaiterais répondre à deux questions qui ont été soulevées lors de l’élaboration de ce texte, ainsi qu’à l’occasion des débats qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale.
Première question, cette proposition de loi aura-t-elle pour effet de réduire l’offre de stages ?
Depuis la mise en place de l’obligation de gratification des stages en 2006, même si cette dernière n’est pas toujours appliquée, le débat est récurrent et l’argument ne cesse d’être brandi par les adversaires de toute réglementation protectrice pour les stagiaires. Nous connaissons bien le raisonnement avancé : on explique aux jeunes que leurs droits sociaux sont la cause de leurs difficultés pour mieux les pousser à renoncer à ceux-ci. Nous avons même vu des jeunes relayer les inquiétudes exprimées par certains employeurs, qui estimaient démesuré le versement d’une gratification de 436 euros par mois, sachant qu’il s’agit d’un plancher et qu’un employeur peut, bien sûr, verser une rémunération plus importante.
Cette forme de chantage n’est pas acceptable. C’est pourquoi je veux ici rassurer les jeunes : contrairement à ce que certains craignaient, la réglementation des stages mise en place progressivement depuis 2006 n’a pas diminué l’offre globale de stages, loin s’en faut ! Un récent rapport du Conseil économique, social et environnemental a même évoqué un doublement du nombre de stages entre 2006 et 2012, puisqu’il serait passé de 600 000 à 1, 2 million. Ce phénomène s’explique, pour partie, par le développement des stages dans les cursus, mais parfois aussi par des dérives consistant à les substituer à des emplois proposés aux jeunes diplômés.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous invite donc à aborder ce débat avec sérénité, pragmatisme, sans tomber dans la controverse, ce dans le seul intérêt des jeunes.
Seconde question, ce texte est-il « stressant » pour les entreprises, pour reprendre une formule qui a été entendue voilà quelques mois au début de sa discussion ?
Je ne vois pas de raison objective à cela. En réalité, la présente proposition de loi est dans l’intérêt des entreprises elles-mêmes et, au-delà, des organismes publics et des associations, puisque les lieux de stage sont bien évidemment divers. En effet, les différents employeurs ont besoin avant tout d’un cadre juridique simplifié et clarifié, qui sécurise la mise en œuvre des stages. Mais, surtout, la majorité des dirigeants d’entreprise et de lieu d’accueil de stagiaires reconnaît l’intérêt de mettre en place des pratiques vertueuses : quelle image donnons-nous à nos jeunes du monde du travail quand leur premier contact avec celui-ci se fait au travers de stages qui ne se déroulent pas dans de bonnes conditions ?
Nous avons évoqué à plusieurs reprises la fuite des jeunes vers d’autres pays. Je tiens à le préciser, en France, ce phénomène est deux fois moindre qu’en Allemagne et près de trois fois qu’au Royaume-Uni.
On exagère donc les chiffres puisque seuls 2 % de nos diplômés sont concernés, même si dans certaines branches les départs sont plus importants. Ramenons les chiffres à la réalité objective !
Quoi qu’il en soit, il convient de donner aux jeunes une bonne image des employeurs. C’est pourquoi une grande majorité de ces derniers sont favorables à ce texte.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je conclurai mon propos en saluant M. le rapporteur, Jean-Pierre Godefroy, qui a conduit les concertations menées autour de ce texte dans un dialogue permanent avec les ministères du travail, de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Qu’il soit remercié de ce travail de grande qualité.
Mme Geneviève Fioraso, secrétaire d'État. La proposition de loi qui va faire l’objet de nos débats est très attendue par les jeunes. Elle est également nécessaire pour améliorer la qualité des formations et pour simplifier la vie des entreprises. Elle constitue aussi et avant tout un message de confiance et de responsabilité partagée entre tous les acteurs – entreprises, organismes d’accueil, établissements de formation et jeunes –, au service d’une priorité que je vous invite à partager : l’emploi des jeunes, la première des solidarités !
Applaudissements

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, voilà maintenant plus de sept ans, au mois de février 2007, je présentais dans cet hémicycle la proposition de loi visant à organiser le recours aux stages que j’avais déposée, avec mes collègues du groupe socialiste de l’époque, au mois de mai 2006. Le fait que nous abordions ce sujet aujourd’hui est un indice, pour ceux d’entre vous, mes chers collègues, qui ne siégeaient pas encore parmi nous, sur le sort qui fut réservé à ce texte ! Je garde en mémoire le débat que celui-ci avait suscité et les interrogations qu’il avait soulevées sur toutes les travées.
En effet, la problématique de l’encadrement des stages était alors nouvelle. Elle était liée à la prise de conscience, partagée par tous, de la nécessité de définir un statut du stagiaire pour mettre un terme aux abus dont les médias se faisaient alors l’écho. Le collectif Génération précaire, qui s’est fait connaître par ses actions coup-de-poing contre les structures recourant manifestement de façon abusive aux stagiaires et par son engagement contre la précarité de ces derniers, est ainsi né au mois de septembre 2005, suivi par la mise en place d’autres organisations associatives. C’est ensuite au mois de mars 2006, à l’occasion de l’examen du projet de loi pour l’égalité des chances, que les premières règles furent posées, en particulier l’obligation de gratification des stages de plus de trois mois.
La reconnaissance de ce phénomène donna lieu à une succession de mesures législatives et réglementaires dont la sédimentation, au fil des années, a abouti certes à conférer des droits nouveaux aux stagiaires, mais également à créer de la confusion parmi les acteurs concernés. Avec l’adoption de pas moins de dix textes apportant des modifications au régime juridique des stages entre 2006 et 2013, il n’est pas étonnant que certains aient eu des difficultés à appréhender le droit en vigueur.
L’un des objets de la présente proposition de loi, déposée à l’Assemblée nationale le 14 janvier dernier par la députée Chaynesse Khirouni, est de rassembler ces dispositions dans une partie dédiée du code de l’éducation, afin d’améliorer leur clarté et leur intelligibilité. Ce texte ne remet aucunement en cause l’avancée majeure qu’a constituée l’accord national interprofessionnel du 7 juin 2011 sur l’accès des jeunes aux formations en alternance et aux stages en entreprise, signé par les partenaires sociaux à l’unanimité, dont la loi Cherpion du 28 juillet 2011 a réalisé la transposition législative, confirmant, notamment, le principe d’une durée maximale de six mois d’un stage.
Comme un stage est toujours inscrit dans un cursus scolaire ou universitaire, il est construit autour d’une relation tripartite entre le stagiaire, l’établissement d’enseignement et la structure d’accueil. Cette relation se matérialise par la convention de stage. Cela peut sembler évident, mais il s’agit là de l’un des atouts du système français. En effet, une récente enquête a montré que, dans l’Union européenne, 35 % des stages ne font pas l’objet d’une telle formalisation juridique.
Par ailleurs, la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche a, pour la première fois, fixé une définition du stage, à savoir « une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification. » Elle a également étendu l’obligation de gratification, restreinte en 2009 aux stages de plus de deux mois, à tous les employeurs publics, collectivités territoriales comprises.
La proposition de loi que nous examinons ce jour poursuit le travail engagé l’an dernier par le biais de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, et concrétise l’engagement de campagne n° 39 du Président de la République. Elle est le reflet de l’évolution des stages depuis le milieu des années 2000, conséquence de la réforme de l’enseignement supérieur et de la professionnalisation croissante des enseignements.
En 2007, lorsque j’ai présenté ma proposition de loi, le nombre de stagiaires était évalué à 600 000. En 2012, le Conseil économique, social et environnemental donnait le chiffre de 1, 6 million. La précision de ces estimations n’est pas absolue, car la multiplicité des situations dans lesquelles un stage peut être réalisé rend leur recensement très complexe. Elles mettent néanmoins en lumière un phénomène indéniable, que chacun de nous a pu constater : la très forte croissance du nombre de stagiaires. Celle-ci appelle une réponse législative globale, qui consiste à mettre en place un cadre juridique stable des stages permettant la poursuite de leur développement, au bénéfice des jeunes comme des entreprises, sans que ce soit au détriment de l’emploi salarié. Je note d’ailleurs, comme vous l’avez souligné, madame la secrétaire d’État, que les évolutions, notamment concernant la gratification, n’ont pas empêché les stages de croître et d’embellir ! C’est peut-être une réponse à ceux qui s’inquiètent, selon moi à tort…
Je ne serai pas redondant avec votre présentation, aussi je traiterai des aspects du texte qui me semblent essentiels et qui ont justifié, la semaine dernière, son adoption par la commission des affaires sociales. Cette proposition de loi repose sur un double processus de responsabilisation : premièrement, des établissements d’enseignement ; deuxièmement, des organismes d’accueil des stagiaires.
J’évoquerai d’abord la responsabilisation des établissements d’enseignement dans l’accompagnement du stagiaire et le suivi du déroulement pédagogique du stage.
Trop souvent, l’implication des établissements d’enseignement supérieur dans ce processus se limite à la signature d’une convention-type, sans autre forme de suivi. Ce n’est pas le cas dans le secondaire, où les lycées professionnels travaillent en parfaite collaboration avec les entreprises de leur bassin économique et leurs élèves pour garantir la cohérence des périodes passées en milieu professionnel.
Pour la première fois, les missions de l’établissement d’enseignement envers le stagiaire sont clairement énoncées, afin de réaffirmer le caractère pédagogique du stage. En complément, la désignation, pour chaque stage, d’un enseignant référent est rendue obligatoire, afin d’en assurer l’encadrement pédagogique. L’idée est qu’un enseignant soit à même de jouer le rôle de médiateur en cas de difficultés entre le stagiaire et son organisme d’accueil.
Le présent texte confirme, par ailleurs, l’obligation d’accompagner un stage, avant ou après sa réalisation, d’un volume pédagogique minimal de formation en établissement durant l’année scolaire. Madame la secrétaire d’État, vous avez répondu par anticipation à l’interrogation qui avait été émise à ce sujet, ce dont je vous remercie !
Cette proposition de loi prévoit également l’extinction des dérogations à la durée maximale de six mois pour un stage. Alors que, aujourd’hui, faute de décret d’application, les contournements de cette règle sont nombreux, la future loi reprendra le pas. Il est difficile de concevoir les apports pédagogiques d’un stage de huit mois par rapport à ceux d’un stage de six mois. En revanche, il est très facile d’imaginer qu’un stage d’un an peut permettre d’éviter d’embaucher un salarié.
Ce texte s’attaque également à la situation des stagiaires dans leur organisme d’accueil et aux pratiques de ces derniers en matière de recours aux stages. Il doit permettre de faire évoluer des comportements inacceptables auxquels, par fatalité ou résignation, notre société s’est malheureusement accoutumée.
Est-il vraiment tolérable qu’une entreprise puisse avoir autant de stagiaires que de salariés ou que certaines entreprises du CAC 40 comptent près de 30 % de stagiaires ? Voilà pourquoi un nombre maximal de stagiaires par entreprise sera institué par décret. Envoyer ainsi un signal fort à la jeunesse, mais aussi aux secteurs d’activité dont le recours aux stages est abusif est, à l’heure du pacte de responsabilité et de solidarité, un geste indispensable.
La désignation d’un tuteur au sein de l’organisme d’accueil contribue également à la responsabilisation de l’entreprise en garantissant la transmission des savoirs et des compétences, ainsi que le respect de la convention de stage.
L’accent mis sur les droits du stagiaire dans son organisme d’accueil répond à cette même philosophie. Droit à congés, bénéfice des titres-restaurant, protection contre les discriminations et le harcèlement : voilà des avancées extrêmement importantes. De même, la définition de règles relatives aux conditions et à la durée de travail, conduisant à les aligner sur celles des salariés, met un terme au flou juridique qui existait en la matière.
Il est vain de fixer un cadre juridique construit autour de plusieurs obligations s’il n’est accompagné d’aucun mécanisme de contrôle. C’est pourquoi le fait de confier à l’inspection du travail les missions de lutter contre les abus et de s’assurer du respect des dispositions relatives au nombre maximal de stagiaires par entreprise ainsi que des conditions de travail ne me choque pas. Au contraire, il me semble que tous ceux qui ont un comportement vertueux envers leurs stagiaires devraient se réjouir de la mise en œuvre de telles mesures. Seuls ceux qui ne voient les stagiaires que comme représentant un avantage compétitif seront, enfin, mis face à leurs responsabilités.
Comme le diable se niche dans les détails, sur certains points, bien sûr, des éclaircissements de la part du Gouvernement seraient souhaitables. Cette proposition de loi renvoie à plusieurs reprises au pouvoir réglementaire pour ce qui concerne la détermination des modalités de sa mise en œuvre. Une telle procédure n’est pas en soi illégitime, car il n’est pas souhaitable de figer dans la loi des règles d’application ne relevant pas de son domaine. Il ne faut toutefois pas qu’elle aboutisse à un résultat qui soit contraire à l’esprit de cette proposition de loi.
Je pense tout d’abord au nombre de stagiaires qu’un même enseignant référent pourra suivre et au contenu précis de cette nouvelle tâche. Il semble nécessaire de faire des distinctions selon les niveaux d’études et l’objet du stage : les besoins ne sont pas les mêmes lors d’une période de formation en milieu professionnel dans le cadre de la préparation d’un baccalauréat professionnel ou au cours d’un stage long de master. De plus, le volume pédagogique minimal de formation en établissement avant un stage ne devra pas se résumer à un cours symbolique.
Il en va de même pour la question du nombre maximal de stagiaires par organisme d’accueil. Une fois encore, certains regretteront ce renvoi au pouvoir réglementaire, mais la souplesse requise pour appliquer une telle mesure plaide en ce sens. Il semble d’ores et déjà évident qu’il faudra traiter différemment les plus petites entreprises et les grands groupes. Une règle uniforme risquerait d’être inopérante, alors que le recours aux stagiaires varie grandement selon la taille de l’entreprise et le secteur d’activité. Vous avez évoqué ce point, madame la secrétaire d’État.
J’aimerais enfin attirer l’attention du Gouvernement sur la situation de certains établissements de l’enseignement agricole. Les maisons familiales rurales offrent des formations à des jeunes en difficulté selon un rythme spécifique, et les résultats obtenus sont indéniables. Dans certains cas, les élèves, qui sont bien souvent âgés de moins de dix-huit ans, peuvent accomplir plus de deux mois de stage par année scolaire. Si la présente proposition de loi est adoptée, ces organismes craignent que leurs élèves ne trouvent pas d’employeur prêt à leur offrir une période de formation en milieu professionnel gratifiée. Sont en l’occurrence en cause le plus souvent de petites entreprises agricoles ou artisanales. Quelle réponse pouvons-nous leur apporter ? Je note néanmoins que l’amendement de notre collègue député Gérard Cherpion, adopté par l’Assemblée nationale, constitue une première solution.
Cela étant, lors de sa réunion du 16 avril dernier, la commission des affaires sociales a adopté la proposition de loi qui lui était soumise, modifiée par quinze amendements que je lui avais présentés. Elle a souhaité confier au conseil d’administration de chaque établissement d’enseignement la mission de fixer le nombre de stagiaires dont un même enseignant référent peut assurer le suivi. En fonction des moyens et, surtout, des formations dispensées, l’organe de direction de l’établissement est bien le mieux à même de déterminer la manière d’organiser ce suivi. C’est le corollaire de l’autonomie pédagogique qui lui est reconnue.
La commission a également limité la durée de travail des stagiaires à la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures. Rappelons que les stagiaires ne sont pas des salariés à part entière – vous l’avez indiqué, madame la secrétaire d’État – et qu’ils n’occupent pas un emploi permanent dans l’entreprise. Quelle est donc la nécessité de les faire travailler parfois plus de 40 heures sans qu’ils puissent bénéficier, comme les salariés, de contreparties sous la forme d’une rémunération complémentaire – ils perçoivent simplement une gratification a minima de 436 euros – ou de temps de repos ?
Ces constats posés, la présente proposition de loi recentre les stages sur leur principe fondamental, à savoir un outil de formation ancré dans un cursus dont il est une composante à part entière. Je vous rejoins pleinement, madame la secrétaire d’État, je ne crois pas au discours selon lequel l’adoption de ce texte aboutira à un tarissement de l’offre de stages. Au contraire, c’est bien le phénomène inverse qui a été observé depuis 2006 et qui a accompagné la construction progressive du statut de stagiaire.
À l’heure où certains se demandent justement si les stages ne sont pas trop nombreux, il faut surtout se donner les moyens de garantir des stages de qualité. Cette proposition de loi constitue un réel progrès en la matière en impliquant les établissements d’enseignement dès la définition du projet de stage.
Récemment, le Président de la République déclarait que le pacte de responsabilité allait être accompagné d’un pacte de solidarité. J’ai le sentiment que cette initiative parlementaire correspond parfaitement à l’esprit de cette annonce. En effet, la précarité est le lot commun de la très grande majorité des stagiaires. Le témoignage récent d’une jeune femme – il a fait l’objet d’une couverture médiatique notable – sur cette génération d’« affamés » qui n’a connu que la crise économique et enchaîne les stages faute de perspectives d’embauche confirme ce diagnostic.
J’en viens maintenant à un regret personnel : ce texte ne fait pas évoluer le régime de la gratification des stagiaires. Au moment où la jeunesse doute et ressent un déclassement par rapport à la génération de ses parents, un débat sur la revalorisation de cette gratification mérite d’avoir lieu, car, eu égard à son faible montant, cette dernière symbolise, aux yeux de nombreux jeunes, leur relégation dans un état de précarité qui se prolonge d’année en année. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé, en ma qualité de rapporteur, deux amendements – je sais qu’ils feront l’objet de discussions : l’un vise à relever le montant de la gratification et à le porter de 12, 5 % à 15 % du plafond de la sécurité sociale – soit 530 euros –, l’autre tend à rendre cette gratification obligatoire pour tous les stages de l’enseignement supérieur de plus d’un mois. Je considère en effet que les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur sont tout de suite opérationnels compte tenu de leur qualification.
Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, sept ans après avoir présenté ma proposition de loi, je regrette que les termes du débat aient si peu évolué, mais je suis heureux que, par le biais du présent texte, notre société prenne enfin ses responsabilités envers tous ces jeunes en garantissant l’effectivité de leurs droits.
À d’autres maintenant, que ce soient les entreprises ou les établissements d’enseignement, de prendre les leurs.
Pour y parvenir, il est très important que le Parlement adopte cette proposition de loi dans les meilleurs délais, afin que ses premières mesures puissent être appliquées, autant que faire se peut, dès la rentrée prochaine. Je vous invite donc, mes chers collègues, à lui apporter vos voix.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC, du groupe écologiste et de l'UDI-UC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, face à l’enthousiasme déclenché par la présente proposition de loi sur certains bancs, plus particulièrement à l’Assemblée nationale, au nom du groupe UMP, je veux dire que nous avons un peu du mal à comprendre les avancées que ce texte est supposé apporter.
Vous l’avez rappelé opportunément, madame la secrétaire d’État, toutes les améliorations adoptées afin de sécuriser la situation des stagiaires l’ont été depuis 2006. Autrement dit, ce sont un gouvernement de droite et des ministres de droite qui les ont proposées et fait voter.
Ainsi, la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances a mis en place l’interdiction de faire accomplir les tâches d’un salarié par un stagiaire, a imposé la convention tripartite et, surtout, le principe d’une gratification obligatoire.
La concertation avec les partenaires sociaux, menée dans le cadre des travaux préparatoires à la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, a précisé le dispositif de la gratification, la rendant obligatoire dès deux mois de stage, et a étendu par décret des obligations quasi identiques aux administrations et établissements publics de l’État qui s’en exonéraient.
Pour ma part, je suis fière d’avoir fait inscrire dans la loi de 2009 l’extension des stages et de leur gratification aux assemblées parlementaires, qui refusaient d’accueillir des stagiaires, estimant que ces derniers pourraient faire concurrence au personnel. Telle fut, je vous l’assure, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la réponse qui me fut apportée dans cet hémicycle même !
J’apprécie que, depuis peu, une page consacrée aux offres de stages proposées par le Sénat soit disponible sur son site.
Enfin, la loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Cherpion », a renforcé ce cadre, en prévoyant notamment l’information du comité d’entreprise, la création d’un délai de carence entre deux stages et la limitation de leur durée à six mois, sauf exceptions, auxquelles nous tenons.
Vous-même, madame la secrétaire d’État, vous avez maintenu ces dispositions dans la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et les avez même étendues à tous les organismes d’accueil de stagiaires.
Selon moi, comme selon nombre de personnes que nous avons auditionnées, le cadre juridique en vigueur était déjà protecteur, tout en présentant l’avantage d’être issu du dialogue social.
Alors, pourquoi ce nouveau texte ?
Certes, on peut encore relever des abus, mais ils restent isolés. Le cas le plus fréquent est le recours aux stagiaires pour effectuer des tâches habituellement dévolues à des salariés. Des sanctions lourdes existent. Elles sont prononcées par les tribunaux, qui savent faire la part des choses entre un véritable stage et un emploi permanent et requalifier le contrat de travail. Mais la démarche est compliquée pour le stagiaire. J’avais donc dans cette enceinte même interrogé le précédent gouvernement, sollicitant l’instauration d’une procédure simplifiée pour que le stagiaire puisse saisir les inspecteurs du travail.
Alors que votre ministère vient de lancer la première plate-forme d’open data sur l’enseignement supérieur et la recherche, j’ai déposé un amendement qui s’inscrit aussi dans une perspective numérique visant à créer un portail internet par lequel stagiaires et établissements pourraient faire remonter des informations à l’inspection du travail.
Cette solution, simple à mettre en place, compléterait utilement les contrôles de l’administration du travail qui ne peuvent être exercés dans chaque entreprise.
J’en profite pour souligner qu’il faudrait prévoir la modernisation des publications ministérielles. Madame la secrétaire d’État, il serait bien de ne pas oublier le guide des stages du portail étudiant : il date de 2012 et cite un montant de gratification datant, lui, de 2010. Il n’est pas sûr que des informations obsolètes soient utiles aux futurs stagiaires… J’espère au moins que mon intervention sera utile de ce point de vue.
Sourires.

Autre abus : les stages conclus hors convention ou accordés sans réel suivi pédagogique. Ils sont susceptibles de poursuites, mais ils sont exceptionnels.
Quant à la conformité du stage avec l’objectif de formation fixé par la convention tripartite, elle peut – elle doit – être vérifiée par les établissements d’enseignement, afin d’éviter ce que vous appeliez vous-même les « stages photocopies ». L’implication de l’université ne devrait pas se limiter à une signature administrative de la convention. Jean-Pierre Godefroy l’a rappelé tout à l’heure.
La conférence des présidents d’université, lors d’une audition à laquelle M. le rapporteur m’avait conviée, a reconnu que les situations étaient très variables et estimé que les universités devaient davantage s’investir dans le déroulement du stage et son contrôle, même pendant les mois d’été. J’ai déposé des amendements directement issus de cette demande.
Cela étant, nous disposons déjà d’un arsenal juridique susceptible d’empêcher les abus. En réalité, il convient plutôt d’intensifier les contrôles, de centraliser les signalements des dérives et non de créer encore des obligations complémentaires qui, je le crois, risquent de tarir les offres de stages respectueux, alors que les vilains petits canards trouveront toujours un moyen de détourner la législation.
Les membres du groupe UMP reprochent à la proposition de loi la création d’un cadre encore plus rigide pour les entreprises, particulièrement pour les TPE et PME. Pour nous, la solution devrait être non pas une thérapie généralisée, y compris destinée aux biens portants, mais des mesures au cas par cas pour les malades.
Ce qui me gêne dans ce texte, c’est l’absence de recul. Son initiatrice semble ne pas avoir compris que la priorité était de préserver et de développer l’offre de stages.
C’est l’unique préoccupation qui a guidé mes collègues et moi-même lors du dépôt d’une trentaine d’amendements. Je pense que M. le rapporteur l’a bien compris.
Le meilleur service que l’on puisse rendre à nos jeunes n’est pas de les assimiler à des salariés ; le stage est pour eux avant tout un moment privilégié de formation nécessaire au cours de leur cursus et pour leur insertion professionnelle.
Outre leur dimension pédagogique essentielle et de mise en œuvre pratique des connaissances acquises, les stages doivent permettre aux jeunes de faire valoir une expérience lorsqu’ils rechercheront un emploi. Parfois, vous l’avez souligné, madame la secrétaire d’État, il arrive que le jeune soit embauché dans l’entreprise où il a effectué son stage.
Selon l’Association pour l’emploi des cadres, 20 % des diplômés de niveau bac+4 qui ont décroché un emploi dans l’année suivant la fin de leurs études l’ont trouvé sur leur lieu de stage.
Certes, par le présent texte, on cherche à protéger encore plus les stagiaires, ce qui est louable. Mais in fine l’effet obtenu risque d’être exactement inverse à l’objectif poursuivi. Sur ce point, je ne partage pas l’avis de M. le rapporteur.
Eu égard à mon expérience passée, je puis dire que le mieux est l’ennemi du bien.
Faisons un retour en 2009, lorsque je présidais la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Nous avions alors rendu obligatoire l’inscription du stage dans un cursus universitaire. Résultat : des milliers d’étudiants ont vu leur stage annulé parce que certaines universités, dans l’attente du décret prévu neuf mois plus tard, ont refusé de délivrer des conventions.
Je peux mettre à votre disposition des articles de presse attestant cette menace qui planait sur les stages professionnels. Il est à noter que des entreprises avaient même annulé certains d’entre eux.
Je vous invite à consulter le site du collectif Touche pas à mon stage, qui date de 2009-2010, lequel m’avait saisie entre Noël et le Jour de l’an. Vous mesurerez ainsi toutes les difficultés que nous avons rencontrées, malgré nos bonnes intentions.
La présente proposition de loi ne prévoit quasiment que des décrets, lesquels suscitent des inquiétudes du côté tant des établissements d’enseignement que des entreprises. Les établissements d’enseignement craignent la diminution de l’offre de stages et les contraintes qu’impose un quota de stagiaires par tuteur.
Par ailleurs, d’ici à deux ans, les stages ne pourront plus durer plus de six mois, alors que certains cursus prévoient un ou deux mois supplémentaires.
Je tiens à mentionner non seulement l’incompréhension des grandes écoles, qui ne pourront plus pratiquer l’année de césure, mais aussi celle des universités, qui l’acceptaient plutôt volontiers lorsqu’un étudiant le leur demandait. Cela affectera particulièrement les étudiants qui en profitaient pour effectuer un stage à l’international. Or, à l’étranger, parfois la notion de stage n’existe pas, les conventions tripartites encore moins.
De plus, les entreprises, plus particulièrement les TPE-PME, seront également soumises à un quota de stagiaires suivis par un même tuteur et, là aussi, les dérogations seront précisées par décret.
Cette absence de précisions n’est pas acceptable. Dans ce cas, pourquoi cette proposition de loi ? Nous, parlementaires, n’avons rien plus à définir ! Après l’autorisation donnée hier au Gouvernement de légiférer par ordonnances pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public à la suite de négociations, on nous demande aujourd’hui une habilitation à procéder par décrets. Étrange conception de notre rôle législatif…
Si, à titre personnel, je suis favorable à ce que les stagiaires puissent bénéficier de certains des droits des salariés, comme l’accès au restaurant d’entreprise ou l’indemnisation des frais de transport, la multiplication des formalités aura, je le crains, des conséquences catastrophiques, particulièrement pour les stages de courte durée. Ce risque a d’ailleurs été évoqué au cours de toutes les auditions que nous avons menées.
Alors que les ministres successifs du Gouvernement clament leur attachement à la négociation, je ne comprends pas pourquoi des accords de branche ne sont pas prévus.
La question du nombre de stagiaires est le meilleur exemple en la matière. Qu’y a-t-il de commun entre les activités d’une grande entreprise et celles d’une start-up, d’autant que, en cas de manquement, une sanction administrative importante est prévue ?
Vous avez déclaré tout à l’heure, madame la secrétaire d’État, que le quota fixé en l’espèce dépendrait du type d’entreprise, mais comment comptez-vous procéder ?
Au terme de mon propos, je citerai encore une fois mon expérience personnelle : lors de l’examen du projet de loi portant création des emplois d’avenir, nous avions alerté sur les difficultés qu’allaient provoquer certaines dispositions. Le Gouvernement ne nous a pas entendus. Néanmoins, il a bien été obligé d’assouplir son dispositif par la suite. Il en a été de même à l’égard des contrats de génération.
Il est temps que le Gouvernement soit un peu plus à l’écoute des parlementaires, fasse davantage confiance aux acteurs de terrain et aux partenaires sociaux. Ne stigmatisons pas toutes les entreprises !
Madame la secrétaire d’État, l’ensemble des amendements que les membres de mon groupe présenteront visera donc à introduire de la souplesse dans le dispositif, dans l’intérêt des stagiaires.
Je tiens enfin à saluer la qualité du travail et l’écoute de notre collègue Jean-Pierre Godefroy, dont l’implication sur le sujet est encore bien plus ancienne que la mienne.
J’aurais aimé, pour ma part, pouvoir réfléchir avec lui à la rédaction d’un texte sénatorial, éloigné des positions démagogiques et d’affichage de la présente proposition de loi.
Madame la secrétaire d’État, je vous crois sincère. Je souhaite une approche plus réaliste et plus pragmatique, qui permette de respecter l’équilibre indispensable entre la protection des droits des stagiaires et le maintien d’une offre de stages.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC . – M. Gilbert Barbier applaudit également.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous nous accordons tous pour dire que les stages en entreprise sont un vecteur important de professionnalisation et constituent un lien entre le système éducatif et l’entreprise.
L’enjeu est donc de permettre aux jeunes de se former tout en répondant aux besoins des entreprises. Ne pas dissuader les entreprises de prendre des stagiaires tout en protégeant mieux ces derniers doit être notre objectif.
Aujourd’hui, le nombre de stages en milieu professionnel s’élève à environ 1, 6 million par an, contre 600 000 en 2006, comme l’a dit M. le rapporteur. Le nombre de stagiaires a presque triplé en dix ans. Les stages abusifs sont estimés à 100 000 par an, soit 8 % du nombre total. Gardons à l’esprit le fait que 92 % des stages se déroulent dans de bonnes conditions. Il nous revient par conséquent de limiter les pratiques abusives sans accroître les contraintes pesant sur les entreprises.
Un certain nombre de dispositions visant à encadrer les stages ont déjà été adoptées, notamment sur l’initiative des centristes.
Ainsi, avec la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, Jean-Louis Borloo, alors ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, a instauré le principe du versement obligatoire d’une gratification pour tous les stages en entreprise d’une durée supérieure à deux mois consécutifs.
De plus, des règles ont été établies afin d’éviter les comportements abusifs de certaines entreprises. On peut citer, notamment, l’interdiction des stages hors cursus, la création d’un délai de carence entre deux stages, la possibilité de déduire la durée du stage de la période d’essai en cas d’embauche.
Enfin, la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a également permis que les stages en entreprise de plus de deux mois puissent, le cas échéant, être retenus à hauteur de deux trimestres dans le calcul des droits à la retraite.
La proposition de loi qui nous est présentée aujourd’hui vise à aller plus loin. Au-delà du fait que les entreprises nous réclament à cor et à cri une stabilité des règles applicables, le présent texte risque de passer à côté de l’objectif affiché. Instaurer de nouvelles contraintes à l’égard des entreprises se retournera contre les stagiaires qui, demain, risquent d’avoir du mal à trouver des entreprises acceptant de les accueillir. Nous tous, mes chers collègues, recevons des dizaines de demandes de stages et connaissons les difficultés rencontrées par les jeunes en la matière et leur angoisse.
Ainsi, mettre en place un taux maximal de stagiaires par entreprise est une fausse bonne idée. Cette mesure, en limitant la possibilité de recourir à des stagiaires, aurait des conséquences négatives, en particulier dans les petites entreprises. Or, chacun le sait, le tissu économique de notre pays est principalement constitué de petites entreprises. On peut donc légitimement s’inquiéter. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons que les entreprises de moins de dix salariés ne soient pas concernées par ce plafond.
De même, la suppression de toute dérogation à la durée maximale de six mois de stage causera des dommages collatéraux. La rédaction actuelle de la proposition de loi interdit de ce fait la possibilité de prendre une année de césure ou d’effectuer un stage de longue durée à l’étranger, cela vient d’être dit. Cela me semble être un non-sens, car ces options facilitent l’insertion des jeunes au moment de la recherche d’emploi. De plus, certaines formations exigent, en particulier dans le secteur agricole – n’est-ce pas, madame Férat ? – des stages d’une durée supérieure à six mois.
Par ailleurs, l’extension aux stagiaires de certains droits salariaux en matière, par exemple, de durée du travail ou de congés familiaux constitue pour les stagiaires, qui doivent rester avant tout des élèves en formation, un glissement vers le statut de salarié. Ne nous y trompons pas, mes chers collègues, cette mesure risque de constituer un signal très négatif pour les entreprises, amenant certaines d’entre elles à renoncer à prendre des stagiaires, dont la productivité n’est naturellement pas la même que celle d’un salarié.
De plus, le fait de confier le contrôle de la situation des stagiaires aux inspecteurs du travail plutôt qu’aux autorités académiques participe de ce glissement du statut de stagiaire vers celui de salarié. Toute assimilation du stage à un contrat de travail vient à l’encontre du principe même du stage, dont l’objet est de contribuer à la formation des jeunes.
C’est pourquoi, si nous devons encourager les entreprises à accueillir davantage de stagiaires, nous devons également éviter les abus.
La prévention de ces excès repose en grande partie sur la responsabilité conjointe de l’ensemble des signataires de la convention de formation, particulièrement de l’établissement d’enseignement, émetteur de la convention.
Or, avec le présent texte, vous vous contentez d’augmenter les obligations des employeurs, ce qui, vous en conviendrez, est assez incohérent par rapport au choc de simplification que vous prétendez vouloir mettre en œuvre. Un stagiaire devra désormais avoir non seulement un tuteur, mais aussi un référent, bénéficier d’un volume pédagogique minimal, et être inscrit au registre unique du personnel : autant de contraintes supplémentaires et de rigidité, assorties de pénalités qui risquent de dissuader les entreprises et les collectivités de prendre des stagiaires. Je pense, entre autres, aux start-up, grandes utilisatrices de stagiaires.
Pour notre part, nous proposons davantage de souplesse. Nous suggérons, par exemple, que la détermination des horaires de présence des stagiaires relève de la convention de stage. Le stagiaire qui s’absenterait quelques jours pour passer des examens, des entretiens, ou encore pour assister à des cours, en conviendrait avec son tuteur et ne serait pas pénalisé.
Si l’objet de ce texte est véritablement d’empêcher les abus liés aux stages, pourquoi ne pas inscrire clairement dans la loi l’interdiction des stages postérieurs à la formation, effectués à l’issue d’un cursus universitaire ?
Les jeunes qui auront la chance de décrocher un stage seront bien protégés, mais ils seront, hélas !, de moins en moins nombreux, au moment où justement il faudrait développer les stages, puisque la qualification et l’employabilité des jeunes passent par des contacts avec la pratique professionnelle. De surcroît, les stages sont indispensables pour valider nombre de diplômes professionnalisant – ce n’est pas Mme la secrétaire d’État chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche qui me contredira. Certains jeunes risquent ainsi d’être privés de diplômes, faute de trouver un stage.
En résumé, avec ce texte, qui donnera, il est vrai, plus de droits au stagiaire, le risque est grand de voir se réduire drastiquement le vivier des offres de stages – je ne partage pas l’optimisme de M. le rapporteur –, car les employeurs seront de toute évidence effrayés par ces mesures dissuasives et inutilement coercitives.
Si je voulais résumer d’une phrase mon propos, je dirai, comme Catherine Procaccia : « le mieux est souvent l’ennemi du bien ». Nous ne devons plus nous contenter de bonnes intentions, de ce qui semble superficiellement aller dans le bon sens. Nous devons au contraire entrer, selon la volonté gouvernementale – c’est en tout cas ainsi que je l’ai comprise –, dans l’ère de l’efficacité. C’est ce à quoi les membres de mon groupe aspirent.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, eu égard à l’explosion du nombre de stagiaires en France, estimé – cela a été dit – à 1, 6 million par an, les membres du groupe communiste républicain et citoyen partagent avec M. le rapporteur, comme avec l’auteur de la présente proposition de loi, la conviction qu’il est nécessaire que la loi apporte une réponse globale et mette en place un cadre juridique stable des stages pour garantir aux stagiaires des droits qui, souvent, leur font défaut.
Trop d’abus ont été et sont encore commis, au seul prétexte que les stages en entreprise sont devenus des passages obligés dans certains cursus universitaires rendant les étudiants captifs.
Bien entendu, il serait exagéré d’affirmer que tous les stages en entreprise donnent lieu à des abus. Pour autant, les témoignages des associations et syndicats étudiants, l’UNEF ou le collectif Génération précaire notamment, sont de plus en plus négatifs : soit les droits élémentaires des stagiaires sont méconnus, soit le stage sert en réalité aux employeurs de voie de contournement aux règles du travail, à tel point que le ou les stagiaires qui se succèdent occupent des postes correspondant à un emploi permanent.
Il était donc nécessaire de légiférer, notamment pour préciser l’objectif du stage – tel est le sens de l’article 1er.
À ce titre, nous nous réjouissons que, pour la première fois, les missions de l’établissement d’enseignement envers le stagiaire soient clairement énoncées et que la vocation pédagogique du stage soit réaffirmée.
De la même manière, comment ne pas nous féliciter que toute discrimination ou tout harcèlement d’un stagiaire tombe sous le coup de la loi, comme ceux qui sont commis à l’égard de tout salarié ?
Ainsi, les stagiaires verront leurs droits consolidés dans les établissements d’accueil. Je pense, par exemple, à l’extension à leur profit du droit à un congé de maternité ou de l’application des règles relatives au temps et à la durée de travail.
M. le rapporteur a par ailleurs renforcé le dispositif en prévoyant de limiter la durée hebdomadaire de travail à 35 heures ou en insérant dans le code du travail une section relative à une demande de requalification en contrat de travail d’une période de formation en milieu professionnel ou d’un stage devant les conseils de prud’hommes.
Les amendements que vous avez présentés lors des travaux de la commission, monsieur le rapporteur, s’inscrivent dans la continuité de la proposition de loi que vous aviez déposée en 2006, et cela vous honore.
Toutefois, et vous ne le contesterez sans doute pas, la rédaction, même améliorée, de l’article susvisé et, de manière plus générale, de cette proposition de loi demeure moins ambitieuse que ce que vous aviez vous-même proposé, ce que nous regrettons.
Je ne prendrai que quelques exemples pour étayer mon propos. Le présent texte réaffirme la portée pédagogique du stage, mais renvoie au décret la fixation du nombre de stagiaires qu’un même tuteur peut encadrer.
De même, il prévoit de réduire les cas de recours abusifs au stage, mais ne précise pas clairement le nombre de stagiaires qu’un organisme peut accueillir, alors que, en 2006, vous proposiez qu’il n’excède pas 15 % de l’effectif total.
Si la proposition de loi précise à raison que l’enseignement, qui sert en quelque sorte de support au stage, doit avoir une durée minimale, elle reste silencieuse sur cette durée. En outre, elle ne supprime pas le recours à des diplômes universitaires de complaisance. Or l’inscription à ces diplômes, qui n’ont pas de portée nationale, constitue la première faille permettant les abus. Je regrette d’ailleurs que ce texte n’indique pas que la durée d’enseignement devrait être systématiquement supérieure à la durée du stage.
En outre, et cela nous paraît être l’insuffisance la plus importante, le montant minimal de la gratification demeure identique à celui d’aujourd'hui et son versement ne sera dû que pour les stages dont la durée excède deux mois comme actuellement.
Or la proposition de loi sénatoriale que vous aviez présentée en 2006, mon cher collègue, rejetée par la droite, était plus ambitieuse. Le changement de majorité politique à l’Assemblée nationale et au Sénat rend pourtant possible l’adoption de la mesure que vous aviez alors proposée. C’est pourquoi nous avons déposé un amendement allant dans ce sens.
Je voudrais d’ailleurs, sur un sujet connexe, faire part de notre étonnement et de notre mécontentement. Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi prévoit que les stagiaires ne bénéficiant d’aucune gratification n’auront droit ni aux titres-restaurant, ni à la restauration scolaire, ni à la prise en charge des frais de transport. En définitive, les plus précaires des plus précaires sont ceux qui ont le moins de droits !
Autre point que je tiens à mettre en exergue, à l’Assemblée nationale, nos collègues du groupe Gauche démocrate et républicaine sont parvenus à faire adopter un amendement pertinent, tendant à accélérer la procédure de requalification d’une convention de stage en contrat de travail. Pour autant, il nous paraît opportun de préciser dans la loi le cadre complet dans lequel cette demande de requalification peut être formulée. La situation est en effet quelque peu étonnante, la proposition de loi indiquant les conditions dans lesquelles la demande peut être portée devant les juges prud’homaux, mais non les cas dans lesquels les stagiaires peuvent la présenter.
Si les amendements que nous avons déposés sur ce point n’étaient pas adoptés, le fondement de cette saisine demeurerait jurisprudentiel et, par voie de conséquence, soumis à une forme d’aléa, alors même qu’il existait auparavant, dans le code du travail, un article R. 136-32 précisant les cas dans lesquels cette demande de requalification était possible.
Positive dans l’esprit, constituant sans doute un premier pas dans la voie du renforcement de leurs droits, cette proposition de loi n’apporte pas pour autant toutes les protections attendues par les stagiaires de notre pays, comme en témoignent, je l’ai déjà souligné, les divers courriers et interpellations que nous avons reçus de la part d’étudiants, d’organisations syndicales ou de collectifs.
C’est pourquoi, monsieur le rapporteur, nous ne pouvons pleinement vous suivre lorsque vous affirmez qu’elle est la concrétisation de l’engagement 39 du candidat François Hollande qui prévoyait un encadrement des stages afin d’empêcher les abus.
Cette concrétisation est effectivement partielle, alors que votre propre proposition de loi aurait, mon cher collègue, permis une réalisation complète, et elle l’est d’autant plus que le même engagement 39 prévoyait la création d’une allocation d’autonomie pour les jeunes. Or celle-ci se fait encore attendre…
Par conséquent, les membres du groupe CRC, comme à leur habitude, soutiendront les mesures positives, seront critiques à l’égard des faiblesses du présent texte et se voudront également force de proposition pour combler ses insuffisances, comme l’attestent les amendements que nous avons déposés.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, à l’heure où le chômage des jeunes à caractère structurel est très élevé, les stages occupent une place de plus en plus importante dans le cheminement de ces jeunes vers l’insertion professionnelle.
La volonté légitime d’améliorer le sort des stagiaires a conduit au développement d’une réglementation foisonnante, environ une dizaine de textes ayant été adoptés depuis 2006. La présente proposition de loi tend de nouveau à modifier un cadre juridique pourtant déjà très complet.
S’il convient de saluer la codification et la simplification du droit, il est à craindre que certaines des mesures proposées ne se heurtent à la problématique de l’offre de stages, surtout étant donné la situation économique actuelle de notre pays.
La demande de stages de la part des étudiants s’accroît. Le nombre des stagiaires a triplé – je n’insisterai pas sur ce point qui a déjà été souligné –, et les formations intègrent de plus en plus de stages. La multiplication du nombre de critères exigés dans les annonces prouve la concurrence qui peut exister en la matière : niveau élevé d’études, suivi de plusieurs cursus dans des domaines différents, pratique courante de plusieurs langues, expériences antérieures... On demande désormais au stagiaire des qualifications identiques à celles que l’on attend d’un salarié !
Certes, les abus demeurent et il convient de les sanctionner sous peine de précariser certains jeunes. Mais faut-il pour autant aller plus loin, à un moment où la situation économique de notre pays est délicate ?
Tout d’abord, comme plusieurs orateurs l’ont souligné s’agissant de la transposition du cadre législatif relatif aux stages aux périodes de formation en milieu professionnel réalisées avant le baccalauréat, nous savons que les élèves rencontrent plus de difficultés que leurs aînés de l’enseignement supérieur lors de la recherche d’un stage, alors que celui-ci constitue une condition nécessaire à l’obtention du diplôme.
La durée, le délai de carence entre deux stages, la gratification, l’encadrement, les congés, le quota maximal de stagiaires ne sont donc pas adaptés à ces formations. La durée maximale ne se justifie pas pour les stages effectués en alternance scolaire, qui implique un déroulement simultané du stage et des enseignements, et l’extension de l’obligation de gratification est insoutenable pour les petites structures, sachant, en outre, que les jeunes sont inexpérimentés. Ces mesures auront donc pour conséquence le tarissement de l’offre de stages dans certains secteurs, notamment l’artisanat et, surtout, l’agriculture.
Les stages accomplis dans le cadre de l’enseignement supérieur n’échappent pas à ces effets négatifs.
La question de la durée pose de réels problèmes dans certaines filières où la pratique est essentielle. Qu’en est-il des 500 heures de stage nécessaires à l’obtention du titre de psychologue ? Qu’en est-il des deux années de stage requises pour devenir commissaire-priseur ? La législation en vigueur demeure plus pertinente puisque les dérogations peuvent être encadrées par décret. Il suffisait de publier ce décret, au lieu de mettre fin aux dérogations sans autoriser aucune flexibilité et sans avoir discuté au préalable avec les filières de formation concernées et obtenu leur accord.
En outre, s’il est prévu que le quota maximal de stagiaires par organisme d’accueil soit fixé par décret, je m’interroge, comme les orateurs précédents, sur les modalités de sa détermination. À l’évidence, on ne peut appliquer aveuglément un pourcentage identique à tous les organismes d’accueil. Quel niveau fixer ? À supposer qu’il s’établisse à 10 % des effectifs, seul un stagiaire pourrait être accueilli dans une structure de dix salariés, et aucun en dessous de ce seuil !
À l’heure du choc de simplification et du pacte de responsabilité, cette proposition de loi crée un climat de méfiance et de présomption de culpabilité à l’égard des entreprises, qui, pourtant, ne commettent pas toutes des abus. Je pense notamment au rôle, encore renforcé, de l’inspecteur du travail.
Par ailleurs, certains stages s’assimilant parfois à un emploi peuvent être appréciés des étudiants car ils leur permettent d’acquérir une expérience professionnelle intéressante qu’ils pourront valoriser par la suite. De tels stages, formateurs et souvent gratifiés, peuvent éventuellement ouvrir la voie à une embauche. Il faut le rappeler, un stage sur cinq aboutit à la signature d’un contrat de travail.
Plutôt que de pénaliser injustement l’ensemble des entreprises, ne convient-il pas d’appliquer le droit existant ? Les étudiants peuvent actuellement évaluer la qualité de l’accueil dont ils ont bénéficié, ce qui permet à l’établissement d’enseignement de vérifier que les droits des stagiaires sont respectés. Les données lacunaires relatives aux abus dont nous disposons pourraient être enrichies. Les étudiants disposent également de la possibilité de demander une requalification de leur stage en contrat de travail.
Mes chers collègues, nous partageons tous la même volonté de mettre fin aux abus dont peuvent être victimes les stagiaires et de lutter contre le chômage des jeunes. Toutefois, les nouvelles contraintes qui seraient créées à la suite de l’adoption de cette proposition de loi, à l’efficacité douteuse pour atteindre la finalité recherchée, pourraient compromettre le développement d’offres de stages et entretenir ainsi une inégalité d’accès au stage.
Certains de mes collègues et moi-même avons donc déposé des amendements ayant pour objet de mieux adapter ce texte aux réalités quotidiennes. Nous espérons être entendus ! §

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui a pour objet de développer, d’encadrer et d’améliorer le statut des stagiaires. Ce triple objectif est louable pour mieux réguler une période de formation indispensable aux étudiants et faire en sorte qu’elle reste un temps d’apprentissage, sans se muer en emploi déguisé.
Il convient de lutter avec fermeté aussi bien contre les entreprises ayant tendance à considérer les stagiaires comme des employés bon marché que contre les instituts de formation délivrant trop légèrement des conventions de stage. Je pense aussi à tous ces blogs, sur lesquels, madame la secrétaire d’État, il serait intéressant de jeter un coup d’œil : on y recherche de manière urgente des stagiaires, mais les annonces sont rédigées de telle sorte – tout est défini, des qualités recherchées aux tâches à effectuer – qu’elles apparaissent rapidement comme de véritables propositions d’emploi.
Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications estime que plus de 100 000 stagiaires, sur les 1, 6 à 2 millions que compte notre pays, seraient en fait des salariés déguisés, soit une proportion d’au moins 6, 25 %.
Il me semble que nous sommes tous d’accord dans cet hémicycle pour considérer le stage comme un élément de la formation, et non comme un premier emploi. Nous partageons tous cette analyse : le stage fait partie du cursus pédagogique et n’est en aucun cas un emploi. Comme il peut coûter cher, une indemnisation est prévue pour compenser les frais de déplacement, de représentation, etc. Mais il s’agit bien d’une indemnisation, et non d’un salaire.
Évidemment, la frontière entre les deux notions est étroite. En fin de formation, les stages deviennent beaucoup plus intéressants. Fort de son potentiel, de sa créativité, de sa jeunesse, le stagiaire a envie de s’investir. Il se réalise. Dès lors, il a tendance à préférer qu’on lui confie un poste ressemblant à son futur travail plutôt que de rester derrière les autres à les regarder travailler.
Cela étant, la présente proposition de loi comprend une série de mesures équilibrées.
L’article 1er met fin aux dérogations à la durée maximale de six mois pour un stage, afin de ne plus faire face à ces situations insupportables dans lesquelles des étudiants restent neuf mois ou un an en stage, avec une indemnisation mensuelle dépassant à peine 400 euros. Or, dans ces cas de figure, le stage ressemble tout de même beaucoup à un emploi !
En matière de rémunération, nous proposerons que les stages donnent lieu à une rétribution dès lors que leur durée est d’un mois, au lieu de deux actuellement.
Pour renforcer l’objectif pédagogique du stage, il est envisagé d’instaurer un volume minimal de formation en établissement avant la délivrance d’une convention. Cette mesure est accompagnée d’une obligation d’encadrement de l’étudiant aussi bien universitaire, via l’enseignant référent, que professionnel, via le tuteur de stage, un nombre maximal d’étudiants par tuteur et par enseignant étant prévu.
La proposition de loi renvoie à un décret la délimitation des seuils correspondants. Mais nous considérons que ceux-ci doivent être débattus dès maintenant. C’est pourquoi nous vous proposerons, mes chers collègues, que le volume minimal de formation soit fixé à 200 heures et qu’un enseignant ne puisse suivre plus de vingt-cinq stagiaires.
Pour ce qui concerne la protection des stagiaires, le texte définit des durées de travail maximales, reconnaît des droits aux congés, aux titres-restaurant, aux frais de transport, et renforce le rôle de l’inspection du travail pour contrôler les abus. Ces mesures sont salutaires et présentent un intérêt certain en vue de mieux protéger les stagiaires. Mais, cela a été souligné, ces dispositions soulèvent de nouveau la question, de toute évidence délicate, de la frontière entre formation et salariat.
Limitation de la durée de stage, renforcement du caractère pédagogique, amélioration de la protection du statut des stagiaires : ce sont des mesures équilibrées que cette proposition de loi comporte. C’est pourquoi, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je vous annonce que les membres du groupe écologiste se prononceront en faveur de ce texte.
Néanmoins, je n’achèverai pas mon intervention ici, tenant à apporter deux brefs commentaires annexes.
D’une part, puisqu’il est question de gratification, je rappelle que le groupe écologiste est favorable à une allocation universelle pour les étudiants. La pauvreté est grande parmi la jeunesse et chacun doit avoir les moyens de suivre une formation.
D’autre part, si l’adoption de cette proposition de loi permettra de bien encadrer les stages et d’améliorer le statut des stagiaires, l’accès au premier emploi n’en demeure pas moins le problème principal. Voilà la vraie question ! Si les jeunes acceptent les conditions imposées, s’ils veulent effectuer des stages, c’est guidés par l’espoir que, en se confrontant, stage après stage, à l’entreprise, leur talent et leur potentiel seront reconnus. Alors, ils se sentiront utiles.
Ainsi, nous voterons cette proposition de loi, mais nous considérons nécessaire qu’un effort soit réalisé par tous pour permettre aux jeunes de trouver un premier emploi et de mettre leur créativité, leur dynamisme, leur fougue au service des entreprises et de la société. §

Mes chers collègues, en raison de la modification de l’ordre du jour initialement prévu ce soir, je vais devoir interrompre la discussion de la présente proposition de loi.

L’amendement n° 59 rectifié bis de notre collègue Charles Revet qui tend à une nouvelle rédaction de l’article 1er de la présente proposition de loi doit faire l’objet d’une discussion commune avec plus de cent autres amendements, ce qui n’apportera guère de clarté à nos débats.
C’est pourquoi, monsieur le président, en application de l’article 49, alinéa 2, du règlement, la commission souhaite qu’il soit disjoint des autres amendements et examiné séparément.

Je consulte le Sénat sur cette demande.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.

Par lettre en date du 29 avril 2014, le Gouvernement demande de compléter l’ordre du jour :
- du lundi 5 mai 2014, le soir, par l’examen du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique ;
- du mardi 6 mai 2014, l’après-midi et le soir, par la suite de l’examen de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires.
En conséquence, l’ordre du jour des séances des lundi 5 et mardi 6 mai 2014 s’établit comme suit :
Lundi 5 mai 2014
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
À 16 heures :
1°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à l’interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié (n° 455, 2013-2014)
La commission des affaires économiques se réunira pour le rapport le mercredi 30 avril matin.

Le soir :
2°) Suite éventuelle de la proposition de loi relative à l’interdiction de la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié
3°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique (texte de la commission, n° 437, 2013-2014)
La conférence des présidents a :

Mardi 6 mai 2014
À 9 heures 30 :
1°) Questions orales
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
- n° 677 de M. Simon Sutour à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice
Suppression de la cour d’appel de Nîmes
Situation des mineurs étrangers isolés accédant à la majorité

- n° 693 de M. Alain Gournac à M. le ministre des finances et des comptes publics
Contrôle sur la vente d’or en ligne

- n° 700 de Mme Hélène Masson-Maret à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement
Inadaptation de la réglementation actuelle relative au loup

- n° 713 de M. Gérard Bailly à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche
Trains express régionaux et désenclavement du haut Jura

- n° 715 de M. Jean-Marc Todeschini à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement
Avenir de la filière bois en Lorraine

- n° 717 de M. Ronan Kerdraon à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Traitement de la cataracte

- n° 719 de M. Daniel Laurent à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Géothermie de minime importance

- n° 720 de M. Robert Laufoaulu à M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique
Fonds marins de la zone économique exclusive de Wallis-et-Futuna

- n° 723 de Mme Aline Archimbaud à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Discrimination des personnes séropositives jusque dans la mort

- n° 725 de M. Jean-Jacques Lozach à M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique
- n° 726 de M. Robert Tropeano à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Dotation horaire globale du collège de Bessan

- n° 727 de M. Philippe Madrelle à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion
Financements apportés par l’État à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde

- n° 729 de M. Georges Labazée à Mme la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire
Difficultés rencontrées par les copropriétaires en résidence de tourisme

- n° 731 de M. Jean-Pierre Vial à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche
Liaison ferroviaire Lyon-Turin

- n° 735 de M. Marcel Rainaud à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement
Recherche sur les maladies du bois de la vigne

- n° 736 de M. Jacques Mézard à M. le secrétaire d’État chargé du budget
Baisse du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

- n° 737 de M. Yannick Vaugrenard à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Situation de la clinique mutualiste de l’Estuaire et du centre hospitalier de Saint-Nazaire

- n° 738 de M. Yves Détraigne à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Logo « Triman » et décret d’application
Sécurisation des quittances d’électricité utilisées comme justificatifs de domicile

À 14 heures 30 et le soir :
Ordre du jour fixé par le Gouvernement :
2°) Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre dans le cadre de la sous-traitance et à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale (n° 397, 2013-2014)
La commission des affaires sociales se réunira pour le rapport le mercredi 30 avril matin.

3°) Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires (texte de la commission, n° 459, 2013-2014)
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt-et-une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.