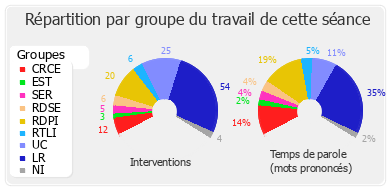Séance en hémicycle du 7 mai 2015 à 15h00
Sommaire
- Questions cribles thématiques (voir le dossier)
- Modification de l'ordre du jour (voir le dossier)
- Octroi de mer (voir le dossier)
- Nomination de membres d'une éventuelle commission mixte paritaire
- Communications du conseil constitutionnel
- Croissance activité et égalité des chances économiques (voir le dossier)
La séance
La séance, suspendue à treize heures vingt-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle les questions cribles thématiques sur la forêt française
Je rappelle que l’auteur de la question et le ministre pour sa réponse disposent chacun de deux minutes. Une réplique d’une durée d’une minute au maximum peut être présentée soit par l’auteur de la question, soit par l’un des membres de son groupe.
Je rappelle également que ce débat est retransmis en direct sur France 3 et sur Public Sénat.
La parole est à M. Alain Houpert, pour le groupe UMP.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la forêt est obscure et j’espère que nos interventions laisseront filtrer quelques de rais de lumière.
Si Yannick Botrel et moi-même avons présenté, le mois dernier, au nom de la commission des finances, un rapport intitulé Faire de la filière forêt-bois un atout pour la France, c’est parce que notre pays n’est pas la puissance forestière qu’il pourrait être.
Notre travail, appuyé sur une enquête de la Cour des Comptes, a permis de démontrer que la politique forestière est aujourd’hui sans stratégie, sans pilote et sans résultats. Les cinq ministères qui mettent en œuvre un ou plusieurs volets de cette politique adoptent, chacun dans leur coin, une vision des enjeux qui leur est propre.
Ma première question, madame la secrétaire d’État, est issue de ce constat : quand et selon quelles modalités allez-vous construire un lieu de concertation et de décision interministérielle pour cette filière ? Il s’agit d’une urgence impérative pour la construction d’un pilotage stratégique de la filière, première de nos recommandations.
Par ailleurs, la France a fait le choix d’un modèle économique de pays en développement. Cette politique se reflète dans les graves déséquilibres entre l’exportation de bois brut et l’importation de produits transformés. C’est cette situation qui conduit à un déficit commercial de la filière de 6 milliards d’euros par an, soit 10 % du déficit total de la balance commerciale de notre pays. Quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre pour rétablir l’équilibre économique de la filière ? Quel regard porte-t-il sur les sept recommandations que Yannick Botrel et moi-même avons formulées dans notre rapport ?
Je souhaite plus particulièrement, madame la secrétaire d’État, que vous nous indiquiez vos réactions sur trois de nos sept préconisations : rapprocher les interprofessions et autres organisations professionnelles ;…

… tourner l’Office national des forêts, l’ONF, vers une logique de performance et de résultats ; réorienter les aides à l’aval, en stabilisant les soutiens au bois-énergie et en soutenant davantage le bois d’œuvre, tout particulièrement le secteur de l’ameublement made in France.
En bref, comment entendez-vous faire enfin de la filière forêt-bois un atout pour la France ?
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais tout d’abord vous demander de bien vouloir excuser l’absence de Stéphane Le Foll, lequel aurait volontiers répondu à vos questions s’il n’avait dû se rendre au G20 agricole, qui se tient à Istanbul cet après-midi et demain.
Je souhaite, au nom du Gouvernement, saluer la qualité des travaux de la Cour des comptes et souligner l’intérêt de disposer, par le biais du rapport évoqué, d’une vision d’ensemble des soutiens financiers apportés à la filière bois.
Je souhaite également rappeler que le rapport porte sur la période 2006-2013 et que la Cour constate d'ores et déjà des avancées dans la politique menée par le Gouvernement depuis 2012.
S’agissant de la gouvernance de la filière forêt-bois, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, promulguée le 13 octobre 2014, a été l’occasion de rénover les structures de gouvernance autour du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. Ce conseil dispose en effet de compétences couvrant l’ensemble des fonctions sociales, économiques et environnementales de la forêt et des produits forestiers. En outre, il réunit l’ensemble des acteurs impliqués, publics et privés.
La loi précitée prévoir également qu’une stratégie de filière sera définie au plan national au travers du programme national de la forêt et du bois. Ce dernier est en cours d’élaboration avec l’ensemble des acteurs.
Ces travaux reprennent en particulier l’ensemble des orientations adoptées le 16 décembre dernier dans le contrat de filière, au sein du comité stratégique de filière adossé au Conseil national de l’industrie.
Le contrat de filière se caractérise par son interministérialité – ce qui est indispensable, comme vous l’avez rappelé, monsieur Houpert –, alors même que la Cour des comptes souligne souvent le manque de travail interministériel dans les politiques de la forêt et du bois menées ces dernières années. Ce contrat a ainsi été signé par la ministre chargée de l’écologie et de l’énergie, le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé de l’industrie et la ministre chargée du logement.
Cette stratégie nationale à dix ans sera ensuite déclinée en région.
Concernant vos sept propositions, sachez que Stéphane Le Foll et ses collaborateurs n’hésiteront pas à les examiner et à vous apporter des éléments de réponse sur chaque point évoqué.

Merci de votre réponse, madame la secrétaire d’État.
Nous pensons qu’un choc de simplification est nécessaire en matière de gouvernance. Par ailleurs, nous souhaitons que le contrat de filière permette de mettre en place davantage d’aides en aval, pour des produits bois made in France.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Nous le disons tous, de nombreux rapports le soulignent, la filière bois est une filière d’avenir. Cette ressource peut servir de levier de développement aux territoires ruraux et hyper-ruraux tant en termes de création d’emploi que de valeur ajoutée.
Très concrètement, je vais m’appuyer sur un sujet que je connais, celui de la forêt lozérienne, dont l’intérêt n’est pas que de recéler des cèpes, des bécasses et autres volatiles.
Sourires.

En Lozère, la filière bois représente 2 000 emplois. Elle est plutôt bien structurée et permet, contrairement à ce qui se passe dans certains autres départements français, de transformer localement la majeure partie des coupes lozériennes.
Cependant, depuis des années, on constate que l’on pourrait mieux utiliser le bois. Les différentes données existantes montrent une évolution qualitative positive de la forêt lozérienne. Ainsi, à la fin des années quatre-vingt-dix, environ 8 % des bois vendus étaient destinés au chauffage, 76 % étaient affectés à la première transformation sans grande valeur ajoutée et 16 % seulement à la deuxième transformation, avec une meilleure valeur ajoutée et surtout de l’emploi à la clé.
Aujourd’hui, on estime que 20 % du bois vendu est destiné à cette deuxième transformation. D’ici à 2030, c’est-à-dire demain, environ 30 % des bois lozériens commercialisés devraient faire l’objet de cette deuxième transformation.
L’enjeu, vous l’aurez compris, est la transformation locale de ce bois-construction et l’adaptation de cette petite industrie à cette ressource plus favorable. Il s’agit d’une question majeure, sachant que la deuxième transformation représente dix fois plus d’emplois. Cela représente des dizaines, des centaines d’emplois supplémentaires dans chacun des départements hyper-ruraux et forestiers.
Toutefois, plusieurs problèmes se posent.

M. le président. Merci d’évoquer ces problèmes rapidement, monsieur Bertrand !
Sourires.

Que fait-on maintenant que le Fonds national forestier n’existe plus ? Comme nous ne replantons pas, une baisse de la production de bois-construction est à craindre.
Madame la secrétaire d’État, quelles aides à destination des PME de la filière de deuxième transformation envisagez-vous ? Quelle est la stratégie du Gouvernement pour favoriser l’investissement forestier et préparer la création de milliers d’emplois dans nos petits départements forestiers ?
Applaudissements sur les travées du RDSE, du groupe socialiste et de l’ UMP.
Monsieur Bertrand, comme je l’indiquais voilà quelques instants, le contrat de filière, signé par quatre ministres, a permis de définir un cadre.
Au travers de ce contrat, nous proposons une large gamme d’actions : mise en place d’outils de pilotage et élaboration de la stratégie de la filière bois ; structuration du segment industriel et du tissu entrepreneurial ; promotion et développement des emplois de la filière bois ; compétitivité par l’innovation de nos entreprises ; marketing et design pour mieux vendre nos produits bois à l’export et en France ; adaptation de l’offre de première transformation aux besoins des marchés de la seconde transformation ; sécurité des approvisionnements en bois de la filière.
En matière de financements, vous rappelez que le « Fonds bois II », consacré aux investissements dans les outils de transformation, est en cours de constitution. La participation de Bpifrance est d’ores et déjà acquise à hauteur de 25 millions d’euros et la recherche de financements privés est en cours.
Quant à l’investissement forestier, la création du Fonds stratégique de la forêt et du bois, dont l’enveloppe devrait atteindre à terme 30 millions d’euros, va se combiner à l’extension du fonds chaleur à la mobilisation du bois-énergie – pour la première fois, 30 millions d’euros sont consacrés cette année à l’alimentation en bois de la production énergétique.
Nous avons également souhaité mettre en place un nouveau compte d’investissement forestier et d’assurance, qui permettra, à travers des mesures fiscales, de dynamiser la mobilisation et de soutenir la transformation du bois sur notre territoire, gage de création d’emplois dans les territoires ruraux et hyper-ruraux qui vous sont chers.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, ainsi que M. le ministre de l’agriculture, de l’ensemble de ces précisions.
Un vrai dispositif et une véritable stratégie ont bel et bien été mis en place. Je vous demanderai toutefois de faire en sorte que les préfets soient les chefs d’orchestre de cette stratégie dans les territoires, les interlocuteurs des investisseurs privés et publics. De cette manière, les entrepreneurs pourront s’adresser à une sorte de guichet unique à même de leur indiquer quelles sont les cordes dont notre arc dispose pour mettre enfin en valeur nos forêts et nos entreprises forestières, et ainsi créer de l’emploi.
Je suis satisfait de cette réponse, mais tâchons de progresser encore sur l’aspect fonctionnel, car nos entrepreneurs et propriétaires forestiers sont un peu perdus.
M. Jean-Louis Carrère applaudit.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd’hui pour cette session de questions cribles thématiques sur la forêt française.
Nous avons pris connaissance du rapport de nos collègues de la commission des finances intitulé Faire de la filière forêt-bois un atout pour la France.
Si le diagnostic qu’il pose est fort intéressant, je déplore que ce rapport aborde la problématique de la forêt française d’une manière essentiellement comptable. Il recommande notamment une recomposition de la forêt vers les résineux au regard de la demande.
Cette approche comptable de court terme doit être revue afin de prendre en compte les aspects non seulement économiques – ceux-ci, bien évidemment, ont aussi leur importance aux yeux des écologistes –, mais aussi écologiques, notamment la biodiversité et le stockage naturel du carbone.
On doit envisager d’innover en associant des essences à plus haute valeur ajoutée économique et en renforçant les aménités environnementales. Il est grand temps de repenser la forêt dans toute sa diversité, en tant que milieu vivant, et de remettre en cause les coupes à blanc systématiques, nuisibles pour les sols et leur structure et très émettrices de carbone. La qualité et la santé de nos forêts auraient tout à y gagner.
Une parcelle forestière gérée durablement permet au sol de jouer son rôle de puits de carbone, objectif affiché par la France, notamment son ministre de l’agriculture, en vue de la COP 21, la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de Paris, au travers du projet de recherche international « 4 pour 1000 » : il s’agit de développer la recherche agronomique, afin d’améliorer les stocks de matière organique des sols de 4 pour 1000 par an. Une telle augmentation permettrait de compenser, à l’échelle mondiale, l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de la planète. C’est dire si la forêt végétale et le sol de cette forêt ont un rôle essentiel à jouer.
Madame la secrétaire d’État, pouvez-vous nous indiquer quelle est la position du Gouvernement en matière de gestion des forêts françaises, pour garantir une cohérence de l’exploitation et une amélioration des aménités environnementales en termes de biodiversité et de stockage du carbone dans les sols forestiers ?
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du RDSE et du groupe CRC.
Monsieur Labbé, je tiens à vous rassurer : dans le respect de nos engagements européens et internationaux, la gestion durable est le principe de base qui guide la politique forestière nationale.
La récente loi d’avenir a d’ailleurs rappelé ce principe en reconnaissant d’intérêt général la protection et la mise en valeur des bois et forêts, ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable.
L’importance des aménités forestières, que ce soit en termes de biodiversité, de lutte contre le réchauffement climatique ou de fonctions récréatives, est régulièrement réaffirmée. Le programme national de la forêt et du bois, en cours d’élaboration, en sera la traduction concrète pour les dix prochaines années. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue que, à ce jour, seules la production de bois et la chasse sont génératrices de recettes et permettent aux propriétaires publics ou privés d’entretenir leurs forêts et d’y investir.
La forêt n’a jamais cessé d’être pensée comme un milieu vivant. La coupe rase ou à blanc ne signifie pas forcément destruction de la biodiversité ou appauvrissement des sols. Il est question de mesure ; il est question de savoir bien gérer la forêt.
Pour ce qui concerne les enjeux climatiques, la forêt et l’agriculture seront au cœur des négociations de la prochaine COP 21, conformément à la volonté affirmée à plusieurs reprises par Stéphane Le Foll.
La forêt et les terres ont un rôle très important à jouer dans l’atteinte des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La dynamisation de la sylviculture – visée partagée par France Nature Environnement – et l’agronomie peuvent fortement contribuer à l’atteinte de cet objectif.
C’est à cette fin que Stéphane Le Foll a engagé le programme de recherche international « 4 pour 1 000 », qui se fonde sur le constat suivant : une augmentation de quatre millièmes de la teneur en matière organique des sols permettrait de compenser les émissions annuelles mondiales de CO2. Enfin, le programme national de la forêt et du bois devra trouver un équilibre entre une nécessaire valorisation économique de notre patrimoine forestier, très largement sous-exploité, puisque 20 % à 30 % seulement de la production annuelle sont prélevés, et la préservation de la biodiversité et des autres fonctions environnementales de nos forêts, comme l’épuration de l’eau.
Nous serons donc mobilisés et attentifs, pour une gestion durable de l’ensemble de nos forêts.

M. Joël Labbé. Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de vos éclaircissements, nécessaires lorsque la forêt devient trop étouffante.
Sourires.

De nombreux aspects n’ont pas été abordés concernant les enjeux liés à l’arbre et la forêt : la préservation et l’entretien de la haie bocagère, qui joue un rôle essentiel, le développement de l’agroforesterie et, enfin, un domaine essentiel, qui fait la grande richesse de notre patrimoine forestier et dont on parle trop peu, les forêts primaires équatoriales.
En conclusion, n’oublions pas que la gestion forestière est du domaine du temps long. Que la forêt vivante puisse dans son profond silence et l’immensité de son mystère nous réapprendre ce que sont patience et longueur de temps…
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, ainsi que sur les travées du RDSE.

Votée à la rentrée 2014, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a rénové la gouvernance de notre politique forestière.
Que le secteur forestier soit enfin reconnu pour ce qu’il est, à savoir une composante économique et sociale essentielle à l’équilibre des territoires : telle était l’ambition affichée.
Plusieurs rapports ayant dressé un bilan très mitigé de la filière bois en France, le Gouvernement n’a pas attendu pour agir.
Afin de renforcer la compétitivité de la filière, le plan national d’action pour l’avenir des industries du bois viendra définir un cadre stratégique pour la filière sur le long terme.
Madame la secrétaire d’État, ce plan national, qui sera finalisé prochainement avec une déclinaison régionale, doit redynamiser l’exploitation forestière de la forêt privée, en encourageant la contractualisation, afin, notamment, de sécuriser les approvisionnements de l’industrie du sciage. C’est une avancée reconnue.
Nous nous félicitons également de la signature par quatre ministres, le 16 décembre dernier, du contrat de filière bois, qui a permis de réunir autour d’une même table l’ensemble des grands acteurs de la filière, pour pouvoir mettre en œuvre une véritable stratégie à long terme.
Hier, sur le salon des élus locaux d’Aquitaine, auquel vous avez participé, monsieur le président, j’ai été interrogée sur la problématique des petites et moyennes scieries, dont la survie est aujourd’hui remise en cause, tout particulièrement en Gironde et dans les Landes.
Madame la secrétaire d’État, pouvez-vous réaffirmer la détermination du Gouvernement à soutenir les scieurs locaux, dont les capacités financières sont limitées, notamment par rapport aux groupes papetiers internationaux ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.
Le secteur de la première transformation du bois connaît les mêmes évolutions que l’agriculture avec une baisse continue du nombre de scieries et une tendance à la concentration, avec la création de grosses unités, surtout pour ce qui concerne les résineux. Depuis trente ans, la scierie française a ainsi perdu chaque année une centaine d’unités, soit près de 3 500, en particulier en feuillus, qui représentent pourtant la majorité de notre peuplement forestier.
Les raisons le plus souvent évoquées de cette concentration par les professionnels sont l’absence de repreneurs, les problèmes de succession, le manque de rentabilité et les contraintes administratives et normatives.
Les scieries artisanales, qui produisent seulement 7 % du volume des sciages, restent majoritaires, avec 60 % des installations. Quant aux scieries industrielles, elles représentent 18 % des installations, mais 77% du volume des sciages.
Nos plus grosses scieries résineuses restent toutefois dans la moyenne des unités allemandes ou autrichiennes. En marge des grands courants d’affaires, le secteur artisanal des petites et moyennes scieries tire son épingle du jeu en s’employant dans le sur-mesure demandé par les artisans, les négoces de ville, ou les particuliers, de plus en plus nombreux. Il faut s’atteler à maintenir cette dynamique.
Le maintien d’un tissu de scieries de toutes dimensions est essentiel pour la continuité de l’activité dans nos territoires ruraux et l’économie de l’ensemble de la filière. Deux leviers peuvent être activés pour améliorer la compétitivité de ces installations : la réduction des charges sociales et la contractualisation. Le chantier de l’allégement des charges sociales et fiscales dans le secteur de la forêt et des industries du bois est largement engagé avec le pacte de responsabilité et de solidarité, et l’effort se poursuivra en 2016 et 2017 pour être porté à 598 millions d’euros en 2017, dont 219 millions d’euros de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
La contractualisation entre les propriétaires forestiers publics et privés et les entreprises de transformation doit permettre de réduire les temps de prospection, de sécuriser les approvisionnements et de limiter les variations de prix. C’est l’une des actions promues par le comité stratégique de la filière bois, avec l’intervention d’un médiateur.
Oui, le Gouvernement est mobilisé pour que les scieries artisanales puissent continuer à exister et à se développer de nouveau après avoir connu des années difficiles. C’est une nécessité pour nos massifs forestiers, nos territoires et l’ensemble de l’économie de proximité.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du RDSE.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de cet encouragement aux scieries artisanales, qui sont indispensables à notre territoire.
Aujourd'hui, avec la fin de l’exploitation des bois de tempête, les industriels papetiers recourent pour leur approvisionnement à des rondins bruts ou des billons de sciage, ce qui vient déstabiliser l’approvisionnement des petites scieries.
De plus, le déséquilibre annoncé entre ressource et demande a entraîné une hausse du prix du bois qui affecte directement les industriels de la filière et pénalise les scieries, dont les capacités financières sont limitées par rapport à celles des groupes papetiers internationaux.
Oui, ces petites scieries ont besoin d’un soutien. C’est une priorité. Je remercie le Gouvernement de l’attention qu’il pourra porter à ce secteur économique, qui joue un rôle extrêmement important dans nos territoires ruraux.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour le groupe communiste, républicain et citoyen.

Depuis plusieurs années, notre forêt fait l’objet d’une spéculation, sans que personne ne semble appréhender réellement la mesure des dégâts occasionnés.
En effet, la forêt est devenue une valeur refuge, qui suscite beaucoup d’appétit de la part des investisseurs privés, lesquels n’ont que peu de considération pour l’écosystème forestier, pourtant fragile. Cela touche en particulier les massifs de résineux. Ainsi, en les couvrant en monoculture avec des essences comme le Douglas, dont la rentabilité est forte, le risque d’une baisse systématique de l’âge d’exploitabilité des forêts et d’une atteinte à la biodiversité est avéré.
Pourtant, notre forêt représente un atout majeur pour notre pays avec la mise en œuvre de la transition énergétique. Il ne faut pas omettre non plus la potentialité de ressources supplémentaires pour les exploitants agricoles. En effet, la transformation du bois peut être largement valorisée au travers de la construction, des chaufferies bois ou des plaquettes. Tout cela contribue à l’aménagement du territoire, à la beauté des paysages et à l’amélioration de la qualité de vie.
De plus, les élus ne peuvent faire face aux opérations d’acquisition menées par des fonds d’investissement qui contournent la législation, notamment le droit de préférence mis en place pour lutter contre le morcellement de la forêt privée. Car le plafond de 4 hectares ne s’applique que sur la totalité de la superficie de toutes les parcelles vendues. Ainsi, si l’ensemble fait plus de 4 hectares, le droit de préférence ne s’applique pas.
Notre forêt a besoin de maîtrise pour toutes ses composantes : de la production à la diversité des essences, en passant par les coûts. Elle est une richesse nationale qui ne doit pas être accaparée par les grands groupes nationaux, voire internationaux, ou par des pays tels que la Chine, qui fait le commerce des grumes de bois.
Il est dommage que l’État se désengage de la gestion forestière en imposant à l’ONF des contraintes financières disproportionnées et des missions éloignées de sa vocation première. C’est pourquoi je vous demande, madame la secrétaire d’État, quelles mesures vous comptez prendre pour protéger la multifonctionnalité de la forêt française dans son ensemble.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC. –M. Jean-Louis Carrère applaudit également.
Comme je viens de l’indiquer dans ma réponse à M. Labbé, la gestion forestière durable constitue le socle de notre politique. Je l’ai rappelé, pour l’instant, force est de constater que seuls le bois et la chasse assurent la quasi-totalité du financement de la forêt.
Alors que la préservation et la valorisation de ce patrimoine forestier dictent notre action, la forêt métropolitaine est aujourd'hui, majoritairement, une belle endormie.
Dans ces conditions, une exploitation forestière plus intense ne représenterait en rien une menace pour les écosystèmes forestiers. On ne prélève en moyenne que 40 % à 50 % de l’accroissement annuel de la forêt, et, pour ce qui concerne la forêt privée, ce pourcentage se situe entre 20 % et 30 %. Autant dire que le capital forestier continue de croître. Dans bien des cas, ce n’est pas souhaitable, ni pour la séquestration du carbone dans des peuplements arrivés à maturité ni pour le renouvellement ou l’adaptation des forêts au dérèglement climatique, sans parler des risques d’instabilité des peuplements en cas de tempête, comme ce fut le cas en 1999 et dix ans plus tard.
La gestion forestière doit être dynamique et respectueuse de la biodiversité. Selon le Gouvernement, il n’y a aucune incompatibilité entre ces enjeux. Je vous rejoins toutefois à propos du constat de certaines dérives, qui conduisent à faire de nos forêts des refuges fiscaux, sans qu’aucun service économique, social ou environnemental soit rendu à la nation. Des contrôles seront prochainement lancés pour vérifier l’effectivité de la gestion forestière, engagement pris par les propriétaires forestiers, en contrepartie des réductions fiscales accordées, qui concernent les droits de mutation et l’ISF.
Des bulles spéculatives sur la valeur des forêts sont actuellement constatées, en lien avec certains avantages fiscaux de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. Certes, la forêt est un bien privé, pour 75 % de sa surface. Toutefois, je vous rejoins totalement sur ce point, monsieur le sénateur, elle représente également, et même surtout, un patrimoine commun, qui ne peut être considéré sous le seul angle du régime fiscal.
Concernant les autres questions que vous avez posées, je vous propose de nous rencontrer ultérieurement, eu égard à la technicité des réponses à apporter qui ne me permettrait pas de respecter le temps de parole qui m’est imparti.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de votre réponse, qui me satisfait partiellement, notamment pour ce qui concerne la gestion durable, le capital à valoriser et les importants efforts qu’il reste à faire, toutes choses parfaitement exactes. Toutefois, certains éléments mériteraient d’être accentués, comme le renforcement du droit de préférence des riverains, afin de favoriser le regroupement forestier. Chaque propriété ou parcelle devrait faire l’objet d’un droit de préférence, quelle que soit sa superficie.
De même, il serait opportun d’élargir encore le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, ou SAFER, aux parcelles boisées, voire de l’octroyer aux communes forestières. Cela pourrait constituer un premier élément de réponse pour lutter contre la spéculation, face à laquelle les acteurs locaux sont totalement désemparés. Cela implique que les communes et les SAFER soient informées à chaque vente.
Enfin, il est nécessaire de mettre en place un véritable service public, qui englobe les propriétaires publics et privés, un contrôle indépendant de l’exploitation des forêts domaniales et un financement pérenne de la gestion forestière, ce afin de réguler l’exploitation, laquelle doit se faire en fonction du long terme et de l’équilibre de la forêt.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour le groupe de l’UDI-UC.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, ma question porte sur l’avenir de l’ONF, du régime forestier et de la gestion durable des forêts publiques françaises.
Au mois d’août dernier, l’État a remis en cause de manière unilatérale le contrat d’objectifs et de performance, le COP, pour la période 2012-2016, qui avait été passé avec l’ONF et les communes forestières.
Il manque 50 millions d’euros pour redresser les comptes de l’ONF. Bercy a donc envisagé un financement supplémentaire des communes et proposé de porter la participation instituée en 2012 de 2 euros par hectare à 14 euros et d’augmenter les frais de garderie de 12 % à 18 %.

Face aux protestations des élus des communes forestières, le Gouvernement recule et renvoie à une renégociation.
Aujourd’hui, ces discussions sont dans l’impasse. Le Gouvernement semble ne pas avoir renoncé à faire payer davantage les communes et choisit même de placer un intérimaire à la tête de l’ONF pour gérer au mieux la négociation en cours.
Il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ; tel est le titre choisi par le président de la Fédération nationale des communes forestières pour son dernier éditorial, afin de témoigner de son dépit.
Car trop, c’est trop ! Dans un contexte de baisse des dotations, les communes forestières n’en peuvent plus. Elles ont déjà fait des efforts financiers considérables en 2012. Aujourd’hui, elles sont prêtes à redéfinir le cadre du régime forestier, à envisager de nouvelles méthodes de gestion plus économes. Mais c’est à l’ONF de maîtriser ses dépenses de fonctionnement : une économie – réaliste – de 2 % suffirait.
Pour cela, il est urgent de mettre en pratique les préconisations de la Cour des comptes : appliquer une véritable comptabilité analytique de toutes les dépenses, et pas uniquement de celles qui sont liées aux forêts communales ; revoir la gestion des ressources humaines – la suppression de 475 équivalents temps plein entre 2009 et 2011 n’a pas empêché la masse salariale d’exploser de 10 millions d’euros ; recentrer les investissements des filiales concurrentielles sur les seules opérations rentables, un critère de bon sens.
Si l’on cherche encore à imposer des charges supplémentaires et injustes aux communes forestières, elles ne signeront pas le contrat précité et elles chercheront à se désengager du régime forestier.

À la veille de la COP 21, il serait dommage d’en arriver à une telle extrémité. Face aux enjeux de mobilisation de ressources renouvelables, sur lesquels nous venons de nous prononcer dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, face aux enjeux de gestion multifonctionnelle de la forêt, nous pouvons faire de l’ONF un outil moderne de gestion, garant d’une stratégie forestière nationale, capable de mobiliser cette formidable ressource, la quatrième d’Europe.

Mme Anne-Catherine Loisier. Madame la secrétaire d’État, dans ce contexte, comment comptez-vous créer les conditions d’un nouveau contrat de gestion des forêts publiques intégrant les besoins des marchés, les attentes sociales de nos concitoyens, la nécessaire préservation de l’environnement, mais aussi et surtout les finances des collectivités territoriales ?
Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC et de l’UMP.
Madame la sénatrice, avant toute chose, je tiens à réaffirmer l’attachement du Gouvernement au régime forestier fondé sur la gestion des forêts des collectivités par l’ONF.
Si les forêts publiques ne représentent qu’un quart de la surface boisée métropolitaine, l’ONF commercialise 40 % du volume des bois. C’est en cela un acteur clef de la filière forêt-bois.
En 2013, le coût net de la gestion des forêts des collectivités s’est élevé à 175 millions d’euros. Les collectivités ont contribué à hauteur de 15 % au financement de ce coût au travers des « frais de garderie » – établis sur la base des recettes tirées de leur forêt – et d’une contribution forfaitaire à l’hectare de forêt gérée, d’un montant de 2 euros par hectare.
En 2014, l’État a augmenté de 20 millions d’euros le versement compensateur pour le porter à 140 millions d’euros. Dans le cadre du budget triennal 2015-2017, l’objectif de réduction des déficits publics avait conduit le Gouvernement à augmenter progressivement la contribution des communes forestières pour qu’elle atteigne 50 millions d’euros en 2017.
La forte opposition des communes forestières a conduit à anticiper la révision du COP de l’établissement, qui devait prendre fin en 2016. Il faut noter que, dès sa première année d’application, en 2012, les hypothèses sous-jacentes à ce COP se sont révélées très ambitieuses, voire peu réalistes. L’État a d’ailleurs contribué à hauteur de 100 millions d’euros au-delà de ce qui était prévu.
En 2015, l’ONF intégrera la baisse de 20 millions d’euros prévue ; le niveau des ventes de bois de 2014 et des économies de gestion y pourvoiront. Je me permets à ce titre de rappeler les efforts réalisés ces dernières années par l’ONF qui ont fortement participé à la réduction des dépenses publiques.
Enfin, les travaux sont d’ores et déjà engagés entre les signataires du COP pour préciser les objectifs et les moyens qui seront assignés à l’établissement pour la période 2016-2020. Nous continuons bien sûr à travailler en concertation avec les communes forestières pour la mise en place d’un dispositif adapté et soutenable.

J’ai bien entendu vos propos encourageants, madame la secrétaire d’État. J’espère vraiment que nous arriverons à trouver un mode d’organisation qui satisfera l’ensemble des parties. Les communes forestières comme l’État sont attachés au régime forestier.
Il faut seulement que le Gouvernement prenne conscience du fait que la forêt française est exceptionnelle. C’est la quatrième forêt d’Europe en surface et la troisième en volume de bois sur pied. Elle est exceptionnelle par sa diversité, par la gestion durable que les acteurs forestiers ont mise en œuvre depuis des années. C’est un formidable potentiel d’emplois que nous nous devons, compte tenu de la situation économique du pays, d’exploiter – le mot convient particulièrement – et d’optimiser.

M. le président. La parole est à M. Philippe Leroy, pour le groupe UMP.
Applaudissements sur les travées de l’UMP.

Je voudrais avant toutes choses remercier la Cour des comptes et la commission des finances qui ont établi deux rapports excellents, faisant un très bon diagnostic de la forêt française, sur la demande initiale du groupe d’études forêt et filière bois du Sénat.
Le rapport de la Cour des comptes qui nous est présenté aujourd’hui doit néanmoins être nuancé dans ses applications. En effet, il rappelle fort opportunément que la forêt française est essentiellement feuillue et très peu résineuse. Or les usages des sciages feuillus ont disparu en grande partie ; nous sommes donc déficitaires en matière de sciages résineux. Cela, c’est une constante, une réalité qui s’impose à nous pour les trois prochaines décennies. D’ailleurs, le marché aura peut-être changé dans trente ans !
On accuse à tort la filière forêt-bois française du déficit, certes considérable, de 6 milliards d’euros. En effet, ce déficit est lié pour une grande partie au fait que nous connaissons un excédent de sciages feuillus que nous ne savons pas utiliser, et un déficit de sciages résineux. Il faut donc se méfier de conclusions qui oublieraient cette évidence.
La Cour des comptes rappelle également fort opportunément une deuxième évidence : ce sont non pas des milliards, mais 900 millions d’euros à peine que l’on donne à la forêt ! Il est important de le souligner : la forêt française ne coûte pas cher.
Le Gouvernement a mis en œuvre le fonds stratégique de la forêt et du bois. Allez-vous, madame la secrétaire d’État, le doter de façon constante et sûre des 100 à 150 millions d’euros dont la forêt a besoin pour assurer son renouvellement et sa bonne mobilisation ?
Vous avez fait l’effort, sur le budget actuel, de mobiliser deux fois 30 millions d’euros, soit 60 millions d’euros en tout. Sans l’assurance de voir doter ce fonds des 100 à 150 millions d’euros nécessaires par an, ce qui n’est rien pour les 15 millions d’hectares de la forêt française, les politiques forestières ne pourront pas être mises en œuvre.
Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UDI-UC.
Monsieur Leroy, vous avez relevé l’importance que représente le fait de disposer d’une forêt bien gérée. Nous devons mesurer pleinement la contribution de la forêt à l’ensemble des activités économiques sur les territoires, ainsi que son apport en matière environnementale et sociale, que nous devons développer.
Il est nécessaire de rappeler que le Gouvernement a pris pleinement conscience des enjeux concernant la forêt. Il a ainsi, je le répète, mis en place différents dispositifs : il s’est intéressé à la gouvernance, a renforcé le caractère interministériel de la question et a fourni des moyens financiers. Vous l’avez indiqué, monsieur le sénateur, une stratégie n’est valable que si elle est soutenue par des crédits budgétaires.
Cela a été rappelé, le « Fonds Bois II » est en cours de constitution. Une somme de 25 millions d’euros lui est déjà assurée, qui sera fournie par Bpifrance. Les consultations en cours avec les financeurs privés sont de bon augure, et Stéphane Le Foll devrait pouvoir vous annoncer, dans les prochains mois, la mobilisation de montants significatifs.
Je signale également la création du fonds stratégique de la forêt et du bois, dont l’enveloppe atteindra à terme 30 millions d’euros. Ce fonds pourra être pérennisé si une bonne dynamique s’engage. Il pourra être renforcé par l’extension du fonds chaleur à la mobilisation du bois énergie. Je l’ai indiqué tout à l’heure, pour la première fois, 30 millions d’euros seront dirigés de ce dernier fonds pour alimenter en amont tous les dispositifs nécessaires. Nous devons favoriser les moyens de chauffage par le bois, mais il faut être certain que l’alimentation soit bonne.
Avec le compte d’investissement forestier et d’assurance, et grâce à des incitations fiscales significatives, nous ferons également en sorte que l’investissement patrimonial puisse être fait de façon active. La coupe, l’entretien, en somme la production de bois, devront donc jouir d’un dispositif fiscal.
Je rappelle en outre que, grâce à des crédits du Fonds européen agricole pour le développement rural, ou FEADER, de nombreux programmes sont fléchés vers le bois.
Enfin, les déclinaisons régionales des programmes de développement rural hexagonal jouiront de la mobilisation de crédits par les régions, qui complèteront les dispositifs majeurs mis en place par l’État.

Je reconnais la bonne volonté du Gouvernement, mais tout cela, madame la secrétaire d’État – pardonnez-moi d’exagérer un peu –, c’est du bricolage ! Alors qu’il nous faut l’assurance de disposer chaque année pendant les quinze prochaines années – pour ce qui concerne la forêt, il ne faut pas raisonner année après année – des 100 à 150 millions d’euros nécessaires à l’amélioration et à la mobilisation de la forêt, vous nous apportez, certes en toute bonne volonté, des solutions de bric et de broc : 10 millions d’euros par-ci, 30 millions d’euros par-là, dont on n’est jamais sûr de la pérennité.
Madame la secrétaire d’État, c’est bien de la pérennité que nous vous demandons, pour que les acteurs de la forêt reprennent confiance, et que nous puissions avancer.
Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UDI-UC.

Voilà maintenant un mois, Alain Houpert et moi-même rendions public, au nom de la commission des finances, un rapport d’information sur les soutiens publics à la filière forêt-bois française. Ce rapport faisait suite à une enquête demandée par cette commission à la Cour des comptes.
À la suite de sa publication, nous avons souhaité appeler l’attention du Gouvernement et des différents ministères concernés, en particulier sur la question de la gouvernance de la filière.
En effet, la réflexion stratégique sur ce que devraient être les priorités de la politique forestière française est insuffisante. Cette situation conduit donc trop souvent à un saupoudrage des crédits publics, ce qui ne permet d’être ni performant ni efficient !
La mise en valeur et l’exploitation efficace et raisonnée de la forêt devraient faire consensus. Dès lors, comment cet objectif se traduit-il en politiques publiques, par exemple en matière de reboisement, pour ce qui concerne l’amont – il s’agit là, selon moi, d’un enjeu fondamental requérant des réponses politiques rapides –, mais également en matière de balance commerciale, pour ce qui concerne l’aval ?
À cet égard, je veux préciser un aspect de notre rapport qui a pu être mal compris : nous ne souhaitons pas mettre à mal la filière bois-énergie ; nous nous interrogeons sur les limites des soutiens apportés à cette sous-filière qui, dans certains cas, et aucunement de manière générale, entraînent des tensions sur les ressources et des conflits d’intérêts, qui peuvent affecter d’autres acteurs de la filière.
Plus globalement, c’est l’équilibre des soutiens publics entre les différents acteurs de la filière qui fait l’objet d’interrogations et attend donc des réponses.
Pour ce qui est de la gouvernance de la filière, quelles sont les dispositions concrètes que le Gouvernement souhaite mettre en œuvre pour la rendre plus adaptée et plus efficace, tant en ce qui concerne l’État, à travers ses ministères, que les acteurs professionnels eux-mêmes, dans l’objectif de mieux conduire les politiques publiques dont la filière bois a besoin ?
Enfin, madame la secrétaire d’État, je souhaite vous poser une question à la fois simple dans l’énoncé et complexe dans la déclinaison des réponses : quelles initiatives comptez-vous prendre rapidement pour développer la filière forêt-bois française aujourd’hui et pour préparer demain ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Monsieur Botrel, la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt répond, me semble-t-il, à vos attentes.
Tout d’abord, un programme national de la forêt et du bois est en cours d’élaboration par l’ensemble des acteurs de la filière forêt-bois. Il sera décliné en programmes régionaux, sous la double tutelle de l’État et des régions, acteurs économiques clés du développement de la filière bois.
La loi d’avenir a créé le fonds stratégique de la forêt et du bois ; je n’y reviens pas. Et une enveloppe est mobilisée pour la biomasse forestière sur le fonds chaleur.
De plus, un appel à manifestation d’intérêts a été lancé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, en lien étroit avec le ministère de l’agriculture et de la forêt, pour une mobilisation accrue du bois-énergie. Cette initiative a été couronnée de succès : plus de 60 millions d’euros de projets ont été identifiés. Les projets définitifs seront sélectionnés au second semestre.
Enfin, le Gouvernement est soucieux d’associer étroitement les acteurs professionnels de la filière aux choix stratégiques, aussi bien amont qu’en aval.
Les commissions régionales de la forêt et du bois seront redéfinies – le décret est en cours – dans le sens d’une participation élargie des acteurs de l’aval de la filière, sous la double présidence de l’État et des régions.
Le programme national de la forêt et du bois, qui est en cours d’élaboration, ses déclinaisons régionales et le contrat stratégique de filière bois, qui a été signé par quatre ministres, constitueront le cadre qui permettra d’avoir une action publique de la filière forêt-bois pour les années futures.
Par conséquent, une nouvelle gouvernance, des financements et un soutien à l’ensemble des acteurs en amont et en aval permettront d’investir fortement dans ce secteur, ce qui n’avait pas été le cas au cours des dix dernières années.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de votre réponse.
Je le rappelle, le rapport portait sur une période qui s’achevait en 2013. Pour autant, l’enjeu économique est important. La forêt pèse pour 10 milliards d’euros dans notre déficit commercial extérieur, qui s’élève à 60 milliards d’euros.
La nécessaire anticipation doit être au cœur de nos politiques. Le secteur de l’emballage léger en bois nous alerte dès à présent sur un risque de pénurie de la ressource – en clair, il s’agit des plantations de peupliers – d’ici à une quinzaine d’années.
Je souhaite enfin formuler une remarque sur l’organisation de l’action gouvernementale. Nous avons cinq ministères qui jouent chacun leur partition ; cela peut parfois conduire à de la cacophonie. Il faut un chef d’orchestre. Nous attendons des initiatives du Gouvernement à cet égard.

Madame la secrétaire d’État, le 22 avril dernier, votre collègue Stéphane Le Foll a réuni pour la cinquième fois le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois.
L’objectif du Gouvernement est très clair : corédiger le programme national de la forêt et du bois avec la filière, dans une démarche de nécessaires politiques interrégionales et de prospective à dix ans.
Les défis sont nombreux, dans un contexte de réforme institutionnelle débouchant sur un nouveau paysage territorial : la lutte contre le réchauffement climatique, la baisse de la dépendance énergétique, le soutien à l’emploi non-délocalisable, la mise en exergue des circuits courts...
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En France, la filière forêt-bois représente 500 000 emplois. Et 300 mètres cubes de bois valorisés, cela équivaut à un emploi non-délocalisable.
C’est pourquoi le Gouvernement s’est uni, via la loi d’avenir, aux collectivités locales et à l’Europe pour mettre en avant le bois dans la construction avec le projet « 100 constructions publiques en bois local », fortement relayé par la Fédération nationale des communes forestières.
À mi-parcours, l’initiative est une réussite. Les collectivités ont compris qu’elles avaient un rôle majeur à jouer en optant pour cette ressource locale, s’agissant tant de la structuration de la filière que du développement économique de leur territoire.
Le département de l’Hérault s’était distingué en obtenant en 2014 le Prix national de la construction bois, avec la salle de spectacle du Domaine d’O, le théâtre Jean-Claude Carrière.
La filière bois fait partie des trente-quatre filières d’avenir identifiées par le Gouvernement, qui vient récemment de signer le contrat de filière bois. Il s’agit de signes forts pour cette filière pourtant affaiblie par la concurrence mondiale.
Face aux efforts constants de la filière, les démarches de certification, les investissements consacrés chaque année à l’innovation et à la modernisation de l’outil de production par les industriels de la transformation du bois, quels moyens envisagez-vous pour soutenir les collectivités territoriales qui optent pour le bois dans leurs constructions ?
Quelles aides incitatives particulières peuvent être mises en place pour favoriser le bois, idéalement le bois français, dans la construction de logements sociaux ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Monsieur Cabanel, vous avez raison : le développement de l’utilisation du bois dans la construction est un levier majeur, sinon le principal, pour l’essor de la filière bois.
Différents leviers peuvent être actionnés pour valoriser les bois français. Je signale d’abord l’initiative du secteur privé, qui vient de proposer un label « bois français ». Cependant, il est difficile d’envisager des aides directes aux collectivités locales pour soutenir la construction en bois ; cela comporterait de lourds risques de contentieux. Une décision récente du Conseil constitutionnel a abouti à l’annulation du décret de 2012 sur le seuil minimal d’incorporation du bois dans la construction.
En revanche, l’État met en œuvre des programmes d’actions, notamment dans le cadre du contrat stratégique de filière, visant non le soutien de la demande, mais l’organisation de l’offre.
Ainsi, le plan bois-construction II pour la période 2014-2017, soutenu par le ministère du logement, se décline autour de trois axes stratégiques : formation-emploi-compétences ; valorisation des feuillus dans la construction ; positionnement des solutions bois sur le marché de la réhabilitation de logements.
En outre, le plan de la Nouvelle France industrielle est également en cours de déploiement et porteur d’une grande ambition pour cette filière d’avenir.
Il convient de rester vigilant pour éviter qu’un développement trop brutal de l’usage du bois dans la construction ne fasse le lit d’importations massives.
C’est pourquoi nous cherchons en parallèle à faire en sorte que ce marché puisse mieux s’appuyer sur la mobilisation de la ressource forestière nationale.
Des travaux sont également engagés sur la commande publique, afin de mobiliser les grandes entreprises publiques et privées, via la commande publique, et soutenir ainsi les entreprises de la filière forêt-bois, le tout grâce à des mesures de simplification et de définition des critères de performance pour la sélection de l’offre, en parallèle d’une formation accrue des maîtres d’ouvrage.
Le secteur bois sera donc pleinement pris en compte dans les modifications apportées au code des marchés publics. L’ordonnance est prévue pour le mois prochain.
Monsieur le président, je profite de cette dernière question pour rappeler que la politique gouvernementale de soutien à la filière bois vise à faire mentir Chateaubriand, selon lequel « les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent ». Nous voulons que le peuple et la forêt puissent coexister durablement, qu’il s’agisse de l’économie, du social ou de l’environnement.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, des précisions que vous venez d’apporter.
Les collectivités locales ou les bailleurs sociaux ont effectivement été un peu refroidis par le coût que pouvait représenter la construction en bois. Certes, ce coût a diminué depuis la deuxième moitié des années soixante-dix ; aujourd'hui, il est équivalent à celui de la construction en parpaing.
C’est à la force publique de montrer l’exemple, en se lançant dans la construction en bois, d’autant que nous sentons une certaine frilosité chez les bailleurs sociaux.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Mes chers collègues, nous en avons terminé avec les questions cribles thématiques sur la forêt française.

Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande, en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution, l’inscription à l’ordre du jour du lundi 11 mai, le matin, l’après-midi et le soir, de la suite de l’examen du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Acte est donné de cette communication.
Dans la ligne de ce qu’a évoqué hier soir le président de séance Claude Bérit-Débat, et après concertation avec le Gouvernement et les groupes, l’ordre du jour du lundi 11 mai s’établira donc comme suit :
À 10 heures :
- Suite du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (projet n° 300, texte de la commission n° 371, rapport n° 370, tomes I, II et III).
À 14 heures 30, le soir et la nuit (jusqu’à minuit et demi) :
- Suite de l’ordre du jour du matin ;
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la réforme de l’asile (projet n° 193, texte de la commission n° 426, rapport n° 425, avis n° 394).
Avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à quinze heures cinquante-cinq, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.

Nous reprenons la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, relative à l’octroi de mer.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 7.
L’article 6 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer l’importation : » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De biens destinés à une personne exerçant une activité économique, au sens de l’article 256 A du code général des impôts. Les exonérations sont accordées par secteur d’activité économique, dans des conditions fixées par décret ; »
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° De biens destinés à des établissements exerçant des activités scientifiques, de recherche ou d’enseignement ; »
4° Au début du 3°, les mots : « D’équipements » sont remplacés par les mots : « De biens » ;
5° Au début du 4°, les mots : « D’équipements sanitaires » sont remplacés par les mots : « De biens » ;
6° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° De biens destinés à des organismes mentionnés au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts. »

L'amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, Desplan, J. Gillot et S. Larcher, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À l’exception des produits listés dans les annexes de la décision du Conseil n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer l’importation : » ;
La parole est à M. Georges Patient.

L’amendement n° 3 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, Desplan, J. Gillot et S. Larcher, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 7
Remplacer le mot :
établissements
par le mot :
personnes
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.

L’amendement n° 4 rectifié est retiré.
L'amendement n° 19 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Desplan, J. Gillot et S. Larcher, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Après le mot :
établissements
insérer les mots :
ou personnes morales
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.

L’exonération prévue à l’article 7 devait concerner les personnes exerçant une activité scientifique, de recherche ou d’enseignement. Toutefois, tel qu’il est actuellement rédigé, cet article ne vise que les « établissements ». Or ce terme pourrait être interprété de manière trop restrictive et empêcher l’application de cette disposition à des personnes privées qui n’exerceraient pas une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts, mais qui assumeraient à titre accessoire des activités de recherche bénéficiant à toute une filière.
Ainsi, cette restriction empêcherait l’association Interprobois en Guyane, par exemple, de bénéficier de l’exonération. Celle-ci se verrait alors réclamer le paiement de l’octroi de mer suspendu depuis un an en attendant le vote de l’amendement. Ces sommes n’ayant jamais été prévues dans le plan de financement du projet, l’association serait dans l’incapacité de les payer sans une intervention des financeurs publics, dont la région Guyane.

La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n°19 rectifié bis, que son auteur a bien voulu modifier à la demande de la commission afin qu’il s’applique non pas aux « personnes », mais aux « personnes morales ».
Nous partageons la position du rapporteur : nous n’étions pas enthousiasmés par la possibilité d’exonérer des personnes physiques, mais l’amendement portant sur les « établissements et personnes morales », nous y sommes favorables et nous levons le gage.

Je suis donc saisi d’un amendement n° 19 rectifié ter, présenté par MM. Patient, Karam, Desplan, J. Gillot et S. Larcher, et ainsi libellé :
Alinéa 7
Après le mot :
établissements
insérer les mots :
ou personnes morales
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 17 rectifié ter, présenté par MM. Guerriau, Delahaye, Trillard, Gabouty, Canevet, Fontaine et Bonnecarrère et Mme Joissains, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
4° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De biens destinés à l’accomplissement des missions de l’État ; »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Joël Guerriau.

J’ai tenu compte des discussions que nous avons eues ce matin, qui constituent à mes yeux un engagement à poursuivre le dialogue et la réflexion sur la prise en considération des différents handicaps que peut représenter pour les services de l’État l’octroi de mer. Celui-ci impose notamment à des hauts fonctionnaires de devoir négocier au cas par cas avec les collectivités territoriales l’obtention d’une exonération.
Cet amendement, dont la rédaction a évolué, vise à étendre les possibilités d’exonération données aux collectivités locales d’outre-mer à l’ensemble des biens destinés à l’accomplissement des missions de l’État. Il est en effet dommage que les choix d’acquisition de biens d’équipement collectifs nécessaires à l’accomplissement de fonctions régaliennes ou, plus largement, de missions d’intérêt national, puissent souffrir du fait des droits d’octroi.
Cette évolution est loin d’être aussi substantielle que celle que j’avais proposée ce matin, mais je prends la mesure des contraintes qui sont les nôtres et de la nécessité aujourd'hui d’accélérer l’application des nouvelles formules d’octroi de mer.

L'amendement n° 18 rectifié bis, présenté par MM. Guerriau, Delahaye, Trillard, Gabouty, Canevet, Fontaine et Bonnecarrère et Mme Joissains, est ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° De biens nécessaires aux services d’incendie et de secours. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Joël Guerriau.

Nous avons déjà abordé ce sujet ce matin.
L’article 6 de la loi de 2004 relative à l’octroi de mer, que l’article 7 du présent projet de loi tend à modifier, prévoit que les exonérations s’appliquent aux biens destinés à l’accomplissement des « missions régaliennes de l’État ». L’amendement n° 17 rectifié ter vise à étendre cette exonération aux biens destinés à l’accomplissement de l’ensemble des missions de l’État. Il nous semble que cette modification ouvrirait un champ très large et bien peu défini.
La commission est donc défavorable à l’amendement n° 17 rectifié ter, ainsi qu’à l’amendement n° 18 rectifié bis.
Nous avons déjà eu ce débat ce matin. Effectivement, la proposition que fait le sénateur Joël Guerriau semble extrêmement large. Si nous comprenons le sens du débat sur les missions régaliennes de l’État, il ne nous semble pas souhaitable en revanche de viser les missions de l’État en général.
L’amendement n° 18 rectifié bis vise les biens nécessaires aux services d’incendie et de secours. Or il n’y a eu aucune demande de ce type à ce jour. Par conséquent, on doit considérer que la possibilité d’exonérer les biens nécessaires à ce type de service existe déjà. Cet amendement est donc satisfait.

Monsieur Guerriau, les amendements n° 17 rectifié ter et 18 rectifié bis sont-ils maintenus ?

On me dit que j’ai déjà satisfaction, mais, si j’ai soulevé le sujet, c’est bien parce que tout le monde n’est pas satisfait. Pour avoir eu des échanges avec certains services de l’État pour l’outre-mer, je souligne que le fait de contraindre des responsables administratifs à négocier au cas par cas des exonérations me paraît très discutable. Je maintiens donc mes amendements.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 24 rectifié est présenté par M. Antiste, Mme Claireaux et MM. Desplan, J. Gillot et S. Larcher, est ainsi libellé :
L'amendement n° 34 est présenté par M. Milon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
5° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De biens destinés aux établissements et centres de santé, ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou privés ; »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l'amendement n°24 rectifié.

L’objet de cet amendement est de permettre aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, à l’assemblée de Guyane, à l’assemblée de Martinique et au conseil départemental de Mayotte d’exonérer également d’octroi de mer les importations en direction des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’aux centres de santé sans limiter cette faculté aux seuls établissements de santé.

L'amendement n° 34 n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 24 rectifié ?

M. Millon avait effectivement déposé un amendement identique, que M. Revet, qui était présent ce matin, aurait défendu avec passion si la séance s’était poursuivie jusqu’à treize heures trente, comme il le pensait.
La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 24 rectifié bis. J’indique toutefois que, à titre personnel, j’y suis favorable, car il me semble préciser utilement le champ des établissements pouvant bénéficier de l’exonération prévue au 4° de l’article 6 de la loi de 2004.
Cet amendement a pour objet d’exonérer totalement ou partiellement certains biens destinés aux établissements de santé publics ou privés. Cet élargissement est bienvenu et, par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.
Par ailleurs, je lève le gage.

Je suis donc saisi d’un amendement n° 24 rectifié bis, présenté par M. Antiste, Mme Claireaux et MM. Desplan, J. Gillot et S. Larcher, et ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
5° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De biens destinés aux établissements et centres de santé, ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux publics ou privés » ;
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 22 rectifié, présenté par M. Antiste, Mme Claireaux et MM. Desplan, J. Gillot et S. Larcher, est ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« …° De tous autres biens pour lesquels il est justifié d’une utilité économique ou sociale particulière et de l’impossibilité de s’approvisionner sur le marché local. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Maurice Antiste.

Il s’agit de permettre à l’assemblée de Martinique, à l’assemblée de Guyane, aux conseils régionaux de la Guadeloupe et de la Réunion et au conseil départemental de Mayotte de consentir des exonérations sur de nouveaux produits en fonction des nécessités des secteurs concernés.

La commission s’interroge sur cet amendement, dont la rédaction est extrêmement imprécise. On ne sait pas très bien en effet quels produits pourraient être concernés.
La commission souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement.
Nous ne sommes pas favorables à cet amendement qui est en effet rédigé en des termes extrêmement vagues. Or je rappelle que nous devons toujours faire vérifier par la Commission européenne le différentiel d’octroi de mer. Une telle formulation ne permet absolument pas de suivre la procédure indispensable.

Il est défavorable. Tous les biens, quels qu’ils soient, finissent par avoir une « utilité économique ou sociale particulière ». Même les produits dont on parlait ce matin, sur la nomenclature desquels nous n’étions pas d’accord, pourraient entrer dans ce cadre.
L'article 7 est adopté.
Le premier alinéa de l’article 7 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer les livraisons de biens produits localement. » –
Adopté.
I. – Après l’article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer les importations, mises à la consommation et livraisons :
« 1° De biens destinés à l’avitaillement des aéronefs et des navires ;
« 2° De carburants destinés à un usage professionnel qui ont fait l’objet d’une adjonction de produits colorants et d’agents traceurs conformément à l’article 265 B du code des douanes. Cette exonération est accordée par secteur d’activité économique. »
II

L'amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, Desplan, J. Gillot et S. Larcher, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Avant les mots :
Les conseils régionaux
insérer les mots :
À l’exception des produits listés dans les annexes de la décision du Conseil n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises,
La parole est à M. Georges Patient.
L'article 9 est adopté.
L’article 8 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 8. – Les biens en provenance d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne qui sont importés en franchise de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée bénéficient d’une franchise d’octroi de mer.
« Les biens en provenance d’un État membre de l’Union européenne sont importés en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et d’octroi de mer lorsque leur valeur totale n’excède pas 1 000 €, pour les biens transportés par les voyageurs, ou 205 €, pour les biens qui font l’objet de petits envois non commerciaux. » –
Adopté.
L’article 9 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « marchandises » est remplacé par le mot : « biens » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la collectivité, pour les biens qui sont expédiés temporairement hors d’une collectivité mentionnée à l’article 1er et réimportés dans cette collectivité, après avoir fait l’objet d’une réparation, d’une transformation, d’une adaptation, d’une façon ou d’une ouvraison. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux biens dont l’importation est exonérée conformément au 2° de l’article 4. » –
Adopté.
I. – L’article 10 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 10. – I. – Le fait générateur de l’octroi de mer se produit et l’octroi de mer devient exigible au moment de l’importation ou de la livraison du bien.
« II. – Pour les produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le fait générateur de l’octroi de mer se produit et l’octroi de mer devient exigible :
« 1°Lors de l’importation des produits ou lors de leur mise à la consommation en sortie d’un entrepôt fiscal de stockage défini à l’article 158 A du code des douanes pour les produits qui ne font pas l’objet d’une transformation dans un entrepôt fiscal de production mentionné à l’article 163 du même code ;
« 2° Ou lors de la livraison prévue au 2° de l’article 1er pour les produits qui ont fait l’objet d’une transformation sous un régime suspensif de production mentionné à l’article 163 du code des douanes. »
II
– Les articles 11 et 12 de la même loi sont abrogés. –
Adopté.
(Supprimé)
Au 1° de l’article 17 de la même loi, le mot : « perçu » est remplacé par le mot : « acquitté » et les mots : « des marchandises » sont supprimés. –
Adopté.
À l’article 18 de la même loi, le mot : « Seules » est supprimé et les références : « des 1° à 3° » sont remplacées par les références : « des 1° et 3° ».

L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
À l’article 18 de la même loi, le mot : « Seules » est supprimé, les références : « des 1° à 3° » sont remplacées par les références : « des 1° et 3° » et, après la référence : « de l’article 4 », sont insérées les références : « et du 1° du I de l’article 5 ».
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel, destiné à tirer les conséquences de l’amendement qui a été adopté sur le marché unique antillais.
L'amendement est adopté.
L’article 19 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – L’octroi de mer qui a grevé un bien d’investissement est déductible en totalité lorsqu’il est affecté à hauteur de plus de 50 % à des opérations ouvrant droit à déduction et n’est pas déductible lorsqu’il est affecté à hauteur de 50 % ou moins à des opérations ouvrant droit à déduction. » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– au début, sont ajoutés les mots : « L’octroi de mer qui a grevé » ;
– à la fin, les mots : « n’ouvrent pas droit à déduction » sont remplacés par les mots : « n’est pas déductible » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Il en est de même de l’octroi de mer qui a grevé les éléments constitutifs, les pièces détachées et les accessoires de ces véhicules et engins. »

L'amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, Desplan, J. Gillot et S. Larcher, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Avant les mots :
L'octroi de mer
insérer les mots :
À l’exception des produits listés dans les annexes de la décision du Conseil n° 940/2014/UE du 17 décembre 2014 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises,
La parole est à M. Georges Patient.
L'article 16 est adopté.
Après l’article 19 de la même loi, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – Les personnes qui, au cours d’une année civile, franchissent le seuil d’assujettissement mentionné à l’article 2 peuvent, dans les conditions fixées par l’article 19, déduire l’octroi de mer qui a grevé les biens d’investissement acquis durant cette année civile et durant l’année civile précédente. Le montant de l’octroi de mer dont la déduction est ainsi ouverte doit être mentionné de façon distincte sur la première déclaration trimestrielle. La taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures dans les conditions fixées au second alinéa de l’article 16. » –
Adopté.
Au second alinéa de l’article 24 de la même loi, les mots : « de biens d’investissement qui ont supporté l’octroi de mer » sont remplacés par les mots : « des biens d’investissements » et les références : « 1° à 3° et 5° » sont remplacées par les références : « 1° et 3° ».

L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le second alinéa de l’article 24 de la même loi est ainsi modifié :
1° Les mots : « de biens d’investissement qui ont supporté l’octroi de mer » sont remplacés par les mots : « des biens d’investissements » ;
2° Les références : « 1° à 3° et 5° » sont remplacées par les références : « 1° et 3° » ;
3° Est ajoutée la référence : « et du 1° du I de l’article 5 ».
La parole est à Mme la ministre.

Le Gouvernement étant cohérent avec lui-même, la commission ne peut être que favorable à cet amendement !
L'amendement est adopté.
L’article 25 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 25. – L’octroi de mer qui a grevé des biens qui, dans les deux ans suivant leur importation par une personne exerçant une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts ou leur livraison à une telle personne, font l’objet, par cette personne, d’une livraison exonérée en application des 1° et 3° de l’article 4 peut être remboursé dès lors que la taxe a été facturée ou acquittée et n’a pas été imputée. »

L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après la référence :
de l’article 4
insérer les références :
et du 1° du I de l’article 5
La parole est à Mme la ministre.
L'amendement est adopté.
L'article 19 est adopté.
L’article 27 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 27. – Les taux de l’octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional de Guadeloupe et de La Réunion, de l’assemblée de Guyane, de l’assemblée de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte.
« Ils sont fixés par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises.
« Les taux de l’octroi de mer ne peuvent pas excéder un taux maximal de 60 % et, pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés, un taux maximal de 90 %. À Mayotte, ces taux maximaux sont majorés de moitié.
« Sous réserve de l’article 28, les produits identiques ou similaires sont soumis au même taux, qu’ils soient livrés à titre onéreux ou importés, quelle qu’en soit la provenance. » –
Adopté.
L’article 28 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’écart, résultant de délibérations prises en application de l’article 7, entre le taux applicable aux importations et le taux applicable aux livraisons d’un même bien ne peut excéder : » ;
2° Au 1°, les mots : « 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 relative au régime de l’octroi de mer dans les départements français d’outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE » sont remplacés par les mots : « du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé. –
Adopté.
L’article 29 de la même loi est abrogé. –
Adopté.
L’article 30 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « 2004/162/CE du 10 février 2004 du Conseil » sont remplacés par les mots : « du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, » et les mots : « le conseil régional adresse » sont remplacés par les mots : « le conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte adressent » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « du conseil régional » sont supprimés et le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du conseil régional » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est supprimé. –
Adopté.
L’article 31 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les références : « aux articles 28 et 29 » sont remplacées par la référence : « à l’article 28 » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, sans excéder le pourcentage strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités locales » ;
2° Au second alinéa, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre » et après les mots : « le conseil régional » sont insérés les mots : « de Guadeloupe ou de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte » et le mot : « région » est remplacé par le mot : « collectivité ». –
Adopté.
L’article 32 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 32. – Aucune différence de taxation n’est autorisée entre les importations de produits bénéficiant du régime spécifique d’approvisionnement prévu au chapitre III du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mars 2013, portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil et les livraisons de produits similaires dans la collectivité. » –
Adopté.
Le second alinéa de l’article 34 de la même loi est supprimé. –
Adopté.
Le II de l’article 35 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque bien, le montant de l’octroi de mer, le taux d’imposition ainsi que sa position par référence aux codes de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 précité ou aux codes de toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée en y ajoutant éventuellement des subdivisions pour les positions limitativement prévues à l’annexe à la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, précitée. » ;
2° Au second alinéa, les références : « articles 5 et 7 » sont remplacées par les références : « articles 7 et 7-1 ». –
Adopté.
Au dernier alinéa de l’article 36 de la même loi, le mot : « région » est remplacé par le mot : « collectivité ». –
Adopté.
L’article 37 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le début est ainsi rédigé : « Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de la Martinique ou le conseil départemental de Mayotte peuvent …
le reste sans changement
– le mot : « région » est remplacé par le mot : « collectivité » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que celles exonérées en application de l’article 5 » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « au titre des articles 6 et 7 » sont remplacés par les mots : « en vertu des articles 6 à 7-1 » ;
– après les mots : « les conseils régionaux » sont insérés les mots : « de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte » ;
2° Au III, le mot : « région » est remplacé par le mot : « collectivité » et les références : « aux articles 28 et 29 » sont remplacées par les références : « à l’article 28 ». –
Adopté.
Le premier alinéa de l’article 38 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les mouvements, d’une part, de biens importés ou produits en Guadeloupe et expédiés ou livrés en Martinique et, d’autre part, de biens importés ou produits en Martinique et expédiés ou livrés en Guadeloupe, font l’objet d’une déclaration périodique et du dépôt d’un document d’accompagnement. » –
Adopté.
L’article 39 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’expédition à destination de Martinique et de Guadeloupe ou la livraison dans ces collectivités de biens qui ont fait l’objet dans l’une de ces collectivités d’une importation donnent lieu à un versement annuel affecté aux communes de la collectivité de destination des biens. » ;
2° Au deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « région » est remplacé par le mot : « collectivité » ;
3° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « les marchandises ont été expédiées ou livrées » sont remplacés par les mots : « les biens ont été expédiés ou livrés » ;
4° À la première phrase du 1° et au dernier alinéa, le mot : « marchandises » est remplacé par le mot : « biens ». –
Adopté.

L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam et J. Gillot, est ainsi libellé :
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 39 de la même loi, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39 -1. – Les livraisons dans une collectivité du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés à destination de la Guyane et les livraisons en Guyane de biens expédiés ou transportés à destination du marché unique antillais donnent lieu à un reversement annuel affecté aux collectivités du département de destination des biens.
« Le versement est prélevé sur les produits de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional perçus dans le département de livraison. Il vient en complément des produits de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional perçus directement dans le département de destination au titre des articles 1er et 37.
« Il est calculé selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article 52. Ces modalités reposent sur l’application des taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional exigibles à la livraison dans le département à partir duquel les biens ont été expédiés ou livrés à :
« 1° La valeur en douane des biens en cas d’expédition sans transfert de la propriété. La valeur en douane est calculée comme en matière de valeur en douane à l’exportation ;
« 2° Au prix hors taxe facturé en cas de livraison.
« Les taux applicables sont ceux en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le versement intervient.
« Il est procédé au versement un an au plus tard après la date à laquelle a été réalisée l’expédition ou la livraison de biens dans le département de destination. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.

La loi relative à l'octroi de mer a organisé des règles d’échanges dérogatoires au droit commun entre la Guyane et le MUA, le marché unique antillais. Les biens livrés dans le MUA et expédiés en Guyane sont soumis à l’octroi de mer interne et à l’octroi de mer régional interne dans le département de livraison, et vice-versa.
Le département de consommation se trouve donc privé des recettes à double titre.
D’une part, l’application du droit commun est écarté et les produits importés ne sont plus soumis à l’octroi de mer externe dans le département de consommation. Le manque à gagner pour les collectivités territoriales est évalué, en Guyane, à 4 millions d’euros par an et à 1, 9 million d’euros par an pour le MUA.
D’autre part, les biens sont soumis à l’octroi de mer interne dans le territoire de livraison. Ce prélèvement est répercuté sur les consommateurs du territoire de consommation, mais il ne génère aucune recette pour les collectivités de ce territoire. Le gain pour les collectivités régionales de Martinique et de Guadeloupe varie de 500 000 à 600 000 euros par an. Les biens livrés en Guyane et expédiés dans le marché unique antillais ne sont actuellement pas soumis à l’octroi de mer interne et ne génèrent pas de recettes.
À l’issue de l’accord sur l’aménagement des règles d’échanges entre la Guyane et le marché unique antillais, les conseils régionaux ont indiqué ne pas être opposés à la mise en place d’une clause de reversement entre la Guyane et le marché unique antillais, à l’instar de celle qui existe déjà entre la Guadeloupe et la Martinique pour les importations. Les taxes d’octroi de mer et d’octroi de mer régional perçues dans le MUA sur les biens expédiés en Guyane, et inversement, pourront désormais faire l’objet d’un reversement au profit des collectivités du département de consommation.
Cet amendement vise donc à tirer les conséquences des dispositions arrêtées lors de la réunion du 28 avril dernier, mais aussi à mettre en œuvre de manière efficace les adaptations nécessaires à nos territoires, et ce dans un esprit de concertation.

M. Éric Doligé, rapporteur. Cet amendement n’est pas inintéressant, donc il est intéressant !
Sourires.

Dans la mesure où ce dispositif ne figurait pas dans l’accord du 28 avril dernier, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement, car il est difficile d’en évaluer l’impact.
Monsieur le président, avant de donner mon avis sur cet amendement, permettez-moi de faire part au sénateur de la Guyane de la solidarité du Gouvernement avec les populations de Camopi qui viennent d’être frappées par des inondations. Je sais que, depuis hier, les hélicoptères de la sécurité civile, dont on voit l’intérêt, interviennent et que la solidarité a commencé à s’exercer. Je me suis rendue à Camopi en février dernier, monsieur le sénateur, et je tiens à ce que vous fassiez savoir aux populations concernées que nous ne les oublions pas et que nous sommes à leurs côtés.
L’amendement n° 25 rectifié soulève le problème des relations entre le marché unique antillais et la Guyane. Nous avons examiné cette question lors de la réunion que nous avons eue ensemble. Comme vous l’avez dit, monsieur le sénateur, nous avons pu dégager des points d’accord sur des sujets qu’il était particulièrement urgent de régler et identifier d’autres secteurs sur lesquels nous devons continuer à travailler.
Par ailleurs, nous avons dégagé une méthode afin que les élus de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe puissent se retrouver et échanger sur les problèmes de perception, de taux différenciés de l’octroi de mer, de reversements éventuels, voire de lieu où l’imposition est due.
Nous prenons acte de la difficulté signalée dans l’amendement n° 25 rectifié et nous confions à la commission le soin d’examiner cette question et d’y apporter des réponses concertées.
Il m’avait d’ailleurs semblé, lors de la réunion que nous avons eue avec les élus de la Martinique notamment, que ces derniers étaient ouverts à une évolution sur ce sujet. En organisant une réunion et en examinant cette question sereinement, nous devrions donc parvenir à une solution dans un délai raisonnable.
Je demande donc le retrait de l’amendement.

J’ai pris note des propos tenus par Mme la ministre. En la circonstance, j’aimerais qu’on aille un peu plus vite que d’habitude, car il s’agit d’un problème important, qui représente un certain poids financier, comme en témoignent les chiffres que j’ai cités sur le niveau des échanges entre le marché unique antillais et la Guyane.
Je retire mon amendement, madame la ministre, mais je souhaite que ce sujet soit inscrit à l’ordre du jour de la première réunion de l’instance de concertation qui, me semble-t-il, devrait se tenir dans le courant du mois de mai.

L'amendement n° 25 rectifié est retiré.
La parole est à M. Serge Larcher.

Je salue la sagesse de mon collègue de Guyane, qui a retiré son amendement.
Depuis la réunion du 28 avril dernier, on sent une certaine ouverture sur cette question, notamment chez les élus du conseil général de la Martinique. Il ne faudrait pas aller contre ce mouvement avec ce projet de loi.
Faisons confiance à ces élus, car ils sont capables d’établir progressivement un système ne spoliant pas les intérêts de la Guyane.
Saluons donc l’ouverture dont ils font preuve et continuons à travailler ensemble, de manière consensuelle et en toute intelligence, afin de trouver des solutions satisfaisantes pour le marché antillo-guyanais. Évitons de provoquer des crispations ou d’opposer les uns et les autres. La décision de mon collègue Patient de retirer son amendement va dans ce sens.
À l’article 45 de la même loi, les mots : « et pour l’application de ces articles dans les régions d’outre-mer » sont supprimés. –
Adopté.
Le premier alinéa de l’article 47 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le produit …
le reste sans changement
2° À la deuxième phrase, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la collectivité territoriale ou le Département ».

L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, Desplan, J. Gillot et S. Larcher, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° À la deuxième phrase, après les mots : « en Guadeloupe, » sont insérés les mots : « en Guyane » et les mots : « en Guyane et » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.

Sur la question de la répartition de l’octroi de mer, la Guyane se distingue des autres départements d’outre-mer, puisque le conseil général bénéficie, aux côtés des communes, d’une part correspondant à 35 % du montant total de la « dotation globale garantie » de la taxe d’octroi de mer. Cette part a été plafonnée à partir de 2005 à 27 millions d’euros, montant perçu par le département en 2003.
Cette disposition, prise dans une loi de finances en 1974, à la suite des difficultés financières du conseil général, a été confortée dans la loi de 2004 relative à l’octroi de mer. Cette disposition est unique en France, en particulier dans les DOM. Elle permet à l’État de récupérer les recettes destinées aux communes pour résorber le déficit du conseil général, plutôt que de prendre les mesures adaptées relevant de la solidarité nationale, instituant ainsi une péréquation entre collectivités pauvres.
Cet amendement vise à supprimer ce prélèvement, qui pénalise très lourdement les communes de Guyane.

Je comprends très bien la position de Georges Patient, qui revient régulièrement sur la situation très particulière de la Guyane, comme il l’a fait avec l’amendement précédent.
On comprend que le régime très spécifique qu’il évoque, qui permet au département de percevoir 27 millions d’euros normalement affectés aux communes, pose problème à ces dernières. Mais on peut aussi se demander comment ferait le département si on lui retirait ces 27 millions d’euros. La solution n’est donc pas aisée à trouver.
Je rappelle que le département et la région devraient prochainement constituer une collectivité unique. Il sera alors peut-être plus facile de trouver une solution au sein de cet ensemble plus vaste, qui, globalement, ne disposera cependant pas de plus de moyens financiers.
Toujours est-il qu’on ne peut pas être a priori favorable à cet amendement, qui, s’il était adopté, déstabiliserait les finances du département de la Guyane.
Deux autres amendements similaires à celui-ci ayant été déposés, j’aimerais avoir l’éclairage du Gouvernement, qui a peut-être une solution pour répondre positivement à la demande de Georges Patient.
Nous ne sous-estimons pas la difficulté soulevée dans ces amendements. Toutefois, la disposition en question est ancienne puisqu’elle date de 1974 : cela fait donc quarante ans que cette situation existe.
S’il est vrai que 27 millions d’euros sont prélevés au profit du département, il faut tout de même reconnaître que la part affectée aux communes est en constante progression. Elle est ainsi passée de 63 millions d’euros en 2008 à 76 millions d’euros en 2014. Cette évolution est logique, car la population de la Guyane ne cesse de croître. Par conséquent, la consommation augmente également.
Nous avons fait des efforts pour permettre un rattrapage en Guyane. À cet égard, je rappelle que, en 2014, la DGF par habitant du département, dont le montant s’établissait à 57, 15 euros, était la plus élevée des DOM. C'est aussi celle qui connaît le plus fort taux d’augmentation des DOM.
Par conséquent, il nous semble que les difficultés des communes de la Guyane, dont nous somment conscients, sont aujourd’hui prises en compte. Ce n’est pas en « coulant » le département que l’on va régler la question.
Quand nous évoquerons le pacte pour la Guyane et que nous préparerons le rapprochement des deux collectivités, nous aurons sans doute à nous pencher sur cette question. En attendant, les choses ne sont pas assez mûres pour qu’elle puisse être réglée dans le présent projet de loi.
Je demande donc le retrait de cet amendement.

Obtenant régulièrement les mêmes réponses, je répéterai moi aussi la même chose, à savoir qu’il faut comparer ce qui est comparable. J’ai déjà évoqué cette question dans un rapport que j’ai rédigé. J’aurais préféré que vous me répondiez, madame la ministre, que l’adoption de dispositions plus favorables aux communes de Guyane était envisageable dans le prochain projet de loi de finances.
Vous avez évoqué le pacte pour la Guyane, madame la ministre : nous l’attendons lui aussi depuis un certain temps ! Or les Guyanais peuvent difficilement attendre. Je ne voudrais pas que l’on pense, sur le fondement des chiffres que vous venez de donner, que les communes de Guyane sont riches, car tel n’est pas le cas.
Je rappelle en effet que la Guyane connaît une croissance démographique exponentielle, la plus forte de France : près de 4 % par an – et jusqu’à 8 % dans certaines communes ! Le PIB est en revanche le plus faible de toutes les régions françaises, après Mayotte : il représente moins de 50 % du PIB de la métropole. En outre, plus du quart de la population vit dans des conditions difficiles. Tout cela doit donc nous conduire à porter une attention très soutenue à la Guyane.
Cela étant dit, je retire mon amendement, pour éviter de procéder à un vote qui en gênerait certains.
L'article 32 est adopté.
L’article 48 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l’article 47 peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du conseil régional de Guadeloupe ou de La Réunion, de l’assemblée de Guyane, de l’assemblée de la Martinique ou du conseil départemental de Mayotte dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de l’État dans la collectivité. » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « du conseil régional » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Nonobstant le premier alinéa, la collectivité de Guyane reçoit une part de la dotation globale garantie fixée à 35 % et plafonnée à 27 millions d’euros. »

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 9 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, Desplan, J. Gillot et S. Larcher, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° À la seconde phrase du second alinéa, après l'année : « 2005 », sont insérés les mots : « et jusqu’à l’exercice 2015 inclus ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour le département de la Guyane du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.

L'amendement n° 9 rectifié est retiré.
L'amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam, Desplan, J. Gillot et S. Larcher, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À compter de l’exercice 2016, la part de la dotation globale garantie reçue par la collectivité territoriale de Guyane est plafonnée à 27 millions d'euros. À compter de l’exercice 2017, elle est plafonnée à 18 millions d'euros. À compter de l’exercice 2018, elle est plafonnée à 9 millions d’euros. À compter de l’exercice 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne la reçoit plus. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Guyane est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Georges Patient.

L’objet de cet amendement est lui aussi de prévoir une meilleure répartition du produit de l’octroi de mer.
L’amendement n° 9 rectifié que j’ai retiré tendait à prévoir la suppression immédiate de la part du montant total de la dotation globale garantie affectée à la collectivité territoriale de Guyane. Le présent amendement tend, lui, à réduire progressivement ce montant, afin de tenir compte de la situation contrainte des finances de l’État. Le manque à gagner pour le département serait compensé par une majoration à due concurrence de la DGF.
S’il était adopté, cet amendement conduirait à restituer aux communes les vingt-sept millions d’euros qui lui sont prélevés chaque année, et ce sur trois exercices : 2016, 2017 et 2018. Cela représenterait un effort de neuf millions d’euros par an, ce qui est selon moi faisable.

Malheureusement, nous nous trouvons dans la même situation que tout à l’heure, si ce n’est que la mesure proposée serait étalée dans le temps. Supprimer 27 millions d’euros de recettes au département afin de les restituer aux communes reviendrait à déshabiller l’un pour habiller les autres. Une telle disposition poserait problème, car elle toucherait à l’équilibre local des finances sur l’ensemble du territoire.
En revanche, comme toujours, je comprends bien la position de Georges Patient. La Guyane se trouve effectivement dans une situation particulière et délicate, comme en attestent les données chiffrées, que l’on ne cesse de rappeler à juste titre, sur l’accroissement de la population, la superficie du territoire ou encore les revenus par habitants.
Il faudra bien un jour trouver des solutions pour résoudre ces problèmes, partiellement ou totalement, et par paliers assez rapides. Certes, vous nous proposez en l’espèce, mon cher collègue, une mesure par paliers, mais il s’agit d’effectuer un prélèvement sur une collectivité au bénéfice d’une autre, ce qui ne changera pas grand-chose pour le territoire dans son ensemble.
Il vaudrait mieux trouver des ressources externes au territoire, mais je ne vois pas d’où elles pourraient provenir, si ce n’est de l’État. Or celui-ci n’est pas en mesure d’en octroyer eu égard à la situation actuelle de ses finances ; je me vois donc malheureusement contraint d’émettre, comme précédemment, un avis défavorable.
Nous poursuivons en effet avec cet amendement le débat que nous venons d’avoir.
Georges Patient, qui connaît très bien ce sujet puisqu’il a produit un rapport remarqué sur les finances des collectivités territoriales, met en lumière un problème réel. En effet, le développement démographique de la Guyane et la pauvreté de sa population posent aux communes un problème de ressources. Toutefois, il me paraît difficile de supprimer une partie de la dotation du conseil général pour la donner aux communes.
Certes, la solution consisterait à demander à l’État de compenser cette baisse à due concurrence. Nous nous efforçons déjà depuis deux ans d’accroître la part relative de la Guyane dans la ligne budgétaire unique et dans d’autres financements de l’État, mais il est difficile de suivre le rythme de croissance de la population guyanaise.
Je vous propose donc de revenir sur ce sujet prochainement, lorsque nous discuterons du pacte pour la Guyane. Je m’engage à ce que nous nous revoyions pour essayer de trouver des fonds afin d’améliorer la situation des communes guyanaises, dont il est vrai que les besoins sont bien plus grands qu’ailleurs. L’équipement de la Guyane accuse un retard important et sa population croît fortement. Je pense que le nouveau pas de tir et le développement à venir de l’or ouvriront des possibilités nouvelles pour la Guyane, et nous les accompagnerons.
En revanche, je n’imagine pas que l’État, considérant l’état de ses finances générales, puisse rapidement compenser les pertes de recettes qui résulteraient de l’adoption de votre amendement, monsieur le sénateur. C’est pourquoi, même si cela vous paraîtra un peu répétitif, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Madame la ministre, je suis patient, mais d’amendement en amendement de notre collègue Patient, nous tournons autour du pot. Le véritable problème de la Guyane réside dans sa faible assiette fiscale, liée à la détention directe par l’État de 98 % du territoire. Nous faisons donc face à une véritable difficulté : la potentialité fiscale de ce département, qu’il faudra tôt ou tard traiter ! Dans ces conditions, comment voulez-vous qu’un territoire dont la population ne cesse de croître, de surcroît de manière non régulée, ce qui pose des problèmes majeurs, puisse s’en sortir, aller de l’avant et maîtriser son avenir ?
C’est pourquoi je comprends tout à fait la motivation des amendements qui nous sont proposés, parce que nous tournons autour du problème sans jamais l’aborder réellement. Il me semble que là est le sujet de fond et qu’il faudra le traiter tôt ou tard.

L’amendement que nous avons proposé avait surtout vocation à prendre date.
Je suis pour ma part conseiller général guyanais depuis plus de trente ans ; ce sont toujours les mêmes questions qui sont posées, les mêmes réponses qui sont apportées, quel que soit le gouvernement.
Le véritable problème a été correctement posé par M. Joël Guerriau : il s’agit de la question foncière. Des solutions existent : il faut fiscaliser les propriétés foncières de l’État en Guyane et les propriétés foncières privées du Centre spatial guyanais – qui, soit dit en passant, représentent l’équivalent de la superficie de la Martinique, soit environ mille kilomètres carrés !
Aux questions posées, il faut apporter des réponses, car le conseil général connaît des difficultés financières structurelles depuis des années, non parce que les présidents qui se sont succédé étaient de mauvais gestionnaires, mais en raison de la démographie de ce territoire. La moitié des habitants ont moins de vingt-trois ans et plus de 50 % de la population ne fait rien, ne travaille pas, à cause du déficit d’emplois. En outre, comme l’a dit Georges Patient ce matin, le PIB s’y est détérioré.
Nous souhaitons ici faire prendre conscience à nos collègues sénateurs du risque d’aggravation de la situation de la Guyane si des solutions ne sont pas trouvées pour remettre à niveau les ressources des collectivités territoriales, ressources dont l’octroi de mer fait partie.

Je prends acte des assurances que vient de nous donner Mme la ministre concernant le pacte pour la Guyane, mais aussi l’octroi de mer.
Ce pacte, que l’on nous a annoncé il y a déjà un certain temps et qui devrait être élaboré prochainement, en concertation, je suppose, avec les représentants de Guyane, devra être l’occasion de revoir et de corriger l’octroi de mer, car il constitue à mon sens l’outil idéal, s’agissant d’une question financière.
Dans ces conditions, je retire mon amendement.
L'article 33 est adopté.

L'amendement n° 32, présenté par MM. Vergès et Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du 2° du I de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
La parole est à M. Éric Bocquet.

Je serai assez bref, les principaux arguments ayant été développés ce matin lors de la discussion générale.
La réforme de la DGF des communes de 2005 a notamment été marquée par l’introduction d’une part proportionnelle à la superficie, sauf pour la Guyane, car la taille moyenne des communes de Guyane est d’un peu moins de quatre mille kilomètres carrés, contre quinze kilomètres carrés pour les communes de la métropole. Face à ce constat, il a été prévu un plafonnement du montant de la dotation superficiaire, fixé au triple du montant de la dotation de base – je vous rappelle que celle-ci est elle-même calculée en fonction de la population de chaque commune.
La Guyane est le seul département où l’on applique une telle limitation.
Le rapport sénatorial Les DOM, défi pour la République, chance pour la France, 100 propositions pour fonder l'avenir, datant de 2009, indique que, du fait de ce plafonnement, « les communes de Guyane ont vu leur DGF amputée d'un montant global de 16 millions d'euros en 2009 ». Il serait donc logique de déplafonner – au moins à hauteur de ce montant, puisque c’est un chiffre remontant à 2009 – la dotation superficiaire.
En outre, la question de l’insuffisance d’identification des bases fiscales de contributions directes n’a toujours pas été résolue – pas plus qu’à Mayotte, d’ailleurs.
Cet amendement s’inscrit dans la logique de celui qu’a déposé Paul Vergès visant à demander la remise d’un rapport sur une réforme de la fiscalité dans les outre-mer.

Nous connaissons aussi cet argument, et il est en effet audible compte tenu de la spécificité géographique de la Guyane – sa très grande superficie et sa très faible densité. Ce territoire français connaît de fortes singularités, y compris du point de vue financier, démographique et économique. Cette question doit donc elle aussi s’inscrire dans une réflexion globale dans le cadre de l’élaboration du pacte pour la Guyane.
Je reconnais que, dans leur ensemble, les Guyanais sont patients, sans vouloir faire de mauvais jeu de mot, cher collègue. Alors que cela fait des années que nous suivons ce dossier avec beaucoup d’intérêt, nous entendons souvent les mêmes réponses porteuses d’espoir. J’espère donc obtenir un jour, et même prochainement, une réponse permettant d’avoir une vision globale.
Encore une fois, je ne pense vraiment pas que nous résoudrons le problème en prélevant à l’un pour donner à l’autre, au sein du même territoire. Il faut trouver d’autres solutions. Notre collègue Antoine Karam vient d’en citer certaines, qui sont intéressantes et ont déjà été étudiées. Il faudrait peut-être dépasser maintenant la simple étude et procéder à des choix et à des réalisations.
La part de la dotation globale de fonctionnement des communes proportionnelle à la superficie s’élève à 3, 28 euros par hectare dans l’Hexagone contre 53 euros en Guyane. Compte tenu des montants financiers en jeu – de l’ordre de quatorze millions d’euros, qu’il faudrait prélever sur la dotation d’autres collectivités –, la commission ne peut pas émettre un avis favorable sur cet amendement. La solution relèverait à mon sens plutôt de la loi de finances.
Ce sujet, que nous connaissons bien, n’a qu’un rapport lointain avec l’octroi de mer. Il est vrai qu’en Guyane, comme vous le soulignez dans votre rapport, monsieur le rapporteur, la taille moyenne des communes est sans équivalent avec le reste de notre pays. Ainsi, si je me souviens bien, la superficie de la commune de Maripasoula, qui compte dix mille habitants, est plus grande que celle de la Martinique.
L’ajustement des dotations est donc évidemment extrêmement compliqué.
Cela étant dit, il est vrai que les propriétés foncières guyanaises de l’État et du Centre national d’études spatiales, le CNES, représentent une question légitime. Toutefois, convenez avec moi, monsieur le sénateur, que le CNES apporte aussi beaucoup à la Guyane en termes d’emploi, de rayonnement et de ressources. Aussi, s’il faut effectivement considérer la moitié vide du verre, il convient également de voir sa moitié pleine.
En conclusion, je le répète, ce sujet, auquel le sénateur Vergès est attentif, devra être abordé dans le cadre de l’élaboration du pacte pour la Guyane et de la discussion du projet de loi de finances, car il n’est pas directement lié à l’octroi de mer.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L’article 49 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « en Guadeloupe et à La Réunion, territoriale en Guyane et en Martinique et départementale à Mayotte » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots : « part régionale », sont insérés les mots : «, territoriale ou départementale » ;
b) À la seconde phrase, après les mots : « conseil régional » sont insérés les mots : « de Guadeloupe ou de La Réunion, de l’assemblée de Guyane, de l’assemblée de la Martinique ou du conseil départemental de Mayotte » et le mot : « région » est remplacé par le mot : « collectivité » ;
4° À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « les régions » sont insérés les mots : «, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;
5° Au dernier alinéa, après les mots : « part régionale » sont insérés les mots : «, territoriale ou départementale » et après les mots : « conseil régional » sont insérés les mots : « de Guadeloupe ou de La Réunion, à l’assemblée de Guyane, à l’assemblée de la Martinique ou au conseil départemental de Mayotte ». –
Adopté.
Les articles 50 et 51 de la même loi sont abrogés. –
Adopté.
L’article 51-1 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 51-1. – Pour l’application de la présente loi en Guyane et en Martinique jusqu’à la date de la première réunion suivant la première élection de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique créées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 :
« 1° Les références à la collectivité territoriale de Guyane sont remplacées par les références à la région de Guyane, à l’exception de celles figurant à l’article 47 et au deuxième alinéa de l’article 48 où elles sont remplacées par les références au département de Guyane ;
« 2° Les références à la collectivité territoriale de Martinique sont remplacées par les références à la région de Martinique ;
« 3° Les références à l’assemblée de Guyane et à l’assemblée de Martinique sont remplacées par les références au conseil régional de Guyane et au conseil régional de Martinique. » –
Adopté.

L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Desplan, J. Gillot et S. Larcher, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'opposabilité des secrets fiscal et statistique opposée par le service des douanes et de l’Institut national de la statistique et des études économiques aux conseils régionaux dans le cadre de leurs travaux relatifs à l’octroi de mer est levée.
La parole est à M. Georges Patient.

Les conseils régionaux accordent des exonérations d’octroi de mer et doivent justifier de leur impact économique dans les rapports annuels d’exécution et dans un rapport d’étape. Toutefois, bien que votant des taux appliqués aux produits, ainsi que les exonérations accordées aux entreprises, ils se voient opposer le secret fiscal par les services des douanes. Ces derniers ne transmettent que des données globalisées et anonymes ne permettant pas de réaliser une étude d’impact correcte du dispositif. Ces travaux ne peuvent être sous-traités à l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’INSEE, celui-ci invoquant, de son côté, un secret statistique qui l’empêcherait de communiquer l’intégralité des résultats d’une telle étude d’impact, s’il la réalisait.

La levée des secrets fiscal et statistique en vue d’améliorer les analyses et la connaissance des bases par les collectivités, et, ce faisant, de leur permettre d’avoir une vision plus précise de leurs ressources en matière d’octroi de mer soulève un problème de fond, bien plus large que le cadre posé par notre collègue Georges Patient.
Il nous semble disproportionné et particulièrement risqué de vouloir lever ces secrets. Les demandes de levée pourraient effectivement s’étendre à d’autres domaines, au point que tout le monde finirait par formuler de telles exigences. Or le secret fiscal a tout de même pour objectif de protéger la vie privée des citoyens. Une évolution de cette nature poserait donc un certain nombre de problèmes.
Pour cette raison, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement.
Sur ce sujet – récurrent, si je peux me permettre de le noter -, il me semble nécessaire d’établir une distinction entre, d’une part, des données nominatives couvertes par un secret qu’il est inenvisageable de lever et, d’autre part, les éléments statistiques susceptibles d’être transmis. S’agissant de ces derniers, il est bien évidemment nécessaire que le conseil régional dispose de toutes les données dont il a besoin pour pouvoir travailler.
Toutefois, compte tenu du caractère absolu du secret, je ne peux émettre un avis favorable sur cet amendement.

L'amendement n° 8 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Patient, Desplan, J. Gillot et S. Larcher, est ainsi libellé :
Après l’article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité d’une taxe territoriale sur les services en Guyane.
La parole est à M. Georges Patient.

L’octroi de mer est une taxe ne frappant que la livraison des biens. Les services ne sont pas taxés en Guyane, contrairement aux autres départements et régions d’outre-mer, où ils sont soumis à la TVA. C’est pourquoi nous souhaitons évoquer ici la possibilité de créer une taxe sur les services spécifique à la Guyane.
Le conseil régional de la Guyane avait indiqué en 2012, lors de la renégociation du dispositif de l’octroi de mer, son intérêt pour une extension, à terme, de l’octroi de mer aux services, à condition de disposer d’un rapport évaluant l’impact d’une telle mesure.
Cette condition n’a pas été remplie, et l’urgence de la situation de la Guyane ne permet pas d’attendre 2020. Aussi la création d’une taxe spéciale sur les services permettrait-elle à la collectivité unique de s'installer et de se structurer, tout en relevant le défi de la gestion des fonds communautaires, ainsi que de l'affichage des contreparties nationales à ces crédits.
Si cette taxe était créée, il faudrait envisager de mettre un terme au prélèvement de 35 % de la dotation globale garantie, soit 27 millions d’euros d’octroi de mer, au bénéfice du conseil général.
Un rapport s’impose donc pour examiner la faisabilité de cette taxe territoriale sur les services.

Cet amendement, qui nous donne l’occasion d’entendre parler une fois de plus des 27 millions d’euros, tend à prévoir la remise, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, d’un rapport sur la faisabilité d’une taxe spécifique à la Guyane.
Ce rapport serait certes d’un grand intérêt, mais la position du Sénat en général et de la commission des finances en particulier est constante sur le sujet : elle est de ne pas accéder aux demandes de rapports.
En revanche, compte tenu de la spécificité de la demande, rien n’empêche les parlementaires qui le souhaitent, au sein de leur commission ou des structures auxquelles ils appartiennent, de mener des travaux sur la question.
La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 21 rectifié.
Voilà une fois encore un sujet qui tient à cœur aux élus, en particulier à ceux dont la région serait bénéficiaire de cette taxe.
Mais nous nous heurtons à une difficulté. Comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, l’octroi de mer est une imposition quelque peu dérogatoire au droit commun et, qui, de ce fait, se trouve encadrée par des conditions assez précisément définies. En particulier, et la décision du Conseil de l’Union européenne du 17 décembre 2014 l’a confirmé une nouvelle fois, il grève les seules marchandises importées et ne peut être appliqué aux services.
Nous devons donc trouver un autre dispositif. Georges Patient propose d’instaurer une taxe sur les services. Pourquoi pas ? Mais il faut bien évidemment au préalable étudier un possible dispositif, son fonctionnement et ses incidences. On pourrait d’ailleurs se demander, dans ce cadre, s’il ne serait pas aussi simple d’étendre la TVA, qui, elle, s’applique également aux services.
Une telle étude, selon moi, pourrait parfaitement être effectuée par la délégation sénatoriale à l’outre-mer, qui dispose d’un certain nombre d’éléments pour pouvoir travailler sur le sujet, ou même par le CNEPEOM, la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État Outre-mer.
En tout cas, si je peux parfaitement envisager que l’on travaille sur la faisabilité d’une taxe spécifique à la Guyane, il me semble que nous n’avons pas besoin de l’inscrire dans la loi. Les parlementaires ont toute latitude pour mener à bien ce travail s’ils le jugent utile.
Par conséquent, l’avis du Gouvernement est également défavorable.

Tous les amendements que j’ai présentés visant à améliorer la situation financière des collectivités de Guyane ont été retoqués, au motif que, dans la situation contrainte où nous nous trouvons, l’État ne peut pas majorer la dotation globale de fonctionnement versée à ces collectivités, en particulier au conseil général.
Mes collègues ont proposé diverses solutions, comme le déplafonnement de la dotation superficiaire ou la fiscalisation du foncier de l'État.
Il faut bien comprendre que la Guyane est victime – j’emploie le terme, même si je n’aime pas l’utiliser – d’un bon nombre de dérogations et d’exonérations, quasiment considérées comme étant de droit commun.
J’évoquais ce matin la situation singulière de ce territoire et force est de constater que toute question le concernant suscite une certaine gêne dans l’hémicycle. On trouve la Guyane trop grande, alors on diminue la dotation superficiaire ! Dans le même temps, l'État, détenteur de 90 % du territoire, se voit exonéré de taxes sur un patrimoine qui n’a son pareil dans aucun des départements de France métropolitaine !
Nous n’avons donc d’autre solution que de compter sur nos propres moyens. L’octroi de mer constitue déjà une fiscalité indirecte très forte. La taxe régionale sur les services serait un moyen, selon nous, d’octroyer des moyens à une collectivité naissante, mais pratiquement mort-née, car, on le sait très bien, elle risque d’être déficitaire dans un ou deux ans.
Je sais bien que le Sénat considère que nous demandons trop de rapports, raison pour laquelle il les refuse. Mais il s’agit, une fois encore, de répondre à une situation d’urgence. Imposer dans la loi la remise d’un rapport, c’est faire en sorte que l’on se mette immédiatement au travail, sans renvoyer le sujet aux calendres grecques.
Je maintiens donc ma demande, étant bien précisé qu’elle porte sur la réalisation d’une étude d’impact, et non sur l’instauration immédiate d’une telle taxe. Tout le monde est conscient que cette étude doit être menée. Indiquons-le dans la loi !
L'amendement n'est pas adopté.
Le Gouvernement remet au Parlement, dès sa transmission à la Commission européenne, le rapport mentionné au 2 de l’article 3 de la décision du Conseil n° 940/2014/UE, du 17 décembre 2014, précitée. Ce rapport comporte notamment une évaluation des effets pour les collectivités et les entreprises de l'abaissement du seuil de taxation prévu aux articles 2 et 6 de la loi n° … du … modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée. –
Adopté.

L'amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Patient, Karam et J. Gillot, est ainsi libellé :
Après l’article 36 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l’article 52 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi rédigé :
« 3° Des articles 31, 38, 39 et 39-1. »
La parole est à M. Georges Patient.

L'amendement n° 26 rectifié est retiré.
L'amendement n° 23 rectifié, présenté par M. Antiste, Mme Claireaux et MM. J. Gillot et S. Larcher, est ainsi libellé :
Après l’article 36 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte sont consultés avant toute modification du régime juridique de l’octroi de mer.
Leurs avis sont réputés acquis en l’absence de notification au représentant de l’État d’un avis exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine. À la demande du représentant de l’État et en cas d’urgence, ce délai est réduit à quinze jours.
La parole est à M. Maurice Antiste.

Il s’agit de permettre à l’assemblée de Martinique, future collectivité unique, à l’assemblée de Guyane, aux conseils régionaux de Guadeloupe et de la Réunion, et au conseil départemental de Mayotte, de se prononcer préalablement à des modifications législatives susceptibles d’être préjudiciables à l’économie locale. Cette consultation visera notamment à faire valoir les préoccupations des ultramarins dans les négociations préalables aux arbitrages européens.
Je précise que, bon nombre de fois, les demandes d’avis parviennent dans les collectivités alors même que les textes sont déjà votés. C’est ce qui me conduit à souhaiter, aujourd'hui, que la nécessité d’une consultation de ces collectivités soit reprécisée.

Considérant que le code général des collectivités territoriales répond à la demande de notre collègue, nous le prions de bien vouloir retirer son amendement. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
En effet, deux articles du code général des collectivités territoriales, les articles 3444-1 et 4433-3-1, prévoient respectivement que « les conseils départementaux des départements d’outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de ces départements » et que « les conseils régionaux des régions d’outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions d’adaptation du régime législatif et de l’organisation administrative de ces régions ».
Effectivement, le code général des collectivités territoriales prévoit la consultation des collectivités sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret, ainsi que sur les propositions d’acte de l’Union européenne. Nous procédons donc obligatoirement à ces consultations et, en pratique, nous ne le faisons pas à la dernière minute.
Ainsi, sur l’octroi de mer, nous avons travaillé main dans la main avec les services de la région. Ce sont eux qui ont établi les listes et nous les ont transmises au fur et à mesure. La décision que nous avons obtenue de la Commission européenne a véritablement été co-construite entre les services de la région et ceux du ministère des outre-mer.
Comme je l’indiquais précédemment, je suis tout à fait prête à améliorer la concertation et à prévoir de nous rencontrer davantage. Toutefois, j’ai vraiment le sentiment que le souhait exprimé par M. Antiste correspond à la pratique quotidienne du ministère.
Bien évidemment, consulter une instance ne signifie pas obligatoirement adopter son point de vue. C’est peut-être là, me semble-t-il, que le bât blesse, car il peut arriver que le ministère ne suive pas certaines des évolutions souhaitées par les collectivités. Mais, j’y insiste, la concertation ne me semble poser aucune difficulté et il paraîtrait étrange de la mentionner dans la loi, alors même que nous la pratiquons quotidiennement.

Vous pensez bien, madame la ministre, monsieur le rapporteur, que je connais l’existence des dispositions législatives que vous mentionnez. Si j’insiste sur le sujet, c’est parce que j’ai vécu les situations que j’ai évoquées, en qualité de conseiller général, puis de conseiller régional. J’aimerais donc vraiment que l’engagement à ce sujet soit total et qu’il soit inscrit quelque part, afin que l’on se souvienne que j’ai insisté sur le caractère obligatoire de ces consultations.
Cette remarque étant faite, j’accepte de retirer cet amendement, monsieur le président.

L'amendement n° 23 rectifié est retiré.
L'amendement n° 33, présenté par MM. Vergès et Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 36 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les pistes de réformes de la fiscalité dans les outre-mer.
La parole est à M. Éric Bocquet.

Comme cela a déjà été souligné, l’octroi de mer est payé par l’ensemble des consommateurs d’outre-mer, indépendamment de leur revenu. Il pénalise donc très fortement les ménages les plus défavorisés. À La Réunion par exemple, Paul Vergès nous en parle régulièrement, 42 % de la population vit sous le seuil de pauvreté monétaire national.
Permettez-moi donc de rappeler à ce stade, et sans malice aucune, certains des engagements pris par le candidat François Hollande en 2012 : « Je créerai un partenariat dynamique entre l’État et les collectivités d’outre-mer, en leur redonnant des marges de manœuvre fiscales et en octroyant davantage de compétences aux régions d’outre-mer. Je veillerai à ce que les dotations de l’État aux collectivités locales tiennent compte plus rapidement des évolutions démographiques ».
N’est-il pas temps de réfléchir à un autre système fiscal dans les outre-mer ? Le Gouvernement avait bien engagé une tentative de réforme fiscale, M. Jean-Marc Ayrault à la baguette… Mais on sait comment l’idée a été enterrée !
Les outre-mer, notamment La Réunion, avaient un moment espéré une « petite révolution pour l’outre-mer », pour reprendre les propos tenus par votre prédécesseur, madame la ministre, en janvier 2014. Celui-ci souhaitait une véritable « remise à plat » des dispositifs existants, à savoir les exonérations de cotisations pour 1, 1 milliard d’euros, les dépenses fiscales pour 1 milliard d’euros, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, pour 320 millions d’euros, la TVA non perçue récupérable pour 100 millions d’euros et les 500 millions d’euros du Fonds exceptionnel d’investissement promis par le Président de la République en cinq ans ! À cela, on peut ajouter les recettes d’octroi de mer - notre sujet du jour – qui se situent entre 169 et 251 millions d’euros.
Nos collègues ultramarins ont rappelé tout à l’heure, par l’intermédiaire d’Antoine Karam, qu’ils attendaient de telles mesures depuis plusieurs décennies maintenant. N’est-il pas temps, enfin, de s’attaquer au sujet et d’accorder à nos collègues, et aux populations d’outre-mer qu’ils représentent, les moyens d’un nouveau développement ?

Tous les chiffres cités par M. Bocquet sont exacts et sont révélateurs de la situation des collectivités d’outre-mer, plus particulièrement de La Réunion.
Cependant, la commission émet un avis défavorable sur cette demande de rapport, comme elle l’a déjà fait pour les autres demandes de même nature.
Mme la ministre a avancé une piste intéressante tout à l’heure et suggéré que le travail de réflexion sur la création d’une nouvelle taxe pour certains outre-mer pourrait être réalisé en interne. Peut-être le rapport que vous demandez pourrait-il l’être également ?
Vous prêchez une convaincue s’agissant des difficultés que rencontrent les populations ultra-marines, en particulier celles de La Réunion. Nous sommes conscients qu’un rattrapage doit être effectué dans tous ces territoires. C’est pourquoi nous plaidons tant à l’échelon national qu’auprès de Bruxelles pour obtenir des crédits supplémentaires pour les outre-mer.
Savez-vous que, cette année, quasiment le tiers des fonds européens qui seront alloués à la France seront dédiés aux outre-mer ? Nous faisons donc en sorte de tenir les engagements que nous avons pris afin de procéder au rattrapage nécessaire.
Vous avez rappelé la différence entre la métropole et les outre-mer en termes de fiscalité, en particulier la part considérable de la fiscalité indirecte dans les territoires ultra-marins. Là encore, nous sommes d’accord : le problème est que la part de la fiscalité directe est forcément modeste lorsque les populations sont pauvres.
Le développement de la formation des jeunes et des contrats aidés afin d’apporter des solutions au problème de l’emploi permet de pallier les déséquilibres fiscaux que vous signalez et que nous connaissons bien.
Une possible réforme de la fiscalité a été évoquée. Nous procédons en effet aujourd’hui à une évaluation qui devrait nous permettre d’aller de l’avant dans ce domaine. Je rappellerai pourtant que, pour rééquilibrer la fiscalité directe, il faudra rattraper le retard important pris dans certains territoires, notamment en Guyane, quant au cadastre. Cela suppose aussi que le niveau de vie des populations s’élève afin que l’impôt direct soit davantage perçu.
Je dirai enfin à M. Bocquet comme à M. Patient que si le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements qu’ils défendent, c’est non parce qu’il est insensible à la réalité exposée, mais parce qu’il lui est impossible de donner suite à leurs propositions dans le présent texte. Je prends toutefois l’engagement de travailler à nouveau sur ces questions rapidement.
L'amendement n'est pas adopté.
La présente loi entre en vigueur à compter du 1er juillet 2015. –
Adopté.
Monsieur le président, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération sur l’article 9, car le Gouvernement a omis de lever le gage prévu à cet article.

Le Gouvernement demande qu’il soit procédé à une seconde délibération de l’article 9.
Je rappelle que, en application de l’article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, « avant le vote sur l’ensemble d’un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement ».
Quel est l’avis de la commission sur cette demande de seconde délibération ?

Je ne ferai pas durer le suspense : la commission émet un avis favorable sur cette demande de seconde délibération, afin que le gage soit levé.

Je consulte le Sénat sur la demande de seconde délibération, présentée par le Gouvernement et acceptée par la commission.
Il n’y a pas d’opposition ?...
La seconde délibération est ordonnée.
Conformément à l’article 43, alinéa 5, du règlement du Sénat, « lorsqu’il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport ».
La parole est à M. Éric Doligé, rapporteur.

Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance afin que la commission puisse se réunir. Elle ne devrait durer que quelques minutes.

Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à dix-sept heures dix.

La séance est reprise.
Nous allons procéder à la seconde délibération.
Je rappelle au Sénat les termes de l’article 43, alinéa 6, du règlement : « Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d’amendements, et sur les sous-amendements s’appliquant à ces amendements. »

Le Sénat a précédemment adopté l’article 9 dans cette rédaction :
I. – Après l’article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l’assemblée de Guyane, l’assemblée de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent exonérer les importations, mises à la consommation et livraisons :
« 1° De biens destinés à l’avitaillement des aéronefs et des navires ;
« 2° De carburants destinés à un usage professionnel qui ont fait l’objet d’une adjonction de produits colorants et d’agents traceurs conformément à l’article 265 B du code des douanes. Cette exonération est accordée par secteur d’activité économique. »
II
L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à lever le gage prévu à l’alinéa 5.
L'amendement est adopté.
L'article 9 est adopté.

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.
Le projet de loi est adopté.
Je tiens à remercier les parlementaires du travail très approfondi qu’ils ont accompli avec succès et de leur collaboration efficace.
J’ai bien pris note, mesdames, messieurs les sénateurs, que nous avions plusieurs rendez-vous de travail devant nous permettre de revenir sur les questions extrêmement importantes que vous avez soulevées.

Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats a été publiée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :
Titulaires : M. Vincent Capo-Canellas, Mmes Catherine Deroche et Dominique Estrosi-Sassone, M. François Pillet, Mme Nicole Bricq, M. Jacques Bigot et Mme Annie David.
Suppléants : M. Alain Bertrand, Mme Jacky Deromedi, M. Jean-Jacques Filleul, Mme Pascale Gruny, MM. Michel Raison, Henri Tandonnet et Yannick Vaugrenard.
Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

M. le président. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat le 7 mai 2015, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du II de l’article 18 de la loi du 16 août 2012
Détermination des bénéfices imposables

Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.
En outre, le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 7 mai 2015, deux décisions du Conseil relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :
-l’impôt sur le revenu sur les gains de cession de parts de jeune entreprise innovante - Critères d’exonération (n° 2015-466 QPC) ;
-la réclamation contre l’avis d’amende forfaitaire majorée (n° 2015-467 QPC) ;
Acte est donné de ces communications.

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (projet n° 300, texte de la commission n° 371, rapport n° 370, tomes I, II et III).
Nous poursuivons la discussion des articles du texte de la commission spéciale.
TITRE III
TRAVAILLER
CHAPITRE II
Droit du travail
Section 3
Le dialogue social au sein de l’entreprise
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 87 A.

L'amendement n° 775 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cardoux, César, Chaize, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Des Esgaulx et Deseyne, MM. Doligé et Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mmes Hummel et Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel, Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, Leleux et de Legge, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Milon, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre et Pointereau, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont fusionnés au sein d’une instance unique de représentation.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Le présent amendement vise, dans un souci de simplification, à fusionner les deux instances de représentation que sont le comité d’entreprise, le CE, et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, sachant que cette fusion n’est pas prévue dans le projet de loi relatif au dialogue social et au soutien à l’activité des salariés, que nous examinerons prochainement, lequel ne la prévoit que pour les entreprises de moins de 300 salariés. La portée de cet amendement est donc beaucoup plus large.

La commission spéciale s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement de simplification.
Défavorable.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 87 A.
L'amendement n° 793 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Deseyne et di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Hyest, Mme Imbert, MM. Laménie, D. Laurent, Lefèvre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Paul, Pellevat, Perrin et Pierre, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Savin et Sido, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vogel, Courtois et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l’article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2323-7-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323 -7 -1. – L’employeur consulte une fois par an le comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences sur :
« 1° Les investissements matériels et immatériels ;
« 2° Les fonds propres et l’endettement ;
« 3° La rémunération des salariés et dirigeants ;
« 4° La rémunération des financeurs ;
« 5° Les flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
« 6° La sous-traitance ;
« 7° Le cas échéant, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Cet amendement vise à rationaliser les dix-sept procédures actuelles d’information-consultation du comité d’entreprise et à ne plus prévoir qu’une seule obligation annuelle.

Les auteurs de l’amendement souhaitent simplifier la consultation du comité d’entreprise créée par la loi du 14 juin 2013.
Tel qu’il est rédigé, cet amendement comporte plusieurs imprécisions. En effet, l’amendement ne fait aucunement disparaître « les dix-sept procédures actuelles d’information-consultation du comité d’entreprise » mentionnées dans son objet. De ce fait, la commission a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, comme devrait d’ailleurs l’être également la commission spéciale. Tel qu’il est rédigé en effet, cet amendement, s’il était adopté, serait inopérant.

L'amendement n° 793 rectifié est retiré.
L'amendement n° 794 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Deseyne et di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Hyest, Mme Imbert, MM. Laménie, D. Laurent, Lefèvre, de Legge, de Raincourt, Leleux, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Paul, Pellevat, Perrin et Pierre, Mmes Primas et Procaccia, MM. Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Savin et Sido, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vogel, Courtois, P. Dominati et Lenoir, est ainsi libellé :
Après l’article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2323-7-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323 -7 -2. – Sauf en ce qui concerne le lancement d’une offre publique d’acquisition, l’employeur consulte ponctuellement le comité d’entreprise avant toute décision importante, de portée collective et durable, n’ayant pas été envisagée lors de la consultation sur les orientations stratégiques et de nature à affecter la structure juridique, économique ou financière de l’entreprise, l'activité, l’emploi, l'évolution des métiers et des compétences, la formation professionnelle, l’organisation du travail et les conditions de travail.
« En cas de lancement d’une offre publique d’acquisition, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre et l'employeur qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement, au moment du dépôt de l’offre, leur comité d’entreprise respectif pour l'en informer et le consulter. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Le projet de loi relatif au dialogue social et au soutien à l’activité des salariés qui est en cours de discussion à l’Assemblée nationale et que le Sénat examinera à la fin du mois de juin prochain met en œuvre une véritable simplification.
Toutefois, il ne prévoit pas la consultation ponctuelle du comité d’entreprise avant toute décision importante, de portée collective et durable, qui n’aurait pas été abordée lors de la consultation sur les orientations stratégiques. Tel est l’objet de cet amendement.
Je précise que la rectification dont il a fait l’objet portait sur l’endroit du texte où insérer l’article additionnel.

La commission spéciale s’en remet à la sagesse du Sénat, à la condition que les auteurs de l’amendement procèdent à une correction formelle, afin de ne pas « écraser » l’article L. 2323-7-2 du code du travail, qui a créé la base de données économiques et sociales. Il faudrait créer un article L. 2323-7-2-1 nouveau.
J’invite donc Mme Procaccia à rectifier son amendement en ce sens.

Madame Procaccia, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° 794 rectifié dans le sens suggéré par Mme le rapporteur ?

Je suis donc saisi d’un amendement n° 794 rectifié bis, présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Deseyne et di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Hyest, Mme Imbert, MM. Laménie, D. Laurent, Lefèvre, de Legge, de Raincourt, Leleux, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Paul, Pellevat, Perrin et Pierre, Mmes Primas et Procaccia, MM. Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Savin et Sido, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vogel, Courtois, P. Dominati et Lenoir, et ainsi libellé :
Après l’article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2323-7-2, il est inséré un article L. 2323-7-2-1 du code du travail ainsi rédigé :
« Art. L. 2323 -7 -2-1. – Sauf en ce qui concerne le lancement d’une offre publique d’acquisition, l’employeur consulte ponctuellement le comité d’entreprise avant toute décision importante, de portée collective et durable, n’ayant pas été envisagée lors de la consultation sur les orientations stratégiques et de nature à affecter la structure juridique, économique ou financière de l’entreprise, l'activité, l’emploi, l'évolution des métiers et des compétences, la formation professionnelle, l’organisation du travail et les conditions de travail.
« En cas de lancement d’une offre publique d’acquisition, l'employeur de l'entreprise sur laquelle porte l'offre et l'employeur qui est l'auteur de cette offre réunissent immédiatement, au moment du dépôt de l’offre, leur comité d’entreprise respectif pour l'en informer et le consulter. »
Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 795 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cardoux, César, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Deseyne et di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Hyest, Mme Imbert, MM. Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Leleux, de Legge, de Raincourt, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Paul, Pellevat, Perrin et Pierre, Mmes Primas et Procaccia, MM. Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Savin et Sido, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vogel, Courtois et P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l’article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2323-7-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-7-3. – La base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 est le support de préparation de la consultation sur les orientations stratégiques.
« Le comité d’entreprise est informé dans un délai d’examen suffisant précédant la réunion prévue pour la consultation de la mise à jour des éléments d’information contenus dans la base de données nécessaires à cette consultation. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Cet amendement vise à maintenir la base de données unique comme support de l’information-consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

L’amendement vise à faire de la base de données économiques et sociales, qui regroupe les informations mises à la disposition des représentants du personnel par l’employeur, le support de la préparation de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
En l’état actuel du droit, il est satisfait puisque tel était l’objectif de cette base de données lorsqu’elle a été instituée.
Tel qu’il est rédigé, l’amendement pourrait laisser penser, a contrario, que, pour les autres consultations du comité d’entreprise, les informations nécessaires ne seraient pas fournies dans la base de données.
La commission spéciale sollicite donc le retrait de cet amendement, par cohérence avec ce que nous avons dit tout à l'heure.
Nous pourrons revenir sur ces sujets lors de l’examen du texte dont Mme Procaccia sera le rapporteur.

L'amendement n° 795 rectifié est retiré.
L'amendement n° 1289 rectifié, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 2323-62 du code du travail, les mots : « voix consultative » sont remplacés par les mots : « voix délibérative ».
La parole est à Mme Éliane Assassi.

Le code du travail prévoit que « dans les sociétés, deux membres du comité d’entreprise, délégués par le comité et appartenant l’un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas ».
De même, « dans les sociétés où sont constitués trois collèges électoraux, en application de l’article L. 2324-11, la délégation du personnel au conseil d’administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres. Deux de ces membres appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification ».
Il est prévu que « les membres de la délégation du personnel au conseil d’administration ou au conseil de surveillance ont droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux membres de ces instances à l’occasion de leurs réunions ».
En revanche, il est tout à fait regrettable que ceux-ci ne puissent que « soumettre les vœux du comité au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, lequel donne un avis motivé sur ces vœux ». En effet, les élus du personnel, choisis au sein d’institutions représentatives du personnel démocratiquement élues, comme les comités d’entreprise, sont tout à fait légitimes pour représenter les salariés au sein des conseils d’administration et de surveillance. Or la législation actuelle réduit considérablement la portée de leur participation à ces conseils.
C’est pourquoi nous vous proposons, au travers de cet amendement, de leur attribuer un droit de vote pour faire d’eux des membres à part entière des conseils d’administration et des conseils de surveillance. La voix délibérative dont bénéficieraient ainsi les salariés permettrait d’améliorer le dialogue social et de renforcer la participation des salariés aux prises de décision des entreprises.

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a rendu obligatoire la présence d’administrateurs représentant les salariés, avec voix délibérative, dans les conseils d’administration des plus grandes entreprises.
La commission spéciale sollicite le retrait de cet amendement, car nous attendons une évaluation de cette mesure avant d’envisager de plus amples modifications.
Madame Assassi, votre amendement aborde un sujet important.
Il s’agit de passer à une véritable codétermination au sein des conseils d’administration.
Comme vous le savez, sur le fondement du rapport Gallois, le Gouvernement avait soutenu l’intégration au sein du conseil d’administration de représentants des salariés, en plus des représentants des salariés actionnaires, ce qui existait déjà dans certains conseils d’administration. Deux représentants des salariés siègent désormais dans les conseils d’administration.
Une évaluation est actuellement en cours. Il y a quelques semaines, François Rebsamen et moi-même avons réuni les partenaires sociaux sur ce sujet. Nous les rencontrerons de nouveau après le 18 mai prochain.
À titre personnel je soutiens la philosophie de votre amendement, qui vise à franchir une étape supplémentaire, en octroyant une voix délibérative pleine et entière aux élus du personnel au sein des conseils d’administration. Je suis également favorable aux accords de maintien dans l’emploi dits « défensifs », qui font aussi l’objet de cette évaluation.
Toutefois, je ne peux, à ce stade, émettre un avis favorable sur votre amendement, madame la sénatrice, pour des raisons de procédure. Nous devons en effet attendre la prochaine réunion des partenaires sociaux avant de pouvoir intégrer la mesure que vous proposez soit dans le présent texte, à l’occasion d’une nouvelle lecture, soit dans le projet de loi relatif au dialogue social et au soutien à l’activité des salariés. J’ai bon espoir que nous pourrons recueillir leur éclairage d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire.
Madame Assassi, le Gouvernement sollicite donc le retrait de votre amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable, même si, à titre personnel, je le répète, je suis favorable à cet amendement. J’espère que nous pourrons aller dans le sens que vous souhaitez.

Monsieur le ministre, je suis ravie que vous soyez sensible à ce sujet et que vous le jugiez important. Comme vous le savez, il s’agit là d’une vieille revendication du monde du travail.
Prenant acte des propos de M. le ministre, je retire cet amendement, monsieur le président.

L'amendement n° 1289 rectifié est retiré.
L'amendement n° 1285 rectifié, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1134-5 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le comité d’entreprise ou une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, a connaissance d’éléments susceptibles de caractériser une ou des discriminations illicites, qu’elles soient directes ou indirectes, notamment à l’occasion de la réunion prévue à l’article L. 2323-57 et à celle prévue à l’article 10 de l’accord interprofessionnel du 12 octobre 2006 relatif à la diversité dans l’entreprise, il peut saisir l’inspecteur du travail.
« Sans préjudice des compétences qu’il détient en vertu des articles L. 8112-1 et suivants et de l’article L. 8113-7, l’inspecteur du travail adresse à l’employeur le rapport de ses constatations.
« L’employeur communique ce rapport au comité d’entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l’inspecteur du travail. Dans sa réponse, l’employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu’il met en œuvre dans le cadre d’un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.
« À défaut de comité d’entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d’entreprise pour l’application du présent article. »
La parole est à Mme Annie David.

Notre amendement fait suite au huitième baromètre sur la perception des discriminations dans l’emploi réalisé par le Défenseur des droits et l’Organisation internationale du travail, l’OIT, qui fait apparaître que les demandeurs d’emploi d’origine étrangère se sentent particulièrement discriminés du fait de leur origine.
Or, face à ces discriminations, les salariés et leurs institutions représentatives ont les plus grandes difficultés à réunir des éléments de preuve leur permettant de mettre pleinement en lumière les violations des droits fondamentaux du citoyen dans l’entreprise.
Notre amendement, calqué sur les dispositions relatives au travail précaire, vise à réaffirmer le rôle fondamental des inspecteurs et des inspectrices et des contrôleurs et des contrôleuses du travail en matière de lutte contre les discriminations. Il tend à prévoir que ces derniers pourront être saisis par le comité d’entreprise ou par une institution représentative du personnel si des éléments susceptibles de caractériser une discrimination sont constatés.
Si elle était adoptée, cette disposition permettrait une avancée majeure en matière de lutte contre les discriminations. Elle aurait plus d’effet que les « plans d’action » – en matière d’égalité professionnelle femmes-hommes, par exemple –, lesquels se réduisent le plus souvent à de simples vœux ou se caractérisent par un pur formalisme, loin de la réalité.

L’amendement est satisfait par le droit en vigueur, car toute personne, quel que soit son statut, peut saisir l’inspection du travail, qui est d’ailleurs tenue de maintenir secrète l’origine des plaintes.
Par ailleurs, la commission spéciale n’a pas souhaité créer une procédure spécifique devant le comité d’entreprise en cas de suspicion de discrimination, qui relève plutôt, à ses yeux, de la compétence des juges judiciaires.
Dès lors, la commission spéciale sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 1312 rectifié bis, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1233-10, il est inséré un article L. 1233-10-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1233 -10 -... – Sans préjudice de l’article L. 1233-22, les délégués du personnel ou le comité d’entreprise, qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l’employeur ne sont pas pourvus d’un motif conforme à l’article L. 1233-3, peuvent exercer un droit d’opposition à la rupture du ou des contrats de travail.
« Ils saisissent à cet effet le tribunal de grande instance en la forme des référés qui statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l’employeur au même article L. 1233-3. L’exercice du droit d’opposition suspend la procédure de licenciement.
« S’il juge que les licenciements visés par l’opposition sont pourvus d’un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 précité, le tribunal met fin à la suspension de la procédure, laquelle peut produire tous ses effets, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1233-65 et suivants.
« S’il juge que le motif des licenciements visés par l’opposition n’est pas conforme à l’article L. 1233-3 précité, la procédure et la rupture consécutive des contrats de travail sont nulles. » ;
2° L’article L. 2313-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De se prononcer sur le recours au droit de veto suspensif défini à l’article L. 1213-1 du présent code en cas de rupture du contrat de travail décidée par l’employeur. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il se prononce sur le recours au droit de veto suspensif défini à l’article L. 1213-1 du présent code en cas de rupture du contrat de travail décidée par l’employeur. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.

Selon nous, les salariés sont une solide garantie du développement harmonieux du secteur d’activité dans lequel ils travaillent et constituent la première richesse de leur entreprise. Leur sort étant lié à celui de l’entreprise, ils sont attentifs à sa pérennité, à la différence par exemple des actionnaires, qui ont parfois une vision de court terme. C’est pourquoi leur contribution à la prise de décision, par leur intelligence créative, peut se révéler décisive.
Les salariés, via leurs instances représentatives, doivent avoir un droit de regard sur les choix de l’entreprise. Ils doivent pouvoir présenter des solutions alternatives au projet de licenciement économique et discuter du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
L’un des enseignements que nous tirons de la crise est qu’il faut avancer vers une véritable démocratie économique dans notre pays. Si nous voulons que nos territoires se développent, et que ce développement soit écologique, vecteur de qualité de vie, de bien-être au travail et hors du travail, qu’il soit celui de toute la société par le progrès et le partage des connaissances, des technologies et de la culture, si nous voulons tout cela, il ne peut plus être question de laisser le pouvoir économique aux seuls actionnaires.
Cet amendement tend donc à prévoir que les salariés puissent exercer un droit d’opposition à la rupture du ou des contrats de travail, en saisissant le juge des référés pour qu’il statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l’employeur.
L’adoption de cet amendement serait un premier pas vers la reconnaissance de nouveaux pouvoirs aux salariés dans l’entreprise, en particulier sur les choix de gestion de celle-ci.
Plus largement, elle aiderait à reconnaître de nouveaux pouvoirs aux citoyens et aux citoyennes, afin de leur permettre de maîtriser notre système financier et les choix d’investissement de notre pays, choix qui feront la France de demain.

Cet amendement constitue une négation du pouvoir de direction reconnu à l’employeur et institue une cogestion de fait de l’entreprise en reconnaissant aux élus du personnel la possibilité de faire obstacle à une décision de licenciement.
Si un salarié licencié conteste le motif économique de son licenciement, il doit saisir les prud’hommes après avoir quitté l’entreprise. Ceux-ci, s’ils jugent que le motif économique invoqué par l’employeur n’est pas réel et sérieux, peuvent prononcer la réintégration du salarié.
En conséquence, la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 898 rectifié ter est présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye et Pozzo di Borgo.
L'amendement n° 1487 rectifié bis est présenté par Mme Gruny, M. Calvet, Mme Deseyne et MM. Grand, Houel, Vasselle et Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail est complétée par les mots : « ni excéder les salaires des neuf derniers mois lorsque l’ancienneté du salarié est comprise entre deux et dix ans ou des douze derniers mois lorsque l’ancienneté du salarié est supérieure à dix ans, toutes causes de préjudices confondues ».
La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 898 rectifié ter.

L’article L. 1235-3 du code du travail fixe le montant minimal de l’indemnité que le juge peut allouer au salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise d’au moins onze salariés.
Le présent amendement tend à fixer le montant maximal que le juge, qui garde son pouvoir d’appréciation, pourrait allouer au salarié licencié en cas de condamnation de l’entreprise.
Cette précision constituerait pour les entreprises un élément essentiel de sécurisation lors des ruptures des contrats à durée indéterminée, car elle leur permettrait de connaître le montant des condamnations qu’elles encourent à la suite d’un licenciement.

La parole est à Mme Pascale Gruny, pour présenter l'amendement n° 1487 rectifié bis.

L'amendement n° 743 rectifié, présenté par Mme Deromedi, MM. Allizard, Baroin, Bas, Bignon, Bouchet et Calvet, Mme Canayer, MM. Cardoux, César, Chasseing, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mme di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Emorine, Forissier, Fouché, J.P. Fournier et Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand et Gremillet, Mme Gruny, M. Houel, Mme Imbert, MM. Joyandet et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, de Legge, Leleux, P. Leroy, Magras et Mandelli, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat et Houpert, Mme Hummel, MM. Kennel, Lefèvre, Longuet, Malhuret, Mayet, de Nicolaÿ, Nougein et Pointereau, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail est complétée par les mots : « ni excéder le salaire des douze derniers mois » ;
La parole est à Mme Colette Mélot.

Aujourd’hui, le code du travail fixe à six mois de salaire le montant minimal de l’indemnité allouée au salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans les entreprises d’au moins onze salariés.
Toutefois, le montant de l’indemnité n’est pas plafonné, ce qui place l’employeur dans une situation de forte insécurité juridique en cas de rupture du contrat de travail et peut dissuader certains employeurs d’embaucher.
L’objet de cet amendement est donc d’introduire un plafonnement du montant de l’indemnité perçue en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Un tel dispositif de plancher et de plafond existe dans la très grande majorité des pays européens – le Danemark, l’Allemagne, le Royaume-Uni.
Sans remettre en cause le pouvoir d’appréciation du juge sur la gravité du préjudice, une telle réforme permettrait de sécuriser juridiquement la rupture du contrat de travail pour les employeurs, tout en garantissant aux salariés de bénéficier d’un montant d’indemnité maximale connu à l’avance. De surcroît, une telle réforme serait de nature à limiter les recours contre les décisions prud’homales et à éviter les appels destinés à faire augmenter la condamnation de première instance.

L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit actuellement que, si le licenciement d’un salarié ayant deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer sa réintégration. Mais si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, en plus de l’indemnité de licenciement.
Les amendements identiques n° 898 rectifié ter et 1487 rectifié bis visent à conserver ce plancher, tout en lui adjoignant un plafond variable en fonction de l’ancienneté du salarié.
Ainsi l’indemnité serait-elle plafonnée à neuf mois de salaire si le salarié a moins de dix ans d’ancienneté, et à un an de salaire s’il travaille dans l’entreprise depuis plus de dix ans.
Cette idée est séduisante, mais elle pose quelques difficultés.
Tout d’abord, les préoccupations des auteurs de l’amendement sont partiellement satisfaites par l’existence, depuis la loi relative à la sécurisation de l’emploi, d’un barème indicatif en phase de conciliation devant le conseil de prud’hommes et par la création, au présent article, d’un référentiel indicatif pour fixer l’indemnité en phase de jugement, ces deux dispositifs se fondant notamment sur l’ancienneté du salarié.
Ensuite, ces amendements sont peu compatibles avec la liberté d’appréciation du juge, qui évalue le préjudice subi au cas par cas. Or, tel qu’il rédigé, l’amendement est très restrictif, puisque le plafond s’appliquerait « toutes causes de préjudices confondues », ce qui s’apparente davantage à une transaction qu’à un jugement.
Pour ces raisons, la commission sollicite le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 743 rectifié est presque identique aux amendements n° 898 rectifié ter et 1487 rectifié bis, mais il tend à fixer un plafond d’un an, quelle que soit l’ancienneté du salarié, plafond qui ne s’applique pas à toutes les causes de préjudices que peut subir un salarié.
Il est certes en partie satisfait par l’existence du barème en conciliation et du futur référentiel en phase de jugement devant le conseil de prud’hommes, mais il est plus ambitieux et offrirait un cadre juridique clair et prévisible aux employeurs en cas de contentieux devant les prud’hommes.
En sécurisant les licenciements, l’amendement, s’il était adopté, permettrait de lever les freins à l’embauche.
C’est pourquoi la commission s’en remet à la sagesse de notre assemblée sur cet amendement.
Le débat juridique a été bien posé par Mme le rapporteur.
Nous sommes parvenus hier à un consensus sur la réforme des prud’hommes. Celle-ci, qui constitue l’une des avancées de ce texte, devrait permettre d’accélérer les procédures et de donner plus de visibilité aux parties grâce au référentiel.
Au-delà, le débat juridique n’est pas tranché sur la possibilité de fixer un plafond d’indemnisation. Pour l’heure, il existe un plancher, auquel nous n’avons pas touché. Plutôt que de chercher à articuler un plancher et un plafond, nous avons travaillé sur un référentiel permettant aux parties de trouver un compromis.
Les services juridiques de l’État qui ont travaillé sur cette question ont relevé une incertitude juridique quant à la possibilité même de plafonner l’indemnisation fixée par une décision de justice. La création d’un plafond serait donc très fragile d’un point de vue juridique.
Je salue la distinction fine effectuée par Mme la rapporteur, mais je solliciterai pour ma part le retrait de ces trois amendements. Faute de garanties juridiques suffisantes, je suggère en effet de consolider l’approche par le référentiel plutôt que de nous aventurer dans une logique de plafonnement.

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 898 rectifié ter et 1487 rectifié bis.

Ces trois amendements relèvent de la même logique, qui n’est pas celle que nous avons retenue hier lorsque nous avons débattu de la justice prud’homale.
Il est louable de vouloir accroître la prévisibilité pour les parties, mais nous préférons la logique du référentiel.
Ne démolissons pas aujourd’hui ce que nous avons construit hier, en accord avec la commission !

Non, je le retire, monsieur le président. Je voterai en revanche l’amendement n° 743 rectifié s’il est maintenu.

L'amendement n° 898 rectifié ter est retiré.
Madame Gruny, l'amendement n° 1487 rectifié bis est-il maintenu ?

L'amendement n° 1487 rectifié bis est retiré.
Madame Mélot, l'amendement n° 743 rectifié est-il maintenu ?

Je le mets aux voix.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 87 A.
L'amendement n° 899 rectifié ter, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Kern et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après l'article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 1235-5 du code du travail, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un ».
La parole est à M. Olivier Cadic.

Cet amendement tend à porter de dix à vingt et un l’effectif des entreprises concernées par les exceptions prévues à l’article L. 1235 5 du code du travail.

Cet amendement, déjà rejeté en commission, vise à conserver les dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail tout en relevant le seuil d’effectif des entreprises concernées par ses exceptions de onze à vingt et un salariés.
On comprend cette démarche dans la mesure où la commission spéciale a relevé de manière permanente, à l’article 87 A, le seuil d’effectif à partir duquel l’élection des délégués du personnel devient obligatoire.
Toutefois, la problématique de l’élection des délégués du personnel et celle des indemnités accordées aux salariés licenciés demeurent deux sujets distincts. S’il était adopté, l’amendement aurait pour effet de diminuer de manière importante les droits des salariés licenciés travaillant dans les entreprises employant moins de vingt et une personnes.
En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 1307 rectifié, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l’article L. 1235-5 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette indemnité ne peut être inférieure à six mois de salaire brut. »
La parole est à Mme Évelyne Didier.

On distingue deux types de licenciement : le licenciement injustifié et le licenciement abusif.
Le licenciement injustifié concerne le salarié licencié qui avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise comptant plus de dix salariés. Dans ce cas, le salarié dont le licenciement n’est pas fondé a droit à une indemnité pour licenciement injustifié et le juge peut proposer sa réintégration dans l’entreprise. À défaut de réintégration, l’employeur est condamné au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette indemnité ne peut pas être inférieure à la somme correspondante aux salaires bruts des six derniers mois perçus. Il s’agit donc d’un « plancher » légal qui peut croître en fonction du préjudice effectivement subi par le salarié.
Le licenciement abusif concerne le salarié qui avait moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ou lorsque cette dernière compte moins de onze salariés. Le salarié subit ici, selon la loi, un licenciement abusif et a droit à une indemnité réparant le « préjudice subi », cette indemnité étant cumulable avec les indemnités de rupture du contrat de travail. Les juges font ici une appréciation libre, c’est-à-dire « souveraine », du préjudice subi par le salarié. Cela signifie que la loi ne fixe aucun minimum d’indemnisation.
Le salarié doit donc prouver l’étendue de son préjudice, en apportant des pièces. Pour évaluer le préjudice, les juges prennent en compte des éléments tels que l’âge du salarié, la durée de son chômage ou encore ses problèmes financiers, médicaux et familiaux.
Notre amendement vise à garantir aux salariés victimes d’un licenciement abusif le bénéfice d’un plancher de six mois de salaire brut.

La commission émet un avis défavorable.Le code du travail prévoit aujourd’hui que l’indemnité doit correspondre au préjudice subi. Il est justifié de maintenir cette règle spécifique pour les petites entreprises. Le but de ce projet de loi est non pas d’augmenter le montant des indemnités pouvant être attribuées par un juge à un salarié, mais de relancer l’activité.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 916 rectifié ter, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après l’article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1234-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de moins de vingt et un salariés, le délai d’un mois mentionné au 2° est réduit à 15 jours et le délai de deux mois mentionné au 3° est réduit à un mois. »
La parole est à M. Olivier Cadic.

Alors que les PME sont le principal vecteur de création d’emplois en France, il est urgent de combattre la peur d’embaucher de leurs dirigeants. Pour qu’ils n’aient plus cette peur, et pour qu’ils soient en mesure d’adapter leur effectif à la situation économique de leur entreprise, il faut qu’ils disposent de préavis de licenciement à délai réduit.

Cet amendement a déjà été rejeté en commission. Il vise à diviser par deux la durée du préavis de licenciement hors faute grave dans les petites entreprises : le préavis des salariés dont l’ancienneté serait comprise entre six mois et deux ans passerait ainsi d’un mois à quinze jours ; celui des salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté serait réduit de deux mois à un mois.
La commission estime que ces modifications – vous parlez quant à vous de simplification – ne sont pas indispensables. Le préavis d’un mois en cas de licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté est déjà court. Il nous semble difficilement acceptable de le réduire à quinze jours. Nous demandons donc le retrait de cet amendement.
(Non modifié)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 2312-5, au deuxième alinéa de l’article L. 2314-11, au premier alinéa des articles L. 2314-31 et L. 2322-5, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2324-13 et au deuxième alinéa de l’article L. 2327-7, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le juge judiciaire » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 2312-5 et au troisième alinéa de l’article L. 2327-7, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du juge judiciaire » et les mots : « à la décision administrative » sont remplacés par les mots : « au jugement » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 2314-11, au deuxième alinéa des articles L. 2314-31 et L. 2322-5 et au dernier alinéa de l’article L. 2324-13, les mots : « de l’autorité administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « du juge judiciaire mentionné » et les mots : « à la décision administrative » sont remplacés par les mots : « au jugement » ;
4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2324-13, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
5° Les articles L. 2314-20 et L. 2324-18 sont ainsi modifiés :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « Le juge judiciaire » ;
b) Aux premier et second alinéas, les mots : «, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, » sont supprimés ;
6° Au début du second alinéa de l’article L. 2324-18, les mots : « L’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « Le juge judiciaire » ;
7° À l’article L. 2632-1, les mots : « la décision administrative prévus au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « le jugement prévus aux deuxième et troisième alinéas ».

Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 80 est présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 290 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Savary, Guerriau, Kern, Longeot et Canevet, Mme Loisier, MM. Bockel, Roche et Marseille, Mme Jouanno, MM. Pozzo di Borgo et Jarlier, Mme Joissains et M. Namy.
L'amendement n° 955 rectifié est présenté par M. Collombat et Mme Malherbe.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 80.

Nous souhaitons réaffirmer notre attachement à un véritable dialogue social dans l’entreprise et au rôle spécifique de l’autorité administrative, dont l’article 87 prévoit de transférer certaines compétences à la justice. Sur cette question, qui n’est pas anodine, aucun document d’orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options n’a été présenté aux organisations syndicales de salariés ni, peut-être, aux représentants des employeurs.
En outre, la complexité de la procédure et les réticences à saisir la justice rendront la défense des salariés plus difficile ; cela risque d’amplifier l’asphyxie des tribunaux, que nous connaissons tous. La question du coût des procédures peut également jouer un rôle dissuasif. Enfin, le juge ne sera apparemment pas obligé de consulter les organisations syndicales pour prendre sa décision, ce qui, même si nous ne contestons pas l’impartialité des juges, pourrait s’analyser comme une régression du droit des salariés.
L’ensemble de ces éléments ne peut que nous inciter à supprimer l’article 87, d’autant que – vous l’avez rappelé vous-même, monsieur le ministre – un projet de loi relatif au dialogue social et au soutien à l’activité des salariés est en préparation ; un document a d'ailleurs été remis aux organisations syndicales début avril. Avant de modifier le code du travail, il serait intéressant de connaître les propositions de François Rebsamen.

Les amendements n° 290 rectifié bis et 955 rectifié ne sont pas soutenus.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 80 ?

La commission spéciale a conservé l’article 87, qui prévoit de transférer de l’inspection du travail au juge judiciaire toute compétence en matière de règlement des différends relatifs à la préparation des élections professionnelles en entreprise. Il nous avait en effet semblé qu’il s’agissait d’une mesure de simplification. Du reste, aucune des personnes que nous avons auditionnées ne l’a critiquée.
Toutefois, depuis lors, des demandes de suppression ou au moins de modification de l’article 87 se sont exprimées. On sent qu’il existe, je n’irai pas jusqu’à dire des désaccords, mais en tout cas des visions différentes au sein du Gouvernement. C'est pourquoi nous souhaiterions connaître l’avis de M. le ministre.
L’intention initiale du Gouvernement, à travers l’article 87, était d’unifier le contentieux des opérations préélectorales. Il subsiste en effet une compétence résiduelle de l’administration et du juge administratif. Nous avons donc proposé de la basculer vers l’autorité judiciaire afin de simplifier le processus pour les organisations syndicales comme pour les employeurs. Cette solution présenterait l’avantage de la lisibilité pour les acteurs de terrain habitués à manier ces dispositions.
J’entends cependant vos arguments, madame David. Vous évoquez la sensibilité du sujet et le besoin de cohérence dans le temps ; j’ai employé ce dernier argument tout à l'heure sur un autre sujet. Un projet de loi de modernisation du dialogue social est effectivement en préparation. Il est vrai aussi que le transfert de compétence augmenterait la charge de travail de la justice judicaire. Hier, nous avons eu débat similaire sur les prud’hommes. Il faut être cohérent. J’ai dit moi-même que nous cherchions à préserver le paritarisme pour ne pas encombrer la justice judiciaire.
Je souscris donc à vos arguments, et j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 80.

Quelle est, en définitive, l’avis de la commission, madame la corapporteur ?

Pour ma part, je me contenterai de m’en remettre à la sagesse du Sénat.

Je soutiens cet amendement pour les raisons évoquées – l’encombrement de la justice judiciaire, notamment. En outre, il arrive trop souvent qu’on nous présente des dispositions sans aucune évaluation ni étude d’impact.
L'amendement est adopté.
(Non modifié)
À l’article L. 3142-7 du code du travail, les mots : « à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national » sont remplacés par les mots : « aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l’article L. 2135-12 ». –
Adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 306 rectifié quater, présenté par MM. Gabouty et Guerriau, Mme Loisier, MM. Kern, Médevielle et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 88
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 3123-14-1 du code du travail est abrogé.
II. – La durée minimale hebdomadaire du travail est déterminé par des accords de branche dans le cadre de la négociation collective entre les organisations d'employeurs et de salariés.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Fixer à vingt-quatre heures par semaine la durée minimale de travail du salarié à temps partiel ne correspond pas à la réalité économique de certains secteurs d'activité. Il convient donc de supprimer cette limite.

L'amendement n° 1290, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 88
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 3123-14-1 du code du travail, les mots : « ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 » sont supprimés.
La parole est à Mme Évelyne Didier.

Lors de la discussion du texte issu de l’accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l’emploi, la précédente majorité sénatoriale avait répondu à nos nombreuses critiques que l’introduction d’une durée minimale de travail à temps partiel était une avancée majeure. Depuis le 1er janvier, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est donc de vingt-quatre heures par semaine, du moins en théorie. Dans les faits, de nombreux employeurs se permettent de la contourner.
Le texte prévoyait déjà des dérogations : pour les étudiants de moins de vingt-six ans, les aides à domicile, les aides ménagères, les salariés volontaires et dans le cas où un accord de branche prévoit des contreparties. Indépendamment de ces dérogations, il existe d’autres moyens de contourner la loi pour les employeurs qui souhaitent avoir des salariés à temps partiel réduit ; c’est le recours à l’intérim qui est le moyen le plus utilisé.
Alors que nous avions fortement critiqué les dérogations, nous constatons aujourd’hui que, en pratique, les exonérations à la durée minimale hebdomadaire de vingt-quatre heures se généralisent. Nous proposons donc de revenir à la version initiale du texte, qui prévoyait une durée minimale de vingt-quatre heures sans exception.

Je commencerai par l’amendement n° 306 rectifié quater. La durée de vingt-quatre heures a effectivement été actée par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. Nous sommes conscients que sa mise en œuvre a pu causer d’importantes difficultés. Néanmoins, une ordonnance du 29 janvier dernier a supprimé les facteurs d’insécurité juridique issus de la loi relative à la sécurisation de l’emploi : la durée de vingt-quatre heures n’est pas applicable aux CDD de remplacement, tandis que les salariés embauchés avant la mise en place de cette règle bénéficient d’une priorité de passage à vingt-quatre heures, et non d’un droit opposable à une telle durée de travail. De plus, des accords de branche peuvent déroger à cette durée. C'est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.
La disposition proposée par les auteurs de l'amendement n° 1290 ferait perdre toute cohérence à la mesure du temps de travail des salariés à temps partiel, puisqu’il est aujourd’hui possible de mesurer la durée de travail sur le mois ou même l’année. Les entreprises seraient désorganisées si elles ne pouvaient pas calculer la durée minimale de travail des salariés à temps partiel sur la même période que celle des autres salariés. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 2314-24 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral. »
II. – L’article L. 2324-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 4614-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire. » ;
2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’ordre du jour ». –
Adopté.
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 2323-4 du code du travail, après les mots : « par l’employeur », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 2323-7-3, ». –
Adopté.

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par Mmes Primas et Lamure, MM. Savin, Danesi, Bouchet, D. Laurent, Calvet, Darnaud, Genest et Bizet, Mmes Morhet-Richaud et Imbert, MM. D. Robert et Mouiller, Mme Cayeux, MM. Cardoux, Mandelli et Doligé, Mme Des Esgaulx, MM. de Nicolaÿ, Mayet, Charon, Gournac et Leleux, Mmes Duchêne et Deromedi, MM. Saugey et Bignon, Mme Mélot, MM. G. Bailly et Houel, Mmes di Folco et Hummel, MM. Milon et Pointereau, Mme Micouleau, M. B. Fournier, Mme Procaccia, MM. Husson, P. Leroy, Chaize, Laufoaulu, Revet, Lefèvre et César, Mme Bouchart, MM. Kennel, Houpert, Grand, Buffet, Grosdidier, Reichardt, Gremillet et Laménie et Mme Gruny, est ainsi libellé :
Après l’article 91
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1242-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa, les mots : « ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois » sont supprimés ;
2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Emplois relevant de certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et dont il est impossible de fixer, sur une durée indéterminée, d’une part la répartition et le volume de la durée du travail et d’autre part les missions confiées au salarié ; ».
La parole est à Mme Colette Mélot.

Le recours aux contrats d’usage, ou contrats d’extra, est une nécessité pour les entreprises de la branche des hôtels, cafés, restaurants, et en particulier pour les traiteurs, afin de faire face aux fluctuations de leur activité.
Toutefois, dans un arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de cassation a remis en cause les bases légales de ce dispositif, en considérant que la qualification conventionnelle de contrat d'extra dépendait de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère « par nature temporaire » de l'emploi.
Or il est bien souvent impossible d’apporter la preuve du caractère « par nature temporaire » de l’emploi. En effet, le recours aux contrats d’extra est une nécessité liée à un besoin temporaire de main-d’œuvre résultant d’un événement particulier – réception ou mariage, par exemple –, mais les emplois confiés aux salariés – serveur, maître d’hôtel, etc. – ne sont pas « par nature temporaires ».
Aussi, faute de pouvoir apporter la preuve du caractère « par nature temporaire » de l’emploi, et même si l’employeur respecte strictement les dispositions conventionnelles, les juridictions requalifient-elles la relation de travail en CDD en relation de travail en CDI et la relation de travail à temps partiel en relation de travail à temps complet.
Ces décisions, qui condamnent les entreprises à devoir verser plusieurs centaines de milliers d’euros, risquent de conduire plusieurs d’entre elles au dépôt de bilan et introduisent une totale insécurité juridique, laquelle est évidemment préjudiciable à l’emploi.
Dans un tel contexte, le présent amendement vise simplement à définir dans le code du travail la notion d’emploi « par nature temporaire » dans des secteurs d’activités définis par décret ou par accord de branche. Ainsi, le recours aux contrats d’extra serait sécurisé et l’équilibre économique et social de la branche des hôtels, cafés, restaurants, dans laquelle ce recours est usuel, serait conforté.

La commission est bien consciente des difficultés provoquées par la jurisprudence de la Cour de cassation sur les CDD d’usage. Il existe des lois, et il faut les respecter, mais le durcissement des règles pose de réels problèmes aux employeurs dans tous les secteurs où l’emploi temporaire est répandu.
La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement.
J’émettrai d'abord une réserve méthodologique. Nous avons à plusieurs reprises évoqué les difficultés rencontrées par certains secteurs, mais l’idée de créer de nouveaux types de contrat ne me semble pas aller dans le sens de la simplification. Il vaut mieux simplifier les règles des contrats existants plutôt que d’en créer de nouveaux. Il me paraît contradictoire de créer des sortes de niches réglementaires pour essayer de simplifier la vie des gens.
Indépendamment de cette première réserve, l’amendement soulève une difficulté d’ordre juridique. Dans une décision du 11 avril 2014, le Conseil constitutionnel a invalidé l’arrêté d’extension de l’accord sur le portage salarial, en indiquant que le législateur ne pouvait confier aux seuls partenaires sociaux le soin de fixer les modalités d’organisation du portage salarial, car la détermination de ces modalités relève du domaine de la loi.
Or cet amendement revient en quelque sorte à renvoyer non seulement au décret, mais aussi à l’accord ou à la convention, pour la détermination de la nature des emplois d’extra et des secteurs dans lesquels on peut y recourir, ainsi que la répartition et la durée de travail auxquelles seraient astreints ces emplois.
Enfin, sans ignorer ces contraintes ni celles qui sont également posées par la Cour de cassation, il convient de rappeler que le recours à ces contrats est considérable dans le secteur des HCR. Il importe donc de maintenir un encadrement juridique strict.
Il conviendrait plutôt d’essayer d’identifier les éléments de rigidité éventuels et les améliorations possibles, sans toutefois conduire ces emplois à la précarité, car bien des jeunes qui travaillent dans ces secteurs ont déjà des contrats courts et fractionnés. Il nous faut constamment garder à l’esprit ce souci d’équilibre.
En tout cas, je ne peux pas vous suivre quand vous proposez, comme ici, un transfert vers la voie conventionnelle, ce qui n’est pas conforme à la Constitution.
Je vous demande donc de retirer cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse.
Nous sommes conscients de la difficulté juridique posée, notamment, par la directive européenne du 28 juin 1999, mais nous appelons le Gouvernement à agir avec force. Comme vous venez de le préciser, nous devons aider les entreprises concernées à sortir de l’insécurité juridique dans laquelle elles sont actuellement plongées.
Vous l’aurez compris, il s’agissait d’un amendement d’appel, que je retire, à la lumière de vos explications.

L’amendement n° 1 rectifié est retiré.
L'amendement n° 921 rectifié ter, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après l’article 91
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1. – À compter du 1er janvier 2017, les règles en matière de relations individuelles et collectives du travail, d'emploi et de formation professionnelle relèvent du champ de la négociation collective et sont déterminées par accord collectif.
« Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement destiné à modifier les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation à ce niveau. À cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.
« Au moment où elles leur font connaître leur intention d'engager une telle négociation, le Gouvernement leur communique le délai imparti pour négocier. En cas d'urgence, le Gouvernement peut décider de mettre en œuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation. Il fait alors connaître cette décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence. »
La parole est à M. Olivier Cadic.

Cet amendement d’inversion de la hiérarchie des normes répond à un triple objectif.
D’abord, il vise à replacer au niveau conventionnel, d’entreprise, de groupe ou de branche, l’ensemble des règles applicables en matière de droit du travail, d’emploi et de formation professionnelle. Nous faisons donc confiance aux partenaires sociaux en choisissant de les responsabiliser. Conformément à l’article 34 de la Constitution, le législateur continuera à fixer les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale.
Ensuite, il tend à adapter les règles du droit du travail au plus près de la réalité du monde du travail en tenant compte de la diversité des secteurs d’activité et des tailles d’entreprise.
Enfin, il a pour objet de simplifier le droit du travail pour le rendre plus lisible, plus praticable et diminuer les contentieux.
Le code du travail fixera désormais uniquement l’ordre public social qui s’imposera au champ conventionnel.

Afin de donner le temps à cette inversion de la hiérarchie des normes sociales de s’installer, le Gouvernement mettra en place par décret un conseil de la simplification du droit du travail, qui déterminera ce qui relève actuellement de l’ordre public social dans le code du travail et ce qui n’en relève pas, afin de simplifier ce code.
Le principe de concertation préalable fixé par la loi du 31 janvier 2007 ne disparaît pas. La coproduction entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux nationaux interprofessionnels demeure, afin de fixer au mieux les principes fondamentaux de l’ordre public social.

Cet amendement vise donc à inverser la hiérarchie des normes du droit du travail.
Supprimer le primat de la loi et de l’ordre public social dans un domaine comme celui du financement de la formation professionnelle, dans lequel les branches et les entreprises disposent déjà d’une marge de manœuvre significative, reviendrait à désorganiser tout l’édifice français en la matière et risquerait de conduire à la diminution de l’investissement des petites entreprises dans la formation professionnelle, alors qu’elles considèrent encore trop souvent qu’il s’agit d’une charge.
Il faut, par ailleurs, prendre en compte les cas où un accord entre partenaires sociaux ne pourra pas être trouvé. Le législateur peut confier des compétences à la négociation collective, mais ne peut pas contraindre les parties à conclure un accord. L’intervention du législateur ne peut donc pas toujours être évitée, au-delà d’une interprétation littérale de l’expression « principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical », telle qu’elle figure à l’article 34 de la Constitution.
En l’état actuel des choses, et sans étude d’impact approfondie, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, mais nous pourrons peut-être reprendre ce débat lors de la discussion du texte à venir sur le dialogue social.
La simplification du droit du travail est un objectif louable en soi, tant il est vrai que notre code du travail est devenu bien long, ce que chacun s’accorde à reconnaître.
La complexité qui le caractérise parfois est le fruit d’évolutions successives, de débats, enrichis souvent, d’ailleurs, par les jurisprudences.
La complexité ou la longueur de ce code…

Il serait plus simple de déposer un amendement de suppression du code du travail !
Laissez-moi aller au bout de mon raisonnement, madame la sénatrice.

Mme Annie David. Ce n’est pas à vous, mais à M. Cadic que je m’adressais.
Sourires.
Dont acte !
La complexité et la longueur de ce code me posent un problème à titre personnel, car la surabondance d’informations est un obstacle à l’accessibilité au droit, donc, parfois, à la défense de l’intérêt des plus faibles. Je ne peux pas dire ici que la taille et l’inflation, année après année, du code du travail ne sont pas des sujets de préoccupation.
Monsieur Cadic, vous proposez, au détour d’un amendement, de bousculer complètement ce code, sa structure, et ce que l’on appelle « l’ordre public social ». À mon sens, ce n’est pas de bonne méthode, même si je le prends comme un amendement d’appel. Son objet est de surcroît un peu radical.
Je ne voudrais pas qu’un débat mal engagé sur un tel sujet vienne gêner la démarche enclenchée voilà quelques semaines par le Premier ministre, démarche que je veux ici défendre et qui m’a conduit hier à prononcer, sans doute un peu rapidement, un « Même avis ! » s’agissant de la création d’une commission de simplification qui allait, elle aussi, un peu loin…
Sourires.
Pour tout vous dire, j’ai été un peu distrait à ce moment-là du débat, mais ce n’est pas grave…

Mme Catherine Deroche, corapporteur. C’est même, en l’occurrence, très bien !
Sourires.

M. Roger Karoutchi. Donc, quand vous m’avez répondu par la négative, vous pensiez le contraire ?
Rires.
M. Emmanuel Macron, ministre. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, monsieur Karoutchi.
M. André Gattolin s’esclaffe.
Quelle est la démarche qu’a entamée M. le Premier ministre voilà quelques semaines en installant la commission dirigée par l’ancien directeur général du travail, M.Combrexelle ?
Il s’agit de réfléchir aux principes et aux normes les plus importants qui doivent être conservés au niveau de la loi, puis de voir comment nous pouvons articuler, sur ce socle, un droit plus conventionnel, qui serait donc décliné principalement au niveau des accords de branche, et ce dans le but d’alléger le code du travail.
Le sujet, éminemment complexe, a déjà fait l’objet de travaux importants de la part d’éminents juristes - les professeurs Lyon-Caen, Barthélémy et Cette – tant il est vrai qu’il constitue la clé de voûte d’un droit qui ne se réduit pas aux seuls principes fondamentaux constitutionnels. C’est d’ailleurs la faiblesse de votre argumentation.
Il faut définir ce qui constitue l’ordre public social. C’est à ce niveau que le débat doit être mené. Dans cette perspective, la bonne démarche consiste, quitte à y consacrer plusieurs mois, à déterminer les normes qui doivent figurer dans le code du travail, au niveau législatif ou au niveau réglementaire, et celles qui doivent relever des accords de branche. Tel est l’objectif de la commission Combrexelle.
Il est vrai qu’au fil des années la loi s’est mise à venir corriger des jurisprudences. Avec ce texte, nous avons d’ailleurs tendance à rester dans cette logique, puisque nous continuons à modifier les lois pour mieux faire fonctionner l’économie.
Ce vrai et beau débat législatif, parce qu’il est à la fois juridique et politique, va prendre du temps, mais il est nécessaire, et vous comprenez bien qu’il ne peut pas être tranché au détour d’un amendement, sauf à donner le sentiment que tout cela n’aurait qu’un seul but, à savoir mettre à bas le code du travail, un code qui a son utilité et qui est, lui aussi, le fruit d’un travail collectif.
Par cette réponse un peu longue, je voulais faire le point sur la démarche entreprise par le Gouvernement. Cependant, si nous avons comme vous le souci de la simplification et de la modernisation du droit du travail, nous ne saurions nous départir d’une méthode équilibrée, car la démarche ne peut se traduire, du fait d’un traitement brouillon, par un amoindrissement des droits.
Ce travail doit être conduit dans les prochains mois par M. Combrexelle et la commission qu’il préside. Il éclairera le Gouvernement, qui fera une proposition entre la fin de cette année et le début de l’année prochaine, pour permettre un vrai débat parlementaire, donnant à toutes les réflexions et à toutes les sensibilités l’occasion de s’exprimer. Nous verrons alors comment remettre à plat l’ensemble de l’édifice. Néanmoins, un tel travail ne peut pas se faire en biffant simplement des dizaines de pages du code ou au détour d’un amendement.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.

Monsieur Cadic, vous nous proposez non seulement de renverser la hiérarchie des normes, mais également d’abattre, d’un seul coup, un tiers du code du travail ! Vous ne laissez finalement à la loi qu’une capacité d’intervention résiduelle.
Sourires.

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas parce que c’est jour de vote chez nos amis du Royaume-Uni qu’il faut adopter cet amendement d’inspiration très libérale !
Nouveaux sourires.

Je sais que vous êtes très attaché à ce qui se passe de l’autre côté de la Manche, mais là, vous avez fait très fort ! Vous nous permettrez d’être contre vos propositions.

Très brièvement, je voudrais saluer la réponse de M. le ministre, très argumentée, qui nous redonne des éléments de calendrier et de méthode sur la mission confiée à M. Combrexelle.
Vous avez dit clairement que le Parlement serait associé à la suite de ces travaux, donc, nous vous prenons au mot. L’interpellation de mon collègue Olivier Cadic va, je crois, dans le bon sens. D’ailleurs, vos propos ne laissent pas de doute sur votre souhait de voir les choses évoluer sur ce point.
Le Parlement sera donc attentif aux suites données à cette commission, et il nous reviendra d’écrire la loi au fur et à mesure, de manière aussi étayée que possible, avec toute l’efficacité juridique attendue.
Votre réponse constitue donc une avancée, mais peut-être pourriez-vous nous éclairer sur le mécanisme d’information et d’association du Parlement aux différentes étapes de ce travail ?
La lettre de mission a été signée par le Premier ministre le 1er avril dernier. Les résultats des travaux de la commission sont attendus à l’automne. Ensuite, je pense que le Premier ministre organisera des séances préparatoires tant avec les partenaires sociaux qu’avec l’ensemble des parlementaires.
J’y insiste, au-delà de tout ce qui sera proposé par l’ancien directeur général du travail, cette œuvre prendra plusieurs mois, car elle suppose un véritable travail d’éclairage par les partenaires sociaux, mais aussi un vrai travail législatif au long cours, qui nécessitera l’association étroite de l’ensemble des commissions législatives compétentes, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale.
Dès l’automne, à la réception des conclusions de la commission Combrexelle, M. le Premier ministre annoncera l’ensemble du calendrier.

Monsieur Cadic, lorsque nous avons recodifié le code du travail en 2007, une commission avait préalablement travaillé le sujet pendant près de quatre ans. Tout paraissait relativement simple, or, depuis 2007, nous passons notre temps à modifier des éléments de ce code du travail qui devait être simplifié…
Aussi, je ne crois pas que nous puissions faire ce que vous appelez de vos vœux avec un simple amendement.
J’apprécie les informations sur la commission Combrexelle, et je voudrais dire à M. le ministre que j’ai tout à fait confiance en M. Combrexelle, que j’ai appris à connaître depuis un certain nombre d’années, au fil de nos travaux parlementaires. En revanche, il me paraît un peu étrange que l’on ait institué cette commission maintenant, alors que doit être examiné prochainement à l’Assemblée nationale un texte sur le dialogue social, dont le dépôt a fait suite à un échec des négociations entre les partenaires sociaux.
N’aurait-on pas pu attendre que la commission Combrexelle nous fournisse un certain nombre d’éclairages, ce qui nous aurait permis de légiférer dans de meilleures conditions, non seulement aujourd’hui - nos rapporteurs ont formulé des propositions -, mais aussi à l’occasion du texte sur le dialogue social ?
Une nouvelle fois, on engage la discussion de projets de loi sans attendre le résultat des travaux confiés à une commission, alors que rien ne presse et que tout aurait pu être plus clair pour les parlementaires dans deux ou trois mois.
Je vais tenter de remettre ces questions en perspective.
Le travail demandé à M. Combrexelle est particulièrement ambitieux. Il consiste à poser les fondements permettant de repenser une vraie hiérarchie des normes, et donc l’articulation de l’ensemble des dispositions existantes. J’ai dit que cela prendrait du temps parce que, une fois le rapport remis, beaucoup restera à faire…
Vous l’avez dit ! Pourtant, pour qui est au contact des réalités économiques, la nécessité de bouger est évidente.
Si j’avais voulu aller dans votre sens, madame Procaccia, j’aurais supprimé la partie de ce projet de loi relative au droit social. Cela aurait attristé votre collègue Roger Karoutchi §, qui voulait aller beaucoup plus loin, il y a deux jours, mais il n’aurait pas été le seul. Dans un tel contexte, nous n’aurions rien fait.
Il me semble très important de distinguer les différents chantiers.
La loi relative à la sécurisation de l’emploi visait à sécuriser la procédure de licenciement collectif, à permettre la mise en place d’accords de maintien dans l’emploi défensifs et à définir les modalités de représentation des salariés au sein des conseils d’administration, sans parler de nombreuses autres dispositions relatives à la formation.
L’évaluation de ce dispositif permettra des améliorations. J’en espère deux : l’une sur les accords de maintien dans l’emploi défensifs et l’autre sur la représentation des salariés dans les conseils d’administration. Si les négociations aboutissent, j’espère que nous pourrons intégrer les dispositions correspondantes soit au présent projet de loi, soit au projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi.
La négociation qui a échoué portait sur les procédures existantes de consultation des salariés, les différentes structures de représentation du personnel, les seuils, les parcours syndicaux, la bonne représentation et le dialogue social. Tous ces sujets ne font pas la totalité du droit du travail et cette négociation était donc limitée.
Il était normal, conformément à l’esprit de l’article L. 1 du code du travail, que le Gouvernement entreprenne dans le même périmètre un travail législatif et propose des solutions respectant un équilibre politique : c’est le projet de loi qu’a présenté mon collègue François Rebsamen et qui sera soumis dans quelques semaines à votre examen. Il n’était pas nécessaire d’attendre.
Tous les autres sujets, comme celui qu’a soulevé il y a un instant M. Cadic, et beaucoup d’autres dont nous discutons, n’ont pas fait l’objet d’une négociation. Il est normal, dans ce cas, d’adopter une approche d’ensemble plus systémique, qui conduira peut-être, dans deux ans ou trois ans, à modifier certaines dispositions, comme l’articulation entre la loi et l’accord. Entre-temps, nous aurons fait œuvre utile en légiférant aujourd’hui sur les sujets qui offrent une certaine lisibilité et sur lesquels existe un équilibre politique et social.
Je pense qu’il est important de procéder par ordre. Je suis très réticent à ce que l’on se précipite lorsqu’un équilibre n’a pas été trouvé. Je ne suis pas non plus favorable à ce que l’on attende inutilement quand et là où on peut avancer.
Le travail de remise à plat et de cohérence qui a été confié à M. Combrexelle, parce qu’il suppose un effort conceptuel plus large, prendra le temps qu’il faudra pour être bien fait, mais il ne nous empêche pas de légiférer utilement dans la perspective que je viens de rappeler.

M. Olivier Cadic. Je suis heureux d’avoir ouvert ce très intéressant débat. Je tiens à remercier M. le ministre : sa réponse a été longue, il l’a dit lui-même, mais elle est bien moins longue que ne l’est le code du travail.
Sourires.

Je vous remercie d’avoir pris le temps de procéder à ces explications, monsieur le ministre.
Je voudrais répondre à Mme Bricq sur le droit en vigueur au Royaume-Uni, puisqu’elle a l’air de penser que le droit du travail français est beaucoup plus protecteur.
Je vais vous donner un exemple vécu : au consulat, deux secrétaires font le même travail, une pour le consul général et l’autre pour le consul général adjoint. Ces deux secrétaires, qui font exactement le même travail, n’ont pas les mêmes droits, parce qu’elles dépendent de conventions différentes. Au Royaume-Uni, une telle situation serait impossible : deux personnes qui font le même travail dans le même bureau doivent avoir les mêmes droits.

Nous pouvons aborder ce sujet si vous le souhaitez, mais ce n’est pas l’objet du débat actuel, qui porte sur la hiérarchie des normes et notre façon d’appréhender notre droit du travail.
Cet amendement, qui était un amendement d’appel, vous l’avez tous compris, était nécessaire pour ouvrir un débat qui va être très important pour notre pays dans les mois à venir. M. le ministre nous a dit qu’une commission avait été constituée, mais je pense que ce débat va durer plus que quelques mois et nous occuper au moins pendant les deux prochaines années.
Je vous ai proposé une vision sur laquelle nous allons tous travailler. Aujourd’hui, tout le monde comprend bien que le code du travail a pris une telle ampleur et que les accords et conventions collectives sont devenus si complexes qu’il va bien falloir reprendre le chantier.
Dans une entreprise, lorsque l’organisation est devenue trop compliquée, on n’essaie même plus de la modifier, parce que l’on sait que l’on n’y parviendra pas. À partir de ce moment, on commence à penser à la réingénierie, qui consiste à redéfinir en profondeur cette organisation : c’est ce que va permettre cette inversion de la hiérarchie des normes. Il sera ainsi possible de replacer au cœur du système le contrat de travail qui unit le salarié à l’entreprise, car la loi ne permettra jamais d’envisager de manière aussi fine la nature du lien entre l’employeur et le salarié.
Tel est le message que je souhaitais faire passer. À titre personnel, je souhaite maintenir mon amendement. Je comprends bien la position de la commission et du Gouvernement, mais il est important pour moi, aujourd’hui, de marquer l’Histoire.
L’amendement n’est pas adopté.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1329 rectifié, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 91
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2251-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2251 -1. – Une convention ou un accord ne peut comporter que des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public. » ;
2° L’article L. 2252-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2252 -1. – Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. » ;
3° L’article L. 2253-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2253 -1. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l’entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.
« Cette convention ou cet accord ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés. » ;
4° L’article L. 2253-4 est abrogé ;
5° L’article L. 3122-6 est abrogé.
La parole est à Mme Annie David.
Sourires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Nous vous proposons donc de faire à nouveau de la loi la référence. Pour que les choses ne soient pas compliquées, il faut que la loi puisse s’appliquer, parce que la loi est claire et que chacun la comprend.
L’amendement n° 1329 rectifié vise donc à rétablir la hiérarchie des normes du droit du travail.

L’amendement n° 922 rectifié ter, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après l’article 91
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2251-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-1. – Une convention ou un accord ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public. »
La parole est à M. Olivier Cadic.

Je crois que le débat a été suffisamment riche. Je retire donc cet amendement, compte tenu du vote émis sur le précédent.

L’amendement n° 922 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 923 rectifié ter, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après l’article 91
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2252-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2252-1. – Une convention ou un accord de niveau inférieur peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d’une convention ou d’un accord de niveau supérieur ou couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Lorsqu’une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l’accord intervenu est conclu, les parties adaptent les stipulations de la convention ou accord antérieur moins favorables aux salariés. »
La parole est à M. Olivier Cadic.

Pour les mêmes raisons, je retire cet amendement, monsieur le président.

L’amendement n° 923 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 1245 rectifié, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 91
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3122-6 du code du travail est abrogé.
La parole est à Mme Annie David.

Nous cherchons, nous aussi, en toute modestie, à simplifier le code du travail et nous vous proposons d’abroger l’un de ses articles.
Abrogeons donc l’article L. 3122-6 du code du travail, qui permet aux employeurs d’imposer à leurs salariés d’importantes modulations du temps de travail, sans avoir à craindre de sanctions judiciaires, à l’image de celle qu’avait prononcée la Cour de cassation le 28 septembre 2010. Cet arrêt avait en effet clairement affirmé qu’un accord collectif ne pouvait imposer au salarié une modulation de son temps de travail sans requérir préalablement son consentement exprès.
Vous l’avez compris, mes chers collègues, ces amendements et ceux qui vont suivre visent à revenir à un véritable code du travail, conforme à un projet de société différent de celui que propose M. Cadic.
Nous voulons en effet un code du travail qui permette aux salariés et aux employeurs de connaître leurs droits et leurs devoirs et garantisse que ceux-ci soient respectés dans l’intérêt général, afin que les salariés puissent travailler dans de bonnes conditions.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 1329 rectifié et 1245 rectifié ?

L’amendement n° 1329 rectifié vise à généraliser le principe de faveur. La commission spéciale a émis un avis défavorable, de même que sur l’amendement n° 1245 rectifié.
Monsieur le ministre, vous nous avez dit que vous attendiez avec impatience les résultats de la commission Combrexelle. Finalement, l’objet de ses travaux n’est pas très éloigné de celui de l’amendement sur lequel vous avez par inadvertance émis un avis favorable hier soir. N’ayez donc pas trop de regrets !
Sourires.
Avec l’amendement n° 1329 rectifié, vous refermez toutes les portes ouvertes dans le code du travail tant par la réforme de 2004, qui a permis à des accords de branche de déroger à la loi, que par la réforme de 2013, qui permet cette fois à des accords majoritaires d’entreprise de déroger à la loi.
Nous avons un désaccord d’ordre politique sur ce point. Je considère qu’il est utile que ces accords, d’entreprise ou de branche, puissent déroger à la loi, mais dans des conditions précises.
Dans les deux cas, ces accords ne sont possibles que dans certains secteurs, définis par la loi.
Ensuite, la possibilité de déroger doit aussi être explicitement prévue par la loi : il n’y a donc pas de principe général permettant à l’accord majoritaire d’entreprise ou à l’accord de branche de déroger à la loi.
Enfin, l’accord d’entreprise doit être majoritaire, ce qui est encore plus contraignant – nous avons eu un long débat avec Mme Lienemann sur ce sujet.
Le droit actuel est donc équilibré et, je le répète, il n’existe aucun principe général de dérogation de l’accord de branche ou de l’accord majoritaire d’entreprise par rapport à la loi.
Vous percevez ces ouvertures comme des failles et je reconnais la cohérence de votre position. Comme je viens de l’expliquer, nous n’avons pas la même vision. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement, parce que je pense que vous ne le retirerez pas, compte tenu de la ligne que vous défendez.
Néanmoins, cet amendement a le mérite de mettre un fait en lumière : on a créé des éléments de flexibilité encadrés, mais l’architecture d’ensemble du code du travail n’est pas cohérente.
Indépendamment de nos sensibilités, reconnaissons qu’il faut ouvrir un débat sur la totalité du code du travail pour y rétablir une cohérence. Il faudra revenir à des principes simples, par exemple en précisant ce qui doit relever de la loi et ce qui doit relever des accords, et avec quels contrôles. Chacun devra se prononcer en fonction de ses convictions, mais je ne vous suivrai pas sur les corrections que vous proposez, parce que je crois à la nécessité des accords de branche et des accords d’entreprise, à condition qu’ils soient bien cadrés.
En ce qui concerne l’amendement n° 1245 rectifié, j’émettrai également un avis défavorable. En effet, l’annualisation du temps de travail est un principe appliqué dans de nombreux secteurs – c’était d’ailleurs l’un des apports de la loi sur les 35 heures, que je ne manque jamais de saluer.
Lorsqu’une entreprise décide d’y recourir, elle doit être couverte par un accord collectif, consulter le comité d’entreprise et informer les salariés concernés. Dans ce cadre, le salarié reste protégé dans la durée légale de la semaine de travail. Il n’y a pas lieu d’abroger une disposition qui permet une certaine souplesse vis-à-vis des salariés, en toute transparence. Imposer une modification du contrat de travail ne ferait qu’alourdir le dispositif sans apporter de garantie supplémentaire.

On a demandé à M. Cadic de retirer son amendement parce que la commission Combrexelle se penchait sur la question ; le même argument aurait pu être opposé à Mme David, même si son amendement ne visait pas, lui, à inverser la hiérarchie des normes du droit du travail.
Monsieur Cadic, le problème qui se pose ne tient pas simplement au poids du code du travail ! Quand M. le Premier ministre a adressé sa lettre de mission à M. Combrexelle, il a bien fixé le cadre et dit les attentes du Gouvernement. Il est parti d’une observation : depuis 1982, c’est-à-dire depuis les lois Auroux, notre pays a connu d’importants changements. Les chiffres relatifs aux accords intervenus en 2013 sont assez éclairants : 5 accords nationaux interprofessionnels, 1 300 accords de branche et 39 000 accords d’entreprise. Le Premier ministre veut donc savoir comment on peut prendre en compte tous ces accords.
Le Premier ministre insiste, également, sur le fait que le droit du travail doit « coller » à la réalité du terrain.
Dans tous les cas, monsieur Cadic, il s’agit de favoriser la négociation collective afin qu’elle se déroule au plus près des acteurs.
Dans le texte que nous examinons, deux notions qui font leur apparition en droit me paraissent importantes. Il s’agit notamment, pour ce qui concerne le travail du dimanche, de la reconnaissance des accords territoriaux.
Lorsque nous examinerons, en fin de parcours, tout ce qui a trait au plan de sauvegarde de l’emploi, le PSE, nous aurons alors à considérer une seconde notion, celle de bassin d’emploi, très importante par rapport à la volonté du Gouvernement de s’approcher au plus près du terrain, mais toujours dans le cadre de la négociation collective. C’est d’ailleurs ce qui nous différencie de vous, monsieur Cadic, qui préférez vous attacher aux relations conventionnelles et individuelles.
Nous considérons, pour notre part, que le sujet traité concerne des salariés, et non des individus, et là réside notre divergence avec nombre de personnes de droite.
Alors on peut toujours dire que l’on aurait dû décider cette mission plus tôt, madame Procaccia. Quoi qu’il en soit, la démarche est importante : elle nous donnera matière à adapter le droit du travail, sans que l’on ait à se départir de la volonté de négociation, si importante, des partenaires sociaux.

En souhaitant le rétablissement de la hiérarchie des normes, nous ne disons pas pour autant qu’il faut supprimer les accords d’entreprise et que tout doit figurer dans la loi.
Ces accords ont toujours existé, mais la loi doit fixer les règles minimales qu’il convient de respecter. C’est ce que je vous reproche de ne pas avoir prévu concernant le travail du dimanche.
J’y insiste, la loi doit fixer les règles minimales relatives au salaire, aux horaires, à la modulation, aux conditions de travail. Par la suite, évidemment, chaque branche élabore l’accord qui lui correspond. Dans la métallurgie, l’accord sera différent de celui qui s’applique dans l’hôtellerie, la restauration ou le commerce. C’est déjà le cas aujourd’hui ! Mais au moins existe-t-il, aujourd’hui, un minimum légal pour tous les salariés : le SMIC, par exemple.
Si l’on vous suivait, on pourrait très bien imaginer, demain, un SMIC différent selon l’entreprise... Cela ne voudrait plus rien dire, si ce n’est une grille de salaires par entreprise. Ce n’est pas ce que nous voulons !
La loi doit définir les règles qui seront impérativement respectées par tous les partenaires sociaux dans les entreprises, règles qui sont ensuite déclinées dans les accords de branche et les accords d’entreprise.
Parmi les accords d’entreprise que vous avez évoqués, madame Bricq, certains sont sans doute plus avantageux que la loi. Tant mieux ! Mais peut-être, aussi, certains le sont-ils moins. Je ne connais pas les milliers d’accords d’entreprise existants...
Vous nous parliez, monsieur le ministre, des accords majoritaires. Ils existent, certes, mais je vous rappelle qu’il y a aussi des référendums, auxquels les entreprises aiment à recourir, car ils leur permettent de faire porter la responsabilité du moins-disant social sur les salariés.
Rappelez-vous les Conti, qui avaient accepté de travailler plus de 35 heures et de diminuer leur salaire, en contrepartie de quoi l’entreprise devait maintenir les emplois. Or, au bout du compte, les salaires ont diminué, les horaires ont augmenté et l’entreprise a fermé !
À un moment donné, il faut tout de même que le droit du travail permette aux salariés, à leurs représentants et à l’ensemble des institutions représentatives du personnel, les IRP, de se faire respecter et d’être entendus.
Par cet amendement visant à rétablir la hiérarchie des normes, je ne souhaite pas revenir à l’époque des dinosaures, mais à la situation d’avant 2004. Ce n’est pas vieux ! Car c’est cette année-là que la hiérarchie des normes a été inversée...
Par ailleurs, nous ne souhaitons pas tant empêcher l’annualisation qu’éviter que les employeurs ne se dispensent de payer les heures supplémentaires, comme cela leur incombe dès lors que l’annualisation est mise en œuvre.
Je maintiendrai donc mes deux amendements, malgré les arguments qui nous ont été opposés.
Je ne veux pas prolonger indéfiniment la discussion, mais celle-ci est très importante en ce qu’elle fait écho, sur le plan conceptuel, au débat que nous avons eu sur le travail du dimanche, exemple que vous avez eu raison de citer.
Lorsque la recodification du code du travail a été lancée, selon le principe très simple que vous avez rappelé, le constat a été dressé collectivement qu’il fallait introduire des aménagements. Mais je ne suis pas d’accord avec vous, madame David, toute la hiérarchie des normes n’a pas été inversée : dans certains pans du droit, l’inversion était très marginale.
Aujourd’hui, il n’y a pas d’inversion de la hiérarchie des normes. Nous en restons au principe dit « de la crémaillère sociale » : sur l’essentiel, hormis les deux sujets que nous avons évoqués, l’accord de branche est toujours mieux-disant que la loi et l’accord d’entreprise toujours mieux-disant que l’accord de branche.
Cela étant, on observe que, lorsque l’on souhaite aller au-delà du minimum prévu par la loi, certains secteurs ou acteurs de l’économie ne peuvent plus suivre, ou difficilement.
Exactement !
Sur le principe, je pourrais être d’accord avec vous et dire qu’il faut payer double le dimanche, car c’est une juste compensation. Pourquoi ne l’a-t-on pas prévu dans la loi ? Parce que nous savons que certains types de commerces et de secteurs ne pourront pas faire face à une telle obligation.
Toute la question est de savoir quel doit être le minimum à inscrire dans la loi. C’est l’objet du débat politique !
En France, le consensus social s’est établi ainsi, collectivement. Ces dernières décennies, la droite et la gauche ont eu tendance à inscrire dans la loi un niveau minimum très exigeant. Or, quand certains secteurs ou certaines entreprises se sont retrouvés en situation difficile, on a vu que ce niveau minimum n’était parfois plus soutenable. C’est exactement ce qu’a illustré notre débat sur le travail du dimanche.
Ainsi, dans le secteur du vêtement, les commerçants ne peuvent pas payer double un salarié qui travaille le dimanche, pas plus que dans nombre de petites villes dites « touristiques » où la fréquentation est nulle du mardi au vendredi soir.
Voilà pourquoi nous n’avons pas inscrit ce niveau minimum dans la loi et que nous l’avons renvoyé à des accords de branche et d’entreprise.
Cette forme de déconcentration, qui consiste à fixer dans la loi des principes et à renvoyer pour le reste à des régulations sociales, a ses vertus. En effet, la meilleure volonté du monde se heurte parfois à la diversité des situations. C’est tout le défi posé au travers de cette réforme du code du travail.

M. Olivier Cadic. Ce débat commence à devenir vraiment intéressant et à aller dans le bon sens !
Exclamations sur les travées du groupe CRC.

Je suis tout à fait d’accord avec vous, madame David, le code du travail doit être le plus simple possible, pour être compréhensible par tous. J’ai compris que vous l’aviez compris !
Sourires.

Tel était exactement l’objet de mes amendements : un code du travail le plus simple possible, l’accord de branche pour entrer plus avant dans les détails, puis l’accord d’entreprise afin d’élaborer le contrat final.
Ce que je viens d’entendre me fait penser que nous pourrions, tous ensemble, progresser et marquer l’Histoire.
Nouveaux sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.

Section 4
Mesures relatives au développement de l’emploi des personnes handicapées et aux contrats d’insertion
(Non modifié)
L’article L. 5212-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « fournitures » est remplacé par le mot : « fourniture, » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi au sens de l’article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l’article L. 8221-6 ou à l’article L. 8221-6-1. » ;
3° Après le mot : « établissements », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : «, services ou travailleurs indépendants. Toutefois, cet acquittement partiel est déterminé soit en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4°, soit de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants mentionnés au même 4° relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »

Apparemment, cet article, qui offre aux entreprises la possibilité de s’acquitter partiellement de leurs obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés semble constituer une réponse intéressante pour permettre le développement de l’emploi des travailleurs indépendants en situation de handicap.
Cependant, ce changement dans l’obligation d’emploi a des effets que je qualifierais de pervers, ainsi que des conséquences indésirables et incontrôlables. Il ne faut pas oublier, en effet, que la grande majorité des travailleurs indépendants qui sollicitent, notamment, le soutien de l’Association chargée de gérer le fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées, l’AGEFIPH, sont des personnes très défavorisées et en difficulté. En outre, elles exercent souvent des métiers ne répondant pas aux demandes des entreprises.
Si cette disposition vise à concerner tous les travailleurs indépendants handicapés, elle ne touchera ainsi, en pratique, qu’une faible minorité qui pourra conclure des contrats avec des entreprises. Il s’agira sans doute, principalement, de personnes qui pourront proposer des prestations intellectuelles : consultants, avocats, comptables, ou encore architectes.
Par ailleurs, alors que le nombre de recrutements de personnes handicapées ne cesse de diminuer d’année en année, avec une baisse en proportion de ces recrutements en CDI, cette disposition pourrait même, dans de nombreux cas, fragiliser les revenus et la qualité de l’emploi de ces travailleurs. En effet, bien que cela soit prohibé par le droit du travail, la tentation risque d’être grande pour un certain nombre d’employeurs de contraindre leurs salariés à adopter le statut d’auto-entrepreneur et ainsi de transformer la relation contractuelle.
Enfin, des interrogations demeurent.
La médecine du travail permet de certifier le handicap d’un salarié pour qu’il soit comptabilisé dans le calcul de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Mais, dans le cas des travailleurs indépendants, comment vérifiera-t-on que l’entrepreneur est bien handicapé ?
Autre interrogation : comment vérifiera-t-on que le travail sous-traité aura été effectué par une personne handicapée ? Par exemple, lorsqu’un cabinet créé par un expert-comptable en situation de handicap intervient pour le compte d’un employeur, comment s’assurer que la prestation a bien été réalisée par lui, et non par un de ses salariés valides ?
Cet article risque donc, selon nous, d’affaiblir l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, et donc de constituer un recul par rapport à la loi de 2005. C’est pourquoi nous nous y opposons.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 81 est présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mmes Cohen, Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 485 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 81.

Après avoir obtenu, depuis vingt ans, des exonérations massives de cotisations sociales, ce qui a permis de faire passer de la poche des salariés à celle des patrons une part croissante des richesses créées par le travail, le MEDEF veut davantage : il souhaite maintenant faire baisser le salaire directement perçu par les travailleurs.
Comme il est encore difficile de casser les garanties collectives contenues dans le code du travail et les conventions collectives, la technique choisie est de priver le maximum de personnes de ces garanties : des informaticiens payés à la mission, des vendeuses qualifiées « gérantes », des cuisiniers « prestataires de services », sans parler des « entrepreneurs de mise en rayon dans les supermarchés », et j’en passe.
Nous rappelons notre opposition à la précarité des travailleurs indépendants et refusons de voir appliquer aux travailleurs handicapés l’absence de statut protecteur.

Aujourd’hui, pour satisfaire leur obligation d’emploi de personnes handicapées, les entreprises peuvent notamment conclure des contrats de sous-traitance, de fourniture ou de prestation avec des entreprises adaptées, centres de distribution d’aide à domicile et services d’aide par le travail. L’article 92 élargit cette liste aux travailleurs handicapés indépendants.
On peut penser que les prestations intellectuelles seront davantage demandées que les manutentions. Surtout, cet article encourage le recours à l’externalisation : certaines entreprises pourraient avoir la tentation de transformer le statut de leurs salariés en indépendants avec, à la clé, des avantages indéniables, comme une rémunération et des horaires « à la carte ».
Lutter contre l’exclusion des personnes handicapées du monde du travail ne doit pas favoriser la précarisation.

L’article 92 ouvre la possibilité de prendre en compte les contrats passés avec des travailleurs indépendants handicapés au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Il apporte une réponse aux difficultés que rencontrent ces personnes sur le marché de l’emploi. Lorsque nous avons reçu l’Association des accidentés de la vie, la FNATH, elle ne nous a d’ailleurs pas fait part de son opposition à cette mesure, dont la portée restera certainement limitée. Est-ce, pour autant, une raison de la supprimer ? La commission ne le pense pas.
L’avis est donc défavorable

L’article 92 prévoit d’intégrer les contrats de sous-traitance passés avec des travailleurs indépendants handicapés dans les modalités d’accomplissement partiel de l’obligation d’emploi de 6 % de personnes handicapées pesant sur tout employeur d’une entreprise d’au moins vingt salariés.
L’étude d’impact qui nous a été fournie indique que l’ouverture du dispositif aux contrats de sous-traitance passés avec des travailleurs handicapés indépendants permettrait à plus de 70 000 d’entre eux d’obtenir un emploi.
Parallèlement, les employeurs pourraient s’acquitter partiellement de leur obligation d’emploi de personnes en situation de handicap.
Un décret en Conseil d’État fixera les modalités de cette disposition nouvelle, qui appelle en effet un encadrement strict afin d’éviter les effets d’aubaine. Sur ce point, je partage les inquiétudes de Jean Desessard.
La formule retenue pourrait être le prix hors taxe des fournitures, des travaux ou des prestations figurant au contrat, déduction faite du coût des matières premières des produits, des matériaux, des consommations et des frais de vente – consommations intermédiaires – divisé par 1 600 fois le SMIC horaire.
Dans le cas où le travailleur indépendant handicapé emploie un ou des salariés, seul sera déductible de l’obligation d’emploi le volume de travail effectué par le travailleur indépendant handicapé, puisque c’est lui qui est visé par la mesure.
Dans le cas où le travailleur indépendant handicapé bénéficie du régime de la micro-entreprise et ne dispose pas d’une comptabilité détaillée lui permettant d’évaluer le coût réel des consommations intermédiaires, le montant de celles-ci pourra être forfaitaire.
Il convient de souligner que cet article, comme les articles suivants, répond à une demande forte des associations, lesquelles s’étonnent que les travailleurs indépendants en situation de handicap ne bénéficient pas des mêmes aides que les entreprises qui emploient des salariés dans la même situation. L’objet de ces dispositions est donc de répondre aux demandes des associations, plus à même que quiconque d’évaluer les besoins.
Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas ces amendements de suppression.

Je suis assez mal à l’aise avec les articles 92, 93 et 93 bis relatifs aux travailleurs handicapés.
Les personnes en situation de handicap ont de très importantes difficultés d’accès à l’emploi et vous savez qu’aucune entreprise, y compris cette noble maison, ne remplit ses obligations d’emploi à cet égard.
Pour ma part, je voterai ces amendements de suppression.
Les amendements ne sont pas adoptés.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1291, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mmes Cohen, Demessine et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa du I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce plan comporte un volet concernant les actions de formation professionnelle des personnes handicapées, élaboré en lien avec les politiques concertées visées à l’article L. 5211-2 du code du travail. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.

Je vais faire plaisir à mes camarades socialistes... La volonté du groupe CRC est de relayer un engagement du Président de la République.
Sourires.
Exclamations amusées sur les travées de l'UMP

Le Président de la République s’y était engagé lors de la campagne des présidentielles : il « garantirait l’existence d’un volet handicap dans chaque loi », il « renforcerait les sanctions en cas de non-respect des 6 % de travailleurs handicapés dans les entreprises, les services publics et les collectivités locales ».
Aujourd’hui, pourtant, que nous propose-t-on, sinon de nouvelles solutions pour soustraire les entreprises à leur obligation de recrutement ?
Nous le savons, il existait déjà des possibilités de détournement, par le biais du recours aux services d’entreprises adaptées et d’établissements et services d’aide par le travail. Pour autant, nous aurions pu nous attendre de ce gouvernement qu’il ait plus de clairvoyance !
Monsieur le ministre, comment comptez-vous favoriser le salariat des personnes souffrant de handicap alors que vous créez de nouvelles exceptions ? Alors, oui, les 71 000 travailleurs handicapés indépendants pourront plus facilement travailler et les employeurs pourront les déduire de leur « quota ». Toutefois, ce coup de canif au droit du travail se fait au détriment des plus de 5 millions de personnes handicapées en France !
Autre détournement au profit des entreprises, la possibilité d’intégrer les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les PMSMP, dans l’obligation faite aux entreprises de plus de vingt salariés de compter 6 % de travailleurs en situation de handicap dans leurs effectifs.
Ce dispositif, qui ne donne aucune garantie de rémunération, est une aubaine pour les entreprises... Ces dernières, plutôt que d’embaucher, pourront enchaîner les PMSMP pour répondre à leurs besoins. On retrouve ici exactement la même logique que pour les stages d’observation d’un mois, qui, au final, servent aux entreprises à se renforcer périodiquement.
L’un de nos collègues parlait d’un retour aux diligences ; avec vos attaques contre le droit du travail, vous nous offrez un retour à l’époque de Victor Hugo, dont j’occupe la place dans cet hémicycle. C’est grandiose...
Vous l’aurez compris, nous ne pouvons pas nous satisfaire d’une politique au rabais en matière d’intégration des personnes souffrant de handicap dans le marché du travail.

L'amendement n° 1292, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les contrats de sous-traitance ou de prestations de services doivent garantir aux prestataires une rémunération minimale supérieure à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. » ;
La parole est à Mme Éliane Assassi.

L’employeur a jusqu’à présent la possibilité de s’acquitter partiellement de son obligation d’emploi des travailleurs handicapés en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services soit avec des entreprises adaptées, soit avec des centres de distribution de travail à domicile, soit avec des établissements ou services d’aide par le travail.
L’article 92 prévoit que les contrats de fourniture de prestations pourront désormais être passés aussi avec des travailleurs indépendants handicapés.
Cela ne doit pas avoir pour effet de réduire les possibilités d’emploi direct ni les ressources de l’AGEFIPH, nécessaires pour agir en faveur des travailleurs handicapés.
Certes, cette disposition n’exonère pas intégralement l’employeur de son obligation, mais elle lui permet de la remplir plus facilement. Elle lève indubitablement une part importante des contraintes qui ne se résument alors qu’à un bon de commande.
C’est pourquoi nous proposons que cette facilité soit assortie d’une contrepartie fixant l’obligation de rémunération des travailleurs indépendants à 20 % minimum au-dessus du SMIC.

La commission spéciale demande le retrait de l'amendement n° 1291, qui tend à inclure dans les contrats de plan régionaux de développement des formations professionnelles un volet relatif à la formation des personnes handicapées. La précision demandée semble superflue.
À l’heure actuelle, ces plans n’ignorent pas les difficultés particulières rencontrées par les personnes en situation de handicap dans l’accès à la formation professionnelle et contiennent des mesures qui leur sont spécifiquement destinées.
Par ailleurs, des documents spécifiques existent : un programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées doit être élaboré, tandis que, tous les cinq ans, le service public de l’emploi établit un plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés.
L'amendement n° 1292 vise à garantir une rémunération minimale de 1, 2 SMIC aux prestataires d’un contrat de sous-traitance passé avec une structure œuvrant à l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Si la commission spéciale partage le souhait exprimé d’une hausse de la rémunération de tous les salariés, handicapés ou non, d’ailleurs, une telle mesure, imposée par le législateur, aurait pour seule conséquence de diminuer le recours par les entreprises à la sous-traitance en direction de ces structures, donc de réduire les opportunités d’emploi pour les personnes handicapées. Tel ne semble pas être l’objectif.
Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 92 est adopté.
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5212-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212 -7 -1. – L’employeur peut s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie.
« Cet acquittement est pris en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa de l’article L. 5212-7.
« Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire. »

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, 22 %, c’est le taux de chômage de la population en situation de handicap, un taux deux fois plus élevé que celui de l’ensemble de la population.
La loi est pourtant claire : tout employeur du secteur privé et tout établissement public d’au moins vingt salariés pendant trois ans doit accueillir 6 % de personnes en situation de handicap dans son effectif total.
Or le taux d’emploi des personnes en situation de handicap se situe bien en deçà de cette obligation légale : 3, 1 % dans le secteur privé et 4, 6 % dans le secteur public. Ainsi, depuis trente ans que cette obligation d’emploi existe, elle n’est toujours pas respectée.
Au lieu de renforcer les sanctions contre les employeurs ne respectant pas cette obligation d’emploi, la loi leur a de plus en plus souvent proposé des dérogations. Peu après l’introduction du dispositif, en 1988, les employeurs ont ainsi eu la possibilité d’avoir recours à des entreprises du secteur protégé, via des contrats de sous-traitance, en déduction de l’obligation d’emploi direct. De même, ils peuvent verser une contribution à l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées ou, depuis 2006, au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Ensuite, la loi de finances de 2009 a introduit la possibilité de déduire de l’obligation d’emploi direct les stages effectués par des personnes en situation de handicap.
Ces dérogations rendent résiduelle la part d’emploi direct des personnes en situation de handicap et transforment une obligation de résultat – 6 % de l’effectif – en obligation de moyens, par le biais de stages, conclusions d’accords et autres.
L'article 93 comporte une dérogation supplémentaire. Il permet de s’exonérer partiellement de l’obligation d’emploi direct en recrutant un stagiaire pour une période de mise en situation en milieu professionnel. Cela concerne les personnes en formation continue, les demandeurs d’emploi ou les personnes exclues du marché du travail.
Cette dérogation s’ajoute à celle qui concerne les stages. La limite est de 2 % de l’effectif de l’entreprise en situation de handicap et en stage ou en mise en situation en milieu professionnel.
Si ces stages permettent de faciliter l’insertion sur le marché du travail, ils restent non rémunérés et entérinent une forme de précarité dans l’emploi.
Nous refusons de soustraire ainsi les entreprises à leurs obligations. Nous aurions préféré que soit étudiée la proposition de l’Association des paralysés de France, qui promeut la mise en œuvre de mesures incitatives l’égard des PME et TPE, entreprises actives et prometteuses, en lieu et place d’un assouplissement des quotas actuels.

Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 82 est présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 486 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 956 rectifié est présenté par M. Collombat et Mme Malherbe.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 82.

La possibilité de déroger à l’obligation d’emploi direct de travailleurs handicapés est souvent justifiée par l’idée qu’il faut faire évoluer les représentations et vaincre les peurs des employeurs, en multipliant les occasions de rencontre.
Il est vrai que le milieu professionnel reste fortement empreint de préjugés. D’ailleurs, selon le Défenseur des droits, l’emploi est le premier domaine dans lequel s’exercent les discriminations liées au handicap.
Or cela fait trente ans que l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés existe, trente ans que, si les employeurs avaient respecté leurs obligations, les perceptions du handicap dans l’entreprise auraient évolué, comme elles ont évolué, d’ailleurs, à l’école.
L’emploi direct est la meilleure manière d’insérer professionnellement et durablement les personnes en situation de handicap ; elle leur permet d’être reconnues par leurs collègues, de prendre une réelle place dans l’entreprise.
On ne s’intègre pas quand on est précaire. On ne fait pas « évoluer les mentalités » pendant une courte période de stage et on ne peut pas demander aux personnes en situation de handicap d’accepter des contrats précaires et non rémunérés, sous prétexte que les employeurs n’ont pas compris la chance que constituait la diversité pour leur entreprise !
Les personnes en situation de handicap rencontrent déjà trop de barrières, d’obstacles dans leur vie quotidienne et leur vie professionnelle. Elles n’ont pas à se contenter de stages au lieu d’un véritable emploi.
Les employeurs ont eu ce temps et les personnes en situation de handicap n’ont plus le temps. Actuellement, 2 millions de personnes en situation de handicap ou d’invalidité vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit 987 euros par mois. C’est d’un emploi qu’elles ont besoin, et pas d’un stage !
Et que dire des jeunes en situation de handicap qui ont étudié sur les bancs des écoles et universités républicaines ? À la rentrée 2014, 258 710 jeunes en situation de handicap étaient ainsi scolarisés. Ces jeunes veulent leur place sur le marché du travail, ce qui est tout à fait légitime.

Cet article prévoit que les périodes de mise en situation en milieu professionnel entrent dans le « quota » obligatoire de personnes handicapées au sein des entreprises.
L’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap est bien un impératif pour bâtir la société inclusive que nous appelons de nos vœux.
Nous sommes également tous d’accord pour dire que l’éloignement de l’emploi est un véritable problème, auquel il convient de remédier. Les périodes d’immersion en milieu professionnel peuvent contribuer à diminuer cet éloignement et doivent donc être encouragées pour recréer des liens et lever des préjugés.
Toutefois, prévoir que ces périodes puissent être décomptées de l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap ne semble pas la réponse appropriée. L’approche privilégiée ici, à savoir les déductions et dérogations à l’obligation d’emploi, est problématique, car une période de mise en situation ne saurait être considérée comme un véritable emploi.
Il faut de la stabilité, de l’ambition, pour ces personnes comme pour tous les salariés, et pas uniquement des dispositifs d’insertion. C'est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cet article.

L'amendement n° 956 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements identiques restant en discussion ?

L’article 93 permet de prendre en compte, au titre de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, dans la limite d’un plafond, les personnes handicapées accueillies dans l’entreprise en période de mise en situation en milieu professionnel. Il vise à favoriser l’insertion des personnes handicapées et leur formation, tout en incitant les entreprises à y contribuer.
Il s’agit toutefois d’une incitation limitée. En effet, la PMSMP dure un mois. Or l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés est calculée sur le temps de présence annuel dans l’entreprise. Cela signifie qu’une PMSMP ne permet de s’acquitter que d’une part bien minime de cette obligation, sans commune mesure avec l’embauche d’un salarié à plein temps. Ainsi, un stagiaire ne compterait que pour 0, 1 bénéficiaire.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Je pense que l’on envoie un mauvais signal en facilitant les exonérations en matière de recrutement de travailleurs handicapés, raison pour laquelle je voterai les amendements de suppression.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 93 est adopté.
Après le premier alinéa de l’article L. 5212-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette possibilité s’applique également en cas d’accueil en période d’observation ou en séquence d’observation mentionnées au 2° de l’article L. 4153-1 d’élèves de l’enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l’allocation compensatrice pour tierce personne ou l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et disposant d’une convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article. »

L’article 93 permet aux entreprises de compter les stages d’observation d’élèves au titre de l’obligation d’emploi de 6 % de personnes handicapées.
Ces stages de découverte des métiers concernent tous les élèves, de la cinquième à la terminale. Il s’agit, pour les enfants handicapés comme pour n’importe quel autre enfant, d’une première immersion dans un milieu professionnel et peut-être – pourquoi pas ? – l’occasion de la découverte d’une vocation.
Toutefois, la prise en compte de ces stages dans l’obligation d’emploi des entreprises nous paraît quelque peu inconvenante.
À notre sens, il est d’abord scandaleux de mettre ainsi sur le même plan un stage de quelques semaines d’un enfant de moins de seize ans avec un emploi à temps complet d’un adulte en situation de handicap. Il n’y a rien de comparable entre les deux situations.
Il est ensuite déchirant de voir qu’il faut en arriver là pour inciter les entreprises à accueillir ces enfants pour quelques semaines, alors qu’il s’agira simplement pour eux, comme pour n’importe quel enfant, d’observer la vie de l’entreprise et non d’y participer. Cela risque, une fois de plus, de laisser penser à ces enfants, dès leur plus jeune âge, qu’ils ne seraient pas « comme les autres ».
S’il s’agit, pour les entreprises, de se dédouaner encore un peu plus de leurs obligations d’emploi de travailleurs handicapés ou de grappiller une partie de leurs cotisations à l’AGEFIPH, c’est un recul de plus – je ne le qualifierai pas ici – au regard de la loi de 2005.
Notre pays bat en retraite un peu trop souvent sur ces questions : alors que le chômage des personnes en situation de handicap augmente deux fois plus vite que la moyenne, le Gouvernement a décidé d’opérer chaque année, de 2015 à 2017, un prélèvement supplémentaire de 29 millions d’euros sur le budget de l’AGEFIPH.
Il est temps, à mon sens, de marquer un coup d’arrêt à ces reculades en matière d’emploi des personnes en situation de handicap, surtout lorsque cela se fait sur le dos des plus jeunes !

Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 83 est présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 145 rectifié ter est présenté par Mmes Gatel et Loisier, MM. Guerriau, Bonnecarrère, Détraigne et Médevielle, Mme Férat, MM. Roche, Namy et Marseille, Mme Doineau, M. Kern et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 487 est présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 83.

Cet article permet aux employeurs d’échapper au financement du fonds AGEFIPH en intégrant aux dispositifs de compensation du handicap les élèves handicapés effectuant une période d’observation.
Outre le mépris pour ces jeunes dont témoigne un tel dispositif, nous considérons qu’il s’agit ici d’un nouveau cadeau fait au patronat, qui ne souhaite pas respecter ses engagements de recrutement de personnes handicapées ni contribuer au financement de l’AGEFIPH.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

La parole est à Mme Élisabeth Doineau, pour présenter l’amendement n° 145 rectifié ter.

Les entreprises d’au moins vingt salariés ont pour obligation, dans une proportion de 6 % de leur effectif salarié, d’employer des personnes en situation de handicap. Elles peuvent partiellement s’acquitter de cette obligation en accueillant des personnes handicapées dans le cadre d’un stage.
Le présent projet de loi permettrait aux entreprises de s’acquitter également en partie de cette obligation en intégrant les périodes d'observation des collégiens.
Si les jeunes en situation de handicap ont certes la possibilité d’être recrutés par les entreprises à l’issue de leur expérience en stage, cela est évidemment impossible dans le cadre des périodes d’observation de quelques jours effectuées par les collégiens.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition contestable pour l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap.

Cette troisième proposition visant à alléger les devoirs de l’entreprise par rapport à l’inclusion des personnes en situation de handicap est une invention déconcertante.
Comptabiliser les heures de stage de découverte des élèves de moins de seize ans pour éviter de recruter des personnes en situation de handicap avec un vrai contrat de travail pose vraiment question !
Quitte à ne plus seulement friser le ridicule, à partir du moment où tout se vaut, pourquoi ne proposez-vous pas aussi de comptabiliser les stagiaires de troisième dans le calcul de la contribution à la formation professionnelle ?
Mme Évelyne Didier marque son approbation.

Par cet amendement, nous vous proposons de supprimer cet article. La société inclusive
Exclamations sur les travées de l'UMP.

… repose sur une politique de l’emploi universaliste et non sur l’instrumentalisation d’élèves en situation de handicap afin d’exonérer l’entreprise de ses devoirs.

La commission est défavorable à ces trois amendements de suppression.
Cet article permet de prendre en compte, dans l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés – l’OETH –, les jeunes élèves handicapés accueillis en stage de découverte ou en stage d’observation.
Contrairement à ce que pensent les auteurs de ces amendements, cet article vise non pas à permettre aux entreprises de s’exonérer de leurs obligations, mais à apporter une solution aux difficultés très importantes que rencontrent les jeunes handicapés pour découvrir l’entreprise dans un cadre scolaire. Les associations que nous avons rencontrées nous l’ont d’ailleurs confirmé.
L’impact sur l’OETH sera particulièrement faible : un stage d’une semaine d’un élève de troisième, par exemple, comptera pour 0, 02 bénéficiaire. Une entreprise de vingt salariés devrait donc accueillir cinquante de ces jeunes pour se mettre en conformité avec ses obligations…
Il s’agit d’envoyer un signal aux entreprises afin qu’elles entrent dans le dispositif et acceptent d’accueillir des élèves handicapés.
Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements de suppression.
Je comprends les sensibilités qui se sont exprimées, mais il ne s’agit pas d’une invention saugrenue du ministre de l’économie ou de ses services. Cette proposition a été formulée par celle de mes collègues qui, au sein du Gouvernement, s’occupe au quotidien de ces sujets, après avoir conduit des concertations.
Il y aurait un effet de substitution, dans les limites soulignées par Mme le corapporteur à l’instant, si nous n’avions que des entreprises vertueuses dans un monde vertueux. Nous en sommes malheureusement bien loin.
Nous créons ici un mécanisme visant à inciter les entreprises à recruter des stagiaires handicapés, à leur permettre d’accéder, de s’exposer au monde de l’emploi.
Je pense que l’inclusion de ce dispositif dans le mécanisme existant est à l’origine de la confusion qui nous fait tenir ce débat dans lequel je suis mal à l’aise. C'est la raison pour laquelle je tiens à expliquer la philosophie d’ensemble de cette mesure.
Nous ne pensons pas une seule seconde que des centaines d’entreprises vont recruter des milliers de jeunes stagiaires pour s’exonérer de leur obligation légale d’emploi des personnes handicapées.
Nous introduisons un mécanisme très pragmatique qui va favoriser l’entrée en stage de jeunes enfants handicapés qui connaissent des difficultés aussi grandes que les adultes pour accéder à l’emploi.
Aujourd’hui, dans les entreprises de plus de vingt salariés, pour une obligation légale de 6 %, le taux d’emploi constaté de 3 %. Nous sommes donc malheureusement bien loin de l’objectif. Deux solutions s’offrent à nous : soit on sanctuarise les 6 % et l’on constate, année après année, que l’on n’y arrive pas, quitte à continuer de mettre la pression sur les entreprises – comme aujourd’hui –, soit on se sert de cette situation pour créer une incitation réelle – déjà loin de l’obligation légale – afin d’offrir une chance aux jeunes et de pousser les entreprises à les accueillir.
Nous parlons de situations humaines particulièrement dures et je ne voudrais pas ici accréditer l’idée que cette proposition pragmatique faite par ma collègue et son équipe est la preuve que nous revoyons nos ambitions à la baisse sur cet objectif extrêmement important.

Je me sens un peu moins seule, l’amendement défendu par Élisabeth Doineau étant un amendement de groupe, déposé par notre collègue Françoise Gatel.
J’ai bien compris vos propos, monsieur le ministre, mais je reste sur ma philosophie : si, dans le cadre de stages en entreprise, les jeunes en situation de handicap peuvent en effet être recrutés à l’issue de leur expérience, cette perspective d’embauche est égale à zéro pour les collégiens effectuant une période d’observation de quelques jours.
Mme Gatel explique que permettre aux entreprises de s’acquitter partiellement de leurs obligations d’emploi en intégrant les périodes d’observation des collégiens est une pure ineptie. Je pense qu’elle a tout à fait raison et c’est pourquoi je soutiendrai les amendements de suppression, dont celui qui a été déposé par l’ensemble de mon groupe.

Je trouve ce dispositif franchement médiocre, monsieur le ministre.
Tout ce qui peut faire en sorte que des collégiens et des lycéens handicapés accèdent à l’entreprise et que des chefs d’entreprise commencent à s’habituer eux-mêmes à travailler avec de jeunes handicapés est une bonne chose.
Toutefois, dire à un jeune handicapé que, au titre de sa période d’observation d’une semaine, il ne compte que pour 0, 02 bénéficiaire de l’OETH et que ces stages ne changent rien à l’obligation d’emploi qui est faite par ailleurs aux entreprises, reconnaissons que cela n’est pas très valorisant pour lui !

Certes, madame Deroche, le jeune l’ignore, mais le chef d’entreprise, lui, le sait !
On nous dit qu’il faut faire en sorte que ces stages d’observation permettent à des jeunes handicapés d’avoir accès à l’entreprise, qu’il faut trouver des solutions pour que les chefs d’entreprise acceptent de soutenir ce genre de stage. Mais alors, pourquoi ne pas proposer une incitation fiscale, par exemple ?
Je ne sais si nous vivons dans une société « inclusive », mais je sais que nous sommes dans une société humaine, où chacun doit trouver sa place. Or cet article n’est pas très valorisant, ni pour le jeune en question ni pour les entreprises, qui ont un rôle social à jouer.
Pour ces raisons, je voterai les amendements identiques de suppression.

Dans une précédente carrière, j’ai eu à m’occuper d’élèves de quatrième qui devaient effectuer des stages en entreprise. Or les élèves handicapés de ces classes étaient traités comme leurs camarades, ils ne faisaient l’objet d’aucune mesure particulière. Je regrette qu’à travers ce dispositif vous introduisiez une certaine forme de discrimination entre stagiaires, selon qu’ils sont handicapés ou non.
Ces stages sont essentiellement une période d’observation. On demande aux collégiens de faire acte de présence dans l’entreprise afin qu’ils comprennent les contraintes du monde du travail. C’est aussi l’occasion de valoriser les métiers qu’ils vont côtoyer pendant quelques jours. Cela ne peut en aucun cas s’apparenter à autre chose qu’à de l’observation.
Franchement, monsieur le ministre, j’espère que vous avez développé cet argumentaire par solidarité gouvernementale ! §Accepter, dans un texte comme celui-là, une mesure de ce type, qui sera sans effet et peut-être même pénalisante, c’est prendre un grand risque.
Il serait judicieux de vous en remettre, sur cette question, à la sagesse du Sénat. Pour le coup, cela va beaucoup trop loin !

Monsieur Karoutchi, j’ai bien précisé qu’il ne s’agissait pas d’une incitation financière ni d’une manière de faire miroiter aux entreprises que l’accueil de jeunes stagiaires handicapés allait compter au titre de l’OETH. C’est même tout le contraire : le pourcentage est tellement faible que l’on voit mal comment les entreprises pourraient s’acquitter ainsi de leur obligation légale. Et ne me faites pas dire qu’un élève de troisième handicapé vaut moins qu’un salarié handicapé, cela n’a jamais été dans l’esprit de la commission.
Au surplus, cette mesure nous a été demandée par les associations.

Je partage tout à fait le sentiment de malaise de la plupart des collègues qui se sont exprimés. Selon moi, une telle disposition n’a pas à figurer dans ce texte, parce que nous touchons là deux problèmes sérieux, auxquels on doit apporter des solutions sérieuses.
Tous les élèves rencontrent des difficultés pour trouver un stage d’observation en entreprise - les parents le savent, il faut se démener – et la démarche est encore plus ardue lorsqu’il s’agit d’enfants handicapés.
Ces difficultés viennent s’ajouter au grave problème que pose à notre société l’intégration des travailleurs handicapés dans l’entreprise. Il faut s’efforcer d’ouvrir une brèche dans le rempart dressé par de nombreuses entreprises en la matière.
Il convient donc de s’attaquer à ces problèmes, mais avec des mesures sérieuses, monsieur le ministre, comme celles que vous avez défendues jusqu’ici, et non par une « mesurette » de cette nature.
Pour ma part, je voterai ces amendements identiques de suppression.

M. le président. J’indique que j’ai été saisi d’une demande de scrutin public par le groupe CRC.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées de l’UDI-UC et de l’UMP.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, nous retirons notre demande de scrutin public.
Très bien ! sur un grand nombre de travées.

Je prends acte de ce retrait, madame Assassi.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 83, 145 rectifié ter et 487.
Les amendements sont adoptés.

L'amendement n° 268 rectifié, présenté par Mmes Duranton et Deromedi, M. Calvet, Mme Cayeux, MM. Milon, César, B. Fournier, Chasseing, Mouiller, P. Leroy et Trillard, Mme Morhet-Richaud, MM. Mayet, Vogel et Revet, Mme Bouchart, MM. Mandelli, Kennel, Grand, Laménie, Grosdidier, Saugey et de Nicolaÿ et Mme Lopez, est ainsi libellé :
Après l'article 93 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité de mettre en place un fonds de garantie solidaire pour les entrepreneurs en situation de handicap.
La parole est à Mme Nicole Duranton.

Le financement des sociétés créées par des personnes en situation de handicap achoppe sur les préjugés bloquant l’accès aux prêts bancaires.
Une problématique similaire existait auparavant en France concernant la création d’entreprises par les femmes, qui représentaient moins de 5 % des entrepreneurs entre 1970 et 1980.
Le Fonds de garantie à l’initiative des femmes a été créé en 1989, afin d’améliorer l’accès des femmes à la création d’entreprises ou d’activités. Il garantit, selon le montant du prêt sollicité, jusqu’à 70 % ou 27 000 euros, les prêts bancaires accordés aux femmes souhaitant créer ou reprendre une entreprise.
Par cet amendement, il s’agit de demander au Gouvernement d’engager une démarche similaire de création d’un fonds de garantie solidaire à destination des personnes souffrant de handicap, afin de promouvoir leur meilleure intégration dans notre économie.

Même si l’objet du rapport demandé est intéressant, la commission, qui a émis un avis défavorable sur tous les amendements tendant à la remise d’un rapport, ne déroge pas à sa position pour ce qui concerne cet amendement.
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre :
1° La suppression du contrat d’accès à l’emploi, mentionné à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail ;
2° L’extension et l’adaptation aux départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon du contrat initiative-emploi mentionné à l’article L. 5134-65 du même code ;
3° La suppression du contrat d’insertion par l’activité mentionné au chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles.

L'amendement n° 84, présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
L'article 94 est adopté.

L'amendement n° 307 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano, Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Patient et Mme Jourda, est ainsi libellé :
Après l’article 94
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises exerçant une activité de caractère hôtelier installées au 1er janvier 2015 dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, ainsi qu’à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, peuvent bénéficier d’un moratoire jusqu’au 31 décembre 2019 sur leurs dettes auprès des caisses de sécurité sociale compétentes de leur département échues jusqu’au 31 décembre 2014 et sur les cotisations patronales de sécurité sociale à échoir au titre de l’année 2015.
II. – Toute condamnation pénale de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour fraude fiscale en application de l’article 1741 du code général des impôts, ou pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 8224-1 à L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2 du code du travail ou, après mise en demeure, le non-paiement des cotisations dues postérieurement à la signature du moratoire entraîne la caducité du moratoire.
En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre ou fraude au cours des cinq années précédant la promulgation de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.
III. – L’entreprise bénéficiaire du moratoire prévu par le présent article peut demander chaque année un certificat à la caisse de sécurité sociale compétente. Ce certificat atteste que l’entreprise est à jour de ses obligations sociales déclaratives et de paiement au sens du code des marchés publics.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Maurice Antiste.

Le projet de loi que nous examinons tend à lever les obstacles à la croissance.
Or l’un des leviers de croissance de la région que je représente est le tourisme. Il constitue en Martinique un secteur important, puisqu’il est à l’origine de plus de 9 % du PIB de l’île et de 12 000 emplois directs ou indirects. Pourtant, malgré des atouts évidents, ce secteur est en difficulté, notamment la grande hôtellerie, qui a perdu, depuis 2008, le tiers de ses capacités et de ses emplois.
La raison principale de cette situation est un manque de compétitivité face à la concurrence des îles voisines, qui disposent d’équipements récents et proposent des prix attractifs. La situation est la même dans les autres territoires français de la zone.
Pour retrouver son attractivité, et financer l’effort indispensable de rénovation, notre hôtellerie devrait pouvoir s’appuyer sur les fonds structurels européens. C’est l’une des raisons d’être de ces fonds que de compenser les handicaps spécifiques des territoires ultramarins.
Mais nous nous trouvons à cet égard dans un cercle vicieux, qui a été bien mis en évidence dans un rapport de l’Inspection générale des finances. En raison de ses difficultés, notre hôtellerie a accumulé une dette importante auprès des organismes de sécurité sociale. Or, pour pouvoir bénéficier des fonds européens, la règle est la même que pour l’accès aux marchés publics : il faut être en règle avec les obligations fiscales et sociales.
Ainsi, les hôtels ne peuvent accéder aux fonds qui leur permettraient de retrouver leur attractivité et d’assainir ensuite leur situation. Par voie de conséquence, il leur est également très difficile d’accéder aux financements bancaires.
Pour engager une dynamique de croissance, il faut commencer par lever ce blocage. C’est le sens de mon amendement, qui prévoit un moratoire sur la dette sociale de l’hôtellerie dans nos territoires, et précise que ce moratoire permet de remplir les conditions pour accéder aux fonds européens.
Nous créerons ainsi une situation favorable à la mise en valeur de notre potentiel touristique, que chacun reconnaît, et nous pourrons espérer, à terme, le rétablissement d’une situation normale pour le paiement des cotisations.
À défaut, nous nous enfermerons dans la spirale négative engagée – je le rappelle, 26 hôtels ont fermé depuis dix ans –, qui se révélera bien plus coûteuse pour les finances sociales que le moratoire ici proposé.
Sans être à lui seul la solution, cet amendement aiderait nos îles à retrouver croissance et emplois dans un secteur où elles ont des atouts.
Le présent amendement vise donc à permettre au secteur de l’hôtellerie de bénéficier d’un moratoire jusqu’en 2019 sur leurs dettes sociales.

Il est vrai que le secteur hôtelier connaît des difficultés outre-mer, où les investissements nécessaires pour réagir au développement de destinations concurrentes n’ont sans doute pas été réalisés.
Il s’agirait de la seconde fois qu’une solution de facilité en la matière serait mise en place par le législateur, puisque la loi de finances pour 2011 avait prévu, pour les mêmes bénéficiaires, un plan d’apurement de leurs dettes envers les organismes de sécurité sociale.
Pour la commission, de telles dispositions ne doivent pas devenir le droit commun : il ne faudrait pas, par ce biais, inciter les entreprises à ne pas acquitter leurs cotisations sociales dans l’espoir de bénéficier, au bout de quelques années, d’un moratoire ou d’un apurement de leurs dettes.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 819 rectifié ter, présenté par MM. Gabouty et Médevielle, Mme Loisier, MM. Guerriau et Pozzo di Borgo, Mme Jouanno, MM. Cadic, Kern et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l’article 94
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« I bis. – Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 2 € et des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle, à hauteur de 3, 70 €, dans les départements d'outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Cet amendement tend à amplifier et simplifier l'allégement du coût du travail pour les particuliers employeurs au titre des cotisations patronales qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés.

Ce sujet a été évoqué au cours de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il est certain que l’abaissement du coût du travail pour les particuliers employeurs pourrait relancer l’emploi dans ce secteur, des mesures plus restrictives ayant créé une forte diminution des déclarations : soit il y a eu moins d’heures travaillées, soit celles-ci n’ont pas été déclarées.
Toutefois, une telle mesure n’est pas sans conséquence pour le budget de la sécurité sociale. Or, à ce jour, nous ne sommes en mesure ni de l’évaluer ni de compenser ses effets.
Pour cette raison, la commission vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement, afin que de telles dispositions soient examinées au cours de la discussion du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Je le retire, pour le représenter dans le cadre du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

L’amendement n° 819 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 154 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Milon, Forissier et Longuet, Mme Cayeux et MM. Savary, Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 94
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3122-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord collectif visé aux articles L. 3122-2 ou L. 3152-1 peut prévoir que la limite visée au 1° correspond à la prise de la durée de congé visée à l’article L. 3141-3 sur la période de variation et est augmentée ou réduite à due proportion du nombre de jours de congés pris ou non durant cette période en application des dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-21 et L. 3151-1 à L. 3153-3. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Section …
Durée du temps de travail et aménagements
La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Il s’agit d’un amendement technique, qui vise à revenir sur des décisions prises en 2013 par la Cour de cassation sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Selon la Cour, en effet, le seuil ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, et ce même si le salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l’accord.
Depuis les années quatre-vingt, le code du travail permet de comptabiliser la durée du travail sur l’année, et non sur la semaine, par accord collectif. La loi du 19 janvier 2000 a fixé à 1 600 heures le seuil annuel, qui a été porté à 1 607 heures avec l’instauration, en 2004, de la journée de solidarité. Ce seuil est calculé à partir de la prise de cinq semaines de congés payés annuels.
En considérant que l’employeur ne peut imposer au salarié la prise anticipée des congés payés, la Cour de cassation – c’est le sens d’un arrêt de sa chambre sociale du 10 février 1998 – place beaucoup d’entreprises dans une position délicate. En effet, quand bien même le salarié nouvellement embauché ne souhaiterait pas prendre de congés payés par anticipation, l’employeur devra obligatoirement lui verser en fin d’année des heures supplémentaires, ne pouvant diminuer son temps de travail sans l’accord de l’intéressé.
Par extension, si le salarié prend la décision de placer une semaine de congés payés sur son compte épargne-temps, des heures supplémentaires seront générées.
Ces conséquences kafkaïennes et coûteuses pourraient pourtant être évitées. Cette interprétation est en effet d’autant plus contestable que le seuil de 1 607 heures vise les accords conclus depuis 2003 puis 2008, dans le cadre du nouvel aménagement négocié du temps de travail. La loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail prévoit, elle, que les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la loi demeurent en vigueur.
Cette complexité pose de vrais problèmes aux entreprises.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Catherine Procaccia l’a dit, le sujet est très technique. C’est pourquoi la commission sollicite l’avis du Gouvernement.
Sourires.
Vous l’avez expliqué de manière très détaillée, madame la sénatrice, le présent amendement tend ajuster le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires au-delà du seuil classique de 1 607 heures, et cela dans deux cas.
Le premier cas concerne le salarié employé par une entreprise ayant mis en place une annualisation du temps de travail. Dans ce cas, sans travailler plus de 35 heures par semaine, le salarié qui choisit de placer des jours de congé ou de repos sur son compte épargne-temps travaille de ce fait au-delà de 1 607 heures dans l’année.
Le second cas a trait au salarié nouvellement embauché en début d’année, lorsque la durée du travail, là aussi, est annualisée. Ce salarié, n’ayant pas encore acquis un droit complet à des congés payés, peut être amené à effectuer plus de 1 607 heures sur l’année, sans pour autant avoir travaillé plus de 35 heures par semaine.
Pour la bonne intelligence collective, j’essaie de remettre les choses en perspective : le salarié, dans ces deux situations, déroge au seuil de 1 607 heures tout en respectant les 35 heures.
Vous avez raison, madame la sénatrice, la situation n’est pas satisfaisante. Elle requiert par conséquent qu’une solution soit trouvée.
Ces heures sont qualifiées d’heures supplémentaires et donc rémunérées comme telles. J’ai peur que le dispositif proposé – ajuster le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise et du nombre de jours qu’il décide de placer sur un compte épargne-temps – n’introduise plus de complexité pour la totalité des entreprises. C’est en tout cas l’analyse que nous en faisons.
Aujourd’hui, en effet, cette obligation n’existe pas. Le problème que vous décrivez, lié à l’intrication de multiples contraintes, est réel, mais vous proposez d’y répondre en demandant à toutes les entreprises de comptabiliser les jours placés sur le compte épargne-temps et de repérer la date d’entrée de chaque salarié. Elles devront donc faire elles-mêmes le décompte leur permettant de déclencher le seuil relatif aux heures supplémentaires. Je crains, madame la sénatrice, les complexités de gestion qu’un tel système engendrerait.
En outre, sur le principe, cette fois, et non plus sur les modalités techniques, il n’est pas illégitime que le salarié nouvellement entré dans l’entreprise perçoive des heures supplémentaires à partir du même seuil d’heures effectuées au cours de l’année, dès lors que la durée de travail est lissée au sein même de l’entreprise.
Si les situations que vous avez évoquées, qui ne concernent sans doute pas des milliers d’entreprises, sont réelles, il semble que la solution que vous proposez ait en réalité des effets assez massifs. Elle conduit à revenir sur le principe d’un seuil unique de déclenchement des heures supplémentaires à 1 607 heures, ce que le Gouvernement ne souhaite pas, et entraîne des difficultés de gestion.
Je reconnais que la situation que vous décrivez pose un problème, sur lequel nous devons continuer de travailler avec François Rebsamen et son cabinet, mais je ne souscris pas à la solution que vous proposez.
C’est pourquoi je vous suggère, madame la sénatrice, de retirer cet amendement. À défaut, j’y serai défavorable.

Si cet amendement est discuté en séance, c’est que les cas décrits ne sont pas exceptionnels, monsieur le ministre.

On ne veut déroger ni aux 1 607 heures ni aux 35 heures ; il faut donc trouver une solution.
M. le ministre s’engageant à en discuter avec François Rebsamen, …

L’amendement n° 154 rectifié est retiré.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quinze.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt-et-une heures quinze, sous la présidence de Mme Isabelle Debré.