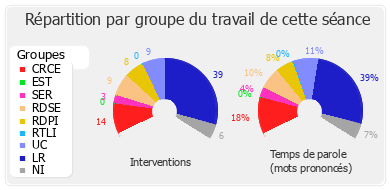Séance en hémicycle du 2 octobre 2012 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Questions orales (voir le dossier)
- Publication par les entreprises françaises de leurs comptes à chaque fin d'année auprès des greffes (voir le dossier)
- Détournement des règles communautaires de détachement des travailleurs dans le secteur du bâtiment (voir le dossier)
- Évolution de la procédure de reconnaissance en l'état de catastrophe naturelle pour les phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols (voir le dossier)
- Taxe sur les salaires du groupement d'intérêt public de la maison départementale des personnes handicapées de la manche (voir le dossier)
- Difficulté d'interprétation juridique relative à l'aide à la prise des médicaments assurée par les assistants maternels (voir le dossier)
- Mise à 2 x 2 voies totale de la rcea entre montmarault et mâcon et paray-le-monial chalon-sur-saône (voir le dossier)
- Communication relative à une commission mixte paritaire
- Débat sur l'application de la loi pour l'égalité des droits et des chances la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (voir le dossier)
- Débat sur l'économie sociale et solidaire (voir le dossier)
- Demande de procédure simplifiée pour l'examen d'un projet de loi
- Débat sur l'application de la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (voir le dossier)
- Ordre du jour (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, auteur de la question n° 63, transmise à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Madame la ministre, j’ai attiré l’attention de M. le ministre du redressement productif sur la situation préoccupante des producteurs autonomes d’hydroélectricité exploitant des centrales. En effet, les contrats d’achat de ces derniers risquent d’être interrompus si les modalités d’application de l’arrêté du 10 août 2012 définissant le programme d’investissement des installations de production hydroélectrique prévu à l’article L. 314-2 du code de l’énergie ne permettent pas d’assurer la continuité entre l’ancien contrat H97 et le nouveau contrat d’achat renouvelé HR97.
Quand M. le ministre a été saisi, le 26 juillet 2012, les problèmes soulevés concernaient le renouvellement des conditions des contrats et l’attente de la publication de l’arrêté.
L’arrêté depuis lors publié au Journal officiel apporte bien une réponse dans la mesure où il prévoit le renouvellement, dans les mêmes conditions, du contrat d’obligation d’achat H97, sous réserve de la réalisation d’un programme d’investissement de 550 à 750 euros par kilowatt installé étalé sur une période de huit ans.
Il n’en demeure pas moins que persiste une préoccupation importante : la continuité temporelle entre les contrats H97 qui arrivent à échéance en octobre 2012, soit ce mois-ci, et les nouveaux contrats renouvelés.
S’agissant d’un renouvellement de contrat, il convient d’assurer aux producteurs concernés la possibilité de continuer à livrer leur production dans le périmètre d’équilibre de l’acheteur obligé, dans la continuité de leur contrat actuel, sans avoir à écouler, même temporairement, leur production sur le marché, voire à interrompre leur production.
Ces modalités permettraient d’articuler intelligemment et avec souplesse l’instruction par les DREAL, les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, des certificats ouvrant droit à l’obligation d’achat, la signature du contrat d’achat HR97 délivré par EDF Obligation d’achat et le rattachement des installations concernées au périmètre d’équilibre de l’acheteur.
En effet, compte tenu des délais de publication de cet arrêté pris en application de l’article 3 de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, dite « loi NOME », il serait anormal de faire supporter les conséquences de ce retard aux producteurs qui souhaitent rester sous obligation d’achat.
Aussi, madame la ministre, quelles réponses positives pouvez-vous apporter aux producteurs autonomes d’hydroélectricité, dont les sollicitations sont, de mon point de vue, très légitimes ?
Madame la sénatrice, je vous remercie de m’interroger sur une question essentielle pour la petite hydroélectricité française et pour de nombreux territoires ruraux et de montagne.
En effet, nous souhaitons développer les énergies renouvelables et décarbonées, qui permettent déjà à la France de disposer, avec l’hydroélectricité, d’un socle de production.
Il s’agit là aussi d’une énergie décentralisée, ancrée dans les territoires et créatrice d’emplois non délocalisables.
L’histoire des quelque 1 700 petites centrales d’hydroélectricité en France est liée à l’histoire de nos montagnes et de leurs vallées, à leur aménagement et à leur développement économique. Si les très petites centrales hydroélectriques assurent 2 % de la production hydroélectrique totale, ces installations représentent 61 % du nombre d’ouvrages hydroélectriques situés sur les rivières françaises. Ces microcentrales ont donc un avenir dans notre pays.
Dès mon arrivée au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, j’ai été interpellée par de nombreux élus sur l’urgence à renouveler les contrats d’obligation d’achat des 1 080 petites centrales de production d’hydroélectricité qui arrivent à échéance à partir du mois d’octobre 2012, question que vous me posez vous aussi, madame la sénatrice.
Comme vous l’avez dit, les petites centrales bénéficient de contrats signés en 1997, dits « contrats H97 », d’une durée de quinze ans, qui arrivent à échéance cette année.
Ce sont d’ailleurs les sénateurs qui, dans la loi NOME, ont proposé et voté le renouvellement de ces contrats, sous réserve que des investissements soient réalisés par les exploitants, dans des conditions définies par arrêté.
Cette disposition, qui figure à l’article 3 de ladite loi, fait exception au principe selon lequel une installation ne peut bénéficier qu’une seule fois d’un contrat d’obligation d’achat, les investissements étant supposés être amortis à l’échéance du contrat.
En concertation avec les fédérations de producteurs d’hydroélectricité, j’ai arrêté un projet de texte, après que le Conseil supérieur de l’énergie a rendu son avis en juillet dernier.
Il fallait faire vite si l’on voulait renouveler et signer les contrats avant leur terme. Il s’est également agi de trouver le bon équilibre de façon que les conditions économiques restent raisonnables et compétitives et qu’elles n’induisent ni effet d’aubaine ni incitation excessive à des investissements non adaptés.
À cet égard, je rappelle que la différence de prix entre le tarif fixé par l’État dans le cadre de l’obligation d’achat et le prix de marché de l’électricité est compensée aux acheteurs via la contribution au service public de l’électricité, la CSPE.
L’arrêté que j’ai signé le 10 août dernier et qui est paru au Journal officiel du 5 septembre 2012 fixe un montant d’investissement en fonction de la taille des installations, ainsi qu’une période de huit ans pour l’étalement de ces investissements, dans un souci de mise à niveau des installations, en fonction des nouvelles exigences réglementaires et environnementales.
Afin de ne pas pénaliser les centrales ayant déjà investi dans la période récente, l’arrêté a prévu un certain nombre d’aménagements.
Tout d’abord, l’exigence de réaliser les investissements avant l’entrée en vigueur du nouveau contrat, envisagée par le précédent gouvernement, a été écartée.
Ensuite, le montant des investissements lancés sous le régime du précédent contrat mais non encore achevés peut être intégré aux investissements à réaliser.
Ces aménagements ont permis de prendre en compte la situation particulière de chaque installation, tout en garantissant une harmonisation du parc et une rémunération adéquate de l’électricité produite.
Afin de renforcer les moyens de suivi et de contrôle de la réalisation de ces investissements, l’arrêté prévoit que le producteur fournit un plan d’investissement au début de son contrat, un rapport intermédiaire après quatre ans et un rapport récapitulatif au bout de huit ans. Le préfet pourra réaliser des contrôles.
Outre la nécessité de veiller à la bonne utilisation des deniers publics, ce contrôle et ce suivi dans le temps mis en place par l’arrêté du 10 août dernier permettront aux services de l’État de constituer une base de données fiables sur la situation des 1 080 centrales.
Les services de mon ministère, en liaison avec les opérateurs compétents, travaillent depuis cette date à la mise en œuvre rapide et efficace de cet arrêté, afin d’assurer une transition sans heurt entre les anciens et les nouveaux contrats d’achat.
Un premier projet de contrat type a ainsi été élaboré par EDF Obligation d’achat, puis soumis à la consultation des fédérations de petits producteurs d’hydroélectricité au début du mois de septembre. La réunion de concertation entre la direction de l’énergie et les fédérations qui s’est tenue le 20 septembre dernier a notamment permis d’aborder la question de la continuité entre les anciens contrats et les nouveaux contrats dits « renouvelés », que vous avez évoquée.
La possibilité de prévoir une entrée en vigueur du contrat d’obligation d’achat antérieure à la date de signature de celui-ci est en cours d’analyse par mes services. Cette pratique autorisée par la Commission de régulation de l’énergie, ou CRE, a déjà été mise en œuvre par le passé. Elle me semble constituer la meilleure solution. Elle serait susceptible de garantir les intérêts des petits producteurs, tout en veillant à ce que les exigences d’investissement soient bien remplies. Ainsi, ces derniers ne seraient pas tributaires du retard que vous avez évoqué.
En parallèle, j’ai donné des instructions précises aux DREAL en vue d’une application homogène des règles sur tout le territoire, et ce dans les meilleurs délais.
Tous ces éléments sont, me semble-t-il, de nature à vous rassurer, madame la sénatrice.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse, qui m’a effectivement rassurée et devrait apporter des satisfactions à tous les agents économiques concernés.

La parole est à M. Jean-Marc Pastor, auteur de la question n° 48, transmise à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Madame la ministre, les antennes-relais implantées dans mon département par les opérateurs de téléphonie mobile suscitent de la part de la population de nombreuses interrogations et des craintes. C’est vrai à Rivières et à Carmaux dans le Tarn, mais aussi dans bien d’autres communes du territoire français.
Ainsi, les riverains demandent que les puissances d’exposition aux radiofréquences soient diminuées à partir des stations de base et que tous les types de couverture ne soient plus centralisés sur les mêmes implantations.
Ils ont fait réaliser des mesures par le Centre de recherche et d’information indépendantes sur les rayonnements électromagnétiques, dont les résultats établissent des risques d’effets physiopathologiques en raison de valeurs souvent supérieures à 1 volt par mètre, voire à 3 volts par mètre. Ils ont donc demandé aux opérateurs de baisser la puissance de leurs antennes, sans succès jusqu’à présent.
La ville de Carmaux a par ailleurs été assignée par un opérateur devant le tribunal administratif en raison d’une délibération de la commune prévoyant une concertation préalable à tout projet de déploiement sur son territoire.
En avril 2012, nous avons rencontré à la mairie les représentants de trois opérateurs : Orange, SFR et Bouygues Telecom. Ces derniers ont fait état du Grenelle des ondes et d’une modélisation effectuée à partir d’une expérimentation sur des sites pilotes au titre de laquelle la ville de Carmaux s’était d’ailleurs portée candidate, mais n’avait pas été retenue. D’après les résultats de cette modélisation, on aboutirait à 80 % de perte de service ; je n’ai cependant pas eu connaissance des résultats de l’expérimentation faite dans le xive arrondissement de Paris.
Pour les opérateurs, l’augmentation du trafic pose un problème de couverture et de saturation. Selon eux, il faudrait ajouter des antennes-relais sans diminuer leur puissance. Les citoyens s’inquiètent : la multiplication du nombre d’antennes permettrait-elle de limiter le seuil d’exposition à un niveau raisonnable ?
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ou ANSES, donne un élément supplémentaire dans la réponse que son directeur général m’a faite récemment. Elle précise qu’une réduction de la puissance des antennes-relais est souhaitable, mais attire l’attention sur les conséquences, pour la population en général et pour les utilisateurs de la téléphonie mobile en particulier, d’une telle réduction qui pourrait conduire à une augmentation de l’exposition de la tête aux radiofréquences émises par les téléphones mobiles.
Madame la ministre, envisagez-vous d’actualiser la réglementation en vigueur en France de telle sorte que les seuils d’émission soient abaissés tout en évitant une augmentation de l’exposition de la tête aux radiofréquences ?
Monsieur le sénateur, je vous remercie de me permettre de préciser la politique du Gouvernement sur un sujet sensible pour les élus locaux et nos concitoyens dans la mesure où il donne lieu à de nombreux contentieux dans les territoires.
L’insertion des antennes de téléphonie mobile dans le cadre urbain et dans les campagnes est un enjeu en termes d’urbanisme et de préservation des paysages ainsi qu’en termes sanitaires et d’information des élus et de la population.
Lors de la conférence environnementale, les enjeux de la santé environnementale ont été, pour la première fois, érigés en axes de travail prioritaires du Gouvernement pour la durée du quinquennat.
En matière d’installation d’antennes-relais de radiotéléphonie mobile, le principe de précaution fait l’objet de jurisprudences parfois contradictoires. Toutefois, il est aujourd’hui évident qu’une maîtrise des émissions d’ondes électromagnétiques s’impose pour répondre à des enjeux sanitaires.
Il est également incontestable que la concertation avec les élus locaux, pour devenir exemplaire, doit être assurée en amont des projets d’installation.
Voilà pourquoi le Gouvernement a pris un certain nombre de décisions, que je tiens à rappeler.
Tout d’abord, en matière de recherche scientifique, les effets sanitaires nécessitent encore des travaux d’expertise, en particulier dans le domaine de l’électro-sensibilité.
Lors de la conférence environnementale, le Premier ministre s’est engagé à assurer l’indépendance des experts scientifiques dont nous avons besoin pour avancer sur ces questions.
C’est la mission de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail que de mettre régulièrement à jour une synthèse des connaissances scientifiques publiées dans l’ensemble de la littérature internationale.
Dans son rapport du 15 octobre 2009 sur les radiofréquences, l’ANSES indique que les niveaux d’exposition liés à l’utilisation intensive d’un téléphone mobile sont très supérieurs aux niveaux d’exposition relevés à proximité des antennes relais.
Elle en conclut qu’il faut recommander prioritairement l’application du principe de précaution pour l’utilisation par les enfants des téléphones mobiles.
Elle souligne même qu’un abaissement des seuils d’émission des antennes pourrait avoir des conséquences négatives sur l’exposition des utilisateurs de téléphones mobiles aux champs électromagnétiques.
Toutefois, comme les connaissances scientifiques peuvent évoluer rapidement dans ce domaine, le Gouvernement a demandé à l’ANSES, à l’issue de la récente conférence environnementale, de mettre à jour rapidement son expertise de 2009 sur les effets sanitaires des radiofréquences.
J’attends la remise de ce nouveau rapport, qui sera naturellement rendu public, pour le début de l’année 2013.
Je précise que le budget annuel de 2 millions d’euros dont dispose l’ANSES pour financer les travaux de recherche dans ce domaine sera maintenu dans le projet de loi de finances pour 2013.
Parallèlement, le Gouvernement a décidé de poursuivre les expérimentations d’abaissement de puissance des antennes relais, conformément aux préconisations formulées par le député François Brottes dans son rapport de 2011 sur la diminution de l’exposition aux ondes électromagnétiques émises par les antennes relais de téléphonie mobile.
Éventuellement, des valeurs cibles intermédiaires autres que 0, 6 volt par mètre pourraient être définies.
Les travaux d’expérimentation ont d’ores et déjà permis de mesurer que, dans quatorze quartiers de villes ou de villages, environ 95 % des niveaux d’exposition sont inférieurs à 1, 5 volt par mètre et 99, 5 % d’entre eux sont inférieurs à 5 volts par mètre.
Les valeurs que vous avez citées, monsieur Pastor, sont donc tout à fait représentatives. Je vous rappelle qu’elles restent très inférieures aux valeurs limites réglementaires.
Il est vrai qu’en quelques points géographiques isolés, dits atypiques, les niveaux d’exposition sont sensiblement plus élevés ; mais ils restent inférieurs aux valeurs limites. Le Gouvernement soutient les travaux en cours pour l’identification, la définition et le traitement spécifique de ces points atypiques. En effet, partout où les émissions peuvent être réduites sans que cela porte préjudice à la qualité du service, cela doit être fait.
J’ajoute que j’ai fait inscrire dans le projet de loi de finances pour 2013 une disposition qui concrétisera enfin la création du fonds public dédié au financement des mesures de champs électromagnétiques réalisées par les organismes indépendants accrédités.
La mise en place de ce fonds est une volonté du législateur, exprimée à la suite de l’adoption de plusieurs amendements à la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dite Grenelle 1.
Ce fonds public est alimenté par une contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, applicable aux stations radioélectriques.
L’article 26 du projet de loi de finances pour 2013 prévoit d’affecter le produit de cette taxe à l’Agence nationale des fréquences, ce qui devrait permettre une mise en œuvre optimale du dispositif.
Je veillerai à ce que l’ensemble des dispositions réglementaires nécessaires à l’entrée en vigueur effective de ce mécanisme soient publiées avant la fin de l’année 2012.
Le Gouvernement sera en mesure de présenter, d’ici au mois de juin 2013, les conclusions qu’il tire des études scientifiques, des expérimentations d’abaissement de puissance, de la finalisation de l’expérimentation de nouvelles procédures de concertation préalable à l’installation d’antennes relais et du nouvel avis de l’ANSES.
Ces conclusions pourront nous conduire à proposer de nouvelles dispositions législatives et réglementaires, tant pour améliorer la concertation au sujet des projets d’implantation que pour diminuer l’exposition des riverains aux ondes électromagnétiques, notamment aux points dits atypiques où les champs sont les plus élevés.

Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse.
Vous avez bien cerné la difficulté : il faut concilier le souci d’une couverture parfaite pour la téléphonie mobile, qui est un service à apporter à la population, et l’acceptation sociale des équipements nécessaires, dont l’installation suscite parfois des oppositions très dures.
Nous devons respecter le principe de précaution ; j’ai bien compris, en vous écoutant, que vous l’aviez parfaitement capté…
Nous serons particulièrement attentifs aux travaux de l’ANSES dont les résultats seront publiés au début de l’année 2013.
Nous serons encore plus attentifs aux propositions que vous ferez au mois de juin 2013 pour apporter les modifications législatives et réglementaires nécessaires.

La parole est à M. Philippe Madrelle, auteur de la question n° 2, adressée à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Monsieur le président, le vignoble girondin, premier producteur mondial de vin d’appellation d’origine contrôlée, ou AOC, n’échappe pas aux effets de la crise mondiale.
Depuis 2008, les ventes ont globalement diminué. Seuls les premiers grands crus classés, comme d’ailleurs tous les produits de luxe, se portent bien.
Il ne faudrait pas – et je sais, monsieur le ministre, que vous en êtes parfaitement conscient – que cette vitrine de luxe dissimule une réalité très hétérogène : en effet, sur 728 millions de bouteilles vendues en 2011, les grands crus prestigieux n’étaient que quelques millions de bouteilles.
Cette vitrine de l’exportation cache la situation de grande précarité dans laquelle se débattent actuellement de trop nombreux viticulteurs. Ceux-ci ont dû et doivent encore faire face à la baisse des cours et à l’augmentation des stocks, la montée en puissance des achats asiatiques étant loin de concerner l’ensemble des producteurs.
Il est patent que l’organisation commerciale des viticulteurs est inadaptée au marché, notamment dans le domaine du vrac : la multiplicité des acteurs vignerons, des caves coopératives et des négociants amplifie la baisse des prix face à une distribution puissante et hyper-concentrée.
Le conseil général de la Gironde, que j’ai l’honneur de présider, a mis en place deux plans triennaux de soutien à la filière viticole.
De très nombreux viticulteurs vivent actuellement dans une grande précarité ; certains même survivent avec le revenu de solidarité active versé par le conseil général.
Par ailleurs, n’oublions pas que de trop nombreux viticulteurs ont dû consentir de gros efforts d’investissement pour se conformer aux contraintes imposées par la réforme des conditions de production. De ce fait, et faute de financements adaptés aux structures de taille modeste, de nombreuses exploitations se trouvent aujourd’hui étranglées.
Ces viticulteurs ne refusent pas de payer la cotisation volontaire obligatoire, mais ils contestent des inégalités trop importantes au sein d’une même région viticole. En effet, si cette contribution est payée par tous les viticulteurs, ils n’en tirent pas tous le même profit.
La contribution par hectolitre s’élève à 4, 72 euros pour le bordeaux AOC, à 7, 79 euros pour le Saint-Émilion AOC et à 10, 39 euros pour le Saint-Émilion Grand Cru.
Entre les appellations les plus modestes et les plus prestigieuses, il y a donc un facteur multiplicateur de 2, alors que le prix de vente du vin peut être multiplié par 100, voire davantage !
Pour qu’un barème plus équitable puisse être défini, il faudrait d’abord que toutes les interprofessions françaises, en particulier le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, enregistrent l’ensemble des transactions en vrac et en bouteilles, et non pas seulement les transactions réalisées en vrac.
Cette mesure, qui n’a aucune conséquence financière, apaiserait un climat tendu et permettrait de mettre à la disposition des syndicats viticoles et agricoles des informations claires et précises, sans porter atteinte à la confidentialité des données recueillies.
On comprend parfaitement le souhait de ces viticulteurs d’une répartition plus égalitaire des contributions volontaires obligatoires et d’une information transparente sur l’utilisation de ces fonds, qu’ils souhaiteraient voir affectés en priorité à la viticulture.
J’ajoute qu’une confirmation du projet de libéralisation des droits de plantation proposé par la Commission européenne et approuvé en 2008 par les ministres européens de l’agriculture – la France était alors représentée par M. Barnier – serait catastrophique.
Je vous remercie vivement, monsieur le ministre, pour la vigueur avec laquelle vous combattez ce projet.
La partie n’est pas gagnée mais, alors que le compte à rebours est lancé, je sais que nous pouvons compter sur votre détermination comme sur celle du Gouvernement pour réunir une majorité qualifiée au sein du Conseil des ministres de l’Union européenne afin de revenir sur cette libéralisation.
Dans ces conditions, chacun comprendra que le climat n’est pas nécessairement serein au sein de nos vignobles girondins, d’autant que l’on s’attend à une baisse de la récolte 2012, en Gironde comme ailleurs.
Monsieur Madrelle, je veux reprendre à mon compte un certain nombre de vos remarques.
D’abord, il ne faudrait pas oublier que la viticulture, comme beaucoup de secteurs d’activité, souffre actuellement de la crise.
Comme vous l’avez indiqué dans votre conclusion, la récolte sera historiquement basse en 2012. Au moins pouvons-nous nous consoler à la pensée qu’il en sera de même partout dans le monde, de sorte que le risque est moindre pour nous de perdre nos parts de marché, qui sont très importantes.
À propos des contributions volontaires obligatoires dans le Bordelais, je rappelle que les interprofessions ont, par définition, la liberté de fixer leurs règles et qu’il est difficile à l’État d’interférer avec leurs choix. Le rôle de l’État est seulement de garantir le caractère obligatoire de la contribution.
Toutefois, j’ai bien écouté votre démonstration au sujet du barème en vigueur : entre les différentes appellations, les écarts ne correspondent pas à la valeur ajoutée liée à la production de tel ou tel vin. Peut-être conviendrait-il que nous entamions une discussion avec les interprofessions ? L’État n’a pas le pouvoir de prendre une décision, mais il peut favoriser l’évolution des choses dans le dialogue. Il est certain qu’une répartition plus équilibrée serait à mes yeux souhaitable. Les interprofessions ont un rôle à jouer.
Je sais qu’un plan important, « Bordeaux demain », a été mis en place pour valoriser la filière sur le plan commercial.
Comme vous l’avez très bien dit, monsieur Madrelle, nous avons besoin de mieux nous organiser. Même dans une grande région viticole comme le Bordelais, dont les performances commerciales sont importantes et l’histoire ancienne, des progrès sont encore possibles ; je crois d’ailleurs que c’est aussi le cas dans d’autres régions.
À un moment ou à un autre, nous devrons avoir une discussion globale sur cette question avec l’ensemble des acteurs de la viticulture.
Il y a aussi des enjeux majeurs à l’échelle européenne, en particulier sur la question des droits de plantation.
Je mène cette bataille avec d’autres pays et j’espère bien faire prévaloir une position qui me semble parfaitement évidente : le vin n’est pas un produit comme les autres. On ne peut pas considérer que seuls les signaux du marché peuvent fixer les volumes de production ; la production de vin a besoin d’être organisée.
Avec la plateforme signée par une dizaine de pays, j’espère bien peser sur la Commission européenne pour que la décision prise en 2008 soit remise en cause.
Peut-être savez-vous qu’il y a une autre bataille au sujet de l’appellation « château ». Je suis monté au créneau pour dire tout le mal que je pense de la décision de la Commission européenne, en particulier des conditions dans lesquelles elle a été prise, et pour tâcher de la faire évoluer.
Comme vous, je suis très attaché à la viticulture. Je pense qu’elle représente un atout majeur pour notre pays et que nous devons lui donner les moyens d’être performante en matière économique et écologique, pour qu’elle reste le fleuron de la représentation de notre pays partout dans le monde !

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, qui me satisfait tout à fait.
Nous savons que vous êtes conscient de toutes les difficultés de la viticulture et nous comptons sur votre détermination.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, auteur de la question n° 4, adressée à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur l’artificialisation des espaces agricoles, qui ne cesse d’augmenter.
En décembre dernier, déjà, à l’occasion de la semaine de la préservation de l’espace foncier agricole, organisée par les Jeunes agriculteurs, des chiffres alarmants ont été rendus publics : la France perd 26 mètres carrés de terre agricole par seconde, soit près de 80 000 hectares par an, ce qui fait un département tous les cinq ans !
Cette évolution est deux fois plus rapide que dans les années soixante, où quelque 40 000 hectares étaient urbanisés chaque année.
Dans l’Aisne, 57, 3 % du territoire est occupé par des terres cultivées ; cette proportion est de 60, 2 % dans l’ensemble de la Picardie.
Le président d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, une SAFER, m’a confirmé que la France consommait deux fois plus de terres périurbaines que nos partenaires européens, notamment allemands.
L’homme s’est historiquement installé sur des terres fertiles, et les villes ont grossi autour de ces premières implantations.
Les sols de très bonne qualité agronomique représentent déjà un tiers des surfaces artificialisées.
Notre collègue Yvon Collin, dans l’excellent rapport d’information sur le défi alimentaire à l’horizon 2050 qu’il a récemment rédigé au nom de la délégation à la prospective, souligne que, à ce rythme, la surface agricole naturelle aura reculé de 3, 4 millions d’hectares en 2050, ce qui représente 12 % de la surface occupée actuellement par les exploitations.
Il est par ailleurs clair que, devant l’ampleur de l’extension urbaine, certains acquéreurs n’hésitent pas à spéculer sur le changement d’usage des terres.
C’est la raison pour laquelle certains maires de zones rurales, et aussi nombre d’agriculteurs, soutenaient la loi du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire, qui pouvait faire espérer un apaisement de la pression immobilière sur les zones agricoles périurbaines.
Au contraire, la tendance récente est à la hausse du prix de la terre agricole : en 2011, la disponibilité des terres libres s’amenuisant, les prix ont été poussés à la hausse, rendant d’autant plus difficile l’installation de nouveaux agriculteurs.
Cette tendance à la hausse semble inéluctable à long terme, la terre agricole étant de plus en plus prisée tant pour sa production que pour sa qualité de valeur refuge pour les investisseurs. Son prix a augmenté de 40 % depuis 1997 pour s’établir à 5 430 euros par hectare en moyenne.
Les SAFER disposent de moyens pour sauvegarder les terres agricoles, mais leur action se heurte à l’opacité des ventes de parts de société agricole. Dans ces transactions, en effet, ni l’État, ni les collectivités locales, ni les SAFER ne sont informés de l’identité des acquéreurs.
Monsieur le ministre, quelle est l’ampleur du marché des parts de société agricole et qu’en est-il de l’éventuel danger d’achats massifs de terres françaises par des acteurs financiers ou des fonds étrangers, dont s’inquiète à juste titre la fédération nationale des SAFER ?
À l’occasion de la préparation de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre dernier, la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, ou FNSEA, se serait montrée volontariste sur une politique de préservation du foncier agricole.
En sera-t-il question dans le futur projet de loi sur l’urbanisme qui devrait être présenté par Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement au cours de l’année 2013 ?
J’ajoute que, dans son communiqué de presse tout récent, l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture insiste sur « l’urgence de freiner le processus de consommation des sols qui entraîne une perte de production, une baisse de potentiel de la biodiversité et une accumulation des contraintes sur le foncier agricole ».
À l’heure où la demande alimentaire mondiale ne cesse d’augmenter, l’enjeu stratégique que représente l’espace agricole en commande une gestion durable.
En outre, la fin programmée du « tout pétrole » promet un bel avenir aux agrocarburants ; il faudra donc produire davantage et, pour cela, posséder la terre !
La préservation du potentiel agricole est une notion nouvelle et primordiale à prendre en compte. Ainsi, certains proposent que la taxe sur le changement de destination des espaces agricoles soit augmentée au moins de 10 % à 15 %, seuil qui serait dissuasif, mais aussi que les nouvelles commissions départementales de classement des terres mises en place par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, dite LMA, du 27 juillet 2010 donnent un avis plus contraignant que simplement consultatif.
Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous puissiez apporter des garanties sur votre volonté de limiter l’accaparement des terres agricoles.
Monsieur le sénateur, ce sujet de l’« artificialisation » des terres agricoles a déjà fait beaucoup parler ! En effet, un département disparaîtrait tous les cinq, six ou sept ans, et c’est un rythme que l’on ne peut plus accepter.
En effet, la terre agricole, c’est notre capacité à produire des biens agricoles et donc des biens alimentaires. Elle doit être préservée d’une consommation s’apparentant plus, depuis des années, à un gaspillage. Effectivement, on a gaspillé de l’espace.
Parmi les pays d’Europe, la France a la surface la plus importante de terres agricoles, et l’on a cru que ces espaces pouvaient être consommés sans limite. Aujourd’hui, il est temps de dire « stop » ! Tel était l’objet de la conférence environnementale que vous avez citée et dont un objectif clairement indiqué était de mettre fin à cette « artificialisation » et à ce gaspillage des terres agricoles.
Nous allons travailler sur les pistes que vous avez évoquées, à savoir la commission départementale de classement des terres et l’augmentation de la taxe sur le changement de destination des espaces agricoles. Cette question sera abordée à l’occasion de l’examen tant du projet de loi sur le logement, qui sera défendu par Cécile Duflot, que de la loi d’avenir de l’agriculture. Ce sujet, que vous avez parfaitement décrit, est en effet majeur, car on ne peut plus accepter que les terres agricoles changent de destination et soient consommées sans limite.
Ainsi, les parkings des zones commerciales s’étendent de manière insensée, leur surface étant calculée pour des heures de pointe qui représentent à peine deux, trois ou quatre heures au plus dans la journée, voire dans la semaine. C’est parfaitement inacceptable ! Il faudra, là aussi, voir comment limiter la consommation qui « artificialise » l’espace et qui engendre des problèmes liés à la pollution, à la gestion de l’eau.
La meilleure des réponses que je puisse apporter à votre question, monsieur le sénateur, est l’affirmation de ma totale détermination à aboutir sur ce sujet-là.

Je vous remercie, monsieur le ministre : j’ai bien senti dès le début de votre propos que votre détermination était totale.
Je suis bien sûr prêt à vous accompagner, vous et vos services, dans le développement des idées nécessaires à l’arrêt de cette artificialisation, qui, vous l’avez souligné, est source de craintes pour l’avenir.

La parole est à M. Yannick Botrel, auteur de la question n° 30, adressée à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement.

Madame la ministre, je tiens tout particulièrement à attirer votre attention sur la situation créée pour la réalisation de projets de construction de logements sociaux et adaptés. Je prendrai pour exemple les projets qui, dans mon département des Côtes-d’Armor, font l’objet d’une remise en cause du fait de la réalisation d’un classement par priorité des territoires, mieux encore des communes. Cette situation a avant tout pour origine le désengagement national, inscrit dans la loi de finances pour 2012, en matière de financement du logement social.
À cet égard, les organismes de construction de logements sociaux et adaptés ont, en premier lieu, à assumer un prélèvement sur leurs fonds propres, ce qui représente pour Côtes-d’Armor-Habitat la somme de deux millions d’euros. À cette ponction s’ajoute le manque de crédits d’État devant abonder les projets de construction de logements sociaux neufs.
En gestion de la pénurie, la répartition de l’allocation des fonds s’est organisée à travers une cartographie. Ce schéma, établi selon des critères multiples, doit rendre compte de la tension du marché de l’habitat, déterminant du même coup les communes éligibles et, a contrario, celles qui se trouvent exclues de fait.
Sans remettre en cause l’établissement des critères qui, n’en doutons pas, ont dû faire l’objet d’études approfondies, les conclusions cartographiques mettent en évidence des tensions d’accès au logement uniquement dans les zones les plus peuplées. Ainsi, dans les Côtes-d’Armor, seuls les secteurs côtiers, à deux communes près, sont identifiés comme étant les plus peuplées. Seules ces zones très tendues verront donc leurs projets retenus.
Je tiens à souligner le caractère très discriminant de l’exercice, puisque seul le périmètre communal est pris en considération. Ainsi, deux communes mitoyennes, reliées entre elles par des moyens de transport public, répondant aux mêmes demandes de logement social et adapté, n’ont pas des chances équivalentes de voir leurs programmes se réaliser. Les élus locaux dénoncent à juste titre un traitement purement technique des demandes, s’appuyant sur la cartographie communale que je viens de décrire et ne comportant aucune disposition pour garantir l’équilibre des territoires.
Cette situation, si elle devait perdurer, conforterait à terme les zones les plus peuplées, écarterait les possibilités d’habitat locatif social et adapté dans les zones plus rurales, où il existe pourtant une vie économique et où la demande de logements, bien que moindre, est réelle. Les locataires sociaux potentiels déserteraient les territoires ruraux, parfois même les territoires périurbains.
Madame la ministre, quelles mesures pourriez-vous mettre en œuvre pour que les projets de constructions de logements sociaux et adaptés déjà engagés aboutissent et que, plus largement, puisse subsister une équité territoriale en termes de constructions locatives sociales, répondant aux besoins spécifiques des populations concernées ?
Monsieur le sénateur Yannick Botrel, le sujet que vous soulevez sera examiné lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2013, dans lequel les crédits en faveur de la construction de logement social seront significativement renforcés du fait d’une mobilisation sans précédent.
Par ailleurs, s’agissant de la répartition des crédits, point particulier sur lequel vous avez attiré mon attention, j’ai décidé la mise en place d’observatoires au plus près des territoires. Ces observatoires permettront de sortir de la logique de zonage existante, qui vise à limiter les zones d’intervention prioritaires sur un certain nombre de communes avec une actualisation évidemment beaucoup plus difficile, pour identifier les secteurs les plus tendus sur un plan général en termes de besoins en logements, ainsi que les secteurs les plus tendus socialement, ceux qui ne sont pas toujours identifiés mais où la demande sociale pour l’offre est très importante, alors que le parc actuel ne répond pas aux besoins, notamment aux besoins sociaux.
La nouvelle politique en matière de logement social permettra donc de répondre à vos demandes sur ce plan.
Elle vise également à mettre en œuvre un versant en faveur des publics spécifiques, avec des logements adaptés pour les personnes tant en situation de handicap qu’en situation de vieillissement. C’est dans ce cadre-là qu’un partenariat sera signé avec l’Union sociale pour l’habitat, afin de mettre en œuvre, dès 2013, 10 000 logements spécifiques qui seront répartis sur l’ensemble des territoires.
Je tiens d’ailleurs à indiquer que, dans la région Bretagne, le préfet a pris l’initiative d’une démarche de zonage beaucoup plus précis et d’une identification dans le cadre des documents existants, en particulier les programmes locaux de l’habitat, ou PLH, qui sont nombreux dans votre région, pour identifier les besoins spécifiques au plus près des territoires et pour apporter les réponses nécessaires en fonction des besoins tels qu’ils s’expriment et non d’une vision administrée ou supraterritoriale.
Toutes ces démarches permettront, me semble-t-il, de répondre à la question que vous avez posée, qui est bien évidemment cruciale et qui nécessite une réponse nuancée et différente selon les territoires. C’est bien tout le sens de la politique en matière de logement, en particulier de logement spécifique, que je porte au nom du Gouvernement.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse qui est précise, argumentée, et qui démontre une bonne connaissance de la problématique que j’ai tenu à souligner à travers la question que je vous ai posée.
Personne ne peut le contester, certains territoires ont des attentes plus fortes que d’autres. Cela ne signifie pas pour autant – vous en avez donné un exemple dans votre réponse – que des besoins ne se manifestent pas ailleurs, particulièrement dans des zones rurales où, parfois, des personnes âgées sont isolées socialement, assez loin des commerces et des administrations dont elles souhaitent se rapprocher. Cela se fait dans les bourgs de façon très générale. Dans des communes rurales situées entre deux bassins d’emplois, la demande de personnes à faibles revenus voulant se loger est également justifiée.
Par conséquent, la réponse du Gouvernement va tout à fait dans le sens de ce que je souhaitais entendre et que j’ai entendu.

La parole est à M. Philippe Dominati, auteur de la question n° 84, adressée à Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement.

Madame la ministre, au cours des derniers siècles, Paris et la région capitale ont connu quatre révolutions majeures : Haussmann et sa transformation de Paris, Charles de Gaulle et la création de huit départements en 1965, Giscard d’Estaing et sa volonté de donner un maire à Paris et, d’une manière générale, de faire évoluer le pouvoir régional, enfin Nicolas Sarkozy et le projet de Grand Paris, auquel il a donné une impulsion nouvelle, contemporaine, correspondant à la région moteur de notre pays.
Cette impulsion devait normalement reposer sur trois principes : une gouvernance, un périmètre et un budget. Mais, au fur et à mesure, la concrétisation de l’intention présidentielle a été détournée par les ministres successifs. Je dirai que, pour l’instant, le Grand Paris est essentiellement un projet technique ou technocratique, avec une société d’État, un système de transport, des investissements disséminés dans la recherche, dans le développement économique ou éventuellement le logement, et qu’il manque de cohésion.
Il appartient au nouveau président de la République de poursuivre l’impulsion donnée par son prédécesseur, de s’attaquer au problème institutionnel, au problème financier et peut-être au problème technique, qui est le plus engagé, celui des transports.
Ma question, en ce début de mandature, est de savoir quelles sont les intentions du Gouvernement, car il y a urgence !
Il y a urgence sur le plan institutionnel, en raison de la remise en cause de la réforme des collectivités territoriales et de la nécessité d’une gouvernance ou d’une cohésion. Votre sensibilité politique ayant tous les pouvoirs –l’État, la région, la ville –, il est donc assez simple de définir éventuellement un projet de gouvernance !
Il y a également urgence sur le plan financier. En effet, pour l’instant, les Parisiens paient, et plus qu’ailleurs. Vous comme moi étions opposés à la taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand Paris. Personnellement, je l’étais, car l’État veut toujours régenter la vie des Parisiens avec peu d’argent et décider à leur place. Allez-vous faire de même ? Sur le plan financier, je souhaite donc savoir ce que vous allez faire concernant l’évolution du réseau de transport.
Sur le plan technique des transports, j’ai dénoncé à plusieurs reprises le fait que, contrairement à toutes les autres régions d’Europe, l’État, en région d’Île-de-France, est tout le temps en retard, car il veut avoir la mainmise sur les transports collectifs.
À trois sociétés d’État, la SNCF, la RATP, RFF, on en a ajouté une quatrième : la Société du Grand Paris. Or il n’y a pas un sou !
Par conséquent, il convient de savoir ce qu’il en est, d’autant que, parallèlement, les pouvoirs du STIF ont été donnés à la région d’Île-de-France. Ma famille politique est à l’origine de cette réforme à laquelle nous avons participé.
Il y a urgence, les mois passent, mais, pour l’instant, c’est le grand silence ! Moins de quatre mois après son élection, Nicolas Sarkozy avait pris une initiative. Je vous demande d’en prendre une à votre tour.
Monsieur le sénateur, votre question recouvre deux sujets : d’une part, la question de la gouvernance du Grand Paris, de l'articulation entre les différents niveaux de collectivités locales ; d’autre part, la question intéressante du rôle de l'État relativement au poids politique des différentes collectivités locales.
Je citerai un premier exemple de rupture avec les pratiques passées : le projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, adopté par le Sénat puis par l’Assemblée nationale voilà quelques jours, a redéfini le lien qui unit les contrats de développement territorial prévus par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et le schéma directeur régional de la région Île-de-France, voté par le conseil régional. L’objectif est de rendre compatibles ces deux documents de manière que l'État n’ait pas à se substituer aux collectivités locales sur les projets d'aménagement qui sont en lien avec les questions de transport.
Les CDT devront désormais être compatibles avec le SDRIF tel qu'il aura été adopté par la région, et cette dernière ainsi que les départements territorialement concernés pourront également, à leur demande, être signataires de ces contrats.
Le Gouvernement a donc la volonté d’associer l'ensemble des acteurs. Considérant que la région d'Île-de-France est aussi la région capitale de notre pays et que, pour cette raison, l'État ne peut s’en désengager, il estime qu’il est de sa responsabilité particulière de remédier autant que faire se peut aux dramatiques sous-investissements chroniques auxquels ont eu à faire face, pendant plusieurs dizaines d’années, les transports en commun.
S’agissant de la gouvernance, le travail mené par Marylise Lebranchu, qui porte non seulement sur la modernisation de l'action des administrations de l'État mais également sur la réforme des collectivités locales et la décentralisation, prendra en compte la situation particulière de l'Île-de-France en tant que région capitale.
Le second volet de votre question porte sur le réseau de transport Grand Paris Express. Ce réseau, comme vous avez eu raison de le souligner, n'est pas au cœur du projet du Grand Paris, projet qui sera porté par l'ensemble des collectivités et par l'État, mais il est un élément important notamment pour les liaisons de banlieue à banlieue. C’est pourquoi il fait actuellement l'objet d'une mission destinée à évaluer son séquençage et son financement. À cet égard, les premiers éléments portés à ma connaissance montrent que le financement prévu pour ce réseau de transport a été sous-évalué et qu'un certain nombre des investissements nécessaires à sa réalisation n'ont pas été pris en considération. En conséquence de quoi, ce projet sera mis en œuvre sur la base d'une évaluation financière très précise et d'un séquençage en fonction de deux objectifs : la desserte des zones d’Île-de-France pour lesquelles les besoins sont les plus criants et le désenclavement des zones d'Île-de-France encore enclavées.
Parce qu’il dépasse la simple question des transports, le financement de ce projet sera garanti par l'État et par l'ensemble des acteurs qui participeront à sa réalisation.
Aussi, monsieur le sénateur, j’espère que vous serez pleinement rassuré.
Sourires.

M. Philippe Dominati. Malheureusement, madame la ministre, vos propos ne m’ont pas tout à fait rassuré. L’exercice est difficile pour vous qui consiste à coordonner l'action de l'État entre plusieurs ministères. En réalité, j'ai le sentiment que vous n’êtes pas en mesure d’apporter des réponses. À votre côté est assis M. le ministre délégué au budget ; il eût été sympathique de sa part de vous faire un clin d'œil pour vous signifier qu’il assurera effectivement le financement du projet dont vous rêvez et dont rêvent les Parisiens.
Sourires.

Malheureusement, la Société du Grand Paris ne dispose à ce jour ni du capital ni des financements requis pour développer ce système de transport.
Sur le plan technique – je reviendrai sur les questions institutionnelles par la suite –, il serait bon que vous mettiez un peu d'ordre. Pourquoi faut-il quatre sociétés d'État pour mettre en œuvre un projet, à la différence de ce qui se passe dans d’autres régions tout aussi performantes dans le service aux usagers, aux habitants et à l'économie régionale ? Pourquoi donc ce millefeuille administratif ? Il faut viser la performance !
Nous avons connu à Paris les projets Éole et Meteor, c'est-à-dire la bagarre entre la SNCF et la RATP. Aucun de ces projets n’a été finalisé, sauf avec vingt ans de retard par tronçon. Allons-nous recommencer, faute de moyens, avec la Société du Grand Paris ?
En outre, à partir du moment où le syndicat des transports d’Île-de-France, le STIF, dispose de moyens et d’un pouvoir régional, pourquoi ne pas en profiter pour mettre à plat cette question des transports ?
Enfin, beaucoup de gens parlent de Paris. Ces enjeux intéressent tout le monde, mais on demande rarement leur avis aux Parisiens. On leur demande juste de payer un impôt nouveau. Je note que vous vous étiez opposée à la création de ce dernier. Aussi, j’espère bien que, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances, vous soutiendrez toute initiative visant à le réduire, d’autant que la Société du Grand Paris, pour l'instant, ne rencontre aucun problème de financement. Cela serait parfaitement justifié puisque nous n’avons aucune information sur le seul tronçon prévu pour Paris intra-muros. Nous avons besoin d'investissements. Dans le XIe arrondissement, on compte 400 habitants par hectare, ce qui n'est pas le cas d’autres zones concernées par le réseau de transport. Pour autant, l'État ne réalise plus aucun investissement dans Paris intra-muros.

La parole est à M. Georges Patient, auteur de la question n° 23, adressée à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Monsieur le ministre, je tiens à attirer votre attention sur la situation financière des communes de Saint-Laurent-du-Maroni et de Roura, en Guyane.
En effet, ces communes, qui connaissent un fort déficit structurel depuis plusieurs années, avec toutes les conséquences négatives qui en découlent sur leurs administrés, notamment des taux élevés d’impôts locaux, se trouvent exclues du dispositif de restructuration mis en place par l’État au profit des communes en difficulté de Guyane, car elles ne disposeraient pas des marges de manœuvre nécessaires au remboursement du prêt que pourrait leur consentir l’Agence française de développement, l’AFD, pivot de ce dispositif sur le plan tant de l’analyse des risques que des conditions de mise en place de ce prêt.
Cependant, ces deux communes demeurent confrontées à une situation financière particulièrement grave en raison de circonstances anormales : une augmentation exponentielle de 74 % de la population administrative de Saint-Laurent-du-Maroni entre 2001 et 2010 qui n’a pas été prise en considération par un recensement non exhaustif et en fort décalage ; une incapacité des services fiscaux à actualiser les bases fiscales communales, et une perte, comme les autres communes de Guyane – c’est en effet une particularité guyanaise –, d’un montant substantiel de recettes d’octroi de mer, à savoir 4, 5 millions d’euros pas an pour Saint-Laurent-du-Maroni et environ 300 000 euros pour Roura.
À défaut de rétrocéder à ces deux communes cette part de recettes d’octroi de mer, ne conviendrait-il pas, monsieur le ministre, de leur appliquer les dispositions de l’article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que des subventions exceptionnelles peuvent être accordées aux communes lorsqu’elles ne sont pas en mesure de rétablir l’équilibre de leurs comptes par leurs propres moyens en dépit de leur effort, notamment fiscal, porté au maximum ? C’est le cas de ces deux communes, qui ont déjà pris des engagements significatifs sur ce point.
Ces subventions exceptionnelles, venant en complément, permettraient de susciter l’élaboration de plans de restructuration, comme l’explique le directeur général de l’AFD dans sa réponse au rapport de la Cour des comptes sur la situation financière des communes des départements d’outre-mer : « C’est le cas notamment de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, où l’AFD n’a pu intervenir en l’absence d’une subvention exceptionnelle de l’État. »
Monsieur le ministre, quelle réponse pouvez-vous apporter s’agissant de l’application de cet article à ces deux communes de Guyane ?
Monsieur le sénateur, la singularité des situations rencontrées par certaines communes a amené le ministère des outre-mer, M. Victorin Lurel, avec l’appui de l’Agence française de développement, à expérimenter des plans de restructuration lorsque les outils de droit commun avaient atteint leurs limites.
Ces plans auxquels vous avez fait référence, mis en œuvre après un diagnostic approfondi des situations financières et des perspectives de redressement, supposent toutefois que les collectivités ne soient pas surendettées, car l’octroi de nouveaux prêts serait en réalité de nature à aggraver leur situation.
À cet égard, le dispositif prévu par l’article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales ne paraît pas être l’instrument le plus adapté pour accompagner dans la durée les collectivités faisant face à des difficultés structurelles. En effet, cet outil a été institué pour remédier aux difficultés financières conjoncturelles rencontrées par certaines communes, en métropole ou outre-mer. Il est nécessairement limité : pour l’année 2012, les crédits inscrits au budget de l’État au titre des subventions exceptionnelles aux communes en difficulté s’élèvent à 2, 7 millions d’euros. C’est le programme 122 de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
S’agissant plus particulièrement de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, dont la situation financière peut être largement imputée, d’une part, à une démographie particulièrement dynamique nécessitant un développement accéléré des services publics offerts à la population et, d’autre part, à la faiblesse structurelle du niveau des recettes de fonctionnement, plusieurs actions ont déjà été entreprises.
J’en citerai quelques-unes.
D’abord, le recensement des bases fiscales a permis une augmentation du produit des contributions directes de la commune de plus de 31 % entre 2009 et 2012. À cet égard, je salue l’action des élus locaux, sans lesquels ce recensement dont on connaît les conséquences n’aurait pu être mené.
Ensuite, les services de l’État, notamment la préfecture, ont mené des négociations auprès des différents créanciers publics – caisses de sécurité sociale, caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, centre de gestion de la fonction publique territoriale – pour obtenir l’établissement d’échéanciers de paiement des dettes.
Enfin – et cet élément est essentiel –, la création du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le fameux FPIC, devrait être de nature à enclencher un processus de restructuration financière. En effet, monsieur le sénateur, la commune de Saint-Laurent-du-Maroni est bénéficiaire, en 2012, d’une nouvelle recette de 236 000 euros, qui devrait progresser d’ici à 2016, au terme de la montée en charge du dispositif.
Comme vous le savez, le projet de loi de finances pour 2013 porte la dotation de ce fonds de péréquation de 150 millions d’euros à 360 millions d’euros.
L’attribution du FPIC par la direction générale des collectivités locales se fait normalement selon des critères normés et financiers. Au sein d’une même intercommunalité, la répartition se fait elle aussi selon des critères de droit commun normés, mais dont les collectivités membres peuvent s’affranchir au profit de critères ad hoc décidés certes unanimement, mais selon la volonté des élus locaux.
Cette mesure pourrait être de nature à contribuer à la résorption du déficit structurel de la commune et permettrait à cette dernière d’envoyer un message significatif à l’ensemble de ses partenaires dans le cadre de l’accompagnement de son redressement. Elle me paraît nettement préférable à celle que vous avez suggérée, qui n’aurait qu’un effet conjoncturel.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse quant à la manière la plus adéquate de résorber le déficit qu’enregistre la commune de Saint-Laurent-du-Maroni.
Je me permets néanmoins d’insister sur les causes du déficit structurel de cette commune, causes qui tiennent pour l’essentiel à des processus relevant de compétences régaliennes : l’immigration clandestine facilitée par la position de ville frontalière de Saint-Laurent-du-Maroni, qui s’accompagne d’une très forte proportion d’enfants à scolariser avec les dépenses de fonctionnement y afférentes ; l’incapacité des services fiscaux à actualiser les bases fiscales communales, en dépit de progrès. S’agissant de ce dernier point, monsieur le ministre, ces progrès sont à porter au crédit des élus locaux – vous l’avez d’ailleurs reconnu – qui ont mis leurs propres agents à disposition des services fiscaux de l’État.
Ainsi, les pertes de recettes que connaissent les communes de Guyane sont très souvent dues au peu d’efforts que consent l’État pour exercer ses compétences régaliennes. De fait, ces communes ne disposent pas de moyens suffisants pour l’accomplissement de leurs missions de service public.
J’insiste une fois encore sur la revendication légitime des communes de Guyane quant à la restitution de la part d’octroi de mer qui leur est prélevée chaque année. Cela ne concerne que la Guyane, car les communes de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion perçoivent l’intégralité de cette ressource. C’est une perte nette de 27 millions d’euros pour les communes de Guyane, alors même qu’elles ont à mener des missions plus importantes que les autres communes d’outre-mer. Il serait temps que l’on réfléchisse à la rétrocession de ce prélèvement.

La parole est à M. Christophe Béchu, auteur de la question n° 71, adressée à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Monsieur le ministre, ma question porte sur l’obligation qui est faite aux entreprises françaises de déposer annuellement leurs comptes auprès des greffes en vue de leur publication.
La transparence a des vertus ; elle aurait sans doute évité, dans le passé, un certain nombre de scandales qui ont conduit à ce que l’opacité dans laquelle avaient été gérées certaines des entreprises ne soit révélée trop tardivement. On pense évidemment à Enron ou à d’autres cas similaires.
Par conséquent, on comprend bien l’intérêt de cette mesure et l’esprit qui a prévalu lors de l’inscription de son caractère obligatoire dans la loi.
Cette transparence permet de surcroît de rassurer les fournisseurs, les sous-traitants, et donc de concourir à la cohérence et au caractère vertueux de l’environnement économique global.
Mais, monsieur le ministre, on évolue en même temps dans un contexte de compétition. Et voilà un sujet sur lequel nous disposons peut-être de marges de progrès en termes de compétitivité, sans aucune conséquence sur le déficit de l’État, de la sécurité sociale ou sur quelque autre ligne budgétaire que ce soit. Aussi, je me plais donc à vous interpeller sur une question où c’est plutôt le soft power, le pouvoir d’influence, à tout le moins le processus de construction européenne, qui peut permettre de restaurer une certaine réciprocité.
La transparence est problématique si certaines entreprises étrangères ont accès à des données publiées par nos entreprises sans que, dans leur pays, ces sociétés concurrentes soient obligées de publier leurs comptes, donc de fournir les mêmes informations.
Vous me répondrez sans doute, monsieur le ministre, que des textes européens existent sur ce point. Mais ils font l’objet d’une grande disparité à la fois dans leurs modalités d’application et dans les sanctions en cas de non-respect de leurs dispositions.
Les délais varient de un mois à treize mois, selon les pays, pour déposer les documents, de même que varient les mécanismes de relance si les prescriptions ne sont pas respectées. Dans certains cas, seuls des tiers peuvent intervenir, comme en Finlande et en Allemagne ; dans d’autres, c’est à la puissance publique d’intervenir : en Belgique, il faut trois années consécutives de non-publication des comptes pour qu’une éventuelle relance soit possible.
Des disparités existent également, monsieur le ministre, dans les seuils des entreprises concernées : en Irlande, par exemple, les PME ne sont pas obligées de déposer leurs comptes alors que, dans d’autres pays comme l’Autriche, les règles concernant l’obligation de publication sont plus subtiles et dépendent de la législation du pays d’origine de la société-mère.
Enfin, les sanctions diffèrent d’un pays à l’autre : en France, des sanctions pénales sont possibles pour les entreprises qui ne respectent pas ces règles ; ailleurs, les amendes peuvent être extrêmement faibles et atteindre au maximum quelques dizaines d’euros.
Monsieur le ministre, ma question est simple : estimez-vous qu’il y ait là un problème et, si oui, pourriez-vous, avec le ministre chargé des affaires européennes, agir dans le sens d’une harmonisation permettant de rétablir des marges de compétitivité en faveur de nos entreprises et ne pas aller dans le sens de certaines entreprises qui demandent la fin de la publication, afin de restaurer la réciprocité.
Monsieur le sénateur, si elle n’est pas nouvelle, la question que vous soulevez n’en est pas moins d’importance. Des réflexions avaient été engagées sous le précédent gouvernement, dont aucune conséquence pratique n’avait été tirée. Sachez que l’intention du gouvernement de Jean-Marc Ayrault est de prendre position sur ce dossier dans un délai raisonnable, que je ne peux malheureusement pas vous indiquer précisément, dans le cadre de réflexions engagées pour améliorer la compétitivité des entreprises.
La question mérite en effet un examen approfondi. La publicité des comptes est un élément important de la vie des affaires, car il contribue à fluidifier les relations entre créanciers et investisseursC’est le moins qu’avant de contracter avec une entreprise ses interlocuteurs disposent d’un minimum d’informations sur sa situation. La disponibilité de ces informations est également un élément déterminant en termes d’efficacité de la lutte contre le blanchiment. Le dépôt des comptes est en outre un outil utile en matière de prévention des difficultés des entreprises.
Sur tous ces points, nous devrions pouvoir trouver un accord, car ce constat est partagé.
Ainsi, non seulement la publicité des comptes est ancienne dans notre droit, mais le droit de l’Union européenne l’a hissée au rang de principe dès 1968 pour les sociétés par actions simplifiées, les sociétés anonymes à responsabilité limitée mais aussi les sociétés en commandite par action. La directive en vigueur impose aux États membres de prévoir des sanctions appropriées en cas de défaut de publicité des documents comptables.
Là où le débat est possible, c’est autour du choix qui a été fait à l’échelon national d’aller au-delà des prescriptions de la directive et de généraliser l’obligation de publication à l’ensemble des sociétés par actions, sociétés anonymes à responsabilité limitée, sociétés en nom collectif dont tous les associés sont des SARL ou sociétés par actions, et ce alors même que le droit européen autorise les États membres à n’imposer aux entreprises se situant en deçà de deux seuils que la publication de documents allégés, voire à les exempter de publication.
Les entreprises individuelles, qui ne sont pas des sociétés, sont quant à elles hors du champ de la directive. Chez certains de nos partenaires, dont l’Allemagne, elles ne sont pas soumises à l’obligation de publicité des comptes. Des formalités allégées sont certes déjà prévues dans le droit français, mais elles ne s’appliquent qu’aux entreprises situées sous des seuils nettement inférieurs à ceux qui sont autorisés par la directive.
Ce débat a été récemment renouvelé par l’intervention d’une directive de simplification, qui concerne spécifiquement les micro-entités. Ce texte de mars 2012 autorise les États membres à prévoir des dérogations à certaines obligations de publicité comptable sous réserve de la combinaison de différents critères de taille de bilan, de chiffre d’affaires et de nombre de salariés. Les sociétés répondant à ces critères peuvent être exonérées de l’obligation de publication des comptes sous réserve qu’elles communiquent leur bilan à une autorité publique.
Reste qu’il faut bien mesurer ce qu’impliquerait l’éventuel allégement des obligations de publication ou des formalités comptables pour certaines entreprises au regard des enjeux de bon fonctionnement du marché ou de protection des intérêts publics, tels que je les évoquais en préalable.
Je relève en outre que, par elle-même, la suppression de l’obligation de publication ne constituerait pas une mesure de simplification si l’obligation de dépôt et la teneur des obligations comptables des entreprises concernées demeuraient inchangées. Cette suppression peut en revanche présenter de l’intérêt en termes de protection de certaines entreprises, pour autant qu’elle ne nuise pas aux exigences de la lutte contre la fraude.
On le voit, la voie est étroite. C’est bien à un traitement d’ensemble de la question, et par la concertation avec les organisations représentatives des entreprises, que le Gouvernement entend déterminer si notre droit et nos entreprises gagneront à une modification du droit en vigueur.
Vous le savez sans doute, deux parlementaires en mission ont été nommés par le Premier ministre pour réfléchir à l’avenir de l’épargne financière. Cette mission s’inscrit dans la réflexion sur l’amélioration de la compétitivité des entreprises, qui devrait, je l’espère, faire l’objet d’une saisine du Parlement en 2013. C’est dans le cadre de cette saisine, me semble-t-il, que ces problèmes pourraient être traités. Sous l’angle de la compétitivité, chacun doit convenir qu’aller au-delà des prescriptions communautaires revient, pour notre pays, à vouloir faire preuve d’une exemplarité qu’au fond rien ni personne ne commande réellement.
Je vous remercie, monsieur le sénateur, de m’avoir permis de m’exprimer sur ce sujet.

La parole est à M. Francis Grignon, auteur de la question n° 46, transmise à M. le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué chargé de la formation professionnelle et de l’apprentissage, mes chers collègues, ma question porte sur le détournement des règles communautaires de détachement des travailleurs dans le secteur du bâtiment. La main-d’œuvre dans le secteur du bâtiment a pris le chemin de la délocalisation, qui revêt différents aspects. Les grands chantiers font l’objet d’appels d’offres européens, et, lorsqu’il s’agit de marchés inférieurs au seuil des appels d’offres européens, ils sont régulièrement attribués à des entreprises européennes, notamment, en Alsace – d’où je viens –, à des entreprises de droit allemand.
Ces entreprises ne sont pas plus performantes que les nôtres et leurs salariés n’ont pas un rendement supérieur aux salariés des entreprises françaises. La différence s’explique par le taux horaire des salaires.
Le secteur économique du bâtiment et des travaux publics allemand emploie massivement de la main-d’œuvre provenant notamment de Pologne, de Hongrie, de Roumanie ou de Bulgarie. Les salaires proposés sont très bas : entre 3 et 7 euros de l’heure, contre 9 à 15 euros pour les ouvriers français, hors charges sociales. Cet écart de compétitivité de 3 à 5 euros de l’heure crée une distorsion de concurrence insupportable pour les entreprises françaises.
L’Allemagne continue à laisser les entreprises du secteur du BTP jouer sur la confusion entre les statuts de détachés et d’intérimaires pour payer leurs employés étrangers moins chers. La loi allemande transposant la législation communautaire n’impose pas aux entreprises d’offrir aux détachés des rémunérations équivalentes à celles de leurs propres salariés. Elle les contraint uniquement à traiter leurs intérimaires avec les mêmes égards que leurs propres employés. Ainsi, les entreprises allemandes disent utiliser des travailleurs détachés, alors qu’il s’agit bien d’intérim déguisé.
Ce phénomène se produit dans le BTP, mais aussi dans de nombreux autres secteurs, en particulier dans l’industrie, ainsi que dans des secteurs qui relèvent de l’agriculture, puisque, dans notre région, les maraichers souffrent énormément de cette distorsion de concurrence.
C’est pourquoi, monsieur le ministre, j’aimerais connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour garantir plus d’équité dans ce domaine.
Monsieur le sénateur, vous avez attiré l’attention du Gouvernement sur les conditions d’intervention en France, notamment dans les zones frontalières, d’entreprises établies dans un autre pays membre de l’Union européenne, et plus particulièrement de celles qui sont établies en Allemagne.
Ces dernières interviennent notamment en région Alsace dans le secteur du BTP, en s’affranchissant visiblement de certaines règles inhérentes au détachement de travailleurs.
Dans ce contexte, vous avez souhaité connaître les initiatives envisagées ou déjà prises afin d’apporter les solutions attendues et de mettre fin à ces pratiques de dumping social qui engendrent une concurrence déloyale.
La réponse que je vais vous donner au nom du Gouvernement devrait intéresser aussi le président de séance, lui-même élu d’un département frontalier. J’ai d’ailleurs le sentiment de devenir peu à peu le spécialiste des questions transfrontalières, si je me réfère à mon intervention de la semaine dernière…
Je voudrais tout d’abord vous rappeler que le code du travail encadre strictement les conditions d’intervention en France des entreprises établies hors de France, conformément aux dispositions de la directive européenne du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.
L’entreprise prestataire étrangère doit notamment intervenir en France de façon temporaire, en fonction de la durée nécessaire à la réalisation d’une mission définie au préalable, et à la condition d’être régulièrement établie dans son pays d’origine et d’y justifier d’une activité significative.
En ce qui concerne le droit du travail applicable, l’entreprise étrangère est tenue de respecter certaines règles françaises d’ordre public social en matière de conditions de travail et d’emploi, notamment la rémunération, la durée du travail, la santé et les règles de sécurité au travail.
C’est en matière de rémunération que les préoccupations sont les plus vives et les plus sensibles, vous l’avez souligné. Les employeurs établis hors de France sont cependant tenus, en droit, de se conformer aux barèmes de rémunération minimaux fixés par le code du travail ou par la convention collective étendue applicable si ses dispositions sont plus favorables aux salariés.
Par ailleurs – ce point est important –, les frais de transport, de logement et de nourriture occasionnés par le détachement des salariés en France ne doivent en aucun cas être déduits du salaire minimum de base des salariés par leur employeur.
Je précise ce point car, dans les faits, les contrôles ont permis de mettre en évidence des pratiques contraires aux règles applicables en matière de rémunération, certains employeurs n’hésitant pas à déduire des sommes considérables de la rémunération de base des salariés détachés au titre de la mise à disposition d’un logement, ce qui peut aboutir dans certains cas à porter leur rémunération mensuelle aux environs de 500 euros...
Conscient des enjeux liés au détournement des règles communautaires en matière de détachement, le Gouvernement a déjà engagé un certain nombre d’actions.
En premier lieu, dans le Plan national de coordination de la lutte contre la fraude, au titre de 2012, il a de nouveau retenu la lutte contre les détournements de la réglementation relative au détachement de salariés dans le cadre de prestations de services internationales comme l’un des axes prioritaires du volet relatif au Plan national de lutte contre le travail illégal, tandis que le secteur du BTP que vous avez cité figure dans la liste des cinq secteurs d’activité prioritaires.
Les services de contrôle interviennent donc activement pour s’assurer du respect des règles dans le secteur du BTP. Ainsi, les contrôles ont augmenté de 17 % en 2010, pour s’établir à 30 606. En 2010, l’enquête recense près de 10 900 entreprises en situation d’infraction liée au travail dissimulé, dont 4 500 pour le secteur du BTP, soit un taux d’infraction voisin de 15 %, en hausse de deux points par rapport à l’année précédente. De plus, 1 688 entreprises étrangères ont été contrôlées, soit près de 2, 5 % de l’ensemble des sociétés contrôlées.
En second lieu, plusieurs initiatives ont été engagées avec les partenaires sociaux dans le cadre du protocole sur la prévention du travail illégal et les bonnes pratiques de la sous-traitance dans le BTP, qui a été conclu le 25 octobre 2005 entre le ministère du travail, le ministère de l’équipement et plusieurs organisations professionnelles.
Le Gouvernement sera attentif à ce que la mobilisation des services soit encore renforcée dans les mois à venir, dans ses aspects tant préventifs que répressifs. Sur ces deux aspects, je compte sur l’ensemble des parlementaires pour accompagner le travail des inspecteurs du travail, missions difficiles qui sont conduites par les agents de l’État.
Le Gouvernement a ainsi décidé, dans le cadre de la feuille de route adoptée à la suite de la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet dernier, de réunir, dès l’automne 2012, la Commission nationale de lutte contre le travail illégal, qui dressera le bilan des actions déjà engagées par les services de l’État et les organismes de recouvrement des cotisations sociales.
Cette commission aura pour objectif de fixer les axes prioritaires du plan national d’action pour les années à venir.
Enfin, dans le cadre des négociations de la proposition de directive visant à renforcer l’effectivité de la mise en œuvre de la directive de 1996, le Gouvernement est extrêmement attentif à sensibiliser l’ensemble de nos partenaires européens à la nécessité de coopérer loyalement pour y parvenir et de mettre en place des mécanismes permettant de lutter efficacement contre les fraudes et les abus que vous avez dénoncés.

Monsieur le ministre, vous êtes l’un des spécialistes des questions transfrontalières, et nous comptons sur vous.
La parole est à M. Francis Grignon.

Je voudrais tout d’abord remercier M. le ministre de s’être déplacé pour répondre à cette question. Pour avoir beaucoup apprécié ses compétences au sein de la commission de l’économie voilà encore quelques mois, je sais qu’il est un orfèvre en la matière.

Cela étant, j’ai évoqué deux problèmes distincts, dont celui des maraîchers qui, j’en conviens, ne relève pas directement de cette question.
Certes, le Parlement français n’est pas habilité à modifier la législation allemande ! Mais il n’empêche que ce problème est très préoccupant pour notre économie locale et, certainement, pour l’ensemble des économies transfrontalières – que ce soit le long des frontières franco-espagnoles ou franco-allemandes.
Pour ce qui concerne le secteur du bâtiment stricto sensu, je confirme les propos que vous avez développés : vous le savez, il y a quelques années, j’ai rédigé un rapport consacré à la problématique du « plombier polonais ». Tout le monde se souvient de la directive Bolkestein, …

… qui, à l’époque, avait suscité un réel émoi.
Monsieur le ministre, je suis d’accord avec vous : ce problème est de l’ordre du contrôle. Il faut aller le plus loin possible dans cette direction, pour qu’il ne soit plus permis de faire n’importe quoi.

La parole est à M. Roland Courteau, auteur de la question n° 137, adressée à Mme la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement.

Madame la ministre, je me réjouis tout particulièrement que vous ayez tenu à répondre vous-même à quelques-unes de mes interrogations, sur un sujet ô combien préoccupant. Je veux parler, évidemment, des violences faites aux femmes, ou encore des violences au sein des couples, et des incidences de ces dernières sur les enfants : il s’agit d’un phénomène trop longtemps minimisé, trop longtemps occulté, trop longtemps considéré comme tabou, et qui est pourtant d’une ampleur considérable.
À ce propos, la mise en place d’un observatoire national consacré à ces enjeux serait particulièrement utile, contrairement à ce qu’affirmaient vos prédécesseurs.
Cela étant, une part du chemin a indéniablement été parcourue quant à la lutte contre ce fléau, grâce aux initiatives parlementaires qui ont abouti aux lois du 4 avril 2006 et du 9 juillet 2010 instaurant non seulement des sanctions à l’encontre des auteurs de violences, mais aussi des mesures de protection pour les victimes, et surtout des dispositifs de prévention.
De fait, face à ces atteintes portées à la dignité et aux droits fondamentaux de la personne humaine, il était impératif de sanctionner les auteurs de violences et de protéger leurs victimes.
Toutefois, notre objectif, qui, je le sais, est également le vôtre, madame la ministre, c’est d’endiguer ce fléau. Or, plus on informera, plus on sensibilisera, plus on alertera, plus vite les violences faites aux femmes diminueront. C’est la raison pour laquelle, lors de l’examen de la loi de 2010, le Sénat a adopté un amendement tendant à instituer une journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes, fixée au 25 novembre de chaque année.
Toutefois, j’ignore pourquoi – les précédents gouvernements l’ont voulu ainsi – les journées du 25 novembre 2010 et du 25 novembre 2011 n’ont pas été des plus marquantes. De facto, lors de ces journées nationales, les Français n’ont pas ressenti un souffle fort de sensibilisation à ce fléau.
Il n’est pas moins hautement nécessaire que nous nous attachions à mettre en œuvre et à soutenir, chaque année, des initiatives susceptibles de donner à cette journée un relief particulier et donc un maximum d’impact.
Madame la ministre, est-ce là votre intention ?
Par ailleurs, si nous souhaitons avoir quelques chances d’éradiquer ce fléau, à moyen terme ou à court terme, il faut faire évoluer les mentalités et, partant, agir très en amont, c’est-à-dire à l’école, au collège et au lycée. Je devrais même dire dès le plus jeune âge, car, dès les premières années de son existence, l’enfant est enfermé dans des représentations très stéréotypées de sa place et de son rôle dans la société.
Pour ma part, je reste persuadé que l’une des dynamiques à exploiter le plus en profondeur réside dans ce travail d’éducation visant à promouvoir le respect mutuel entre les garçons et les filles, l’égalité entre les sexes, le respect des différences et la lutte contre les préjugés sexistes. Tel était également l’objet de l’amendement adopté par le Sénat, en 2010, devenu l’article 23 du texte de loi entré en vigueur.
Pourtant, durant les deux années scolaires qui ont suivi l’adoption de ces dispositions par le Parlement, aucun chef d’établissement scolaire n’a reçu d’instructions visant à instaurer ces séances d’information à destination des élèves, et encore moins à préciser leur contenu pédagogique. §
Madame la ministre, ma question est simple : sur ce point, comme sur bien d’autres, entendez-vous prendre toutes les initiatives permettant de donner force et vigueur à cet indispensable volet de prévention ?
Monsieur le sénateur, je tiens tout d’abord à vous dire combien je suis heureuse de m’adresser à vous, aujourd’hui, sur ce sujet : je sais que la question des violences faites aux femmes vous tient à cœur, je connais votre mobilisation sur ce dossier, au sein de la délégation aux droits des femmes et, plus largement, au sein de la Haute Assemblée.
Dès mon entrée au ministère, j’ai tenu à m’emparer de la question des violences faites aux femmes, car je considère qu’elle figure au cœur des politiques d’égalité que le Gouvernement entreprend de mener. Vous le savez, ces violences, ces crimes entachent encore trop souvent notre conception républicaine de l’égalité.
Dès le mois de juillet dernier, à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif au harcèlement sexuel, nous avons eu l’occasion de rappeler, dans cet hémicycle, la nécessité absolue de se doter d’un Observatoire national des violences faites aux femmes. §Je m’étais engagée sur cette disposition : celle-ci procède d’une volonté politique claire, que je rappelle aujourd’hui.
Pourquoi est-il nécessaire de créer un tel observatoire ? De fait, aujourd’hui, si on dénombre chaque année environ 17 000 condamnations pour violences conjugales en France, les chiffres cachent une réalité plus dramatique encore : seul un dixième de ces violences font l’objet d’un dépôt de plainte. Pis, un grand nombre de plaintes n’aboutissent jamais.
Il est donc indispensable d’améliorer notre connaissance du sujet via la création d’un observatoire dédié à ces violences, que l’on pourrait qualifier de violences de genre : ces dernières sont spécifiques, car elles sont fondées sur des représentations sexuées et inégalitaires du monde, solidement ancrées dans les mentalités.
Je le précise de nouveau, je tiens à ce que cet observatoire soit en mesure non seulement de mener des études et des enquêtes, mais aussi d’évaluer les travaux menés au sein des territoires. Ces expérimentations ont été aussi nombreuses qu’intéressantes et, quand elles ont fait leurs preuves, comme c’est le cas du dispositif du téléphone de grande urgence, nous veillerons à les généraliser au niveau national. En effet, rien n’est plus insupportable que les inégalités territoriales dans l’accès aux services publics, nées des différences de volontarisme politique entre tel et tel territoire, tel et tel département.
Plusieurs travaux ont d’ores et déjà été engagés pour donner à cet observatoire, qui verra le jour dans le courant de l’automne, les moyens de ses ambitions. Sachez, par exemple, que nous avons sollicité l’Institut national d’études démographiques, l’INED, pour que ses équipes puissent enfin reconduire une étude qui nous manquait cruellement et nous fournir des données chiffrées qui n’avaient pas été actualisées depuis dix ans.
Par ailleurs, nous organisons le recueil des données à la faveur de la modernisation des instruments statistiques de la justice et de l’intérieur, en lien avec mes collègues de ces deux ministères. Ces données permettront au futur observatoire de s’imposer comme un véritable outil de pilotage, en lien avec les acteurs locaux, au service des victimes de violences.
Monsieur le sénateur, pas plus tard que la semaine dernière, j’étais en Languedoc-Roussillon, et plus précisément à Montpellier, pour soutenir l’action des associations et des élus en faveur de la prévention des violences. Comme vous et moi, ces acteurs dressent ce constat : si elle opère une indéniable avancée, la loi du 9 juillet 2010 n’est encore pas assez bien appliquée.
Ce texte est donc perfectible. L’amélioration de son application constitue du reste un chantier que nous avons ouvert avec le ministre de l’intérieur et la garde des sceaux.
Premièrement, les ordonnances de protection ne sont pas encore suffisamment employées dans certains territoires : les délais de mise en œuvre de cette procédure restent trop longs. Son champ d’application demeure trop limité dans la durée et selon les types de violences couverts. Ainsi, les professionnels et les représentants des associations nous le disent : telles qu’elles sont aujourd’hui appliquées, les ordonnances de protection, élaborées pour protéger les femmes en grand danger, placées dans des situations d’extrême urgence, ne jouent pas leur rôle.
Deuxièmement, les places d’hébergement réservées aux femmes victimes de violences – souvent subies au sein de leur propre famille – souhaitant quitter le domicile conjugal, font cruellement défaut. Nous nous attelons actuellement à ce problème, avec ma collègue Cécile Duflot.
Troisièmement, le suivi des auteurs de violences, indispensable pour prévenir les risques de récidive, n’est pas suffisamment assuré aujourd’hui.
Oui, monsieur le sénateur, la loi est perfectible. Néanmoins – et vous êtes bien placé pour le savoir – le problème ne se cantonne pas à cet aspect.
De fait, pour que la lutte contre les violences faites aux femmes soit réellement efficace, trois conditions essentielles doivent être réunies : tout d’abord, l’orientation très rapide des victimes vers la bonne procédure, ce qui nécessite la formation de tous les acteurs ; ensuite, l’implication des différents acteurs concernés et leur mise en réseau – voilà pourquoi les actions menées au sein des territoires sont dignes d’intérêt, car c’est bien de synergie et de partenariat local qu’il s’agit ; enfin, la prévention, que vous avez évoquée en présentant votre question, et qui doit s’étendre non seulement à l’école, mais aussi aux médias, vous avez raison.
Avec le ministre de l’éducation nationale, Vincent Peillon, nous l’avons souligné la semaine dernière : l’égalité entre les filles et les garçons dans le système éducatif doit être et sera au cœur même de la refondation républicaine de l’école que nous préparons.
Ce message, nous l’adresserons ensemble aux recteurs lors de la grande réunion qui aura lieu le 13 novembre prochain, à laquelle Vincent Peillon m’a prié de prendre part. Comptez sur moi pour rappeler combien l’égalité entre les femmes et les hommes se construit, elle aussi, dès le plus jeune âge.
Parmi les actions que nous prévoyons pour les mois et les années à venir, je citerai trois initiatives.
Premièrement, des modules à l’égalité entre les femmes et les hommes seront inclus dans la nouvelle formation initiale et continue des enseignants et personnels d’éducation, de direction et d’orientation.
Deuxièmement, Vincent Peillon et moi-même lancerons très prochainement une expérimentation dans cinq académies, pour que les enfants travaillent dès le plus jeune âge sur cette égalité entre les filles et les garçons. Oui, cela s’apprend ! Ce programme, destiné aux enfants de six à dix ans, sera fondé sur des jeux et des outils ludiques. Nous sommes en train de l’élaborer.
Troisièmement enfin, nous mettrons l’accent sur le respect entre les sexes avec la tenue systématique des séances d’éducation à la sexualité, de la maternelle à la terminale. Vous l’avez rappelé, c’est là une obligation légale qui n’a jamais été respectée. Cette fois-ci, nous ne laisserons rien passer.
Monsieur le sénateur, vous rappelez avec raison la signification que la loi a conférée à la journée du 25 novembre. Cette date importante n’est pas encore empreinte de toute la force symbolique dont elle aurait dû être investie. Cette année, nous en ferons un véritable événement national pour saluer l’engagement des acteurs concernés et mener des actions de sensibilisation et de communication à destination du grand public.
Surtout, cette journée nationale doit être mise à profit pour réunir les nombreux professionnels concernés : les forces de l’ordre, les professionnels de la justice, le monde médical, etc.
Le but visé est clair : d’une part, organiser un échange, au titre duquel chacune de ces professions fera part des difficultés ressenties au quotidien par ses membres ; de l’autre, sensibiliser et former les professionnels concernés à une réalité très simple, que je rappelle aujourd’hui de nouveau, car ces chiffres ne sont pas assez connus. On croit souvent que le silence et le tabou qui pèsent sur les violences conjugales sont le fait des victimes. Or, en réalité, elles sont le fait de la société qui n’entend pas les victimes.
Les études démontrent que, dans huit cas sur dix, lorsqu’on demande à une femme si elle subit ou non des violences conjugales, elle répond très naturellement. La véritable interrogation est donc la suivante : combien sont ceux qui, parmi nous, pensent à poser cette question, tout naturellement ?
C’est cet enjeu qu’il convient d’exposer aux professionnels les plus directement concernés par ce sujet : ces derniers doivent être conscients, les uns et les autres, de notre incapacité collective à entendre aujourd’hui les victimes de violences conjugales et, surtout, de l’absolue nécessité d’y remédier.

Madame la ministre, permettez-moi de vous remercier très vivement des précisions que vous venez de nous apporter, et que nous attendions depuis près de deux ans.
Sachez que je suis tout particulièrement satisfait de la richesse et de la diversité des propositions que vous avez formulées. Qu’il me soit permis de saluer, à cet égard, l’efficacité de votre action.
La volonté du législateur est enfin prise en compte sur un sujet majeur : la prévention d’un véritable fléau qui touche aux droits fondamentaux et à la dignité de la personne humaine. Toutefois, cette question va plus loin encore : en effet, la lutte contre les violences au sein des couples, ou à l’égard des femmes en général, constitue, je le répète, l’un des préalables, à défaut d’être l’unique prélude à tout approfondissement de l’égalité entre les hommes et les femmes. §

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, auteur de la question n° 43, adressée à M. le ministre de l’intérieur.

Madame la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, je vous remercie d’être présente parmi nous en ce matin pluvieux. La dernière fois, j’avais eu le plaisir d’entendre Mme la ministre chargée de l’outre-mer. Je ne doute pas que M. le ministre de l’intérieur finira par me répondre en personne !
En effet, voilà plusieurs années que, sans me lasser, j’interroge avec constance les ministres de l’intérieur sur l’intention des gouvernements successifs de pérenniser ou non le stationnement d’un hélicoptère de la sécurité civile sur la base du Cannet des Maures, seul moyen d’assurer efficacement le transport sanitaire d’urgence dans la zone, essentiellement rurale, du centre et du haut Var.
Je n’avais jusque-là obtenu que des réponses dilatoires, voire contradictoires, comme lorsque le précédent préfet du Var annonça publiquement qu’une décision positive avait été prise, au moment même où le ministre de l’intérieur me faisait savoir que tout dépendait des résultats d’une sorte d’étude coût-avantage en cours. S’agissant de la sécurité minimale d’un territoire aussi vaste, cette réponse m’avait semblé passablement désinvolte.
Quelques semaines avant l’élection présidentielle de 2012, une rumeur persistante laissait craindre que le Gouvernement d’alors ne supprime le stationnement permanent, pour ne maintenir l’appareil que pendant la période estivale. Pourtant, entre-temps, le conseil général, comme cela lui avait été demandé, avait réalisé à ses frais l’équipement permettant le stationnement permanent de l’appareil.
Le nouveau gouvernement installé, j’ai donc reposé ma question, le 26 juillet 2012, dans la forme permise par l’état des informations dont je disposais à cette date.
La réponse m’a été apportée, indirectement, par M. le ministre de l’intérieur lui-même, lors de sa venue dans le Var le 18 août 2012, alors qu’il passait en revue le dispositif de lutte contre les incendies de forêt de l’été. Il m’a confirmé que le stationnement de Dragon 83 – tel est le nom de l’appareil – serait bien pérennisé en centre Var.
J’ai donc constaté avec plaisir que, pour le Var rural en tout cas, et en matière de transports sanitaires d’urgence, le changement, c’était bien pour maintenant !
Il reste cependant un point non réglé, qui justifie le maintien de ma question, celui du type d’appareil stationné au Cannet des Maures. Actuellement, il s’agit d’un « Écureuil », alors qu’un appareil de type « EC-145 » serait nécessaire. Ce dernier est en effet susceptible d’emporter, outre le pilote et le patient, un médecin et un infirmier, ce qui peut permettre la mise en place d’un SMUR aérien réglementaire.
Tout en remerciant très chaleureusement, au nom de tous les Varois, le ministre de l’intérieur d’avoir, en si peu de temps et si clairement, tranché en faveur du stationnement de l’appareil, je repose donc ce qui reste de ma question : les Varois peuvent-ils espérer voir remplacer l’appareil actuellement basé au Cannet des Maures par un « EC-145 » ou tout autre appareil permettant de rendre le même service ?
Même si je serai très heureux de vous revoir bientôt dans cette enceinte, madame la ministre, je préférerais, bien entendu, que la réponse soit « oui » !
d’autant qu’il s’agit pour moi de vous annoncer une bonne nouvelle.
Manuel Valls tient en effet à rappeler que la sécurité civile, tout comme les forces de l’ordre, doit être présente sur l’ensemble du territoire de la République. Il est inacceptable qu’une personne soit moins bien secourue en zone rurale ou montagneuse qu’en ville ou dans une zone touristique.
Lors de son déplacement à Pignans le 18 août dernier, il a eu l’occasion de vous annoncer le maintien de la présence d’un hélicoptère de secours aux personnes sur la base du Luc.
En 2009, la direction générale de la sécurité civile avait décidé de l’implantation de cet appareil de type « Écureuil » – je le rappelle pour ceux qui ont moins bien suivi le dossier que vous, monsieur le sénateur –, en se fondant sur un manque de moyens de secours primaires héliportés sur cette partie de la zone de défense Sud. La présence de cet appareil avait toujours été considérée comme expérimentale.
Comme dans les autres matières, les retours d’expérience sont essentiels et les chiffres intéressants à examiner. Ils démontrent en l’occurrence que cet hélicoptère est actif, qu’il vole régulièrement et qu’il a porté secours en 2011 à près de 600 personnes.
En comblant l’espace géographique séparant les Bouches-du-Rhône des Alpes-Maritimes, cet appareil assure clairement le secours à personne héliporté dans le Var. Au-delà de cette mission, la mise en place de ce détachement au Luc permet, pendant la saison des feux de forêts, de positionner une machine au plus près des incendies qui touchent votre département.
Conscient de la nécessité de cet équipement, mon collègue Manuel Valls a donc décidé de le pérenniser, mais aussi de le moderniser. Les quatre hélicoptères « Écureuil » de la Sécurité civile sont vieillissants et seront donc mis en vente au cours des années 2012 et 2013. Dans le cadre d’une opération de redéploiement des moyens actuels, l’appareil du Luc sera remplacé par un hélicoptère de type « EC-145 ».
J’insiste cependant sur ce terme de redéploiement : vous connaissez les contraintes dans lesquelles s’exerce l’action publique. Si, comme vous le dites, le seul calcul coût-avantages ne peut déterminer toutes les décisions dans un domaine aussi sensible que le secours, il faut aujourd’hui conjuguer les efforts avec le maintien d’une bonne couverture des risques. C’est pourquoi les moyens aériens de la sécurité civile répondront toujours au principe d’adaptabilité du service public : leur implantation doit correspondre à une analyse précise des risques. Si ces risques évoluaient, l’implantation devrait également évoluer.
D’autres mesures de rationalisation et de mutualisation entre les flottes d’hélicoptères de l’État sont indispensables : il ne servirait à rien de préserver l’implantation d’une base s’il n’y a plus de crédits pour son fonctionnement ni pour la maintenance de ses appareils.
Vous aurez, monsieur le sénateur, l’occasion de reparler de ces dossiers avec le ministre de l’intérieur lorsqu’il présentera, dans quelques semaines, le budget de la mission « Sécurité civile ».
Quoi qu’il en soit, sachez, monsieur le sénateur, que la décision que je viens de vous transmettre a été guidée par un principe d’équité territoriale, principe qui préside d’ailleurs à tous les domaines d’action de mon collègue ministre de l’intérieur.

M. Pierre-Yves Collombat. Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre, même si j’avoue que je me serais bien contenté de la première partie de votre intervention…
Sourires.

In cauda venenum, je ne l’ignore point ! En l’occurrence, la cauda m’a semblé un peu longue, et surtout un peu inquiétante, si vous me le permettez. J’avoue que cela a quelque peu gâché mon plaisir, même si je serai toujours content de vous revoir…
Si le stationnement permanent d’un hélicoptère est nécessaire, aujourd’hui, pour remplir toutes les missions de sécurité, je ne vois pas pourquoi ce besoin devrait évoluer à l’avenir.
Je retiens toutefois que, dans l’immédiat, l’appareil sera modernisé et qu’il pourra remplir la totalité de ses missions.

La parole est à Mme Sophie Primas, auteur de la question n° 61, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

Madame la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, je souhaite attirer l’attention du ministre de l’intérieur sur la procédure de reconnaissance de communes en l’état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain liés aux phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols.
En effet, pour de nombreuses communes de mon département des Yvelines, situées sur un territoire argileux, les périodes de sécheresse et de réhydratation successives se traduisent par des mouvements de terrains importants, qui affectent gravement les infrastructures et, surtout, les habitations.
Les dégâts subis sont de tous ordres : affaissement des charpentes de toitures, fissures importantes en façades, dislocation des dallages et cloisons, distorsion des portes et fenêtres, etc. Les habitants assistent alors impuissants à la dégradation de leur patrimoine immobilier, notamment parce que les travaux préconisés pour ce type de dommages, les « reprises en sous-œuvre », sont particulièrement onéreux. Avec les associations de sinistrés, nous les avons chiffrés à environ 80 000 euros par habitation.
Dans ce contexte, la non-reconnaissance d’un certain nombre de communes provoque une grande détresse pour les sinistrés.
Compte tenu de l’aggravation constante des dégâts, c’est en réalité la pertinence de la méthode d’analyse scientifique retenue pour la reconnaissance de la sécheresse, et réalisée par la direction de la climatologie, qui doit être questionnée.
Ainsi, à la suite du travail que j’avais mené conjointement avec Cécile Dumoulin, ancienne députée, le prédécesseur de M. Valls, M. Claude Guéant, avait engagé une réflexion sur la prise en compte de l’impact de la nature argileuse du sol dans la procédure de reconnaissance. En ce sens, il avait sollicité les services de Météo France, ainsi que ceux du Bureau de recherches géologiques et minières, le BRGM, afin qu’une étude conjointe permette, pour le traitement des sécheresses à venir, de corréler la nature argileuse du sol et les effets des conditions météorologiques. De surcroît, il conviendrait de prendre en compte dans la procédure la succession des épisodes de sécheresse et de réhydratation sur des périodes beaucoup plus longues qu’à l’heure actuelle.
Par conséquent, je vous demande, madame la ministre, de bien vouloir m’indiquer la position du Gouvernement sur ce sujet, ainsi que l’avancement éventuel de cette évolution de la procédure de reconnaissance en l’état de catastrophe naturelle.
Madame Primas, je tiens tout d’abord, au nom de mon collègue Manuel Valls et en mon nom personnel, à profiter de votre question pour adresser un message de soutien à tous ceux qui ont subi les conséquences d’une catastrophe naturelle. Comme vous le soulignez, les dégâts sont parfois importants et il faut souvent plusieurs années pour surmonter de tels événements.
Vous interrogez le Gouvernement précisément sur les évolutions possibles des critères de reconnaissance des catastrophes naturelles liées aux phénomènes de sécheresse suivis d’une réhydratation des sols.
Je tiens, en premier lieu, à souligner la performance des outils utilisés actuellement. Depuis 2009, la commission interministérielle utilise pour traiter les demandes « sécheresse » un modèle météorologique élaboré par Météo France, modèle qui simule les flux d’eau en surface, l’évolution du débit des rivières et les échanges hydrologiques avec le sol. Il s’agit de l’outil « SIM » – Safran-Isba-Modcou –, du nom des trois modèles qui en forment la base.
Ce système permet une analyse très fine des phénomènes de sécheresse et, plus largement, des phénomènes hydrologiques, sur l’ensemble du territoire. Le modèle s’appuie sur des données climatologiques recueillies par 4 500 postes de mesure. Ce travail permet de dresser un bilan hydrique très précis sur chaque parcelle du territoire. La conclusion de ces travaux figure dans un rapport météorologique de la sécheresse fourni chaque année.
En termes de procédures, la commission interministérielle en charge de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle émet des avis, après application de ses critères habituels, en se basant sur les conclusions scientifiques de ce rapport, et après constatation de la présence d’argile dans le sol.
Après trois années d’utilisation de ce modèle SIM, un premier bilan de sa pertinence peut être établi : les demandes communales au titre des sécheresses de 2009 et de 2010 ont obtenu des avis favorables dans respectivement 38 % et 13 % des cas. Ces résultats peuvent sembler faibles, mais il est à noter que Météo France n’avait pas enregistré de sécheresse particulière durant ces deux années. Il en est tout à fait autrement pour la sécheresse de 2011, année de sécheresse printanière avérée, pour laquelle 87 % des décisions prises ont été favorables – 76 % dans le seul département des Yvelines.
Il apparaît donc que la non-reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse pour une année donnée ne préjuge en rien d’un éventuel état de sécheresse les années suivantes.
Néanmoins, j’entends que le système doit encore être amélioré. Il faut, notamment, mettre le plus possible en adéquation l’analyse scientifique de la sécheresse, réalisée par la direction de la climatologie de Météo France, et la réalité des dégâts subis par les habitations des sinistrés sur le terrain. Dans ce sens, l’analyse doit davantage prendre en compte la corrélation entre les critères météorologiques et les critères géotechniques fournis par le Bureau de recherches géologiques et minières précisant la nature du sol.
Sachez que le ministre de l’intérieur a d’ores et déjà obtenu l’accord de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, dont dépend le Bureau de recherches géologiques et minières, pour la création d’un groupe de réflexion réunissant des représentants de la commission interministérielle en charge de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, des experts de Météo France et des membres du BRGM, afin de proposer une méthodologie adaptée au traitement de la sécheresse. Celle-ci permettra d’appréhender plus finement la réalité des situations.
Ce groupe de réflexion aura notamment pour mission de suivre au plus près les travaux du programme « ARGIC 2 », dont l’objectif est précisément de mieux appréhender les interactions entre la météorologie et les déformations des sols argileux. Les conclusions de ce programme, financé par le ministère de l’écologie, sont attendues pour la fin de l’année 2013.
Nous sommes conscients, madame la sénatrice, que les préjudices subis par ceux qui vivent dans des zones touchées par des catastrophes naturelles peuvent être dramatiques. Nous devons tout faire pour mieux comprendre et prendre en compte les dommages.
Je crois que le processus que je viens de décrire va dans ce sens.

Madame la ministre, je vous remercie de me confirmer que ce groupe de réflexion va pouvoir effectivement travailler et rendre un rapport d’ici à la fin de l’année ; cela va vraiment dans le sens de ma question.
Je souhaite attirer votre attention, au-delà de l’évolution de la procédure, sur quatre points sur lesquels nous devrons, me semble-t-il, travailler tous ensemble compte tenu de l’immense détresse dans laquelle se trouvent un certain nombre de sinistrés.
Le premier concerne ce que j’appellerai un peu cyniquement le « stock actuel de sinistrés ». Nombre de nos concitoyens vivent aujourd’hui dans des zones sinistrées, dans des conditions de grande détresse. Comme les communes n’ont pas été reconnues en état de catastrophe naturelle, les assurances ne veulent pas indemniser. Il y a donc de nombreuses personnes en difficulté pour lesquelles il faudrait trouver une solution.
Deuxième point, je souhaite que l’on réfléchisse au comportement des compagnies d’assurances, qui, lorsqu’une commune est déclarée en état de catastrophe naturelle une année, si le plaignant a fait une demande l’année précédente, ne prennent pas en considération les demandes en s’appuyant sur la non-reconnaissance de l’année antérieure. Il y a là, me semble-t-il, un problème sur lequel nous devons travailler.
Troisième point, je voudrais également que l’on puisse se pencher sur la responsabilité des constructeurs : est-il normal qu’un aménageur soit exonéré de toute responsabilité au-delà de la garantie décennale ? Il est de sa responsabilité de construire une maison qui tienne sur ses fondations un certain nombre d’années, quelle que soit la nature du sol.
Enfin, quatrième point, il faut peut-être réfléchir sur la responsabilité future des constructeurs, notamment sur l’obligation de faire des analyses des sols, même si la commune n’est pas engagée dans un plan de prévention des risques naturels, qui est une démarche assez lourde. Nous pourrions, me semble-t-il, réfléchir à une évolution de la législation dans ce sens.

La parole est à M. Pierre Hérisson, auteur de la question n° 86, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

Madame la ministre des droits des femmes, bien que ma question s’adressât à M. le ministre de l’intérieur, c’est bien volontiers que je vous la pose.
Le Comité ad hoc d’experts sur les questions roms, le CAHROM, au Conseil de l’Europe à Strasbourg, au sein duquel je représente la France depuis 2011, est le lieu d’évocation et de réflexion de la présence de certaines minorités ethniques roms, hors de leurs pays d’origine. Ces pays, je le rappelle, reconnaissent dans leur constitution les minorités ethniques, mais ce n’est pas pour autant qu’ils les traitent de manière satisfaisante.
Il convient de préciser que, si ces minorités ethniques sont reconnues dans leur pays, même si l’on sait, je le répète, la façon dont elles y sont traitées, la République française, dans laquelle tous les citoyens sont égaux, n’opère pas de telles distinctions.
Le CAHROM a permis de constater l’amalgame trop souvent fait, et que je dénonce dans ma proposition de loi relative au statut juridique des gens du voyage – déposée en juillet sur le bureau de notre assemblée –, entre ces populations provenant de l’espace Schengen et les gens du voyage, essentiellement – pour ne pas dire entièrement – de nationalité française.
Or, comme vous le savez bien, madame la ministre, des populations roms viennent s’installer de manière illégale sur le territoire français. Cette situation entraîne des tensions particulièrement aiguës, notamment dans les zones frontalières comme dans les grandes agglomérations. Ainsi, dans la commune de Gaillard dans mon département de la Haute-Savoie – dans notre département, monsieur le président ! –, des populations roumaines, hongroises, bulgares, identifiées comme roms – minorités ethniques dans leur pays – pratiquent en journée la mendicité à Genève et regagnent la France à la tombée de la nuit. Elles stationnent alors illégalement sur des places de parking ou dans des constructions précaires et, dans tous les cas de figure, dans l’illégalité.
On pourrait dire que ma question est quasiment une question d’actualité et qu’elle aurait pu être inscrite comme telle.
Ces situations se produisent dans des départements où, du fait des dynamiques économiques et touristiques, la population augmente fortement. Cela crée un déséquilibre fort, compte tenu des moyens dont disposent les forces de police et de gendarmerie. Ainsi, le dernier recensement de la Haute-Savoie évalue la population à 740 000 habitants alors que le département est en réalité aujourd’hui peuplé au quotidien d’environ 1, 2 million de personnes, pour certaines, certes, en déplacement pour tous motifs, y compris celui qui est évoqué ce matin. C’est un chiffre auquel il convient d’adosser les 500 000 habitants du canton de Genève, de la Suisse voisine.
Un jeu de « cache-cache » s’instaure alors avec les forces de l’ordre tant françaises que suisses, qui ne peuvent réagir de manière satisfaisante et suffisante face à une telle explosion de l’insécurité et notamment des cambriolages au quotidien.
Aussi ma question, madame la ministre, est-elle la suivante : une réorganisation des moyens de police et de gendarmerie semble aujourd'hui urgente et indispensable ; sera-t-elle mise en place afin que la situation puisse être réglée, notamment dans les zones frontalières, en particulier avec la Suisse, en Haute-Savoie et dans le département de l’Ain, notre département voisin ?
Vous savez combien le Gouvernement partage votre préoccupation d’assurer la sécurité de nos concitoyens, qui ont besoin de sentir, en effet, la présence de l’État, en particulier dans les zones les plus fragiles ou les plus sensibles, comme le sont indéniablement les zones transfrontalières. Dans cette optique, la gendarmerie et la police adaptent leur dispositif en permanence aux évolutions de la délinquance et de la démographie.
Vous visez, dans votre question, la délinquance émanant d’une certaine population. Permettez-moi de raisonner autrement. Toute délinquance, quelle que soit la nationalité de ses auteurs, doit être combattue. Je me permets, par ailleurs, de préciser que les nationalités que vous évoquez sont celles de ressortissants de l’Union européenne. À ce titre, ils peuvent circuler librement au sein de l’espace Schengen sous réserve de certaines conditions, notamment si leur séjour est supérieur à trois mois.
Je peux vous assurer, au nom de mon collègue ministre de l’intérieur, que les services de police, notamment ceux de la police aux frontières, et de gendarmerie intervenant en Haute-Savoie sont activement mobilisés dans la lutte contre la criminalité transfrontière, laquelle est, vous le savez, extrêmement mouvante.
Les services de police et les unités de gendarmerie disposent pour ce faire d’effectifs adaptés à un département de 740 000 habitants, pouvant atteindre, on le sait, un million avec les résidents occasionnels. Ainsi, le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Savoie compte aujourd'hui 964 militaires, appuyés au besoin de 200 réservistes et renforcés, l’hiver, d’une centaine de militaires de la gendarmerie et, l’été, de plus d’une trentaine. Parallèlement, la police aux frontières dispose quant à elle de 74 fonctionnaires, la direction départementale de la sécurité publique de 374 personnels et l’antenne de police judiciaire de 255 personnels.
La gendarmerie et la police nationales veillent à adapter leurs effectifs en fonction des réalités locales, dans le cadre d’une démarche associant les élus et les autorités administratives et judiciaires du département. Différents projets de réorganisation d’unités sont en cours de réalisation pour la gendarmerie et visent à améliorer les capacités d’action de la gendarmerie départementale sur le réseau routier, pour une meilleure prise en compte des flux, notamment en zone frontalière. Parallèlement, les zones les plus sensibles en termes d’activité et de délinquance ont d'ores et déjà été renforcées.
L’action des forces de l’ordre produit des résultats. En 2011, une vaste opération judiciaire menée par la section de recherches de la gendarmerie de Chambéry, appuyée par le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale, avait permis, vous le savez, le placement en détention provisoire de onze trafiquants de drogue de nationalité albanaise. Tout récemment encore, en juin 2012, une opération menée par les policiers du commissariat de police d’Annemasse a permis d’interpeller les membres d’un réseau d’exploitation de la mendicité roumaine.
Enfin, le centre de coopération policière et douanière de Genève assure une très bonne circulation de l’information entre les deux pays. Cette structure permet à chaque partie d’alerter en temps réel sur un événement susceptible d’intéresser l’autre partie. Les échanges directs entre la police de Genève, la gendarmerie et les services de police de la Haute-Savoie, les douanes du Léman et la préfecture de la Haute-Savoie sont matérialisés par une réunion mensuelle de coordination. Plusieurs opérations communes sont réalisées, sous des formes diverses, de façon ponctuelle – des contrôles thématiques, des services d’ordre public pour des événements ayant un impact des deux côtés de la frontière – ou de façon régulière. C’est ainsi, par exemple, que le corps des gardes-frontières helvétiques et les policiers de la brigade anti-criminalité, la BAC, d’Annemasse et du service de la police aux frontières d’Annemasse organisent régulièrement ensemble des patrouilles mixtes.
Monsieur le sénateur, vous le voyez, tous les moyens sont engagés pour faire face aux problématiques que connaît votre territoire.

Madame la ministre, je vous remercie de cette présentation des effectifs et des périodicités. Cependant, étant moi-même, ainsi que notre collègue président de séance, colonel de la réserve citoyenne de la gendarmerie nationale, j’aurais pu sans notes développer le même argumentaire que vous.
Hélas ! même si les moyens sont importants et s’ils ont été renforcés, en particulier ces cinq dernières années, je peux vous dire que les résultats ne sont pas satisfaisants.
Si j’interviens ce matin, c’est en tant que porte-parole d’une population d’une zone frontalière qui, toutes sensibilités politiques confondues – excusez l’expression un peu triviale que je vais employer – « en a marre ». Il suffit, comme nous l’avons fait avec M. le préfet de la Haute-Savoie, Mme le maire de Gaillard et le directeur départemental des polices urbaines, d’aller un matin à six heures à la porte de France, c’est-à-dire au passage du tramway qui permet de se rendre au cœur de la ville voisine de Genève, pour constater l’existence d’un réseau organisé qui exploite la misère de la population : des mères arrivent vers six heures et demi, un bébé emmailloté dans les bras et accompagnées d’enfants en bas âge ; elles reçoivent des consignes, assorties de la cartographie du quartier dans lequel elles doivent passer la journée. Il s’agit d’une véritable exploitation !
Les effectifs, les interventions et l’efficacité des opérations coup-de-poing sur ces secteurs ne sont pas à mettre en cause. L’effort doit porter plutôt, me semble-t-il, sur le démantèlement des réseaux, qui organisent de manière dramatique l’exploitation de mères de famille, d’enfants en bas âge, de personnes handicapées…
Malheureusement, certaines personnalités, comme des magistrats de Genève, de la Suisse voisine ou des avocats d’ONG, d’associations humanitaires repoussent l’idée d’une organisation, affirmant qu’il s’agit simplement d’un problème d’intégration ou de mendicité lié à la pauvreté.
Nous devons travailler beaucoup plus en amont, peut-être pas avec la gendarmerie parce que nous sommes dans un périmètre frontalier, zone de police nationale, mais en étroite concertation avec les élus locaux et les polices municipales notamment, pour démanteler ces réseaux dont les responsables, après avoir collecté les fonds se rendent, le soir, en toute impunité dans une banque spécialisée, pour envoyer les sommes rassemblées en Roumanie ou en Bulgarie. Le phénomène se développe au vu et au su de tous, tout le monde en parle et nous manquons totalement d’efficacité. En tout cas, je puis vous assurer que ce n’est ni un problème polémique, ni un problème politique.

Monsieur Hérisson, merci d’avoir évoqué un problème malheureusement récurrent !

La parole est à M. Hilarion Vendegou, auteur de la question n° 92, adressée à M. le ministre des outre-mer.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en ces temps difficiles pour tous nos concitoyens, il me revient de rappeler que la situation sociale en Nouvelle-Calédonie est loin d’être satisfaisante. Sans vouloir faire de catastrophisme, je dirai qu’elle est même inquiétante.
La vie chère, vous le savez, est la préoccupation majeure des habitants de la Grande Terre. Elle l’est davantage encore pour les îliens. Les prix des produits de première nécessité, essentiellement la nourriture, le carburant, sans parler du fret et des transports maritimes et aériens, sont autant de dépenses incompressibles auxquelles il est de plus en plus difficile de faire face.
Cela ne peut plus durer.
Monsieur le ministre, afin de ne pas laisser sur la route les plus démunis d’entre nous, pourriez-vous nous indiquer si une réflexion est menée sur ce sujet au sein de votre ministère ? Et, si c’est le cas, quelles solutions pourraient d’ores et déjà être envisagées ?
Monsieur le sénateur, vous m’interrogez sur le problème de la vie chère en Nouvelle-Calédonie, une question qui a été très longuement débattue ici même lors de l’examen du projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer, dont un volet est consacré aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
Un rapport a été rendu public aujourd’hui même dans le cadre de la convention d’assistance technique avec l’Autorité de la concurrence. Il contient quelques préconisations à l’adresse des autorités de la Nouvelle-Calédonie. Je vous renvoie à ce texte.
Je souhaite toutefois insister sur quelques recommandations de bon aloi qui ont été formulées.
Premièrement, des pistes ont été évoquées pour orienter les mesures de protections quantitatives dans un sens plus favorable à la concurrence. J’en mentionne au moins trois : d’abord, transformer les protections de marché quantitatives, quota ou interdiction d’importer, en protections tarifaires, notamment en taxes douanières ; ensuite, supprimer les droits de douane supplémentaires imposés sur les importations de pays non membres de l’Union européennes ; enfin, être plus sélectif dans l’octroi de protections.
Deuxièmement, il faudrait mettre fin à la régulation des prix et des marges et privilégier une action sur les structures de marché afin de renforcer la concurrence sur le marché de la distribution de détail. Cela relève de la compétence des autorités de la Nouvelle-Calédonie.
Pour notre part, nous proposons de créer une autorité de concurrence indépendante chargée du contrôle des pratiques anticoncurrentielles et des concentrations.
Il sera probablement tenu compte des nouvelles orientations définies par l’Autorité de la concurrence lors de l’examen à l’Assemblée nationale, les 9 et 10 octobre prochain, du projet de loi qui a été adopté ici même.
Il y a en outre, me semble-t-il, des recommandations qui pourraient être transposées en droit local. Il appartiendra aux autorités de la Nouvelle-Calédonie de s’en inspirer.
Nous avons été saisis par des parlementaires pour ce qui relève de l'État. En effet, si la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de lutte contre la vie chère, c’est bien l’État central qui est compétent – il y a eu un avis du Conseil d’État sur le sujet – en matière de tarification bancaire. Dans cette perspective, il nous a été suggéré, voire demandé d’interdire les frais de tenue des comptes bancaires, notamment pour les comptes ordinaires ; ce qui ne se pratique plus dans l’Hexagone se pratiquerait encore dans les outre-mer. Nous y souscrivons. J’espère que le problème pourra être réglé lors de l’examen du texte, les 9 et 10 octobre prochain.
Nous approuvons également – je l’ai déjà indiqué – la demande de création d’une autorité indépendante. En effet, on peut agir de deux manières : soit en renforçant les pouvoirs locaux, mais la décision appartiendra en dernière instance au gouvernement local, soit, et c’est tout aussi pertinent et adapté, en instituant une autorité indépendante de la concurrence habilitée à prononcer des sanctions, notamment à infliger des amendes. À mon sens, c’est une bonne manière de procéder.
Nous suivons avec attention ce qui se passe localement. Le congrès de Nouvelle-Calédonie s’est emparé de la question et un accord a été signé entre partenaires sociaux le 2 juin 2012. Un nombre assez important de produits, environ 400 produits semble-t-il, auraient été retenus pour faire l’objet d’un suivi particulier, afin d’éviter la vie chère.
Je ne vous cacherai pas que la situation des collectivités régies par l’article 74 et de la Nouvelle-Calédonie inspire un peu notre texte. En effet, conformément aux engagements du Président de la République, nous instituons ce que nous appelons un « bouclier qualité-prix ». En clair, entre 100 et peut-être 200 produits feront l’objet d’une négociation annuelle obligatoire. Chaque année, les partenaires sociaux examineront le prix global d’une liste limitative de produits au sein des observatoires des prix, sous l’autorité du préfet. C’est déjà, pour partie, ce qui se pratique en Nouvelle-Calédonie.
Dans le deuxième chapitre du projet de loi relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer, il y a des mesures de ratification d’ordonnances pour les collectivités concernées, en particulier pour la Nouvelle-Calédonie.
Voilà ce qui se fait, monsieur le sénateur. Mais ce qui se fera sera peut-être encore plus intéressant, puisque cela relève de vos propres compétences. Les élus néo-calédoniens peuvent prendre la décision de transposer ce qui se fait ici afin d’améliorer la concurrence, donc, je l’espère, de mieux défendre le pouvoir d’achat des habitants.

Monsieur le ministre, je vous remercie du suivi très attentif que vous portez à nos difficultés économiques.

La parole est à M. Philippe Bas, auteur de la question n° 8, transmise à Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion.

Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, ma question porte sur l’application de la taxe sur les salaires aux emplois des personnels recrutés par la maison départementale des personnes handicapées de la Manche.
Notre situation est un peu particulière puisque les personnels mis à disposition par l’État ont été pratiquement tous remplacés au fil des années par des agents recrutés directement par le groupement d’intérêt public de la maison départementale des personnes handicapées de la Manche. Et, à notre grande surprise, les services fiscaux ont réclamé le versement pour les années 2008 à 2011 d’une taxe sur les salaires d’un montant de 216 000 euros.
Pour un groupement d’intérêt public, ou GIP, créé sur l’initiative du législateur, composé exclusivement de personnes publiques et d’agents ayant une mission de service public sans mission autre que cette mission de service public, le principe même de l’assujettissement à la taxe sur les salaires est tout à fait surprenant. Nous souhaitons en conséquence que le Gouvernement revoie sa position à cet égard.
Dans l’hypothèse où cette position ne serait pas réexaminée et n’aboutirait pas à l’exonération de la taxe sur les salaires, il nous paraît indispensable que l’État contribue au versement de l’impôt à due proportion de sa participation aux dépenses de fonctionnement de la maison départementale des personnes handicapées, en l’occurrence à hauteur de 76 %.
Par conséquent, pour nous, l’alternative est claire : soit c’est l’exonération, soit c’est une subvention supplémentaire. D’ailleurs, je regretterais qu’elle s’impose au budget de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, car c’est une absurdité que de devoir ressortir l’argent qui serait rentré dans les caisses de l’État en suivant ce circuit pour le moins compliqué.
Monsieur le sénateur, je tiens à vous informer que le préfet de la Manche a tout récemment attiré mon attention sur la maison départementale des personnes handicapées, ou MDPH, de votre département. Mes services ont d’ores et déjà apporté des éléments de réponse aux questions soulevées à cette occasion, et ce sont sensiblement les mêmes que les vôtres.
Vous évoquez précisément les difficultés financières de la MDPH liées à son assujettissement à la taxe sur les salaires.
Les MDPH, constituées sous la forme de groupements d’intérêt public, sont en effet soumises à la taxe sur les salaires sur les rémunérations versées aux personnels dont elles sont employeurs, en application du premier alinéa de l’article 231 du code général des impôts, dès lors qu’elles ne sont pas soumises à la TVA ou qu’elles ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année précédente. Elles n’y sont pas soumises pour les rémunérations versées aux personnels mis à leur disposition, que ce soit par l’État ou par le conseil général.
Exonérer les MDPH du paiement de la taxe sur les salaires pourrait susciter des demandes reconventionnelles de la part des autres employeurs assurant également des missions d’action sociale et financés sur fonds publics. C’est le cas du monde associatif, des établissements publics ou de tous les autres GIP.
En outre, une telle exonération représenterait un manque à gagner pour le budget de la sécurité sociale, auquel le produit de la taxe sur les salaires est affecté.
Par ailleurs, vous demandez à l’État de compenser cette dépense. Or, dès 2006, l’État s’est engagé – vous le savez très bien – à apporter aux MDPH les moyens qui étaient antérieurement utilisés pour le fonctionnement des commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel, ou COTOREP, et des commissions départementales de l’éducation spéciale, les CDES, complétés par les moyens alloués au dispositif des sites pour la vie autonome tels que retracés dans les conventions constitutives.
Cet engagement s’est traduit par un versement global de l’État de 651, 6 millions d’euros entre 2006 et 2011 – là aussi, vous êtes bien placé pour le savoir –, ce qui représente un effort significatif compte tenu du contexte budgétaire actuel. Les dettes relatives aux exercices 2006 à 2010 ont en outre été honorées pour un montant de 24, 4 millions d’euros.
Si l’État doit compenser financièrement les postes non mis à disposition des MDPH, il ne saurait engager de frais supplémentaires liés aux décisions de recrutement du personnel des MDPH.

Madame la ministre, vous le comprendrez, je ne suis pas satisfait de votre réponse, qui ne tient pas compte des particularités de la maison départementale des personnes handicapées de la Manche.
Tout d’abord, sur le principe, je crois que le ministère des finances se livre à une interprétation extensive des textes en imposant un tel assujettissement. Je laisse ce point de côté.
Je voudrais souligner un autre élément. Dans la Manche, ceux qui sont recrutés et dont l’emploi est assujetti à la taxe sur les salaires sont non pas des personnels supplémentaires, mais bien les remplaçants des personnels de l’État qui avaient été initialement mis à la disposition. Il se trouve que les remplacements ont été très nombreux dans notre département, et ce pour une raison très simple : ces personnels de l’État habitent Cherbourg, alors que la maison départementale des personnes handicapées est à Saint-Lô, et ils n’ont rien eu de plus pressé que d’obtenir de nouvelles affectations pour le service de l’État sur Cherbourg.
Par conséquent, la maison départementale des personnes handicapées a remplacé les personnels de l’État. Comme l’État s’était engagé à fournir en nature un apport de personnel, il s’est aussi engagé à prendre à sa charge les remplaçants de ces personnels. S’il y a un surcoût lié non pas à une décision de la maison départementale, mais bien à l’application de la taxe sur les salaires, il me paraît parfaitement normal que l’État le prenne à sa charge, quelle que soit la manière dont il a honoré, ou pas, ses engagements sur les autres postes de dépenses de la maison départementale des personnes handicapées.
C’est la raison pour laquelle j’insiste en vous demandant de réexaminer votre position. La réponse qui a été apportée par écrit au préfet voilà quelques mois n’est pas du tout satisfaisante, et la réponse que vous venez de faire ne l’est pas non plus, madame la ministre.

La parole est à M. Bernard Cazeau, auteur de la question n° 131, adressée à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.

Ma question porte sur une difficulté d’interprétation juridique relative à l’aide à la prise des médicaments assurée par les assistants maternels pour les enfants dont ils ont la garde.
En effet, jusqu’à très récemment, nous avions eu des certitudes sur la légalité des actes des assistants maternels en ce domaine. Un avis du Conseil d’État du 9 mars 1999, puis une circulaire du 4 juin 1999 indiquèrent que l’aide à la prise d’un médicament qui ne présente pas de difficulté particulière ni d’apprentissage peut être laissée par le médecin à l’initiative de la personne, de sa famille ou d’un tiers aidant.
Aussi, il avait été admis qu’un assistant maternel pouvait aider l’enfant à prendre des médicaments, à la double condition que le médecin ait délivré une ordonnance et un protocole médical.
Or une récente réponse à une question orale au Gouvernement du 30 mars 2011 – question orale n° 1375 de M. le député Philippe Vigier – a pu semer le doute chez les professionnels de la petite enfance à ce sujet.
Elle affirme que l’aide à la prise de médicaments pour les enfants de moins de six ans ne pouvait être considérée comme un acte usuel de la vie courante, sauf exceptions justifiées.
Ainsi, la seule dérogation admise actuellement relève de la possibilité pour les infirmiers, les puéricultrices et les auxiliaires de puériculture, sous leur contrôle, d’aider les enfants accueillis dans les établissements d’accueil autorisés à cet effet.
Cette réponse n’a pas, en elle-même, de portée juridique coercitive.
Elle sous-entend cependant que les assistants maternels à domicile ne pourraient aider à la prise de médicaments, même avec une ordonnance en bonne et due forme et un protocole du médecin, et n’écarte pas, du moins en théorie, une accusation d’exercice illégal de la fonction d’auxiliaire médical.
L’interprétation stricte de ces modalités conduirait à l’impossibilité d’accueillir tout enfant devant observer un traitement médical.
En outre, elle entrerait en contradiction avec le décret relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants maternels publié le 15 mars 2012. Celui-ci prévoit dans les critères d’évaluation du candidat à l’agrément « la capacité à appliquer les règles relatives à l’administration des médicaments ».
Au vu de cette discordance, je souhaite madame la ministre, que vous précisiez le champ des devoirs et obligations, ainsi que le rôle des assistants maternels accueillants des enfants de moins de six ans en ce qui concerne l’aide à la prise de médicaments.
Monsieur le sénateur, vous avez raison de le rappeler, la réponse à la question orale au Gouvernement du 30 mars 2011 a soulevé beaucoup d’interrogations sur la possibilité pour un assistant maternel d’administrer des médicaments à un enfant dont il a la garde.
En effet, selon cette réponse, l’administration des médicaments ne peut être autorisée pour tous les personnels de crèches, mais seulement pour les infirmiers, les puéricultrices ou les auxiliaires de puériculture, sous leur contrôle.
Cette réponse a ainsi été interprétée comme revenant implicitement à interdire aux assistants maternels d’administrer des médicaments, sauf en cas de situation de péril imminent et constant. Elle revient donc à rendre, en principe, impossible tout accueil d’un enfant malade par un assistant maternel.
Pour lever le doute sur cette question, une circulaire du 27 septembre 2011 de la direction de la sécurité sociale et de la direction générale de la santé a permis de préciser que, dans le cas d’un médicament prescrit, si le mode de prise ne présente pas de difficultés particulières ni de nécessité d’apprentissage, et lorsque le médecin n’a pas demandé l’intervention d’un auxiliaire médical, l’aide à la prise du médicament est considérée comme un acte de la vie courante.
Concrètement, cela signifie que seule l’autorisation des parents, accompagnée de l’ordonnance médicale prescrivant le traitement, suffit à permettre aux assistants maternels d’administrer les médicaments requis aux enfants qu’ils gardent.
De plus, afin que ces règles soient bien connues des assistants maternels, le décret du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants maternels prévoit que soit prise en compte pour l’examen d’une demande d’agrément la capacité du candidat à appliquer les règles relatives à l’administration des médicaments.
Pour conclure, monsieur le sénateur, je vous remercie d’avoir posé cette question. Elle nous donne l’occasion d’affirmer qu’il n’existe pas de contradiction dans la réglementation. Le champ des devoirs et obligations, ainsi que le rôle des assistants maternels est clairement défini par la réglementation existante, et garantit pleinement la sécurité des enfants.

Je remercie Mme la ministre de cette réponse à la fois claire et rassurante pour les assistants maternels.
Elle simplifiera beaucoup de choses, notamment pour les formateurs qui rencontraient des difficultés à formuler une réponse satisfaisante sur ce point depuis la question de M. Vigier.
Par ailleurs, les assistants maternels, privés de la possibilité d’administrer des médicaments sur prescription médicale, avaient le sentiment d’un manque de reconnaissance.
Vous levez aujourd’hui une ambiguïté héritée du précédent gouvernement et vous ouvrez des perspectives.

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, auteur de la question n° 97, adressée à M. le ministre du redressement productif.

Monsieur le ministre, je suis très heureux que vous répondiez en personne à ma question, car vous êtes très directement concerné par ce dossier.
Intermarché a décidé, sans dialogue social, de délocaliser sa base de Lectoure dans le Gers et ses 315 salariés vers Montbartier dans le Tarn-et-Garonne, alors que celle-ci est bénéficiaire.
De plus, Intermarché avait reçu lors de son implantation des subventions de l’État, de la région, du département du Gers et de la ville de Lectoure. Tout cet argent public sera-t-il donc gaspillé ?
Dans ce contexte, chacun se remémore vos engagements contre les délocalisations et en faveur de la ruralité.
Lectoure en est le symbole. Les 315 salariés concernés représentent le dixième de la population de la ville. Pouvez-vous accepter le désastre que cette délocalisation représenterait pour tout le canton, pour son économie, pour ses écoles, pour les salariés qui se sont endettés afin de bâtir et qui auront beaucoup de difficultés à retrouver un emploi ? Non, vous ne le pouvez pas, car c’est inacceptable !
Cette délocalisation, totalement injustifiée économiquement, entraînera une catastrophe sociale. Elle va à l’encontre de la justice sociale proclamée par le Gouvernement.
Intermarché donnerait le choix à ses salariés : soit ils démissionnent, soit ils font 150 kilomètres chaque jour. Pour des employés payés au SMIC, cela représenterait, selon le barème fiscal de 0, 36 euro par kilomètre, plus de 10 000 euros par an : c’est irréaliste et inacceptable !
C’est inacceptable parce que les salariés seraient, de plus, embauchés dans une nouvelle structure, ce qui s’accompagnera pour eux d’une perte d’ancienneté. C’est contraire à la loi, plus précisément à l’article L. 122-12 du code du travail.
C’est inacceptable, car la région, qui a participé au financement de la zone industrielle accueillant cette nouvelle implantation, précise « qu’elle ne peut bénéficier d’aucune aide sauf accord entre la commune de départ et la commune d’implantation » ; il n’y pas d’accord !
Monsieur Montebourg, un ministre de ce gouvernement va-t-il laisser faire une délocalisation contraire à la loi et à la morale sociale, toutes deux ni de droite ni de gauche ?
Dimanche encore, vous affirmiez : « Je suis aux côtés de ceux qui ont peur de perdre leur emploi. » Allez-vous laisser passer l’opportunité, monsieur le ministre, de mettre vos actes en accord avec vos déclarations ?
Monsieur le sénateur, je vous remercie de votre question, du ton que vous y avez mis et de votre engagement en faveur du département du Gers, particulièrement de la belle ville de Lectoure.
Le ministère du redressement productif a été informé du projet de délocalisation de la base de produits frais Intermarché du Gers vers Montbartier dans le Tarn-et-Garonne par le maire de Lectoure, qui a été reçu par mon cabinet le 12 juin dernier.
Les dirigeants d’Intermarché, plus particulièrement le directeur de la logistique, ont également été reçus conjointement par mon cabinet et par celui du ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme le 9 juillet dernier, en présence du président du conseil général du Gers.
Il s’agissait d’obtenir d’Intermarché, qui avait effectivement été aidé dans son implantation en 1993 par les collectivités locales, des explications sur un projet qui menace près de 300 emplois directs et indirects, ce qui est beaucoup par rapport à la population de la commune.
Le groupe Intermarché a expliqué son choix par la recherche d’une implantation optimale des plates-formes logistiques dictée par la recherche d’une réduction du nombre de kilomètres parcourus pour assurer l’approvisionnement de ses magasins, dont les implantations se sont, elles-mêmes, fortement diversifiées depuis vingt ans. Telle est la position du groupe Intermarché.
En outre, Intermarché souhaite promouvoir des bases multi-activités pour optimiser ses livraisons. Le groupe souligne l’éloignement de Lectoure du principal réseau autoroutier. Intermarché, déterminé à faire aboutir son projet, a également indiqué souhaiter anticiper les conséquences de sa décision pour les salariés de Lectoure comme pour le bassin d’emploi. Son projet – toujours d’après le groupe – ne trouverait sa concrétisation qu’à échéance de trois ans.
Le ministère du redressement productif a exprimé son désaccord à l’égard d’Intermarché et a souligné l’extrême gravité pour le bassin d’emploi de Lectoure de la décision prise par le groupe. Il a rappelé l’entreprise à ses responsabilités vis-à-vis des salariés comme des collectivités locales qui l’ont accompagné dans son implantation.
Par ailleurs, nous avons rappelé que les textes en vigueur prévoyaient le remboursement des aides publiques en cas de délocalisation, même à 75 kilomètres du lieu.
Le ministère a demandé à Intermarché de reconsidérer le projet compte tenu de ses conséquences économiques et sociales pour Lectoure.
En tout état de cause, il n’est pas possible qu’Intermarché, dans le délai de trois années, se sépare de Lectoure sans encourir de sanctions. Si le groupe persistait dans son projet, nous lui demanderions des réparations pour le préjudice subi.
Monsieur le sénateur, je puis vous assurer que nous aurons l’occasion de reparler de ce projet de délocalisation, que le Gouvernement désapprouve.

Monsieur le ministre, j’ai été, dans un premier temps, abasourdi par votre réponse, qui reprenait les arguments du groupe Intermarché !
Je les ai repris, mais uniquement pour exposer la position du groupe ; c’est une position que le Gouvernement réprouve !

Quoi qu’il en soit, vous n’avez répondu qu’en partie à ma question.
Vous l’avez rappelé, le groupe Intermarché a reçu des fonds publics en provenance de l’État, de la région, du département et de la commune. La ville de Lectoure vient à peine de finir de rembourser ses emprunts. Et on voudrait la priver d’un élément essentiel pour elle, qui touche près du dixième de sa population ! Il est donc impératif qu’Intermarché rembourse les aides versées.
Néanmoins, il est également essentiel qu’Intermarché respecte la loi. Aujourd’hui, ce que propose le groupe est contraire au code du travail, code que vous devez faire respecter.
J’attends de vous, monsieur le ministre, que vous fassiez preuve d’une grande pugnacité sur ce dossier. La délocalisation de la base de produits frais Intermarché de Lectoure est un désastre pour tout un canton. Je pense aux écoles qui fermeront dans les villages alentour si les familles déménagent. Cette délocalisation aura des répercussions calamiteuses en chaîne.
Je vous demande donc, monsieur le ministre, de mettre tout votre poids pour faire appliquer la loi, conformément à vos déclarations pendant la primaire socialiste et à vos propos en tant que ministre, afin d’éviter la catastrophe sociale et économique qui se prépare.
Monsieur de Montesquiou, il est hors de question que l’on déroge à la loi pour Intermarché. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur et sa vertu. Si elle s’avère insuffisante, nous aurons à faire preuve de pugnacité. Vous demandez la pugnacité du Gouvernement, vous l’aurez, monsieur le sénateur !

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, auteur de la question n° 51, adressée à M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche.

Monsieur le ministre, le fret ferroviaire SNCF est en chute constante. J’ai interpellé, ici même à de nombreuses reprises, les différents ministres des gouvernements successifs. Malgré les discours, malgré les bonnes intentions du Grenelle de l’environnement, la situation ne fait qu’empirer chaque année un peu plus.
La part du ferroviaire dans le transport de marchandises en France est passée de 30 % en 1984 à 9, 5 % en 2011, avec un nouveau recul en 2012, alors que le Grenelle de l’environnement avait fixé l’objectif de porter la part modale du non-routier et du non-aérien à 25 % pour 2022.
Cela est d’autant plus incompréhensible et absurde économiquement que ce recul se produit dans une période d’augmentation des prix du pétrole, qui ont été multipliés par trois depuis 2000 et qui risquent de doubler à l’horizon 2025.
Le transport routier de marchandises continue, lui, d’augmenter : il représente 88, 3% de la part du marché et porte la responsabilité de 93, 7% des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport, sans compter les autres polluants ayant des conséquences sur la santé et les milieux naturels.
Les chargeurs sont bien souvent contraints de faire ce choix du transport routier par manque de proposition viable par voie ferrée. Nous savons que des clients n’obtiennent pas toujours les réponses à leurs demandes. Je peux vous dire, monsieur le ministre, qu’ils seraient plus nombreux à faire le choix du transport par voie ferrée s’ils se sentaient plus écoutés.
Ne faudrait-il pas décentraliser les services commerciaux en région afin d’apporter une réponse adaptée et pertinente aux chargeurs ?
La création des autoroutes ferroviaires, que l’on nous donne toujours comme perspective – c’est en tout cas la réponse que l’on m’a systématiquement faite – ne permettra pas, à elle seule, de redresser la situation. On sait que ce système ne peut, au plus, transporter que 0, 5 % à 1 % des marchandises.
C’est une réponse économique, sociale et financière globale qui doit être élaborée pour répondre aux besoins de ce secteur. Mais cela ne pourra se faire sans un engagement politique.
Il faudrait amplifier le travail entrepris sur la qualité du réseau alors qu’une récente enquête de la Cour des comptes effectuée à la demande de la commission des finances fait état d’une grave incertitude sur le financement futur de l’effort de rénovation du réseau.
Il faut également rouvrir, de toute urgence, les gares de fret fermées par le précédent gouvernement, et les moderniser.
Il faut remettre sur les rails les wagons isolés qui ont fait leur preuve chez nous et qui continuent à se développer dans d’autres pays européens, comme en Allemagne, si souvent donnée en exemple, alors que la France est en forte régression.
Le Centre d’analyse stratégique a émis récemment des préconisations, dont certaines sont intéressantes. L’une d’elles en particulier vise à encourager le développement de plateformes multimodales.
Le 13 septembre 2007, j’interpellais ici même Dominique Bussereau, alors secrétaire d'État aux transports, en ces termes : « La gare de triage de Saint-Pierre-des-Corps pourrait devenir le grand hub manquant sur ce territoire, car c’est un point stratégique pour les grandes circulations nord-sud et ouest-est. »
Le 22 juillet 2010, il reconnaissait la pertinence de notre site et déclarait : « Saint-Pierre-des-Corps est une plaque tournante importante. » Mais depuis, aucune réponse concrète n’a été apportée.
La grande région Ouest est abandonnée en matière de transport ferroviaire ! C’est un sentiment largement partagé. Mettons-nous autour de la table, monsieur le ministre. Un groupe de travail pourrait se réunir, à votre initiative, sur Saint-Pierre-des-Corps et travailler à cette dynamisation avec les partenaires du fret SNCF. Le potentiel existe véritablement.
Cela va dans le sens de la décision de votre ministère de mettre en place une « commission des sages » afin d’évaluer les projets d’infrastructures de transports en vue d’un meilleur aménagement du territoire.
C’est par une politique volontariste orientée vers le développement du trafic et non par sa réduction que le fret SNCF pourra trouver un nouveau rebond.
Monsieur le ministre, je vous demande donc aujourd’hui quelle nouvelle orientation donnera le Gouvernement à la SNCF pour que le redressement du fret ferroviaire se produise enfin et quelles mesures immédiates et urgentes sont à l’ordre du jour pour inverser la tendance.
Madame la sénatrice, je vous remercie de votre question, qui met en exergue tout l’intérêt que vous portez au ferroviaire, particulièrement au fret.
Vous l’avez justement signalé, les déclarations ont été nombreuses dans le cadre du Grenelle de l’environnement, qui avait vertueusement fixé l’objectif ambitieux de porter la part du transport alternatif à la route de 14 % à 25 % à l’horizon de 2022. Cela devait passer par la nécessaire reconquête de parts de marché du fret ferroviaire.
Les annonces du précédent gouvernement, comme vous l’avez vous-même souligné, étaient louables en la matière mais elles n’ont pas été suivies d’effet. Le Gouvernement actuel est déterminé à redonner sa juste place au fret ferroviaire, qui est un mode écologique et sûr dans le cadre d’une politique de report modal vers les transports les plus respectueux de l’environnement.
Il ne s’agit pas pour moi de faire de grandes annonces, nous n’en avons eu que trop d’exemples, mais bien de prendre en compte de façon pragmatique le dossier du fret ferroviaire, comme vous m’y invitez, afin de lever les blocages réels en mettant en place des mesures destinées à renforcer la pertinence et la performance des opérateurs.
Donc, il n’est pas question ici d’annoncer des mesures miracles mais bien d’afficher des objectifs qui soient à la fois réalistes et qui permettent d’affirmer la volonté et l’ambition du Gouvernement de répondre à cet enjeu.
Vous l’avez souligné, il faut que les freins, notamment la pertinence de la demande locale, puissent être pris en compte et que le développement du fret ferroviaire passe par des actions pratiques.
Les autoroutes ferroviaires, que vous avez évoquées, seront un axe de développement, mais je ne veux pas suivre l’exemple de mes prédécesseurs, qui, depuis 2007, dites-vous, vous renvoient dans leurs réponses à la seule perspective des autoroutes ferroviaires. Encore faut-il, pour qu’il y ait autoroutes ferroviaires, qu’il y ait pertinence des sillons, notamment que des corridors puissent être mis en place en fonction d’un plan d’aménagement du territoire.
Les services du ministère travaillent actuellement sur cette question afin de favoriser une connexion entre ces autoroutes ferroviaires et les ports français, notre façade portuaire pouvant constituer un élément fort de la compétitivité française. C’est en effet en irriguant par des infrastructures pertinentes l’hinterland que nous réussirons à désenclaver les ports français, et c’est en mettant en place des plateformes portuaires de transport combiné que nous favoriserons le développement de ce mode de transport.
Il y a quelques jours, la solution heureuse – en tout cas moins malheureuse que nous ne le redoutions – trouvée pour Novatrans a permis de sauver plusieurs centaines d’emplois. C’est à la fois une satisfaction mais aussi un motif de regret puisque cela signifie que l’opérateur ferroviaire historique se retire de ce transport combiné.
Il faut donc le réorienter, il faut porter une exigence, notamment vis-à-vis de Fret SNCF, de manière que, dans le cadre de rencontres régionales, les demandes, là où elles existent, puissent être analysées, et que l’opérateur de fret soit en mesure de fournir aux entreprises un service de qualité répondant à leurs besoins.
Les petites entreprises seront effectivement les donneurs d’ordre et un certain nombre d’opérateurs, aujourd’hui, apparaissent sur le marché.
Pour autant, tant que nous n’aurons pas réglé la question de l’écart de coût parfois extrêmement sensible entre la route et le rail, la compétitivité du ferroviaire restera insuffisante.
À cet égard, la mise en place de l’écotaxe poids lourds permettra, bien évidemment, de financer des projets d’aménagement. J’ai parlé des plateformes, du rehaussement du niveau de qualité du réseau ferroviaire qui est, comme vous l’avez signalé, extrêmement préoccupant.
Il s’agit non pas de jouer la route contre le fer ou le fer contre la route mais bien de développer une vision combinée de l’ensemble des modes de transports, notamment de marchandises, sachant que, derrière tout cela – c’est vrai à Saint-Pierre-des-Corps comme ailleurs –, c’est l’emploi, en particulier l’emploi ferroviaire, qui compte.

Monsieur le ministre, j’ai bien entendu votre réponse. Je crois en effet – et c’est le sens de ma question – qu’il faut examiner comment, régionalement, un certain nombre de problèmes pourraient trouver une réponse.
Nous constatons qu’un certain nombre de trains qui, autrefois, prenaient du fret en passant par notre gare continuent de la traverser mais ne prennent plus de fret. Cela signifie qu’on a modifié la conception dans laquelle on travaillait mais que, parallèlement, on n’a pas apporté de réponse à ceux qui étaient utilisateurs du fret jusqu’à maintenant et que l’on renvoie vers la route un certain nombre d’opérateurs qui étaient pourtant très intéressés par la conservation de ce fret.
Par ailleurs, au motif de mieux équilibrer les comptes, on fait aux entreprises qui jusqu’à maintenant utilisaient le fret des propositions dans lesquelles les prix sont multipliés par deux ou par trois : il est évident que la route est alors choisie prioritairement.
J’espère donc que votre proposition d’accélérer la mise en œuvre de la taxe poids lourds – qui, depuis le temps qu’il en est question, n’est pas sans rappeler l’Arlésienne ! – nous aidera à mieux faire prendre en compte la réalité du coût du transport routier. D’autres mesures en ce sens, que je n’évoquerai pas dans cette courte intervention, seront nécessaires.
Mon souci, c’est vraiment qu’on puisse trouver des solutions concrètes. Je serai donc amenée à prendre contact avec votre cabinet, monsieur le ministre, afin que puisse être mené un travail peut-être plus spécifique sur l’avenir régional du fret ferroviaire.

La parole est à M. Jean-Patrick Courtois, auteur de la question n° 60, adressée à M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche.

Monsieur le ministre, je tiens à appeler votre attention sur le dossier de mise à deux fois deux voies totale de la route Centre Europe Atlantique, RCEA, notamment entre Montmarault et la ville de Mâcon, dont je suis le maire, et entre Paray-le-Monial et Chalon-sur-Saône pour la branche nord.
La mise à deux fois deux voies complète et la sécurisation de la RCEA est, aujourd’hui, attendue par l’ensemble des habitants, des riverains, des élus et des acteurs économiques des départements de l’Allier et de la Saône-et-Loire.
À la suite du débat public qui a été organisé sur ce dossier en 2010-2011, le présent Gouvernement a décidé, l’été dernier, de retenir l’option de la mise en concession pour financer ce projet.
Opposé à cette solution, le conseil général de Saône-et-Loire propose de recourir au dispositif de l’écotaxe, avec tous les problèmes juridiques que cela pose.
D’autres élus, dont je fais partie avec René Beaumont, qui siège à mes côtés, militent, quant à eux, pour la solution de la mise en concession avec franchise de péage, ce qui permettrait d’assurer le financement pérenne de ce projet, sa rapidité de réalisation, tout en garantissant la gratuité pour les usagers locaux de cette route, ce qui paraîtrait tout à fait justifié puisque les départements ont financé, avec l’État et la région, déjà une grosse partie de ces travaux.
Aujourd’hui, le flou est le plus complet sur l’avenir de ce dossier puisque les intéressés ont appris, récemment par voie de presse, à la fois que le lancement d’avis de la procédure d’attribution de marché avait été initié par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne pour la mise en concession autoroutière, mais aussi que les travaux de génie civil pour la mise en place des portiques de points de contrôles pour l’écotaxe poids lourds, sur ce tronçon de la RCEA, débuteraient cet été.
Au regard de l’urgence de ce dossier, il nous paraît indispensable de connaître quel mode de financement sera choisi pour ce projet, sachant que les contingences financières actuelles tant de l’État que du conseil général de Saône-et-Loire sont limitées et, surtout, quel calendrier sera retenu pour le déroulement des travaux de la mise à deux fois deux voies totale de la route Centre Europe Atlantique.
Compte tenu de l’attente de la population et du caractère particulièrement accidentogène de cette route – deux morts supplémentaires ont malheureusement été dénombrées ce week-end –, je souligne que ces précisions sont très attendues, monsieur le ministre, tant par les élus que par la population.
Monsieur le sénateur, je vous remercie de votre question ; elle me permet de revenir sur l’actualité de ce dossier qui a provoqué une grande émotion sur le territoire concerné. Permettez-moi, à mon tour, de donner un certain nombre d’explications.
J’ai conscience des difficultés que soulève ce dossier. Cet itinéraire, qui est emblématique des risques que fait peser le manque de sécurité de cette infrastructure, mêle des trafics locaux à un important trafic longue distance, constitué notamment de très nombreux poids lourds. La situation est donc extrêmement préoccupante sur le plan de la sécurité.
Vous y avez fait référence, on constate de trop nombreux accidents graves, mortels même, et ce week-end en a encore été la preuve.
La mise à 2x2 voies de cette route apparaît comme la solution qui permettrait de répondre le mieux à ces enjeux tout en améliorant la qualité de service de cet axe, ainsi que la desserte et le développement des territoires qui en ont besoin. Les investissements nécessaires sont toutefois importants : ils sont estimés entre 950 millions et un milliard d'euros. Se pose dès lors la question centrale de leur financement.
Vous l’avez dit, le précédent gouvernement a décidé, à l’issue d’un débat public, de recourir à la mise en concession de l’axe pour financer la mise à 2x2 voies de la RCEA. Cette décision a soulevé, et continue de soulever, l’inquiétude de nombreux usagers locaux de cette route quant à l’évolution du coût d’usage de la voie. Elle pose également un problème de légalité. En effet, compte tenu d’un nombre insuffisant d’itinéraires alternatifs, une fois la RCEA devenue payante, quid du libre accès et, notamment, de la liberté de circulation ? Tous ces points doivent être expertisés.
Des solutions de financement sans mise à péage – j’en parlais il y a un instant avec mon collègue Arnaud Montebourg – ont été proposées. Le département de Saône-et-Loire avait décidé d’utiliser les recettes, qui bénéficient aux conseils généraux, de l'écotaxe poids lourds perçue sur une partie de la RCEA et sur des itinéraires départementaux. Cette taxe permet ainsi d’apporter un cofinancement, conformément d’ailleurs à sa finalité : permettre l'amélioration et la modernisation des équipements et des infrastructures routières ou autoroutières.
D'autres perspectives avaient été envisagées, comme le transfert au conseil général de la Saône-et-Loire d’une partie de l'itinéraire, à charge pour lui de l'aménager.
La commission du débat public à laquelle vous avez fait référence faisait d’ailleurs état dans ses conclusions des divergences d’opinion sur le dossier et de la tension perceptible sur les territoires. Elle émettait « le souhait que les propositions alternatives de montage financier, les propositions d’aménagement de sécurité et les principaux amendements soient examinés de façon contradictoire, au besoin chiffres contre chiffres, afin que les ministres disposent de tous les éléments d’appréciation avant leur prise de décision, mais également afin que les auteurs de ces propositions aient le sentiment d’avoir été respectés, conformément aux principes du débat public ». Eh bien, c'est précisément ce que je fais.
Nous tirons aujourd'hui la conséquence des conclusions de ce débat, ce qui n’avait pas été fait : il est nécessaire de procéder à des analyses et à des échanges et de faire expertiser les différentes solutions. J’ai très rapidement demandé qu'une expertise soit menée et, avant même que la décision n'ait été publiquement annoncée, j’ai confié, dès cet été, une étude au Conseil général de l'environnement et du développement durable, le CGEDD. Il lui revient de mettre à plat l’ensemble des dispositifs envisageables, d'expertiser tous les montages possibles pour satisfaire les attentes légitimes des élus sur les différents territoires, quels que soient les départements concernés. Le CGEDD rendra ses conclusions au plus tard dans quatre ou cinq mois.
Pour autant, on ne peut se satisfaire de la situation dont j'hérite. Je tiens à vous préciser qu'aucune procédure de mise en concession n’a été lancée, contrairement à ce que vous avez indiqué. L’avis d’appel d’offres auquel vous faites référence portait simplement sur un marché d’assistance dans le pilotage technique du dossier.
Par ailleurs, la RCEA étant toujours dans le réseau routier national non concédé, il est normal que son usage soit soumis à la future taxe poids lourds comme le reste du réseau routier structurant français ; cela explique la mise en place des portiques auxquels vous avez fait allusion.
Quoi qu'il en soit, on ne peut faire l’économie du temps nécessaire à l'expertise si l’on veut se fonder sur des analyses pertinentes. Sachez que je suis particulièrement mobilisé, tout comme les services de mon ministère, pour faire en sorte que les délais de l’expertise réalisée par le CGEDD soient tenus afin que nous puissions rapidement avoir pleine connaissance de toutes les possibilités de financement et de cofinancement. Je n'exclus pas la concession mais, avant de prendre toute décision, je veux être informé de toutes les solutions envisageables dans le cadre d’un nouvel environnement financier.
En effet, l’écotaxe poids lourds sera effective dès 2013. Il revient donc à notre gouvernement la responsabilité de la mettre en œuvre, et nous l’assumerons. Une occasion nous est ainsi donnée d’ouvrir une discussion avec les collectivités locales.
Au demeurant, dès 2012, le ministère a débloqué une enveloppe de 40 millions d’euros dans Allier et dans la Saône-et-Loire pour que, ainsi que je l'avais indiqué lorsque la décision a été prise, des mesures concrètes soient rapidement mises en place sur les tronçons les plus accidentogènes.
Voici les résolutions prises par le Gouvernement sur ce dossier : de la clarté, une expertise sérieuse et une décision rapide.

Monsieur le ministre, nous sommes d'accord sur un certain nombre de points, notamment sur le coût des travaux, qui s’élèverait à un milliard d'euros. S’agissant des deux départements traversés, je rappelle que celui de l'Allier était d'accord pour la concession et que ne restait donc que le problème de la Saône-et-Loire.
Le dossier soulève par ailleurs des questions juridiques puisque l'écotaxe, dont vous avez parlé dans le cadre de la question précédente, doit normalement servir au développement des transports alternatifs. Une autre utilisation supposerait tout de même de modifier la loi, ce qui prendrait un certain temps !
Nous avons, nous aussi, fait des calculs. Aussi aimerions-nous nous être associés aux travaux qui sont actuellement menés à votre demande pour examiner toutes les possibilités envisageables. Nous avons calculé ce que la Saône-et-Loire devrait emprunter pour terminer les travaux en prenant les chiffres donnés dans le débat public pour l'écotaxe, et en en déduisant le delta restant à la charge du département. Le montant est considérable, d’autant qu’il faut y ajouter les frais d'entretien et de fonctionnement de la route, lesquels sont loin d'être négligeables.
L’entretien d’une route à 2x2 voies – j’en ai une sur le territoire de ma commune – représente un coût considérable, rien que pour le déneigement. Je le répète, je suis tout à fait d'accord, si vous le souhaitez, pour travailler avec la commission afin de prendre la meilleure décision possible dans les délais les plus rapides.
Par ailleurs, je vous rejoins sur les problèmes que pose une mise en concession totale sans itinéraires alternatifs. J'ai été maire d'une commune dans laquelle il n'y avait pas de voie alternative. Nous avons proposé, comme cela a été fait aux alentours de Dijon et au sud de Paris, d’ouvrir des secteurs libres d'accès, afin de permettre la circulation intra-muros et de ne pas gêner le financement des autoroutes.
Tous ces éléments doivent être examinés avec attention, monsieur le ministre, dans l'intérêt des territoires et surtout des usagers de cette route. Si vous le souhaitez, je le redis, je suis tout à fait prêt, avec René Beaumont et l'Association pour la route Centre-Europe-Atlantique, à travailler avec la commission pour trouver sinon la meilleure solution, du moins la moins mauvaise.

La parole est à M. Didier Guillaume, auteur de la question n° 41, adressée à M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche.

Mais il n’y a pas que les vins de la Drôme : il y a aussi ses bouchons !
Nouveaux sourires.

Selon les derniers comptages effectués en novembre 2011, on enregistre un trafic journalier de l’ordre de 23 000 véhicules, dont près de 1 400 poids lourds et une moyenne de trente convois exceptionnels, le trafic pouvant même atteindre 35 000 ou 40 000 véhicules par jour en période de pointe, notamment en été. Personne ne peut nier l’impact de cette situation en termes de nuisances, notamment de pollution sonore en centre-ville.
Monsieur le ministre, ce projet de déviation répond à une nécessité, au regard à la fois de la fluidité du trafic et, dans un secteur particulièrement accidentogène, de la sécurité routière.
L’état d’avancement du projet laisse perplexe : les terrains sont acquis, les expropriations ont été menées à bien, vingt maisons auraient été détruites, le tracé est piqueté depuis de très nombreuses années, mais, de report en report, d’étude en étude, et après la réalisation d’un premier rond-point qui ne débouche sur rien, tout le monde se demande si le projet n’est pas maintenant au point mort et si la déviation verra jamais le jour, faute de financements.
Pourtant, des intentions, il y en a bien eu : le précédent Président de la République lui-même, à la fin de 2008, avait fait figurer ce dossier dans son plan de relance. Ce projet avait également déjà été inscrit dans le contrat de projet État-région 2000-2006. D’annonce en annonce, le temps passe et l’on ne parle plus, semble-t-il, que de la réalisation d’un barreau central, qui, au lieu de jouer le rôle de déviation, risque de se transformer en souricière s’il n’est pas immédiatement suivi de la réalisation effective, au sud comme au nord, des branches d’accès aux communes de Loriol et de Livron.
Après de nombreuses fluctuations, le coût d’objectif a été fixé par l’État à 95 millions d’euros. Cependant, hormis les études et les travaux préparatoires, selon les informations recueillies auprès des services de l’administration, seuls 18 millions d’euros seraient aujourd’hui réellement disponibles, en plus des 12 millions d’euros déjà dépensés. Mettre 30 millions d’euros sur la table pour un projet dont tout le monde sait qu’il en coûtera au moins le triple, ce n’est pas sérieux ! Qui paiera les 65 millions qui manquent ?
Aucun d’entre nous n’ignore la situation financière de notre pays, et notre inquiétude quant à l’avancement de ce projet ne s’en trouve que renforcée. Les habitants de Livron et de Loriol seront-ils sacrifiés sur l’autel des promesses non tenues du précédent gouvernement ? Personne n’ose y croire, monsieur le ministre, et c’est au nom de l’ensemble des élus et des habitants de la Drôme que je vous questionne sur ce projet : oui ou non, la déviation de Loriol-Livron se fera-t-elle ? Et si oui, avec quel financement global et dans quels délais de réalisation ?
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche. Monsieur le sénateur, je vous remercie pour cette entrée en matière qui nous fait rêver et qui sonne comme une invitation à venir découvrir le patrimoine culturel et gastronomique de votre beau territoire, à condition, bien entendu, que cela ne crée pas des bouchons supplémentaires !
Nouveaux sourires.
Vous avez raison d’attirer de nouveau – nous nous sommes déjà entretenus de cette question – mon attention sur l’opération de déviation Livron-Loriol sur la mythique RN7, ce qui montre bien votre implication dans ce dossier.
Je connais vos préoccupations. Il est vrai que la RN7 joue un rôle très important en termes de desserte locale et de liaison entre les agglomérations pour les courtes distances. Quoi qu'il en soit, le trafic sur le tronçon qui traverse Livron et Loriol, s’il reste constant depuis plusieurs années, est particulièrement dense : environ 15 000 véhicules par jour en 2011.
Vous l’avez rappelé, la déviation de Livron et Loriol par la RN7 a été déclarée d’utilité publique en décembre 2001. Les emprises nécessaires à la réalisation du projet ont été, depuis, intégralement acquises et l’opération a connu des débuts de réalisation. Je me souviens que vous aviez déjà évoqué devant moi ce fameux rond-point qui ne mène nulle part. Il convient qu’une programmation connaisse une concrétisation, qu’un suivi soit assuré et que l’achèvement d’un projet s’inscrive dans un horizon déterminé ; il y va de la crédibilité de l’État.
Bien sûr, je ne saurais être engagé par des promesses qui ont été multipliées par d’autres, particulièrement dans le domaine des infrastructures et du transport. Vous le savez, le schéma national des infrastructures de transport, le SNIT, représentera une facture de 245 milliards d’euros d’ici à 2025, alors même que l'État ne peut en financer que 2 milliards d’euros par an.
Au-delà de la multiplication des engagements, c'est surtout un manque de sérieux et de réalisme qui a entouré ces promesses, fussent-elles présidentielles.
Aussi, nous avons souhaité mettre en place très rapidement une commission d’expertise du SNIT, permettant que tous les engagements et toutes les promesses en matière d’infrastructures soient expertisés en termes de faisabilité, tant sur le plan économique qu’au regard des partenariats avec les collectivités locales, sachant que la situation dont nous héritons en matière de finances publiques est particulièrement contrainte.
Ma responsabilité est de vous dire la vérité, là où d’autres ne se sont pas appliqué un tel principe ni soucié de tenir un discours réaliste.
Cela étant, comme vous le faites observer très justement, nous ne saurions sacrifier les habitants de Livron et de Loriol et il nous faut, comme pour d’autres opérations d’aménagement du réseau routier national, inscrire le financement de cette déviation dans les programmes de modernisation des itinéraires routiers, les PDMI, qui succèdent au volet routier des contrats de plan État-région.
Un montant de 300 millions d’euros a été inscrit au PDMI actuel de la région Rhône-Alpes pour y mener à bien la modernisation du réseau national, dans le cadre d’un cofinancement entre l’État – pour près de 85 % – et les collectivités territoriales.
Dès ma prise de fonctions en tant que ministre délégué chargé des transports, j’ai pris connaissance de la situation des crédits de l’État disponibles. À cet égard, monsieur le sénateur, il est tout à fait exact que l’enveloppe réservée à la modernisation de la déviation Livron-Loriol dans le cadre du dernier contrat de projets État-région s’élève à 18 millions d’euros. Cette enveloppe est notoirement insuffisante pour permettre la réalisation de l’ensemble de l’aménagement, dont le coût dépasse en fait aujourd’hui 125 millions d’euros.
Au regard, d’une part, de cette impasse financière et, d’autre part, de la nécessité d’avoir une démarche pragmatique et réaliste, il nous appartiendra d’engager très rapidement avec les collectivités locales, dont je souhaite que l’implication soit forte, une programmation nouvelle, dans le cadre du prochain PDMI, de sorte que nous puissions à tout le moins disposer d’un calendrier donnant à la fois de la crédibilité à la parole de l’État et des perspectives aux habitants, lesquels ont besoin d’un langage de vérité lorsque sont en jeu la qualité de l’aménagement routier de leur région, mais aussi, tout simplement, leur qualité de vie.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Elle ne me satisfait absolument pas, mais je comprends que vous ne puissiez m’en donner une autre.
Qu’on nous ait à ce point amusés avec des annonces et des affirmations rassurantes me laisse littéralement sans voix !
De vos propos et du résultat des expertises que vous avez fait réaliser par vos propres services – j’avais moi-même mené mes propres investigations –, je comprends que, jusqu’à présent, les élus, les habitants, les chefs d’entreprise de la Drôme ont été « baladés » par des affirmations concernant un projet qui n’était pas vraiment financé.
Vous l’avez dit, il importe de ne pas entacher la crédibilité de l’État.
Je vous remercie de votre engagement concernant le PDMI.
Je prends acte du fait que nous aurons la possibilité de discuter sérieusement avec vos services et votre cabinet d’une programmation fixe parce que, comme vous l’avez vous-même déclaré, il y va tout simplement de la confiance dans la parole publique. Cela fait des années que des terrains et des maisons ont été achetés et que des piquetages ont eu lieu !
Pour des raisons de sécurité et afin de mettre un terme aux bouchons, il faut vraiment désengorger cette Nationale 7.
En outre, vous avez évoqué un montant de 125 millions d’euros, alors que je croyais que le coût d’objectif fixé par l’État n’était que 95 millions d’euros. Cela fait tout de même 30 millions de plus ! Du reste, cela signifie que la part du projet financé ne s’élève qu’à 25 %, à peine, puisque seuls 30 millions d’euros ont pour l’instant été engagés !
Monsieur le ministre, au nom de tous les habitants de la Drôme, je demande que nous puissions nous réunir pour faire un point sur le sujet, sans se perdre en polémiques, mais sans rien concéder non plus, afin de déterminer si cette déviation se fera un jour et, en tout cas, pour arrêter des dates précises.
Si les habitants de ce secteur peuvent comprendre que la réalisation de la déviation prendra du temps, ils ne peuvent plus être « baladés » d’annonce en annonce.
Vous avez parlé de crédibilité et je vous en remercie. Pour notre part, nous voulons des dates et des annonces concrètes !
Monsieur le sénateur, la situation de votre territoire justifie votre déception, votre ire même, et la vigueur de votre condamnation.
Je retiens de cette expérience que c’est exactement ce type de démarche que doivent à tout prix éviter ceux qui sont aux responsabilités, notamment nationales. Il faut savoir assumer la parole donnée car il y a, derrière, des vies, des enjeux territoriaux, le quotidien de nos concitoyens.
À cet égard, je m’appliquerai à ne pas suivre l’exemple malheureux de mes prédécesseurs.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures trente-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.
À cet égard, je m'appliquerai à ne pas suivre l'exemple malheureux de mes prédécesseurs.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures trente-cinq,

J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant création des emplois d'avenir est parvenue à l'adoption d'un texte commun.
Débat sur l'application de la loi pour l'égalité des droits et des chances la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
Débat sur l'application de la loi pour l'égalité des droits et des chances la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

L'ordre du jour appelle le débat sur l'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
La parole est à M. le président de la commission sénatoriale.

Monsieur le président, madame la ministre, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, le débat thématique qui s'ouvre cet après-midi relève d'un genre tout à fait nouveau. Je suis particulièrement ému de prendre la parole pendant quelques minutes pour saluer l'introduction d'une innovation dans le fonctionnement du Sénat, car un tel débat est organisé pour la première fois, à la demande de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de réitérer cette procédure ce soir, avec le débat sur le contrôle de l'application de la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, également inscrit par la conférence des présidents à l'ordre du jour du Sénat à la demande de la commission sénatoriale.
Pour cet après-midi, sans aborder la question sur le fond – je laisse ce soin à nos deux excellentes rapporteurs, Mmes Claire-Lise Campion et Isabelle Debré –, je veux souligner brièvement l'intérêt de la procédure inaugurée aujourd'hui, qui marque un nouveau pas dans le développement des instruments du contrôle parlementaire.
Mon sentiment profond est que les modalités du contrôle doivent se moderniser et s'adapter aux évolutions de l'action publique, de manière à « coller » au plus près aux attentes de nos concitoyens. À mon sens, la question de l'application des lois est cruciale, car d'elle dépend la confiance que nos compatriotes peuvent placer dans la loi et dans ceux qui la font.
Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à cette tribune, la première condition de notre égalité républicaine est l'effectivité de la loi. De fait, à quoi bon « légiférer à tout va » si, en aval, nos textes ne s'appliquent pas, ou s'ils ne s'appliquent pas comme nous l'aurions souhaité ? Sur le terrain, le « citoyen de base » vit mal cette situation. Il voit que, dans nos hémicycles, nous parlons parfois beaucoup, mais que nos débats n'ont pas toujours de traduction concrète. C'est pourquoi nous devons adopter une posture nouvelle, et cesser de gérer la question de l'application des lois comme une simple donnée technique : c'est avant tout une exigence politique, au meilleur sens du terme.
L'enjeu n'est pas seulement de comptabiliser les décrets d'application ou leur délai moyen de publication, même si cela a son importance, mais bien de restaurer une pleine confiance dans la loi.
Souscrivant à cet objectif, le bureau du Sénat a souhaité renforcer l'efficacité de nos procédures de contrôle de l'application des lois, et a créé un organe nouveau, travaillant à côté des commissions permanentes et en étroite collaboration avec elles. Sa démarche s'inscrit dans le droit-fil de la révision constitutionnelle de juillet 2008, le constituant ayant désormais inscrit dans notre loi fondamentale la fonction de contrôle et la fonction d'évaluation.
Ces innovations participent de l'effort de réhabilitation de la loi et de l'action publique, mais peuvent aussi faire taire certaines critiques bien connues qui alimentent inutilement, et de façon très démagogique, l'antiparlementarisme.
Notre commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois est un organe nouveau, certes, si on le compare aux commissions permanentes qui s'appuient sur une expérience plus que séculaire, ou à la commission des affaires européennes, déjà installée depuis longtemps dans le paysage institutionnel du Sénat. Mais, en à peine un an, nous avons « mis les bouchées doubles », si vous m'autorisez cette expression. J'en veux pour preuve les deux débats inscrits aujourd'hui à l'ordre du jour en séance plénière, ou encore les sept rapports d'information déjà publiés dans l'espace des six premiers mois d'existence de la commission.
Je tiens à saluer, à ce propos, le concours précieux que nous ont apporté les rapporteurs issus des autres commissions, car leur « double casquette » a été un gage supplémentaire de qualité de nos travaux. Je n'oublie pas non plus l'apport des administrateurs mis à notre disposition par ces commissions. Je remercie enfin tout particulièrement les présidents de ces commissions, avec lesquels nous avons élaboré notre programme de travail, et qui ont « joué le jeu ». J'émets le souhait que ce climat de bonne coopération perdure et se renforce dans les travaux que nous allons entreprendre durant cette nouvelle session ordinaire.
Le 7 février dernier, lors du débat annuel sur l'application des lois, mon dernier mot avait été pour le gouvernement alors en place. Entre-temps, une autre majorité s'est installée à l'Assemblée nationale. Il reste que, sur ce point, le gouvernement d'aujourd'hui a la même responsabilité que celui d'hier pour assurer la meilleure application possible des lois. J'avais annoncé que nous serions vigilants et « proactifs » quant à la publication des mesures réglementaires ; je puis vous assurer que nous le resterons !
Cependant, à l'occasion du débat qui s'ouvre cet après-midi, je préfère conclure en mettant l'accent sur l'autre volet de notre travail, à savoir l'évaluation, qui débouche nécessairement sur des réflexions et des propositions. Au fond, pourquoi vouloir créer une césure artificielle entre le Parlement législateur, d'un côté, et un Parlement contrôleur, de l'autre ? C'est pourquoi, quand nous vérifions la manière dont les lois s'appliquent et que nous mettons le doigt sur les éventuelles imperfections des textes, il nous paraît logique de réfléchir aux mesures susceptibles d'y remédier. Comme vous avez pu le constater, et comme vous le montreront encore les interventions de nos deux rapporteurs sur la « loi handicap » de 2005, nos rapports comportent non seulement un « état des lieux » de l'application de telle ou telle loi, mais également un ensemble de préconisations en vue de l'améliorer.
Cette démarche répond bien, me semble-t-il, aux attentes de nos concitoyens. Elle est la parfaite illustration des synergies constructives à établir entre notre fonction de contrôle et notre fonction législative proprement dite.
Applaudissements.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, aboutissement de trois années de réflexions partagées entre les gouvernements successifs, le Parlement et les associations, la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a profondément modifié la politique du handicap, trente ans après le texte fondateur de 1975. Très ambitieuse, elle entend couvrir tous les aspects de la vie des personnes handicapées. Cette approche transversale constitue sa force, mais aussi sa faiblesse, car elle exige un travail important de pilotage et de mise en œuvre qui, sept ans après son adoption, n'est pas encore achevé.
D'un point de vue strictement réglementaire, le bilan est très positif puisque 99 % des textes d'application ont été publiés. En revanche, l'objectif, fixé par la loi, d'une publication de l'ensemble des mesures réglementaires dans les six mois suivant sa promulgation n'a pu être tenu, en raison des expertises juridiques nécessaires et des concertations menées. Tout n'a sans doute pas non plus été suffisamment mis en œuvre, après la publication de la loi, pour faire prendre conscience, sur le plan national, de la nécessité d'une large mobilisation et d'un engagement personnel à tous les niveaux.
Compte tenu du champ très vaste de la loi et du temps dont nous disposions, Isabelle Debré et moi-même avons décidé de nous concentrer sur ses quatre principaux thèmes : la compensation du handicap, l'accessibilité à la cité, la scolarisation des enfants handicapés et, enfin, la formation et l'emploi des personnes handicapées. Nous avons procédé, au cours du premier semestre de cette année, à de très nombreuses auditions et avons effectué plusieurs déplacements, ce qui nous a permis de mieux évaluer le degré d'application de la loi sur le terrain.
J'aborderai, en premier lieu, la question de la compensation du handicap.
La reconnaissance d'un droit à la compensation des conséquences du handicap par la solidarité nationale est l'avancée majeure de la loi de 2005. Prestation « cousue main », la prestation de compensation du handicap, la PCH, a permis une nette amélioration de la couverture des besoins, tant par le montant que par la diversité des aides attribuées.
La PCH demeure cependant incomplète au regard des objectifs initiaux : la couverture des besoins en aides humaines est encore trop restrictive ; la suppression des barrières d'âge, pourtant inscrite dans la loi, n'a pas été réalisée ; la prestation accordée aux enfants se révèle inadaptée à leurs besoins. Sachant que les dépenses de PCH pèsent déjà lourdement dans les budgets des conseils généraux, …

… la mise en œuvre de ces mesures se heurte inévitablement à un obstacle financier.
Aussi, les deux mesures que nous proposons s'attachent à mieux répondre aux besoins des personnes handicapées, tout en ne sous-estimant pas la contrainte financière qui est la nôtre aujourd'hui : il s'agit, d'une part, de la suppression de la limite d'âge, actuellement fixée à soixante-quinze ans, pour demander la PCH, pour les personnes qui étaient éligibles avant soixante ans et, d'autre part, de la pérennisation des fonds départementaux de compensation, dont l'action est indispensable pour diminuer les reste à charge des personnes handicapées et de leurs familles. Sur ce point, je note avec une grande satisfaction, madame la ministre, que le Gouvernement entend très prochainement abonder ces fonds à hauteur de 4 millions d'euros.
J'en viens maintenant aux maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, innovation majeure dans l'architecture institutionnelle de la politique du handicap.
Même si de nombreuses difficultés de fonctionnement persistent, ces maisons ont apporté un réel progrès en termes de service public en permettant l'accès à un interlocuteur unique de proximité, une simplification des démarches administratives, une certaine « humanisation » de l'instruction des dossiers et une forte implication des associations dans la prise de décision.
Cependant, six ans après leur création, les MDPH font face à une inflation d'activité qui se révèle préjudiciable à la qualité du service rendu : les délais de traitement sont encore trop longs, l'approche globale des situations individuelles est parfois mise à mal, le suivi des décisions n'est pas toujours assuré. Il en résulte un profond sentiment de mécontentement et de déception chez de nombreux usagers.
Nous avons également constaté de très fortes disparités dans les pratiques des MDPH, contraires à l'objectif assigné de traitement équitable des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire. Les efforts déployés jusqu'ici par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, n'ont pas permis de résorber les écarts entre départements, ce qui prouve la nécessité d'aller beaucoup plus loin dans l'harmonisation des pratiques.
Pour toutes ces raisons, améliorer le fonctionnement des MDPH est un impératif. Nous estimons que cela passe, notamment, par le transfert des compétences de notification et de fabrication de la carte européenne de stationnement aux directions départementales de la cohésion sociale, par la simplification des démarches administratives pour les demandes de renouvellement et par l'intensification des actions de la CNSA en matière d'harmonisation des pratiques des MDPH.
Par ailleurs, dans le contexte de raréfaction des ressources publiques, le principal sujet d'inquiétude pour les MDPH est d'ordre financier : comment leur garantir des moyens pérennes leur permettant d'assumer pleinement leurs missions ? En prévoyant la signature de conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens, la loi du 28 juillet 2011, dite « loi Paul Blanc », devrait offrir les conditions d'une meilleure visibilité financière, à supposer toutefois que ses textes d'application, non encore parus à ce jour, respectent les intentions du législateur.
J'évoquerai, en second lieu, la question de l'accessibilité.
La loi de 2005 a étendu la notion d'accessibilité à tous les types de handicap et à tous les domaines de la vie en société. On parle désormais d'« accessibilité universelle » pour désigner le processus visant à éliminer toutes les barrières qui peuvent limiter une personne dans l'accomplissement de ses activités quotidiennes.
Cette démarche s'adresse non seulement aux personnes atteintes d'une déficience, mais aussi à toute personne pouvant être confrontée, un jour ou l'autre, à une situation de handicap, qu'elle soit temporaire ou durable.
Au regard du vieillissement de la population, cette approche transversale représente un enjeu considérable.
Vous le savez, la loi pose un principe général d'accessibilité du cadre bâti, des transports et de la voirie, dans les dix ans suivant sa publication.
Le premier constat que nous faisons est celui d'une absence criante de données sur l'état d'avancement de la mise en accessibilité. En effet, la loi n'a pas prévu de remontées d'informations obligatoires de la part des acteurs publics ou privés concernés. Même l'Observatoire interministériel de l'accessibilité et de la conception universelle n'est pas en mesure de dresser un bilan exhaustif de ce chantier !
À défaut d'éléments chiffrés incontestables, la deuxième tendance qui se dégage est celle d'un important retard, en dépit de réels progrès. Le baromètre de l'accessibilité de l'Association des paralysés de France affiche, certes, des résultats en constante progression, mais seulement 15 % des établissements recevant du public seraient actuellement accessibles.
À trois ans de l'échéance fixée par la loi, force est donc de reconnaître que la mise en accessibilité de l'ensemble du cadre bâti, de la voirie et des transports ne sera pas réalisée. Tel est également le constat que dressent l'Inspection générale des affaires sociales, le Conseil général de l'environnement et du développement durable et le Contrôle général économique et financier dans un rapport commun que vous avez rendu public, madame la ministre, il y a quelques semaines.
Certes, la date de 2015 peut sembler ambitieuse au regard de l'ampleur de la tâche à accomplir et des contraintes techniques, financières et administratives qui y sont associées. La fixation d'un délai à moyen terme était néanmoins indispensable pour tirer les leçons des résultats décevants de la loi de 1975, éveiller les consciences et engager une nouvelle dynamique en faveur de l'accessibilité.
Nous avons identifié plusieurs facteurs expliquant le retard pris. Tout d'abord, l'échelonnement sur plusieurs années de la publication de la quarantaine de textes réglementaires nécessaires a retardé d'autant la mise en œuvre concrète des mesures. Ensuite, un portage politique insuffisant : autant la loi de 2005 a été voulue et soutenue au plus haut sommet de l'État, autant la mise en œuvre de son volet « accessibilité » n'a pas mobilisé les pouvoirs publics autant qu'elle aurait dû. J'en veux pour preuve les nombreuses tentatives de dérogations législatives ou réglementaires pour le bâti neuf. Enfin, nous avons relevé une appropriation insuffisante, sur le terrain, de l'objectif d'accessibilité, aussi bien chez les décideurs publics que chez les acteurs privés.
En tout état de cause, reculer la date de 2015 n'est pas envisageable : ce serait un très mauvais signal envoyé aux personnes handicapées et à leurs familles, chez qui la loi de 2005 a suscité un formidable espoir ; cela aurait, en démobilisant les acteurs et en décalant les travaux en cours ou programmés, un effet contre-productif. En outre, une telle décision serait, à coup sûr, interprétée comme une forme de renoncement à un chantier, certes très ambitieux, notamment du fait des coûts induits, mais dont l'enjeu sociétal justifie que l'on s'y attèle véritablement.
Aussi, nous estimons qu'il est indispensable d'impulser dès à présent une nouvelle dynamique à la fois en créant les conditions d'un meilleur pilotage national des enjeux de l'accessibilité, en mettant en place un système de remontées d'informations obligatoires et en dressant, d'ici à 2015, un bilan exhaustif de l'état d'avancement du chantier de l'accessibilité.
Madame la ministre, vous avez récemment annoncé que le M. le Premier ministre devait me confier dans les prochains jours une mission de concertation visant à déterminer si les propositions contenues dans le rapport que j'ai cité précédemment rencontrent, sur le terrain, un écho favorable ou non. J'en suis extrêmement honorée, même si j'ai pleinement conscience de la difficulté de cette mission. J'émets le souhait que celle-ci aboutisse à un nouveau point d'équilibre, supportable par les différents acteurs concernés et garantissant le maintien d'une dynamique forte en faveur de l'accessibilité.
Avant de passer la parole à ma collègue Isabelle Debré, je voudrais insister sur la nécessité de pérenniser l'approche transversale du handicap, qui constitue la grande avancée de la loi de 2005.
Il convient, d'une part, d'intégrer cette problématique dans l'ensemble des politiques publiques. Le Gouvernement s'y est engagé, et je m'en félicite. Une circulaire du Premier ministre du 4 septembre dernier impose en effet la prise en compte systématique du handicap dans les projets de loi. Il s'agit, d'autre part, d'organiser un pilotage national clair et cohérent des enjeux liés au handicap, lequel a fait défaut jusqu'à présent. §

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, Claire-Lise Campion a présenté les principaux constats que nous avons effectués et les principales propositions que nous avons formulées en matière de compensation et d'accessibilité. Je vais, pour ma part, évoquer la question de la scolarisation des enfants handicapés et celle de la formation et de l'emploi des personnes handicapées.
La loi du 11 février 2005 reconnaît à tout enfant handicapé le droit d'être scolarisé dans l'école de son quartier ; la scolarisation en milieu ordinaire constitue le droit commun et le parcours de scolarisation repose sur une approche globale et pluridisciplinaire mise en œuvre par la maison départementale des personnes handicapées, à travers le projet personnalisé de scolarisation.
Cinq ans après la mise en application effective de la loi, le constat est unanime : un réel mouvement d'ouverture de l'école de la République sur le monde du handicap s'est opéré. Preuve en est l'augmentation d'un tiers du nombre d'enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire depuis 2006, soit 55 000 enfants supplémentaires accueillis.
Ces bons résultats doivent cependant être nuancés car, selon le rapport de notre ancien collègue Paul Blanc, 20 000 enfants handicapés demeureraient sans solution de scolarisation. La récente rentrée scolaire a été l'occasion pour les représentants associatifs de rappeler que de nombreux enfants sont encore laissés sur le bord du chemin.
J'insiste toutefois sur le fait que ce chiffre est à prendre avec précaution dans la mesure où il n'existe pas d'outil statistique national permettant de chiffrer précisément le nombre d'enfants handicapés scolarisables. Vous en conviendrez, madame la ministre, il est urgent que les pouvoirs publics s'attèlent à l'élaboration d'un tel outil.
Par ailleurs, cette avancée quantitative indéniable ne s'est pas accompagnée d'une avancée qualitative de même ampleur.
Nous avons tout d'abord constaté une extrême diversité des situations vécues par les familles selon les départements : les temps hebdomadaires de scolarisation sont très aléatoires et les projets personnalisés de scolarisation sont de qualité hétérogène, voire inexistants.
Nous nous sommes ensuite rendu compte de l'existence de ruptures fréquentes dans les parcours de scolarisation en raison de la difficulté à poursuivre la scolarité en milieu ordinaire dans le second degré et d'un accès encore très limité à l'enseignement supérieur.
Enfin, nous avons relevé un important point noir : l'échec de l'accompagnement en milieu ordinaire. Le recours croissant aux assistants de vie scolaire individuels – AVSI – insuffisamment formés et embauchés avec des contrats précaires ne permet pas de répondre de manière pertinente aux besoins.
Le ministre de l'éducation nationale a annoncé le recrutement de 1 500 AVSI pour cette rentrée. Certes, il s'agit en apparence d'une bonne nouvelle, mais le problème ne se résume pas aux seuls effectifs. Nous devons aussi et surtout stabiliser les conditions d'intervention de ces personnels et leur offrir un cadre d'emploi pérenne.
Par ailleurs, il faut noter que l'insuffisante formation des enseignants les laisse souvent démunis face au handicap d'un élève.
Enfin, une dernière difficulté doit être promptement surmontée : il existe un manque patent de coopération entre le secteur médico-social et l'éducation nationale, qui se caractérise par un cloisonnement des filières très préjudiciable à la qualité de la prise en charge.
À partir de ce constat, nous formulons plusieurs propositions : l'élaboration d'un outil statistique national permettant d'évaluer précisément le nombre d'enfants handicapés non scolarisés ; la mise en place de référentiels communs entre académies et entre MDPH afin d'harmoniser les pratiques et, ainsi, de garantir l'équité de traitement sur le territoire ; la réactivation du groupe de travail sur les AVS – je crois que cela fait partie de vos projets, madame la ministre –, afin de définir un véritable cadre d'emploi et d'améliorer leurs débouchés professionnels ; le renforcement de la problématique du handicap dans la formation initiale et continue de tous les enseignants ; enfin, la promotion de la coopération entre les sphères médico-sociale et éducative.
Sur tous ces sujets, madame la ministre, nous aimerions connaître les intentions du Gouvernement.
Avant d'en venir à la dernière partie de notre rapport, je souhaiterais dire quelques mots sur le déplacement que ma collègue Claire-Lise Campion et moi-même avons effectué en Belgique.
Vous le savez, l'autisme est déclaré « grande cause nationale 2012 ».
Si nous ne pouvions matériellement pas traiter ce sujet dans son intégralité, nous tenions à nous rendre sur place afin de comprendre pourquoi de plus en plus d'enfants autistes français sont scolarisés dans des établissements belges.
Contrairement à la France, qui a fait de la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire une priorité, la Belgique a privilégié la voie de l'enseignement spécialisé, même si l'intégration dans l'enseignement ordinaire y existe aussi. Dans les écoles d'enseignement spécialisé, comme celle que nous avons visitée en zone transfrontalière, les enfants sont accueillis dans des classes à petit effectif et encadrés par deux intervenants : un enseignant spécialisé et un professionnel paramédical.
Plusieurs raisons expliquent pourquoi 3 000 enfants français sont aujourd'hui scolarisés dans de tels établissements.
Tout d'abord, la prise en charge est centrée sur les besoins spécifiques de chaque enfant. Ensuite, les équipes éducatives, particulièrement bien formées, font preuve d'un grand pragmatisme en recourant à différentes méthodes d'apprentissage – programmes TEACCH ou ABA, par exemple. Enfin, l'enfant et ses parents sont accompagnés et conseillés tout au long du parcours scolaire par un service spécialisé.
Comme nous avons pu le constater, les progrès réalisés par les enfants sont tout à fait remarquables : des petits arrivés à l'école dans un état très grave parviennent, quelques mois plus tard, à communiquer, à participer à des activités, à ne plus être effrayés par la présence d'autrui, voire, pour certains, à tenir une conversation.
Bien sûr, il ne s'agit pas ici d'ériger la Belgique en modèle, mais simplement d'enrichir notre réflexion et, pourquoi pas, de lancer des pistes de réforme.
J'en viens maintenant à la formation et à l'emploi des personnes handicapées.
La loi de 2005 consacre un changement de paradigme s'agissant de l'emploi des personnes handicapées : jusqu'alors appréhendé à partir de l'incapacité de la personne, il s'apprécie désormais à partir de l'évaluation de ses capacités. L'intégration professionnelle des personnes handicapées est dorénavant un élément à part entière de leur citoyenneté.
Dans la continuité de la loi du 10 juillet 1987, la loi « handicap » maintient l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour tous les employeurs, privés et publics, ayant vingt salariés ou plus, dans la proportion de 6 % de l'effectif total, tout en leur permettant de répondre à cette exigence selon diverses modalités.
Surtout, elle étend aux employeurs publics le dispositif de contribution annuelle financière pour compenser le non-respect de l'obligation d'emploi, en créant le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
La loi prévoit par ailleurs la mise en œuvre de politiques régionales concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées et charge les MDPH d'évaluer leur employabilité et de les orienter vers le marché du travail.
Certes, cette politique à la fois incitative et coercitive porte ses fruits. Malgré tout, le taux d'emploi demeure en deçà de l'objectif des 6 % : il ne s'établit qu'à 2, 7 % dans le privé et à 4, 2 % dans le public. Le taux d'emploi global des personnes handicapées est, quant à lui, nettement inférieur à celui de l'ensemble de la population en âge de travailler – 35 % contre 65 % – et le taux de chômage est deux fois plus important – 20 % contre 10 %.
Le principal obstacle identifié pour l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées est leur faible niveau de qualification : en effet, 83 % d'entre elles ont aujourd'hui une qualification égale ou inférieure au CAP ou au BEP.
C'est pourquoi nous insistons sur la nécessité de relever le niveau de qualification des personnes handicapées. Cela suppose, d'une part, d'agir prioritairement en direction des jeunes, en leur permettant d'accéder aux études supérieures, en les informant mieux sur les parcours d'études possibles et en les rapprochant du monde de l'entreprise. Cela suppose, d'autre part, de leur permettre un réel accès à la formation professionnelle, en rendant les lieux et le contenu des formations accessibles, en accompagnant les travailleurs handicapés tout au long de leur parcours professionnel et en accélérant la mise en œuvre des politiques régionales concertées.
Enfin, nous devrons encourager les entreprises à mettre en œuvre des actions positives comme l'aménagement des postes de travail, la prévention des licenciements pour inaptitude ou encore l'amélioration de la qualité des accords exonératoires.
Vous le voyez, mes chers collègues, jamais une loi n'aura à ce point structuré l'ensemble d'une politique publique. De l'avis de tous, la loi du 11 février 2005 est une très belle loi. Elle affirme de grands principes tout en posant les jalons pour mettre en œuvre une politique forte en faveur des personnes handicapées.
Certes, des avancées significatives ont été réalisées dans tous les domaines mais, comme toute réforme ambitieuse, le bilan reste, sept ans après, en deçà des espoirs que la loi avait initialement soulevés. Comme nous l'ont très justement fait remarquer plusieurs acteurs du secteur, « la loi de 2005 reste à déployer ». §

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme l'ont déjà excellemment rappelé les deux rapporteurs de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois, la loi du 11 février 2005 est une belle loi, dont nous pouvons être fiers, car elle résulte largement d'une initiative parlementaire, notamment du Sénat.
Permettez-moi d'ailleurs de rendre hommage à trois anciens parlementaires, Paul Blanc et Nicolas About, qui furent nos collègues au Sénat, ainsi que Jean-François Chossy, ancien député, qui ont porté ce texte depuis sa genèse et qui ont contribué à le faire vivre grâce à leur implication et à leur énergie, grâce aussi au suivi qu'ils en ont assuré. Ils ont défendu une vision qui nous semble aujourd'hui évidente : une loi globale, de portée transversale, ayant pour ambition de faire en sorte que l'on voie dans chaque personne en situation de handicap d'abord une personne, à laquelle on doit reconnaître toute sa dignité et tous ses droits.
Ce changement de regard est bien l'avancée majeure de la loi du 11 février 2005.
Je tiens également à rappeler la volonté politique des gouvernements précédents, dont le soutien à cette démarche n'a jamais faibli. Je ne doute pas, madame la ministre, que le gouvernement auquel vous appartenez aura à cœur de la soutenir à son tour. Ayant été secrétaire d'État chargée de la solidarité pendant deux ans, je peux témoigner de l'ampleur de l'effort consacré à la politique du handicap au cours du précédent quinquennat.
Ainsi l'allocation aux adultes handicapées, l'AAH, a-t-elle été revalorisée de 25 % entre 2007 et 2012.
Un plan a également prévu la création de 51 400 places supplémentaires en établissements. Au 31 décembre 2010, 73 % de ces crédits avaient été notifiés aux agences régionales de santé. À mi-parcours, 50 % des places étaient autorisées.
Par ailleurs, un effort sans précédent a été fait en faveur de la scolarisation des enfants handicapés : entre 2006 et 2012, 55 000 élèves handicapés de plus ont été scolarisés en milieu ordinaire.
De nouveaux plans sectoriels ont été mis en œuvre : le plan autisme, que vient d'évoquer Isabelle Debré, le plan handicap visuel, le plan en faveur des personnes sourdes et malentendantes.
La compensation du handicap a été améliorée. En 2005, le montant moyen de l'allocation compensatrice pour tierce personne, l'ACTP, s'établissait à 400 euros par mois. Le montant moyen de la prestation de compensation du handicap est de 850 euros.
Je tenais à rappeler ces chiffres parce qu'ils traduisent de véritables avancées, comme le rappelait le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, Patrick Gohet, à l'occasion d'une tribune publiée l'année dernière.
Cela dit, je ne souhaite pas non plus verser dans l'angélisme : si les progrès sont là, tout n'est pas réglé, il s'en faut. À cet égard, le travail de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois constitue un recensement utile des difficultés les plus criantes. Je souscris bien volontiers aux remarques et aux propositions de la commission concernant les difficultés de fonctionnement des MDPH, les conditions d'examen des dossiers de plans d'aide, la nécessité d'orienter la scolarisation des enfants handicapés vers une prise en charge plus qualitative, le défi que constitue toujours l'accessibilité universelle à l'échéance de 2015, le chemin qu'il reste à parcourir pour offrir un véritable parcours de vie, en particulier par l'accès à l'emploi.
En matière d'autonomie des adultes, on s'arrête trop souvent à la question des structures, en oubliant que de plus en plus de personnes handicapées sont aujourd'hui capables d'aller vers l'autonomie. Il nous manque simplement les outils adaptés.
Madame la ministre, permettez-moi maintenant de vous faire part de quelques remarques dans trois domaines qui devront, selon moi, être au cœur de la politique à mener au cours des cinq ans à venir et faire l'objet de toute l'attention des pouvoirs publics.
J'évoquerai tout d'abord l'équité territoriale, sur laquelle on ne peut manquer de s'interroger à la lecture du rapport. Cette question surgissait également très vite lors des auditions des associations et des familles lors de la préparation de mon rapport sur l'évaluation de l'impact du dernier plan autisme. Les disparités constatées dans les plans d'aide, dans les montants des PCH alloués, dans les projets personnalisés de scolarisation, les PPS, selon les départements, et pour des situations qui sont ressenties comme comparables, pourraient constituer, si elles continuaient de croître, un véritable danger. Elles pourraient en tout cas rompre l'égalité que toute personne handicapée ou tout parent d'enfant handicapé est en droit d'attendre.
Je me suis toujours battue pour que nous conservions à l'échelon national un socle de solidarité, lequel doit être, à mon sens, le même en tout point du territoire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'avais pas souhaité, lors de la préparation de la loi du 28 juillet 2011, que l'on transfère entièrement la gestion des MDPH au département.
On voit bien quelles pourraient être les conséquences, en termes d'équité, pour les politiques territorialisées si d'aventure l'État continuait de s'en désengager totalement. À titre d'exemple, pour un budget du handicap d'un montant voisin, la Ville de Paris traite, par l'intermédiaire de sa MDPH, 90 000 dossiers par an, quand la MDPH du département du Nord en voit passer plus de 150 000.
Quant aux familles d'autistes, elles n'ont aucune possibilité, dans certaines régions, de trouver une place à proximité de leur domicile dans les structures pour enfants autistes mettant en œuvre des méthodes éducatives et comportementales. Même en Île-de-France, région pourtant la mieux dotée de toutes, ces structures sont inégalement réparties selon les départements.
Il est nécessaire que, dans l'acte III de la décentralisation qui nous est annoncé, le handicap fasse l'objet d'un traitement particulier afin que l'ajustement des moyens alloués aux départements soit à la hauteur des besoins. Lors cette nouvelle étape, et compte tenu de l'expérience acquise, l'effort devra être qualitatif et équitablement réparti, tout en tenant compte du contexte local, madame la ministre.
Ma deuxième série de remarques portera sur ce qui constituait l'ambition fondamentale de la loi de 2005 : la construction d'un parcours de vie optimisant les chances d'inclusion.
Il me semble que, aujourd'hui, le handicap est toujours vécu comme une suite de ruptures et de discontinuités. Les familles évoquent toujours un « parcours du combattant ». La complexité des dossiers, la lenteur de leur examen et les files d'attente, le besoin de justifier sa situation lors de chaque renouvellement : tout cela concourt à susciter un sentiment de précarité, qui pourrait être atténué par une plus grande souplesse. Simple à dire, difficile à faire ! Toutefois, c'est bien en agissant sur ces petits points d'achoppement que l'on pourrait gagner en efficacité. Face à des publics aussi fragiles, il faut combattre notre tendance à trop bureaucratiser.
En matière scolaire, et pour tous les handicaps intellectuels ou psychiques, les discontinuités sont particulièrement dangereuses, car elles sont trop souvent synonymes de pertes de chances et de régression. Or ces discontinuités pourraient être mieux gérées. L'éducation nationale et les établissements spécialisés doivent apprendre à travailler plus étroitement ensemble. Il existe malheureusement encore trop peu d'établissements dans lesquels voisinent école ordinaire et structure spécialisée.
Ma dernière série de remarques portera sur le vieillissement.
Nous allons vers une société plus âgée, au sein de laquelle les personnes en situation de handicap vivront plus longtemps. La loi de 2005 prévoyait de lever les barrières d'âge, mais cela n'a pas été possible du fait de la contrainte financière. Pour autant, nous ne devons pas nous dispenser de conduire une réflexion sur une prise en charge adaptée du handicap chez la personne vieillissante. Cette question préoccupe particulièrement les familles, et à juste titre.
Il n'est pas certain, par exemple, qu'un adulte autiste vieillissant trouve sa juste place dans un EHPAD – établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Quel efforts financiers serons-nous prêts à consentir, dans un contexte qui nous laisse peu de marges de manœuvre ? Il nous faut rouvrir le débat sur le « cinquième risque » et donner tous les éléments à nos concitoyens, sans faux-semblants, car il n'y aura pas de choix facile. Ces sujets sont très complexes. Ils sont malheureusement devant nous et il nous faudra trouver des solutions les plus justes possible.
Je conclurai mon intervention par deux questions plus précises.
La première d'entre elles portera sur l'accessibilité. Comment comptez-vous avancer dans ce domaine, madame la ministre ? Quelle méthode allez-vous adopter ? Que pensez-vous de la proposition du président du CNCPH, qui a suggéré « de mettre en place un accord entre les demandeurs et tous les acteurs chargés d'appliquer la loi, à leur niveau de responsabilité, afin d'aboutir à une stratégie portant sur une orientation nationale » ?
Ma seconde question portera sur le troisième plan autisme, madame la ministre, sur lequel vous vous êtes engagée en juillet dernier. Pouvez-vous nous préciser quel sera le calendrier ? Prévoyez-vous la création de places supplémentaires, en particulier pour les adultes ? Lors d'un colloque auquel j'ai très récemment assisté, j'ai pu constater combien ce problème était aigu. Il est urgent d'agir.
Sept ans après le vote de la loi, les attentes demeurent toujours aussi fortes. De nombreuses avancées ont été accomplies, mais beaucoup reste à faire. Il nous appartient collectivement de nous mobiliser pour avancer le plus sereinement possible, en essayant de faire en sorte que les plus fragiles d'entre nous puissent être fiers du travail réalisé par le Parlement et le Gouvernement. §

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « bilan en demi-teinte », « des progrès, mais des objectifs non atteints », « de grandes ambitions, mais des réalisations insuffisantes » : de telles expressions reviennent de façon récurrente dans le rapport très complet réalisé, au nom de la commission sénatoriales pour le contrôle de l'application des lois, par nos collègues Claire-Lise Campion et Isabelle Debré, que je tiens à remercier pour leur important travail.
C'est peu dire que la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées était ambitieuse. Il s'agissait d'assurer l'égalité entre les valides et les personnes atteintes de handicap. Rien de moins ! Elle embrassait tous les aspects de la vie des handicapés : l'accès à l'éducation, au travail ; elle devait faciliter les démarches administratives tout comme l'accès aux bâtiments et aux transports. Elle devait aussi modifier le regard de la société sur les personnes handicapée, qu'elle devait faire entrer pleinement dans la Cité. Elle promettait l'égalité. C'était magnifique !
On a coutume de dire que cette loi était attendue et nécessaire. Néanmoins, lors de l'examen du texte, en 2004, notre ancien collègue du groupe RDSE Gérard Delfau avait relevé que ce texte « faisait planer quelques menaces et que manquaient cruellement les moyens de son ambition en termes de financement ». Il ajoutait que « le décalage entre les principes fixés par la loi et la réalité se trouvera souligné au terme de ce débat, d'où une grande frustration qui s'exprime déjà au sein de toutes les associations œuvrant dans le domaine du handicap ».
Ainsi, de manière presque prophétique, notre collègue avait résumé les écueils que nous constatons aujourd'hui, ce qui m'incite à penser que le principal problème de cette loi tient moins à son pilotage qu'à sa rédaction.
L'exemple de l'accessibilité dans la cité est, à ce titre, éloquent. La loi « handicap » fixait un objectif ambitieux : que les établissements recevant du public, les ERP, et les transports en commun soient accessibles à tous en 2015. Dans cette perspective, chaque département, ou presque, s'est doté d'un comité de pilotage et d'un observatoire de la mobilité, voire des deux. Mais les moyens, eux, ont rarement été mobilisés.
Au regard de l'accessibilité, les amendements apportés à la proposition de loi déposée par Paul Blanc, en 2011, ont constitué, il faut le souligner, un recul inadmissible en prévoyant des dérogations à l'obligation d'assurer l'accessibilité pour tous dans les bâtiment neufs, ouvrant ainsi une brèche dans le principe de « conception universelle ».
Il m'est impossible de traiter de toutes les ramifications de la loi de 2005 dans le temps qui m'est imparti. Vous me permettrez donc de m'attarder sur les dispositions de la loi qui concernent les départements. Ce sera également l'occasion de démontrer que, loin d'être un frein au travail parlementaire, la présidence d'un exécutif local enrichit son titulaire d'une expertise de terrain que la simple étude « hors-sol » ne pourra jamais remplacer !
Murmures et sourires.

Vous le savez, les conseils généraux sont désormais identifiés comme l'échelon de la solidarité. C'est ainsi que, presque naturellement, il leur a incombé de piloter la mise en œuvre des grandes dispositions de la loi de 2005. Ces avancées se sont pourtant parfois heurtées à de grandes difficultés.
La première concerne les MDPH. Comment ne pas souscrire à cette belle idée consistant à simplifier les démarches des personnes handicapées en instituant un interlocuteur unique dans chaque département ?
Permettez-moi de citer l'exemple d'un département que je connais bien, le Tarn-et-Garonne, où nous nous sommes dotés d'une MDPH dès la fin de l'année 2005. Oh, il a fallu « essuyer les plâtres », au sens propre comme au figuré ! Comme dans les autres départements, nous nous sommes heurtés aux problèmes de gestion du personnel, du fait de la multiplicité des statuts en présence.
La loi « Paul Blanc » a apporté, c'est vrai, des améliorations dans le fonctionnement des MDPH. Elle prévoit notamment la mise en place de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens afin de pérenniser les ressources des MDPH et leur permettre de ne plus naviguer à vue, comme ce fut le cas à leurs débuts.
Cependant, cela a été dit, nous sommes encore, tant d'années après, dans l'attente de l'ensemble des décrets d'application relatifs à ce texte.
La PCH était une autre innovation majeure. Se substituant à l'allocation compensatrice pour tierce personne, ou ACTP, elle opérait un changement de paradigme : elle considérait le handicap comme un préjudice et, à ce titre, celui-ci devait être réparé. Là encore, la MDPH est au centre du dispositif, car c'est elle qui, en lien avec les personnes handicapées, procède à l'évaluation des besoins.
La PCH, après des débuts en douceur, a vu le nombre de ses bénéficiaires augmenter rapidement. Cette forte croissance, si elle témoigne de l'efficacité du dispositif, suscite, vous le comprendrez, des inquiétudes dans les conseils généraux, car elle s'accompagne mécaniquement d'une hausse des dépenses à leur charge des départements.
De plus, nous avons pu constater une diminution inquiétante, en proportion, de la participation de la CNSA au financement de la PCH. Comme indiqué dans le rapport d'information, le concours de la CNSA est resté globalement stable en valeur absolue, mais il ne représente désormais plus qu'un tiers des dépenses au titre de la PCH. Il revient donc aux départements de supporter seuls l'accroissement des dépenses, qui culminent à plus de 1, 4 milliard d'euros.
Je m'interroge donc sur les propositions 8 et 9 du rapport, relatives à l'élargissement du périmètre de la PCH. Je ne remets pas en cause le bien-fondé de ces propositions, qui sont généreuses ; je me permets seulement de poser la question de leur financement. Et le fait que le Gouvernement envisage, compte tenu du contexte, une baisse de plus de 2 milliards d'euros des dotations aux collectivités sur la période 2013-2015 ne sera pas de nature à faciliter la tâche des conseils généraux !
L'élargissement des bénéficiaires de la PCH ne pourra être envisagé que si la proposition 10, qui consiste à pérenniser les fonds départementaux par le biais de règles contraignantes fixant les engagements des différents contributeurs, est réellement mise en œuvre.
Il en va de même pour les fonds départementaux de compensation, qui devaient être abondés par l'État, la CPAM, les conseils généraux et la MSA. Après deux années de fonctionnement, l'État, malheureusement, a suspendu unilatéralement – une fois de plus ! – sa participation au financement des fonds pendant trois années, en 2008, 2009 et 2010.
J'ai choisi l'exemple de la PCH et des fonds départementaux de compensation, mais j'aurais également pu parler du désengagement de l'État en matière de formation professionnelle des personnes handicapées. Ce dernier n'a-t-il pas confié à l'Association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, l'AGEFIPH, la gestion de plusieurs dispositifs relevant pourtant de sa compétence, et ce sans compensation financière ?
Au-delà du problème de l'état d'application de la loi, le législateur doit s'interroger sur sa faisabilité même. Dans le cas présent, le décalage entre des objectifs élevés et les moyens disponibles constituerait presque un motif de ne pas mobiliser les seconds pour s'approcher des premiers.
Ce décalage pose également la question des outils de pilotage, de suivi et d'évaluation des lois. Le 25 septembre dernier, à l'Assemblée nationale, lors de la séance de questions au Gouvernement, vous ne disiez pas autre chose, madame la ministre. Vous voyez que j'ai de bonnes lectures ! §

Vous constatiez que cette loi n'avait « pas été conduite, ni managée, ni suivie ». J'ajouterai que, pour partie, la loi de 2005 constitue ce qu'on pourrait appeler une loi d'affichage.
Le Président de la République a souhaité opérer un changement de méthode en matière, notamment, de politique du handicap. Il a raison ! Dans son programme présidentiel, il s'engageait à garantir « l'existence d'un volet handicap dans chaque loi ». Ce fut le cas de la loi sur les emplois d'avenir, avec le recrutement de 1 500 auxiliaires de vie scolaire supplémentaires. Il sera de la responsabilité du Gouvernement et du Parlement qu'il en aille de même pour les contrats de génération et les réformes des dispositifs d'aide aux personnes âgées et de la dépendance. Nous attendons également, vous l'imaginez, la présence d'un tel volet dans la future loi de décentralisation.
Voilà, madame la ministre, ce que les radicaux pensent du bilan de l'application de la loi de février 2005. §

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier les rapporteurs pour leur travail très précis et très riche.
Le débat demandé par la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois permet de dresser un état des lieux utile, portant sur le respect des obligations fixées par la loi de 2005.
Tout d'abord, je rejoins le point de vue exprimé par les rapporteurs et par plusieurs des orateurs qui m'ont précédée, selon lequel le recul de l'échéance de 2015 pour permettre un égal accès à la Cité pour tous serait un très mauvais signal, décourageant et démobilisateur. Nous ne pouvons pas nous le permettre et nous devons résister aux fortes pressions qui s'exercent en ce sens.
Cela est d'autant plus vrai que le retard est très important. En effet, selon le rapport rendu public le 12 septembre dernier par Mme la ministre, le niveau de réalisation actuel ne dépasserait pas 15%. Ce rapport met en cause l'ampleur des travaux, et donc de leur financement, le manque de proportionnalité des normes entre le neuf et l'ancien, le manque d'harmonisation entre les commissions d'accessibilité, mais aussi un portage politique parfois – pour ne pas dire souvent – insuffisant, ainsi que l'échelonnement dans le temps de la publication des textes réglementaires.
Il paraît donc indispensable de maintenir le cap et de conserver l'échéance finale, tout en distinguant les différentes catégories d'ERP, ce qui permettra de déterminer des niveaux de priorité différents et obligera à élaborer un calendrier précis de ce qu'il reste à faire.
En effet, l'accessibilité est une condition de la participation économique, sociale et citoyenne, car elle définit non seulement les aménagements rendant possible la mobilité de tous au sein de l'espace public, mais inclut également la notion d'accès aux services et d'implication active dans la vie sociale, à tous les niveaux.
Nous défendons une politique du handicap fondée sur la solidarité et sur l'autonomie des personnes en situation de handicap, qui vise à leur inclusion par une application pleine et entière de cette loi et par l'application de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qui prévoit notamment le droit à la santé, à des revenus suffisants, à la compensation intégrale du handicap et à l'accessibilité.
Plus généralement, notre société doit garantir aux personnes en situation de handicap les conditions de l'exercice plein et entier de la citoyenneté. Ainsi faut-il donner les moyens à ces personnes de s'intégrer dans la société par la mise à niveau de l'allocation aux adultes handicapés, l'amélioration de l'insertion professionnelle par le renforcement des moyens de l'AGEFIPH, un nouveau statut pour les employés des établissements et services d'aide par le travail, les ESAT, et un soutien des collectivités aux structures accueillant des travailleurs handicapés.
Parallèlement, une politique de désinstitutionalisation progressive nous paraît devoir être engagée, afin de permettre une meilleure intégration sociale pour un plus grand nombre de personnes en situation de handicap dont le placement en institution spécialisée n'est pas indispensable et dont le maintien ou le retour à domicile, total ou partiel, est possible.
J'en viens au fonctionnement des MDPH. Sur ce point, le rapport est très riche, et nous souscrivons d'ailleurs aux suggestions qui y sont faites. Nous proposons également de soutenir les services d'aide à domicile, avec une revalorisation des tarifs et de la qualification du personnel, en développant notamment la formation de ce dernier.
Le rapport analyse également la question très importante de la scolarisation des élèves handicapés au sein des établissements destinés à tous. Nous proposons d'augmenter significativement le nombre d'auxiliaires de vie scolaire – au demeurant, les annonces faites récemment par le Gouvernement vont évidemment dans le bon sens –, en les intégrant à l'éducation nationale, mais aussi en leur garantissant une professionnalisation et une formation de bon niveau, ainsi qu'un statut qui les sorte de la précarité dans laquelle ils vivent aujourd'hui.
Les enseignants doivent également recevoir une formation au handicap, ainsi que le matériel adapté. Pour les enfants ne pouvant être accueillis en milieu scolaire ordinaire, il est nécessaire d'augmenter la capacité d'accueil et le maillage des territoires par de petites structures spécialisées. Il est vrai que, pour certains enfants, le nombre d'heures de transport par jour pose problème.
Concernant l'égalité d'accès aux soins, nous proposons d'augmenter le seuil d'accès à la CMU complémentaire, en rattrapant le retard d'adaptation des structures hospitalières et médicales.
Plus généralement, il nous paraît important d'engager les collectivités territoriales dans la mise en place de ce que l'on appelle l'« Agenda 22 », en prévoyant, par exemple, un soutien à l'aménagement des logements particuliers, une aide financière au logement adapté et accompagné – usufruit locatif social, maison-relais, etc. – et surtout en répondant à la demande d'autonomisation des personnes handicapées. Par exemple, des lieux d'hébergement intermédiaires peuvent être créés pour les personnes souffrant d'un handicap psychique.
Enfin, l'accessibilité au transport, mais aussi à la culture et au sport, doit être garantie pour toutes et tous.
La loi de 2005 proposait un changement complet de regard dans tous les domaines, plusieurs orateurs ont eu l'occasion de le rappeler. J'entends par là l'adoption d'une approche à la fois transversale et positive, en ce sens que toutes les questions, y compris celle de l'intégration professionnelle, sont appréhendées à partir non plus des incapacités de la personne, mais de l'évaluation de ses capacités et compétences.
Ne nous arrêtons pas en chemin. Engrangeons les acquis tout en conservant les objectifs. Madame la ministre, nous comptons sur vous pour donner une forte impulsion à l'important travail de pilotage engagé et à la mise en œuvre nécessaire des mesures prévues vu l'étendue et la transversalité des secteurs concernés. Les sénateurs du groupe écologiste vous assure de leur soutien. §

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avant d'en venir au débat qui nous réunit aujourd'hui, je voudrais revenir sur l'examen du projet de loi portant création des emplois d'avenir qui a eu lieu la semaine dernière au Sénat.
J'avais déposé, avec le groupe CRC, un amendement visant à rendre obligatoire une formation préalable pour les jeunes qui, dans le cadre de ce recrutement, seraient appelés à travailler auprès de personnes dépendantes ou en situation de handicap.
Cette formation préalable est, à l'image de celle qui existe en matière de petite enfance, indispensable pour éviter des situations de maltraitance involontaire. Je suis d'autant plus étonnée du mauvais sort qui a été réservé à mon amendement que l'objectif qu'il sous-tendait rejoint celui que votre collègue chargée des personnes âgées et de l'autonomie, Mme Delaunay, a mis en avant le lendemain même, à l'occasion des 3e Assises nationales de l'aide à domicile.
La commission mixte paritaire qui s'est réunie ce matin ne nous a pas donné satisfaction. C'est dommage car, vous le savez, madame la ministre, pour ce qui concerne l'accompagnement des personnes en situation de handicap, la seule bonne volonté ne suffit pas. Pourtant, sur ce sujet comme sur d'autres, il faudra bien que nous avancions, et que nous avancions vite.
S'il est indéniable que l'adoption de la loi du 11 février 2005 a permis une évolution notable des conditions de vie des personnes en situation de handicap, beaucoup de chemin reste à parcourir, ainsi que l'ont souligné plusieurs de mes collègues. La force de cette loi réside sans doute dans le fait que, pour la première fois, notre pays appréhendait la question du handicap dans son ensemble, suscitant ainsi un très grand espoir.
Plus de sept ans après son adoption, force est de constater que tous les objectifs ne sont pas atteints et que nous ne nous sommes pas dotés des outils nécessaires à leur pleine réalisation, surtout quand la détermination politique a fait défaut. Je pense particulièrement à l'objectif d'une société accessible pour tous en 2015. Cet engagement, qui est un véritable enjeu de société, est au croisement d'exigences différentes, mais convergentes.
Une Cité universelle est le gage d'une réelle prise en compte des besoins spécifiques des familles, des personnes vieillissantes et de la volonté des personnes en situation de handicap de ne plus être victimes d'une forme d'apartheid ou, à tout le moins, de relégation sociale.
Tant que l'espace urbain, les lieux de rencontre et de vie collective ainsi que les chaînes de déplacement ne seront pas accessibles à toutes et à tous, on privera, de fait, les personnes en situation de handicap de leur pleine citoyenneté.
Je rappelle d'ailleurs, que, comme nous l'avions signalé à Jean-Pierre Bel le lendemain de son élection à la présidence de la Haute Assemblée, les tribunes de notre hémicycle demeurent inaccessibles aux personnes à mobilité réduite, ce qui oblige une délégation à suivre en ce moment même nos travaux depuis le salon Victor-Hugo. Ce qui est vrai au Sénat l'est malheureusement également à l'extérieur, comme le rappelle fort bien le rapport de nos collègues.
Ce rapport explique notamment le retard pris en la matière par un manque de pilotage, ce qui est certainement vrai. Sans doute aurions-nous pu, ou dû, nous doter dès 2005 d'un outil statistique susceptible d'évaluer annuellement les progressions afin de pouvoir agir plus rapidement.
Dans le même temps, un autre rapport de l'IGAS précise que l'ampleur des travaux à réaliser impliquerait d'engager près de 20 milliards d'euros de dépenses si l'on maintenait le cap posé par la loi.
Cette somme colossale nous interpelle : si les collectivités ne peuvent en assurer seules la charge sur une période si courte, cette somme est d'abord et avant tout la conséquence du retard pris. En effet, les acteurs publics ont peu pris en compte les problématiques liées à l'accessibilité dans leurs choix en matière d'investissements.
Permettez-moi, madame la ministre, de dire que votre dernier communiqué de presse sur ce sujet nous rassure. Les propos tenus lors de la remise du rapport de l'IGAS nous ont fait craindre un renoncement non pas sur la date de l'échéance, mais sur les objectifs. Cela m'a d'ailleurs rappelé le débat que nous avions eu ici même sur les notions d'aménagements et de dérogations lors de l'examen de la loi « Paul Blanc ». Nous savons aujourd'hui que l'accessibilité universelle reste l'objectif, et nous nous en réjouissons.
Dès lors, il faut mobiliser toutes les énergies et mettre cette question au cœur de tous les projets. Plus aucune subvention publique ne doit être donnée, plus aucun chantier immobilier urbain engageant des fonds publics ne doit être lancé sans intégrer un volet accessibilité. Ces 20 milliards d'euros sont des dépenses légitimes dans la mesure où elles correspondent à un engagement de la Nation. De plus, il s'agit non seulement d'un investissement pour le « vivre ensemble », mais aussi d'une politique d'emploi judicieuse.
En outre, je veux profiter de cette intervention pour aborder la question de la compensation du handicap.
L'exposé des motifs du projet de loi du 11 février 2005 prévoyait que la politique de compensation devait permettre « à chaque personne handicapée d'obtenir la réponse appropriée à ses besoins et de disposer des moyens nécessaires pour faire face aux charges spécifiques liées à sa situation de handicap ». Cet objectif a malheureusement été démenti « à la source » tant la loi a posé de restrictions, à commencer par l'absence d'une véritable PCH enfant ou encore l'instauration de tarifs plafonds ou de critères d'éligibilité, qui se traduisent par une PCH dont le montant ne permet pas de répondre pleinement aux besoins des personnes en situation de handicap.
Cela explique sans doute pourquoi de nombreuses personnes en situation de handicap pourtant éligibles à la PCH continuent d'opter pour l'ACTP, et ce malgré le durcissement des conditions de contrôle.
Je dois dire qu'une formule utilisée dans le rapport de nos collègues concernant la PCH et les maisons départementales des personnes handicapées a attiré mon attention. En effet, s'appuyant sur les difficultés qu'ont pu connaître les MDPH, principalement en raison du non-respect par l'État de ses obligations en matière de personnels et d'une importante montée en charge de la PCH, le rapport pose la question d'une éventuelle remise en cause du statut actuel. Or celui-ci présente l'avantage de réunir les différents acteurs dont les départements, acteurs de proximité indispensables pour une évaluation au plus près des besoins, et l'État, acteur indispensable pour garantir la solidarité nationale.
Sans que soit directement remis en cause le statut actuel, celui du GIP – groupement d'intérêt public –, on devine toutefois la tentation de faire en sorte, notamment dans le cadre d'une nouvelle étape de décentralisation, que les MDPH deviennent des services intégrés aux conseils généraux. Ainsi, leurs présidents des assemblées départementales deviendraient définitivement les contrôleurs, les instructeurs des dossiers et les payeurs.
Si cette solution présente l'avantage, pour les départements, d'adapter au plus juste ces dépenses, elle entraîne de fait une dissolution du rôle de l'État en tant qu'autorité édictant des règles communes, garantes de l'égalité territoriale et de la solidarité nationale.
Le groupe CRC estime que, plutôt que de s'engouffrer dans ce chemin, les conseillers généraux doivent porter le combat de la juste participation financière de l'État à la PCH, comme aux deux autres allocations individualisées que sont l'APA et le RSA.
Faute de temps, je ne pourrai aborder la question de la scolarisation des enfants handicapés ni celle de la professionnalisation des auxiliaires de vie scolaire. Même si je note que le Gouvernement a fait des efforts importants en recrutant notamment 1 500 AVS, je déplore que trop d'enfants demeurent encore privés d'une scolarité en milieu ordinaire, ou n'y ont accès qu'à temps partiel.
Avant de conclure, je voudrais vous interroger, madame la ministre, sur l'AAH.
Si le Président de la République l'a bien augmenté de 25 %, …

… il n'a toutefois pas oublié de faire en sorte que le nombre de bénéficiaires se trouve réduit.

Ainsi, sous couvert d'une nouvelle définition des conditions d'appréciation par les MDPH des besoins des personnes en situation de handicap, le gouvernement de Nicolas Sarkozy a promulgué un décret réduisant la portée de la notion de « restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi », …

… qui permet à une personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % de bénéficier de l'AAH.
Désormais, pour évaluer la « restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi », seul le handicap sous son aspect médical est pris en compte, écartant, contrairement à ce qui prévalait auparavant, l'environnement économique et social de la personne en situation de handicap. Ce décret exclut des critères de détermination du montant de l'AAH les difficultés particulières liées au transport, ce qu'il est convenu d'appeler la « chaîne de déplacement ».
Pourtant, compte tenu du retard pris en matière d'accessibilité, cette question doit être regardée comme fondamentale. D'ailleurs, on voit bien que cette mesure n'est en réalité qu'une mesure d'économie, qui devrait logiquement éviter une dépense de 74 millions d'euros.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, vous me permettrez tout d'abord de remercier et de féliciter très sincèrement Mmes les rapporteurs pour la qualité de leur rapport, qui constitue la base de notre débat.
Ce rapport rend globalement justice à la loi de 2005, même si l'application de celle-ci n'est pas à la hauteur des ambitions du législateur sur tous les points, ce qui est d'ailleurs, hélas ! commun à nombre de lois. Vous avez, mesdames, examiné les avancées réalisées et les freins qui subsistent dans tous les domaines.
Cette loi ne comprend pas seulement un certain nombre de mesures articulées les unes aux autres : elle constitue un changement radical dans l'approche que les pouvoirs publics, comme notre société, ont ou doivent avoir du handicap. Elle est fondée sur le droit à la compensation du handicap, ce qui est une nouveauté radicale. Je suis convaincu que, un jour ou l'autre, ce droit à la compensation sera l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
En effet, la loi de 2005 s'intéresse d'abord non pas au handicap, mais aux capacités des personnes handicapées. Or compenser le handicap, c'est précisément faire en sorte que chaque personne handicapée puisse aller comme les autres au bout de ses capacités et puisse dépasser ses propres limites. C'est un apport essentiel de cette loi. Du reste, si l'on en examine les différents volets, on constate que tous ont pour objectif de permettre la concrétisation de cette très noble ambition dans un domaine ou un autre.
Aussi, vous comprendrez, mes chers collègues, que je veuille, à ce stade de mon intervention, rendre hommage à un homme qui, tout au long de sa vie publique, a confirmé et amplifié son engagement en faveur des personnes handicapées ; je veux parler du président Jacques Chirac, …

… qui est à l'origine de la grande loi de 1975, laquelle a créé l'allocation aux adultes handicapés et les établissements médico-sociaux qui s'y rattachent, la loi de 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, ainsi que la loi de 2005, dont l'application fait l'objet du présent débat. Sur trente ans, ces trois grandes lois de la République sont toutes dues à l'action personnelle de Jacques Chirac.

Vous avez très bien montré, mesdames les rapporteurs, que, sur nombre de points, les résultats sont au rendez-vous, même si beaucoup reste encore à faire.
Tout d'abord concernant l'éducation, le nombre d'enfants scolarisés en milieu éducatif ordinaire et accompagnés a connu une progression tout à fait importante ; les capacités des sections spécialisées, mises en place surtout dans les collèges, ont considérablement augmenté.
J'évoquerai ensuite la prestation de compensation du handicap, qui est incomparablement supérieure à l'ancienne allocation compensatrice pour tierce personne, mais dont la diffusion rapide pose aujourd'hui un problème de financement.
J'insisterai aussi sur l'augmentation des ressources des personnes handicapées qui s'est produite au cours des dernières années, comme cela a été rappelé tout à l'heure, grâce à la hausse sans précédent de l'allocation aux adultes handicapés. Les conditions nouvelles qui ont été fixées pour l'accès à cette prestation sont certes négatives, mais elles n'effacent pas l'avantage immense que cette hausse exceptionnelle représente pour les personnes handicapées.
En revanche, en ce qui concerne l'emploi des personnes handicapées, les résultats se font davantage attendre. C'est sur cette question qu'il faudra, selon moi, concentrer nos efforts dans les mois et les années qui viennent.
Il en va de même pour l'accessibilité, qui est aussi un problème majeur. Dans ce domaine, malgré le délai de dix ans qui a été accordé aux responsables d'établissements recevant du public, le travail est très loin d'être terminé.
Sur ces différents points, il est plus que temps de dynamiser l'action des pouvoirs publics et de faire preuve d'une volonté politique inflexible pour rendre l'action de l'État et des collectivités territoriales beaucoup plus efficace et ses résultats, plus rapides.
S'agissant de l'éducation, des résultats tout à fait remarquables ont été obtenus. Chacun a pu prendre connaissance des chiffres fournis par Mmes les rapporteurs et constater qu'un élan formidable a été donné. L'augmentation d'un tiers du nombre d'enfants handicapés accueillis par l'éducation nationale depuis 2006 est un résultat dont notre République peut légitimement être fière. (
Je mesure néanmoins le nombre des situations qui restent aujourd'hui sans solution : dans ce domaine, si l'on est satisfait de noter les améliorations, on souffre toujours, par compassion, de voir des difficultés irrésolues. Mais que cela ne nous empêche pas de nous réjouir des progrès !
Quant au nombre des élèves accompagnés par des auxiliaires de vie scolaire individuels, il a bondi puisque, selon Mmes les rapporteurs, il est passé de 18 500 à 61 700 enfants, ce qui représente tout de même une augmentation de 230 %.
Mais ne nous endormons pas sur nos lauriers : des actions majeures restent à conduire. Je les mentionne pêle-mêle, compte tenu du temps encadré dont nous disposons dans ce débat.
Il faut d'abord améliorer la formation des enseignants. En effet, un certain nombre de professeurs des écoles se sentent démunis et ne s'en cachent pas : ils ont besoin d'être soutenus.
Il faut ensuite revaloriser le statut des auxiliaires de vie scolaire, dont la précarité est un problème auquel il n'a été porté remède ni par aucun de vos prédécesseurs – j'en fais partie – ni par vous-même, pour le moment, madame la ministre, quoiqu'il pénalise beaucoup l'accompagnement de nos enfants handicapés. (
Je sais bien que les budgets de l'éducation nationale sont toujours tendus et que le ministre, lorsqu'il a des choix à faire, qu'on me pardonne de le dire, préfère toujours les professeurs aux auxiliaires de vie scolaire. Il faut donc avoir une volonté politique très ferme de remédier à cette situation.

Il importe aussi que le nombre des places en ITEP – institut thérapeutique, éducatif et pédagogique – soit augmenté. Nous mesurons dans nos départements leur insuffisance, d'autant plus criante qu'elle affecte des enfants particulièrement handicapés, notamment ceux qui souffrent d'autisme. Il faut également continuer à augmenter le nombre des places en CLIS – classe pour l'inclusion scolaire – et en ULIS – unité localisée pour l'inclusion scolaire.
La prestation de compensation du handicap est un autre sujet à propos duquel nous pouvons être globalement satisfaits.
Cette allocation est un outil extraordinaire en ce que son champ déborde le seul financement de l'aide humaine à la personne pour s'étendre aux aides techniques, aux aides à l'adaptation du logement et aux aides à l'adaptation des véhicules. Il y a là quelque chose de tout à fait novateur puisque c'est la première fois qu'est mise en œuvre une aide aussi finement individualisée.
Elle est d'autant plus individualisée que les associations de personnes handicapées qui siègent au sein des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, les CDAPH, portent sur la situation des personnes et sur leurs besoins pour réaliser leur projet de vie un regard personnel qui diffère de celui des professionnels et vient le compléter.
Seulement voilà : nous sommes aujourd'hui au pied du mur. La prestation de compensation du handicap a besoin d'être financée et les finances départementales sont dégradées, de même que les finances de l'État, celles de la sécurité sociale et celles de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Je crois qu'il est temps, au lieu de nous renvoyer la balle les uns aux autres, de tenir une sorte de lit de justice avec tous les acteurs concernés, pour examiner de quelle façon nous financerons à l'avenir cette prestation, dont le nombre des bénéficiaires est passé de 37 000 en 2007 à 160 000 en 2010.
Il s'agit d'un enjeu majeur, car la progression se poursuit au même rythme. Sans compter que les départements, précisément parce qu'ils ne gèrent pas cette prestation comme un guichet administratif mais que les CDAPH existent, n'ont pas la possibilité de resserrer les conditions d'attribution. Nous devons donc trouver un moyen de faire face à nos engagements.
Et puisqu'on reparle enfin de la réforme de la prise en charge de la dépendance des personnes âgées, il est plus que temps d'y associer celle de la prise en charge de la dépendance des personnes handicapées. Madame le ministre, je vous en supplie, ne restez pas à l'écart de ce débat, dont votre collègue en charge des personnes âgées n'a pas le monopole ! Le problème de la dépendance, dont les enjeux financiers sont extrêmement lourds, doit aussi être l'une de vos préoccupations majeures.
La création des maisons départementales des personnes handicapées est une avancée précieuse, pourvu que ces structures aient les moyens d'assurer leur avenir. Or il n'est pas toujours facile de faire fonctionner ces institutions encore jeunes, qui sont des lieux d'accueil conçus pour mettre fin au « parcours du combattant », comme il est dit dans le rapport, que les personnes handicapées devaient affronter auparavant pour faire reconnaître leurs droits.
L'avenir des MDPH sera menacé si des mesures urgentes ne sont pas prises pour en assurer le fonctionnement.
Au chapitre des progrès très sensibles qui ont été réalisés, il faut citer enfin les ressources des personnes handicapées.
Je reconnais bien volontiers que nous ne sommes pas allés au bout du chemin, mais tout de même ! Que dirait-on aujourd'hui si l'allocation aux adultes handicapés n'avait pas été augmentée de 25 % en cinq ans ?
Toutefois, prenons garde : quels que soient les progrès accomplis, nous devons en être conscients, l'enjeu de demain n'est pas seulement d'augmenter le niveau de ressources des personnes handicapées qui ne travaillent pas : il est de conduire un nombre croissant de personnes handicapées vers l'emploi.
Pour cela, il faut les accompagner sur le plan social, mais aussi au regard de la formation aux métiers et de l'insertion dans les entreprises et les services publics qui les emploient. De cette façon, les personnes handicapées ne seront pas enfermées dans l'inactivité. Il faut le savoir, un minimum de subsistance, à quelque rythme qu'il progresse, restera toujours un minimum de subsistance. C'est donc sur l'emploi qu'il faut, selon moi, mettre aujourd'hui l'accent.
Le fait est que, dans ce domaine, les résultats sont tout à faits décevants. Bien que le secteur public soit désormais plus ouvert à l'emploi des personnes handicapées, la loi du 11 février 2005 l'ayant soumis à la même obligation que le secteur privé, les améliorations se font attendre.
En réalité, on observe une sorte de stagnation de l'emploi des personnes handicapées, comme Mmes les rapporteurs l'ont parfaitement mis en évidence. Les majorités changent, les problèmes demeurent.
C'est pourquoi nous devons nous persuader que l'enjeu principal, l'horizon le plus important, la frontière qu'il nous faut franchir, c'est maintenant l'emploi des personnes handicapées. Songez, mes chers collègues, que leur taux de chômage est deux fois plus élevé que celui des autres Français !
Cette situation est totalement inacceptable. Elle montre les limites des mesures de coercition que nous avons voulu mettre en œuvre : elles ont beau être appliquées, elles n'empêchent pas qu'un certain nombre d'employeurs, privés ou publics, préfèrent payer pour ne pas employer plutôt que d'employer pour ne pas payer.
Il y a enfin le problème majeur de l'accessibilité. Il est temps que le décret sur l'accessibilité des lieux de travail paraisse ; c'est à juste titre, mesdames les rapporteurs, que vous le demandez.
Il faut aussi reconnaître, s'agissant des établissements recevant du public, que le délai de dix ans n'aura pas été bien mis à profit. Il n'était pas fait pour qu'on s'endorme en attendant l'échéance !
Les données manquant, il importe de mettre en place des systèmes de collecte de l'information. Mais il faut en outre qu'un nouvel élan soit donné, aussi bien pour la voirie que pour les transports collectifs ou l'aménagement des établissements recevant du public, afin que l'objectif fixé pour 2015 puisse être atteint.
J'observe que, sur ces travées, nous sommes partagés : certains ont déjà fait leur deuil de cet objectif quand d'autres veulent qu'on mette les bouchées doubles. Nous verrons ce qui se passera en 2015, mais, quoi qu'il en soit, il importe aujourd'hui de faire savoir à nos compatriotes qui ont des obligations dans ce domaine que nous voulons, autant qu'il est possible, atteindre notre objectif. Et il faut aussi leur montrer que, dès maintenant, nous commençons à prévoir ce que nous déciderons pour ceux d'entre eux qui n'auront pas atteint l'objectif en 2015.
Autrement dit, il va falloir encadrer dans un calendrier précis, avec des engagements de financement et un programme d'action, tous les établissements recevant du public qui ne se seront pas mis aux normes d'accessibilité.
Nous devons donc être fermes sur les objectifs mais, en même temps, trouver de nouvelles procédures pour accélérer les résultats.
Telles sont, madame la ministre, mes chers collègues, les observations que je souhaitais vous présenter. Je tiens, pour finir, à insister sur un certain nombre de vœux.
Que la réforme de la dépendance prenne en compte les personnes handicapées et que nous relancions le plan pluriannuel de création de places et de services en faveur des personnes handicapées et des enfants handicapés.
Que nous offrions un statut digne de ce nom aux auxiliaires de vie scolaire.
Que nous renforcions l'accompagnement dans l'emploi et la formation des travailleurs handicapés.
Que nous fassions face à l'impératif de la prise en charge du vieillissement des personnes handicapées.
Et, surtout, que nous prenions des mesures pour que l'accessibilité pour tous devienne une réalité, si possible en 2015.
C'est ainsi, madame la ministre, mes chers collègues, que nous réussirons à changer réellement la vie des personnes handicapées, pour que la différence des uns cesse de se heurter à l'indifférence des autres !
Applaudissements sur les travées de l'UMP. – M. Gilbert Barbier applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je veux remercier à mon tour nos collègues Claire-Lise Campion et Isabelle Debré pour la qualité du rapport d'information qu'elles ont préparé au sein de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois, présidée par David Assouline.
Voter des lois est important ; en vérifier l'application est tout aussi nécessaire.
Nous voici à l'heure du premier bilan de la loi du 11 février 2005, dite « loi handicap ». Où donc en sommes-nous ?
La loi était ambitieuse, le bilan est mitigé. Il pouvait difficilement en être autrement. Mais ce bilan nous montre surtout dans quelle voie il faut poursuivre.
Je parlerai d'abord de la petite enfance, puis de la scolarisation, en insistant sur la continuité qui existe dans le parcours de vie de l'enfant et de sa famille.
L'arrivée dans une famille d'un enfant porteur de handicap est souvent source d'inquiétude, voire d'angoisse quant à son évolution et à son devenir. C'est aussi une charge importante pour les parents qui accompagnent leur enfant au quotidien. Les familles nous le disent : leur emploi du temps est très largement consacré à leur enfant, aux consultations médicales, aux bilans, aux accompagnements pour la scolarisation et aux activités adaptées, si l'enfant a la chance d'en bénéficier.
Beaucoup de mères cessent leur activité professionnelle pour prendre en charge l'enfant porteur de handicap ; pour la famille, c'est souvent un salaire en moins, alors même que les frais à sa charge augmentent. Parfois aussi, des couples se séparent ou des fratries sont mises à mal.
Je ne veux pas peindre un tableau trop noir, car de nombreuses familles rebondissent, se mobilisent, militent pour faire avancer leur situation et celle des autres. Mais il faut bien reconnaître que leur parcours est tout de même plus difficile au quotidien et dans la durée que celui des autres familles.
La loi du 11 février 2005 a suscité beaucoup d'espoir dans ces familles, celle-ci pensant qu'elle leur offrirait enfin des réponses adaptées à la prise en charge à long terme de leur enfant et qu'elle leur permettrait de vivre comme des familles presque ordinaires.
Bien sûr, tout n'est pas négatif dans les cinq premières années de mise en place de cette loi globale et ambitieuse, nous nous devons tout de même de constater que le chantier reste colossal.
Tout d'abord, sur la prise en compte des familles et du projet individualisé pour l'enfant, le rapport constate de nettes insuffisances. Pour que l'enfant et sa famille soient placés au cœur du dispositif, il faut impulser, voire imposer, un changement dans les mentalités et dans les cultures professionnelles.
En effet, la famille est toujours centrale dans l'accompagnement de l'enfant ou du jeune. C'est sur elle que tout repose, il faut bien le dire. Nous en avons la preuve dans nos départements lorsque l'aide sociale à l'enfance doit parfois prendre le relais auprès d'enfants présentant un handicap, et ce n'est pas simple !
Il faut être très attentif dans la période d'annonce du handicap, car c'est à ce moment crucial et difficile que des obstacles peuvent survenir, mais aussi être dépassés. Ces obstacles trouvent le plus souvent leur source dans l'incompréhension, la culpabilité et la colère. Il faut permettre aux parents de s'exprimer, de poser leurs questions, pour que leur regard sur leur enfant devienne bienveillant, autant qu'il est possible, et que chacun trouve peu à peu sa place. Il faut passer du « Pourquoi le handicap ? » à « Comment allons-nous accompagner notre enfant ? »
Le rôle des professionnels des maternités, des centres de protection maternelle et infantile et des centres d'action médico-sociale précoce dans les départements est, à ce titre, déterminant. Il faut pouvoir mobiliser aussi ces services lors de l'annonce d'un handicap acquis ou découvert plus tardivement. La cellule familiale doit tenir bon autour de l'enfant ; il y va de l'intérêt de l'enfant, de sa famille et de la société tout entière.
Ensuite, vient le temps social, où la famille se confronte, au-delà des discours d'intention, aux réalités locales de l'accueil des enfants ayant des besoins spécifiques. La nécessité du « sur mesure » se heurte à nos dispositifs normés.
L'accueil en structure collective ou chez une assistante maternelle est la première épreuve pour les familles. Il en va de même pour les structures de loisirs. Pourtant, des solutions existent, élaborées ici et là en France à partir de la volonté et de l'intelligence des professionnels et des familles, et avec le soutien des collectivités locales. Il serait intéressant, madame la ministre, de pouvoir faire connaître ces montages, par exemple sur un forum dédié, placé sous la responsabilité de votre ministère.
À ce titre, il me semble aussi que les maisons d'assistantes maternelles pourraient jouer un rôle non négligeable dans la construction de réponses locales individualisées en matière d'accueil de la petite enfance, moyennant la formation de ces professionnelles volontaires et une petite réduction du nombre d'enfants accueillis en recherchant le moyen de prendre en charge financièrement une partie du manque à gagner qui en résulterait.
L'enfant, déjà habitué à un petit collectif, pourrait aborder sa scolarisation avec des acquis et moins de difficultés. Il pourrait être scolarisé à temps partiel tout en restant, dans un premier temps, à la maison d'assistante maternelle l'après-midi. Il en irait de même pour un enfant dont les difficultés exigent une orientation vers une structure spécialisée. Il s'agirait d'un temps d'observation et de première socialisation très utile en matière d'orientation scolaire de l'enfant.
Aujourd'hui, il est très difficile de trouver des solutions d'accueil permanent ou occasionnel pour des enfants en situation de handicap. Je fais ici le lien avec la volonté de Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée chargée de la famille, de relancer ce grand chantier de l'accueil de la petite enfance. N'oublions pas les enfants en situation de handicap. Des volontés et des compétences existent ; il nous faut donc pouvoir les mobiliser.
La loi de 2005 prévoit la scolarisation comme étant le droit commun. L'affirmation de ce principe a déjà fait bouger les lignes, comme on le constate dans le rapport, du moins d'un point de vue numérique. C'est un début encourageant, car il a permis de démontrer que l'intégration est possible.
Toutefois, je ne suis pas la première à le dire, nous devons rester réalistes et faire preuve de ténacité, car les obstacles sont encore nombreux. Ils tiennent en très grande partie à des résistances de cultures professionnelles cloisonnées et peu formées à la transversalité. Ils s'illustrent notamment par la trop grande faiblesse dans la collaboration avec l'enfant et sa famille. C'est, en vérité, le constat qui m'a le plus choqué à la de ce rapport.
Selon l'Association pour adultes et jeunes handicapés, seulement 30 % des enfants bénéficieraient d'un projet personnalisé de scolarisation, et ceux-ci sont parfois établis sans consultation préalable des parents, alors que la loi l'exige ! Nous sommes loin du compte en matière de respect de l'enfant et de sa famille.
Comment peut-on ignorer à ce point qu'il est essentiel de rechercher des solutions avec la famille ? Celle-ci est bien souvent la meilleure spécialiste, car elle connaît le détail de la vie quotidienne de l'enfant, ses capacités, et l'accompagne, parfois jour et nuit, le plus souvent 365 jours par an. Bien sûr, on nous dira que certaines familles « étouffent » leur enfant handicapé ou pensent à sa place. C'est une raison supplémentaire pour impliquer l'enfant et sa famille, et faire évoluer cette situation dans l'intérêt de l'enfant.
Il nous faut donc renforcer la formation des professionnels par des rencontres et des apports des représentants des familles et de leur association, afin que celles-ci soient entièrement associées à toutes les étapes de l'intégration de l'enfant et du jeune.
La formation des enseignants, des professionnels des RASED et du périscolaire aux réalités des différents handicaps et au partenariat interinstitutionnel devrait pouvoir renforcer leur capacité d'intégrer des enfants différents au sein des groupes d'élèves. Nul doute que les futures créations de postes annoncées récemment par le ministre de l'éducation nationale constitueront autant de chances pour la prise en compte des enfants et des jeunes ayant des besoins spécifiques dans tous les cycles de scolarisation.
L'autre défi est de donner de la souplesse à nos dispositifs, pour les adapter aux besoins spécifiques. L'exemple de la Belgique, cité dans ce rapport, est, à ce titre, très intéressant du point de vue des différentes modalités d'intégration des enfants autistes.
Il s'agit de répondre aux besoins de l'enfant et non de répondre, comme trop souvent encore chez nous, par une scolarisation à temps très partiel, faute d'autre solution. Il nous faut construire localement, avec le concours de tous les acteurs concernés par le projet personnalisé de scolarisation, des solutions souples et évolutives qui prennent également en compte les besoins de transport, d'accueil périscolaire notamment, cela a été dit.
Je ne reviens pas sur la nécessité de former et de professionnaliser les assistants de vie scolaire ; la démonstration en est faite dans ce rapport.
Nous sommes contraints de poursuivre la tâche avec détermination de sorte que les 20 000 enfants et jeunes sans solution – pour peu que ce chiffre soit exact, tant la statistique est défaillante dans ce domaine – trouvent une solution correspondant à leurs besoins d'intégration sociale et scolaire.
Les trois quarts de ces jeunes sont en établissement et un quart, soit 5 000, seraient chez leurs parents, en attente de solution...
Ces situations doivent mobiliser prioritairement les MDPH et l'éducation nationale, afin que ces jeunes et leurs proches ne se sentent pas abandonnés par nos institutions.
Il me semble nécessaire, tant le chantier est important, d'inscrire un nouveau rendez-vous dans trois ou cinq ans, afin de faire le point sur l'évolution de la situation. En effet, il nous faut maintenir la vigilance et la volonté politique pour lutter contre les discriminations liées aux handicaps.
Madame la ministre, j'en suis convaincue, chaque fois que, d'une manière ou d'une autre, nous permettons à un enfant, à un adulte, de s'intégrer, au mieux de ses possibilités, dans notre vie sociale, scolaire et professionnelle, cela constitue une victoire sur l'injustice. Alors continuons à construire ensemble notre projet social vers toujours plus d'égalité ! §

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées engagée par le gouvernement Raffarin nourrissait « l'ambition de concrétiser l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées ». Il nous faut saluer l'objectif de cette loi, ainsi que les nombreuses retombées positives qui ont découlé de son application.
Pourtant, malgré une ambition bien légitime, je souhaite aujourd'hui vous parler d'un point précis de la loi qui pénalise le bon fonctionnement de nombreux services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS.
En tant que rapporteur pour avis de la mission « Sécurité civile » du projet de loi de finances, j'ai interrogé à plusieurs reprises les représentants du Gouvernement sur les difficultés d'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés par les SDIS en raison des caractéristiques de leur métier, soumis à des conditions d'aptitude physique particulières.
Rappelons que, comme tous les employeurs publics qui emploient au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les SDIS sont soumis à l'obligation d'emploi de 6 % de personnes handicapés. La contribution est fondée sur l'effectif des titulaires. Or la plupart des fonctionnaires des SDIS sont des sapeurs-pompiers professionnels pour lesquels les conditions physiques et médicales sont incontestablement incompatibles avec un handicap.

Tenant partiellement compte des difficultés rencontrées par les SDIS, une circulaire du 26 octobre 2009 leur a offert la faculté de déclarer dans ce cadre l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'une affectation non opérationnelle.
Dès lors, ne pouvaient être comptabilisés au titre des effectifs déclarés au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, ou FIPHFP, que les sapeurs-pompiers professionnels reclassés sur un poste non opérationnel, notamment dans le cadre d'un projet de fin de carrière.

Ainsi, cet assouplissement ne permet toujours pas d'atteindre l'obligation d'emploi de 6 % et les conséquences financières qui en découlent, au travers de la contribution au FIPHFP, sont très lourdes pour les SDIS.
Si la circulaire du 26 octobre 2009 a un peu desserré la contrainte dans certains départements, elle n'a pas résolu la difficulté principale découlant de la condition d'aptitude médicale et physique pesant sur l'essentiel des effectifs des SDIS.
Aussi, l'année dernière, j'ai jugé utile d'interroger l'ensemble des SDIS sur les difficultés rencontrées pour honorer leur obligation d'emploi. Sur l'ensemble des réponses obtenues, à l'exception d'une seule, il s'avère que les SDIS ne parviennent pas à s'acquitter de cette obligation et doivent verser au FIPHFP une contribution financière qui peut dépasser, pour certains, 200 000 euros, cette somme venant alourdir un peu plus les dépenses contraintes des services départementaux.
Or, il convient de le souligner, certaines entreprises du secteur privé bénéficient d'une minoration de leur contribution lorsqu'elles emploient plus de 80 % des salariés occupant des emplois nécessitant des aptitudes physiques particulières ; je fais ici référence aux articles D5212-21 et D5212-24 du code du travail.
Dans l'article D5212-25 du code du travail, sont énumérées les catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, comme les personnels navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile ou les personnels navigants techniques de la marine marchande, les ambulanciers, les convoyeurs de fonds, les charpentiers en bois qualifiés, les conducteurs routiers, les livreurs, etc.
Or les SDIS, dont la plupart des emplois exigent aussi des conditions d'aptitude particulières, ne bénéficient pas d'une minoration analogue. Dans l'ensemble, les responsables de SDIS dénoncent l'iniquité de traitement avec le secteur privé.

Certains proposent, pour résoudre ces difficultés, de ne soumettre à l'obligation d'emploi de 6 % que les seuls personnels administratifs et techniques.
En conséquence, je souhaite que ce débat soit l'occasion pour le Gouvernement d'envisager de rouvrir ce dossier pour apporter aux SDIS une réponse appropriée. §

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, pour ma part, après tout ce qui vient d'être dit, je concentrerai mon intervention sur l'emploi des personnes handicapées depuis la promulgation de la loi de 2005 en vue de dresser un bilan, puis j'essaierai de vous faire part, de manière synthétique, de l'expérience que j'ai tirée des différentes responsabilités que j'ai pu exercer dans ce domaine.
De manière générale, la situation de l'emploi des personnes handicapées n'est pas satisfaisante. Pour preuve, leur taux d'emploi est presque deux fois moindre que celui de l'ensemble de la population en âge de travailler : 35 % contre 65 %. Certes, leur taux d'activité est plus faible – 44 % contre 71 % –, mais leur taux de chômage est le double de celui de la population active : il s'établit à 20 %.
Aussi, bien que l'effet de la crise économique sur l'emploi des personnes handicapées soit difficilement mesurable, il faut souligner qu'en 2011, le nombre de demandeurs d'emploi handicapés a augmenté de 13, 9 %, tandis que cette hausse a été de 5, 3 % pour l'ensemble des demandeurs d'emploi.
Comme bien souvent, ce sont les plus vulnérables qui sont les premiers affectés par les crises, que ce soient les personnes handicapées, celles qui sont en situation d'extrême précarité, les jeunes ou les seniors.
Pour autant, depuis la promulgation de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le tableau est moins sombre et ressemble davantage à un clair-obscur.
À titre liminaire, rappelons, d'une part, que la loi de 2005 a maintenu l'obligation d'employer 6 % de travailleurs handicapés pour toute entreprise dont l'effectif atteint ou dépasse vingt salariés et, d'autre part, que, tout en préconisant des mesures incitatives, elle a étendu à la fonction publique le dispositif coercitif de contribution annuelle afin de compenser le non-respect de cette obligation en créant le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Toutefois, si secteur public et secteur privé sont soumis depuis 2005 à un mécanisme de sanction identique dans l'hypothèse où ils ne respecteraient pas l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés – ou OETH –, de fortes disparités subsistent.
En effet, dans le privé, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap a augmenté de 0, 4 point entre 2006 et 2009. Cependant, d'après l'analyse effectuée par la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, cette évolution positive résulte principalement d'un changement des modalités de décompte des bénéficiaires de l'OETH. À périmètre constant, sur la même période, leur taux d'emploi n'aurait progressé que de 0, 1 point !
Néanmoins, les établissements privés ont effectué de réels progrès. À titre d'exemple, la proportion d'entreprises à quota zéro, c'est-à-dire n'employant aucune personne handicapée soit directement ou indirectement et n'ayant pas signé d'accord exonératoire, est passée de 35 % en 2006 à 11 % en 2009.
L'application, pour la première fois en 2009, de la pénalité financière prévue par la loi de 2005 a donc eu l'impact escompté, dissuadant les entreprises de ne pas se conformer aux dispositions en faveur de l'emploi des personnes handicapées.
À cet égard, on peut considérer que la mise en œuvre de mesures coercitives, par leur caractère dissuasif, a eu un effet bénéfique. Lors de l'examen de la proposition de loi relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, discutée dans cet hémicycle l'hiver dernier, mes collègues de la majorité et moi-même avions d'ailleurs défendu des dispositifs analogues en vue de contraindre les employeurs à appliquer le principe d'égalité salariale sous peine de sanctions financières.
Quand une inégalité de traitement injustifiée perdure, que l'incitation et la pédagogie ne parviennent malheureusement pas à remédier à l'injustice, il convient d'agir différemment ; il ne s'agit aucunement de punir, il s'agit au contraire d'éduquer.
Cette parenthèse étant refermée, focalisons-nous sur l'emploi des personnes handicapées dans le secteur public. Entre 2006 et 2009, leur taux d'emploi y a grimpé de 0, 5 point pour s'établir à 4, 2 %. Par conséquent, ce dernier apparaît plus élevé que dans le privé.
Pour autant, il est nécessaire d'étudier ces chiffres avec précaution. En effet, dans une communication en date du 29 février 2012, la Cour des comptes a alerté les pouvoirs publics sur la différence de traitement entre secteur public et secteur privé en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées.
Tout d'abord, le mode de calcul des bénéficiaires de l'OETH favorise la majoration du taux d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique. Sont ainsi comptabilisés au titre de l'OETH les titulaires d'un emploi réservé, les agents bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité et les agents reclassés.
Ce phénomène a pour conséquence de gonfler un peu artificiellement les statistiques en matière d'emploi des personnes handicapées, et donc de masquer la réalité de la situation.
En outre, certaines administrations sont d'office exemptées de l'OETH sur le seul fondement de leur statut juridique. C'est notamment le cas des autorités administratives indépendantes, des diverses juridictions, des institutions étatiques telles que la présidence de la République ou même des assemblées parlementaires.
La Cour conclut ainsi : « Ce constat appelle une clarification indispensable du champ d'application de l'obligation d'emploi au sein du secteur public, qu'il s'agisse d'institutions de l'État ou de certains organismes sui generis. »
Il semble d'autant plus impérieux d'appeler à cette clarification que la fonction publique a un devoir d'exemplarité en matière d'emploi des personnes en situation de handicap. Il serait incompréhensible et même intolérable que les autorités publiques prônent, à juste raison, une meilleure insertion professionnelle des personnes handicapées, tout en affranchissant certaines institutions et administrations de l'OETH. À l'avenir, il est donc impératif que le champ d'application de celle-ci soit le plus large possible et englobe l'ensemble des entités qui constituent le secteur public.
De surcroît, il faut bien avoir conscience que les difficultés d'accès à l'emploi des personnes handicapées se cumulent. Le profil des demandeurs d'emploi handicapés, établi par Pôle emploi en 2011, démontre ainsi que 53 % sont des chômeurs de longue durée – 39 % pour l'ensemble des demandeurs d'emploi –, que 41 % ont cinquante ans et plus – 19 % pour l'ensemble des demandeurs d'emploi –, que 83 % sont peu ou pas qualifiés – 58 % pour l'ensemble des demandeurs d'emploi.
Au regard de ces éléments, il ressort une priorité absolue : l'accompagnement. Cet accompagnement doit débuter très en amont, dès l'enfance et l'entrée dans le parcours scolaire. Sans trop m'étendre sur ce sujet qu'ont déjà abordé mes collègues, je veux néanmoins dire qu'il paraît essentiel de donner les moyens aux auxiliaires de vie scolaire individuels d'effectuer leur travail dans les meilleures conditions et au service de l'élève handicapé. Cela requiert notamment de leur prodiguer une meilleure formation et de revoir leur statut afin de leur assurer une véritable stabilité et, par là même, mettre fin à l'extrême précarité à laquelle ils doivent faire face.
En ce sens, je ne peux que souscrire à l'une des propositions du rapport rédigé par mes deux collègues, qui vise à « définir un véritable cadre d'emploi » et à « améliorer les débouchés professionnels » des auxiliaires de vie scolaire individuels. Cette dernière exigence suppose d'améliorer l'accompagnement de l'élève handicapé, la prise en compte de ses besoins, son orientation, ses compétences et, in fine, son niveau de qualification.
Parallèlement, il est fondamental de réformer l'accès à la formation professionnelle pour les travailleurs handicapés. Rendez-vous compte : ces derniers accèdent quatre fois moins à la formation professionnelle que les travailleurs valides ! À cet égard, dans son rapport de 2010, le Conseil national consultatif des personnes handicapées met en exergue que « l'accès des travailleurs handicapés à la formation ne s'est pas sensiblement amélioré au cours des vingt dernières années ». Preuve en est : la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ne contient aucune disposition portant sur l'accompagnement des travailleurs handicapés.
De plus, pour améliorer l'efficacité de l'accompagnement, il est indispensable de revoir et de simplifier le maelström administratif actuel. Entre l'AGEFIPH, les maisons départementales des personnes handicapées, les politiques régionales concertées qui font intervenir une foultitude d'acteurs, il paraît judicieux de clarifier et de rationaliser les missions de chacun, car cette trop grande dispersion, au final, risque de nuire au service offert aux personnes handicapées.
Enfin, j'aimerais aborder ce qui me paraît être l'une des barrières majeures d'accès à l'emploi des personnes handicapées. Elle est beaucoup plus insidieuse, mais elle se concrétise par des mots, des attitudes : il s'agit du regard porté sur le handicap.
Depuis la loi du 30 juin 1975, qui a crée la politique française d'insertion professionnelle des personnes handicapées, ce ne sont pas tant les mesures qui ont changé que la philosophie des textes. Ainsi, la loi de 2005 a opéré un revirement de paradigme ; alors que la question de l'emploi des personnes handicapées était auparavant appréhendée sous le seul prisme de l'incapacité de l'individu, il s'agit désormais de se concentrer sur son projet professionnel à partir d'une évaluation objective de ses capacités. En somme, il s'agit d'honorer, autant que faire se peut, son projet de vie.
En d'autres termes, nous ne partons plus du postulat, faussement généreux, selon lequel la société doit s'attacher à trouver une place à la personne handicapée, ses capacités étant jugées, par essence, résiduelles. Nous affirmons que la personne handicapée, telle qu'elle est, et indépendamment de son handicap, a pleinement sa place dans la société ; nous affirmons qu'au même titre que tout individu valide elle a des potentialités qui ne demandent qu'à être mises en valeur. Les pouvoirs publics doivent précisément avoir un rôle d'impulsion afin de favoriser les aménagements nécessaires à la mise en valeur de ces potentialités.

En procédant de cette manière, et sans renier le handicap de la personne, ce qui constituerait un déni de réalité, nous garantissons sa liberté de choix et lui permettons de mener à bien les projets qu'elle entend former. Nous agissons en faveur de son épanouissement et de son bien-être personnels. Surtout, alors que le handicap naît principalement dans le regard d'autrui, nous contribuons, humblement et en notre qualité de législateur, à lutter contre l'un des fléaux de notre temps, qui prospère sur le terreau fertile de la crise : l'intolérance à la différence.
Nous devons plus que jamais tout faire pour parvenir à ce que nous avions essayé de faire dans un film que peu de personnes connaissent, Le regard des autres : modifier ce regard sur le handicap.
Bien que la loi de 2005 ait contribué à faire évoluer les mentalités, parfois par la menace et la crainte de la sanction financière, nous devons poursuivre implacablement nos efforts en vue d'améliorer l'emploi et, plus généralement, la vie des personnes handicapées. Car, si le destin a fait de la vie de ces personnes un parcours qui peut se révéler accidenté, les pouvoirs publics et la société doivent tout faire pour que, elles aussi puissent essayer de vivre ensemble, avec nous, cette belle aventure qui s'appelle la vie.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, trop longtemps, les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ont été oubliées. Certes la loi de 1975 avait été un progrès, mais la loi du 11 février 2005 était très attendue par nos concitoyens handicapés et leur famille.
Cette loi pose le principe de l'accessibilité à tous. Elle rénove ainsi la notion d'accessibilité, l'étendant non seulement à tous les types de handicap, qu'il soit mental, sensoriel ou psychique, mais aussi à tous les domaines de la vie en société, qu'il s'agisse du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics ou des transports.
L'accessibilité pour tous et à tout – à l'école, aux lieux publics, à l'emploi, à la culture, aux loisirs –, c'est l'accessibilité universelle.
Cela a été dit, la loi Handicap a apporté des avancées considérables en termes de compensation, de scolarisation et de formation. Des avancées significatives ont également été obtenues concernant l'accessibilité à la cité.
Je centrerai mon propos sur ce dernier point, plus particulièrement sur les obligations à la charge des collectivités locales, que nous représentons.
La loi affiche une ambition forte : non seulement elle prévoit que toutes les nouvelles constructions destinées à accueillir du public doivent être accessibles – ce n'est pas le plus difficile –, mais elle impose également que soient rendus accessibles l'ensemble des établissements recevant du public, les ERP, ce qui comprend bien entendu les établissements déjà existants, et ce d'ici au 1er janvier 2015.
Cette loi ambitieuse est malheureusement confrontée à certaines réalités. En effet, si son ambition est légitime, elle n'en pose pas moins de réelles difficultés dans de nombreux cas, compte tenu de la structure des bâtiments existants, souvent non modifiables ou difficilement aménageables, des monuments ou sites historiques, mais aussi de la configuration ou de la topographie locale.
De plus, les normes techniques sont particulièrement exigeantes et rigides pour les établissements existants, car elles s'avèrent le plus souvent identiques à celles qui sont établies pour des constructions nouvelles. Certes, des dérogations restent possibles, mais elles sont qualifiées d'« exceptionnelles » par la loi.
Par ailleurs, c'est l'ensemble du parc existant d'établissements recevant du public des collectivités locales qui est concerné, et leurs bâtiments sont très nombreux : mairies, écoles, collèges et lycées, sans parler des gymnases, salles polyvalentes, médiathèques ou piscines. Et n'oublions pas que, dans le cadre de la loi, s'ajoutent les coûts de mise en accessibilité de la voirie et des transports collectifs. Le chantier à réaliser d'ici à 2015 est donc immense.
Selon une étude réalisée par Dexia, l'accessibilité des établissements recevant du public nécessiterait 20 milliards d'euros d'investissement, dont 17 milliards d'euros incomberaient aux collectivités territoriales et 3 milliards à l'État.
En raison des difficultés que je viens d'évoquer, de nombreux retards sont à déplorer, même si le chantier a avancé.
Tout d'abord, l'ensemble des établissements recevant du public, les ERP, étaient tenus de réaliser un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité au plus tard au 1er janvier 2010 ou 2011.
Si une démarche de diagnostic est souvent engagée, seule une commune sur cinq a achevé le processus à la date prévue par la loi. Seulement 60 % des plans d'accessibilité de la voirie et des aménagements publics sont en cours d'élaboration ou achevés, et 5 % de ces plans ont été adoptés par délibération.
Par ailleurs, en ce qui concerne la réalisation de l'accessibilité, seuls 15 % des ERP seraient actuellement accessibles.
En dépit de la prise de conscience des collectivités et de leur volonté, à trois ans de l'échéance, et dans le contexte budgétaire actuel, la mise en accessibilité de l'ensemble du cadre bâti, de la voirie et des transports ne sera sans doute pas achevée à l'échéance 2015.
Dès le 1er janvier 2015, des contentieux seront ouverts à l'encontre de l'État et des collectivités locales.
Vous l'avez dit, repousser l'échéance de 2015 serait un très mauvais signal, qui ne manquerait pas d'être interprété comme une forme de renoncement. Mais on ne peut nier la situation dans laquelle se trouvent les collectivités. Il faut donc, selon moi, trouver des solutions.
L'an dernier, Mmes les ministres Roselyne Bachelot-Narquin et Nathalie Kosciusko-Morizet ont demandé à une mission conjointe de l'Inspection générale des affaires sociales et du Conseil général de l'environnement et du développement durable un rapport sur les difficultés rencontrées dans l'application des dispositions de la loi de 2005 et sur les mesures de substitution envisageables.
Il est ainsi préconisé de reconnaître accessibles les équipements conformes aux règles d'accessibilité en vigueur avant la loi de 2005, au moins pour dix années supplémentaires ; c'est une piste à explorer.
Par ailleurs, dans son excellent rapport, notre collègue Éric Doligé recommande, entre autres propositions, de substituer à la définition réglementaire de l'accessibilité une approche fonctionnelle. On passerait ainsi de la notion de « personne handicapée qui doit pouvoir occuper un bâtiment exactement comme un valide » à la définition suivante : « La personne handicapée doit avoir accès à toutes les fonctions du bâtiment. »
L'échéance de 2015 est maintenant très proche et une augmentation des demandes de dérogation est à prévoir.
Éric Doligé a également proposé une procédure permettant au représentant de l'État d'apporter ponctuellement des assouplissements au vu des circonstances locales.
Notons enfin, mes chers collègues, l'inquiétude des élus face aux sanctions et à leur responsabilité pénale.
Toutes ces propositions méritent, à mon sens, d'être prises en considération.
Les lois relatives au handicap font toujours naître d'immenses espoirs. Il n'en reste pas moins que ce délai de trois ans est très court.
Il est important, à ce stade de la mise en application de la loi de 2005, de trouver des solutions, mais surtout d'établir des priorités, voire des échéanciers, lesquels, sans remettre en cause l'objet du texte et l'échéance du 1er janvier 2015, permettent de garantir un avancement réel de l'accessibilité, dans une optique plus réaliste au regard des possibilités de nos collectivités locales. Il convient d'agir en concertation avec tous les acteurs concernés.
Applaudissements sur les travées de l'UMP. - M. Gilbert Barbier applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, je tiens à vous rappeler que la loi de 2005 dite loi Handicap entend couvrir tous les aspects de la vie des personnes handicapées. Ce texte est l'aboutissement du long chemin parcouru par les représentants des personnes handicapées, leurs familles et leurs amis, qui avaient déjà obtenu la reconnaissance par la nation de l'indispensable solidarité collective due à ceux d'entre nous qui présentent des particularités de nature à les priver de leurs droits fondamentaux.
En effet, les lois de 1975 ont été une étape essentielle pour sortir cette prise en charge du huis clos familial ou associatif et introduire une obligation nationale de prise en charge par l'ensemble de la société, en vue d'assurer aux personnes en situation de handicap l'autonomie à laquelle elles aspirent.
La mise en chantier de cette réflexion, qui a abouti à la loi de 2005, reposait sur l'exigence d'une reconnaissance de la citoyenneté des personnes à besoins spécifiques, quelle que soit leur singularité. « Citoyen à part entière, parmi les autres » était un slogan de rassemblement puissant au tournant des années deux mille.
S'il exalte effectivement cette aspiration forte à la participation citoyenne des personnes en situation de handicap, le texte de 2005 introduit surtout un nouveau droit imprescriptible, celui de la compensation du handicap.
De l'excellent rapport de nos collègues, il ressort clairement que la politique volontariste d'intégration a permis de réelles avancées, exigeant une mobilisation de moyens financiers d'autant plus importants que l'approche privilégiée est celle des normes, des contraintes et des sanctions, notamment à l'échéance de 2015. C'est donc un texte à la fois incitatif et coercitif. Il est ainsi source d'inégalités, de rigidités et, malheureusement, de résistances à satisfaire.
Qu'en est-il de l'approche culturelle, sociale, humaniste ?
Qu'en est-il du changement de regard de la société sur celles et ceux qui sont porteurs de singularité au point d'avoir des besoins spécifiques, pour qu'ils contribuent à leur place, parmi les autres, à la bonne marche de la société ?
Le temps est venu, dans le cadre de ce bilan, de revoir les enjeux de ce texte.
À trois ans de l'échéance fixée, il convient, dans un contexte de contrainte économique qui restreint les capacités d'investissement des collectivités territoriales, d'analyser les retards et inerties dénoncés dans le rapport au regard des avancées significatives constatées dans tous les domaines, ainsi que l'évolution des mentalités, qu'il faut continuer d'encourager et de nourrir par des orientations susceptibles de définir un vrai projet de société participatif et inclusif qui ne devrait pas ignorer la juste place de l'entraide et de la solidarité. La compensation du handicap ne doit pas nous exonérer de l'attention qui humanise le lien.
Madame la ministre déléguée, construisons un projet de vivre ensemble où chacun contribuera, à sa place, à l'enrichissement des potentialités d'une société actuellement trop tournée vers l'individualisme et la sanction.
Il faut privilégier la « participation sociale », approche qui ouvre des possibilités en s'adaptant aux aptitudes et aux aspirations de la personne. Les façons de participer sont multiples : elles peuvent être sociales, relationnelles, culturelles, professionnelles ou affectives.
Le changement culturel vers une société « inclusive » impose que la société humaine s'adapte aux besoins spécifiques des personnes tout autant qu'à leur environnement. Il faut créer les conditions d'une véritable participation sociale en instaurant une accessibilité non seulement spatiale et physique, mais aussi professionnelle, culturelle, sociale, affective, civique et créative. L'égalité réelle est à ce prix.
La société inclusive est celle qui s'adapte aux différences de la personne, va au-devant de ses besoins et de ses aptitudes, afin de lui ouvrir toutes les chances de réussite dans la vie, sans tabou ni compassion, avec réalisme et humanité, en respectant ses désirs et sa parole pour l'accompagner, la porter au plus haut d'elle-même.
Cette inclusion est possible ; elle se développe déjà sur bien des terrains, à l'école notamment, mais elle requiert un minimum d'investissements et d'efforts de l'État pour garantir la qualité des accompagnements et des services proposés, assurer une considération et une reconnaissance à part entière de la personne handicapée.
L'inclusion doit être appréhendée comme un investissement durable, source d'humanité et de richesses pour la société tout entière : nous sommes tous appelés à y contribuer, elle ne concerne pas seulement les passeurs d'ordre ou les recruteurs.
L'inventaire de cette loi le montre, les moyens existent, les contraintes et les sanctions aussi. Ce sont l'adhésion politique, les disponibilités financières, le bon sens et le pragmatisme qui ont manqué et risquent de faire défaut de façon grandissante. La nouvelle étape doit donc être, à mon sens, plus culturelle que réglementaire, de façon à assurer une prise en charge globale et naturelle du handicap. Il faut voir les individus avant leur infirmité, et envisager leurs aptitudes avant leurs insuffisances, comme certains orateurs l'ont brillamment expliqué.
La sensibilisation à la connaissance et à l'approche du handicap doit, au-delà de la formation des enseignants précédemment évoquée, s'adresser aussi aux médecins, aux professionnels de santé, aux gestionnaires des ressources humaines, aux directeurs d'établissements culturels, à l'ensemble de la population.
Recherchons une approche globale, qui rende le handicap, la déficience, le besoin spécifique plus visibles, en considérant l'apport des personnes handicapées comme un atout dans la construction d'une société plus juste et plus égalitaire. Sachons faire preuve de pragmatisme et de bon sens dans l'application de la loi.
Des obligations normatives insupportables sont sources de clivages néfastes à la cohésion sociale, à une pensée sociale progressiste garante de cette société inclusive que nous appelons de nos vœux. La circulaire du Premier ministre du 4 septembre dernier impose que tous les actes législatifs prennent dorénavant en considération les besoins et la dignité de nos concitoyens en situation de fragilité au regard de leur autonomie et de leur autodétermination. C'est une bonne démarche.
Monsieur le président, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, l'accomplissement du projet de vie de nos semblables ayant des besoins spécifiques leur permettra de donner le meilleur d'eux-mêmes au collectif, sans durcissement des contraintes, mais en s'appuyant sur une vraie générosité du cœur et de l'intelligence, adossée au courage et à la sincérité politiques, qui devrait nous épargner toute surenchère sur le dos des personnes handicapées.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Monsieur le président, mesdames les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, l'existence, au sein de votre institution, d'une commission pour le contrôle de l'application des lois est une très bonne nouvelle pour la démocratie. Je tenais à saluer le président de cette commission, David Assouline, et, plus largement, l'ensemble de ses membres, qui contribuent, par leur vigilance, à ce que nos lois ne restent pas lettre morte. Je vous remercie d'avoir inscrit ce débat à l'ordre du jour d'une semaine sénatoriale de contrôle.
Le rapport qui nous rassemble aujourd'hui met particulièrement à l'honneur Mmes Claire-Lise Campion et Isabelle Debré, vice-présidentes de cette commission. Qu'il me soit permis de leur adresser tous mes remerciements pour le travail remarquable et sans concession qu'elles ont réalisé. Je tiens également à saluer l'engagement des sénateurs dont témoigne la qualité des interventions que j'ai pu entendre aujourd'hui ; elles me seront fort utiles dans le cadre de ma mission.
Que vaut une loi qui ne serait pas appliquée ou qui le serait mal ? Vous veillez à ce que cela n'arrive pas, et, en l'espèce, vous attirez mon attention sur une situation quelque peu préoccupante : la loi du 11 février 2005 est sans doute une grande loi de la République, mais sa mise en œuvre a été certainement défaillante.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je veux saisir l'opportunité de la publication de ce rapport pour faire un état des lieux de la prise en charge du handicap en France et vous dire quels seront les grands axes de mon action au service des personnes handicapées.
Dans les quatre grands domaines traités par le rapport – l'accessibilité, la scolarité, l'emploi et les prestations –, qui sont ceux de la loi de 2005, j'agirai avec principes et méthode.
Mes principes sont les suivants : apporter aux personnes handicapées des réponses personnalisées, car les situations de handicap sont multiples, ainsi que les histoires de vie et les projets, et faire du handicap, autant que possible, une situation ordinaire.
Par conséquent, les besoins diffèrent d'une personne à l'autre. Ce n'est pas l'architecture figée de nos dispositifs actuels qui doit justifier le parcours de prise en charge de la personne handicapée, mais bien, a contrario, les besoins de cette dernière, à titre individuel et à chaque moment de son existence.
Je m'efforce d'aller à la rencontre des acteurs de terrain, sur l'ensemble du territoire national. À ce titre, lorsque j'ai inauguré la maison d'accueil spécialisée « Les Acacias » à Pierrefeu-du-Var, certaines personnes handicapées m'ont fait part de leur soulagement de n'être plus internées en hôpital psychiatrique, et d'être enfin encadrées et respectés. J'ai rencontré d'anciens usagers des établissements et services d'aide par le travail, les ESAT, qui m'ont exprimé leur bonheur de travailler, parce qu'ils le pouvaient et le voulaient, dans une entreprise adaptée, voire dans une entreprise ordinaire. C'est possible !
Chaque personne handicapée a le droit d'être reconnue dans sa singularité : sa parole doit être écoutée et une réponse adaptée doit lui être proposée.
Je le répète, mon but est de faire du handicap une situation ordinaire, car je repousse la perspective d'une société dans laquelle la dépendance plus ou moins grande de certaines personnes deviendrait un prétexte pour les exclure ou les reléguer.
Faire du handicap une situation ordinaire, c'est réaffirmer notre volonté et notre faculté de vivre ensemble, dans le respect de nos différences et la conscience de ce qui nous unit tous.
C'est dans cet esprit que François Hollande, alors candidat à l'élection présidentielle, s'était engagé à ce que chaque projet de loi, chaque politique publique comprenne à l'avenir un volet handicap : cette promesse a été tenue ! Tout récemment, le Premier ministre a du reste adressé une circulaire à l'ensemble de ses ministres, afin que chacun d'entre eux prenne en compte, dans l'ensemble de ses propositions, le critère du handicap. Tel est le cas de la loi portant création des emplois d'avenir. D'ores et déjà, nous incluons le handicap dans chacune de nos réformes, et nous poursuivrons dans cette voie pour l'ensemble des politiques de l'emploi. Je développerai ce sujet dans quelques instants.
Ma méthode est claire : je veux agir dans la concertation et la transparence.
Certains se sont moqués des corps intermédiaires, des élus et des associations. Le Gouvernement veut, au contraire, consulter ces derniers et les associer systématiquement aux concertations mises en œuvre.
Pour assurer l'application de la loi de 2005, les élus locaux sont, certes, des partenaires essentiels. Mais, au-delà, je souhaite mobiliser tous les acteurs concernés par le champ du handicap pour mettre notre intelligence collective au service des personnes handicapées.
La transparence, c'est la condition de la confiance sur laquelle repose notre travail en commun.
Ainsi, j'ai tenu à rendre public un rapport relatif au handicap, qui a été remis au mois d'octobre 2011, par lequel trois inspections pointent les défaillances qu'a subies la mise en application de la loi de 2005. De fait, il me semblait urgent de sortir de la situation de non-dit et de défiance qui s'installait entre l'État, les associations de personnes handicapées, les collectivités territoriales et, plus généralement, les acteurs du monde économique.
J'ai souhaité cette publication parce que nous devons la vérité aux personnes handicapées, à leur famille et aux associations qui les représentent. J'ai l'habitude de prendre les problèmes à bras-le-corps : encore faut-il avoir conscience des enjeux et porter un regard lucide sur ces derniers.
Je distinguerai, à ce titre, les quatre principaux champs d'intervention énumérés dans ce rapport.
Le premier est celui de l'accessibilité. En la matière, je souhaite maintenir l'échéance de 2015. De fait, nous n'avons pas le droit de reculer : emprunter les transports en commun, faire ses courses, aller chez le médecin, c'est un parcours du combattant pour la plupart des millions de personnes en situation de handicap vivant dans notre pays.
Rendre nos villes, nos territoires, notre espace public accessibles aux personnes en situation de handicap, c'est également y faciliter les déplacements de nos aînés, des jeunes parents, des jeunes enfants eux-mêmes, du plus grand nombre de nos concitoyens, bref rendre service à la société tout entière.
L'accessibilité universelle est une grande et belle idée. Tout le monde doit pouvoir avoir accès à tout, notamment aux moyens modernes de communication, qui occupent une si grande place dans nos vies. Voilà pourquoi un appel d'offres sera lancé à la mi-octobre pour la création de centres relais téléphoniques généralistes, destinés à briser l'isolement des sourds et malentendants.
Par ailleurs, l'accès au débat public, et donc à la citoyenneté, qui est au fondement du vivre ensemble, doit encore être facilité. Dans cette perspective, le Gouvernement a publié, à l'intention des personnes déficientes intellectuelles, une version facile à lire et à comprendre du discours de politique générale du Premier ministre. Ce travail a été accompli en partenariat avec des personnes en situation de handicap, ainsi qu'avec les associations chargées de les représenter. Pour aller plus loin, les services de communication de l'État seront associés à cette démarche, afin que l'ensemble des sites officiels deviennent totalement accessibles.
La traduction en langue des signes française et la vélotypie seront systématiquement employées lors des interventions du Président de la République et du Gouvernement. Toutefois, nous travaillons également à plus long terme : à cet égard, je souligne dès à présent qu'une mission de simplification des documents et des processus administratifs sera confiée à la direction générale de la modernisation de l'État, la DGME.
Néanmoins, comme l'ont rappelé les orateurs qui se sont succédé, le dossier le plus lourd, c'est celui de l'accessibilité du bâti et des transports.
Tous les lieux accueillant du public devraient être accessibles aux personnes handicapées dès 2015. Nous sommes loin du compte, il faut l'admettre. C'est d'ailleurs à cette conclusion qu'aboutissent le rapport de l'IGAS et votre propre rapport, mesdames les rapporteurs. Il ne s'agit pas d'un écueil, ce n'est pas grave de dresser ce constat, au contraire : il faut jouer le jeu de la vérité, et présenter les faits de manière claire et précise pour garder le cap, car tel est mon objectif.
Ainsi, sur mon initiative, le Premier ministre a confié à Mme Claire-Lise Campion la responsabilité de prolonger ces deux rapports par une mission parlementaire chargée de définir, avec l'ensemble des acteurs de terrain, les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés pour 2015. Cette mission sera courte – trois mois – et permettra de définir un échéancier et un plan d'action crédibles sur la base des propositions synthétisées dans le rapport de l'IGAS.
Nous procéderons avec volonté et pragmatisme pour avancer, essentiellement, sur ces deux sujets capitaux que sont le bâti et les transports. J'annoncerai des mesures précises à l'issue de ces travaux, certainement au début de l'année 2013.
Le deuxième champ d'intervention est celui de la scolarité des enfants en situation de handicap. Les divers orateurs ont longuement évoqué ce sujet.
Les enfants qui souffrent de handicap font partie de la jeunesse de notre pays. Ils incarnent son avenir et son espoir, comme tous les enfants. Or un élève qui ne peut pas suivre convenablement sa scolarité, c'est non seulement une tragédie personnelle, mais aussi un énorme gâchis collectif. Il n'est pas acceptable que l'école de la République ne se donne pas les moyens d'accueillir tous ses enfants dans de bonnes conditions.
Je vous signale, madame la rapporteur, qu'une mission a été confiée à l'IGAS et à l'Inspection générale de l'éducation nationale, pour déterminer le nombre d'enfants concernés. De fait, derrière les données quantitatives, il faut considérer les vies humaines. On évoque le chiffre de 10 000 enfants. La réalité est sans doute plus proche de 6 000 individus. Quoi qu'il en soit, vous avez raison, il est impératif de connaître l'état précis de la situation : même si des progrès ont été accomplis, il ne faut laisser aucun enfant sur le bas-côté. §
Dans cette perspective, je précise qu'une partie des créations de postes dans l'éducation nationale sera destinée à accompagner les élèves en situation de handicap. Certains orateurs l'ont souligné à la tribune : dès la rentrée scolaire 2012, nous avons créé 1 500 postes d'auxiliaires de vie scolaire individuels supplémentaires. À ce jour, nous comptons donc, globalement, 24 500 AVS individuels.
Le but est de répondre aux besoins d'accompagnement, capitaux pour nombre de familles.
À l'heure actuelle, dans le cadre de la refondation de l'école, trois chantiers sont en cours, sur lesquels je travaille précisément avec Vincent Peillon et George Pau-Langevin.
Premièrement, j'évoquerai la professionnalisation des AVS, que l'on nomme plus couramment les accompagnants.
Un groupe de travail a été réuni. Il a d'ores et déjà commencé ses travaux, et rendra normalement ses préconisations à la mi-mars 2013.
Mon objectif est simple : il s'agit de créer un métier pérenne, accessible au terme d'une formation, sur la base d'un niveau requis, afin de ne pas ajouter la précarité au handicap. Soit dit en passant, les enfants en situation de handicap sont les seuls pour lesquels les accompagnants se voient imposer un si faible degré de qualification ! Globalement, pour les autres enfants, les règles en vigueur sont bien plus rigoureuses.
Le but est donc d'avancer sur ce dossier, en mutualisant les moyens : évidemment, il ne sera pas possible de recruter un AVS pour chaque enfant handicapé. Il faut donc impérativement dégager des moyens via des mutualisations.
Madame Debré, comme vous, je souhaite éviter les ruptures, en accompagnant ces enfants vers la scolarité. Aujourd'hui, 80 % des enfants en situation de handicap achèvent leur scolarité par l'obtention d'un BEP ou d'un CAP. Il n'est pas tolérable que, parmi les élèves handicapés, certaines intelligences soient abandonnées. La France ne compte que 11 000 étudiants handicapés. Ce n'est pas acceptable ! Il faut accompagner les enfants en situation de handicap vers le plus haut niveau de scolarisation. Les universités font des efforts : elles concluent des conventions, travaillent avec les grandes écoles, lesquelles ont d'ailleurs de plus grandes difficultés à mettre en œuvre ce chantier. J'espère donc que nous travaillerons également en ce sens dans le cadre de la refondation de l'école.
Deuxièmement, la question de la formation des enseignants et, plus largement, de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, a été longuement abordée. Les enseignants exercent leur métier avec passion, mais ils sont souvent démunis face aux enfants en situation de handicap. À cet égard, le Gouvernement tient à rétablir la formation initiale des enseignants, en y intégrant l'approche du handicap. Les professeurs ne deviendront certes pas des spécialistes en la matière, mais ils ne bénéficieront pas moins d'une approche de ces enjeux, que nous souhaitons également promouvoir dans le cadre de la formation continue.
Il faut saluer le travail exceptionnel que les enseignants accomplissent au service de la jeunesse de notre pays, en leur donnant les moyens d'exercer leur métier dans de bonnes conditions.
En outre, nous allons conclure une convention avec l'Association pour adultes et jeunes handicapés, l'APAJH, qui dispose d'un réseau à l'échelle nationale, et dont les membres sont souvent d'anciens enseignants, connaissant bien l'univers de l'éducation nationale. C'est préférable, dans ce domaine ! À la prochaine rentrée scolaire, dès qu'un enfant en situation de handicap sera signalé, ces derniers s'efforceront de se tourner vers les écoles, collèges et lycées, pour accompagner, aider et préparer les personnes concernées.
Troisièmement, et enfin, dans le cadre de la refondation de l'école, la coopération entre les établissements ordinaires et spécialisés doit devenir systématique. L'engorgement des unités localisées pour l'inclusion scolaire, les ULIS, ainsi que l'absence de recrutement d'AVS ces dernières années ont conduit à une triste situation : de nombreux enfants sont en effet « assignés » à domicile, si vous me passez l'expression !
Souvent, cet état de fait emporte des conséquences terribles sur la carrière des parents, plus exactement sur celle des mères.
Nous devons rester fidèles à l'esprit de la loi de 2005 et adopter une logique de parcours, pour penser l'articulation entre les établissements ordinaires et les établissements spécialisés d'une part, entre ces établissements et la scolarisation à domicile de l'autre. Il ne doit pas exister deux filières, l'une spécialisée et l'autre ordinaire, collaborant à l'occasion. Au contraire, une seule forme de scolarisation est acceptable : le projet personnalisé de scolarisation.
Dans la même perspective, il nous faut renforcer l'aide apportée par les professionnels de la filière médico-sociale – un orateur l'a précédemment souligné –, à savoir les psychologues, orthophonistes, kinésithérapeutes, par le biais, notamment, de services d'éducation spéciale et de soins à domicile.
Après l'école, le troisième champ capital est celui de l'emploi : M. Teulade l'a amplement évoqué il y a quelques instants.
Comment ne pas opérer le rapprochement entre notre économie et le sort réservé aux personnes handicapées en France, lorsqu'on constate que la carte européenne des pays les plus gravement plongés dans la crise se superpose à celle des États les plus négligents quant à la prise en compte du handicap ? Cette corrélation ne se double peut-être pas d'une causalité évidente, mais j'ose en souligner le caractère frappant.
Au reste, aucune nation ne peut se permettre d'écarter de son économie une part considérable de ses forces vives, et surtout pas la France, déjà fragilisée par de nombreuses exclusions.
Le taux de chômage des travailleurs handicapés est deux fois supérieur à celui des travailleurs valides. Il est urgent d'agir pour que le seuil de 6 % de personnes en situation de handicap dans les entreprises et la fonction publique soit enfin respecté.
Notre économie ne doit se priver d'aucun talent, d'aucune force. Or, dans ce domaine, le bilan du pouvoir sortant n'est pas très bon.
Il faut à la fois inciter davantage les employeurs et sanctionner plus sévèrement les entreprises défaillantes dans ce domaine. L'État doit, quant à lui, se comporter de manière exemplaire en se conformant à la loi.
Évidemment, il nous faut toujours agir avec pragmatisme et discernement. Aussi, je vous remercie, madame la sénatrice, d'avoir attiré mon attention sur la situation des services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS. Nous aurons l'occasion d'aborder ce sujet plus avant.
Avec le ministre du travail, Michel Sapin, et les syndicats, nous avons tracé le cadre d'une grande négociation interprofessionnelle sur l'emploi des travailleurs handicapés, qui se tiendra au début de l'année 2013. Elle traitera notamment de l'accès à la formation et de l'adaptation des postes.
Les jeunes adultes sont particulièrement touchés par le chômage. L'accès à un premier emploi stable est une gageure pour nombre d'entre eux, puisqu'on leur demande de disposer d'une expérience sans jamais leur donner la possibilité de faire leurs preuves.
Certains de ces jeunes sont en situation de handicap et cumulent, partant, les difficultés. Avec les dispositions spécifiques au handicap, la loi portant création des emplois d'avenir apporte une première réponse à leurs problèmes. L'ensemble de notre politique en faveur de l'emploi visera le même objectif, en particulier dans le cadre du prochain dispositif présenté, relatif aux « contrats de génération ». Celui-ci concerne non seulement l'insertion des jeunes, mais aussi le maintien dans l'emploi des salariés désignés par le terme de « seniors ». Vous le savez, l'éviction précoce dont sont victimes ces actifs touche particulièrement les travailleurs handicapés.
J'ai également la conviction qu'il nous faut consolider le réseau des établissements et services d'aide par le travail, les ESAT, et faciliter la mobilité des travailleurs entre ESAT, entreprise adaptée et entreprise ordinaire.
Chaque travailleur handicapé doit pouvoir se réaliser dans la structure qui lui convient et dans laquelle ses compétences seront mises en valeur.
La politique de création de places dans les ESAT menée ces dernières années a été bénéfique, mais elle s'est faite au détriment des structures existantes. Je souhaite inverser complètement cette logique.
Je veux aussi aider les ESAT à conforter leur situation financière – certains sont aujourd'hui en grande difficulté – et faire une pause dans l'obligation de convergence tarifaire, qui s'impose à ces établissements et les fragilise.
Nous procéderons également à la revalorisation des rémunérations des salariés, en dégageant plus de 10 millions d'euros supplémentaires pour 2013, et développerons de nouveaux projets d'accompagnement de sortie des ESAT.
Un effort particulier est demandé à Pôle Emploi et au réseau Cap Emploi pour améliorer la situation des travailleurs handicapés, qui souffrent plus que les autres encore des effets de la crise. L'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, l'AGEFIPH, doit intensifier son action d'information des employeurs sur leurs obligations et les aides dont ils peuvent bénéficier.
Enfin, je veux parler des établissements et services accueillant des personnes handicapées. Notre responsabilité est d'être à l'écoute de ces personnes, afin de leur proposer des soins adaptés, dans l'environnement qui leur convient le mieux.
De ce point de vue, il est contre-productif d'opposer milieu ordinaire, médico-social et sanitaire, car c'est bien par la diversité de l'offre et la combinaison des approches que l'on peut espérer accompagner efficacement la personne handicapée, au plus près de son parcours de vie.
Les personnes handicapées doivent avoir le choix. Celui-ci est rendu possible, entre autres, grâce aux acteurs du secteur médico-social, qui, par leur professionnalisme et leur dévouement, apportent à des centaines de milliers de personnes les soins et l'accompagnement social et éducatif que nécessite leur handicap. Comme les salariés des ESAT, ces professionnels verront leur rémunération revalorisée.
Ils doivent en outre recevoir une formation adéquate qui les prépare, notamment, à un travail en réseau avec l'ensemble des autres professionnels impliqués dans le suivi de la personne handicapée.
Tout à l'heure, nous avons évoqué le plan de création de 50 000 places, engagé en 2008. Nous assurerons la mise en œuvre de ce plan, en créant 3 000 places en 2013.
Mais nous avons aussi relevé des besoins spécifiques, cela a été souligné au cours du débat. Tout d'abord, on observe dans notre pays un énorme déficit dans la prise en charge de l'autisme, tout comme dans celle du handicap psychique. Ensuite, nous devons répondre à un phénomène de société, celui des personnes handicapées vieillissantes. Car les personnes handicapées vieillissent, elles aussi, et il faut trouver des solutions adaptées. Nous y travaillerons dans le cadre de la préparation du prochain plan. Par ailleurs, des déséquilibres territoriaux très marqués ont été constatés. Il s'agit par conséquent de procéder à un redéploiement plus homogène sur l'ensemble du territoire. Dans certains départements ou régions, on observe de vraies défaillances, de vrais retards.
La prestation de compensation du handicap, ou PCH, est un acquis majeur de la loi de 2005. L'idée même qu'un handicap peut être compensé est centrale, comme l'indiquait tout à l'heure Philippe Bas. On souligne ainsi que le handicap est toujours un handicap en situation. Si nous sommes capables de faire évoluer les situations, d'adapter l'environnement, alors le handicap s'estompe.
La contribution de la PCH à l'autonomie des personnes handicapées ne fait aucun doute. Nous devons donc agir pour pérenniser cette prestation. Certes, je garde en tête que certains besoins en termes d'aide à domicile ou de soutien à la parentalité ne sont pas couverts par celle-ci. Mais je voudrais reprendre les propos de Jean-Michel Baylet et affirmer que la pérennisation de la PCH implique de mieux encadrer le marché des aides techniques, pour éviter que les prix ne dérivent au détriment des finances publiques et, en fin de compte, des personnes handicapées. J'ai demandé à l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, une mission sur ce sujet.
La PCH coûte aujourd'hui 1, 5 milliard d'euros aux départements, l'État ne compensant ces dépenses qu'à hauteur de 500 millions d'euros. Nous devons véritablement pérenniser cette prestation, mais aussi la consolider, en veillant à éviter les dérapages.
Par ailleurs, comme Mme Campion l'indiquait tout à l'heure, le Gouvernement est attentif à la situation des fonds départementaux de compensation. Je vous confirme que nous les abonderons prochainement à hauteur de 4 millions d'euros.
Nous devons cependant assurer l'équité sur l'ensemble du territoire, alors même que nous constatons de vraies disparités entre départements. Tous les acteurs – conseils généraux, maisons départementales des personnes handicapées, caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et associations de personnes handicapées – doivent se mettre autour de la table pour homogénéiser les prestations et les simplifier.
Une autre innovation remarquable de la loi de 2005 est précisément la création des maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH.
À la fois « maisons communes » et « guichet unique », les MDPH jouent un rôle central dans l'accueil, l'évaluation et l'orientation des personnes en situation de handicap. Il est très commode d'avoir un interlocuteur unique et proche de son domicile pour accomplir ses démarches. Il est rassurant de pouvoir s'adresser à une personne connue quand on parle de choses aussi essentielles que la prise en charge de son handicap. Toutefois, la gouvernance des MDPH doit être clarifiée pour que la qualité du service rendu aux personnes handicapées soit améliorée.
En 2013, là aussi, l'État contribuera à hauteur de 62, 8 millions d'euros au fonctionnement des MDPH, sans compter les personnels mis à disposition, qui représentent environ un millier de fonctionnaires.
J'ai entendu vos suggestions de réorganisation et de simplification des démarches pour les demandes de renouvellement. Il s'agit en effet de pistes sérieuses sur lesquelles nous pouvons travailler.
Par ailleurs, j'ai la conviction qu'il est possible de repenser notre système de financement et de tarification en vue d'une plus grande équité, efficacité et simplicité. La mission IGAS-IGF rendra ses conclusions dans les prochains mois. Elles seront discutées avec l'ensemble des acteurs, les gestionnaires d'établissements et de services, mais aussi les ARS, les conseils généraux et, bien sûr, les représentants des personnes handicapées et de leur famille.
La réforme de la tarification sera certainement un chantier de moyen, voire de long terme, mais cela ne nous empêchera pas d'avancer plus rapidement en ce qui concerne l'objectif de simplification.
Mesdames, messieurs les sénateurs, globalement, je me félicite de ce que, dans cette période de grande tension budgétaire, alors que le Gouvernement met en œuvre le redressement dans la justice, pour lequel les Français ont investi le président François Hollande, la solidarité envers les personnes handicapées reste une priorité. En 2013, les crédits alloués aux personnes en situation de handicap dépasseront 20 milliards d'euros, avec 11, 2 milliards d'euros au titre du projet de loi de finances, soit une augmentation de 6, 3 %, et 9 milliards d'euros au titre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, soit une augmentation de 3, 3 %.
Les défis que nous avons à relever sont à la fois nombreux et de taille. Votre concours est indispensable et, sans jamais remettre en cause votre indépendance, je vous associerai tout au long du chemin.
Nous n'avons pas d'autre alternative que de réussir : nous le devons aux personnes handicapées, qui souffrent encore trop souvent d'être reléguées de l'école, de l'emploi, de la citoyenneté… bref, de la société. Une société qui, souvent, les oublie, une société atteinte de cécité, une société qui ne voit pas qu'en excluant, elle se prive de ressources précieuses ; qu'en excluant, elle s'abîme ; qu'en excluant, elle cesse d'être la République, cet idéal qui nous rassemble, dans le respect de nos différences et de nos singularités.
Je veux que vous m'aidiez à construire une société dans laquelle chacun peut s'épanouir, une société dans laquelle les différences ne sont pas autant de justifications à la stigmatisation, à la relégation ou à la discrimination, une société qui fait sienne cette évidence fondamentale : oui, nous sommes tous différents, c'est notre richesse ; mais nous sommes aussi tous unis, c'est notre fierté, la fierté de la République.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Nous en avons terminé avec le débat sur l'application de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

L'ordre du jour appelle le débat sur l'économie sociale et solidaire, à la demande de la commission des affaires économiques.
La parole est à M. Marc Daunis, président du groupe de travail sur l'économie sociale et solidaire.

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, le 22 février dernier, notre commission, alors commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, a décidé de créer un groupe de travail sur l'économie sociale et solidaire, l'ESS, dont elle m'a confié l'honneur de la présidence et d'une co-animation avec mon excellente collègue Marie-Noëlle Lienemann.
Permettez-moi de remercier ici tous mes collègues de la commission, particulièrement notre président, Daniel Raoul, ainsi que l'ensemble des membres du groupe de travail pour la qualité de nos échanges. Cette création préfigurait, d'une certaine manière, la décision prise quelques mois plus tard par le Gouvernement de mettre en place un ministère consacré à cet important secteur de notre économie. Je me félicite de ces deux initiatives, car, par le passé, les pouvoirs publics n'ont pas toujours su accompagner avec toute la constance et la détermination souhaitables un secteur qui contribue pourtant de façon significative à la création de richesses, mais aussi à la cohésion sociale dans notre pays.
De surcroît, la création de ce groupe de travail intervient à un moment-clef. En effet, la crise économique et financière que nous traversons n'est pas simplement due aux errements de la finance. Elle est aussi la conséquence de la montée d'égoïsmes, d'individualismes sans rivage, de la logique d'un système et de la remise en cause progressive du rôle de la puissance publique.
La cohésion sociale s'en trouve gravement menacée. Le chômage de masse s'installe, en même temps que la précarité pour des catégories de plus en plus nombreuses de la population, notamment les classes moyennes. Dans un tel contexte, il est aisé de constater un regain d'intérêt manifeste pour l'économie sociale et solidaire dans son rôle de « réparateur social ».
Au-delà, il est intéressant de porter un regard sur l'origine de l'économie sociale. La croyance en la capacité d'une économie sociale et solidaire de répondre à une exigence de justice et d'efficacité est une vieille utopie, portée par certains penseurs dès le XIXe siècle. La critique à l'encontre du laisser-faire allait alors de pair avec la crainte et le refus d'une économie administrée centralement.
L'économie sociale et solidaire investit ainsi des champs qui ne sont pas occupés par les acteurs économiques traditionnels. Plus humaine, elle crée des richesses tout en préservant l'environnement et les ressources naturelles durables.
Une première approche, assez répandue, attribue aux coopératives, mutuelles, associations et fondations qui constituent l'économie sociale et solidaire un rôle de complément de l'économie capitaliste de marché et d'aide à la reconstruction d'un lien social mis en danger par la crise.
L'ESS traduit également une volonté de se rapprocher des territoires. Je pense en particulier aux territoires ruraux qui, présentant des atouts indéniables en termes de qualité de vie, attirent une nouvelle population résidentielle.
L'avenir de ces territoires, nous le savons, dépendra de leur capacité à maintenir un lien social fort, à proposer une vie associative locale dynamique, ainsi que des services nouveaux et diversifiés. Ainsi, nous avons pu mesurer au cours de nos travaux et des nombreuses auditions que nous avons menées à quel point l'économie sociale et solidaire foisonne de projets qui peuvent sans aucun doute contribuer au désenclavement des territoires ruraux et favoriser l'installation des populations, en particulier des jeunes.
Au cours de ces mêmes auditions, nous avons aussi vu combien il serait réducteur d'appréhender l'économie sociale et solidaire principalement au travers d'une fonction de réparation sociale : elle constitue plus largement un secteur économique à part entière, créateur de richesses et porteur d'innovations, qui a pris une importance croissante ces dernières années. D'après les statistiques officielles, il représente 10 % de l'emploi en France, soit 2, 3 millions de salariés ire.
Majoritaires dans le domaine social, ces emplois sont aussi très nombreux dans les domaines de l'assurance et du crédit ou bien encore dans l'agroalimentaire et le commerce, au travers de sociétés coopératives. Si on peut noter une présence moins soutenue dans d'autres branches de la production, comme l'artisanat, l'industrie ou le logement, je suis pourtant convaincu que l'économie sociale et solidaire a le potentiel pour s'y développer rapidement, si l'on met en place des dispositifs de financement adaptés et qu'on lève certains freins juridiques qui brident le potentiel d'innovation des acteurs, sur lequel je reviendrai.
Stratégique par son poids économique, fortement territorialisée, l'économie sociale et solidaire présente aussi l'avantage essentiel d'offrir une importante ressource d'emplois non délocalisables. En relation beaucoup plus étroite avec son environnement territorial que l'économie capitaliste, l'économie sociale et solidaire se caractérise aussi par un maillage de PME et de TPE, qui contribuent à la dynamique des territoires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais plaidé, dans le cadre de notre rapport, pour la mise en place d'un Small Business Act à la française en faveur des PME et des TPE et demandé qu'un volet dédié à l'économie sociale et solidaire y soit intégré.

J'aimerais enfin aborder un autre constat majeur concernant la place qu'occupe aujourd'hui l'économie sociale et solidaire. De plus en plus de citoyens, d'entrepreneurs et de responsables politiques voient en effet dans ce secteur une alternative d'avenir à un modèle économique fondamentalement déséquilibré, qui a fondé la suprématie de la recherche opportuniste et individualiste des gains financiers de court terme. Par opposition aux dérives de ce modèle, l'intérêt de l'ESS réside principalement dans sa capacité à produire des idées et des pratiques réconciliant performance et solidarité, croissance et justice, prospérité et développement durable.
Dans le contexte actuel, qui révèle clairement les limites, l'essoufflement, d'un capitalisme globalisé et financiarisé, l'économie sociale et solidaire fait figure de potentiel alternatif.
Naturellement – cela mérite de s'y arrêter quelques instants –, l'économie sociale et solidaire ne saurait être considérée comme une alternative globale au capitalisme et à ses dérives. Comme je l'ai déjà suggéré, il n'est nullement question que se substitue au marché une planification centrale. Il est au contraire question de laisser libre cours à des initiatives locales et de leur donner les moyens de réussir, particulièrement là où le marché est en échec.
Historiquement, dans les cycles de « bon fonctionnement » du marché, se produit presque mécaniquement un alignement des entreprises sur le modèle capitalistique classique. En revanche, quand le marché dysfonctionne, on peut noter que les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont sollicitées. Ce fut le cas dans le passé avec les mutuelles, y compris les banques mutualistes. La distinction s'est estompée dans la période de croissance forte et régulière, au point d'ailleurs que les statuts juridiques ont été alignés. Elle pourrait redevenir d'actualité.
Ainsi, il apparaît aujourd'hui erroné de présenter l'ESS comme un creuset, une matrice, un modèle de développement, mais il est certain qu'elle concourt, eu égard à ses dynamiques et modèles originaux, à la création d'une alternative. Or, nous le savons tous, historiquement, les modèles économiques se sont succédé et ont connu des phases de mutation avec des périodes plus ou moins intenses.
Prenons l'exemple concret de la reprise par des entreprises de l'économie sociale et solidaire d'activités auxquelles renoncent des entreprises capitalistes classiques. Je n'aborderai pas ici les raisons d'une telle évolution. Mais les conditions de cette reprise sont forcément délicates à établir, car elles renvoient à la situation du marché, aux conditions de demande et de concurrence, bref à un environnement qui demeure, quant à lui, inchangé. C'est la raison pour laquelle il paraît important – j'y reviendrai ultérieurement – d'adapter certaines de ces règles à l'économie sociale et solidaire.
Notre rôle de législateur pourrait être de fixer ces règles ainsi que les critères d'attribution des subventions publiques au secteur de l'économie sociale et solidaire, afin qu'il puisse remplir les missions que les entreprises traditionnelles ne sont plus en mesure d'assumer.
Ainsi, si l'ESS ne constitue pas l'unique matrice de ce qui supplantera de façon inéluctable l'actuel modèle économique dominant, elle contribue indiscutablement à son émergence. Dès lors, son développement nécessite impérativement d'être encouragé et facilité par les pouvoirs publics.
À ce sujet, je relève que la nécessité de replacer l'humain au centre des préoccupations économiques ne concerne pas seulement notre pays. L'Union européenne dans son ensemble cherche désormais à promouvoir ce qu'elle appelle un objectif de « croissance inclusive, plus juste socialement et écologiquement durable ». La Commission européenne multiplie ainsi les initiatives depuis quelques mois en faveur de « l'entrepreneuriat social ».
Bien que je me félicite, cela va de soi, de l'intérêt de la Commission en la matière, je souhaite toutefois appeler à une certaine vigilance. Les acteurs de l'ESS que nous avons auditionnés ont en effet unanimement souligné l'enjeu crucial d'une présence forte de la France dans le débat européen. Les règles juridiques qui seront mises en place dans les années à venir au niveau européen devront conforter, et non pas déstabiliser, l'économie sociale et solidaire tel que nous la concevons dans notre pays. Il convient de nous assurer que, derrière ce qui ne pourrait être qu'un glissement lexical et sémantique – l'Europe parle d'entrepreneuriat social là où la France utilise les termes d'économie sociale et solidaire –, ne s'opère pas aussi un glissement de sens susceptible de conduire, à terme, à la dissolution de l'économie sociale dans un droit étroit de la concurrence. La redéfinition des frontières de l'économie sociale et solidaire doit permettre d'enrichir la notion, et non de la diluer. Le Sénat, pour sa part, peut, à son niveau, contribuer à peser sur les débats européens au moyen de propositions de résolutions européennes.
Après ces propos de portée générale destinés à rappeler la place de l'ESS en France et en Europe, permettez-moi de revenir sur les travaux du groupe de travail mis en place par le Sénat sur ces questions.
Il y avait, à l'origine de sa création, le constat d'une carence dans l'organisation institutionnelle et l'agenda de travail des pouvoirs publics français. L'ESS a été marginalisée au cours des dix dernières années. La création, en mai dernier, d'un ministère de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, rattaché au ministère de l'économie et des finances et qui vous a été confié, monsieur le ministre délégué, a constitué un très beau signal et une très belle reconnaissance.
Au-delà de la mission conduite par le député Francis Vercamer entre 2008 et 2010, il nous appartient maintenant de présenter, conformément à votre volonté, des mesures législatives et financières, afin que la mise en place d'un dialogue renforcé avec l'ensemble des ministères concernés et les instances représentatives puisse concerner tout le secteur de l'économie sociale et solidaire.
Pour sa part, le groupe de travail sénatorial a entamé, dès le mois de mars dernier, des travaux qui ont suivi deux axes : d'une part, appréhender globalement la situation de l'économie sociale et solidaire et, d'autre part, de façon plus circonscrite, établir un diagnostic précis du système coopératif en France, l'objectif étant de dégager des propositions concrètes en faveur de son développement. Cela a donné lieu à la publication le 25 juillet, d'un rapport que nous avons cosigné avec Marie-Noëlle Lienemann, laquelle a impulsé un remarquable travail concernant le système coopératif.
Avant de lui céder la parole, je souhaite mettre l'accent sur les trois questions clés qui se dégagent de la consultation transversale menée auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire.
Tout d'abord, il est nécessaire de réfléchir à une définition des frontières de l'économie sociale et solidaire. Celle-ci inclut aujourd'hui les organismes qui se rattachent à l'une des quatre grandes familles statutaires : coopératives, mutuelles, associations et fondations. Autour de ce noyau dur, on trouve cependant un grand nombre d'entreprises qui, bien qu'empruntant la forme juridique d'une société classique, revendiquent leur appartenance à l'ESS du fait des valeurs de désintéressement, de solidarité et de démocratie auxquelles elles se réfèrent et des objectifs d'utilité sociale qu'elles cherchent à promouvoir. Faut-il inclure ces organismes dans l'ESS ?
D'un côté, il n'y a pas de raison de penser que les quatre statuts qui définissent aujourd'hui les frontières officielles de l'ESS constituent l'horizon ultime du secteur. Ces frontières ont d'ailleurs été redéfinies plusieurs fois par le passé. Je rappelle, par exemple, que jusqu'au début des années deux mille, on parlait d'économie sociale et non pas d'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, tout cela est entré dans les mœurs. Pour l'avenir, on peut s'interroger sur la vocation de l'ESS à intégrer plus largement toutes les formes de production se développant hors de la logique capitalistique.
D'un autre côté, la référence aux valeurs qui sont celles de l'ESS ne constitue pas à elle seule un critère d'appartenance suffisant, d'autant que toutes les entreprises communiquent désormais sur le thème de la responsabilité sociale et environnementale. N'y a-t-il pas là un risque de dilution auquel il convient de réfléchir ? Cette question est d'autant plus pertinente que j'ai noté tout à l'heure, en évoquant les travaux actuels de la Commission, la nécessité de renforcer et non pas de diluer ce secteur lors d'une redéfinition de ses frontières.
Je souhaite insister sur un point : dès lors que l'on met en place des politiques publiques assorties d'outils fiscaux ou financiers spécifiques, il importe d'en désigner avec précision les bénéficiaires. Jusqu'à présent, la réflexion sur la question des frontières s'est structurée dans un débat sur la création d'u nouveau label. Mais il serait intéressant également de réfléchir aux moyens d'une inclusion statutaire.
La deuxième question importante sur laquelle il convient de se pencher est celle du financement de l'ESS. Même lorsqu'elles évoluent dans la sphère marchande, les structures relevant de l'économie sociale et solidaire ont en effet beaucoup de mal à trouver des financements externes, car leur logique de profit limité et leurs principes de gouvernance démocratique les rendent peu intéressantes pour les investisseurs financiers. Il faut donc réfléchir aux moyens d'orienter l'épargne vers l'économie sociale et solidaire en créant des outils et des circuits de financement spécifiques. Mobiliser l'épargne solidaire et l'épargne populaire, mettre en place des mécanismes de cofinancement ou de garantie publics, utiliser plus largement les fonds européens ou le mécénat, favoriser le renforcement des fonds propres : il s'agit là d'un vaste chantier. Je sais, monsieur le ministre délégué, que vous vous y êtes attelé. Le Sénat, pour sa part, est prêt.
D'ailleurs, la création de la future banque publique d'investissement, avec un compartiment dédié au financement de l'ESS, est un élément de réponse pragmatique à ces difficultés. De même, la facilitation de l'accès aux marchés publics pour les entreprises de l'ESS constitue l'un des objectifs prioritaires. Cela permettra de répondre au besoin de fonds propres que ces entreprises ont clairement exprimé.
Un troisième axe de réflexion concerne la question de l'emploi. Je ne reviendrai pas sur les emplois d'avenir. Cependant, notre conviction est qu'il existe, dans l'économie sociale et solidaire, d'autres gisements d'emplois importants à exploiter, y compris dans le cadre d'une activité marchande. Il convient donc de réfléchir à des moyens complémentaires, notamment financiers, pour les stimuler.
Le dernier point sur lequel je souhaite attirer votre attention est la participation au dialogue institutionnel. La réforme du cadre normatif relatif à l'économie sociale et solidaire donne une place importante au Sénat, qui doit jouer un rôle d'intermédiaire pour faciliter la contractualisation entre l'État et les acteurs de l'ESS.
Monsieur le ministre délégué, au niveau national, vous avez indiqué qu'une loi de programmation sur l'économie sociale et solidaire serait présentée au cours du premier semestre 2013 au Parlement. L'occasion devra être saisie pour aborder la question controversée de la gouvernance de l'ESS.
Je conclurai en soulignant la nécessité de pérenniser l'existence d'une structure consacrée à l'ESS au sein de notre Haute Assemblée. Le tableau que j'ai brossé montre que nous devrons nous impliquer dans des chantiers lourds et complexes. Il nous a donc paru hautement souhaitable de créer un groupe d'études sur l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire une instance visible, pérenne et transversale permettant d'irriguer les différents champs du travail législatif. Tout comme le ministère de l'ESS est rattaché au ministère de l'économie, ce groupe d'études sénatorial serait rattaché à la commission des affaires économiques.
Par ailleurs, nous avons également appelé de nos vœux un travail de veille législative tous azimuts, afin de mettre en place un véritable volet ESS dans les différents textes législatifs. En effet, si une loi-cadre peut être utile pour affirmer des principes communs et des objectifs stratégiques relatifs au développement de l'économie sociale et solidaire, il faut coupler l'approche législative transversale avec une approche sectorielle plus ciblée, en veillant à ce que chaque texte à portée économique et sociale prenne en compte les attentes des acteurs de l'ESS sur le terrain. §

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, monsieur le président de la commission des affaires économiques, monsieur le président du groupe de travail sur l'économie sociale et solidaire, mes chers collègues, je centrerai mon propos sur le fait coopératif en France et la nécessité de lui donner un nouvel élan pour lui permettre de se développer.
Si l'ONU a consacré l'année 2012 comme l'Année internationale des coopératives, c'est que, partout dans le monde, cette forme d'activité, le plus souvent inscrite dans l'économie de marché, a fait la preuve de son efficacité, de sa singularité et, en même temps, de sa capacité à se développer dans des champs extrêmement variés.
Dans ce contexte, et en écho à la volonté du Gouvernement de préparer une loi sur l'économie sociale et solidaire pour renforcer ce secteur majeur de notre économie et de notre société, il nous a paru utile, au sein de la commission des affaires économiques, de concentrer nos travaux sur des volets très particuliers, susceptibles d'être opérationnels à court terme.
Dressons d'abord un bilan du fait coopératif. À cet égard, il me semble nécessaire de rappeler quelques éléments. Les principes sur lesquels les coopératives se fondent sont très anciens ; ils datent du milieu et de la fin du XIXe siècle, époque de la deuxième révolution industrielle. Mais ils n'en sont pas moins résolument contemporains et modernes.
Premier principe : ce sont des sociétés de personnes, et non de capital. On mesure toute l'importance de cette caractéristique dans le monde actuel, marqué par la crise de la financiarisation !
Deuxième principe : un homme, une voix. Il y a bien profit, il y a bien valorisation de l'entreprise, mais les gains sont redistribués soit sous la forme de ristourne coopérative au sociétaire usager, soit pour pérenniser l'outil, le moderniser, et permettre son développement. Il n'y a donc pas de captation de la richesse aux seules fins d'accumulation de capital. Là encore, c'est un élément extrêmement important.
Troisième principe : l'ancrage territorial de nos coopératives, qui fonde d'ailleurs toute leur actualité. À partir du moment où une coopérative est constituée, elle est en général adossée à des hommes et des femmes qui sont liés à une histoire, un territoire, des projets, et qui n'ont pas du tout l'intention de délocaliser pour aller faire du profit ailleurs. La plupart du temps, l'outil leur appartient justement pour garantir leur emploi, celui de leurs voisins ou de leurs enfants, ainsi que le développement de leur territoire. D'ailleurs, pour le Sénat, l'ancrage local est évidemment un point très important : chacun d'entre vous a l'occasion de voir dans son département combien les coopératives constituent un levier de développement économique.
Ce bilan étant dressé, il faut aussi observer que les coopératives ont mieux résisté que beaucoup d'autres secteurs d'activité à la crise économique. Ainsi, le taux de pérennité des coopératives à trois ans est supérieur à celui des autres sociétés en France. L'écart est encore plus net si l'on considère les longues durées, par exemple le taux de pérennité à cinquante ans. Les coopératives sont donc des sociétés pérennes, qu'il convient de consolider.
Fort heureusement, depuis l'apparition du phénomène, le droit des coopératives a évolué. Il y a notamment eu dans notre pays des évolutions qu'il est important de souligner, voire de conforter, monsieur le ministre délégué.
Premièrement, au-delà des simples sociétaires, il peut y avoir des apports capitalistiques, certes minoritaires, mais qui peuvent s'adosser au projet coopératif. Bien entendu, la rémunération de ce capital est extrêmement encadrée. Il ne s'agit pas de tuer l'esprit coopératif. Mais nous savons que cet apport peut se révéler nécessaire, que ce soit dans certains secteurs industriels, pour l'exportation ou encore l'agrandissement d'activité.
Deuxièmement, on a créé les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SCIC, ce qui permet aux collectivités locales d'entrer dans un mécanisme coopératif. Jusqu'à présent, aux termes de la loi, elles peuvent atteindre 20 % des parts sociales. Dès lors, elles sont parties prenantes du projet coopératif, ce qui s'avère indispensable dans bien des cas. Je pense notamment aux coopératives HLM, mais aussi aux coopératives d'activité médicale ou paramédicale, lorsque des médecins ou des professions paramédicales décident de s'unir. En l'occurrence, la collectivité peut apporter un soutien logistique et garantir la présence sur l'ensemble du territoire, en particulier là où ce n'est pas forcément évident, d'un certain nombre de services médicaux, tout en respectant l'indépendance d'acteurs comme les infirmières ou les médecins.
Nous voyons donc ces formes de coopératives se développer. Je pense qu'il serait intéressant de renforcer un tel mécanisme en augmentant le taux de participation des collectivités locales. En effet, le taux de 20 % reste encore assez faible, eu égard à un certain nombre d'investissements dans différents domaines.
Parmi les autres activités coopératives qui se sont développées figurent les coopératives d'activité et d'emploi, les CAE. En général, elles regroupent des salariés indépendants qui auraient pu faire le choix de l'auto-entreprenariat ; mais, comme vous le savez, le statut d'auto-entrepreneur est très décrié et n'a pas toujours l'efficacité souhaitée. Avec les CAE, les personnes concernées gardent leur autonomie, mais mettent en commun des moyens, des projets, des compétences, des transferts de savoirs et d'idées, ce qui se révèle particulièrement utile dans les domaines de la comptabilité, du marketing ou de la formation.
Monsieur le ministre délégué, nous serions demandeurs d'un travail d'évaluation des CAE. Pourquoi demeurent-elles au stade embryonnaire alors que, aux dires de nombreux acteurs, elles devraient se développer ?
Troisièmement, certaines coopératives qui existaient déjà sont aujourd'hui boostées.
Par exemple, le nombre de sociétés coopératives artisanales a augmenté de 35 % en sept ans. Dans notre pays, les artisans sont en train de faire une mutation culturelle, comme ce fut jadis le cas des agriculteurs. Il y a de plus en plus de coopératives artisanales, soit pour procéder à des groupements d'achats, soit pour faire de la valorisation de produits de manière conjointe, soit pour mener des actions très simples ; je pense notamment aux bouchers indépendants qui se regroupent en coopératives parce qu'ils ont besoin de réaliser de gros investissements pour les ateliers de découpe. On découvre ainsi que de multiples synergies peuvent être mises en valeur. L'artisan garde son autonomie, les traditions et la présence territoriale sont préservées, mais certains aspects sont mis en commun. On peut également mentionner les coopératives de pêche.
Autre secteur qui s'accroit fortement et pourrait se développer encore lourdement et massivement, celui des SCOP, anciennement « sociétés coopératives ouvrières de production », désormais « sociétés coopératives et participatives ». Dans la période récente, les SCOP ont fait leur preuve en tant qu'outil de reprise des entreprises ou de transmission, dans le cas d'un patron désireux de laisser sa société à ses salariés.
Pour franchir un cap quantitatif important, il faut lever toute une série de verrous ; je les évoquerai dans quelques instants.
Les autres coopératives émergentes sont les coopératives d'habitants. Existent aujourd'hui les coopératives HLM, qui ont été très fortement liées historiquement à la location-attribution, puis se sont reconverties, essentiellement en coopératives d'accession sociale à la propriété, avec la disparition de ce produit.
Les coopératives d'HLM pourraient se développer. Mais il existe aussi d'autres attentes de la part des habitants. Cela concerne moins directement le secteur du logement social, car il s'agit de catégories sociales variées. Par exemple, des populations urbaines très sensibilisées aux questions de développement durable peuvent souhaiter développer les coopératives d'habitants, à l'instar de ce qui s'est passé en Suisse ou dans d'autres pays. Nous avons formulé des propositions pour permettre à de tels projets de prospérer.
Par ailleurs, les gros bastions coopératifs existant – il ne faut pas les négliger – peuvent parfois rencontrer des difficultés. Je pense bien sûr aux coopératives agricoles ou aux banques coopératives, dont il faudra évoquer la gouvernance, mais aussi à toute une série d'autres secteurs, comme les coopératives de pêcheurs, que j'évoquais tout à l'heure, ou les commerces associés, une forme de coopératives très importante dans notre pays ; d'ailleurs, tout le monde ne sait pas toujours qu'il s'agit de coopératives…
Dans le rapport, nous ciblons des priorités. Le développement des SCOP en fait partie, notamment pour ce qui concerne la reprise et la transmission d'entreprises, car plusieurs facteurs de blocage existent aujourd'hui.
Prenons le cas des reprises d'entreprise. Actuellement, les seules indemnités perçues par les salariés en cas de licenciement économique ne sont pas suffisantes pour constituer la base de départ nécessaire au rachat d'une entreprise fortement capitalisée. Et les organismes bancaires ne se lancent pas facilement dans des aventures d'une telle nature.
Le Québec a institué un système de progression vers la coopérative. C'est un système transitoire où les coopérateurs sont actionnaires minoritaires de la coopérative, elle-même actionnaire minoritaire de l'entreprise. Tous les profits accumulés leur sont remis pour que leurs parts deviennent de plus en plus importantes, le reste étant porté par la caisse Desjardins vers une banque un peu spécialisée dans le monde coopératif. Chez nous, un tel dispositif pourrait être géré soit par des banques coopératives, soit par un fonds d'investissements coopératif, la coopérative dont les salariés sont minoritaires ayant vocation à devenir à terme une coopérative définitive.
Cela suppose également une adaptation de toute la législation, notamment fiscale.
J'insisterai quelques instants sur la question de la fiscalité. On entend parfois dire que de considérables avantages fiscaux seraient accordés aux coopératives. C'est inexact. Les coopératives ne bénéficient nullement d'avantages fiscaux particuliers.
La Cour de justice de l'Union européenne, dont chacun connaît le laxisme…
Sourires sur le banc de la commission.

Très relatif !
La Cour de justice de l'Union européenne, disais-je, a reconnu que l'application du droit de la concurrence à l'échelle européenne pouvait exercer un effet de discrimination à rebours au détriment des coopératives. Le statut des coopératives ne leur permet pas d'avoir accès au marché des capitaux, qui autorise la libre concurrence.
La Cour, dans sa « sagesse » – c'est une qualité que je ne lui reconnais pas sur tous les sujets –, a considéré que les États membres pouvaient prévoir des contreparties fiscales destinées à compenser certains des handicaps que rencontrent les coopératives, notamment dans l'accès aux marchés de capitaux.
Pour favoriser la reprise d'entreprise sous forme de SCOP, plusieurs solutions sont proposées.
Premièrement, nous pourrions mettre en place un mécanisme de portage.
Deuxièmement, il faut pouvoir trouver les financements nécessaires. Diverses possibilités sont envisagées, dont la création d'une banque publique d'investissement. Notre rapport, monsieur le ministre délégué, souligne que les critères d'attribution des crédits d'OSEO ne s'adaptent pas toujours parfaitement aux coopératives. C'est un problème qu'il faudra résoudre.
Troisièmement, nous pourrions instaurer un fonds de développement coopératif. En Italie, cet outil existe déjà. Il est financé grâce à un prélèvement de 3 % sur les bénéfices des coopératives. Ce fonds pourrait soutenir la création et le développement de sociétés coopératives.
Il serait utile que le monde coopératif français s'inspire du modèle italien. Je rappelle, au passage, que le fait coopératif n'est pas géré par l'État, même si celui-ci peut donner un coup de pouce, encadrer et être partenaire, pour permettre les reprises d'entreprise sous forme de SCOP.
Quatrièmement, enfin, il faudra également adapter les procédures concernant l'aide au reclassement. Aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier de l'aide à la reprise d'entreprise, il faut être chômeur, c'est-à-dire que l'entreprise doit avoir fermé ou être déclarée en faillite.

Il est absurde d'attendre, pour agir, que l'entreprise soit fragilisée. Nous pourrions la favoriser plus en amont !

Voilà pourquoi le rapport prévoit toute une série de mécanismes pour lever les freins à la constitution de groupes coopératifs. Nous souhaitons, notamment, que soit institué un droit de préférence pour les salariés qui souhaitent présenter une offre de reprise coopérative. S'il n'y a pas de repreneur et que l'entreprise est viable, pourquoi ne pas favoriser une reprise par les salariés, afin de maintenir, ainsi que nous y sommes tous attachés, le maintien de certaines activités sur le territoire national ?
Monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, pour ne pas trop dépasser mon temps de parole, je vous renvoie à la lecture du rapport pour ce qui concerne la partie bancaire, que nous aborderons plus particulièrement lors du débat sur les banques, et la partie habitat. Sur ce dernier point, le groupe de travail a repris les travaux déjà engagés par le Parlement, en particulier par le Sénat.
En conclusion, monsieur le ministre délégué, je voudrais insister sur un aspect particulièrement étonnant de mon point de vue.
Bien qu'appartenant au monde coopératif, j'ignorais que les programmes scolaires faisaient l'impasse sur la notion de coopérative.

Les cours d'économie au lycée l'ignorent. Sous votre amicale pression, votre collègue Vincent Peillon, attentif à juste titre à l'avenir des programmes scolaires, ne pourrait-il pas remédier à cet état de fait ?
La remarque s'adresse également à votre collègue ministre de l'agriculture pour ce qui concerne l'enseignement agricole. C'est d'ailleurs un comble quand on connaît la force du monde coopératif dans ce secteur !
S'il ne devait ressortir qu'une seule chose de nos débats, je privilégierai ce devrait être le souci d'inscrire du réel dans les programmes scolaires, car il est important que l'enseignement reconnaisse l'économie sociale et solidaire, donc les coopératives, qui constitue un pan entier de la société française. §

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, la crise qui touche l'ensemble de l'économie mondiale depuis 2008 a au moins eu un mérite, celui de mettre en lumière un modèle auparavant sous-estimé : l'économie sociale et solidaire.
Source d'emplois non délocalisables, conciliant performance économique, progrès social, préservation de l'environnement et développement local, l'économie sociale et solidaire, dans le contexte actuel, ne manque pas d'atouts.
De manière générale, si les structures se réclamant de l'économie sociale et solidaire ont mieux résisté à la crise que les entreprises traditionnelles, certaines ont été affectées par la baisse des crédits.
En effet, entre 2007 et 2012, l'État s'est nettement désengagé, comme le reflète symboliquement la suppression, en 2010, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, la RGPP, de la délégation interministérielle à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale.
De plus, le gel des dotations d'État aux collectivités a contribué à fragiliser les acteurs associatifs de l'économie sociale et solidaire.
La nouvelle majorité a pris la mesure de l'importance de l'ESS, qui emploie environ 2, 3 millions de salariés en France et a créé quelque 440 000 emplois ces dix dernières années. La création, dont nous nous réjouissons, d'un ministère délégué chargé de l'économie sociale et solidaire est l'illustration de cette reconnaissance.
Le Sénat s'est également saisi de cette thématique en constituant, en février dernier, au sein de la commission des affaires économiques, un groupe de travail dédié. Ce dernier, dont je salue ici le travail, a publié à la fin du mois de juillet un premier rapport comprenant plusieurs recommandations, relatives notamment aux coopératives, que Mme Marie-Noëlle Lienemann vient d'évoquer.
S'appuyant sur ces travaux, le Gouvernement s'est attelé à la préparation d'un texte de loi annoncé en conseil des ministres le 5 septembre dernier. La concertation, menée en liaison avec les commissions du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, devrait s'achever à la fin de l'année.
Ce futur texte suscite une grande attente dans l'ensemble de la galaxie de l'économie sociale et solidaire. Cependant, certaines pistes évoquées posent question.
La première interrogation porte sur la nature même du futur texte de loi que le Gouvernement entend présenter au Parlement. Il était initialement prévu une « loi fondatrice d'orientation et de programmation pour l'économie sociale et solidaire ». Qu'en est-il aujourd'hui ?
La seconde question qu'il faudra traiter concerne les modalités de définition du périmètre de l'économie sociale et solidaire. Il importe que toutes ses formes – associations, fondations, mutuelles et coopératives – soient prises en compte et que des impératifs, notamment celui de propriété impartageable, soient requis pour qu'une structure puisse être considérée comme relevant de l'économie sociale est solidaire.
La future banque publique d'investissement est elle aussi au centre des préoccupations. L'enjeu du financement des structures relevant de l'économie sociale et solidaire est crucial. Sur les 20 milliards d'euros dont la banque publique d'investissement disposera, une première tranche de 500 millions d'euros devrait être réservée à ce secteur. Une question subsiste : ce financement, monsieur le ministre délégué, constituera-t-il un premier volet qui en appellera d'autres ?
Par ailleurs, le Gouvernement envisagerait de créer des « certificats mutualistes », afin de permettre aux acteurs de l'ESS de lever des capitaux. Vous le savez, les représentants de grandes mutuelles ont émis des réserves quant à cette mesure. Qu'en est-il de cette disposition ?
Plus généralement, les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont en quête de représentativité, voire de reconnaissance, eux qui sont encore largement exclus, fort injustement d'ailleurs, du dialogue social et de l'élaboration des grands chantiers gouvernementaux.
Du fait de leur transversalité, les organisations représentatives doivent être associées aux grandes réformes du quinquennat : la réforme territoriale, le chantier de la petite enfance ou ceux de la dépendance et de la lutte contre la pauvreté.
Ce qui est en jeu, ce n'est rien de moins que l'aggiornamento de l'économie sociale et solidaire. Pour ce faire, celle-ci devra pouvoir bénéficier d'un cadre législatif et réglementaire modernisé, de ressources pérennisées, et ses représentants devront être écoutés et considérés comme des partenaires. Ce faisant, elle pourra constituer un des leviers incontournables du redressement de notre économie et de la France ! §

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, ce débat sur l'économie sociale et solidaire fait suite au très bon rapport rédigé par mes collègues Marie-Noëlle Lienemann et Marc Daunis dans le cadre du groupe de travail sur l'économie sociale et solidaire.
Je souhaite débuter mon intervention en insistant sur la nécessité de prendre en considération la grande diversité existant au sein des coopératives. Comme l'a proposé Marc Daunis, il est important de réfléchir aux périmètres et aux valeurs des grandes et des petites coopératives.
J'insiste également sur la nécessité de pousser l'innovation et d'encourager un certain nombre de structures coopératives, qui me paraissent particulièrement pertinentes dans le contexte social et économique actuel.
Je souligne fortement que les SCIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, créées par la loi du 17 juillet 2001, permettent une coopération concrète très intéressante, pour ce qui concerne notamment l'accès au capital des collectivités locales, des communes, des agglomérations, des conseils généraux et des régions avec les structures financières de l'économie solidaire, mais aussi avec de simples citoyens. Ces collectifs sont opportuns, car ils permettent de porter un projet pendant des années. J'ai pu le constater concrètement en Seine-Saint-Denis, comme sur tout le territoire. Il serait bon que les pouvoirs publics et votre ministère, monsieur le ministre délégué, soutiennent ce type de coopératives.
Mes collègues ont également évoqué les coopératives d'activités et d'emploi. Il est vrai que les créateurs d'entreprise ont besoin d'un accompagnement, et pas seulement pendant quelques mois. Ces structures offrent la possibilité de mettre en place cet accompagnement, et donc de soutenir des créations durables, qui se consolident.
L'importance des coopératives d'habitat a également été soulignée, car elles permettent de lutter contre la spéculation immobilière, qui est un vrai souci dans bon nombre de territoires, tout en restant dans une logique solidaire et collective, mais en n'attendant pas tout de l'État.
Tous ces dispositifs sont à encourager. C'est dans ces secteurs qu'il faut porter l'effort pour alléger des procédures encore un peu lourdes et améliorer le régime juridique. Les préconisations du rapport sur ce sujet paraissent extrêmement importantes. Il faudrait également créer un statut adapté aux coopératives d'habitants.
Dans la période difficile que nous traversons, toutes ces dynamiques doivent être fortement encouragées.
Il est également urgent, je rejoins mes collègues sur ce point, d'inciter à la reprise d'entreprises sous forme de SCOP. Il convient de lever l'obstacle que constitue la nécessité pour les salariés de disposer d'emblée de la majorité du capital social. Il faut leur laisser le temps, comme le souligne le rapport, soit cinq à dix ans, de parvenir à cette majorité. Il serait utile, également, d'instaurer un droit d'information des salariés, ainsi qu'un droit de préférence systématique à leur profit lors des projets de cession.
Je l'ai constaté encore très récemment, y compris dans le cas de PME en difficulté – elles sont aujourd'hui nombreuses dans le tissu industriel –, lorsque des salariés apprennent tardivement qu'ils sont licenciés, il est compliqué pour eux de rassembler l'argent et de monter, en quelques semaines, le dossier visant à créer une SCOP.
Il nous paraît donc essentiel de favoriser de façon systématique la reprise d'entreprises par les salariés
M. Jean Desessard applaudit.

Il y a là un gisement colossal d'emplois durables et soutenir cette démarche serait, monsieur le ministre délégué, réellement contribuer à la relance industrielle que le Président de la République a appelée de ses vœux et à laquelle nous travaillons tous.
On pourrait aussi envisager la mise en place de dispositifs d'appui à ces salariés, qui ne se limiteraient pas à un soutien financier de l'État ; cette aide pourrait prendre la forme d'un encouragement à des réseaux d'accompagnement de salariés. Dans la période de crise et de mutation que nous connaissons actuellement, il y a là aussi une opportunité de créer de nouvelles entreprises et de répondre à nos objectifs. Ainsi, favoriser une mutation industrielle répondrait à notre volonté de mettre en place une transition énergétique.
En cette période de crise financière, économique, sociale, écologique, en cette heure où nous observons une montée préoccupante de la précarité et du chômage, mais où nos concitoyens expriment aussi une aspiration démocratique, l'économie sociale et solidaire démontre qu'il est possible de faire autrement, de créer des structures viables économiquement tout en respectant l'humain.
L'économie sociale et solidaire prolonge, en la renouvelant, en l'actualisant, la belle tradition de l'économie sociale, tant il est vrai que, depuis la fin des années quatre-vingt, un certain nombre de réseaux sont venus l'enrichir. Aujourd'hui, c'est un réel moyen de nous aider à faire face à la crise de façon non marginale.
À côté du secteur public et du secteur privé, ce troisième secteur économique présente de multiples atouts.
Premièrement, il contribue, avec l'État et les collectivités territoriales, à la mobilisation citoyenne, qu'il s'agisse de salariés, de créateurs d'activités, d'épargnants, de cadres acceptant d'apporter gratuitement leur parrainage et leurs compétences aux créateurs d'emplois, de consommateurs ou d'habitants.
Tout cela constitue pour notre pays un réseau de compétences, de vigilance, d'action, de démocratie économique ; dans le contexte national et international que nous connaissons, c'est un plus qui peut être très précieux.
Deuxièmement, l'économie sociale et solidaire participe traditionnellement de la volonté d'internaliser des coûts sociaux et écologiques en concourant activement à la création de nombreux emplois utiles socialement, des emplois d'insertion, et en s'efforçant toujours de privilégier les services et produits utiles sur les plans social comme environnemental, ce qui réduit d'autant les coûts en aval.
Troisièmement, l'économie sociale et solidaire – cet aspect a déjà été largement développé par les orateurs qui m'ont précédée, mais il est important – permet un enracinement dans les territoires tant ruraux qu'urbains, notamment ceux qui sont en grande difficulté. Cet enracinement est très intéressant, dans la mesure où, depuis de nombreuses années maintenant, les collectivités locales, à tous les niveaux, se sont engagées dans ce secteur, qu'elles sont même organisées en réseau national et qu'elles peuvent être des partenaires très utiles pour le ministère.
De ce point de vue, la création récente d'un ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation est pour le groupe écologiste porteuse d'un grand espoir. Il s'agit de rompre avec les dix années pendant lesquelles nous n'avions plus de ministre chargé de ce secteur, le secrétariat d'État à l'économie solidaire piloté par Guy Hascoët ayant disparu en 2002. Les réseaux ont connu dix années difficiles.

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, monsieur le président du groupe de travail, madame la rapporteur, mes chers collègues, le secteur de l'économie sociale et solidaire rassemble en France plus de 200 000 entreprises : coopératives, mutuelles, associations et fondations.
Avec près de 2 millions de salariés, ce secteur est fortement créateur de richesses pour notre pays. Les entreprises qui le constituent jouent un rôle de premier plan dans plusieurs secteurs, comme la banque, l'assurance, l'agriculture, la santé ou la distribution. Elles doivent ainsi constituer, par leur nature et leur histoire, un point de référence dans la lutte contre le chômage.
Cependant, l'économie sociale reste, dans certains secteurs, moins développée que chez nos voisins européens. Notre économie est ainsi privée de l'apport d'entreprises qui sont souvent celles qui favorisent l'émergence de nouvelles activités et proposent des projets structurant le développement national ou local.
Il nous paraît essentiel d'améliorer l'environnement dans lequel les entreprises de cette nature peuvent se développer et de favoriser l'essor de nouveaux projets et d'entrepreneurs sociaux.
C'est un défi pour notre pays, car nous sommes convaincus que ces activités constituent un gisement de richesses et d'emplois considérables. Je souhaite que notre pays relève ce défi et poursuive une politique ambitieuse de développement de l'économie sociale et de l'entrepreunariat social.
En effet, le précédent gouvernement a beaucoup œuvré pour ce secteur. Dans le cadre du programme d'investissements d'avenir – précédemment appelé « Grand emprunt » –, la Caisse des dépôts et consignations s'est vu confier, à la fin de 2010, une enveloppe de 100 millions d'euros pour soutenir le secteur de l'économie sociale et solidaire, via un appel à projets.
L'objectif est d'aider au développement de plus de 2 000 entreprises et à la création ou à la consolidation de plus de 60 000 emplois. Il était alors également prévu de faciliter l'accès de ces entreprises à des financements bancaires ou liés au marché de l'épargne solidaire.
Un appel à candidatures visait à retenir les partenaires financiers avec lesquels des co-investissements seront obligatoirement réalisés en complément de l'apport du programme d'investissements d'avenir. Il possède un caractère pérenne afin de permettre l'entrée régulière de nouveaux intervenants jusqu'au 31 décembre 2014. Tout financeur de l'économie sociale et solidaire souhaitant se porter candidat peut le faire à tout instant, dès lors qu'il répond aux conditions du cahier des charges.
Je tiens à préciser que ce niveau d'ambition, jamais atteint, avait été salué par l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire.
Il nous plairait donc, monsieur le ministre délégué, que vous puissiez nous faire un état des lieux de cet appel à projets que le précédent gouvernement avait lancé.
L'une des caractéristiques majeures du secteur de l'économie sociale et solidaire, qui en fait sa richesse mais engendre également une difficulté d'appréhension à la fois sectorielle et globale, c'est sa très grande diversité.
En découlent donc, j'en conviens volontiers avec vous, des sujets de préoccupation, des besoins, des attentes très diverses à l'égard de la puissance publique, avec des spécificités particulières correspondant à ses nombreuses composantes.
Rappelons en effet qu'historiquement la sphère de l'économie sociale et solidaire englobe les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations. Plus récemment, le secteur de l'entrepreneuriat social revendique aussi son appartenance à cette grande famille.
Les différentes composantes de ce secteur considèrent que les approches qu'elles privilégient, les valeurs et les principes sur lesquels reposent les activités qu'elles développent se sont avérés pleinement appropriés au contexte de crise économique et sociale que connaît le monde depuis 2008. Ces activités sont d'autant plus pertinentes qu'elles ont, dans l'ensemble, mieux résisté à la crise que les secteurs de l'économie classique, notamment en termes d'emplois.
Incontestablement, nous avons pu voir les limites et les risques que comporte une approche purement économique.
C'est donc dans ce contexte que le secteur de l'économie sociale et solidaire peut constituer un modèle alternatif qui pourrait contribuer à surmonter la crise. Il serait une référence pour le nouveau modèle de développement à concevoir pour les décennies à venir.
Au vu de ces éléments, mais aussi de l'annonce faite par le gouvernement Fillon à la fin de 2010 et selon laquelle une fraction du grand emprunt, à hauteur de 100 millions d'euros, serait consacrée au soutien et au développement de l'économie sociale et solidaire dans notre pays, les acteurs de ce secteur ont un degré d'attente très élevé.
Aussi serait-il bon, monsieur le ministre délégué, que le Gouvernement tienne pleinement compte de cette espérance et veille à prendre les décisions nécessaires pour éviter de susciter des déceptions légitimes, alors que les besoins d'aide et d'accompagnement sont réels et que le secteur recèle des potentialités insuffisamment mises à profit jusqu'à présent.
Nous ne nous prononcerons pas sur le caractère alternatif du modèle incarné par le secteur de l'économie sociale et solidaire. Nous prenons acte des évolutions qu'il connaît dans notre pays et constatons que son histoire est rythmée par différentes phases évoluant d'une logique statutaire à une logique entrepreneuriale, sans que la seconde s'impose d'ailleurs au détriment de la première. Si l'entrepreneuriat social succède, dans le temps, à la conception statutaire de l'économie sociale, il ne la supplante pas à ce jour, mais se développe aux côtés de structures dont la dimension associative, mutualiste ou coopératiste conserve toute sa pertinence.
Cependant, une importance particulière doit être accordée au sens de l'action entreprise plus qu'à la maximisation du profit, qui pourrait, certaines fois, utilement inspirer l'économie classique, et être largement partagée par nombre d'acteurs.
Il nous semble en effet que les principes et les valeurs revendiqués par l'économie sociale et solidaire sont compatibles avec une vision de l'économie qui valorise le projet et l'apport de celui-ci à la société dans son ensemble plus que le rendement financier à court terme.
L'ESS répond en outre à une aspiration profonde de toute une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs et de futurs cadres formés dans les écoles de commerce, qui cherchent à donner un sens à leur engagement professionnel.
Ce sentiment est d'autant plus fort que notre pays est en recherche de voies et moyens pour relancer la croissance, une croissance plus riche en emplois, plus à même d'accroître le bien-être collectif tout en contribuant à maîtriser la dépense publique. Il s'agit d'associer les citoyens à un nouveau modèle de croissance, qui reste à inventer, porteur de développement durable, avec toutes les facettes que cela comprend, en particulier l'émergence de métiers nouveaux ou la mutation de métiers existants liées aux enjeux d'une croissance économique plus respectueuse de l'environnement.
Certes, les entreprises classiques ne sont pas exemptes de considérations sociales. Bien des sociétés de la sphère privée proprement dite développent des politiques qui rendent compte de leurs préoccupations pour l'environnement social et sociétal dans lesquelles elles s'inscrivent ou des politiques de valorisation des ressources humaines qui prennent en considération l'apport de chaque collaborateur dans une communauté de travail et de valeurs formée par l'entreprise.
Il n'en reste pas moins vrai que l'économie sociale et solidaire, par ses valeurs et ses modes d'action, est porteuse d'une dimension humaniste de l'activité économique, qui, dans le contexte actuel, peut trouver un écho particulier dans notre société, irriguer celle-ci et inspirer de nombreux acteurs de l'économie classique.
En la matière, une attention plus grande doit être portée à ce secteur qui connaît des réussites réelles et recouvre des réalités très diverses. Je souhaiterais ici en évoquer certaines.
Je citerai en premier lieu la contribution de nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire au développement d'activités à forte utilité sociale répondant à des besoins pas ou mal couverts, et ce avec une faible mobilisation de capital mais avec une forte mobilisation en ressources humaines.
J'évoquerai en second lieu une contribution notable aux politiques de l'emploi par le biais notamment des acteurs de l'ESS, très impliqués en matière d'insertion sociale et professionnelle par l'économique, mais aussi par le biais des nombreuses structures associatives recourant largement aux contrats d'insertion ou de professionnalisation et facilitant ainsi la formation et l'insertion professionnelle des jeunes.
Un rôle actif est également joué par certains acteurs, qui constituent de vraies pépinières pour la création d'emplois nouveaux à fort potentiel de développement dans le cadre, notamment, d'activités de recyclage des déchets et de reconditionnement.
Un rôle non négligeable est joué aussi en matière de revitalisation de certains territoires délaissés par des activités traditionnelles frappées par les incidences de la mondialisation ou l'obsolescence technologique.
En conclusion, monsieur le ministre délégué, j'espère qu'avec ce débat nous pourrons mieux appréhender la façon dont l'État, par votre ministère, compte prendre en charge ce secteur multiforme, faire le point sur les actions conduites, examiner le champ des possibles, afin de répondre aux attentes et aux besoins exprimés par les différentes composantes de ce secteur. §

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer la qualité du travail réalisé par le groupe de travail sur l'économie sociale et solidaire. Nous sommes convaincus que le rapport de Mme Lienemann constituera un outil très utile à l'appui des réflexions qui s'engagent sur ce sujet.
Comme vous l'avez rappelé, ma chère collègue, ce travail s'inscrit « dans un contexte général de crise économique et sociale propice à la redécouverte et à la défense des valeurs et de l'action des acteurs de l'ESS ».
En effet, face à la crise économique, à la montée de la précarité et de la pauvreté, à la destruction de l'emploi, notamment à travers le délitement du tissu industriel, l'économie sociale et solidaire joue un rôle essentiel. Sa dimension territoriale, l'expression des valeurs de solidarité et de responsabilité qu'elle porte en font à juste titre un outil économique et social pertinent.
Cependant, il ne faudrait pas laisser croire à l'omnipotence de cet outil.
La France a passé le cap des 3 millions de chômeurs ; si le chômage partiel est pris en compte, il y a près de 5 millions de personnes en sous-emploi en France. Selon la CGT, 75 000 emplois sont menacés.
Tous les secteurs sont touchés : l'automobile, les transports, l'agroalimentaire, l'industrie lourde, le bâtiment, les télécommunications. Les exemples n'ont pas manqué ces derniers temps.
La situation de notre pays appelle donc des mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de l'industrie, ainsi qu'une volonté politique forte pour garantir un véritable redressement productif, sans quoi non seulement on coupera les ailes aux projets portés par l'économie sociale et solidaire, mais, en plus, on laissera de côté des sites industriels pour lesquels l'ESS n'est pas adaptée.
Il est urgent de décréter un moratoire sur tous les plans sociaux pour rechercher des solutions de remplacement s'appuyant sur les contre-propositions des salariés.
Il est urgent que l'Assemblée nationale examine et adopte la proposition de loi tendant à interdire les licenciements boursiers, adoptée par la majorité de gauche du Sénat. Nous avons déjà perdu trop de temps ! Il n'est pas acceptable que les entreprises qui réalisent des bénéfices licencient en vue de profits supplémentaires.
Il est urgent d'accorder aux salariés des pouvoirs nouveaux pour réorienter les choix de gestion, mobiliser autrement l'argent des entreprises, des banques et des fonds publics pour une utilisation de la monnaie et du crédit favorisant la création, la sécurisation, la promotion de l'emploi et de la formation.
Il n'est pas acceptable que des groupes industriels ferment des sites en France au prétexte de difficultés économiques, alors que, dans le même temps, ils réalisent leurs investissements productifs dans des sites étrangers afin de bénéficier du dumping social. Il n'est pas question d'autre chose avec la fermeture de PSA-Aulnay, avec la menace de fermeture de la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne ou avec l'arrêt des hauts fourneaux d'Arcelor-Mittal à Florange.
Le ministre du redressement productif annonçait la semaine dernière le dépôt d'un projet de loi visant à obliger un industriel à céder une usine viable. Hélas, le temps législatif s'accorde mal avec l'urgence sociale !
Nous devons aller plus loin que la recherche de repreneur ; l'État doit renforcer sa présence dans le capital d'entreprises stratégiques pour leur sauvegarde et leur développement et reprendre sa part de responsabilité dans l'activité industrielle de notre pays.
En ce qui concerne les situations pour lesquelles l'économie sociale et solidaire peut jouer un rôle, nous avons accueilli avec intérêt les mesures que vous avez avancées cet été, monsieur le ministre délégué, notamment en vue de l'amélioration des conditions de reprise des entreprises sans entrepreneurs ou en difficulté par les salariés eux-mêmes, avec un droit préférentiel, sous forme de société coopérative participative.
Mais quels moyens donnons-nous aux salariés pour que leurs projets aboutissent et qu'ils ne cèdent pas à la pression de la finance et de la concurrence mondiales ?
Je voudrais prendre ici l'exemple des salariés de Fralib qui représentent un espoir pour tant d'autres, ceux de Paru Vendu, Hélio Corbeil, Merck-Organon, M-Real, Petitjean, Sodimedical, Still-Saxby ou Pilpa. On pourrait en citer d'autres, car la liste est longue.
En septembre 2010, le groupe Unilever annonce la fermeture du site rentable de Gémenos. En 2011, il réalise un chiffre d'affaires de 46, 47 milliards d'euros, avec des bénéfices atteignant plus de 4 milliards d'euros.
La totalité des salaires des 182 salariés et dirigeants de l'usine représente 15 centimes de chaque boîte de thé vendue, mais le groupe veut encore faire des bénéfices et délocaliser son activité en Pologne. Les salariés ont d'ailleurs découvert dans un supermarché des boîtes de thé fabriquées en Pologne avec le code de traçabilité de Gémenos, alors que leur usine a arrêté toute production depuis des mois !
Le capitalisme financier est bien rodé. Unilever a créé une structure financière en Suisse pour éviter de payer des impôts en France. Encore un bel exemple d'évasion fiscale, légale cette fois !
C'est dans ce contexte que, depuis 2010, les salariés se battent pour avoir le droit de travailler. Quand on évoque les sociétés coopératives, il faut avoir à l'esprit que la meilleure volonté des travailleurs se heurte aux appétits de grands groupes, qui mènent une réelle politique de casse de l'emploi. Les salariés ont été victimes de comportements innommables de la part de la direction, avec la caution de l'ancien ministre du travail qui était intervenu pour bloquer une lettre d'observation préparée par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, la DIRECCTE. Un certain nombre d'entre eux revivent la douloureuse fermeture, en 1997, de l'usine du Havre, pourtant rentable.
À ce passé traumatisant pour les travailleurs et leurs familles s'ajoutent les pressions psychologiques incessantes de la direction, comme les coupures de courant et l'interdiction d'accès au site, mais également la mise en œuvre d'un véritable harcèlement judiciaire.
Il faut savoir que des salariés ont été déclarés grévistes dans le seul but de les priver de leurs salaires. Ils ont subi trois plans sociaux. Ils se sont heurtés au refus du groupe de relancer l'activité, alors même qu'une décision de justice l'y obligeait. À chaque fois, Unilever a été condamné, mais comment préserver les salariés qui luttent pour porter un projet industriel de ces attaques sournoises ?
Heureusement, de bonnes nouvelles sont tombées. La communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, pas encore contrainte par un traité européen imposant l'austérité aux collectivités territoriales, a procédé à l'acquisition des terrains, bâtiments et machines de Fralib.
Les salariés le méritent, ils portent un projet industriel solide, conforme à l'histoire et à l'exigence de qualité de la marque Éléphant née il y a 120 ans à Marseille.
Seulement, un écueil de taille demeure : la propriété de la marque. Comme vous le savez, Unilever a déclaré cet été qu'il ne participerait à aucune réunion sur un projet impliquant la marque Éléphant ou des volumes de sous-traitance, réclamant de l'État une « attitude impartiale » sur « le respect des lois en matière de propriété intellectuelle et de droit des marques ».
Aujourd'hui, malheureusement, rien n'oblige juridiquement le groupe à céder sa marque. Tout porte à croire que l'opposition d'Unilever sert un objectif de sabordage du projet des salariés et non une réelle volonté de faire vivre la marque.
En effet, depuis 2002, le groupe industriel procède à une politique de regroupement des marques, qui sont passées de 1 600 à 400. La stratégie commerciale a organisé, au détriment de la qualité des produits naturels Éléphant, leur glissement vers Lipton, avec le conditionnement en pyramides et le logo Lipton apposé à côté du logo Éléphant.
Demain, une table ronde devrait se tenir entre les salariés et la direction, sous la présidence du préfet. Nous attendons tous beaucoup de cette rencontre. Mais, au-delà des décisions qui seront prises, monsieur le ministre délégué, nous aimerions connaître les intentions précises du Gouvernement pour protéger l'outil de production, les brevets, les marques. Le ministre Arnaud Montebourg avait envisagé une réquisition des marques : qu'en est-il de ce projet ?
Au travers de leur lutte, les salariés de Fralib, comme beaucoup d'autres, défendent notre patrimoine industriel et la vitalité économique de tout un pays. Que proposez-vous aujourd'hui pour garantir demain aux salariés la pérennité de leur projet de SCOP s'il n'y a pas de réforme du droit de la propriété intellectuelle ? §

Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, si les contours de l'économie sociale et solidaire demeurent encore l'objet de débats, la notion a acquis une reconnaissance dans l'espace public au cours de ces trois dernières décennies.
Force est de constater que ses frontières sont difficiles à cerner. En effet, les principaux organismes constituant le cœur de l'ESS se rattachent à l'une des quatre grandes familles statutaires – coopératives, mutuelles, associations et fondations –, qui représentent 2, 3 millions de salariés, soit plus de 10 % de l'emploi en France, selon l'INSEE.
Autour de ce noyau dur gravitent beaucoup d'entreprises. Certes, il existe une définition légale de l'entreprise solidaire issue de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 et précisée par le décret du 18 mars 2009. Cependant, la réalité nous laisse voir une ESS à géométrie variable, en raison de la grande diversité de statut de ses acteurs et de l'absence d'une représentation réellement unifiée.
Je souhaite d'abord saluer la réflexion menée dernièrement au sein du groupe de travail sur l'ESS, présidé par M. Daunis, dont nous pouvons lire les conclusions dans le rapport d'information sur les coopératives en France, rédigé par Mme Lienemann.
Cette réflexion nous a permis d'appréhender globalement la situation de l'ESS et de proposer des mesures en faveur du développement des entreprises coopératives qui représentent une grande partie de l'activité de cette économie, particulièrement dans nos territoires ruraux où les deux tiers des agriculteurs participent à des coopératives.
Cette problématique, qui est désormais traitée dans un ministère à part entière, s'inscrit dans une logique d'évolution, d'amélioration et d'identification.
Monsieur le ministre délégué, vous avez précisé le 4 juillet dernier devant les élus du Réseau des territoires pour l'économie solidaire, le RTES, les contours du projet de loi que le Gouvernement présentera au Parlement à la fin de l'année.
Ce texte, qui devrait être discuté durant le premier semestre de 2013, prévoit certaines mesures intéressantes. Je pense notamment à un accès facilité à la commande publique, en promouvant l'innovation sociale.
Ce projet de loi représente également, selon moi, une opportunité pour favoriser les coopératives de production et de distribution, pour moduler la fiscalité des entreprises en fonction des résultats et des efforts fournis en matière de responsabilité sociale, sur la base de normes européennes communes, ou encore pour promouvoir toutes les forces de distribution en circuit court, du producteur au consommateur.
J'espère, monsieur le ministre délégué, que ces idées seront retenues.
En revanche, vous avez évoqué la création d'un label pour les entreprises sociales, ce qui me paraît plus discutable. Par qui sera-t-il décerné ? Comment sera-t-il vérifié ? Sera-t-il vraiment reconnu par le public ? Quelle en sera la portée normative ? Voilà autant de questions qui s'apparentent à la constitution juridique de règles strictes et contraignantes. Encore un label de plus, pourrait-on dire ! Il me semble que la plus grande prudence est nécessaire en la matière.
Si l'on doit améliorer les fondements juridiques de l'ESS, il faut le faire dans une perspective européenne. La réflexion de l'Union européenne sur ce sujet est en effet favorable, l'économie ne se réduisant plus désormais à ses yeux au marché, puisqu'elle inclut les principes de redistribution et de réciprocité.
Encourager cette économie ne veut pas dire la cloisonner. Il faut donc veiller à ce que la mise en place d'un label pour les entreprises ne vienne pas créer un fossé entre les structures considérées comme « sociales » et celles qui seraient « non sociales ». Une certaine souplesse doit être conservée.
Depuis peu, l'ESS fait face à un fort marquage politique qui laisse penser que ces entreprises se différencieraient très nettement des entreprises dites classiques. Veillons à ne pas tomber dans la caricature, c'est-à-dire à établir une différenciation entre une ESS « vertueuse » et une ESS « spéculative ».
Les problématiques de l'ESS sont très souvent concrètes et identiques à celles des entreprises classiques. Les priorités sont le financement, la croissance de l'activité, les ressources humaines, la fiscalité, l'innovation. Permettez-moi d'évoquer la situation problématique, sur mon territoire, des CUMA, les coopératives d'utilisation du matériel agricole, qui se trouvent exclues du bénéfice de l'exonération des cotisations sociales employeur pour les emplois saisonniers.
La loi doit avant tout permettre de remédier à des rigidités ou à des insuffisances statutaires, grâce à l'adaptation de certains des statuts en vigueur.
La complexité de l'ESS, qui fait aussi sa richesse, réside dans son aspect transversal, qui s'inscrit dans la diversité de ses structures et de ses objets.
Certaines des entreprises sociales et solidaires sont 100 % marchandes, d'autres le sont très peu et combinent des ressources non marchandes et non monétaires. Certaines ont plusieurs milliers de salariés, d'autres aucun. Il est particulièrement difficile d'édicter des lois communes pour toutes ces structures.
C'est pourquoi il faut à tout prix éviter de surcharger ce secteur de nouvelles normes, lesquelles devront, autant que faire se peut, être adossées aux dispositifs de droit commun.
Il faudra aussi aborder le contrôle de la gestion des fonds publics qui financent une grande partie des associations chargées de véritables services publics. Une commune de 500 habitants qui gère un budget de 100 000 euros est particulièrement encadrée. Il n'en va pas de même d'une association à qui une grande collectivité peut confier un service social doté d'un budget de plusieurs millions d'euros.
Il faut donc s'interroger sur le mode de contrôle de gestion qui pourrait être mis en place. Un chantier doit être ouvert en la matière.
Notons, à ce titre, les difficultés des acteurs associatifs. Bon nombre d'entre eux ne peuvent fonctionner comme une entreprise. Ils rencontrent des difficultés internes particulièrement importantes. Les moyens humains, juridiques et financiers manquent. Aussi sont-ils inquiets quant à leur faculté d'assumer toutes les responsabilités qui leur incombent.
Enfin, il me semble que d'autres pistes, sur lesquelles nous n'insistons pas assez, devraient être creusées. Je pense ici à l'enseignement. Mme la rapporteur a d'ailleurs insisté dans sa conclusion sur ce point.
Si l'ESS nous tient à cœur, c'est avant tout parce que ses fondements sont respectueux de l'homme. Ils s'incarnent dans une finalité d'utilité sociale, voire d'intérêt général.
À la notable exception des collectivités territoriales, qui soutiennent de plus en plus l'ESS, ayant compris son intérêt pour le développement local durable, les autres acteurs de la société continuent à la méconnaître largement.
Selon moi, l'une des réponses à son développement passe par la promotion de l'enseignement et de la formation à l'économie sociale auprès des jeunes.
Dès 2011, a été lancé, sur l'initiative de l'État et de six fondations d'économie sociale, le programme Jeun'ESS, qui comporte un volet entrepreneurial. L'appel à projet a été pris d'assaut !
Aujourd'hui, les jeunes souhaitent à la fois pouvoir observer le résultat de ce qu'ils font, être autonomes, prendre des initiatives, exercer les responsabilités d'un entrepreneur, tout en recherchant un travail qui ait du sens, qui serve l'intérêt général.
Pour conclure, monsieur le ministre, l'économie sociale et solidaire peut constituer un renouveau de l'économie, sur la base des principes de solidarité et de proximité auxquels aspire la jeunesse.
Il nous appartient, à nous comme à vous, monsieur le ministre, de ne pas ralentir son foisonnement en créant de nouvelles barrières, en voulant trop bien faire.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'économie sociale et solidaire souffre de beaucoup d'idées reçues ; c'est le moins que l'on puisse dire !
Comme elle est associée au secteur associatif, au bénévolat, à l'absence de profits – et donc de rentabilité exponentielle –, on oublie trop souvent à quel point ses acteurs sont producteurs de richesses, de cohésion sociale et d'aménagement du territoire.
À cet égard, je sais gré au Président de la République d'avoir pleinement reconnu cette spécificité, en nommant, dans le champ de l'économie traditionnelle, un ministre délégué à l'économie sociale et solidaire. En effet, notre économie, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, a besoin à la fois de normes et d'un secteur associatif et coopératif extrêmement fort pour que nous puissions relever les défis de la croissance.
Bien évidemment, je salue la grande qualité du rapport qui sert de support à ce débat : sans nier la diversité des formes de l'économie solidaire, ses auteurs ont pris acte de la nécessité de s'appuyer, de manière ciblée, sur ses acteurs pour contribuer à la croissance de notre pays.
La croissance est affaire de moyens, de redistribution et de justice sociale. Elle est aussi affaire de mise en réseau ; je sais que Marc Daunis ne me démentira pas sur ce point. L'économie solidaire n'est pas l'économie solitaire !

Elle est fortement ancrée dans les territoires. Par conséquent, elle n'est pas ou n'est que peu délocalisable.
À ce sujet, je me permets de vous faire part de mon expérience. Il y a quatorze ans, dans la commune de 15 000 habitants dont je suis le maire, nous avons créé un pôle local d'économie solidaire, sur lequel nous avons aujourd'hui des bilans chiffrés et un recul important.
Ce pôle, dont les statuts sont ceux d'une association « loi 1901 », s'articule autour de trois réseaux : un réseau de créateurs, un réseau d'intervenants volontaires et un réseau de financement solidaire.
Il a pour missions non seulement l'aide à la création, au maintien et au développement d'entreprises, mais aussi un développement local participatif de qualité.
Il mobilise un club d'investisseurs, des dons de particuliers et des associations d'entreprises, qui alimentent des projets directement générateurs d'emplois, mais qui prennent également en compte l'insertion professionnelle globale de la personne accompagnée.
Quatorze ans plus tard, le bilan est extrêmement positif. Avec un budget annuel de 50 000 euros et un chargé de mission, le pôle a accompagné six cent cinquante-six personnes et permis cent quarante-trois créations d'entreprise, cent seize emplois directs et cent quarante-deux accompagnements vers l'emploi. Depuis sa création en 2001, la cagnotte solidarité emploi a été à l'origine d'une cinquantaine d'emplois et a directement soutenu une trentaine de projets individuels.
Mes chers collègues, ces initiatives fonctionnent : elles créent de l'emploi ; elles créent de la valeur. Mais elles sont arrivées à un stade où leur développement nécessite des évolutions statutaires, financières et culturelles.
À cet égard, monsieur le ministre, nous attendons beaucoup du projet de loi dont vous avez annoncé la présentation au cours du premier semestre 2013 lors du conseil des ministres du 5 septembre dernier.
Le rapport de la commission des affaires économiques contient un certain nombre de préconisations ciblées, qui, je le crois, seront très utiles car leur mise en œuvre est déterminante pour passer le cap de croissance.
Le premier levier porte sur le statut des coopératives, que nous devons impérativement faire évoluer, ainsi que l'ont déclaré tout à l'heure Marie-Noëlle Lienemann et Marc Daunis.
Certes, la coopérative est une forme originale mais elle est trop souvent le dernier recours quand toutes les voies ont été explorées. §

Dans un rapport publié en 2011 à l'issue d'un an de travaux, la mission commune d'information sur la désindustrialisation des territoires avait rappelé la grande fragilité de la transmission ou de la reprise d'entreprises.
Les coopératives doivent pouvoir être mobilisées beaucoup plus souvent, ce qui passe par la refonte de leur statut. Dans nos centres-villes, les reprises de commerces ou d'entreprises d'artisanat pourraient alors avoir lieu dans des conditions renouvelées.
Je souhaite que nous ne sombrions pas non plus dans l'angélisme : certains choisissent la formule de la coopérative pour bénéficier d'une niche fiscale. Nous le savons, même si les cas sont minoritaires. Néanmoins, la coopérative doit garder les caractéristiques qui la différencient d'entreprises plus traditionnelles.
Le deuxième levier porte sur le financement de l'économie solidaire. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire doivent être incités à bénéficier des fonds régionalisés de la future Banque publique d'investissement. La possibilité que des sociétés coopératives de production – les SCOP – se multiplient, créent de la valeur, de la richesse et de l'emploi ou que des coopératives industrielles voient le jour en sortirait renforcée. En effet, l'investissement dans le secteur industriel nécessite l'apport de capitaux.
Monsieur le ministre, l'idée d'une fondation, contenue dans le rapport, qui interviendrait de manière complémentaire me paraît aller dans le bon sens. Il s'agit non pas de suppléer les clubs d'investisseurs ou les dispositifs actuels, mais, là encore, de jouer les accélérateurs de projets.
Le troisième levier auquel je suis favorable est celui de la mise en réseau. C'est la force de l'économie sociale et solidaire ; elle est dans sa nature. Mais, pour que certains projets voient le jour et puissent passer à la vitesse supérieure, d'autres travaux en commun doivent être recherchés.
Par exemple, je suis de ceux qui plaident pour une réflexion sur une meilleure intégration de l'économie sociale et solidaire au sein de pôles de compétitivité profondément remaniés.
Je suis aussi de ceux qui souhaitent que ces acteurs de l'économie solidaire ne s'interdisent ni de pénétrer le champ de l'innovation et de la recherche ni de recourir à la mutualisation des moyens, qu'il s'agisse des transports, de l'énergie, des ressources humaines, de la commercialisation ou de l'exportation.
Mes chers collègues, je suis originaire de Franche-Comté, le pays de Victor Hugo et de Proudhon. Leur région abritant des coopératives de comté, des coopératives laitières, les Francs-Comtois savent que de telles entités fonctionnent, y compris à l'exportation.
Permettez-moi de vous faire une dernière suggestion, à laquelle j'espère, monsieur le ministre, que vous serez sensible : le développement de l'économie sociale et solidaire au service de l'emploi passe aussi par des simplifications administratives majeures.
En effet, la simplification des normes administratives est bonne pour toute l'économie. Or la France est malade de la norme.

Cette situation est très compliquée pour les élus, pour les entreprises – qu'il s'agisse d'entreprises artisanales ou de grandes entreprises –, comme pour nos coopératives. Nous devons donc aller vers un travail de simplification pour développer nos territoires et nos entreprises. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Aline Archimbaud et M. Gérard Le Cam applaudissent également.)

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le secteur de l'économie sociale et solidaire fait partie intégrante de notre économie.
De surcroît, il est un recours parmi d'autres en période de crise économique et financière. Incarnant une autre vision des relations économiques entre les hommes et les femmes, il représente un espoir. Faisant la part belle à toutes les formes de coopération, il constitue une espérance. Surtout, il est à la fois espoir et espérance parce qu'il permet l'innovation sociale.
Pour l'ensemble de ces raisons, il mérite toutes les attentions, et en particulier la vôtre, monsieur le ministre.
L'économie sociale et solidaire est aujourd'hui à la croisée des chemins : elle a besoin qu'évoluent tant son statut juridique que ses modes de financement. À défaut, ses structures seront condamnées, condamnées soit à vivoter, soit à perdre leur âme. Tel est le cas des coopératives vinicoles, qui ne disposent pas des fonds propres nécessaires pour faire face à la concentration du secteur ainsi qu'aux nécessaires investissements de développement commercial et de croissance externe.
Le moment semble venu de permettre au secteur de l'économie sociale et solidaire, porteur d'innovation et de progrès social et pourvoyeur d'emplois non « délocalisables », de jouer pleinement le rôle qui lui revient, à côté du secteur caritatif et du secteur commercial. Il convient toutefois de combattre fermement les dérives financières qui, çà et là, gangrènent ce dernier.
Pour continuer non seulement de voir le jour, mais aussi de croître, les multiples structures – associations, sociétés coopératives et participatives, sociétés coopératives d'intérêt collectif – qui composent l'économie sociale et solidaire gagneraient à bénéficier d'un statut juridique approprié.
En effet, nous savons que la constitution d'une société coopérative de production, une SCOP, peut comporter des risques, lesquels découragent bien trop souvent les salariés à racheter leur entreprise, quand bien même cette dernière est tout à fait viable.
De façon générale, monsieur le ministre, ne peut-on pas réfléchir à un cadre juridique spécifique et commun aux différents types d'associations œuvrant dans le secteur de l'économie sociale et solidaire ? Une piste de travail consisterait à mettre en place un type de société inspiré de la société anonyme à responsabilité limitée, propre à l'économie sociale et solidaire, qui garantirait le respect de ses principes fondateurs comme la protection des apporteurs.
Cette réflexion sur le statut juridique ès qualités dont on pourrait doter les structures d'économie sociale et solidaire prendra inévitablement du temps. Pour l'heure, le financement est la question urgente à régler. À défaut, l'économie sociale et solidaire manquera un rendez-vous historique et ne pourra que stagner, voire régresser.
Monsieur le ministre, tel est le défi que l'économie sociale et solidaire doit relever ! Il faut trouver des capitaux plus « patients », moins « gourmands », et imaginer une autre forme de rémunération des capitaux que la seule rentabilité financière.
Hélas ! en l'état actuel, le mode de financement des entreprises coopératives accuse encore un retard dans la mobilisation d'outils pourtant classiques, qu'il s'agisse des leasings, des garanties, des adossements ou des partenariats. Cette lacune, qui s'accompagne, de fait, d'une très faible innovation en matière d'ingénierie financière, freine l'évolution et la croissance des structures, tout en les privant d'une stratégie économique digne de ce nom.
Aussi, c'est de matière grise que le secteur de l'économie sociale et solidaire a le plus besoin pour effectuer la mutation essentielle pour son avenir.
Tout l'enjeu consiste à lui permettre de disposer, pour son financement, de fonds dédiés à l'amorçage de projets socialement innovants et présentant un potentiel, mais ne pouvant atteindre leur équilibre économique qu'à moyen terme, à savoir trois à cinq ans. Par exemple, ces fonds pourraient prendre la forme de prêts pour le financement de la phase de « lancement-maturation ».
L'économie sociale et solidaire gagnerait également à ce que des fonds de garantie spécifiques – associant, le cas échéant, les collectivités – soient mis sur pied.
Enfin, des fonds d'investissement en fonds propres tels les titres participatifs doivent pouvoir soutenir les structures qui souhaitent se développer, en les accompagnant dans leur changement d'échelle.
Dans ces conditions, comme nombre de mes collègues, j'attends beaucoup de la future banque publique d'investissement, dont l'une des vocations, vous l'avez dit, monsieur le ministre, consiste à rassembler l'ensemble des missions et structures orientées vers le financement de l'économie sociale et solidaire.
J'estime en effet qu'elle doit pouvoir jouer un rôle important dans la dynamique que j'appelle de mes vœux, au côté d'autres acteurs publics : je pense notamment aux conseils régionaux qui font beaucoup. Vous vous doutez, monsieur le ministre, que je les porte dans mon cœur, celui de Languedoc-Roussillon plus particulièrement ! §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme l'illustre l'excellent rapport de notre collègue Marie-Noëlle Lienemann, l'économie sociale et solidaire couvre un grand nombre de secteurs. À ce titre, elle est appelée à prendre toute sa part dans l'entreprise de redressement de notre pays que mène actuellement le Gouvernement. Dans cette logique, je consacrerai mon intervention au logement au travers du prisme singulier des « coopératives d'habitants ».
Si le rapport de Marie-Noëlle Lienemann précise que « l'habitat coopératif est un phénomène récent et embryonnaire en France », pour autant, ce sujet n'est pas inconnu de notre assemblée. Ainsi, en 2009, à l'occasion du débat sur la loi « de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion », la gauche avait déposé des amendements relatifs à ce sujet. Le gouvernement Fillon s'était bien engagé à travailler la question, mais cet engagement est resté de l'ordre de la déclaration d'intention.
Plus récemment, lors du dépôt par le groupe socialiste de la proposition de loi « visant à faire du logement une priorité nationale », notre attention avait été attirée sur ce sujet par le titre V, visant à « doter les initiatives solidaires et coopératives spécifiquement orientées sur le logement d'un cadre légal ».
Le sujet ne nous est donc pas totalement étranger. Cependant, dans notre pays, les coopératives d'habitants restent encore peu nombreuses : on en dénombre seulement une cinquantaine. Or, en Suisse, les coopératives d'habitation représentent 8 % du parc immobilier et 20 % des logements dans une ville comme Zurich. En Norvège, plus de 650 000 personnes ont opté pour ce mode d'habitat, soit l'équivalent de 15 % du parc immobilier national. Des initiatives de ce type existent dans toute l'Europe : en Allemagne, en Italie, en Belgique...
Ce mouvement s'inscrit dans un contexte national où, pendant les dix dernières années, le coût du logement a crû de 107 %, quand les revenus n'augmentaient que de 17 %. Le bilan est sans appel : la crise du logement frappe près de 10 millions de personnes dans notre pays. Ainsi que le précise le professeur Marty, le logement est devenu, pour l'essentiel, un objet de spéculation et de rente. Cette dynamique « mercantile » induit deux effets conjoints : d'une part, le citoyen se retrouve dans l'obligation de s'effacer devant les intérêts privés qui composent la chaîne immobilière et marchande ; d'autre part, au fil des politiques de défiscalisation, le logement neuf devient abondant et de qualité, mais reste inaccessible à une très grande majorité de nos concitoyens, compte tenu de son coût.
Face à cette réalité, et pour emprunter à Durkheim, « les coopératives d'habitants » opèrent un travail « d'administration de la preuve ». Cette solution alternative aux politiques de logement traditionnel est non seulement réaliste, mais elle speut constituer un élément important dans une politique renouvelée d'accès au logement. À ce titre, elle entend dépasser l'opposition entre propriété et location et elle est sous-tendue par une double logique : la première, qui est horizontale, renvoie à la solidarité envers nos contemporains ; la seconde, qui est verticale, s'exerce à l'endroit des générations à venir, compte tenu des procédés de fabrication retenus.
D'un point de vue théorique, les « coopératives d'habitants » peuvent prendre la forme de « coopératives locatives d'habitation » ou de « coopérative d'habitants par capitalisation ». Dans les faits, les porteurs de projets se tournent vers un modèle mixte, alliant les logiques économiques de la capitalisation et de la location.
Néanmoins, quelle que soit la forme retenue, les « coopératives d'habitants » présentent des caractéristiques communes. Il s'agit notamment de la propriété collective de logements dont tous les locataires sont les coopérateurs, car propriétaires des parts sociales de la coopérative. Ainsi, en cas de départ d'un coopérateur, ce qui est revendu, ce ne sont pas des murs, mais des parts sociales dont le prix de cession est encadré.
Le modèle est démocratique, puisque fondé sur la gouvernance démocratique et le principe « une personne égale une voix ». Il est solidaire, puisque la dimension individuelle n'exclut pas le développement de la mutualisation de services et d'espaces ; il est solidaire aussi du fait de la prise en compte des préoccupations environnementales. Enfin, il est non spéculatif, puisque la cession s'effectue sur une base de parts sociales à prix encadré.
Comme l'affirme Marie-Noëlle Lienemann dans son rapport, cette forme d'habitat participatif s'inscrit parfaitement dans une démarche de coopérative, telle que l'entend la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cependant, les coopératives d'habitation ont été supprimées par la loi Chalandon de 1971. De ce corpus législatif ne subsistent que les coopératives de construction et les coopératives d'HLM ayant pour objet la construction de logements en accession à la propriété individuelle.
Convaincue de la pertinence de ce modèle qui propose « d'habiter un territoire » et non pas de « consommer du logement », j'estime qu'il est désormais temps de faciliter son développement et je compte sur votre action en ce sens, monsieur le ministre, ainsi que sur celle de vos collègues.
Sans reprendre toutes les propositions du rapport, je voudrais en rappeler quelques-unes.
La première concerne les nécessaires modifications à apporter à la loi de 1947. Ce texte est la base légale sur laquelle les projets sont actuellement produits, mais il n'a pas été pensé spécifiquement pour encadrer des projets de coopérative d'habitants. Ainsi, la rédaction d'un article visant à définir les sociétés coopératives d'habitants, la qualité d'associé, les possibilités que pourraient offrir des statuts précis, notamment au regard de tiers non-associés, constituerait une avancée importante.
Un vide juridique existe aussi pour les conditions de cession de parts. Il serait souhaitable d'y remédier en permettant que ces cessions se fassent librement, avec un prix qui serait bien sûr encadré, afin d'éviter toute dérive spéculative. Dans ce sens, permettre à la coopérative de pratiquer des loyers inférieurs au niveau du marché, sans risque juridique ou fiscal de pénalisation, me semble important. Dans le respect de l'esprit coopératif, il en va de même de la possibilité de moduler les loyers demandés aux coopérateurs selon l'ancienneté et le montant de l'apport initial.
La question du régime fiscal appliqué aux « coopératives d'habitants » constitue également un volet essentiel. Il serait intéressant de procéder à la modification du premier alinéa du I de l'article 150 U du code général des impôts pour que les bénéfices provenant d'opérations effectuées avec un tiers soient assujettis à l'impôt sur les sociétés à titre normal, pour que ces coopératives puissent provisionner sur le long terme en vue de travaux et pour organiser fiscalement la cession de parts sociales, initiales ou acquises, de la coopérative.
Enfin, la mauvaise articulation entre le droit coopératif et le droit du logement obère le développement de partenariats avec les sociétés d'HLM. De plus, elle rend problématiques les conditions d'attribution des logements sociaux produits au sein de la coopérative : il est donc nécessaire de réformer, à la fois dans une perspective de faisabilité et d'efficacité.

Vous l'avez compris, mes chers collègues, la forme coopérative est adaptée à l'habitat groupé. Elle replace tous les habitants, même les plus fragiles, au cœur des dispositifs immobiliers des métropoles urbaines. Elle oppose un démenti formel aux logiques urbaines reposant sur « l'entre-soi » et la marchandisation de l'habitat.
Faire évoluer notre droit afin de rendre ces dynamiques coopératives plus aisées et plus effectives me semble donc constituer un objectif à atteindre. Nous comptons sur vous, monsieur le ministre !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Jacques Mézard applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président du groupe de travail, madame la rapporteur, mes chers collègues, en parallèle aux auditions du groupe de travail sur l'économie sociale et solidaire, ou ESS, j'ai souhaité mener une étude de ce secteur dans le département de l'Ardèche, en procédant à une série d'entretiens avec les principaux acteurs sur le territoire, représentant d'ailleurs différentes formes d'activités. Mon intervention dans ce débat en rendra compte succinctement.
Je note tout d'abord qu'en Ardèche, département très touché par la crise, avec de nombreuses fermetures d'usines ou des compressions d'effectifs, dans l'industrie textile et les équipements automobiles, en particulier, l'ESS est un secteur en expansion ces dernières années : ses effectifs ont en effet augmenté quatre fois plus que ceux de l'ensemble de l'économie ardéchoise.
Ainsi, le poids de l'ESS est plus important en Ardèche qu'au niveau national et régional : elle représente 15 % des emplois salariés privés, soit 12 847 salariés, avec 1 400 établissements œuvrant principalement dans les domaines de la finance et des assurances, de l'enseignement, de l'action sociale, des arts et spectacles, mais aussi du sport et des loisirs, ou également dans la production artisanale ou industrielle. Par exemple, la SCOP Ardelaine, qui emploie 45 salariés dans une commune de moins de 500 habitants, traite et valorise la laine des moutons de 300 éleveurs d'Ardèche et de Haute-Loire et commercialise ses produits sur place, dans les foires, salons et magasins bio.
Cette étude m'a ensuite permis d'identifier les initiatives innovantes de ce territoire et de les porter à la connaissance du groupe de travail, comme expériences transposables à d'autres départements.
Lors des auditions réalisées, j'ai également pu relever des obstacles au développement de l'ESS en Ardèche : certains d'entre eux, notamment dans le domaine financier, figurent dans les conclusions du groupe de travail, d'autres viennent les compléter.
Plusieurs questions essentielles ont été posées au cours des différents entretiens. Tout d'abord, comment améliorer la professionnalisation des acteurs de l'ESS ?
En effet, la professionnalisation des acteurs associatifs, qui constituent une grande partie des structures de l'ESS, constitue un enjeu important. Les associations, ne disposant souvent pas de « culture économique et financière », ont tendance à écarter, par éthique, l'objectif de « bons résultats », qu'ils confondent avec les « profits » du secteur libéral et concurrentiel. Des évolutions me semblent souhaitables à cet égard dans les mentalités et les comportements, y compris au niveau des services de l'État, qui considèrent parfois négativement les soldes excédentaires des comptes des associations, alors que ces bons résultats leur permettent bien sûr de réinvestir et de développer leurs activités, sans objectif de rentabilité « capitalistique », et donc de maintenir et de créer des emplois.
Avec la complexification des actions des associations, la relation et le partage des tâches entre les bénévoles et les salariés tendent également à devenir problématiques. C'est pourquoi l'idée a été émise de constituer un statut pour les bénévoles, qui permettrait notamment de valoriser leur travail non salarié, de les pérenniser et d'articuler leur rôle avec celui des salariés.
Autre question posée : quelle politique d'encouragement de l'ESS faut-il mener et à quels acteurs la confier ?
Le rôle des élus, locaux et nationaux, et des institutions, pour donner le goût d'entreprendre, en l'occurrence « autrement », et inculquer les valeurs de l'ESS à un public élargi, est ici primordial. La suggestion de désigner un élu « référent économie sociale et solidaire » dans les échelons administratifs a notamment été formulée, tout comme l'insertion de clauses sociales dans les appels d'offres des marchés publics – même si cet outil doit être manié avec les précautions juridiques indispensables.
Outre des problèmes de cohérence entre les politiques menées à différents niveaux administratifs, on peut remarquer que trop peu d'élus sont sensibilisés à l'ESS, car ils en ont une image évoquant trop fortement l'aide sociale, sans avoir conscience du réel potentiel économique qu'elle représente aussi.
Les chambres consulaires, quant à elles, déconseillent trop souvent aux porteurs de projets de choisir les statuts coopératifs, malgré tout l'intérêt qu'ils comportent.
Ensuite, il existe trop peu de « lieux-ressources » capables de former et d'orienter les acteurs de l'ESS sur le territoire, et ceux qui existent sont mal répartis. Divers acteurs de l'ESS ont souligné le besoin de territorialisation de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, la CRESS, ou encore de la présence de permanences des coopératives d'activité plus nombreuses sur tout le territoire.
Enfin, il apparaît nécessaire d'améliorer différents aspects juridiques. Les acteurs du secteur sont assez unanimes pour dire qu'un réel travail sur la définition même de l'ESS est indispensable, une simple énumération des statuts des établissements considérés comme relevant de l'ESS leur paraissant insuffisante.
Très brièvement, je me bornerai à évoquer quelques points. La société coopérative d'intérêt collectif, ou SCIC, est reconnue sur le terrain comme présentant de nombreux avantages, mais quelques inconvénients ont tout de même été soulignés, je n'en mentionnerai que deux. Tout d'abord, l'adhésion obligatoire à la Confédération générale des SCOP lors de la création d'une SCIC paraît relativement onéreuse pour les petites structures, même si le coût de l'adhésion est proportionnel au chiffre d'affaires et à la masse salariale. Ensuite, ce statut de création récente manque encore de reconnaissance, car, située entre l'entreprise et l'association, la SCIC n'est considéré ni comme l'une ni comme l'autre, ce qui constitue parfois un frein.
En ce qui concerne les SCOP, les entrepreneurs souhaitent la création d'un statut « d'entrepreneur-salarié », qui existe, de fait, pour le personnel, mais qui n'est pas sécurisé juridiquement.
Enfin, l'article 200 du code général des impôts ne permet pas aux associations œuvrant dans le domaine du développement local d'être reconnues comme « d'intérêt général ». S'il était possible d'y remédier, cela ouvrirait sans doute des champs d'initiative nouveaux.
En conclusion, j'espère que les obstacles que j'ai mis en évidence, et d'autres davantage explicités et illustrés dans mon rapport, seront susceptibles d'alimenter les réflexions qui se poursuivront, notamment au Sénat, et, avec quelque prétention peut-être, vos propres réflexions, monsieur le ministre.
Je ne doute pas cependant, monsieur le ministre, que vous ferez votre miel de l'ensemble des constatations et des suggestions qui ressortent du débat organisé ce jour au Sénat sur le thème de l'économie sociale et solidaire, secteur à part entière de l'économie à visage humain. §
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires économiques, monsieur le président du groupe de travail sur l'économie sociale et solidaire, madame la rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, je vais tenter à la fois de répondre à vos questions et de revenir sur le contenu du rapport de Mme Lienemann, notamment sur les perspectives que le Gouvernement entend donner à plusieurs de ses préconisations sur l'avenir du secteur coopératif dans le cadre du projet de loi que je prépare pour le printemps 2013 et qui sera consacré à l'économie sociale et solidaire, l'ESS.
Je commencerai cependant par faire le point sur l'approche du Gouvernement en matière d'économie sociale et solidaire et sur la nature des politiques publiques que nous entendons mettre en œuvre. Elles procéderont non seulement de la loi, mais aussi d'un certain nombre d'engagements forts, notamment dans le cadre de la Banque publique d'investissement, la BPI, des emplois d'avenir et de toute une série d'actes politiques qui ne relèvent pas strictement du projet de loi sur l'économie sociale et solidaire.
Un point important a été évoqué par plusieurs d'entre vous : nous sommes arrivés à un moment où soit l'État, les collectivités locales, la puissance publique se dotent des moyens de permettre à l'économie sociale et solidaire de changer d'échelle, soit ce secteur, qui a peut-être mieux résisté que l'économie classique en période de crise, sera confronté, en raison d'une concurrence féroce dans les domaines dans lesquels il s'est développé, à un risque de déclin qui s'accompagnera de destruction d'emplois.
Pour la première fois, en 2011, le secteur associatif, qui a créé 440 000 emplois au cours des dix dernières années, a perdu 22 000 emplois. La question qui se pose aux pouvoirs publics, au Gouvernement et à votre assemblée est la suivante : sommes-nous arrivés à un palier que nous voulons franchir en inscrivant le développement de l'économie sociale et solidaire dans la stratégie de croissance de la France ou à un plafond au-delà duquel nous ne parviendrons pas à développer l'ESS, avec sa mission si originale conciliant activité économique, utilité sociale et service de l'intérêt général ?
C'est donc à cette question que le Gouvernement a voulu répondre, pour commencer par la création d'un ministère de l'économie sociale et solidaire logé à Bercy, qui profite de la voilure, de la compétence des directions de l'administration centrale de l'économie et des finances. La politique que va mettre en œuvre ce ministère sera axée autour de trois principes : la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire, sa structuration, dans un deuxième temps, en valorisant les expériences des territoires et, enfin, son développement. Je présenterai tout d'abord le contenu que nous entendons donner à ces trois priorités en faveur de l'ESS, avant de vous dire comment nous avons réagi à vos propositions en faveur du secteur coopératif proprement dit.
La reconnaissance de l'économie sociale et solidaire va passer par la loi. Pour ma part, j'ai une approche très inclusive de la reconnaissance légale de l'économie sociale et solidaire. Je ne crois pas qu'il faille, ici ou ailleurs, chercher à arbitrer une forme de querelle entre les anciens et les modernes, les anciens appartenant à l'ESS par statut – les coopératives, les fondations, les associations, les mutuelles – et les modernes étant de l'ESS par finalité, à savoir le mouvement de l'entrepreneuriat social. Ces deux traditions concourent aujourd'hui en France à créer non seulement de l'activité mais aussi de l'emploi et à articuler activité économique et utilité sociale. De ce point de vue, que l'on soit un entrepreneur social ou un mutualiste, on rend un service important à la collectivité française. Je vous proposerai donc d'adopter une approche inclusive de l'économie sociale et solidaire.
Je souhaite créer, dans le cadre du projet de loi qui vous sera présenté, un label de l'entreprise sociale et solidaire. Ce label, de type inclusif, n'exclura aucun statut. Il vise surtout à permettre la reconnaissance d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Comment la Banque publique d'investissement, qui consacrera 500 millions d'euros au financement des structures de l'ESS, pourrait-elle mettre efficacement en œuvre cette politique si elle n'est pas en mesure de reconnaître une telle entreprise ? Cette labellisation vise d'abord à permettre aux instruments de financement de l'ESS de reconnaître les entreprises qui relèvent du secteur.
Si nous voulons orienter la commande publique vers l'économie sociale et solidaire, il importe aussi, plusieurs d'entre vous l'ont souligné, que les donneurs d'ordre soient capables de reconnaître une entreprise sociale et solidaire, comme demain le législateur, s'il souhaite orienter la politique fiscale en faveur de l'ESS, en sortant du maquis qui parfois distingue le mouvement mutualiste, le mouvement coopératif, les fondations, le mouvement associatif ou l'entrepreneuriat social.
Nous voulons avoir une approche plus générique de l'entreprise sociale et solidaire, qui fixera à côté les contreparties fiscales, réglementaires, l'accès à la commande publique, ainsi que les conditions d'éligibilité à la Banque publique d'investissement.
C'est un débat qui anime le monde de l'économie sociale et solidaire. Le but de la labellisation n'est pas d'exclure qui que ce soit, encore que l'on puisse aussi s'entendre sur ce que n'est pas l'économie sociale et solidaire : elle n'est ni le social business, ni la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, ni, à l'évidence, l'économie low cost. Nous avons besoin, au-delà de la définition de ce que n'est pas l'économie sociale et solidaire, de fixer le périmètre légal de l'ESS à travers des principes : la non-lucrativité ou la lucrativité limitée, la gouvernance démocratique, le partage du pouvoir, le principe « un homme - une voix », l'ancrage territorial, autant de principes qui concourent aujourd'hui à définir le champ de l'économie sociale et solidaire. Ce label permettra aux entreprises sociales et solidaires, au sens générique du terme « entreprise », de bénéficier des contreparties qu'aura voulu mettre en œuvre le législateur pour favoriser le développement de ce secteur.
La reconnaissance, ce n'est pas simplement le fait d'inscrire dans une loi-cadre l'existence de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi, comme plusieurs d'entre vous l'ont souligné, notamment la rapporteur Marie-Noëlle Lienemann, permettre qu'elle soit enseignée. J'ai commencé à discuter avec mon collègue Vincent Peillon afin que figurent, demain, dans les programmes et les manuels scolaires, dans les cours d'économie, l'existence de modèles d'entreprise alternatifs à l'entreprise classique contribuant à la création d'activités. Il n'est pas question de porter un jugement, mais simplement de pouvoir enseigner l'ESS, en tant que modèle économique, davantage que lors d'une semaine de l'économie sociale et solidaire au collège ou au lycée. Nous voulons que l'activité de ce secteur soit intégrée aux manuels et aux programmes scolaires.
Je rebondis sur une proposition de M. Jean-Michel Baylet, qui insistait sur l'importance de la reconnaissance des employeurs de l'ESS. Lors de la dernière conférence sociale, Mme Parisot a ouvert le chantier de la rénovation de la représentativité patronale, faisant suite à une demande de l'USGERES, l'Union de syndicats et groupements d'employeurs représentatifs dans l'économie sociale, qui souhaite être intégrée au dialogue social, aux discussions interprofessionnelles. Un chantier sera ouvert dans le cadre de la négociation sociale et devrait permettre, au-delà de la reconnaissance par la loi et dans le système éducatif, la reconnaissance des employeurs de l'économie sociale et solidaire dans le dialogue social interprofessionnel.
La deuxième priorité, qui rejoint les propos de M. Chastan, concerne la contractualisation et la nécessité de structurer, dans les territoires, l'économie sociale et solidaire. L'ESS existe sur tous les territoires. Souvent, les citoyens ne la reconnaissent pas, mais ils sont sociétaires d'une mutuelle, inscrivent leurs enfants dans une association de soutien scolaire ou de théâtre. Ils ont donc des contacts multiples avec l'économie sociale et solidaire, mais ne voient pas forcément le lien qui unit les structures de ce secteur.
Les collectivités territoriales, à travers leurs choix stratégiques, en particulier les régions qui ont, pour beaucoup d'entre elles, inscrit dans leur schéma régional de développement économique le développement de l'ESS, connaissent parfaitement les besoins du monde associatif, coopératif, mutualiste, parce qu'elles ont d'ores et déjà des stratégies de filière.
Je reviens de Toulouse, dans la région Midi-Pyrénées, où j'ai visité trois coopératives. La première, une SCOP de douze personnes, est spécialisée dans la transformation de déchets de la ferme en biogaz, en énergie renouvelable : j'ai ainsi appris qu'une chèvre valait 80 litres de fuel par an et une vache 40 litres ! La deuxième, Scopélec, dans le domaine du câblage électrique, compte 1 600 salariés. La troisième, Éthiquable, associe le modèle coopératif et la logique du commerce équitable. Ce sont trois mondes totalement différents. Il existe aujourd'hui des coopératives ou des structures de l'économie sociale et solidaire dans tous les domaines. Dans les services à la personne, le monde de l'industrie, des secteurs parfois terriblement concurrentiels, ces structures, robustes, gagnent des marchés, se développent et créent de l'emploi.
J'insiste sur le fait que, pour disposer d'une stratégie de filière, il faut pouvoir s'appuyer sur la contractualisation et sur les territoires. Dans le projet de loi vous sera proposé un modèle de contractualisation à l'échelle des régions, des départements, des agglomérations ou des communes, qui, entre l'État, les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les collectivités locales, permettra de construire des stratégies à court, à moyen et à long terme.
Nous avons besoin, dans l'ESS, de temps, de nous projeter dans l'avenir et rien ne serait pire que des annonces qui ne seraient pas suivies d'effet. C'est pourquoi nous voulons construire cette contractualisation et la formaliser par la loi. Ce sera un point important de cette deuxième priorité : structurer l'ESS dans les territoires.
Je ne développerai pas tous les points. Vous constaterez que le projet de loi se nourrit largement des travaux du Sénat, du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, du rapport du député Vercamer et du groupe d'étude de l'Assemblée nationale. Il y aura d'autres propositions pour structurer l'ESS, mais je voulais insister particulièrement, devant la Haute Assemblée, sur l'importance de la contractualisation au niveau des territoires.
La dernière priorité, c'est le développement de l'économie sociale et solidaire. À l'évidence, le programme des emplois d'avenir est naturellement dédié aux structures de l'ESS, puisqu'il concerne toutes les structures d'insertion par l'activité économique, en particulier le monde associatif qui a besoin d'embaucher non seulement des jeunes peu ou pas qualifiés, mais aussi un certain nombre de jeunes qualifiés. Dans nos territoires, nous constatons aujourd'hui que les difficultés d'embauche concernent bien sûr, surtout, les jeunes peu qualifiés, mais également les jeunes qualifiés. La commission mixte paritaire qui s'est réunie aujourd'hui sur le projet de loi portant création des emplois d'avenir a permis de préciser cette question entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Le monde associatif aura la possibilité d'embaucher des jeunes de niveau bac et bac+3 pour encadrer un certain nombre d'activités essentielles, notamment dans les zones urbaines sensibles ou dans les zones rurales en déshérence économique. Le programme des emplois d'avenir sera naturellement très orienté vers l'économie sociale et solidaire.
J'évoquerai maintenant un second instrument, dont plusieurs d'entre vous ont parlé, à savoir la Banque publique d'investissement.
La BPI consacrera 500 millions d'euros au financement de l'économie sociale et solidaire. Nous avons tiré les conséquences, je le dis à M. Magras, des investissements d'avenir mis en œuvre par le précédent gouvernement. Cette initiative a été tout à fait utile pour le développement de l'économie sociale et solidaire. Une partie des investissements d'avenir ont en effet été orientés vers le développement de cette économie.
Nous avons mobilisé la mission de préfiguration de la banque publique d'investissement et étudié ce qui, dans ce dispositif, avait bien et mal fonctionné. Nous allons maintenant essayer d'orienter ces financements afin qu'ils répondent parfois aux besoins de haut de bilan, parfois aux besoins de bas de bilan, et qu'ils permettent de boucher le plus gros trou existant aujourd'hui dans la raquette du financement public de l'économie sociale et solidaire, à savoir l'absence d'instrument de financement de l'innovation sociale. Nous ne disposons pas actuellement d'instrument spécifiquement dédié au financement de l'innovation sociale. À cet égard, il faudra d'ailleurs définir ce qu'est l'innovation sociale.
La Banque publique d'investissement permettra de boucher les trois trous de la raquette : les besoins de financement en haut de bilan, les besoins de financement en bas de bilan et le financement de l'innovation sociale.
Nous avons voulu que l'instrument soit le plus adapté aux besoins très variés des différentes entreprises de l'économie sociale et solidaire, de la petite association qui a un découvert de 5 000 euros et qui a donc besoin de facilités de trésorerie, aux grands établissements sanitaires et sociaux du secteur privé non lucratif, tels les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui ont besoin de plusieurs millions d'euros afin de pouvoir reconstituer leurs fonds propres.
La Banque publique d'investissement proposera l'ingénierie, un accompagnement et des solutions aux différents besoins qui sont aujourd'hui ceux des structures de l'économie sociale et solidaire.
De surcroît, je me réjouis que, dans son rapport sur la réforme de l'épargne réglementée, M. Duquesne propose que parmi les nouvelles obligations d'emplois des crédits décentralisés de l'épargne réglementée gérés par les banques figurent désormais, du fait notamment du doublement du plafond du livret de développement durable et de l'augmentation du plafond du livret A, outre le financement des PME et la rénovation thermique des bâtiments anciens, le financement de l'économie sociale et solidaire. Cela permettra à l'économie sociale et solidaire de bénéficier des financements du secteur bancaire privé, en plus des moyens mis en œuvre par la Banque publique d'investissement.
Ce sont là des instruments tout à fait nouveaux et performants, destinés à muscler et à doper le financement de l'économie sociale et solidaire. J'espère, en tout cas c'est notre vœu, qu'ils contribueront à permettre ce changement d'échelle voulu par nombre d'entre vous.
Je n'esquiverai pas les questions qui m'ont été posées sur les certificats mutualistes.
Nous réfléchissons aujourd'hui, à la demande notamment d'une grande société d'assurance mutualiste, Groupama, au principe de la création d'un certificat mutualiste qui permettrait aux mutuelles de lever des fonds propres, parfois indispensables pour respecter les exigences prudentielles de Solvabilité II – celles qui s'imposent au monde mutualiste et au monde assurantiel sont fortes –, mais aussi pour faire face aux difficultés auxquelles il leur arrive d'être parfois confrontées.
À titre personnel, ma religion n'est pas encore totalement faite sur ce sujet, sur lequel nous travaillons actuellement avec la direction générale du Trésor. Les titres mutualistes sont peut-être le troisième instrument, avec les titres associatifs et les titres participatifs, qui manque. Il pourrait nous permettre de consolider le modèle économique des sociétés d'assurance mutualiste et des mutuelles en France, qu'elles relèvent du code de la mutualité ou du code des assurances.
En tout cas, nous réfléchissons à cette piste, mais nous n'avons pas encore, à ce stade, tranché la question. Notre débat avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs, nous y aidera.
Telles sont les informations dont je souhaitais vous faire part en guise d'introduction sur ce que seront les grandes priorités du projet de loi-cadre et des politiques publiques que nous voulons mettre en œuvre dans le domaine de l'économie sociale et solidaire.
Il manque à cet inventaire beaucoup de propositions, dont plusieurs, monsieur Daunis, figurent dans le rapport de Marie-Noëlle Lienemann. Je vais maintenant en dire un mot.
Le secteur coopératif, comme l'un d'entre vous l'a dit, est très ancien. Il commence avec Charles Fourier et ses phalanstères à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle, se poursuit avec Proudhon – cher au sénateur Bourquin –, qui, entre le communisme et le capitalisme, a inventé le mutualisme et s'est beaucoup inspiré du système coopératif, et, plus récemment, avec Charles Gide et ses phalanstères. Nous avons donc quelques solides expériences dans ce domaine.
La France compte aujourd'hui 21 000 entreprises coopératives, un million de salariés en intégrant les filiales et 330 000 si on ne prend en compte que les coopératives au sens strict, ainsi que 23, 7 millions de membres – c'est beaucoup, mais cela intègre évidemment les clients des banques coopératives. Les entreprises coopératives représentent 288 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le monde coopératif contribue donc de manière extrêmement importante au PIB, mais également, et surtout, à la structuration de l'économie sociale et solidaire.
Toutefois, ce secteur présente des lacunes. Un certain nombre d'entreprises coopératives se sont en effet un peu libérées de leurs obligations ou de leurs grands principes pour tenter elles aussi l'aventure sur les marchés financiers.
Je rappelle que, schématiquement, on peut aujourd'hui distinguer les coopératives d'entreprises, dont les associés, c'est-à-dire les coopérateurs, sont des entrepreneurs ; les coopératives d'utilisateurs ou d'usagers, dont les associés sont les utilisateurs des biens et des services produits ; les coopératives de production. – les plus célèbres d'entre elles sont les SCOP, dont nous allons beaucoup parler et dont nous cherchons, vous comme nous, à favoriser le développement – ; les coopératives multi-sociétariales, les plus connues étant les SCIC, les sociétés coopératives et d'intérêt collectif, qui associent collectivités locales, simples citoyens, acteurs divers, notamment du monde coopératif ; enfin, les banques coopératives, dont les associés sont les clients ou les sociétaires.
Quelles sont les limites de ce modèle ?
On peut objectivement constater que si elles développent des grands principes, toutes les coopératives, notamment dans le secteur bancaire, ne sont pas passées à côté du mirage de « l'économie casino ». Plusieurs banques coopératives ont été prises la main dans le pot de confiture, si je puis dire. Elles ont créé des filiales cotées en bourse et leurs pratiques ont donc de fait été agrégées à celles des autres banques. La BPCE a ainsi créé Natixis, le Crédit agricole le Crédit agricole SA. Ces filiales ont pris des risques financiers considérables, car elles ne se sont pas fondamentalement distinguées de leurs concurrents du secteur bancaire privé classique.
Le monde coopératif n'est donc pas, par définition, plus vertueux que les autres. Un certain nombre de banques coopératives se sont affranchies du modèle coopératif pour gagner des parts de marché, dans une logique de développement. Elles ont alors fait des choix qui les ont exposées à des risques considérables.
Dans le monde coopératif agricole, on distingue deux modèles : les coopératives de comté en Franche-Comté, chères à Martial Bourquin, et un certain nombre de grandes coopératives agricoles ayant beaucoup servi le modèle productiviste et l'agriculture intensive. Ces deux types de coopératives ne défendent pas le même modèle de développement. On pourrait dans ce secteur également formuler quelques critiques et essayer de réorienter une partie de ces coopératives vers les grands principes qui étaient les leurs au départ.
L'objectif du Gouvernement, c'est un renouveau du modèle coopératif. Disons, d'abord, qu'une coopérative n'est pas de la magie. Elle ne transforme pas une entreprise en difficulté, dont le carnet de commandes est vide, en une entreprise qui, du jour au lendemain, parce que les salariés se sont substitués au chef d'entreprise, gagnerait de l'argent.
Nous devons collectivement tordre le coup à l'idée selon laquelle toute entreprise en difficulté, dès lors qu'elle est reprise par les salariés, se met soudainement à découvrir de nouveaux marchés, à être innovante et performante, alors qu'elle ne l'était pas avant.
Parfois, la reprise d'une entreprise sous forme de SCOP permet cela. Nous connaissons de très beaux exemples. Ainsi, dans la Drôme, la CERALEP – Didier Guillaume aurait pu nous en parler – est une coopérative qui fabrique des isolateurs en porcelaine. Alors que cette entreprise fondée en 1921 était prospère, elle a été rachetée par un fonds de pension américain en 2000 et a été conduite au dépôt de bilan en 2003. Les salariés l'ont reprise, elle fait aujourd'hui de nouveau des bénéfices et gagne des marchés.
Dans d'autres cas, le modèle coopératif, en tout cas le modèle de SCOP, n'est pas forcément la réponse la plus adéquate. À cet égard, le cas de la société Fralib est révélateur.
À la demande des salariés, le Gouvernement étudie, notamment avec l'Union régionale des SCOP, les conditions dans lesquelles les salariés pourraient être les repreneurs de leur entreprise. Une réunion a eu lieu lundi 1er octobre entre Arnaud Montebourg, les représentants syndicaux de Fralib et la direction d'Unilever : il est très clair que la viabilité de l'entreprise dépend très largement des conditions dans lesquelles Unilever acceptera d'être le client de la société et la marque Éléphant sera transmise aux salariés.
SCOP ou non, si ces conditions ne sont pas réunies, cela fragilise la reprise de l'entreprise et sa viabilité. L'enjeu est considérable. Le Gouvernement, Arnaud Montebourg en tête, a beaucoup agi pour donner des garanties aux salariés et permettre la revitalisation du site et pour investir à cet effet.
Mon ministère, en liaison avec celui d'Arnaud Montebourg, est intervenu pour assurer l'expertise du modèle de SCOP. Nous sommes arrivés à la conclusion que ce qui permettrait de débloquer la situation ce n'est pas le passage en SCOP, mais le fait de disposer de la marque et des moyens d'Unilever, qui constituent la clef permettant de déverrouiller la situation.
Voilà où nous en sommes, puisque vous m'avez interrogé sur ce point, madame Pasquet. Je vous informe qu'une table ronde aura lieu à la préfecture de Marseille le 3 octobre prochain. Elle devrait, je l'espère, permettre de clore ce dossier. J'espère, tout comme vous, qu'une sortie positive sera trouvée pour les salariés, pour l'activité et pour la région de Marseille, en l'occurrence la région PACA.
Notre objectif en matière de renouveau des coopératives sera d'abord de développer les structures existantes. Dans un second temps, il sera d'étendre les principes coopératifs à de nouveaux acteurs, notamment aux coopératives d'habitants, madame Demontès.
Concernant le développement des structures existantes, en lien avec l'administration, la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, la DGCIS, qui est représentée aujourd'hui à mes côtés au banc du Gouvernement et qui travaille avec le ministère du redressement productif, nous réfléchissons aux conditions de la mise en œuvre de l'engagement du Président de la République de créer un droit de préférence pour le rachat d'entreprises par les salariés sous forme de SCOP.
Le droit de préférence aurait pour but d'obliger le cédant à faire une proposition aux salariés par la voie des institutions représentatives du personnel et à leur donner les conditions de temps et de réflexions nécessaires à la formulation d'une offre de reprise. Il ne suffit pas en effet de disposer d'un droit de préférence, encore faut-il que les salariés aient le temps d'élaborer un dossier et les moyens de le faire. Il faut qu'ils disposent de l'accompagnement et de l'ingénierie nécessaires. On ne s'improvise pas du jour au lendemain repreneur d'une entreprise dans laquelle on a travaillé toute sa vie. Devenir, même collectivement, chef de l'entreprise ne s'improvise pas. Il faut du temps. Il faut pouvoir construire les conditions de cette reprise.
Le projet de loi distinguera le cas des cessions d'entreprises en bonne santé et celui des entreprises en difficulté, reprises à la barre du tribunal de commerce. Ce n'est pas la même chose de reprendre une entreprise en difficulté et une entreprise saine.
Comme l'un d'entre vous l'a rappelé tout à l'heure, on estime aujourd'hui qu'entre 50 000 et 200 000 emplois disparaissent faute de reprises d'entreprises saines, simplement parce que le patron de la PME prend sa retraite. Il considère qu'il a bien travaillé et qu'il est temps pour lui de se reposer, mais il n'a pas préparé sa succession. Il s'agit d'entreprises qui gagnent de l'argent, pas suffisamment pour qu'un fonds spéculatif se jette sur elles, mais assez pour faire vivre entre dix et quarante salariés. Faute de repreneurs, ces entreprises disparaissent. Nous voulons favoriser la reprise par les salariés de ces entreprises saines, grâce au droit de préférence pour le rachat d'entreprises par les salariés sous forme de SCOP. Telle sera la réponse du Gouvernement à ce problème.
Par ailleurs, toujours afin d'encourager la reprise par les salariés de leur entreprise sous forme de SCOP, nous prévoyons de créer une dérogation temporaire quant à la possession majoritaire du capital par les salariés. Cette disposition vise à faciliter l'entrée d'investisseurs tiers au capital de la SCOP. Les salariés conserveront 65 % des droits de vote sans pour autant être majoritaires au capital, pour une durée qu'il nous reste à définir ensemble.
Pour les salariés, détenir la majorité du capital représente un véritable défi, qu'il leur est parfois impossible de relever. Nous voulons donc, pour les aider, leur permettre de détenir la majorité des droits de vote sans pour autant être majoritaires au capital, par l'entremise d'une dérogation nécessairement temporaire, de façon à ne pas remettre en cause le principe et la philosophie mêmes des SCOP. Durant le court laps de temps dans lequel la dérogation prendra place, les excédents, venant alimenter le capital, permettront aux sociétaires de détenir la majorité des droits de vote comme du capital. Ce sera une des propositions importantes contenues dans le projet de loi que nous vous soumettrons au printemps prochain.
Par ailleurs, nous allons mener un audit des pratiques de cessions d'entreprises dans le cadre de la justice commerciale. La Chancellerie s'y livrera, de manière à rendre les procédures plus efficaces et à mieux connaître les conditions de cessions des entreprises, une fois celles-ci passées par le tribunal de commerce. Il permettra également d'améliorer l'information des salariés, et portera sur les outils d'analyse financière et économique, le montage du financement et l'élaboration du business plan nécessaire à la reprise.
J'ajoute que, naturellement, la Banque publique d'investissement leur sera en partie – en partie seulement ! – dédiée.
Nous réfléchirons également aux dispositifs fiscaux applicables aux SCOP. Nous avons ainsi veiller à ce que, au sein de la loi de finances rectificative pour 2012, la hausse du forfait social pour l'intéressement et la participation ne concerne pas les coopératives, et notamment les SCOP. De même, le régime fiscal lié à la provision pour investissement, propre aux SCOP, a été préservé. Les taux sont en effet restés les mêmes, à 8 %, là où le forfait social pour la participation est passé à 20 % pour l'ensemble de l'économie dite « classique ». La volonté de ce gouvernement, actée par la loi de finances rectificative, est donc bien de favoriser le modèle coopératif, et notamment celui des SCOP.
Telles sont donc les informations que je tenais à vous livrer à propos des SCOP. Je vois que j'ai largement dépassé le temps qui m'était imparti !
Je tiens néanmoins à insister sur le fait que nous allons développer les coopératives d'activité et d'emploi, les CAE. Nous devrons notamment répondre au problème d'insécurité juridique qui les frappe.
En effet, vous n'êtes pas sans savoir que le salarié d'une CAE est économiquement et professionnellement autonome. Il est son propre employeur, puisqu'il crée son propre emploi. Cela occasionne des situations d'insécurité juridique puisque, par conséquent, le lien de subordination n'est pas vérifié, l'obligation pour l'employeur de fournir du travail au salarié n'est pas satisfaite dans la mesure où le porteur de projet crée lui-même sa propre activité, la rémunération du salarié est fonction non pas du temps travaillé mais du chiffre d'affaires qu'il dégage, et les charges sociales patronales pèsent sur le salarié au titre de son activité.
Il s'ensuit un risque permanent de requalification de ces contrats et de condamnation pour fraudes fiscale et sociale, face auquel nous ont alerté les CAE. Il convient d'y mettre fin. C'est ce que nous allons essayer de faire dans le cadre du prochain projet de loi. Nous allons également tenter de mieux adapter les dispositifs existants – l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise, l'ACCRE, le nouvel accompagnement pour la création et la reprise d'entreprise, le NACRE – pour qu'ils correspondent mieux à la réalité des CAE, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Un travail important reste donc à faire sur l'environnement juridique et sur les conditions dans lesquelles les CAE peuvent bénéficier des dispositifs d'aide à la reprise d'entreprise ou à la création d'activités pour les chômeurs, qui ne sont pas très adaptés à leur statut spécifique.
Je terminerai mon intervention en vous disant que nous voulons élargir le principe coopératif à de nouveaux secteurs d'activité. C'est le cas d'un domaine dans lequel le Sénat a été particulièrement en pointe : les coopératives d'habitants.
En la matière, le Sénat a un temps d'avance sur l'Assemblée nationale comme sur beaucoup d'autres acteurs. Dans un texte d'origine sénatoriale, la Haute Assemblée a en effet déjà formulé quelques propositions en ce sens.
Nous considérons que les coopératives d'habitants présentent une multitude d'atouts. Elles permettent, tout d'abord, la sortie du logement du marché spéculatif. La valeur des parts sociales du logement étant définie à l'avance, les logements sortent du marché spéculatif et les prix restent encadrés.
La coopérative permet, de surcroît, d'accéder à un logement d'autant plus adapté aux besoins du locataire que ce dernier a participé à sa conception.
La coopérative d'habitants autorise, en outre, la mise en commun d'espaces et de services – salle polyvalente, salle commune, buanderie – pour favoriser l'entraide, la vie sociale et les solidarités de voisinage, ce qui apporte une vraie réponse à l'individualisme et à l'isolement.
L'implication des coopérateurs, les efforts de mutualisation des moyens et des espaces permettent d'éviter les intermédiaires et d'offrir, ainsi, des loyers inférieurs aux prix du marché.
Enfin, la construction ou la rénovation de ce type d'habitat prend souvent en compte les besoins des habitants, couplés avec le respect de critères écologiques. Le choix des matériaux, la conception du bâtiment sont beaucoup plus conformes à nos souhaits visant à développer un habitat respectueux des exigences du développement durable, économe en énergie et fonctionnant grâce aux énergies renouvelables.
Tous ces avantages nous poussent à vouloir créer un statut de coopérative d'habitants, qui intégrera largement les propositions et travaux du Sénat.
Voilà ce que, à gros traits, je tenais à vous dire, mesdames, messieurs les sénateurs, sur les propositions qui pourront figurer dans le prochain projet de loi sur l'économie sociale et solidaire, et notamment sur le renouveau du monde coopératif.
Ce projet de loi sera important, car il marquera la reconnaissance du secteur de l'économie sociale et solidaire, dont vous avez tous dit qu'il pesait autour de 10 % du PIB français, et embauchait 2, 3 millions de salariés.
C'est un grand rendez-vous, que les acteurs de l'économie sociale et solidaire attendent impatiemment.
Surtout, nous avons, à travers ce texte, la possibilité de construire une vraie stratégie de croissance. En effet, la croissance, ce n'est pas simplement la restauration de la compétitivité de l'économie française grâce aux capacités d'innovation de ses entreprises ou au coût du travail, questions discutées, à l'heure actuelle, dans le cadre de la conférence sociale. La stratégie de croissance de la France repose également sur la consolidation et la valorisation d'un modèle économique qui a été, je vous le rappelle, plus robuste que tous les autres en période de crise. Ce constat donne, me semble-t-il, ses lettres de noblesse à l'économie sociale et solidaire. Il nous revient donc de la valoriser et de faire en sorte qu'elle contribue, demain, à la création d'activités, d'emplois, et au service de l'intérêt général, ce qui constitue sa principale valeur ajoutée.
Je vous donne donc rendez-vous au printemps prochain, lors de l'examen de ce projet de loi.
J'imagine, cependant, que nous aurons l'occasion de nous revoir d'ici là, notamment sur les sujets liés à la consommation, autre compartiment de mon portefeuille dans lequel le Sénat est en pointe.
En tout état de cause, je vous donne rendez-vous pour construire, au printemps prochain, une vraie politique publique de l'économie sociale et solidaire. Je peux vous assurer que, d'ores et déjà, les travaux du Sénat irriguent et structurent ce que sera le projet de loi qui vous sera alors présenté. §

Nous en avons terminé avec le débat sur l'économie sociale et solidaire.

Au cours de sa réunion de ce jour, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a demandé que le projet de loi autorisant la ratification de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail soit examiné selon la procédure simplifiée, le mardi 9 octobre prochain.
Le délai pour revenir, le cas échéant, à la procédure normale pourrait être fixé au vendredi 5 octobre, à 17 heures.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq,

L'ordre du jour appelle le débat sur l'application de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (demande de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois) (rapport d'information n° 572, 2011-2012).
La parole est à M. le président de la commission sénatoriale.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, presque quatre ans après le dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, nous sommes amenés à parler de la loi qui en est issue pour contrôler son application.
La caractéristique majeure de ce texte est qu'il a fait couler une mer d'encre avant, pendant et après son adoption ! On a ainsi vu s'affronter ou, à tout le moins, débattre, d'une part, ceux qui prétendaient que la suppression de la publicité sur France Télévisions allait libérer le groupe d'une aliénation commerciale et, d'autre part, ceux qui considéraient que le groupe France Télévisions allait en sortir extrêmement fragilisé et qu'il se retrouverait en difficulté pour mener à bien les missions de service public qu'il remplissait de mieux en mieux.
Aujourd'hui, je puis vous dire que tout ce qui s'est passé avait été prédit et annoncé ; il suffit de relire les débats pour s'en rendre compte. Il n'en reste pas moins que tout ce qui a été annoncé ne s'est pas forcément déroulé comme prévu, et que le devoir de procéder à une analyse précise nous incombait.
Je suis donc particulièrement satisfait, en tant que président de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois, qu'un rapport exhaustif ait pu être publié sur cette question et qu'un débat soit organisé aujourd'hui dans l'hémicycle pour voir ensemble les conclusions que nous pouvons en tirer.
Concernant la question de la méthodologie, je me félicite que deux rapporteurs représentant la majorité et l'opposition aient pu élaborer un rapport commun et nuancé. Certes, vous pourrez le constater, nos analyses peuvent diverger, mais M. Legendre et moi-même sommes parvenus à donner à chacun les outils nécessaires pour avoir une opinion éclairée sur le bilan d'application de la loi.
À ce stade du débat, il n'est pas inutile de faire un bref rappel historique de cette loi-surprise, qui ne résultait ni d'un engagement de campagne ni d'une réflexion approfondie.
Cette loi a sans doute été pensée quelques jours avant le 8 janvier 2008 par un conseiller du Président de la République, qui a annoncé ce jour-là, à la surprise générale – on dit même que le Premier ministre n'était pas au courant ! –, la suppression de la publicité sur France Télévisions.
Après cette déclaration initiale, le projet a été mené au pas de charge.
Trois mois plus tard, la commission dite « Copé » a été mise en place et a lancé la concertation.
Trois mois plus tard encore, la polémique s'engageait, car la commission Copé butait sur le mode de financement de la suppression de la publicité, qui était déjà érigée en un dogme intangible et incontestable, le maintien en l'état de la redevance en étant un autre. M. Copé disait : « Moi vivant, la redevance n'augmentera pas ! » Vous l'avez remarqué, M. Copé est toujours vivant et la redevance a augmenté un peu ! Certains membres de ladite commission, dont moi-même, ont démissionné.
Trois mois plus tard enfin, nouvelle surprise : le projet de loi adopté en conseil des ministres prévoyait que les présidents de l'audiovisuel public seraient nommés par le Président de la République. Là encore, on était loin des débats de la commission Copé et des idées qui avaient émergées, parfois très intéressantes, en tous les cas sur toutes les questions de fond.
Un peu moins d'un an après le discours du Président, la publicité était supprimée – au moins en journée sur les antennes de France Télévisions –, alors même que la loi n'était pas encore votée !
Trois mois plus tard, la loi a été promulguée après plus d'une centaine d'heures de débats parlementaires.
Ce n'est cependant pas seulement parce que cette loi est née de manière improbable et dans des conditions aussi difficiles que ses conséquences sont néfastes ou que son bilan est négatif.
Ce n'est pas non plus parce que M. Legendre et moi-même avons été des acteurs importants de la discussion, forcément subjectifs, que nous avons abandonné l'idée de produire un rapport de vérité sur le sujet.
Le bilan est, je le crois, précis et le plus factuel possible.
Afin de mesurer la pertinence de la mise en œuvre de la loi, nous avons mené un travail d'archéologie, en étudiant et en reconstituant l'histoire de celle-ci, qui va de l'annonce aux réalisations concrètes auxquelles elle a donné lieu, en passant par sa conception et son examen. Nous avons jugé les effets constatés de la loi non pas à l'aune de notre avis sur le projet de loi, ni au vu du contexte actuel, mais bien au regard des intentions et des souhaits exprimés initialement.
C'est donc un rapport détaillé, précis et balancé que la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois a adopté.
Si je me suis abstenu d'émettre une quelconque opinion au moment de rendre le rapport sur les modifications à apporter à la loi, estimant que cette méthode permettrait de neutraliser les jugements portés, il n'en sera pas de même aujourd'hui : l'heure a sonné, il convient de tirer des conclusions et d'apporter des réponses, que j'évoquerai à la fin de mon propos.
À quelle conclusion sommes-nous parvenus l'été dernier ?
Il nous est apparu, trois ans après son adoption, que le bilan de la mise en œuvre de cette loi est très mitigé. Il ne l'est pas au sens où toutes les dispositions qu'il contient auraient moyennement atteint leurs objectifs. Au contraire, la mise en œuvre de certaines mesures a été particulièrement efficace et pertinente ; je pense notamment à la modernisation des règles applicables à l'ensemble des médias audiovisuels.
En revanche, d'autres dispositions n'ont absolument pas atteint l'objectif recherché, certaines d'entre elles ayant même été totalement contre-productives.
La réforme de l'audiovisuel public a ainsi peiné – c'est un euphémisme – à être mise en œuvre et a largement fragilisé le groupe France Télévisions.
Parlons tout d'abord de la mesure phare : la suppression de la publicité.
Cette mesure avait été présentée comme étant emblématique de l'ambition du Président de la République d'alors pour la télévision publique. Or elle est, à mon sens, emblématique de son échec.
La suppression de la publicité en journée a été rapide, tellement rapide qu'elle est intervenue avant l'adoption de la loi. D'ailleurs, cette décision a été a posteriori jugée illégale par le Conseil d'État.
Comme vous le savez, la suppression de la publicité en soirée aurait dû intervenir à la fin de l'année 2011. Or elle n'a pas eu lieu pour des raisons de financement. L'actuel gouvernement devra d'ailleurs régler cette question pendante : à un moment donné, il faut trancher !
En outre, quelle a été la conséquence de la suppression de la publicité ?
On était supposé assister à la fin « de la dictature de l'audience », ce qui impliquait qu'il y en avait une auparavant et que la réforme allait changer en profondeur le modèle culturel de France Télévisions.
La vérité est que les programmes n'ont pas changé de nature, et ce pour trois raisons.
Premièrement, le cahier des charges est resté très peu contraignant.
Deuxièmement, les yeux des dirigeants sont restés rivés sur la courbe d'audience. Quand un groupe dépense 2, 5 milliards d'euros pour ses programmes, on peut comprendre qu'il souhaite avoir des téléspectateurs. Toutefois, il n'en demeure pas moins que l'objectif initial était tout autre.
Troisièmement, enfin, il est objectivement difficile d'allier programmes exigeants et audience forte. À cet égard, la suppression de la série « Chez Maupassant » nous a surpris, monsieur Legendre et moi-même, …

… dans la mesure où elle faisait partie de ces programmes rares qui réussissaient à concilier ces deux exigences.
Dans le domaine de l'information politique, reconnaissons, en revanche, l'engagement pertinent et réussi de France Télévisions en faveur d'un renforcement de l'offre de programmes. À l'époque, rappelez-vous, il n'y avait plus d'émissions politiques. Certes, la campagne électorale y a peut-être été pour quelque chose, mais force est de constater que, dans le paysage audiovisuel, c'est France Télévisions qui a assumé cette tâche. Je ne souhaite pas juger les émissions ni me constituer en énième programmateur de France Télévisions – tel n'est pas mon rôle ; je suis là pour légiférer –, mais je considère, au vu des rapports relatifs à l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens depuis 2011, que, globalement, France Télévisions n'a pas changé fondamentalement de couleur, alors que la réforme l'envisageait avec enthousiasme.
À cet égard, on doit se poser la question de la capacité du législateur à influencer réellement la programmation culturelle et celle de sa légitimité pour le faire.
Le rôle de la commission que j'ai l'honneur de présider est aussi, parfois, de souligner les limites de l'action du législateur. Dans le cas de la programmation télévisuelle, les interrogations peuvent être fortes.
De ce point de vue, la question de l'heure de début des programmes est tout à fait symbolique.
France Télévisions n'a pas respecté la règle de 20 heures 35 fixée par le cahier des charges et invoquée de manière incantatoire par l'ancienne majorité pour justifier la réforme. Les programmes commenceraient plus tôt, disait-on, de sorte qu'il y aurait désormais deux tranches de programmes, alors que, dans les grilles des autres chaînes, les programmes du soir commençaient à 21 heures.
Le groupe a enfreint cette règle en conscience, parce qu'il a considéré que, non pertinente pour le téléspectateur, elle était en outre contre-productive pour son audience. Il assume pleinement ce choix cette année en ne respectant même plus le décret.
Indépendamment du jugement que l'on peut porter sur le fait que France Télévisions ait pris cette liberté, la question se pose : jusqu'à quel point peut-on lui imposer ce type de règles par la loi ?
Le rôle du législateur n'est-il pas plutôt de fixer les grands principes et de s'en remettre à des personnes responsables pour leur mise en œuvre ?
Ne vaut-il pas mieux prévoir un mode de nomination efficace – j'y reviendrai –, qui permette de désigner des personnalités compétentes, lesquelles seront jugées sur pièces, sur la réussite de leur action ? C'est cela qui est nécessaire.
Mais revenons à la suppression de la publicité. Ce n'est pas qu'elle ait été sans effet ; elle a bien eu des conséquences, mais très dommageables.
D'abord, elle a changé le modèle économique de France Télévisions. D'un diptyque composé de la redevance et de la publicité, qui garantissait l'indépendance du groupe à l'égard du commerce comme de l'État, ce modèle est devenu un triptyque formé d'une dotation publique, de la publicité et d'une dotation budgétaire. Or ce nouveau modèle de financement s'est révélé beaucoup plus fragile.
En effet, la dotation budgétaire a été chaque année diminuée en exécution. Le fameux contrat d'objectifs et de moyens n'a pas joué son effet bouclier et la dotation promise pour 2012 a déjà été largement rabotée. Cette situation n'est bonne ni pour l'indépendance de France Télévisions ni pour son équilibre économique.
Lors du débat sur la loi du 5 mars 2009, j'ai dit dans cet hémicycle, avec beaucoup d'autres, que si France Télévisions dépendait entièrement de la dotation publique, lorsque l'État aurait moins de moyens, le problème se poserait de la réduction de cette dotation et, par conséquent, de la fragilisation du groupe.
Peut-être même nous proposerait-on, en pareille situation, de réduire le périmètre de France Télévisions ? Cela, nous nous refusions tous à l'envisager.
Nous y sommes aujourd'hui. Sans anticiper le débat que nous aurons bientôt sur budget, je veux dire que France Télévisions est dans une situation d'asphyxie et que l'État, compte tenu de ses propres problèmes, ne pourra pas, sans de grandes difficultés, justifier le maintien de sa dotation au même niveau.
La suppression de la publicité a produit un deuxième effet, qui concerne les caisses de l'État.
Le financement de la réforme par la mise en place de nouvelles taxes a été un échec. Alors qu'on attendait 450 millions d'euros de recettes, on a levé seulement 270 millions d'euros.
La suppression de la publicité représente donc un coût net de 180 millions d'euros par an, alors même que la publicité a finalement été maintenue en journée, contrairement à ce qui était prévu !
En quatre ans, la réforme a eu un coût de 628 millions d'euros pour l'État. Cette somme, auparavant fournie par la publicité, aurait à mon sens été mieux employée au profit de nombreux programmes culturels qui en auraient bien eu besoin – je ne voudrais pas qu'elle ait servi à autre chose.
Pis : la taxe télécoms, qui est la plus rentable pour l'État puisqu'elle rapporte environ 350 millions d'euros par an, est contestée à Bruxelles. Le verdict tombera au cours du premier semestre de l'année prochaine.
Si cette taxe était déclarée incompatible avec le droit de l'Union européenne, nous aurions besoin de trouver 350 millions d'euros supplémentaires chaque année. De plus, il faudrait rembourser environ 1 milliard d'euros aux opérateurs, s'ils en faisaient la demande. Terrible perspective !
En pareille hypothèse, le bilan de la loi, que j'ai jugé tout à l'heure mitigé pour accepter une expression commune avec M. Legendre, deviendrait franchement catastrophique !
Ainsi, la loi qui ambitionnait de révolutionner le modèle culturel et le modèle financier de France Télévisions a profondément miné le second sans améliorer le premier.
J'en viens à la question de l'entreprise unique, dont la création était l'autre grande ambition de la loi du 5 mars 2009.
Sur ce point, il me semble que le bilan doit être relativisé au vu de la lourdeur de la mission. Le problème de cette réforme est que le traitement n'a pas encore eu d'effets positifs mais que les effets secondaires, en revanche, ont été rapides et assez visibles.
Parmi les effets secondaires figurent les multiples changements d'organigrammes que le projet d'entreprise unique a provoqués et qui ont désorganisé le groupe pendant quatre ans. Les questions relatives à la rédaction de France Télévisions sont aujourd'hui une conséquence directe de cette désorganisation.
Par ailleurs, la remise en cause des accords collectifs a eu pour conséquence de focaliser l'ensemble des débats sur le dialogue social, au détriment des enjeux culturels qui étaient pourtant au cœur de la réforme.
On pourrait dresser exactement le même constat pour l'audiovisuel extérieur de la France, qui se trouve dans une situation très compliquée que nous connaissons tous.
À cet égard la publication très tardive du cahier des charges de la société AEF n'a pas franchement facilité un projet déjà très mal engagé. Sans parler du contrat d'objectifs et de moyens, obligatoire selon la loi et qui n'est jamais sorti…
Reconnaissons néanmoins quelques effets positifs au projet d'entreprise unique.
D'abord, si les synergies n'ont pas encore été complètement réalisées, la Cour des comptes estime qu'elles produiront inévitablement des effets dans les prochaines années. Qui sait ? Nous ferons un nouveau bilan le moment venu.
Ensuite, les inquiétudes sur la question dite du guichet unique ont été levées ; c'est toujours un progrès, qu'il faut mettre à l'actif de l'actuelle direction.
En outre, le média global a été lancé. On ne sait pas si c'est la conséquence de la mise en place de l'entreprise unique ou d'une prise de conscience du groupe, mais c'est un fait et cela fonctionne. Malheureusement, les moyens manquent – nous savons pourquoi.
Enfin, la création d'un conseil d'administration unique, dont je ne juge pas l'action quotidienne, a amélioré la gouvernance de l'entreprise et l'a rendue plus rationnelle.
S'agissant de la gouvernance, nous avons aussi souhaité évoquer la question du mode de nomination des présidents de l'audiovisuel public, dont le changement était inscrit dans la loi.
Il faut bien constater que le mode de nomination de ces présidents, quels que soient leur professionnalisme et leur indépendance, a handicapé leur action, parce qu'il a fait naître un soupçon, une suspicion, un doute, sur chacun de leurs faits et gestes importants.
La mise sous surveillance du pouvoir politique par l'opinion publique a été le seul frein à un interventionnisme qui, s'il avait eu libre cours, aurait pu être de grande ampleur. Mais le mal était fait et la crédibilité du groupe entamée.
Mes chers collègues, les mois et les années à venir seront très difficiles pour France Télévisions, en grande partie à cause de sa fragilisation par une réforme complexe et coûteuse.
L'impasse budgétaire dans laquelle se trouve le groupe justifie qu'on s'attache à définir des solutions de court et de moyen terme.
Au-delà du maintien nécessaire de la publicité en soirée, dont je proposerai d'inscrire le principe dans la loi, le rétablissement de la publicité en soirée sera forcément à l'ordre du jour si l'Europe nous condamne et qu'il nous faut trouver les 350 millions d'euros dont j'ai parlé. Je n'en dis pas plus pour le moment ; ce débat est devant nous.
Il reste que le marché publicitaire n'est pas le même aujourd'hui qu'en 2009 et que l'introduction inopportune de six nouvelles chaînes sur la télévision numérique terrestre à partir du mois de décembre ne favorisera pas le dynamisme des recettes publicitaires.
C'est d'autant plus vrai que même les groupes privés, comme TF1 ou M6, sont aujourd'hui en grande difficulté. La manne publicitaire ne peut pas se démultiplier, ce poste étant assez fixe dans les budgets des entreprises.
J'ai parlé tout à l'heure des deux jambes sur lequel repose le financement de France Télévisions : la publicité et la contribution à l'audiovisuel public. C'est évidemment sur cette seconde recette qu'il faut jouer.
La contribution à l'audiovisuel public est déjà indexée sur l'inflation. Le Gouvernement a apporté pour l'année 2013 une réponse qui, à mon avis, va dans le bon sens : il a proposé une hausse de 2 euros de cette contribution.
La décision d'augmenter la contribution à l'audiovisuel public est courageuse et le Sénat l'a toujours souhaitée : j'espère que la commission des affaires culturelles, gauche et droite confondues, continuera de juger cette mesure positive.

M. David Assouline, président de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois. Et le centre aussi !
Sourires.

Il reste qu'à moyen terme cette augmentation ne suffira pas à compenser la suppression brutale de la publicité en 2009.
Je propose donc que le rétablissement des résidences secondaires dans l'assiette de la redevance soit envisagé.
M. André Gattolin applaudit.

Non pas forcément pour le mettre en œuvre immédiatement, ce qui serait un peu rapide, mais pour programmer dans le projet de loi de finances pour 2013 son entrée en vigueur en 2014, ce qui laisserait aux services de l'État le temps de s'organiser.
Cette proposition sera probablement examinée au cours du prochain débat budgétaire.
Quant à la nomination des présidents de l'audiovisuel public, vous connaissez ma position : il faut qu'une instance totalement indépendante en soit chargée. Ce sera le chantier audiovisuel du printemps prochain.
Je veux conclure sur une note positive. La modernisation des règles relatives à l'ensemble des médias audiovisuels avait une ambition limitée, mais elle constituait une partie importante de la loi du 5 mars 2009. À cet égard, les décrets ont été pris rapidement, les objectifs atteints et l'esprit du législateur bien souvent respecté.
Je crois, au vu du bilan global, que ces dispositions auraient dû former le cœur de la loi audiovisuelle de la précédente législature.
Le seul décret qui n'a pas été pris à ce jour concerne le comité de suivi de la loi. Compte tenu du bilan que je viens de dresser, on peut comprendre pourquoi…
Mais l'absence de ce comité a été compensée par le travail de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois, que je préside, et elle rend d'autant plus utile le débat de ce soir !
Je considère que le débat est bien lancé. Mon collègue Jacques Legendre va maintenant poursuivre la présentation de notre rapport.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste. – M. Jean-Pierre Plancade applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois, mes chers collègues, vous ne serez guère surpris que je ne partage pas bon nombre des analyses de mon collègue et corapporteur David Assouline.
Sur bien des mesures, il fait un constat en demi-teinte ; considérant pour ma part le verre à moitié plein, je considère que le bilan de la loi du 5 mars 2009 est positif.
À titre liminaire, je souhaite apporter deux précisions méthodologiques qui me paraissent essentielles.
D'une part, l'analyse exhaustive d'une loi nous conduit et conduira l'ensemble de nos collègues de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois à mettre en relief un bilan incomplet.
La première raison en est que, dans l'enthousiasme des débats, on place toujours beaucoup d'espoirs dans l'adoption de mesures qui, sur le terrain, se heurtent forcément à des difficultés.
La deuxième raison est que, comme on parle davantage des trains qui arrivent en retard que de ceux qui arrivent à l'heure, les dispositions qui peinent à être mises en œuvre, systématiquement mentionnées dans les auditions ou les commentaires, sont naturellement celles que l'on met en relief.
D'autre part, cet effet structurel s'est, selon moi, fortement renforcé d'un biais conjoncturel dans la rédaction de ce rapport.
En effet, il se trouve que les deux rapporteurs du bilan d'application de la loi du 5 mars 2009 ont été deux des principaux acteurs de sa discussion parlementaire.
Il a donc forcément été difficile, tant pour l'un que pour l'autre, de prendre le recul nécessaire pour analyser de manière apaisée et sereine l'application d'une loi que l'un a férocement contestée et l'autre pleinement soutenue…
Néanmoins, et en dépit de ces difficultés méthodologiques, nous avons essayé de dresser un bilan objectif et exhaustif de l'application de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.
J'espère qu'à travers des lectures contrastées, voire contradictoires, d'un même bilan, l'ensemble de nos collègues pourront se faire une opinion étayée par des analyses et des faits précis ; c'est du moins la raison d'être de ce débat.
J'estime, tout d'abord, que l'application de la loi au sens strict doit être appréciée de manière positive.
Aujourd'hui, en effet, douze décrets ont été pris sur les treize requis. Le précédent gouvernement a donc fait un réel effort d'application dans des délais très raisonnables.
S'agissant du seul décret qui n'a pas été pris, relatif au comité de suivi de la loi, le précédent gouvernement a apporté des réponses précises et argumentées sur son choix assumé de ne pas le publier : la conformité de certaines dispositions de la loi au droit de l'Union européenne était selon lui à ce prix.
En outre, je considère que le travail que nous avons mené, David Assouline et moi-même, est la meilleure réponse à l'absence de comité de suivi. Libre enfin à l'actuel Gouvernement de le mettre en place – il n'est pas trop tard ! –quand vous estimerez, et je le comprendrai tout à fait, qu'il est opportun de le faire.
Les trois ordonnances prévues ont également été adoptées dans l'année suivant l'adoption de la loi. Enfin, la quasi-intégralité des rapports demandés ont également été rendus. On permettra à la représentation nationale d'y être évidemment sensible.
Bref, le service « après-loi » a été rapide et efficace. Après tout, on ne peut pas toujours en dire autant ; il est donc bon de le souligner.
Je commenterai ensuite à la fois l'application de la réforme de l'audiovisuel public, qui faisait l'objet de la première partie de la loi, et les dispositions sur l'évolution du paysage audiovisuel français.
S'agissant de la suppression de la publicité, mes commentaires seront beaucoup plus modérés que ceux de mon collègue. Je note, en effet, que son impact sur le visage éditorial de France Télévisions n'a pas été majeur. Admettons-le, la suppression de la publicité n'a pas suffisamment permis jusqu'ici de relativiser la contrainte d'audience et de modifier la programmation en profondeur. Force est de penser que la culture de l'audimat imprègne si fortement les esprits des dirigeants de l'audiovisuel public que la suppression de la contrainte publicitaire ne suffit pas à infléchir ce tropisme.
Est-ce pour autant qu'il fallait y renoncer ? Nous sommes nombreux sur ces travées, j'en suis sûr, à dire que le « qualimat » nous paraît beaucoup plus important que l'audimat ! Voilà bien ce que nous attendons des dirigeants de nos chaînes de télévision.
Je tire cependant de la situation actuelle les conclusions suivantes.
Certes, les programmes ne débutent pas à vingt heures trente-cinq, mais, grâce à la loi, ils commencent bien plus tôt que sur les chaînes privées. Selon moi, il s'agit d'un atout majeur et il ne faut pas revenir en arrière.
Le confort de vision est largement amélioré. Le sondage réalisé à la demande de l'Assemblée nationale, abondamment cité dans le rapport, montre que les téléspectateurs sont, pour une grande majorité, pleinement satisfaits de cette suppression de la publicité en soirée. Pour faire court, la réforme a suscité l'adhésion du public, même si l'on a pu constater parfois des dérives avec un parrainage parfaitement ambigu.
Il s'agit, en outre, d'un élément très fort de différenciation avec l'offre télévisuelle privée, ce qui légitime à mes yeux pleinement la réforme. Regardez la télévision publique au Royaume-Uni ; vous constaterez que l'absence de publicité constitue un atout de programmation et de différenciation très puissant.
L'engagement de France Télévisions en faveur de la création, corollaire de la loi, à hauteur de 420 millions d'euros en 2012 est, enfin, un atout majeur de promotion de la culture française. L'ensemble des acteurs l'a reconnu et a insisté sur cet aspect. Je crois que l'on n'en parle pas assez, les engagements du groupe en faveur de la création n'ont jamais été si importants.
Les effets seront constatés à moyen terme, car créer une politique ambitieuse de fiction et de documentaire, c'est long ! Notre rapport arrive trop tôt pour qu'un jugement soit porté sur ce point. Mais donnons à France Télévisions le temps de la stabilité et de la confiance, et je suis certain que les résultats seront au rendez-vous.
À cet égard, la suppression de la contrainte publicitaire mettra du temps à marquer les esprits en dépit de la modification subséquente du cahier des charges. Mais je suis convaincu que des résultats positifs sont déjà à l'œuvre. Je suis d'autant plus optimiste que la suppression de la publicité ne peut que favoriser ce que nous attendons, à savoir de l'audace et de l'ambition.
En outre, fondamentalement, la qualité ne rime pas avec une baisse d'audience. La télévision populaire de qualité est donc un objectif à la mesure du groupe. Une émission – allez, je vais en citer une ! – comme Secrets d'histoire, présentée cet été, en était un bon exemple.
Enfin, je regrette que, pour des raisons économiques, le report de la suppression totale de la publicité ait été nécessaire. Mais je me félicite, en revanche, que ce report ait été rendu possible par la stratégie consistant à mettre en œuvre la suppression de la publicité en deux étapes. Cela a été une grande force de cette loi que de laisser la place à l'expérimentation et à la prudence. Après tout, on ne fait pas toujours appel à l'expérimentation dans les actions de réforme. Ici, au contraire, l'expérimentation est à l'ordre du jour. C'est une leçon qu'il faudra probablement retenir pour l'avenir.
Je ferai un constat un peu similaire sur le parrainage. Son maintien après vingt heures était une erreur, j'en suis convaincu, car je pense qu'il ne doit pas y avoir de publicité du tout en soirée sur France Télévisions, quelle que soit sa forme.
France Télévisions a entendu cette critique et a compris que l'esprit de la loi devait parfois prendre le pas sur sa lettre. Elle nous a donc proposé d'établir une charte sur le parrainage assez efficace, garantissant son utilisation raisonnée. J'espère qu'une suppression pourra advenir quand les temps seront meilleurs. On comprend bien que tout ne peut pas être fait en même temps.
Sur la question de l'entreprise unique, la loi était forcément brève. Il s'agissait surtout de la mettre en œuvre. Et, comme l'ont souligné les commissaires aux comptes de France Télévisions que nous avons auditionnés, cette œuvre est tout bonnement gigantesque. Une telle fusion est extrêmement rare dans le paysage industriel français, avec 11 000 salariés à réunir sous une bannière unique. Le constat qu'ils font est que la fusion poursuit sa route dans de bonnes conditions.
Je tiens au demeurant à souligner que sa légitimité n'a jamais été contestée, pas plus par l'opposition de l'époque que par la majorité d'aujourd'hui. Si la mission est de longue haleine, elle est donc à la fois utile et nécessaire. Je remarque à cet égard que cette fusion a été accompagnée financièrement de manière substantielle : les crédits dédiés à France Télévisions ont ainsi augmenté régulièrement depuis 2009 avec une hausse toujours supérieure à l'inflation. Le budget qui nous est proposé pour 2013 ne sera peut-être pas – attendons la discussion – à la hauteur de l'ambition que nous avons pour l'audiovisuel public.
David Assouline a mentionné à juste titre la question de la gouvernance du groupe.

On ne peut passer sous silence la question de la nomination des présidents de l'audiovisuel public par le président de la République. Je considère quant à moi que cette mesure a effectivement mis fin à l'hypocrisie préexistante. Qui contesterait que les choix ont été plutôt de bons choix ?
La vérité est que l'existence d'un État actionnaire de l'entreprise à 100 % crée forcément des doutes sur les relations potentiellement dangereuses que la télévision publique et les politiques entretiendraient.
La vérité est aussi que France Télévisions mène ses missions en toute indépendance, et je mets au défi quiconque de projeter des images des journaux ou magazines d'information de France Télévisions particulièrement favorables à l'ancien président de la République ou à l'ancienne majorité.
En fait, ce que l'on peut souligner, c'est que les personnes qui ont été nommées sont à la fois compétentes, consensuelles et incontestées. C'est, pour ma part, le bilan simple et visible par tous que je tire de la mesure. La nomination en cours de Mme Marie-Christine Saragosse à la tête de l'Audiovisuel extérieur de la France, AEF, se fait, au demeurant, selon une procédure similaire. Nous n'avons évidemment aucun procès a priori à instruire à Mme Saragosse. Je suis certain qu'elle ne sera pas non plus contestée.
Évoquons enfin les sujets qui ne fâchent pas. Ils sont à mettre au crédit de la loi et du précédent gouvernement.
Les dispositions relatives aux services de médias audiovisuels à la demande ont permis de faire entrer la télévision de rattrapage et la vidéo à la demande à la fois dans notre corpus juridique et dans notre quotidien. Leur développement et leur succès sont aujourd'hui frappants, tant pour les services de rattrapage devenus très accessibles par nos concitoyens que s'agissant des supports de vidéos à la demande, qui ont pris des formes originales et séduisantes pour l'utilisateur.
L'accessibilité des programmes aux personnes aveugles ou malvoyantes – c'est important ! – a aussi été particulièrement renforcée. Le législateur s'y est employé avec l'adoption de cinq articles dédiés dans la loi. Il a choisi de laisser le choix des moyens au régulateur pour les chaînes privées et à l'État pour les chaînes publiques, et de l'accompagner avec une mesure incitative de valorisation de l'audiodescription dans la contribution à la création.
Cette méthode a été efficace. Dès l'année prochaine, nous pourrons avoir un programme audiodécrit par soirée sur le paysage audiovisuel français, ce qui sera une amélioration remarquable pour les personnes en situation de handicap visuel. On comprendra que, humainement, nous y soyons tous très attachés.
La question de la promotion de la diversité de la société française a été enfin particulièrement bien traitée par la loi. La volonté de promouvoir cette diversité multiple d'origine, de genre ou de catégorie socioprofessionnelle, à la fois en matière de programmation audiovisuelle et de gestion des ressources humaines des éditeurs, a conduit le législateur à introduire pas moins de cinq dispositions dans la loi, pour des résultats que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a jugé positifs dans son dernier rapport sur le sujet.
Il faut dire que l'autorité s'est, là encore, bien emparée de la loi en imposant des engagements précis aux chaînes de télévision. Une mesure cliquet notamment impose aux chaînes d'être chaque année meilleures dans le baromètre établi par l'autorité.
Si le bilan de la loi n'est pas parfait dans l'ensemble des secteurs, reconnaissons que, sur ce sujet, elle est une belle réussite qui symbolise à la fois les vertus du volontarisme législatif et l'importance des autorités d'application.
C'est au bénéfice de ces observations, reprises dans le rapport, que j'ai soutenu son adoption. J'espère que ces quelques analyses vous auront permis de constater que bien des mesures de la loi du 5 mars 2009 ont trouvé un terrain d'application favorable. Je crois même qu'elle a bien lancé la télévision de l'avenir. Mais de prochains textes sur ce sujet nous permettront certainement de dégager des voies d'amélioration. Il y a évidemment toujours des améliorations à apporter, une actualisation de la loi à faire. Je n'en attends pas moins de la présente majorité. §

Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de souligner la très grande qualité et l'importance du travail des auteurs de ce rapport concernant la loi de mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. Ce document offre notamment un éclairage très pertinent sur la situation financière actuelle de l'audiovisuel public, en particulier la fragilité de son mode de financement.
Cette insécurité provient, en premier lieu, des contestations devant la Cour de justice de l'Union européenne de la taxe sur les fournisseurs d'accès à Internet, taxe supposée initialement compenser la suppression de la publicité entre vingt heures et six heures du matin sur France Télévisions. L'invalidation éventuelle, et pour tout dire fort probable, de cette taxe censée rapporter chaque année 350 millions d'euros pourrait, selon ce rapport, coûter à l'État près de 1 milliard d'euros.
Dans ces conditions la question du financement de la réforme qui nous occupe aujourd'hui se pose cruellement. En effet, la redevance ou contribution à l'audiovisuel public, qui constitue historiquement la principale source de financement de la télévision publique, est menacée d'un déclin annoncé de son assiette fiscale telle qu'elle est définie actuellement.
À notre sens, celle-ci demeure trop étroite ; elle exclut notamment les téléviseurs des résidences secondaires à un moment, précisément, où le taux d'équipement des ménages dans ce domaine commence à régresser du fait de nouvelles pratiques qui conduisent un nombre croissant de personnes à suivre les programmes télévisuels à partir d'un terminal d'ordinateur.
En effet, si une augmentation du niveau de la contribution à l'audiovisuel public vient d'être annoncée par le Gouvernement, elle ne compensera guère plus que l'inflation et, surtout, elle n'est pas en mesure de contrebalancer la baisse des recettes de la télévision publique, notamment celle de France Télévisions, dont les recettes seront amputées de plus de 80 millions d'euros dans le prochain budget.
C'est d'autant plus vrai que le rendement d'une autre taxe destinée à pallier la suppression de la publicité, la taxe sur la publicité des chaînes privées, s'avère bien plus faible que prévu. Au lieu des 94 millions d'euros que l'État espérait récolter, ce ne sont finalement que 27 millions d'euros qui ont pu être prélevés en 2009 et des sommes encore moindres les années suivantes. La raison en est que la seconde source de revenus de la télévision publique que constitue la manne publicitaire est aujourd'hui de plus en plus incertaine.
La suppression de la publicité en soirée sur le service public n'a d'ailleurs pas eu les effets escomptés...

... sur les ressources des télévisions privées, ce qui explique pour partie le faible rendement de la taxe compensatoire qui leur était accolée.
Le contexte de crise économique que nous traversons actuellement a, en effet, des incidences fortes sur les investissements télévisuels des annonceurs.
Au premier trimestre de cette année, l'Institut de recherches et d'études publicitaires, l'IREP, évalue à 4, 2 % le recul de la publicité sur les chaînes de télévision françaises publiques et privées et projette que, sur l'ensemble de 2012, la récession sera d'environ 2 %, estimation à mon avis assez optimiste.
En matière d'investissements publicitaires, les télévisions généralistes souffrent de la concurrence croissante des chaînes de la TNT et de la montée en puissance d'Internet sur le marché publicitaire.
Dans ce contexte concurrentiel exacerbé, on peut qualifier d'irresponsable la volonté de la précédente majorité d'avoir voulu, coûte que coûte, attribuer six nouvelles autorisations de chaînes commerciales sur la TNT, dans un marché publicitaire en récession.
En résumé, la télévision publique est aujourd'hui en proie à un effet de ciseaux inquiétant qui voit ses deux principales ressources décliner assez durablement.
De fait, on peut dire que la réforme de l'audiovisuel public de 2009 a été mal menée, car conduite dans la précipitation.
Déjà, à l'époque, notre collègue Marie-Christine Blandin avait insisté sur le fait que si nous saluions le principe de la suppression partielle de la publicité sur France Télévisions, une vigilance toute particulière était de mise quant aux modes de compensation financière qui allaient être instaurés.
J'en viens à présent à la gouvernance de l'audiovisuel public.
En la matière, aucun modèle culturel n'a véritablement été défini et on ne peut pas dire que la qualité soit clairement au rendez-vous des programmes du service public.
France Télévisions souffre aujourd'hui d'une absence de véritable projet éditorial et de gestion stratégique de ses moyens et de son organisation.
Pour rationaliser son offre globale, le groupe avait opté voilà quelques années pour un principe d'horizontalité entre ses différentes chaînes, un peu sur le modèle anglo-saxon de la BBC.
L'actuelle direction a remis de la verticalité – une gestion par chaîne –, mais sans opter clairement pour l'une ou l'autre des deux solutions. Résultat : cette logique hybride d'organisation mêlant horizontalité et verticalité multiplie les centres de décisions, entraînant un manque flagrant de contrôle des coûts opérationnels de la structure.

Le service public achète beaucoup de programmes à des sociétés de production rattachées à des groupes internationaux, ce qui renchérit leurs coûts. Quand une émission est achetée à un producteur extérieur appartenant à un groupe international, la holding prend d'emblée 20 % de marge. Ensuite, la société locale prend également au moins 20 %. Le résultat, c'est que, aujourd'hui, pour nombre d'émissions achetées par France 2 et France 3, les marges extérieures des producteurs dépassent 40 % du coût de chaque émission. C'est assez insupportable !
Pendant ce temps-là, nous découvrons dans la presse qu'une fusion des rédactions de France 2 et de France 3 est soudainement envisagée et que certains n'hésitent pas à prescrire des coupes brutales dans les emplois et les moyens consacrés aux programmes régionaux de France 3.
Alors oui, dans un contexte budgétaire très difficile, des économies sont à faire au sein de France Télévisions, mais celles-ci ne se trouvent pas dans un amoindrissement des missions de service public.
Le groupe écologiste pense qu'il est temps de poser les questions de fond. Comment l'audiovisuel public peut-il se distinguer du secteur privé ? N'est-il pas temps de revenir sur l'externalisation massive de la production et de la création ?
Dans l'immédiat, commençons déjà par obliger la télévision publique à travailler uniquement avec des sociétés de production extérieures qui publient leurs comptes, ce qui présenterait l'avantage de mettre en lumière les bénéfices exorbitants de certaines de ces structures et de les remplacer par des producteurs locaux ou nationaux tout aussi efficaces et moins coûteux.
Par ailleurs, on peut craindre que, derrière le fiasco annoncé de la « taxe télécom » à Bruxelles, se profile l'annonce d'un possible retour de la publicité après vingt heures. Et là, nous disons aux tenants d'un rétablissement de la publicité : « N'en attendez pas trop ! »
Par absence de véritable projet éditorial visant à satisfaire tous les publics, France 2 et France 3 ont vu leur audience singulièrement régresser auprès de deux cibles stratégiques : les actifs de 25 à 59 ans et les femmes de moins de 50 ans.
Il s'agit là des deux principales cibles recherchées par les annonceurs. Elles composent également une large part de la population. En l'espace de trois ans, France 2 a vu son audience marchande décliner de 50 %.
Un retour de la publicité après vingt heures allégerait certes la facture, mais dans une proportion qui serait loin de représenter le même niveau de ressources d'avant la réforme de 2009.
En conclusion, nous voulons insister sur un point : la télévision publique française ne souffre pas seulement d'un sous-financement flagrant, elle souffre également d'une sous-gouvernance, car elle a été trop souvent confiée à des dirigeants – pardonnez-moi de le dire – dont les compétences restaient à démontrer.
Il est urgent, à notre sens, que les pouvoirs publics s'attachent à remédier à ces deux problèmes lors des prochaines lois qui verront le jour dans ce domaine.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame la ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la grève massive qu'ont menée aujourd'hui les salariés de l'audiovisuel public, le rassemblement qui a eu lieu cet après-midi devant notre assemblée tout comme la présence, ce soir, dans nos tribunes, de leurs représentants syndicaux illustrent bien l'enjeu du bilan que nous avons à tirer de la réforme de 2009.
Ce bilan intervient alors que France Télévisions vient d'informer ses salariés de la suppression de 500 nouveaux postes et qu'une baisse brutale de son budget est annoncée par le Gouvernement.
Les effets cumulés de ce bilan et de ces annonces peuvent s'avérer désastreux, voire entraîner des ruptures pour l'avenir de France Télévisions. La situation est donc particulièrement inquiétante et les salariés viennent à juste titre de tirer le signal d'alarme.
En réalité, la loi de 2009 a mis en péril le service public de l'audiovisuel en le confrontant à une double crise : une crise économique et une crise de confiance.
La crise de confiance est notamment – mais pas seulement – le résultat du mode de désignation des présidents de l'audiovisuel public. Ceux-ci étant désormais nommés directement par l'exécutif, les liens créés avec le pouvoir politique sont devenus trop ténus pour que les décisions prises puissent échapper à cette dépendance. On le voit ces derniers jours avec l'incapacité du P-DG de France Télévisions à réagir pour défendre les moyens du service public et ses salariés, contrairement à ce qu'il disait voilà quelques jours encore. Cette incapacité est l'illustration de cette situation.
Crise de confiance, mais surtout crise de financement et de vision stratégique. Évidemment, on ne peut faire un bilan de la réforme de 2009 sans évoquer la suppression de la publicité télévisuelle, qui en était l'objectif affirmé et qui a en réalité, on le voit aujourd'hui, profondément affecté les finances de France Télévisions. À l'époque, nous avions déjà alerté sur ce point : la condition expresse devait être d'assurer des ressources pérennes alternatives.
Entendons-nous bien : nous partageons l'objectif d'une télévision publique dégagée de la contrainte marchande afin de privilégier une offre indépendante et de plus grande qualité. Mais force est de constater que les conditions de mise en œuvre de cette suppression n'ont servi en réalité qu'à fragiliser les finances de France Télévisions, sans pour autant ni modifier significativement le contenu de sa programmation ni la dégager des contraintes de l'audimat.
Le risque de déstabilisation était d'ailleurs tellement manifeste dans ces conditions que la suppression de la publicité ne s'est appliquée qu'après vingt heures. Si tel n'avait pas été le cas, la catastrophe serait déjà survenue.
S'agissant des effets sur les programmes, la suppression de la publicité ne permet pas de conclure à de véritables changements éditoriaux ni à une modification notable de la qualité des programmes. La réforme de 2009 avait d'ailleurs, et fort peu logiquement, autorisé le parrainage et les placements de produit qui envahissent la soirée, ce qui a d'autant réduit l'impact de la suppression de la publicité.
En vérité, la tyrannie de l'audience a dans les faits continué à jouer à plein.
Résultat pour France Télévisions : la réforme de 2009 a entraîné une déstabilisation financière sans gain qualitatif.
La loi de 2009 avait prévu de nouveaux dispositifs censés compenser la baisse de ressources financières consécutive à la suppression de la publicité, mais ils sont aujourd'hui tous remis en cause. Non seulement le taux de la taxe sur le chiffre d'affaires des recettes publicitaires qui a été créée et affectée à France Télévisions n'a cessé de diminuer au fil des lois de finances, passant de 3 % initialement à 0, 5 % aujourd'hui, mais encore son rendement a diminué du fait d'une conjoncture économique défavorable et de l'effondrement des recettes publicitaires.
Cela impacte donc doublement le budget de France Télévisions : le montant de la taxe est plus faible qu'escompté et celle-ci souffre de la baisse des revenus publicitaires en journée.
D'ici à la fin de l'année 2012, on estime que ce sont environ 60 millions d'euros de revenus publicitaires qui manqueront à France Télévisions.
Quant à la taxe sur les fournisseurs d'accès à Internet, également créée pour compenser la baisse des ressources publicitaires, elle est aujourd'hui ouvertement menacée par la Commission européenne, qui devrait rendre une décision au cours de l'année 2013.
La logique de concurrence aveugle véhiculée par la Commission européenne ainsi que le lobbying des fournisseurs d'accès à Internet auront malheureusement porté leurs fruits, empêchant la mise en place de mutualisations pourtant légitimes.
Il est en effet à redouter, dans ces conditions, que la Commission invalide cette taxe. Cela entraînerait un manque de 250 millions d'euros par an pour France Télévisions et l'État devrait alors rembourser au moins 1 milliard d'euros – il est même question de 1, 3 milliard d'euros pour les trois années précédentes.
Il est dit que le Gouvernement aurait provisionné cette somme ; dans le contexte budgétaire actuel, sur quels budgets ces sommes seraient-elles prélevées ?
Enfin, il était prévu que le Gouvernement compense les pertes de recettes publicitaires par l'affectation d'une dotation budgétaire annuelle d'un montant de 450 millions d'euros. Or non seulement cet engagement n'a jamais été respecté, pas même la première année au motif des « surperformances » de la régie publicitaire de France Télévisions, mais, entre 2008 et 2011, il a manqué au total 86 millions d'euros de dotations publiques promises.
L'ensemble de ces constats est pour nous sans appel. Nous ne pourrons pas sortir France Télévisions des difficultés actuelles en bricolant, a fortiori en portant par surcroît des coups de hache dans son budget. C'est à la mise en chantier urgente d'une nouvelle loi qu'il faut s'atteler au plus vite afin de remettre sur le métier une solution d'ensemble pour la pérennisation des ressources de France Télévisions. Il y va de la responsabilité de la gauche et de son ambition pour le service public de l'audiovisuel.
Au lieu de cela, comment comprendre que le Gouvernement ait annoncé ces jours-ci une diminution brutale du budget de France Télévisions qui représenterait une perte supplémentaire de 85 millions d'euros ? Si cette mesure était confirmée au cours du prochain débat budgétaire, ce serait là une baisse historique du budget de France Télévisions. Elle poserait plus que jamais la question de la survie d'un service public de la télévision performant et de qualité.
La réflexion sur les financements nouveaux ne peut donc pas, dans ces conditions, se réduire à la seule augmentation de la redevance, surtout dans le contexte fiscal que nous abordons.
La réforme de 2009 a déjà conduit, récemment, à l'annonce de la suppression au sein de France Télévisions de 500 nouveaux emplois en plus des 650 départs déjà enregistrés cette année – il paraît même que le P-DG a annoncé vouloir poursuivre dans cette voie ! –, sans compter les fins de contrats à durée déterminée et de contrats de pigistes.
La réforme de 2009 a également précipité l'annonce récente par la direction de sa volonté de fusionner les rédactions de France 3 et France 2 au détriment des missions de la première et pousse chaque jour à la mise en cause des moyens de production, singulièrement des moyens de production régionaux.
S'agissant de Radio France, si la baisse de ses moyens n'est « que » de 3 millions d'euros, les emplois ne sont pas non plus épargnés.
Dans ces conditions, nous ne pouvons être que surpris par les annonces gouvernementales. Surtout au moment où de nouveaux canaux de diffusion sont attribués aux chaînes privées, comment imaginer que la gauche porte ce type de projets pour le service public et remette à plus tard une grande et ambitieuse réforme de l'audiovisuel ?
Voulons-nous aggraver les conséquences d'une loi mal ficelée déjà en 2009 ou sortir de l'ornière à laquelle celle-ci a conduit ?
Par conséquent, c'est en reposant la question de l'ambition et des missions de service public qu'il faut indéniablement songer à dégager de nouvelles recettes pérennes pour France Télévisions et, pour les mêmes raisons, revoir le mode de désignation des présidents de l'audiovisuel public.
Des réformes fondamentales pour l'indépendance et la démocratisation des médias publics sont urgentes. Au-delà, c'est la remise en chantier de toutes les pistes de financement qui est nécessaire, le préalable étant, à nos yeux, la remise en cause immédiate des coupes budgétaires annoncées. À défaut, la confiance serait rompue avec les personnels de France Télévisions, sans lesquels aucun redressement ne sera possible.
Concernant la contribution à l'audiovisuel public, une remise à niveau reste nécessaire. Comment y parvenir ? par un élargissement aux résidences secondaires ? par l'augmentation de quatre euros déjà annoncée ? Je pose la question, car cela mérite discussion, mais, en tout état de cause, dans le contexte d'austérité actuel, toute mesure fiscale nouvelle devra intégrer des éléments de progressivité et s'inscrire dans une réforme fiscale plus globale, allant vers une réelle justice.
Alors que le taux de la redevance française est inférieur au taux européen moyen, ne pourrait-on envisager une augmentation par paliers, avec des exonérations pour les foyers les plus démunis ?
Et faut-il envisager un retour de la publicité après 20 heures ?

Il est temps de vous orienter vers votre conclusion, mon cher collègue.

Certaines organisations syndicales le proposent, faute d'autres financements. Ce n'est pas la piste que nous privilégions, vous le savez, mais la situation mérite l'examen de toutes les propositions.
En revanche, et malgré le lobbying des chaînes de télévisions privées et le contexte de réduction des ressources publicitaires, nous pensons qu'il faudrait rétablir le taux de la taxe sur les chiffres d'affaires publicitaires au niveau prévu par la loi de 2009.
Au-delà, les rapports entre France Télévisions et les producteurs privés doivent être revus en profondeur pour redonner au service public la maîtrise des droits sur ce qu'elle finance, d'autant que France Télévisions – c'est un enjeu de taille – a une obligation d'investissements de 470 millions d'euros par an dans la production télévisuelle et cinématographique, investissements qui nourrissent, de fait, les producteurs privés.
Enfin, il faut continuer à travailler sur d'autres pistes, dont la taxe sur les agrégateurs de contenus, la fameuse « taxe Google ».
Telles sont les quelques brèves, trop brèves remarques que je souhaitais formuler. Une chose est sûre, et je terminerai sur ce point, le bilan de la loi de 2009 ne laisse d'autre option qu'une refonte profonde et rapide de la loi. Des pistes sont possibles, le calendrier est urgent. Il faut que la gauche agisse !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste, du groupe écologiste et du RDSE.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il y a peu, la Cour des comptes rappelait, à propos de France Télévisions, l'exigence de « préserver l'équipe dirigeante des atermoiements et revirements qui ont affecté la stratégie de l'entreprise au cours des dernières années ». En 2010, je reprenais ces propos en conclusion du rapport d'information sur les comptes de France Télévisions établi notamment au nom de notre commission de la culture. C'était un premier bilan de la réforme, et je regrette que vous ayez omis de le mentionner, monsieur Assouline.
Or, que constate-t-on depuis quelques mois ? La presse se fait le relais de déclarations discordantes au sein du Gouvernement sur ce dossier. Retour de la publicité après 20 heures, évolution de la contribution à l'audiovisuel public : on a eu droit à plusieurs annonces contradictoires qui ont inquiété le secteur.
De quoi avons-nous besoin, en réalité ? Que l'on garde le cap, certes compatible avec les contraintes liées à la crise économique. Ce cap, pour nous, est clair : adapter le service public aux enjeux de notre temps, marqué ces dernières années par le bouleversement du paysage audiovisuel avec, notamment, l'arrivée des nouvelles chaînes de la TNT et des mutations technologiques profondes et toujours plus rapides.
Le passage en entreprise unique sur le point d'aboutir ces jours-ci, l'instauration du global media, un nouveau cahier des charges et des missions, un bouquet de chaînes pertinent libéré de la tyrannie de l'audimat via la publicité, sont autant de questions toujours d'actualité ; le réaffirmer est un préalable.
La présentation officielle du projet de loi de finances pour 2013 aura un peu clarifié la position gouvernementale. Nous en reparlerons lors de la discussion de ce texte. Une chose est sûre, cependant : c'est le premier budget de l'audiovisuel public sous une majorité de gauche depuis dix ans ; mais surtout, c'est la première fois que l'on constate une baisse des dotations à l'audiovisuel public ! Notre collègue David Assouline n'avait sans doute pas forcément cela en tête ces derniers mois...
M. le président de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois s'exclame.

Je note l'abandon du retour de la publicité après 20 heures. Tant mieux, parce que, au-delà de la question de principe, vu l'état actuel du marché publicitaire, très dépressif, non seulement cela n'aurait pas produit les effets escomptés, mais, surtout, compte tenu de l'arrivée des six chaînes supplémentaires, cela aurait encore plus bouleversé l'équilibre du marché. Rappelons que, pour 2012, les pertes publicitaires pour France Télévisions sont évaluées à 50 millions d'euros.
Le groupe centriste était, je tiens à le rappeler, défavorable à cette arrivée précoce des chaînes supplémentaires avant que le modèle économique imaginé lors de la réforme de 2009 ne soit pleinement stabilisé.
Pour en revenir à l'application de la loi proprement dite, la question qui reste posée à ce jour est d'abord celle des financements, j'ai déjà eu l'occasion de le redire lors de la discussion du dernier projet de loi de finances en proposant un moratoire sur la suppression de la publicité avant 20 heures jusqu'en 2016.
Lors de l'examen de la loi de 2009, Michel Thiollière et moi-même, en tant que corapporteurs de ce texte, nous interrogions déjà. Nous avions ainsi fait inscrire dans le texte le principe de mise en œuvre d'un comité de suivi pour venir renforcer l'expertise sur cette question. Conscients que l'évolution de l'économie du secteur et de la crise conditionnerait celle du financement du service public audiovisuel, nous voulions ce comité, composé de quatre députés et de quatre sénateurs, afin de faciliter une application cohérente de la loi.
Le décret permettant la création du comité n'est toujours pas paru. Je le regrette, car ses travaux auraient éclairé efficacement la réflexion sur les évolutions nécessaires en matière de financement.

Au Sénat, le groupe centriste a adopté une position constante depuis 2002 : un service public de qualité, avant tout financé par des fonds publics, pérennes et dynamiques, seuls garants de l'indépendance, ne venant pas grever les finances de l'État, autrement dit, un service public financé par une redevance indexée et raisonnablement réévaluée.
La question de la redevance, que j'avais proposé de rebaptiser « contribution à l'audiovisuel public », a longuement occupé nos débats. Nous avions adopté plusieurs mesures à son sujet, dont la revalorisation du montant et l'indexation sur le taux d'inflation. Nous aurions voulu, à l'époque, aller plus loin.
Encore aujourd'hui, l'évolution de la contribution à l'audiovisuel public reste l'un des sujets importants, si ce n'est le plus important, pour l'avenir de l'audiovisuel public. Les incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur le financement de France Télévisions, notamment la taxe sur les fournisseurs d'accès à internet sur laquelle nous avions émis des réserves, voire manifesté notre hostilité, mettent une fois encore l'accent sur l'insuffisante pérennisation des ressources de l'audiovisuel public.
Une chose est sûre, la contribution à l'audiovisuel public doit être renforcée. Ce renforcement doit-il passer exclusivement par une hausse, comme cela vient d'être annoncé ? Avant même de nous prononcer sur cette hausse et son montant, nous plaidons, comme je l'ai encore fait lors de l'examen du dernier projet de loi de finances, pour un élargissement de l'assiette.
Le système proposé est simple : une taxe d'habitation, une contribution à l'audiovisuel public. Le principe d'une contribution par taxe d'habitation paraît à la fois juste et simple à appliquer, avec un rendement évalué entre 200 millions et 250 millions d'euros.
Malheureusement, cet amendement n'avait pas été adopté par l'actuelle majorité sénatoriale. Mais, madame la ministre, à une époque où vous étiez encore députée, vous vous déclariez favorable, me semble-t-il, à une telle extension, donc à la proposition issue de mon rapport d'information de 2010, avec une taxation équivalente à la moitié de celle qui s'applique aux résidences principales.
Mme la ministre de la culture et de la communication opine.

Il faudra donc que cela se concrétise lors de l'examen du budget pour 2013.
Autre proposition que vous aviez reprise en juillet, madame la ministre, l'application de la contribution à l'audiovisuel public aux terminaux informatiques si ceux-ci servent de récepteurs à la place d'un écran classique. Vous avez été contredite par le ministre délégué au budget ; qu'en est-il aujourd'hui ?
Si tout le monde doit participer au redressement des comptes publics, il faut aussi que l'on mesure bien l'ampleur du chantier demandé à France Télévisions et les engagements contractés, mais surtout le calendrier imposé pour réaliser les 100 millions d'euros d'économies que vous exigez.
Des économies, une rationalisation de la gestion, cela faisait partie des objectifs à atteindre avec la constitution de l'entreprise unique. Mais n'oublions pas qu'une réforme a dans un premier temps un coût et que les économies viennent après. N'oublions pas non plus que la loi garantit la compensation intégrale de la perte des ressources publicitaires après 20 heures.
Je dirai enfin quelques mots sur la stratégie éditoriale, brièvement, compte tenu du temps qui m'est imparti.
Il est de bon ton de dire que peu de chose a changé. Indéniablement, la question de France 3 reste posée, une chaîne qui doit assumer sa vocation territoriale, mais, depuis 2010, le bouquet des chaînes a pris de la couleur, et ce sur tous les supports – nous avions réclamé cette vraie évolution. France Télévisions s'est efforcée de maintenir ses obligations en matière de production audiovisuelle, participant à plus de 60 % à la création française. Tout un secteur, et de nombreux emplois, sont concernés.
En conclusion, la trajectoire budgétaire prévue dans le plan d'affaires a été respectée, avec la priorité donnée aux programmes, comme l'exigeait la réforme. Beaucoup de chemin reste à parcourir, bien sûr, mais nous aurons d'autres rendez-vous pour en parler.
Applaudissements sur les travées de l'UCR et de l'UMP.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi de finances pour 2013, examiné en conseil des ministres, prévoit une baisse de 85 millions d'euros des ressources de France Télévisions, soit une diminution de 3, 4 %. Comme l'a souligné à juste titre M. Assouline, cette mesure avait été annoncée depuis plusieurs années.
Le débat qui nous réunit aujourd'hui nous permet de revenir sur cette loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, donc également sur son financement, qui reste son point faible.
J'en profite pour dire que j'ai lu avec beaucoup d'attention le rapport d'information de MM. Assouline et Legendre, qui est très intéressant et de grande qualité, même si nos appréciations divergent parfois. Ce travail nous permet aujourd'hui de porter un regard, certes un peu rapide –comme l'a dit M. Legendre –, sur cette question, mais nous avons tout de même pratiquement quatre ans de recul.
En 2009, on nous disait qu'il fallait réformer la gouvernance de France Télévisions, l'entreprise unique et le média global permettant de créer un modèle économique viable... J'étais et reste d'accord avec la démarche.
On nous a dit qu'on allait supprimer la publicité à partir de 20 heures, pour se soustraire au « diktat de l'audimat » et favoriser ainsi des émissions culturelles et créatives. Nous restons aussi d'accord sur ce point ; d'ailleurs, revenir sur cette mesure serait un recul. La recette publicitaire sera remplacée par une subvention de l'État… C'est là, de notre point de vue, que commence le désaccord, comme je l'avais dit à l'époque.
Qu'en est-il de tout cela ? Une télévision qui ne trouve toujours pas son modèle économique, et pour cause... Le nouveau modèle culturel qui devait s'ensuivre n'est pas au rendez-vous, et, même si, je le reconnais, cette demi-mesure constitue un progrès - je suis favorable à la suppression totale de la publicité à la télévision - elle a cependant un effet pervers sur la jeunesse qui, elle, continue à recevoir les messages publicitaires des annonceurs.
En toute franchise, quand on feuillette les programmes, France Télévisions ne se distingue parfois que très marginalement des chaînes privées.
Madame la ministre, quand va-t-on se décider, dans ce pays, à créer un service public audiovisuel de qualité, autonome et pérenne ? Tout le débat est là... On peut créer des taxes et autres dispositifs « bouts de ficelles » – le mot est un peu excessif –, cela ne fonctionnera pas.
J'en veux pour preuve les deux taxes créées par la loi de 2009, l'une sur la publicité à la télévision, l'autre sur les services de télécommunications. Les produits attendus pour la première étaient de 94 millions d'euros, alors qu'ils n'ont été en réalité que de 28 millions en 2009 et de 17 millions en 2011. Quant à l'autre taxe, elle n'a même pas été évaluée et son sort est, par ailleurs, soumis à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne ; si nous étions condamnés, cela pourrait coûter très cher au budget de l'État, qui n'en a pas vraiment besoin en ce moment.
Aujourd'hui, France Télévisions, baisse budgétaire oblige, sera conduite à poursuivre son plan de départs volontaires, qui devait s'arrêter en 2012. À lire la presse, il semblerait également que ce plan prévoie d'aller au-delà des 5 % de baisse d'effectifs prévue d'ici à 2015.
Peut-être faudrait-il envisager de maîtriser davantage les dépenses et les coûts. Quand on sait que la redevance rapporte 3, 5 milliards d'euros, ce qui représente 50 % du budget de votre ministère, madame la ministre, on se demande parfois où passe l'argent !
Peut-être faudrait-il également envisager que le service public dispose de droits plus étendus sur des programmes dont, en définitive, il assure lui-même le financement.
Enfin, cette réduction budgétaire, cette diminution des ressources, n'augure rien de bon pour la réforme de France 3. On sait que, parmi les 11 000 salariés de France Télévisions, plus de la moitié travaillent pour cette chaîne. Or il faut bien avouer que, si nous restons très attachés à la mission de service public dont la chaîne des régions est investie, le budget de 850 millions d'euros publics dont celle-ci dispose ne peut être pour autant déconnecté de toute considération d'audience, alors que le nombre des téléspectateurs de France 3 diminue régulièrement.
À ce propos, d'aucuns suggèrent que les mauvais résultats de cette chaîne ne sont peut-être pas sans lien avec des pratiques éditoriales et rédactionnelles discutables et parfois militantes.

Je le dis, madame la ministre, mandaté par mon groupe, car cette analyse est unanimement partagée par les membres du RDSE, qui, vous le savez, est pourtant pluriel. De surcroît, ce cri d'alarme s'élève dans toutes les régions, sans exception.
Vous l'aurez compris, nous appelons de nos vœux la création d'un service public audiovisuel autonome et pérenne. Or, aujourd'hui, où est le souffle de l'indépendance et de la liberté, quand la France connaît un contrôle politique aussi fort en la matière ? La situation actuelle est même choquante : de fait, le président de France Télévisions est toujours nommé par le chef de l'État.
J'ai bien entendu M. le rapporteur il y a quelques instants : nul ne remet en cause la qualité des personnalités nommées depuis quelques années. Néanmoins, le simple fait que ces responsables soient directement désignés par le Président de la République jette nécessairement la suspicion sur eux, qu'on ne veuille ou non.
Certes, comme je l'ai déjà indiqué, l'ancienne procédure avait tout au moins le mérite d'être claire : on sait qui est Pierre, Paul, Jacques, ou Jacqueline.

M. David Assouline, président de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois. Ou Rémy !
Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Reste que le nouveau mode de désignation revêt malgré tout un caractère choquant. Le président de France Télévisions est nommé par le chef de l'État lui-même, tandis que le budget dudit groupe est placé sous le contrôle du Gouvernement et d'une majorité politique, …

Ce double contrôle laisse planer un doute quant à l'indépendance du service public de l'audiovisuel.
À nos yeux, le seul moyen d'assurer l'indépendance de France Télévisions réside dans la création d'un conseil d'administration représentatif, autonome et pluraliste.
Par ailleurs, la pérennité de l'audiovisuel public ne pourra passer que par la redevance. D'aucuns ont chiffré le prix de cette indépendance : moins de 30 euros par an. Ainsi, avec moins de 3 euros supplémentaires par mois pour chaque Français assujetti, le service public audiovisuel français serait financé, sans faire appel au budget de l'État.
À ce propos, il est intéressant de noter qu'en définitive, le contribuable paye deux fois pour l'audiovisuel public : une première fois via la redevance, une seconde fois via la subvention directe de l'État. Avec la réforme que nous proposons, peut-être chacun y verrait-il un peu plus clair !
Voilà, madame la ministre, les observations que je souhaitais vous communiquer, en espérant que le projet de loi que vous préparez actuellement comblera les lacunes de la loi de 2009 et compensera ses effets négatifs, tout en affichant une grande ambition pour l'audiovisuel public français.
M. le président de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'a pplication des lois applaudit.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme le faisait remarquer M. le rapporteur à l'occasion de l'examen du rapport sur la communication audiovisuelle et le nouveau service public de la télévision, il est difficile d'examiner un texte dont la mise en application n'est pas encore achevée. De fait, il est sans doute trop tôt pour dresser un bilan précis des différents aspects de la loi du 5 mars 2009.
Toutefois, le changement de majorité place aujourd'hui entre vos mains, madame la ministre, et sous notre vigilance, la poursuite des réformes engagées par le président Nicolas Sarkozy. Il est donc utile d'établir ce point d'étape pour soulever les différents problèmes qui se posent déjà à votre gouvernement.
Vous vous souvenez sûrement, comme moi, du concert d'indignations qu'avaient soulevé les débats en 2009. Nicolas Sarkozy avait alors fait le choix de la transparence, en modernisant les conditions de nomination des présidents des sociétés nationales de programmes que sont France Télévisions, Radio France, et la holding Audiovisuel extérieur de la France, l'AEF.
Nicolas Sarkozy proposait tout simplement que le Président de la République soumette ses candidats à l'adoubement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des commissions parlementaires compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour mettre un terme au règne de l'hypocrisie, qui, comme M. le rapporteur vient de le rappeler, pesait encore sur ces nominations.
L'opposition avait alors sonné la charge pour dénoncer « une preuve de plus de l'hyper-présidence », « le fait du Prince » « dans une quasi-dictature ». Je vous épargne les images les plus fantaisistes !
Lors de la dernière campagne présidentielle, François Hollande, la main sur le cœur, avait promis que, lui Président de la République reviendrait sur ces pratiques indignes d'une démocratie moderne.

M. Pierre Charon. Je vous avoue avoir été quelque peu surpris en apprenant, par la presse, la nomination de Marie-Christine Saragosse par lui Président de la République, à la tête de l'AEF, après moult manœuvres dont les médias se sont fait l'écho. Il me semble que la démocratie moderne était plus honorée par la décision de Nicolas Sarkozy de soumettre son choix à l'approbation du Parlement !
M. le président de la commission sénatoriale pour le con trôle de l'application des lois manifeste son désaccord.

Mes chers collègues, vous conviendrez que le nuage de fumée particulièrement épais qui entoure la nomination de Mme Saragosse, dont les mérites personnels ne sont pas en cause, à la tête de l'AEF, trahit une conception assez sommaire de la démocratie parlementaire.
Par ailleurs, la réforme engagée par le gouvernement de François Fillon, visant à restructurer France Télévisions pour en améliorer le management, semble suivre, depuis quelques mois, une trajectoire pour le moins hasardeuse.
L'entreprise unique n'est toujours pas à l'ordre du jour, tandis qu'aucune direction claire ne semble fixée en termes de gestion des effectifs.
Du reste, aujourd'hui même, les salariés du groupe France Télévisions étaient en grève : ils se plaignent du manque total de concertation.
Mme Cécile Cukierman s'exclame.

Nous pourrions ne pas nous soucier face à cette inertie si les résultats du groupe étaient satisfaisants. Malheureusement, là encore, les chiffres sont inquiétants. Le 24 septembre dernier, France 3 a recueilli 2, 7 % des parts d'audience avec son programme de soirée.
Certes, l'audimat n'est peut-être pas le seul critère permettant de juger de la réussite d'une chaîne, mais vous en conviendrez, on peut légitimement douter de la pertinence de la dépense publique dans le domaine de l'audiovisuel, quand elle concerne moins de 3 % des téléspectateurs !
M. le président de la commission sénatoriale pour le con trôle de l'application des lois manifeste son scepticisme.

Bref, nous sommes placés face un management défaillant, à une audience déclinante, tandis qu'une vision stratégique pour l'avenir de notre service public de l'audiovisuel fait cruellement défaut.
Aussi, je l'avoue, je crains que le manque d'idées, mais aussi de courage, ne vous conduise à remédier à cette situation par l'augmentation de la dépense publique. À ce propos, on évoque, ici ou là, une redevance informatique ou une augmentation de la redevance audiovisuelle, dont le montant serait relevé à 140 euros.
À force de renoncements, faudra-il un jour porter la redevance à 2 000 ou 3 000 euros pour pallier le manque d'organisation et d'efficacité de l'audiovisuel public ?
Je me permets d'insister sur ce point, car c'était là un enjeu fondamental de la réforme engagée par le précédent Président de la République : pas un euro de plus de redevance !
J'espère donc, madame la ministre, que vous êtes en mesure de nous proposer d'autres pistes pour pérenniser le financement de l'audiovisuel public sans alourdir la part assumée aujourd'hui par le contribuable.

Enfin, concernant la qualité des programmes, j'admettais il y a quelques instants que l'audimat n'était pas le seul outil de mesure : c'est vrai. Néanmoins, il faut observer une certaine humilité face aux choix des Français, tout en faisant confiance à leur discernement.
Le 3 juillet dernier, la très bonne émission d'histoire que Stéphane Bern a consacrée à Louis XIV sur France 2 a recueilli plus de 21 % des parts d'audience, faisant jeu égal avec Spiderman 2, sur TF1 ! Il n'y a donc aucune fatalité en matière de culture et d'audimat.
M. le rapporteur acquiesce.

Aussi attendons-nous, madame la ministre, les éléments concrets permettant de clarifier votre politique et de placer la structure de l'audiovisuel public au service de ce talent.
Applaudissements sur les travées de l'UMP .

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a profondément bouleversé tant le financement que l'organisation de la télévision publique.
Cette réforme, ouvrant notamment la première étape de disparition de la publicité sur les chaînes publiques, entre 20 heures et 6 heures, a été engagée dans un contexte difficile, marqué par une audience en repli et par une situation financière déjà préoccupante.
Or cette loi n'a fait qu'aggraver et fragiliser le modèle économique de l'audiovisuel public. Alors que la période qui s'ouvrait exigeait des investissements pour maîtriser l'ensemble des nouveaux canaux de diffusion, ce texte a fortement pénalisé France Télévisions en réduisant sa capacité à innover et à répondre aux évolutions des technologies numériques.
Déjà, lors des débats de 2009, les sénateurs du groupe socialiste avaient alerté la précédente majorité sur ce sujet, en soulignant avec force l'impossibilité de supprimer totalement la publicité dans l'audiovisuel public sans garantir de manière pérenne le financement et le développement de ce dernier.
Chacun sait que ni les compensations instituées en vertu de ce texte, ni l'indexation de la redevance audiovisuelle sur l'inflation, ni les nouvelles taxes sur le chiffre d'affaires des opérateurs de télécommunications et sur les recettes publicitaires des chaînes de télévision privées – pour un montant total de 300 millions d'euros en 2011 – n'ont permis de renouer avec l'équilibre.
Au demeurant, sur ce sujet, les conclusions du rapport rédigé en 2009 par nos collègues David Assouline et Jacques Legendre font l'objet d'un consensus : « Le produit de cette nouvelle taxe n'a pas été correctement évalué, notamment à cause du manque de transparence sur les éléments de l'assiette de cette recette fiscale fournis par le précédent gouvernement lors du débat parlementaire. »
De nombreux sénateurs proches du précédent gouvernement ont également affirmé au cours des débats que le financement du groupe France Télévisions restait aléatoire.
M. le président de la commission sénatoriale pour le con trôle de l'application des lois acquiesce.

Le Conseil constitutionnel, quant à lui, a considéré que la suppression de la publicité sur France Télévisions avait « pour effet de priver cette société nationale de programmes d'une part de ressources significative, qui constitue un élément de son indépendance ».
Enfin, la Cour des comptes a ajouté que le montant des compensations résultait « in fine d'un arbitrage budgétaire, et non d'une évaluation précise fondée sur les performances publicitaires virtuelles de France Télévisions. »
Ainsi, chacun admet que l'équation telle qu'elle est posée n'est pas viable à long terme, et que de nouveaux moyens devront être recherchés.
Par ailleurs, outre un produit insuffisant, le fondement juridique de la « taxe télécoms » compensatoire est fortement contesté par la Commission européenne, qui pourrait contraindre l'État à rembourser plus de 1 milliard d'euros aux opérateurs, somme qu'il conviendrait de porter au déficit de la précédente majorité et qui, du reste, a d'ores et déjà dû être provisionnée au titre du projet de loi de finances pour 2013.

Madame la ministre, en juillet dernier, lors de votre audition devant notre commission de la culture, de l'éducation et de la communication, vous avez précisé que toutes les pistes restaient ouvertes pour assurer un financement durable de l'audiovisuel public.
Ainsi, la question du retour éventuel de la publicité en soirée sur les chaînes publiques doit être posée, même si cela pourrait être assimilé à un recul.
Par ailleurs, un possible élargissement de l'assiette de la contribution à l'audiovisuel public mérite d'être étudié.
Parallèlement, la question de la modernisation des services de France Télévisions ne doit pas être éludée, de même que celle de la mutualisation de certains moyens techniques et humains, notamment entre les différentes chaînes du groupe, lorsque celles-ci traitent d'un même sujet d'actualité.

Cette synergie est indispensable pour dégager des économies de fonctionnement.
S'ajoute à cela l'amélioration des recettes publicitaires liées à internet, et non concernées par la loi.
Toutes ces décisions qu'il vous reviendra de prendre, madame la ministre, sont précisément celles qui n'ont pas été prises depuis dix ans.

M. Jacques Chiron. Dans un contexte où chacun sait que nous devons consentir un effort collectif historique sur les dépenses pour redresser la situation de nos comptes publics, le Gouvernement demanderait une participation budgétaire à France Télévisions en 2013, et c'est normal. Cependant, la contribution à l'audiovisuel public serait, en contrepartie, revalorisée, afin d'augmenter des recettes qui ont subi une dégradation sensible.
Mme la ministre acquiesce.

J'insisterai quelque peu sur la contribution à l'audiovisuel, qui reste le cœur du financement de France Télévisions.
Force est de le constater, cette contribution est relativement faible en France, si on la compare aux prélèvements en vigueur dans les autres pays européens. En 2012, son montant s'élève, dans notre pays, à 125 euros, contre 216 euros en Allemagne, 180 euros en Grande-Bretagne, 365 euros en Suisse, 317 euros en Norvège et 309 euros au Danemark. La contribution à l'audiovisuel public moyenne dans la totalité des États européens dépasse 160 euros.
Précisons également que l'assiette de cotisation prise en compte dans l'Hexagone est moins large que chez nos voisins. En effet, contrairement à certains pays étrangers, la France ne soumet pas la détention d'un ordinateur à la redevance. Quant aux résidences secondaires, elles ne sont plus concernées par cette taxe depuis 2005, en vertu de la mesure dite « Copé ».
Au demeurant, si toutes les pistes de financement doivent être explorées, certaines sont, à mon sens, plus justes que d'autres.

À ce titre, le rétablissement d'une taxe adaptée sur les résidences secondaires me semble plus juste qu'une augmentation trop brutale de la contribution, taxe non progressive qui toucherait tous les Français sans distinction.
Puisqu'il est aujourd'hui question de vérifier l'application de la loi du 5 mars 2009, je ferai ce constat, à l'instar de plusieurs de nos collègues : trois ans après l'adoption de ce texte, n'ont été mis en place ni le comité de suivi de la loi, prévu à l'article 75, ni un quelconque financement compensant la suppression totale de la publicité initialement prévue en 2012 et très rapidement reportée au 1er janvier 2016, avant les élections...
Ce délai montre bien l'incapacité de l'État, reconnue par tous, à financer cette réforme dans les années à venir, incapacité confirmée par la Cour des Comptes dans son dernier rapport de 2012.
À nous, à vous, madame la ministre, de trouver des solutions pour garantir un modèle de financement stable et pérenne qui garantisse enfin l'indépendance des groupes publics dans un contexte particulièrement concurrentiel.
Car c'est aussi l'indépendance de notre audiovisuel public qui pourrait, à terme, être remis en cause. Sans insister sur les nouveaux modes de désignation des dirigeants prévus par la loi de 2009, mais sur lesquels il faudra revenir – le Président de la République l'a dit –, le mode de financement de l'audiovisuel public constitue également un moteur de son indépendance. Or chacun s'accordera sur le fait que la contribution à l'audiovisuel public et la publicité représentent des ressources beaucoup plus favorables à l'indépendance du groupe qu'une dotation budgétaire négociée avec l'État.
Quant aux objectifs de ce texte, qui étaient, d'une part, de « faciliter le virage éditorial du groupe en faveur du renforcement de ses missions de service public et, d'autre part, de créer une spécificité du service public en termes d'horaires », nous sommes contraints de constater qu'ils ne sont pas atteints.
Nous avons observé une baisse du nombre des programmes culturels diffusés en première partie de soirée, alors qu'il s'agissait du premier engagement du cahier des charges.
Le nombre de soirées consacrées aux spectacles vivants et aux fictions patrimoniales historiques a peu évolué, même si l'on note un engagement plus important du service public en faveur de la création.
La loi n'a donc pas réussi à réellement donner un nouveau visage éditorial à France Télévisions.
Au-delà de ces objectifs non atteints, le principal enjeu de la suppression de la publicité était la disparition de la « tyrannie de l'audimat ». Or c'est l'argument souvent invoqué par les dirigeants du groupe pour justifier le non-respect des objectifs du texte, notamment sur les horaires de programmation. C'est aussi le discours tenu par la plupart des interlocuteurs auditionnés dans le cadre du rapport de nos collègues, qui considèrent que l'audience restait un impératif majeur pour France Télévisions.
Enfin, la question de l'audimat se trouvait au cœur de l'intervention, en mars dernier, du précédent ministre de la culture, qui, répondant à une question écrite d'un député, précisait que l'État fixait des objectifs d'audience à la Société.
À ce sujet, même s'il faut substituer au diktat de l'audience l'utilisation progressive d'outils qualitatifs, il serait aussi difficile d'accepter que l'État investisse dans des programmes peu regardés par les Français. L'audience doit rester l'un des objectifs guidant la télévision publique, mais cela ne doit pas nous conduire à reproduire des programmes des chaînes commerciales. Il faut continuer d'inciter le groupe à répondre aux attentes des téléspectateurs et à diffuser sur les chaînes du service public des émissions de qualité, différentes de celles qui sont produites par les chaînes commerciales.
Je pense notamment aux émissions scientifiques ou technologiques, attractives, bien documentées, à l'instar de ce que sont certaines émissions diffusées sur des radios publiques comme France Inter ou France Culture.
In fine, le texte de 2009 a soulevé plus de questions qu'il n'a apporté de réponses.
Le général de Gaulle a créé en 1964 l'ORTF ; François Mitterrand a, tout au long de son mandat, libéré la communication audiovisuelle et renforcé l'indépendance du CSA, indépendance que le Président de la République sortant aura rapidement remise en cause. L'histoire retiendra que, partisan d'un audiovisuel déréglementé, il aura largement pénalisé France Télévisions par rapport aux grands groupes industriels détenant les chaînes privées.
À vous, madame la ministre, de relever le défi et de mettre en œuvre une réforme qui permettra à l'audiovisuel public de jouer à nouveau pleinement son rôle fédérateur de la société française, et d'en discuter sans tabou ni préjugé.
À France Télévisions, aussi, d'inventer une nouvelle télévision publique qui participe à la diversité culturelle et au pluralisme de l'information, inlassablement battus en brèche par la concentration des médias privés au bénéfice des grands groupes industriels et financiers.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, alors qu'il s'agit, dans ce débat, de faire un état des lieux de l'application de la loi de 2009, la tonalité de mon intervention sera légèrement différente. Je reprendrai en effet un certain nombre de faits que nous avons connus lors de la dernière campagne présidentielle, qui a révélé un véritable déséquilibre dans l'expression des médias, avec des comportements souvent incompatibles avec une démocratie pluraliste.
La liberté des médias a pour corollaire le respect du pluralisme au sens de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. De nombreux articles parus dans la presse étrangère ont dénoncé, par rapport à ce texte, de véritables caricatures et certaines comparaisons, madame la ministre, ne furent guère flatteuses pour la République française.
Le Conseil constitutionnel lui-même a réaffirmé à plusieurs reprises la nécessité du pluralisme, des supports comme des expressions, afin que les auditeurs et les téléspectateurs puissent, notamment, exercer « leur libre choix ».
À vrai dire, si les différentes lois de 1986 sur la presse et la liberté de communication s'efforçaient d'organiser le pluralisme, nous sommes obligés de constater aujourd'hui qu'elles sont largement contournées et dépassées, et qu'elles ne permettent plus vraiment « une libre communication des pensées et des opinions ». Au contraire, elles coproduisent un véritable asservissement au seul corpus idéologique du « politiquement correct ».
Cette tendance, pesante au quotidien, devient insupportable en période électorale et connaît des accélérations suspectes pour peser à des moments clefs où se forgent les opinions.
Ces phénomènes ont indiscutablement aidé les favoris des élections présidentielles de 2007 comme de 2012, avec, pour ces dernières, une indécence caricaturale. Ce syndrome médiatique du « favori des médias » s'explique partiellement par la sensibilité des rédactions, majoritairement de gauche, mais, plus encore, par le jeu des groupes propriétaires des entreprises médiatiques, dont beaucoup prospèrent dans les contrats et commandes publiques. Ces relations économiques stratégiques, pour nombre de ces entreprises, n'inclinent pas à l'indépendance, mais plutôt à l'anticipation de la victoire.
C'est ce que nous venons de vivre, et c'est ce qu'il conviendrait de réformer.
À vrai dire, mes chers collègues, il existe sur ce sujet un large consensus entre nous, illustré par plusieurs propositions de loi : celle de M. Ayrault, cosignée par Mme la ministre, celle du groupe socialiste au Sénat, celle de M. Lagarde et du groupe centriste à l'Assemblée nationale et, enfin, présentement, celle du groupe UMP au Sénat. Ce consensus devrait nous permettre de légiférer utilement et rapidement, car il ouvrirait « la possibilité à de véritables entreprises de médias d'investir dans le secteur sans être concurrencées par des conglomérats industriels cherchant uniquement à contrôler des vecteurs d'information au service de leur propre communication ».
On peut, sur ce point, observer que nombre des titres de la presse écrite régionale et nationale n'ont pu, ces dernières années, construire de véritables entreprises de médias, alors qu'il s'agit de leur cœur de métier.
Pour le pluralisme, les attributions récentes de canaux de télévision numérique terrestre ont surtout défrayé la chronique, un groupe s'étant notamment offert une plus-value de plusieurs centaines de millions d'euros en cédant ses deux licences à Canal+, filiale de Vivendi, trois ans après les avoir obtenues, ce qui lui a permis de s'installer comme un actionnaire de référence de ce groupe.
À vrai dire, mis devant le fait accompli, le CSA a entériné, faute de moyens suffisants pour faire respecter ses propres règles.
Les entreprises éditrices de la presse écrite sont, elles, soumises à des règles de transparence de leur actionnariat et à une charte interne régissant les rapports avec les rédactions, qu'il serait urgent d'étendre aux groupes de médias des radios et télévisions. En effet, ceux-ci, quotidiennement impliqués dans la communication commerciale de masse, ont un pouvoir de « bourrage de crâne » qui peut éventuellement contribuer avec la même efficacité au « bourrage des urnes », d'autant qu'ils n'hésitent pas à pratiquer la publicité comparative illustrée par le récent « tout sauf Sarkozy », comme ils vendent le « tout sans OGM », deux mentions aussi erronées l'une que l'autre.
Plus insidieusement, le paysage audiovisuel des six derniers mois, avant le premier tour de l'élection présidentielle, a vu également défiler, dans les émissions les plus disparates, une cohorte de savants, sociologues, experts, chercheurs, psychologues, environnementalistes, jusqu'aux podologues, qui expliquaient fort doctement que leur dernière éruption de boutons ne pouvait se comprendre que dans un anti-sarkozysme tout aussi éruptif, créant ainsi un climat de méfiance, si ce n'est d'hostilité généralisée envers un candidat !

M. Francis Delattre. Il me semble que nous sommes réunis aujourd'hui pour dresser un état des lieux, et que l'on peut librement s'expliquer. Je comprends toutefois que cela puisse vous déranger…
Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste.

Vous devriez d'ailleurs relire vos propres propositions. Ainsi, à travers votre proposition de loi, monsieur Assouline, vous souhaitiez que, en application de la nouvelle rédaction de l'article 34 de notre Constitution, le législateur mette la République à l'abri de ces contingences en redéfinissant les règles susceptibles de garantir l'honnêteté de l'information, l'effectivité des pratiques du pluralisme et de l'indépendance des médias, d'une part, en donnant de véritables pouvoirs de contrôle et d'investigations à la Haute Autorité, d'autre part, en limitant strictement les participations financières des groupes, acteurs réguliers de la commande publique, au capital des sociétés de radio et télévision, pour quasiment vous citer, monsieur Assouline.

M. David Assouline, président de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application de la loi . Il n'est pas là, monsieur Dassault ?
Sourires.

M. Francis Delattre. Nos propositions de loi, sur toutes les travées, convergent. Permettez-moi, madame la ministre, de faire en sorte que, lors de nos prochains débats, ces véritables sujets de notre démocratie puissent être évoqués sereinement.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, nous sommes ici pour débattre des résultats de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, trois ans après son adoption.
Cette loi fixait plusieurs objectifs qui ont été abondamment commentés.
Le premier objectif était de réduire la dictature de l'audimat. Ce soir, quelle que soit notre appartenance politique, nous avons tous constaté que cet objectif n'avait pas été atteint.
Le deuxième objectif était de transposer deux directives européennes dans le droit français, l'une sur les médias audiovisuels, l'autre sur la télévision sans frontières. Sur ce point, tout le monde s'est accordé pour dire que la loi avait été utile et qu'elle avait consacré une modernisation du droit français.
Le troisième objectif était de refondre le modèle économique de financement du service public, en supprimant la publicité après 20 heures. Deux conséquences de cette mesure apparaissent aujourd'hui clairement, de mon point de vue. D'abord, et cela n'a peut-être pas été suffisamment souligné, cette suppression s'est en effet traduite par un accroissement important des ressources financières du secteur privé, à laquelle fait écho une sorte de précarité financière de l'audiovisuel public.
En effet, le financement de la réforme a été marqué par la création de deux nouvelles taxes, qui ont été largement explicitées, et qui sont pour moi marquées du sceau de l'amateurisme et de la confusion.
Amateurisme pour la première taxe, celle sur les recettes publicitaires des opérateurs privés, qui devait susciter une ressource de 450 millions d'euros, mais qui en a rapporté à peine un peu plus de la moitié.
Confusion pour la seconde de ces taxes, assise sur le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie, qui s'est révélée plus rentable, mais qui fait l'objet d'une grave contestation de la part de la Commission européenne. Comme cela a été souligné, le risque est aujourd'hui important pour notre pays de devoir rembourser ces sommes.
Le gouvernement actuel se trouve donc aujourd'hui contraint de faire face à ces engagements très importants. Il devra peut-être provisionner des sommes, et en tout cas trouver de nouvelles ressources stables pour l'audiovisuel public.
Un quatrième objectif était de changer de mode de nomination des présidents de sociétés de l'audiovisuel public. Chacun a pu donner son avis sur la question. Quant à moi, je constate que cet objectif a conduit à une intrusion beaucoup plus directe que par le passé du pouvoir politique dans les choix des responsables.
La loi avait un cinquième objectif, la fusion des différentes sociétés de France Télévisions ; elle a été à peine engagée, conduite très partiellement avec une méthode et une approche qui produisent – chacun le voit – une lourde inquiétude pour les agents des sociétés concernées.
Le gouvernement actuel hérite donc d'un dossier particulièrement difficile, doté d'une sorte de bombe à retardement financière dans le contexte général très difficile des finances publiques de notre pays. C'est à lui qu'il reviendra de remettre en place un système de financement stable pour notre audiovisuel public.
À cet instant – et pour me tourner rapidement vers l'avenir –, je voudrais souligner une des dimensions particulières de notre système audiovisuel public : sa relation avec nos territoires. Il existe, je le rappelle, un fort attachement des populations, dans toutes les régions de France, à une information liée à leurs territoires et pluraliste. Cet attachement est d'autant plus important que la mondialisation de l'information se développe.
L'une des spécificités du service public est justement qu'il est très implanté sur le territoire à un moment où, dans le contexte que nous connaissons, à l'inverse, la presse quotidienne régionale est souvent réduite à un seul titre et où les quotidiens gratuits diffusés dans les villes ne donnent souvent que des informations minimalistes.
Enfin, les radios commerciales, qui sont nombreuses, restent essentiellement axées sur le divertissement.
Pour ces raisons, la présence d'un service public puissant et diversifié me semble importante, madame la ministre, qu'il s'agisse de la télévision publique ou de Radio France, une radio dont chacun constate et apprécie aujourd'hui la grande qualité.
Je voudrais souligner, en terminant, qu'il me paraît important de réfléchir à une organisation de notre secteur audiovisuel public qui garantisse pleinement les capacités des chaînes à remplir ces missions, particulièrement sur l'ensemble des territoires, ce qui ne doit pas être incompatible, me semble-t-il, avec une bonne gestion des deniers publics et la recherche d'une réelle maîtrise des équilibres budgétaires.
Tel est, de mon point de vue, l'un des enjeux majeurs de la période à venir et je vous souhaite, madame la ministre, compte tenu de la situation, bon courage pour aller au bout de cette lourde tâche !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de me réjouir de l'organisation de ce débat qui entre pleinement dans la mission de contrôle du Parlement à laquelle nous sommes, nous centristes, très attachés.
Il fait utilement suite au débat organisé en mai 2010, sur notre initiative, un an après la promulgation de la loi du 5 mars 2009.
Si, lors de l'examen du projet de loi, j'avais, en tant que porte-parole du groupe de l'Union centriste, souligné les apports positifs de ce texte, sur lesquels je ne redeviendrai pas ce soir par manque de temps, j'avais également insisté, sans complaisance aucune, sur le point faible de la réforme : le financement de l'audiovisuel public.
C'est ce sujet que je souhaite évoquer aujourd'hui.
Force est en effet de constater que nos inquiétudes étaient fondées.
Nous avions à l'époque souligné que la suppression de la publicité à la télévision privant France Télévisions de 450 millions d'euros, était certes une idée sympathique, mais totalement inadaptée à la situation économique.

La création d'une taxe sur les fournisseurs d'accès à internet et d'une taxe sur la publicité devait compenser cette perte de recettes.
J'avais souligné le caractère inapproprié de ces taxes et regretté, concernant la taxe sur les fournisseurs d'accès à internet, que l'on n'ait pas imposé aux opérateurs des obligations en termes d'aménagement numérique des territoires plutôt que de les taxer d'une manière aussi inadaptée.

Si, sur l'absurdité de ces taxes, le gouvernement et la majorité de l'époque ne nous avaient pas entendus, nous avions, en revanche, obtenu gain de cause, contre l'avis de l'Assemblée nationale, sur la revalorisation de 2 euros hors indexation de la redevance rebaptisée, sur l'initiative de notre rapporteur Catherine Morin-Dessailly, « contribution à l'audiovisuel public ».
Nous avions également proposé, comme vous, madame la ministre, d'élargir l'assiette de la contribution aux terminaux susceptibles de recevoir la télévision et aux propriétaires de résidences secondaires dans la limite d'une fois et demie le montant de la redevance.
Qu'en est-il aujourd'hui ?
Censée rapporter à l'origine 94 millions d'euros, la taxe sur la publicité, dont le taux initial de 3 % a été ramené à 1, 5 % par la loi puis à 0, 5 % par la loi de finances pour 2011, rapporte non pas les 94 millions d'euros annoncés, mais 18 millions d'euros...
Quant à la taxe sur les fournisseurs d'accès à internet, censée rapporter 380 millions d'euros, elle ne rapporte que 250 millions d'euros environ et, surtout, il y a tout lieu de penser qu'elle sera annulée par les instances européennes, ce qui pourrait conduire la France à rembourser près de 1 milliard d'euros.
On le voit, l'équilibre financier de la réforme assuré artificiellement en 2009 ne l'est toujours pas mieux aujourd'hui.
Face à ce fiasco financier, j'avais dès 2010 insisté auprès de votre prédécesseur pour qu'il renonce à la suppression de la publicité avant 20 heures qui aurait coûté encore 330 millions d'euros par an. Sur ce point, me semble-t-il, nous sommes en phase, madame la ministre.
Le Gouvernement vient d'annoncer une augmentation de la contribution à l'audiovisuel public de 2 euros hors inflation. J'avoue que j'aurais préféré l'élargissement de l'assiette aux résidences secondaires à cette mesure qui frappera tous les ménages, même les plus modestes.
Quoi qu'il en soit, cette augmentation ne suffira pas à assurer l'équilibre de l'audiovisuel public.
À cet égard, comment ne pas s'inquiéter de la diminution des ressources publiques affectées au groupe France Télévisons, en baisse de 3, 4 % pour 2013, ajoutée à la diminution de leurs ressources publicitaires, qui devraient être inférieures de 50 millions d'euros par rapport aux prévisions du contrat d'objectifs et de moyens ?
Je ne peux donc, madame la ministre, que vous inviter à honorer les engagements de vos prédécesseurs en créant le groupe de travail chargé de réfléchir à l'évolution de la contribution à l'audiovisuel public ou le comité de suivi prévu par l'article 75 de la loi de 2009.
Il y a, vous le voyez, madame la ministre, une réelle inquiétude sur l'avenir de l'audiovisuel public et de l'audiovisuel dans son ensemble, puisque la multiplication des chaînes privées n'est pas sans conséquences sur l'équilibre financier de l'ensemble de l'audiovisuel.
Nous sommes donc impatients de connaître les propositions du Gouvernement en ce domaine.
Vous avez indiqué à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, le 16 juillet : « Il faut être sans tabou sur le sujet du financement », ajoutant « les difficultés budgétaires n'affectent pas nos ambitions ». Nous le souhaitons sincèrement, madame la ministre.
Le groupe de l'Union centriste et républicaine, fidèle à ses positions en la matière, sera extrêmement attentif à vos propositions sur ce sujet.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président et monsieur le rapporteur de la commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois, je précise l'intitulé de la commission, mes chers collègues, parce que je suis le dernier orateur à intervenir dans ce débat avant Mme la ministre et je voudrais souligner l'utilité de cette commission – certains en doutaient – créée par la volonté de Jean-Pierre Bel avec l'appui de sa majorité.

Il est vraiment bon d'observer et d'analyser notre propre travail : comment les lois sont-elles appliquées ? Le Gouvernement remplit-il son rôle ? Comment est-il perçu par les usagers ? Pour le coup, ce travail effectué par la commission et par nos collègues David Assouline et Jacques Legendre m'inspire une remarque générale : la précipitation est toujours nuisible.
Le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle, dont on analyse aujourd'hui l'impact, a jailli comme par génération spontanée d'une idée avancée un matin par le Président de la République. Aucune expertise, aucune simulation, aucune étude d'impact, aucune concertation ! Ce rapport, je le pense et je le dis très sincèrement, nous invite à bannir une telle méthode.
Cela étant, je vous parlerai tout de même du sujet qui nous intéresse…
Rappelez-vous, mes chers collègues, nos propos lors de l'examen, au titre de la procédure d'urgence, de la loi du 5 mars 2009, relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision ; c'était en janvier 2009. Ce sentiment de malaise dans nos rangs – et même dans ceux de la majorité d'alors – anticipait celui que nous ressentons aujourd'hui face au bilan de ce dispositif élaboré dans l'urgence, et pour rien, si ce n'est pour fragiliser le service public audiovisuel.
Il y a presque quatre ans, nous avions déjà senti que l'on nous roulait dans la farine.
Comment pouvait-on croire au bien-fondé de ce projet de loi visant prétendument à rénover le service de télévision publique, alors qu'une procédure accélérée s'y appliquait ? Y avait-il un terrible danger imminent pour aller si vite et pour anticiper son application avant même son vote par le Sénat ?
Monsieur Legendre, vous disiez tout à l'heure que si, pour David Assouline, le verre était à moitié vide, pour vous, le verre était à moitié plein. Soit, mais, pour le coup, il est à moitié plein d'erreurs et d'échecs ! Vous le reconnaissez vous-même en page 121 du rapport : « Je regrette que pour des raisons économiques, la suppression totale de la publicité ait dû être reportée. » Vous voyez, c'est déjà un échec !

Autre argument : le maintien après 20 heures du parrainage– ce fameux parrainage dont on a beaucoup parlé, mais auquel personne n'a rien compris – était une erreur.
Monsieur Legendre, ce ne sont que quelques exemples, mais je pourrais en citer d'autres. Vous voyez bien que le verre était vraiment à moitié plein d'erreurs.
Cette réforme de 2009 s'apparente en fait à une réforme idéologique qui serait la résultante d'une idée dominante chez les gouvernements successifs de droite depuis vingt ans, selon laquelle le service public audiovisuel n'est pas un bien sacré. Sans parler du fait que l'une des « mesures phare » de ce projet de loi, la suppression de la publicité en prime time sur la télévision publique, était déjà entrée en vigueur dès le 5 janvier, avant même que nous ayons fini d'en débattre. Avouez que c'est le comble du mépris à l'égard du Parlement !
Nous l'avions dit haut et fort, mais nos protestations étaient restées vaines Nous avons cependant joué le jeu en présentant près de 150 amendements, dont certains ont même été votés – je le précise – par la majorité d'alors.
La France a été l'un des rares pays à aller si loin dans la transposition de la directive Services. Sous le prétexte de la transparence, la loi de mars 2009 a institué également la nomination et la révocation des présidents des sociétés de l'audiovisuel public, France Télévisions, Radio France et l'audiovisuel extérieur, par décret présidentiel.
Eh oui, mes chers collègues, priver la télévision publique de ses moyens financiers, la rendant ainsi dépendante, n'était pas suffisant ; cette nouvelle procédure de nomination et de révocation y ajoutait une dépendance politique. C'est dire, mes chers collègues, combien cette loi est toxique !
Rarement nous avions connu un tel entêtement de la part de l'exécutif.
Aujourd'hui, quel bilan pouvons-nous tirer ? Le rapport de nos collègues David Assouline et Jacques Legendre est édifiant, implacable, même si les conclusions de ce rapport « à deux voix » ne sont pas en phase sur tout. De notre clairvoyance passée nous n'avons nulle gloire à tirer, plutôt du découragement, car nous n'avons pas été entendus.
Trois ans après, que pouvons-nous dire de l'application de cette loi ?
En ce qui concerne la mesure emblématique de cette loi, la suppression de la publicité en première partie de soirée, son application n'a été que partielle, puisque son extension en fin de soirée – vous l'avez dit, monsieur Legendre –, prévue pour la fin de l'année 2011, ne s'est jamais concrétisée, faute de financement compensatoire suffisant et compte tenu des mauvaises prévisions de l'évolution du marché publicitaire.
La dictature de l'audimat a perduré. Le tunnel publicitaire avant 20 heures est devenu interminable ! Peut-être parce que les raisons de cette réforme n'ont jamais été clairement spécifiées. Peut-être parce que la définition d'une télévision publique de qualité n'a jamais été réfléchie et déclinée.
On se demande si le jeu en valait la chandelle.
En ce qui concerne l'audiovisuel extérieur, la publication très tardive de son cahier de charges est le symbole des errements qui ont marqué ce chantier, pour aboutir à surseoir à la fusion de RFI et France 24.
Mais le bouquet, mes chers collègues, madame la ministre, c'est le mode financement sorti du chapeau de prestidigitateur de MM. Sarkozy, Copé et leurs alliés. C'est peu dire que le financement est un fiasco !
Le produit des deux taxes instituées pour compenser la perte de recettes publicitaires n'a pas atteint le montant espéré. Cela coûte désormais 180 millions d'euros par an à l'État.
De plus, la taxe dite « télécoms », soit 250 millions d'euros, risque fort d'être annulée par la Cour de justice de l'Union européenne. Le jugement doit être rendu à la fin du premier semestre de l'année 2013. Si l'État est contraint de rembourser, c'est plus de 1 milliard d'euros qu'il devra rendre aux opérateurs de télécommunications !
Le financement prévu par le gouvernement Fillon n'assure pas la relève et fragilise la télévision publique. Cela augmente la dépendance à l'égard de l'État, qui est contraint de renflouer le budget de l'audiovisuel public.
À ce gâchis s'ajoute la bombe à retardement dont le Gouvernement vient d'hériter ; une de plus ! Madame la ministre, sachez que vous nous trouverez toujours à vos côtés quand il s'agira de garantir le financement et l'indépendance du service public audiovisuel !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite tout d'abord vous remercier de m'avoir conviée au présent débat sur l'application de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. Le contrôle de l'action publique fait partie des missions du Sénat, et c'est une nécessité. Le Gouvernement est dans son rôle en étant présent ce soir pour vous écouter.
Même si nous n'en sommes pas encore à l'examen du projet de loi de finances pour 2013, la concomitance entre ce qui vient d'être annoncé dans cette perspective et le débat de ce soir a amené un certain nombre de sénateurs à s'exprimer par anticipation sur les aspects budgétaires. Vous le comprendrez, je ne pourrai pas répondre à toutes vos interrogations sur le sujet. Je tenterai cependant de vous apporter l'éclairage du Gouvernement sur les questions qui ont été soulevées dans le rapport ou pendant le débat.
Je veux auparavant saluer la qualité du travail fourni par MM. David Assouline et Jacques Legendre dans leur rapport d'information. Comme vous le verrez, mes propos rejoindront un certain nombre de leurs analyses.
La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, adoptée sous le précédent gouvernement, a posé quelques bases utiles ; je pense notamment aux services de médias audiovisuels à la demande. Mais elle a surtout abouti à une véritable déstabilisation de la télévision publique, aussi bien dans son financement que dans son indépendance, via les nominations de dirigeants.
Je vais tenter d'évaluer devant vous le bilan de la loi à la lumière de la situation dont nous héritons aujourd'hui. J'aborderai les cinq points qui ont été évoqués, c'est-à-dire la modernisation de la réglementation audiovisuelle, la procédure de nomination des présidents de l'audiovisuel public, la suppression de la publicité en soirée sur France Télévisions, la fusion des chaînes de France Télévisions en une entreprise unique et la réforme de l'audiovisuel extérieur de la France.
Premièrement, on peut effectivement dire, à l'instar de M. le rapporteur, Jacques Legendre, qu'il y a eu une certaine modernisation de la réglementation audiovisuelle. Je pense en particulier à l'adaptation aux nouveaux services de médias audiovisuels à la demande, les fameux « SMAD », qui sont principalement les services de vidéo à la demande et ceux de la télévision de rattrapage. M. Jacques Legendre ayant parfaitement exposé cet apport, je ne m'étendrai pas sur le sujet.
L'univers numérique est en constante mutation. On constate de nouvelles évolutions, imputables, notamment, au phénomène de convergence des médias. Il devient donc nécessaire d'avancer de nouveau dans la réflexion sur la modernisation.
C'est pourquoi M. le Premier ministre a décidé de confier à trois membres du Gouvernement, M. le ministre du redressement productif, Mme la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique et moi-même en tant que ministre de la culture et de la communication, une réflexion sur un éventuel rapprochement entre les deux instances de régulation que sont le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP. La réflexion sera menée jusqu'à la fin du mois de novembre de cette année sur les implications d'une telle évolution pour la régulation des secteurs de l'audiovisuel et des communications électroniques.
Cette mission relève d'une nécessité : examiner le périmètre d'une réforme des autorités de régulation pour les rendre plus efficaces, notamment à l'heure de la « télévision connectée ». En effet, les appareils sont désormais disponibles et tous les mécanismes de régulation qui ont été mis en place jusqu'à présent pour la télévision risquent d'être bouleversés par les programmes non linéarisés.
Nous proposerons donc dans les prochains jours de rencontrer les membres du Sénat et de l'Assemblée nationale spécialistes des questions liées à l'audiovisuel et aux télécommunications pour entendre leur point de vue sur le sujet. Cela aboutira ensuite à un projet de loi qui sera soumis au Parlement en 2013.
Deuxièmement, et le projet de loi que je viens d'évoquer portera évidemment aussi sur le sujet, le mode de nomination des présidents de l'audiovisuel public était l'un des volets, et non des moindres, de la réforme décidée par Nicolas Sarkozy en 2008. Les choix qui ont été faits alors n'étaient pas, et ne sont toujours pas compatibles avec les impératifs d'une démocratie moderne.
Selon M. Charon, garantir par la loi l'indépendance des présidents de l'audiovisuel public en modifiant leur mode de nomination serait faire preuve d'hypocrisie ; un tel argument n'est absolument pas recevable.
M. Pierre Charon s'exclame.
Ainsi que plusieurs orateurs l'ont souligné, le mode de nomination retenu en 2008 jette un doute sur l'indépendance des personnes nommées, contrariant ainsi leur travail, la relation de confiance qu'elles doivent entretenir avec les salariés et, au final, la réalisation de leur projet pour le service public de l'audiovisuel.
Il faut donc aujourd'hui modifier la procédure. Comme cela a été annoncé, nous le ferons au début de l'année 2013. Conformément à l'engagement de M. le Président de la République, le mode de nomination qui sera retenu associera largement la future instance de régulation de l'audiovisuel.
Il faut donc attendre, et c'est bien logique, que la réflexion sur l'éventuel rapprochement entre le CSA et l'ARCEP soit menée à son terme pour que nous puissions ensuite jeter les bases d'une telle réforme, l'objectif étant évidemment de rétablir l'indépendance la plus absolue pour tous les présidents de l'audiovisuel public afin de les mettre à l'abri de toute pression ou de la moindre suspicion.
Contrairement à ce qui a été affirmé ce soir – je pense en particulier à certaines attaques de M. Pierre Charon
M. Pierre Charon ironise .
Troisièmement, et M. Assouline l'a démontré de manière implacable, la suppression de la publicité en soirée a considérablement fragilisé le financement des missions du service public.
L'ambition affichée lors de l'annonce de cette suppression, était de « libérer » le service public des contraintes commerciales imposées par le marché publicitaire, afin de lui donner la liberté de proposer une offre plus novatrice, distincte de celle des chaînes commerciales. Force est bien de constater que si l'on ne discute pas avec France Télévisions d'un véritable projet éditorial en accompagnement d'une telle mesure, cela ne peut pas porter de fruits.
Quatre ans donc après cette annonce, nous constatons que, comme nous le craignions, le seul résultat tangible a été la déstabilisation du financement de France Télévisions.
En effet, pour compenser les pertes de recettes publicitaires de l'entreprise en soirée, la réforme de 2009 a introduit deux taxes dont il a été montré à quel point elles-mêmes ont ensuite été rognées par la volonté du précédent gouvernement, que ce soit dans leur taux – je ne reviens pas sur le passage de 3 % à 0, 5 % – ou dans leur assiette, tout simplement par la diminution des ressources publicitaires sur les chaînes privées.
Et la compensation par des ressources budgétaires introduite par la réforme de 2009 était par définition fragile – nous l'avions dit lors du débat parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat –, puisque soumise aux aléas de la conjoncture économique.
Mesdames, messieurs les sénateurs, compte tenu de la situation extrêmement dégradée des finances publiques dont nous héritons du précédent gouvernement, nous sommes en quelque sorte soumis à une forme de double peine.
D'un côté, les finances publiques sont dans un état catastrophique ; de l'autre, l'État ne peut pas assurer la compensation du coût du service public de l'audiovisuel dans des proportions suffisantes.
La situation est donc extrêmement difficile. Le mécanisme implacable qui a été mis en place a exposé France Télévisions à des ajustements par rapport au budget de l'État.
Outre France Télévisions, la fragilisation a aussi touché tout le secteur audiovisuel public. Certaines annulations de crédits budgétaires de France Télévisions ont en partie été compensées par des transferts de crédits – vous l'avez rappelé – issus de la contribution à l'audiovisuel public versée aux autres organismes.
Dès lors, et compte tenu de cette situation très compliquée, le Gouvernement a fait un choix, et un choix difficile. Je l'assume, y compris devant les représentants des salariés de France Télévisions, que je veux saluer ce soir. Le Gouvernement a fait le choix de la responsabilité et de la vérité.
Responsabilité, d'abord, parce que nous sommes contraints de faire porter à France Télévisions une part de l'effort que nous demandons à l'ensemble des administrations publiques, des départements ministériels, des établissements publics et des opérateurs. Nous ne pouvons donc pas alourdir davantage la contribution du budget de l'État.
Vérité ensuite, parce que nous avons reconnu que les trajectoires financières du contrat d'objectifs et de moyens, pourtant récemment signé par France Télévisions et l'État, devaient être adaptées. Nous avons donc ouvert de nouvelles discussions avec l'entreprise sur ses activités et sur ses intentions.
La question du comité de suivi a été évoquée à plusieurs reprises, le treizième décret d'application de la loi de 2009 n'étant pas passé. Mais, étant donné que l'on va négocier un avenant au contrat d'objectifs et de moyens, ce n'est peut-être pas le moment de créer un comité de suivi, même si j'en reconnais, sur le principe, la nécessité.
Choix de vérité, encore, il s'agit de reconnaître qu'il faut assurer des ressources pérennes et durables au service public de l'audiovisuel. Ce dernier doit être financé par une ressource stable et non soumise aux aléas budgétaires, une ressource moderne et adaptée à l'évolution des pratiques, une ressource juste et équitable.
Ces choix confortent l'indépendance du service public de l'audiovisuel.
Je puis d'ores et déjà vous annoncer, cela figure dans le projet de loi de finances pour 2013, que le Gouvernement a fait le choix, outre de l'indexer sur l'inflation, d'augmenter de 2 euros la contribution pour le service public de l'audiovisuel.
Cette hausse, couplée à l'indexation sur l'inflation, portera la redevance, en France métropolitaine, de 125 euros à 129 euros et, dans les départements d'outre-mer, de 83 euros à 87 euros.
J'ai bien compris ce soir que le Parlement, et il est en cela tout à fait dans son rôle, fera également des propositions dans le débat budgétaire.
Concernant la suppression de la publicité, nous n'allons pas poursuivre son application au-delà du 1er janvier 2016. D'ailleurs, le gouvernement précédent ne s'apprêtait pas non plus à le faire, contrairement à ce qui avait été prévu. Nous prendrons des dispositions législatives pour que ne subsiste aucun doute sur ce point. On comprendrait mal, d'ailleurs, que la ministre de la culture et de la communication poursuive dans la mise en œuvre d'une réforme qui a suscité autant de critiques de sa part.
S'agissant maintenant des modalités de financement et des critiques que vous avez formulées à cet égard, je dois à la vérité de dire que, pour moi, elles ne sauraient à elles seules déterminer la qualité des programmes. Ce qui prime dans les discussions actuelles du Gouvernement avec France Télévisions, c'est la recherche d'une audace créative, d'une volonté éditoriale. Les succès de France Télévisions en matière d'information, je pense ici aux magazines, vont dans le bon sens et nous incitent à encourager la poursuite de cette démarche de qualité.
Ce projet éditorial doit se discuter en même temps que l'examen de l'avenant au contrat d'objectifs et de moyens. Il ne s'agit en aucune manière de laisser les contraintes budgétaires, même si elles sont lourdes aujourd'hui, j'en ai bien conscience, décider des modifications des contenus et des programmes ou encore des lignes stratégiques du service public de l'audiovisuel. Les missions du service public doivent primer.
Le quatrième point que je souhaite évoquer concerne la fusion des chaînes de France Télévisions en une entreprise unique, qui est également traitée dans le rapport.
La réorganisation qui a suivi la fusion des chaînes de France Télévisions en une seule société nationale de programmes a été complexe et longue. La convergence des systèmes informatiques et des statuts sociaux n'est toujours pas achevée, comme l'a souligné David Assouline.
Les synergies et les économies qui avaient été promises en 2009-2010 pour une brève échéance ne peuvent se réaliser que progressivement. Elles seront l'un des enjeux de la négociation du futur avenant au contrat d'objectifs et de moyens.
Là aussi, l'organisation ne doit pas primer plutôt que les missions : le travail sur ces missions est au cœur de nos échanges avec France Télévisions.
Je puis vous garantir que le service public ne sera pas affaibli. Ses salariés, dont l'expertise et l'engagement n'ont pas failli, seront respectés, comme il se doit.
S'il est important de repenser les missions et l'organisation du groupe, pour autant, toute restructuration ne saurait être fondée que sur des identités claires. Même si la recherche des synergies se justifie dans certains cas, l'objectif, voire l'obsession, doit rester la qualité du service public.
Le cinquième et dernier point que je souhaite aborder concerne la réforme de l'audiovisuel extérieur de la France.
Le 5 juin dernier, Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères, et moi-même avons confié à M. Jean-Paul Cluzel une mission d'évaluation de la fusion en cours à l'Audiovisuel extérieur de la France, l'AEF, pour examiner la pertinence stratégique et l'impact des décisions prises. Le rapport nous a été remis le 25 juin 2012.
Dans ce rapport, Jean-Paul Cluzel préconise une AEF réformée, fondée sur la séparation des rédactions de France 24 et de RFI, la reconstitution de deux directions d'antenne bien distinctes et la réaffirmation de l'identité et de la spécificité de France 24 et de RFI.
Après une analyse approfondie de ces conclusions, le conseil d'administration a demandé qu'un nouveau projet d'organisation lui soit proposé, fondé sur des rédactions distinctes pour RFI et France 24.
Je considère que c'est la bonne solution. C'est désormais dans cette direction que la nouvelle équipe de l'AEF avancera dès sa nomination effective. Pour cela, il n'est pas indispensable de remettre en cause le cadre législatif de la société nationale de programme AEF, créée par la loi du 5 mars 2009. Toutefois, l'indépendance des deux rédactions doit être garantie par l'adoption d'un nouveau cahier des charges, consacrant la spécificité des deux antennes.
Sur les cinq sujets évoqués, nous voyons combien le service public est un bien précieux, mais fragile. Il a été considérablement fragilisé par la réforme de 2009 dont vous venez de faire le bilan. Légiférer en la matière exige beaucoup de précautions, de débats, de doigté, mais aussi de volonté politique.
Pour ma part, je l'ai dit au cours de mon audition devant la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat et devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, je considère que toutes les pistes, toutes les solutions doivent être examinées. Je n'ai aucun a priori idéologique. Mon seul souci est le service public de l'audiovisuel, ma seule ambition est de mettre en place les bonnes conditions pour sécuriser son financement et surtout pour renforcer son indépendance.
Vous serez évidemment associés à toutes les démarches d'ores et déjà engagées par le Gouvernement pour franchir l'étape de l'année 2013, qui sera budgétairement difficile en raison de la crise, non seulement pour France Télévisions, mais également pour l'ensemble du budget de l'État ainsi que, malheureusement, pour un grand nombre de nos concitoyens.
La situation dont nous héritons ne nous facilite pas la tâche, bien au contraire. Néanmoins, toutes les mesures seront prises dans la concertation. Nous n'utiliserons pas la contrainte budgétaire pour imposer des réformes qui ne seraient pas justifiées sur le fond.
Nous devrons également faire face aux enjeux de la modernisation. Je pense au numérique et à la convergence des médias, qui sont essentiels. Il nous faudra traiter ces dossiers très rapidement, ce que nous pouvons faire même dans un contexte budgétaire tendu.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de votre attention et me tiens à votre disposition pour échanger avec vous sur tous s sujets.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Nous en avons terminé avec le débat sur l'application de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 3 octobre 2012 :
De quatorze heures trente à dix-sept heures :
1. Débat sur les conditions de la réussite à l'école.
De dix-sept heures à dix-neuf heures trente :
2. Débat sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales.
De vingt et une heures trente à minuit :
3. Débat sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de notation.
En outre, à quatorze heures trente :
- Désignation des vingt et un membres de la commission d'enquête sur l'influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé.
- Désignation des douze membres de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.