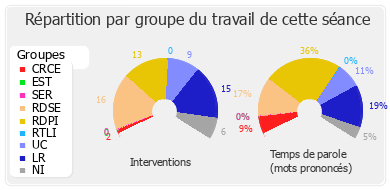Séance en hémicycle du 16 février 2010 à 14h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à douze heures cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Jean-Claude Gaudin.

La séance est reprise.

J’informe le Sénat que la commission des finances m’a fait connaître qu’elle a d’ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu’elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d’une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2010 actuellement en cours d’examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2010 (projet de loi n° 276, rapports n° 278, 283 et 284).
Dans la discussion des articles de la première partie, nous allons examiner l’article 1er que nous avions prévu d’appeler en début d’après-midi.
Nous reprendrons ensuite le cours normal de notre discussion.
PREMIÈRE PARTIE
I. – Les personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui, au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle. Cette taxe est affectée, dans la limite de 360 millions d’euros, à l’établissement public OSEO en vue de financer une dotation en capital exceptionnelle au titre de sa mission de service public de financement de l’innovation et des petites et moyennes entreprises.
II. – La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, au titre de l’année 2009, par les personnes morales mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise.
La part variable des rémunérations mentionnée à l’alinéa précédent correspond au montant brut de l’ensemble des éléments de rémunérations attribués à ces salariés au titre de l’année 2009 en considération de leurs performances individuelles ou collectives, y compris lorsque leur versement et leur acquisition définitive sont sous condition, à l’exception des sommes leur revenant au titre de l’intéressement ou de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail.
Les éléments de rémunération qui entrent dans l’assiette de la taxe sont pris en compte quelle que soit l’année de leur versement ou celle au cours de laquelle leur acquisition est définitive.
Lorsque l’attribution porte sur des options sur titres, des actions gratuites ou d’autres titres consentis à des conditions préférentielles, y compris lorsque cette attribution est effectuée par une société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le salarié exerce son activité, l’assiette est égale à la juste valeur de ces options, actions ou titres à la date de leur attribution, telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales.
Seule la part variable de la rémunération individuelle qui excède 27 500 € est prise en compte dans l’assiette de la taxe.
III. – Le taux de la taxe est de 50 %.
IV. – La taxe est exigible au premier jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque tout ou partie de la part variable des rémunérations définie au II est attribué après cette date, la taxe correspondante est exigible au premier jour du mois suivant la décision d’attribution.
La taxe est déclarée et liquidée dans les vingt-cinq jours de son exigibilité, sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
V. – Dans le cas où le montant de la part variable des éléments de la rémunération finalement versés ou acquis aux salariés est inférieur au montant compris dans l’assiette de la taxe, aucune restitution n’est opérée.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cet article 1er instaure une taxe exceptionnelle sur les rémunérations versées au bénéfice des opérateurs de marchés financiers, ceux que l’on appelle en mauvais franglais les traders.
Une telle mesure, rappelons-le, figure dans les recommandations formulées lors des sommets du G8 comme du G20 et nous devons immédiatement souligner que, contrairement à d’autres initiatives prises dans le cadre de la crise financière de 2008, l’idée de cette taxation de la rémunération des traders ne vient pas de notre pays, et donc de notre Gouvernement, mais a été, en quelque sorte, lancée par le Président des États-Unis et, en Europe, par le Premier ministre britannique.
À chaque pays évidemment, ensuite, de fixer les conditions de cette taxation, d’un caractère quelque peu symbolique et qui apparaît un peu comme la « queue de la comète » de la crise financière.
La taxe, exceptionnelle, que l’on met en place avec cet article 1er, est en effet un peu le moins que l’on pouvait faire après une crise financière qui a provoqué un large investissement des États en soutien des activités bancaires et ne semble pas avoir fait renoncer les établissements financiers à leurs mauvaises habitudes.
Les 360 millions d’euros attendus du rendement de la taxe ainsi mise en œuvre peuvent-ils et doivent-ils nous faire oublier que nous avions ici même débattu, fin 2008, d’un plan de sauvetage bancaire de 360 milliards d’euros – c'est-à-dire mille fois plus... – qui est quasiment forclos aujourd’hui ?
Certains établissements de crédit ont en effet évité la faillite pure et simple grâce à l’intervention publique, mais aucune des banques concernées par le plan de sauvetage – dans des proportions globalement bien moins élevées que la ligne de crédit qui avait été ouverte – n’a véritablement modifié ses pratiques.
Aucune de nos banques n’a cessé de jouer le jeu de la spéculation sur les marchés – seules les mouches ont changé d’âne, selon l’expression populaire –, en passant des produits dérivés sur des crédits immobiliers américains au marché des matières premières et désormais aux valeurs obligataires, et surtout, la pratique du crédit aux entreprises ne s’est aucunement améliorée.
C’est ainsi que, malgré l’intervention du Médiateur du crédit, René Ricol, devenu depuis quelques jours le Commissaire général à l’investissement, le niveau global des prêts bancaires aux entreprises s’est réduit, limitant par conséquent les moyens de financer le développement de l’activité économique, et participant par là même à la récession économique.
La baisse de 7, 6 points de l’investissement productif, résulte aussi, selon nous, de cette contraction du crédit aux entreprises, alors même que tout était a priori réuni pour que ce crédit soit facilité.
Le plan de sauvetage bancaire, peu exigeant sur les contreparties, privant l’État sur le fond comme sur la forme d’une véritable prise de participation au capital, donc aux décisions, de nos établissements de crédit, n’aura donc servi qu’à conforter la position de ces établissements et à permettre la distribution de ce dont nous découvrons la trace pour le moins déroutante, c'est-à-dire la poursuite des rémunérations discrétionnaires, des bonus et des primes dévolues aux « bons acteurs » de marché !
Et les 360 millions d’euros de taxe affectés au financement des actions d’OSEO ne feront jamais oublier les milliards d’euros que l’État aurait pu récupérer, sans douleur particulière, en entrant effectivement dans le capital de nos banques. Ils apparaissent, du fait même du caractère exceptionnel de la taxe, comme un faux-semblant.
Nous ne pensons pas que la taxation des opérations de marché devrait se contenter d’être une mesure de caractère exceptionnel, comme on nous y incite. Ces pratiques doivent être durablement découragées.
Telles sont les raisons d’être des amendements que nous avons déposés sur cet article 1er.

Si j’ai souhaité intervenir de nouveau sur le problème soulevé dans l’article 1er, c'est-à-dire la taxe sur les bonus introduite par le Gouvernement dans ce projet de loi de finances rectificative, c’est parce que Mme Lagarde était retenue hier par ses obligations à Bruxelles. En conséquence, je n’ai pas obtenu de réponses de la part de M. Woerth, qui sans doute vous réservait le soin de me les apporter, madame la ministre. Cependant, je ne suis pas sûre que mes demandes vous aient été transmises.
Le texte issu de l’Assemblée nationale a profondément modifié la taxe introduite par le Gouvernement en l’améliorant. Ainsi, nos collègues députés ont obtenu que son produit soit affecté au budget général de l’État et n’abonde pas, comme il devait l’être grâce à la manœuvre habile préparée par vos collaborateurs et que vous aviez assumée, le fonds de garantie des dépôts, dont le plafond était relevé à 100 000 euros par une directive européenne de mars 2009.
Madame la ministre, l’une de mes questions portait sur le délai et la manière selon lesquels le gouvernement français entendait transposer la directive pour qu’elle soit applicable. Même si cela ne relève pas de la loi mais du règlement j’aimerais vous entendre à ce sujet.
Le dispositif fragile que vous aviez inscrit dans le projet de loi a été démonté par nos collègues députés et c’est un point très positif.
Néanmoins, il subsiste un certain nombre d’interrogations qui justifient les amendements que nous allons présenter.
Le périmètre que vous avez choisi est la reprise exacte de l’arrêté de novembre 2009 ; il se limite donc aux opérateurs de marché. Le rapporteur général l’a légèrement élargi en impliquant toute la chaîne de commandement, appelée la « chaîne hiérarchique ». Je vous pose donc également une question à ce sujet. Il est dommage que le périmètre n’inclue pas les fonds alternatifs, les hedge funds, qui sont des spéculateurs actifs, notamment dans la crise de l’endettement public dont vous vous occupez, en particulier la crise de la Grèce.
Pour nous, le périmètre doit être beaucoup plus large. Lors des premières discussions qui ont eu lieu au niveau international au cours du G20 de Washington en novembre 2008, une prise de conscience globale a eu lieu sur le fait que les rémunérations, notamment les rémunérations variables et parmi elles les bonus – mais il n’y a pas qu’eux –, avaient finalement accéléré la crise financière, dans la mesure où le gain à court terme et excessif avait été produit par une prise de risque irresponsable.
Lors des sommets internationaux, il a été unanimement reconnu qu’il fallait stopper ces mécanismes de rémunération fondés sur le court terme et le risque irresponsable. Cependant, les déclarations ont été suivies de peu d’effet, notamment d’effet législatif ; je n’y reviens pas, toutes les initiatives prises depuis ces déclarations étant passées en revue dans le rapport de la commission.
Il reste néanmoins dommage que la taxe ne concerne pas la totalité des salariés. Certes, le seuil retenu, fixé à 27 500 euros, est tout à fait raisonnable – c’est celui qu’ont choisi les Britanniques –, mais il faudrait qu’il vise l’ensemble des salariés touchant ce type de rémunérations.
Nous avons certainement un différend avec le Gouvernement, comme nous en avons eu un avec la commission, sur un autre sujet que vous connaissez bien, madame la ministre : la déductibilité de cette taxe bonus au titre de l’impôt sur les sociétés. Une telle compensation, d’une part, prive le budget d’une recette et, d’autre part, est difficilement compréhensible. Elle fait du reste l’objet d’un de nos amendements.
Nous aurons demain les résultats des banques pour l’année 2009. Peut-être nous confirmerez-vous, madame la ministre, que celui de la BNP, pour ne pas la citer – c’est le seul résultat connu pour l’instant –, s’élève à 5, 3 milliards d’euros. Rendre la taxe déductible de l’impôt sur les sociétés pour des banques auxquelles l’État, donc le contribuable, a été obligé d’accorder des aides, même si celles-ci ont été remboursées, c’est tout de même un peu fort de café !
Pour terminer, monsieur le président, je voudrais revenir sur un point que Mme la ministre connaît déjà, puisqu’elle l’a abordé dans les déclarations qu’elle a faites au Canada, il y a une dizaine de jours, à l’issue du G7 des ministres des finances.
Du fait de son caractère de réparation, la taxe bonus, nous dit-on, concerne le passé. Pour l’avenir, la taxe assurantielle, qui reviendrait à ce que les banques s’assurent elles-mêmes par le biais d’une prime d’assurance, en est encore à l’état purement déclaratif. Elle permettrait pourtant d’éviter que les États ne soient les assureurs de dernier ressort et, in fine, ne se voient éventuellement contraints de s’endetter eux-mêmes en cas de nouvelle crise financière – alors même qu’aujourd’hui la spéculation s’opère sur la dette publique. Vous avez affirmé, madame la ministre, que vous n’étiez pas opposée au principe d’une telle taxe assurantielle à partir du moment où tout le monde l’appliquait : or l’expérience montre que, lorsque tout le monde attend que tout le monde agisse, rien ne bouge, et, depuis 2008, rien n’a bougé.
Je ne pense pas que la taxe sur les bonus soit une réparation pour le passé, pas plus qu’elle n’est une prévention pour l’avenir : on le voit bien, les mauvais comportements que nous avons connus hier continuent, et même de plus belle.

Je souhaite, en écho à la discussion qui a eu lieu au sein de la commission des affaires européennes, interroger Mme la ministre sur l’avancement des négociations, aujourd’hui très laborieuses, relatives à la taxe sur les bonus.
L’article dont nous abordons l’examen institue donc une taxe sur les « bonus » versés en 2009 à certains salariés des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. Il vise à mettre en œuvre les principes arrêtés en 2009, en particulier lors des sommets du G20, pour faire en sorte que les pratiques de rémunérations ne mettent pas en péril la stabilité financière.
Le rapporteur général le note dans son rapport : le champ d’application de cette taxe gagnerait à être élargi. La commission des finances propose ainsi d’intégrer dans son assiette les bonus perçus par les responsables hiérarchiques des opérateurs des salles de marché.
Le champ d’application de cet article aurait également pu être étendu, pour que la régulation de la sphère financière soit poussée plus loin, à d’autres établissements financiers, par exemple aux sociétés de gestion de portefeuilles qui opèrent sur des fonds spéculatifs, dont les fameux hedge funds.
À cet égard, je rappelle que les négociations sur la proposition de directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, que la Commission européenne a présentée le 30 avril 2009, n’ont pas encore abouti. Ce texte controversé, bien plus politique que ses dispositions techniques ne le laisseraient penser de prime abord, vise à réglementer au niveau communautaire l’activité des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, qui font actuellement l’objet de dispositions nationales.
Le champ de cette proposition de directive est très large puisque sont concernés les fonds spéculatifs, les fonds de capital-investissement, les fonds immobiliers, les fonds de matières premières, mais aussi les fonds d’infrastructures et d’autres types de fonds institutionnels. Je rejoins là ma collègue Nicole Bricq, qui souhaitait à l’instant que l’on puisse élargir le champ d’application de la taxe et y inclure le plus vite possible l’ensemble de ces fonds.
J’ai présenté le 3 février dernier, devant la commission des affaires européennes, une communication sur l’état d’avancement des négociations européennes, certes laborieuses, sur ce texte. Il est vrai qu’entre le texte d’une proposition de directive déposée par la Commission européenne et celui de la directive qui est définitivement adoptée, au terme de négociations qui peuvent durer des mois, voire davantage, les différences peuvent être considérables sans que la représentation nationale en soit nécessairement informée, ce qui est tout à fait regrettable.
Nous avons pris note, madame la ministre, d’informations faisant état d’avancées dans la discussion, en particulier de rapprochements des positions entre la France, l’Allemagne et quelques autres pays continentaux. Il semble néanmoins que subsistent quelques différends notables avec le Royaume-Uni.
Nous souhaiterions donc que le Gouvernement puisse préciser quels points de blocage pourraient éventuellement être surmontés, et selon quel calendrier, afin qu’un accord puisse être trouvé au plus vite sur ce texte. Nous avons conscience que l’article 1er du projet de loi de finances rectificative, tel qu’il nous est soumis aujourd’hui, représente déjà un premier pas sur un chemin qui sera encore long avant que nous ne parvenions à une réglementation à peu près homogène à l’échelle européenne. Or chacun sait que cette homogénéité est une condition préalable à une gestion rigoureuse et sérieuse de la question des bonus.
Aussi, madame la ministre, il serait fort utile que vous nous apportiez des informations sur tous ces points avant que nous n’ayons à nous prononcer sur l’article 1er.

Le dispositif de taxation des bonus qui nous est proposé est clairement ciblé sur les opérateurs de marché – en clair, les traders – employés par des banques ou des entreprises d’investissement indépendantes ou filiales de banques. En revanche, comme mes prédécesseurs à ce micro viennent de le souligner, il ne couvre pas les bonus des gérants des fonds alternatifs, ou hedge funds, alors que ces personnes exercent grosso modo les mêmes activités – ce sont d’ailleurs souvent d’anciens traders – et perçoivent des rémunérations variables très élevées, et que les fonds pour lesquels elles travaillent peuvent avoir des effets déstabilisants, on l’a vu la semaine dernière avec la crise de la dette grecque.
On peut cependant, madame le ministre, comprendre les raisons qui, à ce stade, ont déterminé le choix du Gouvernement.
En premier lieu, le dispositif français se veut le plus proche possible de celui de la Grande-Bretagne, et ce afin d’éviter tout nouveau désavantage compétitif à l’égard de la place de Londres, notre principal concurrent. Or la taxe britannique ne couvre pas les bonus des gérants de hedge funds.
En deuxième lieu, ces fonds alternatifs n’ont pas joué les premiers rôles dans la crise financière. Ils ont supporté directement certaines de ses conséquences, avec la fuite de leurs investisseurs, et le paysage de ces fonds a été considérablement assaini depuis 2008, après des années de croissance facile, voire de croissance folle.
En troisième lieu, le problème des fonds alternatifs vient avant tout, je voudrais le souligner, de leur manque de transparence, du faible niveau de régulation et de diligences auquel ils sont soumis dans certaines juridictions, et de leur recours parfois opaque et excessif aux effets de levier. Il apparaît donc préférable – c’est la voie que vous nous proposez, madame la ministre, mais je voudrais vous demander quelques précisions à ce sujet – de privilégier une stratégie de rapatriement de ces fonds pour en faire des fonds onshore, c’est-à-dire pour susciter leur existence dans un cadre français et européen régulé. De fait, le droit français prévoit des véhicules spécifiques : nous avons créé les OPCVM contractuels, les OPCVM à règles d’investissement allégées, dédiés à des investisseurs qualifiés et dont les sociétés de gestion font l’objet d’un agrément. De même, la proposition de directive sur l’encadrement des gérants de fonds alternatifs, dite « directive AIFM », présentée par la Commission européenne le 29 avril 2009, fait actuellement l’objet de négociations au sein du Parlement européen et entre les États membres.
Il serait heureux que vous nous confirmiez, madame le ministre, les positions que vous avez prises à ce sujet, car, si nous n’avons pas étendu la taxe que vous nous proposez aux opérateurs des hedge funds, c’est pour éviter de rendre encore plus difficile la négociation dans laquelle vous êtes investie.
La commission des finances a déjà relevé les principaux enjeux de cette directive très importante dans son rapport d’octobre dernier sur la modernisation de la régulation financière. Parmi ces enjeux figurent la définition du champ de la directive, la question très controversée du « passeport » des gestionnaires de pays tiers, l’indépendance de la valorisation des fonds, mais aussi la rémunération des gestionnaires.
Vous avez déjà beaucoup œuvré, madame la ministre, dans le cadre de ces travaux internationaux et européens. Les fonds alternatifs peuvent être pour certains un objet de fantasmes et d’opprobre excessifs ; il n’en reste pas moins que la crise a mis en relief, dans ce domaine aussi, la nécessité de mieux encadrer, mais d’encadrer de façon concrète et réaliste. Car, ici comme ailleurs, « le diable est dans les détails » !
Je souhaiterais donc que vous puissiez nous exposer avec précision les options défendues par le gouvernement français dans les négociations européennes et internationales. Notamment, je me pose les questions suivantes : quel sera le rôle des autorités nationales de régulation ? Comment est envisagée la question de l’effet de levier ? La question des rémunérations des gestionnaires est-elle oui ou non sur la table ? Le passeport des gestionnaires offshore est-il désormais écarté ? Le régime des « fonds alternatifs à la française » est-il à la fois suffisamment sûr et attractif ?
Si vous pouviez nous éclairer sur ces points, madame la ministre, nous serions confortés dans notre choix de ne pas encore intervenir sur ce champ. Néanmoins, si nous avions le sentiment que tout cela n’avance pas et n’est pas promis à un accord réaliste, nous nous réserverions bien entendu la possibilité de revenir sur le sujet à l’occasion d’un prochain texte. Et puisque j’invoquais le diable : ce serait tout de même bien le diable que l’on n’ait pas d’autre loi de finances rectificative dans le courant de cette année 2010 !
Sourires
Nouveaux sourires
Mesdames, messieurs les sénateurs, avant de répondre de manière détaillée aux questions qui m’ont été posées, concernant notamment la rédaction actuelle de la directive AIFM et les suites que nous en attendons, permettez-moi de revenir quelques instants sur les conditions dans lesquelles l’article 1er de ce projet de loi de finances rectificative a été élaboré.
Cet article dispose qu’est soumise à une taxation de 50 % la part variable des rémunérations octroyées aux opérateurs de marché. M. le rapporteur général défendra tout à l'heure, au nom de la commission des finances, un amendement qui tend à élargir quelque peu le champ des personnes dont les rémunérations feront l’objet de cette taxation, amendement qui, je le dis d’emblée, m’inspire une certaine sympathie…
Cette disposition revêt un caractère exceptionnel, car elle s’inscrit dans une période exceptionnelle, durant laquelle l’État a apporté un concours exceptionnel à l’ensemble des établissements visés par l’article 1er, tout simplement pour permettre le financement de l’économie à un moment où l’ensemble des circuits de financement étaient totalement asséchés par la crise financière, largement importée des États-Unis.
J’indique à M. Foucaud qu’il faut clairement distinguer, d’une part, la taxation annoncée par le président des États-Unis et, d’autre part, le projet franco-britannique présenté tout à la fois par le Premier ministre britannique, M. Gordon Brown, et par le Président de la République, Nicolas Sarkozy, concernant la taxation exceptionnelle des rémunérations variables des opérateurs de marché.
La taxation annoncée, puis commentée par le président des États-Unis, et dont les modalités évoluent d’ailleurs au fil des déclarations, n’a rien à voir avec le dispositif que nous mettons en place. Aux États-Unis, la taxation, qui porte d’ailleurs sur des montants bien plus importants, est destinée à compenser, sur une période de dix, voire douze ans, la perte nette subie par les contribuables américains à la suite du programme TARP mis en place, sous la présidence Bush, par le prédécesseur de M. Timothy Geithner. Il s’est agi d’un plan massif de soutien à un système bancaire en très mauvaise situation, avec un coût net pour le contribuable américain. Le programme TARP comportait d’ailleurs un dispositif permettant le remboursement par les banques, sur une période donnée, des aides financières ainsi consenties.
Autrement dit, la taxation « à l’américaine » est de nature à compenser des pertes sèches, tandis que la taxation que nous prévoyons est exceptionnelle parce qu’elle est liée à des circonstances exceptionnelles.
Il faut bien comprendre que nous souhaitons très vivement coller le plus possible au mécanisme mis en œuvre par les Britanniques, ou plutôt, devrais-je dire, au mécanisme actuellement en cours de discussion – car nous sommes un peu plus avancés qu’eux sur le sujet – afin d’éviter, comme vous l’avez précisé, monsieur le rapporteur général, tout déséquilibre compétitif dont les opérateurs tireraient très rapidement parti.
Le Président de la République avait clairement annoncé, lors de la conférence de presse qu’il a tenue le 25 août dernier à l’issue de la réunion qu’il avait organisée avec l’ensemble des dirigeants de banque, que cette taxation exceptionnelle devait être affectée à la garantie du système. C’est dans ces conditions que nous avons élaboré ce dispositif, que Mme Bricq a qualifié, si je me souviens bien, de « subtile architecture », en prévoyant que les fonds ainsi collectés viendraient renforcer le Fonds de garantie des dépôts, en vue précisément de garantir les avoirs de nos déposants.
À l'Assemblée nationale, à l’issue d’un débat nourri et fructueux avec la majorité et avec les membres de la commission des finances, nous avons modifié, par amendement gouvernemental, l’affectation de ces fonds puisque le produit de cette taxe est désormais destiné à OSEO pour financer les petites et moyennes entreprises.
Madame Bricq, la transposition de la directive se fera par voie réglementaire, au plus tard le 31 décembre 2010, de manière qu’elle soit effective au 1er janvier 2011. Ensuite, il faudra bien entendu appeler les fonds nécessaires pour renforcer le montant de la garantie, qui passera de 70 000 euros à 100 000 euros.
Monsieur le rapporteur général, je vous répondrai très précisément sur la question des fonds alternatifs, également évoquée par M. Marc.
Il s’agit d’un phénomène important puisque les fonds alternatifs concourent manifestement, par leur volatilité, à des mouvements parfois extrêmement brutaux sur un certain nombre de marchés. Leurs déplacements d’un marché à l’autre peuvent évidemment donner lieu à des déséquilibres.
Le G20 avait décidé qu’aucun acteur, aucun produit, aucun marché n’échapperait à la régulation. Établie conformément à ces conditions, la directive européenne sur les fonds alternatifs est actuellement soumise à l’examen à la fois du Parlement européen – je salue au passage le travail exceptionnel, très technique et très précis, de son rapporteur, Jean-Paul Gauzès, qui œuvre pour faire avancer ce texte le plus rapidement possible – et du Conseil, puisqu’il s’agit d’une codécision.
Une bonne nouvelle : tant le commissaire au marché intérieur et aux services financiers, Michel Barnier, que j’ai rencontré ce matin à l’occasion de la réunion du conseil Ecofin, que la présidence espagnole souhaitent faire aboutir ce texte avant la fin du mois de juin 2010. La commission économique et financière du Parlement européen, le conseil Ecofin et la Commission européenne travaillent de concert, avec le même souci d’une adoption rapide de ce texte. Mais il est clair que, s’agissant d’une codécision, le texte final devra être le fruit d’un consensus.
Monsieur le rapporteur général, trois maîtres mots caractérisent, me semble-t-il, la question des fonds alternatifs : régulation, transparence et intégration.
Concernant la régulation, la directive prévoit un enregistrement des gestionnaires des fonds alternatifs et introduit des règles quant aux fonds propres, des règles de gestion des conflits d’intérêts, des principes de gouvernance et de gestion des risques.
Concernant la transparence, nous menons aujourd'hui un travail parallèle, mais indispensable, pour que cette directive prospère. On le constate bien souvent, les fonds alternatifs opèrent sur le marché OTC, sur lequel les informations sont très limitées.
Corrélativement au chantier de la directive, nous devons faire avancer celui qui est relatif aux plateformes de compensation, au niveau français certes, mais bien plus encore au niveau des zones monétaires, notamment la zone euro, sur lesquelles nous manquons aujourd'hui d’éclairage. Il faut que nous puissions vraiment connaître les mouvements des fonds.
La directive met donc fin à une sorte d’obscurité dans laquelle prospèrent les fonds alternatifs en prévoyant la communication d’informations aux autorités de supervision.
Concernant l’intégration, la directive vise à bâtir un marché européen sûr et intégré pour la gestion d’actifs garantissant un niveau élevé de protection des investisseurs. L’objectif est de faire de ce cadre de régulation un standard international de référence pour la régulation de tels fonds.
Une question a donné lieu à de sérieuses difficultés entre différents États membres ; je veux parler du passeport.
Dans sa rédaction initiale, la directive telle qu’elle avait été élaborée par le prédécesseur de Michel Barnier à la Commission, Charlie McCreevy, notamment, prévoyait un mécanisme de passeport qui autorisait que des fonds off shore, et non pas on shore, soient parfaitement habilités à intervenir sur le marché européen. Ce dispositif a été écarté, grâce à l’action déterminée de la France.
La France souhaite par ailleurs que l’autorité européenne qui rassemblera les superviseurs de marché, l’ESMA, soit dotée d’un pouvoir de plafonnement de l’effet de levier en cas de circonstances exceptionnelles. Ce débat est indispensable, mais il sera, je ne vous le cache pas, très difficile, car cette mesure n’est guère souhaitée par un certain nombre d’autres États membres.
À propos de la rémunération, la France a demandé l’application de toutes les règles du G20 aux rémunérations des gérants de fonds. Ce dossier avance, mais, là aussi, nous ne sommes certainement pas encore au bout du chemin !
Enfin, je souhaite que, sur le territoire français, l’Autorité des marchés financiers ait la capacité d’enregistrer et de contrôler l’activité des fonds alternatifs.
Pour conclure, je tiens à vous remercier, monsieur le rapporteur général, de l’action que vous menez au sein du Haut Comité de place. Si nous avons notamment amélioré le dispositif OPCVM et si nous pouvons soutenir que la place de Paris est propice à la gestion d’actifs dans des conditions de transparence et de régulation convenables, c’est notamment grâce à votre action au sein de ce comité.

L'amendement n° 117, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après les mots :
code monétaire et financier
insérer les mots :
, autres que celles mentionnées à l'article L. 532-9 du même code,
La parole est à M. Philippe Dominati.

Permettez-moi, au préalable, de vous remercier, madame la ministre, des explications particulièrement complètes et précises que vous avez apportées au sujet de l’article 1er. Grâce à vous, la France continue de jouer un rôle moteur dans les discussions internationales, ce qui me satisfait grandement.
Toutefois, je formulerai trois remarques.
Premièrement, lorsque l’on joue un rôle de challenger, on doit avoir un différentiel positif vis-à-vis de ses concurrents. En l’espèce, notre concurrent, c’est la place de Londres, qui ne fait pas partie de la zone euro. Nous avons donc un double rôle de challenger à assumer, en nous méfiant à la fois de la compétitivité britannique et de celle des autres pays européens.
J’aimerais avoir l’assurance que le rôle moteur que joue la France ne sera pas, à terme, de nature à nous déséquilibrer.
Deuxièmement, dès lors qu’il est question de taxe ou d’impôt exceptionnel, on craint que l’État, par une sorte d’effet d’addiction aux recettes, ne cherche à la ou le rendre permanent ! De fait, plus on étend le champ de ses recettes, plus il lui sera difficile, à l’avenir, de s’en passer.
Ma troisième remarque sera d’ordre politique.
Le gouvernement français trouve de temps en temps sa source d’inspiration auprès de son homologue britannique, gouvernement travailliste, social-démocrate. Il serait souhaitable qu’il trouve auprès de nos voisins la même inspiration pour tout ce qui concerne les dépenses publiques ou encore la rémunération des fonctionnaires. Au demeurant, on ne sait pas ce que, dans un an, il adviendra de cette politique, car on ne sait pas si le peuple britannique voudra maintenir cette tendance de fond.
Pour ce qui est de l’amendement n° 117, je l’ai déposé dans un souci de clarification, afin de m’assurer que le champ d’application de cette taxe correspond à celui qui est retenu par les normes européennes et nationales en matière de régulation prudentielle et que les sociétés de gestion en sont donc exclues.

Je pense que cet amendement d’appel est satisfait par le texte qui nous est soumis.
Dans la rédaction actuelle, les sociétés de gestion de portefeuilles sont très clairement exclues du champ d’application de cette disposition. Dès lors, il est logique d’exclure également les autres entreprises d’investissement qui ne pratiquent pas la négociation pour compte propre. Rappelons-le, l’objectif est de veiller à une bonne maîtrise des risques encourus par le placement des fonds propres de l’entreprise.
Mais je sollicite l’avis du Gouvernement, et j’espère que la réponse de Mme la ministre vous conduira, mon cher collègue, à retirer votre amendement.
Je vous encourage effectivement, monsieur Dominati, à retirer votre amendement.
Je reprends à mon compte la distinction opérée par M. le rapporteur général entre, d’un côté, les gérants de SICAV ou d’OPCVM et, de l’autre, les gérants qui font de la gestion pour compte propre dans les établissements financiers.
Votre amendement est satisfait, puisque l’article 1er du projet de loi vise implicitement à exclure les sociétés de gestion du champ de la taxe en se fondant sur une acception étroite de la notion d’entreprise d’investissement, dont la réglementation prévue par le code monétaire et financier n’est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille que dans des conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Par conséquent, implicitement, la référence étroite dans l’article 1er exclut les sociétés de gestion telles que les SICAV ou les OPCVM.

L'amendement n° 117 est retiré.
L'amendement n° 95, présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Remplacer le mot :
exceptionnelle
par le mot :
spéciale
La parole est à M. Thierry Foucaud.

Par souci de cohérence, je vais faire une présentation globale de nos amendements portant sur l’article 1er.
Remarquons tout d’abord que nous n’avons trouvé aucun amendement visant à remettre en question le dispositif de cet article. Tout se passe donc comme si ceux qui, dans le passé, ont voté sans trop sourciller l’ensemble des textes libéralisant largement les activités financières se rendaient compte, peut-être sous la pression de l’opinion publique, qu’il est indispensable de « marquer le coup » un peu plus d’un an après le déclenchement de la crise financière.
Une telle situation ne serait sans doute pas advenue sans les quelques initiatives qui ont été prises à l’échelon international, initiatives qui, hélas, nous ne pouvons que le souligner, ne sont donc pas d’origine française…
Nous voici en présence d’une taxe exceptionnelle – j’ai bien entendu tout à l'heure Mme le ministre y insister – portant sur la rémunération des traders, taxe d’autant plus justifiée que les banques de notre pays ont été quelque peu secourues par l’État, c’est-à-dire grâce à de l’endettement public. C’est ce que rappelait aussi notre collègue Nicole Bricq dans son intervention sur l’article.
Pour notre part, nous sommes partisans de donner à cette taxe un caractère pérenne – c’est le sens de notre premier amendement –, ce qui implique naturellement de limiter à la seule année 2009 le versement au profit d’OSEO du produit de la taxe dans sa totalité, quitte à en faire par la suite une recette du budget général.
Outre le fait que nous sommes en accord avec l’amendement de la commission des finances qui tend à accroître le nombre des redevables de la taxe en intégrant la rémunération des cadres dirigeants des entreprises de marché, il nous semble qu’il importe de donner un caractère pérenne et donc plus efficient à une telle taxation.
La taxe doit, à notre sens, participer d’une logique de « dés-incitation », ramenant de fait les établissements de crédit vers leur mission principale, à savoir le financement de l’économie et son développement, et non, comme cela a trop souvent été le cas, la spéculation sur des valeurs de marchés et produits dérivés.

Il est vrai que cette taxe est annuelle. Mais le budget l’est aussi ! Par conséquent, chaque année, on pourra reparler de ce sujet.
L’approche qui a été exposée ici est liée à la situation très spécifique du secteur bancaire en 2008-2009. Mais ne préjugeons pas de l’avenir. Au reste, il faudra aussi trouver des recettes pour les budgets futurs.
Pour le moment, c’est une taxe exceptionnelle et la commission la conçoit ainsi. De ce fait, celle-ci est défavorable aux amendements de M. Foucaud.
Défavorable, monsieur le président, car il s’agit bien d’une taxation exceptionnelle pour des circonstances exceptionnelles. Par conséquent, nous ne souhaitons pas pérenniser cette taxation.
En revanche, je voudrais attirer l’attention de M. Thierry Foucaud et des membres de cette assemblée sur le caractère pérenne de l’autre taxation, celle que nous avons mise en œuvre pour financer la supervision et qui, elle, est évidemment pérenne, à la différence de la taxation exceptionnelle sur les bonus.
Il est une autre taxation dont nous serons amenés plus tard à examiner le fondement, dès lors qu’il serait international : c’est la taxation à laquelle réfléchit actuellement le Fonds monétaire international, qui nous rendra ses travaux au mois d’avril. Elle serait parfaitement justifiée dès lors qu’elle constituerait un mécanisme permettant de prévenir le risque sous une forme assurantielle ou sous une autre – la forme assurantielle n’est pas prédéterminée – et dès lors qu’il s’agirait bien d’un instrument international applicable à tous les établissements financiers et non aux établissements financiers français ou de tel ou tel autre pays.
On en revient là au débat sur l’avantage compétitif dont bénéficieraient ceux qui ne seraient pas soumis à cette taxation.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 59 rectifié, présenté par MM. Collin et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 1, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cette taxe est affectée, selon des modalités définies en loi de finances, aux établissements publics ou privés qui financent les investissements créateurs d'emplois des entreprises, leurs actions de recherche et d'innovation, ainsi que les domaines de leur activité présentant un intérêt national.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 96, présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 1, seconde phrase
Remplacer les mots :
dans la limite de 360 millions d'euros
par les mots :
pour l'année 2009
La parole est à M. Thierry Foucaud.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 85, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Cette taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
La parole est à Mme Nicole Bricq.

Madame le ministre, vous vous référez aux Britanniques, et vous l’avez encore fait tout à l’heure. Vous les suivez pour éviter une perte de compétitivité de la place de Paris, mais ils ont choisi, eux, de ne pas rendre la taxe sur les bonus déductible de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. C’est un premier motif pour lequel nous avons déposé cet amendement.
Plus fondamentalement, cette taxe, telle qu’elle est conçue, ne permettra pas d’éviter les comportements à risque. Elle n’est pas faite non plus en vue d’une réparation Or, même si la procédure ne présente qu’un caractère exceptionnel, sur lequel vous insistez beaucoup, elle doit quand même être liée à la réparation due au peuple français.
Vous pouvez toujours dire que la plupart des banques ont remboursé, mais, nous le savons bien, les bilans ne sont pas encore complètement « nettoyés » et quelques-unes comptent encore beaucoup d’actifs dits « toxiques ». Certaines d’entre elles ont même incité des petits porteurs à souscrire de tels actifs. Je ne les citerai pas, car je ne suis pas là pour faire de la dénonciation ; de toute façon, sur la place de Paris, tout le monde les connaît !
Par conséquent, cette taxe sur les bonus devrait, nous semble-t-il, illustrer cette réparation pour le passé. Si, comme vous l’avez voulu au départ, elle est indolore pour les opérateurs financiers, franchement, à quoi sert-elle ?
L’argument que vous nous opposez est connu : selon le droit commun, les impôts et taxes de toute sorte doivent être déductibles et il n’est pas possible de payer un impôt sur un impôt. Permettez-moi cependant de vous faire remarquer qu’il existe déjà une exception à cette règle : la CSG comporte une part non déductible ! On me rétorquera évidemment – ce débat remonte à plus de vingt ans ! – que ce n’est pas un impôt, mais un prélèvement. Aujourd’hui, il me paraît vraiment difficile de le prétendre !
En bref, pour les trois raisons que j’ai indiquées, cette taxe ne doit pas être déductible de l’impôt sur les sociétés.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement parce qu’elle est opposée au principe de la double peine
Souriressur les travées de l’UMP

Quant à la disparité avec la Grande-Bretagne, madame Bricq, je pense que Mme la ministre vous apportera les éléments d’information nécessaires.
Madame Bricq, vous avez raison pour ce qui est du projet : le principe de la non-déductibilité y est prévu, mais la question ne sera pas débattue avant un certain temps, car le projet de budget britannique sera examiné plus tard.
Nous essayons d’établir deux régimes parallèles. Si vous avez lu les réponses que j’ai faites à l’Assemblée nationale, vous constaterez que mon point de vue n’a pas varié à ce sujet. Nous parvenons à une espèce de parité entre le mécanisme français et le mécanisme britannique, compte tenu des différences existant par ailleurs : les banques françaises sont soumises à la taxation sur les salaires, ce qui n’est pas le cas des banques britanniques.
La cote n’est donc pas parfaitement taillée, mais elle respecte néanmoins le principe de notre droit fiscal qui est d’éviter la double peine, sauf pour les amendes, ce qui, en l’occurrence, n’est clairement pas le cas.
C’est pour tenir compte de l’absence de taxe sur les salaires en Grande-Bretagne que nous avons préféré mettre en place le principe de la déductibilité.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune et tous deux présentés par M. Jégou.
L'amendement n° 49 est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Après les mots :
rémunérations attribuées,
insérer les mots :
au titre de leur activité exercée en France,
II. - Alinéa 3
Après les mots :
part variable
insérer le mot :
discrétionnaire
L'amendement n° 51 est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
rémunérations attribuées,
insérer les mots :
au titre de leur activité exercée en France,
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Madame la ministre, dans votre propos liminaire, vous avez complété vos précédentes déclarations et éclairé le débat. Toutefois, les quatre amendements que je présenterai ont pour objet d’apporter des précisions.
L’amendement n° 49 vise à préciser la nature des rémunérations constituant l'assiette de la taxe ainsi que le périmètre de cette taxe. Dans l’échange que vous avez eu avec le rapporteur général, il était bien question d’activités de marché. Il convient donc de viser les professionnels des marchés dont les activités sont porteuses de risques pour l'entreprise et qui perçoivent des bonus très généralement discrétionnaires. C'est d'ailleurs l'assiette retenue par le projet de taxation en Grande-Bretagne, pays avec lequel nous agissons en parallèle.
Soit vous précisez qu’il en est bien ainsi, madame la ministre, et cet amendement deviendra sans objet, soit ce n’est pas le cas et mon amendement se révélera pertinent.
L’amendement n° 51 vise, tout comme le I de l’amendement n° 49, à préciser que sont visées les activités exercées dans notre pays.

En ne visant que les bonus « discrétionnaires », on risque d’exclure de l’assiette les bonus garantis sur un an, dont l’arrêté du 3 novembre 2009 maintient la possibilité. En effet, cet arrêté prévoit notamment que « les entreprises assujetties veillent, concernant les salariés, professionnels des marchés financiers, dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur leur exposition aux risques, […] à ce que la rémunération variable ne soit pas garantie au-delà d’un an ».
Incidemment, on peut rappeler que le groupe de travail de la commission des finances sur la crise financière et la régulation des marchés, dans son rapport d’information d’octobre 2009, a préconisé de manière plus stricte d’interdire toute forme de bonus garanti.
Quant à la précision concernant la territorialité, elle crée une ambiguïté qui pourrait contribuer à diminuer l’assiette, car le critère d’activité exercée en France par les opérateurs de marché n’est pas aussi clair que celui de domiciliation fiscale ou d’exploitation d’une entreprise en France.
Qu’en est-il, par exemple, des opérateurs employés en France, mais qui réalisent des opérations exclusivement sur les marchés étrangers : britannique, américains, asiatiques, etc. ? Pareillement, qu’en est-il des opérateurs, même s’il s’agit de cas marginaux, qui exercent majoritairement en France, mais ont aussi des activités à Londres ou dans d’autres places ?
Au regard de ces différentes questions, la commission souhaite vivement entendre votre avis, madame la ministre.
Sur l’amendement n° 49, le Gouvernement a émis un avis défavorable, pour les raisons évoquées par M. le rapporteur général.
La rémunération variable inclut aussi les sommes versées au titre des bonus garantis, qui sont autorisés exclusivement dans la limite d’une année. Pourquoi ces rémunérations, prévues par la réglementation et plafonnées à un an, échapperaient-elles à la taxation ?
Par ailleurs, il ne semble pas pertinent de mettre en place un mécanisme incitatif pour une pratique que nous acceptons, mais de manière restrictive.
En ce qui concerne l’amendement n° 51, je préfère en rester à la formulation prévue dans le texte, laquelle a pour avantage de clarifier très précisément le champ d’application et d’éviter ainsi tout risque de contournement et de débordement.
Le texte permet ainsi d’appliquer le mécanisme de taxation à 50 % sur la rémunération de tous les salariés de l’entreprise visés par le dispositif. Ceux-ci sont donc clairement identifiés puisqu’ils sont liés à l’entreprise par un contrat de travail. Cela permet d’éviter un champ d’application à géométrie variable ou dont la délimitation serait floue.
Le Gouvernement vous demande donc, monsieur Jégou, de bien vouloir retirer les amendements n° 49 et 51. À défaut, il se verra contraint d’émettre un avis défavorable.

Madame la ministre, après vous avoir écouté attentivement, je retire l’amendement n° 49.
Sur l’amendement n° 51, vos propos ne m’ont pas vraiment convaincu, mais peut-être ne les ai-je pas bien compris.
Nous souhaitons insérer les mots « au titre de leur activité exercée en France » pour une raison simple : il paraît tout de même difficile de taxer des activités qui ne seraient pas exercées réellement sur notre territoire.
Au demeurant, je suis prêt à retirer cet amendement si vous me dites que des activités qui ne sont pas exercées en France ne donnent pas lieu à une taxation sur les bonus.
S’agissant du champ d’application de la taxe, nous avons voulu nous assurer, dans le cadre de l’article 1er, que les redevables sont bien les banques, lesquelles ne sont pas particulièrement mobiles.
Le contribuable est donc clairement identifié. Quant à l’assiette, elle est constituée de l’ensemble de la part variable des rémunérations qui sont versées aux salariés liés à l’établissement bancaire par un contrat de travail soumis au droit français.
Selon moi, le champ d’application que je viens de définir ne laisse place à aucune équivoque. En effet, si l’on commence à distinguer les parts de rémunération selon qu’elles correspondent à une activité exercée sur le territoire français ou sur un territoire tiers, je crains qu’on n’ouvre la porte à de longs et laborieux débats. Je pense notamment aux discussions fiscales relatives à l’application de certaines conventions visant à éviter la double imposition.
Dans le cadre d’une taxation exceptionnelle, nous avons intérêt à trouver un critère simple d’assujettissement, afin de laisser le moins de place possible à des finasseries qui permettraient de structurer les rémunérations de façon à éviter leur taxation.

Monsieur le président, je ne suis pas totalement convaincu par les propos de Mme la ministre, mais il faut savoir arrêter une discussion. Au demeurant, nous aurons probablement l’occasion de revenir sur ce sujet. Je retire donc l’amendement n° 51.

L’amendement n° 51 est retiré.
L'amendement n° 97, présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2 et 3
Supprimer les mots :
au titre de l'année 2009
Cet amendement n’a plus d’objet, monsieur Foucaud.

Effectivement, monsieur le président, car il vise à une coordination avec un amendement qui a été repoussé.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 86, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
mentionnées au I,
rédiger comme suit la fin de l'alinéa :
à leurs salariés.
La parole est à Mme Nicole Bricq.

Madame la ministre, la taxe que vous proposez repose sur la notion de personne « dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise ». Cette notion nous paraissant trop vague, nous souhaitons élargir le périmètre du dispositif.
Vous avez déclaré récemment qu’une telle mesure concernerait 3 000 personnes, ce qui, selon nous, ne recouvre pas l’ensemble de celles qu’il convient de viser. La taxe doit s’appliquer à la rémunération variable de tous les salariés des banques qui en perçoivent une, en conservant le plancher de 27 500 euros que vous avez fixé, mais en excluant l’intéressement et la participation.
Notre proposition nous paraît tout de même plus cohérente. Son adoption permettrait non seulement de recueillir un produit significatif, mais aussi d’envoyer, fût-ce à titre exceptionnel, un signal fort, de manière à prévenir pour le futur les comportements excessifs.

L'amendement n° 50, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
les activités
insérer les mots :
de marché
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Cet amendement a pour objet de préciser le périmètre de la taxe en indiquant que les activités faisant encourir des risques sont les activités de marché, expression que vous avez d’ailleurs employée dans vos propos liminaires, madame la ministre, ce qui renforce la pertinence de ma proposition. Je me réfère également au rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire et à l'exposé des motifs figurant en introduction de ce projet de loi de finances rectificative, qui vise à mon sens explicitement les traders, et non l’ensemble des activités bancaires.

L'amendement n° 3, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi qu'aux personnes sous le contrôle desquelles opèrent ces salariés.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° 86 et 50.

L’amendement n° 3 a pour objet d'étendre le champ de la taxation à la chaîne hiérarchique des opérateurs de marché, c'est-à-dire aux personnes sous le contrôle desquelles ceux-ci opèrent. Puisque la vocation de la taxe est de participer à un meilleur contrôle des risques, celles et ceux qui définissent les politiques de risques et veillent à leur bonne application sont, non pas les opérateurs qui sont sur la table, dans la salle de marché, mais le chef de secteur chargé des produits négociés, le directeur de la salle des marchés, le responsable hiérarchique de celui-ci, voire le directeur général adjoint auquel il rend compte. Toute cette chaîne hiérarchique me semble devoir être concernée par le dispositif, dans un souci de cohérence.
On aurait pu s’interroger sur l’application de cette taxe aux rémunérations des mandataires sociaux. Nous ne l’avons pas fait, madame la ministre, parce qu’il existe des textes spécifiques les concernant. Sans doute serait-il bon que vous puissiez rappeler à notre assemblée les dispositions prises en la matière, qui reflètent un niveau d’exigence proportionné à la gravité de la crise que nous avons connue.
L’amendement n° 50 de M. Jégou vise à introduire une précision qui ne paraît pas vraiment utile dans la mesure où la formulation retenue par l’article reprend les termes de l’arrêté du 3 novembre 2009, lequel s’applique sans ambiguïté aux rémunérations des opérateurs de marché et dont la rédaction a été établie en concertation avec la profession bancaire. Il ne fait guère de doute que les activités des professionnels des marchés financiers, telles qu’elles sont visées, sont bien des activités « de marché ».
La précision introduite par cet amendement pourrait même, à la limite, entraîner des interprétations défavorables à l’assiette de cette taxe.
S’agissant de l’amendement n° 86 du groupe socialiste, j’aurais vraiment de la peine à le cautionner. En effet, étendre la taxe à tous les salariés des banques, ce serait l’appliquer aux agents de sécurité qui font le tour des parkings la nuit, aux secrétaires des différents échelons, aux femmes ou aux hommes de service, dont on a tant besoin si l’on veut que les locaux demeurent attrayants !
Sourires sur les travées de l’UMP. – Protestations sur les travées du groupe socialiste.

Je suis désolé, mais, tel que l’amendement est rédigé, c’est ce que l’on comprend ! Aucune limite n’est fixée ! Dans ces conditions, il n’est pas possible d’émettre un avis favorable sur cet amendement.
Je ne suis pas favorable non plus à l’amendement n° 86.
L’article 1er vise les opérateurs de marché, c'est-à-dire les personnes qui prennent des risques exceptionnels au titre d’activités qu’ils exercent à des tables de marché. Selon moi, il ne serait pas opportun d’étendre comme le prévoit cet amendement le champ d’application de la taxe, qui pèserait alors sur les rémunérations des chargés de clientèle et des salariés qui proposent des crédits aux entreprises ou aux ménages. Or ces derniers n’exercent pas du tout les activités visées par la taxe !
Au contraire, il est nécessaire de bien cibler le périmètre de l’article 1er, qui doit s’appliquer uniquement au segment « opérations de marché ».
Monsieur Jégou, la rédaction de l’article 1er ainsi que le bref exposé que je vous ai présenté tout à l’heure indiquent clairement que ce sont les activités de marché qui sont visées. Si le Sénat souhaite clarifier ce point en adoptant votre amendement n° 50, je n’y vois pas d’inconvénient. Je m’en remets donc, à son endroit, à la sagesse de la Haute Assemblée.
Monsieur le rapporteur général, votre amendement n° 3, à propos duquel j’ai déjà fait part de l’ouverture du Gouvernement, a pour objet d’étendre le champ de la taxation, mais en ciblant bien l’activité de marché. Seraient ainsi concernés tous les professionnels de marché, c'est-à-dire les professionnels de marché salariés, les professionnels de marché qui dirigent des activités de banque de financement et d’investissement – BFI –, les patrons de table, les patrons d’activités et les patrons de salle, ainsi que les professionnels de marché mandataires sociaux et dirigeants des activités de BFI.
Je suis favorable à cet amendement, à condition qu’y soit apportée une clarification. Il me semble en effet important de remplacer les mots « personnes sous le contrôle desquelles » par les mots « professionnels de marché sous le contrôle desquels », afin de bien souligner que seuls les dirigeants des activités de BFI sont visés et d’éviter toute confusion : les mandataires sociaux seraient ainsi exclus puisqu’ils sont, vous l’avez indiqué tout à l’heure, monsieur le rapporteur général, soumis à une réglementation spécifique en vertu des décrets des 30 mars et 20 avril 2009
Le Gouvernement approuve donc l’élargissement du champ de la taxation, mais à condition d’indiquer clairement que les dirigeants visés sont bien des professionnels de marché.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, cédez-vous à la pression de Mme la ministre et acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens proposé par le Gouvernement ?
Sourires

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est une pression très amicale !
Nouveaux sourires.

Je crois comprendre que, sous le vocable « professionnels de marché », on englobe la chaîne hiérarchique intermédiaire que je décrivais, notamment les responsables, qui peuvent être des mandataires sociaux de la banque de financement et d’investissement.
Dès lors que cette précision est apportée, j’accepte volontiers de rectifier mon amendement.

Je suis donc saisi d’un amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi qu'aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l’amendement n° 86.

Après les propos caricaturaux qu’a tenus M. le rapporteur général en réponse à notre amendement, je tiens à rappeler la réalité.
Il est bien question, ici, d’une taxe sur les bonus, applicable, comme le souhaite Mme la ministre, à ceux d’entre eux dont le montant excède 27 500 euros. Monsieur le rapporteur général, ne prétendez pas que ces bonus-là sont distribués, dans les établissements dont il est question, aux personnels tels que les femmes de service, les gardiens de parking, etc. Notre amendement reste bien dans l’épure que vous avez tracée.
Non seulement vous n’en voulez pas, monsieur le rapporteur général, mais encore vous avez accepté de réduire la portée de votre propre amendement.
Je souhaite d’ailleurs souligner au passage que nous avions déposé un amendement visant également les mandataires sociaux, mais que celui-ci a été rejeté par la commission au motif que c’était un cavalier. Par conséquent, ceux-ci sont exclus du champ d’application du II de l’article 1er.
Enfin, vous n’avez obtenu aucune réponse sur l’état d’avancement du projet de directive sur les hedge funds, qu’avait proposé dans un premier temps le commissaire Charlie McCreevy, avant qu’il ne soit repoussé par certains États membres, notamment la France. Mme la ministre a simplement indiqué que l’inclusion des rémunérations dans le champ du projet de directive prendrait beaucoup de temps.
Au final, cette taxe sur les bonus ne représentera pas grand-chose et ne vaudra ni réparation pour le passé ni prévention pour l’avenir.

Cette discussion sur les trois amendements, y compris celui du rapporteur général, me pose un problème parce qu’il y a tout de même la question de l’égalité devant l’impôt.
Nicole Bricq, nous instituons une taxe dont la base concerne tous ceux qui touchent des bonus de plus de 27 500 euros. Qu’ils soient ou non énumérés dans la loi, ils sont tous dans la base taxable. Mais si la loi décide de se lancer, ce que personnellement je regrette, dans une énumération, alors il faut que celle-ci soit complète, c’est-à-dire que, pour assurer l’égalité devant l’impôt, tous ceux qui perçoivent un bonus doivent être concernés et visés par la loi. Ou alors, monsieur le rapporteur général, on n’énumère personne et l’on dit simplement, ce qui serait beaucoup plus simple du point de vue rédactionnel, que tous ceux qui perçoivent un bonus de plus de 27 500 euros sont dans la base taxable.

Je ne comprends pas cette discussion parce que, quand on se lance – et je ne critique personne, car nous essayons tous de faire le meilleur travail législatif possible – dans une énumération, il y a toujours un risque d’oublier quelqu’un.

Mais, je me permets de faire cette observation au passage, nous avons un juge suprême qui, il n’y a pas longtemps, à propos de la taxe carbone, a appliqué rigoureusement le principe d’égalité devant l’impôt et les charges.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. D’ailleurs, il sera peut-être encore plus efficace prochainement !
Sourires

Je considère, en ce qui concerne l’amendement de Mme Bricq, que la mention qui consiste à ajouter des salariés ne peut concerner que les salariés qui sont dans la base taxable, pas ceux qui n’y sont pas.
Si le ministre disait que, bien évidemment, sans l’amendement de Nicole Bricq, les salariés inclus dans la base taxable sont bien dans cette base, je la connais suffisamment pour savoir qu’elle n’insisterait pas. Mais s’il y a une incertitude, alors, il faut qu’on la lève en écrivant dans la loi ce qui doit être écrit.
De même, l’amendement du rapporteur général visait « les personnes sous le contrôle desquels opèrent ces salariés ». Le ministre propose de remplacer « les personnes » par « les professionnels de marché ». Très bien ! Mais, en tout état de cause, ce ne peut être que ceux qui perçoivent des bonus de plus de 27 500 euros.
Monsieur le président, je me permets, à cette heure de l’après-midi où nous sommes encore bien réveillés, d’appeler l’attention du Sénat sur ce point. Ne rentrons pas dans un processus qui nous conduirait à une décision qui sanctionnerait une inégalité devant les charges et devant l’impôt !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.

M. le président. Vous voyez, monsieur Jégou, vous avez bien fait de venir !
Sourires
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 53, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
Lorsque l'attribution porte sur des options sur titres, des actions gratuites
par les mots :
Lorsque la part variable prend la forme d'une attribution d'options sur titres, d'actions gratuites
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
Nouveaux sourires.

J’y suis d’autant plus incité que cet amendement, le dernier d’une série visant à préciser la nature des rémunérations incluses dans la base taxable, a été « adoubé » par avance par M. le rapporteur général.
Le mot « bonus » fait désormais partie du langage courant. Or il existe plusieurs sortes de bonus. Ainsi, la part variable perçue par les chargés d’affaires et de clientèle qui prêtent de l’argent aux entreprises, qui placent des titres d’assurance vie auprès des particuliers, constitue-t-elle un bonus ? Qu’en est-il lorsque cette part variable prend la forme d’une attribution d’options sur titres ou d’actions gratuites ? Tous ces points doivent être précisés.

À la suite des votes intervenus sur les amendements précédents, je voudrais que le ministre nous confirme bien que les rémunérations de toutes les personnes visées au II de l’article 1er sont dans la base taxable, qu’on les ait énumérées ou pas.

Ce qui veut dire, madame le ministre, chère Christine Lagarde, que cela nécessitera une instruction très précise de l’administration fiscale pour définir le champ d’application en précisant bien que toutes les personnes visées au II…

Oui, mais il y a aussi les personnes physiques qui sont bans la base puisque sont visés les salariés !
Il faudra donc préciser que tous ceux, personnes morales ou personnes physiques, qui sont taxables au titre du II sont bien taxables, énumération ou pas. Cela me paraît la moindre des choses !
Cela étant, je suis tout à fait d’accord avec l’amendement de notre collègue Jégou.
Je rappelle que les redevables de cette taxe exceptionnelle sont les personnes morales mentionnées à l’article L. 511–1 et L. 531–4 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article 2 dispose bien que « la taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, au titre de l’année 2009, par les personnes morales mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise ».
L’amendement n° 50 de M. Jégou, que le Sénat vient d’adopter, précise même que les activités dont il est question sont les activités de marché.
Certes, l’administration fiscale aura tout loisir de produire des instructions, mais le champ d’application de cet alinéa est parfaitement clair et les redevables de cette taxe sont bien identifiés.
Par conséquent, je ne doute pas que le principe d’égalité devant l’impôt et les charges des personnes morales est respecté.
L'amendement est adopté.

La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote sur l'article 1er.

Je voterai bien évidemment l’article 1er, mais je ferai deux observations.
Premièrement, il est bien clair que ce sont les entreprises qui seront taxées, et non les opérateurs de marché. Par conséquent, ces derniers continueront de bénéficier d’un certain nombre de rémunérations variables, lesquelles échapperont en partie à toute taxation, compte tenu des taux d’imposition.
Deuxièmement, sur proposition de M. le rapporteur général, nous avons accepté, pour des raisons de fiscalité générale, que cette taxation frappant les entreprises soit déductible de leur bénéfice annuel. Cela va dans le bon sens, même si cette mesure reste d’une portée limitée.
Madame la ministre, il faudra que vous abordiez, au cours de vos discussions avec l’ensemble de la profession bancaire, la méthode de rémunération de ces opérateurs de marché, qui nous préoccupe beaucoup. Car c’est bien la rémunération de ces traders qui est en cause. Les mesures décidées par le G20, ainsi que les décisions que devraient prendre prochainement le Royaume-Uni, les États-Unis et peut-être l’Allemagne devraient se traduire, dans les prochaines années, par une modification des modes de rémunération, notamment par une élasticité moindre des rémunérations variables. L’argent ainsi récupéré pourra être consacré au développement des petites entreprises, ce qui va dans le bon sens.
Quoi qu'il en soit, nous ne serons pleinement satisfaits que si les méthodes de rémunération des traders sont modifiées dans le sens des directives du G20, de manière à éviter que les établissements prennent des risques mal mesurés.
L'article 1 er est adopté.

Nous en revenons maintenant à l’examen des articles additionnels avant l’article 1er, que nous avons entamé hier.
L'amendement n° 79, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les articles 8 et 10 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont abrogés.
II. - L'article 779 du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. François Marc.

Force est de constater que ce projet de loi de finances rectificative augmente très sensiblement notre déficit et notre endettement. Hier, nous avons dénoncé la politique dispendieuse qu’a menée le Gouvernement, consistant en particulier en la distribution indue d’un certain nombre d’avantages et de cadeaux fiscaux, mesures sans lesquelles les 140 milliards d’euros de déficit public auraient pu être réduits.
Nous souhaiterions à tout le moins, madame la ministre, que vous reconnaissiez le bien-fondé de nos arguments et que vous fassiez machine arrière en remettant en cause ces avantages qui obèrent aujourd’hui dramatiquement les finances publiques.
Le présent amendement répond à cette préoccupation.
Nous considérons que les 12 milliards d’euros imputables au paquet fiscal pèsent lourdement sur le budget de 2010. Notre amendement, qui vise la seule mesure afférente aux droits de succession, permettrait à l’État de récupérer plus de 2 milliards d’euros par an. Une telle perte de recettes n’est pas acceptable au vu de la situation de nos comptes publics et de la forte injustice qui caractérise le régime des droits de succession.
Avant le vote de la loi TEPA, la très grande majorité des successions de notre pays n’était pas soumise à l’impôt. Le dispositif institué par cette loi a donc permis une exonération massive des successions élevées des contribuables les plus aisés.
Le présent amendement vise par conséquent à revenir sur cette exonération, à nos yeux injuste et injustifiée.
On peut certes nous objecter que l’adoption de cet amendement ne rapporterait « que » 2 milliards d’euros, mais nous considérons que ce serait déjà un pas intéressant dans un parcours de reconquête d’une situation plus acceptable de nos finances publiques.


L’amendement n° 79 vise à rétablir le régime des droits de succession qui existait avant la loi TEPA d’août 2007.
Si cet amendement est adopté, je souhaite que le produit des impositions résultant de ce rétablissement soit affecté au Fonds de réserve pour les retraites.

Nous assistons, comme hier soir, au « redépôt » d’un amendement déjà examiné dans d’autres circonstances !

Cet amendement tend à rétablir cet épouvantable impôt sur la mort ! (M. Michel Charasse s’exclame.)
Mais oui, sur la mort !

Cet amendement vise donc à rétablir cet impôt que, grâce au Président de la République, 95 % des Français ne paient plus, s’agissant de patrimoines qui, dans l’ensemble, sont modestes !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. On ne va pas jusqu’à les faire voter !
Sourires

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Bien sûr !
Nouveaux sourires.

Au-delà de cette facétie, mes chers collègues, vous aurez compris que la commission des finances est défavorable à cet amendement et, par voie de conséquence, au sous-amendement qui y est attaché.

M. François Marc. Décidément, M. Marini est vraiment un rapporteur général « antiredéposition » !
Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Dans la mesure où des amendements analogues ont été déposés à plusieurs reprises, il oppose une fin de non-recevoir au présent amendement : on ne revient pas sur ce qui a été mis en place !
Monsieur le rapporteur général, c’est oublier qu’il y a un élément nouveau. La France est dans une situation financière très dégradée. Le ministre du budget a déclaré fin janvier, et ses propos ont été repris dans de nombreux médias, qu’il fallait trouver 50 milliards d’euros pour ramener le déficit public à 3 % du PIB, conformément aux exigences européennes. Il y a donc une donnée nouvelle : il faut réaliser une économie de 50 milliards d’euros.
Monsieur le rapporteur général, vous pouvez certes refuser notre amendement pour rester fidèle à des positions que vous avez exprimées dans le passé, considérer qu’il n’y a rien de neuf, nous dire : « Circulez, il n’y a rien à voir », mais vous montrez ainsi que vous êtes bien un rapporteur général « antiredéposition ».
Nous estimons, pour notre part, qu’il faut répondre aux problèmes qui se posent à l’instant t. Aujourd’hui, la France a besoin d’argent. Le ministre crie à qui veut l’entendre qu’il faut trouver 50 milliards d’euros pour réduire le déficit public. Nous vous en proposons deux : prenez-les !
Le sous-amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 71, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement doit, dans un délai de six mois, fournir au Parlement un rapport dans lequel il exposera les modalités concrètes de la mise en place d'une taxe assurantielle sur les activités des banques, en fonction du risque qu'elles prennent sur les marchés financiers.
Cette taxe devra être en adéquation avec la proposition d'une taxe assurantielle pour les banques, faite par le Président du Fonds Monétaire International lors de la réunion du G20 Finances des 24 et 25 septembre 2009.
Le dispositif mis en place ne devra pas prévoir de compensation au moyen d'une baisse de la taxe sur les salaires acquittée par les banques.
La parole est à Mme Nicole Bricq.

Monsieur le rapporteur général, nous revenons, là encore, sur un sujet que nous avons déjà abordé, mais dont, en vérité, nous n’avons fait que commencer à débattre. Il s’agit du principe d’une taxe assurantielle sur les activités à risque des établissements bancaires et financiers.
Pour innover quelque peu à ce sujet dans le cadre du présent collectif, nous demandons au Gouvernement de fournir au Parlement un rapport exposant la faisabilité de la création d’une taxe assurantielle payée par les banques afin d’éviter que, comme nous avons pu l’observer au moment de la crise, les États ne deviennent les assureurs en dernier ressort.
La proposition d’une taxe assurantielle pour les banques faite par le président du Fonds monétaire international n’a pas, dans son essence, été contestée par les ministres des finances réunis à l’occasion du G20. Vous-même, madame la ministre, n’y semblez pas hostile, à la condition que tous les pays l’acceptent.
Dans votre propos liminaire, vous avez considéré, à juste titre, que cette taxe n’était pas le seul moyen de prévenir les pratiques à risque et le fait que les États soient appelés à s’endetter pour venir au secours du système financier. Je n’en disconviens pas, et il est vrai que cette mesure peut apparaître trop « rustique ». Il reste que c’est la seule mesure dont il ait été fait état. Mais peut-être la Commission examine-t-elle d’autres pistes. Vous pourrez éventuellement nous dire quelles autres solutions existent qui seraient susceptibles de recueillir notre accord en ce qu’elles permettraient d’obliger les établissements financiers à constituer un niveau de fonds propres suffisants pour assumer les risques qu’ils prennent, de telle manière que cela leur coûte plus cher. Après tout, pourquoi pas ?
Quoi qu'il en soit, la présentation d’un rapport au Parlement nous permettrait de mieux cerner la situation.
Lors de la discussion de la proposition de résolution européenne que nous avions présentée au Sénat le 29 octobre 2009 et qui portait sur la proposition de directive du 13 juillet 2009 relative aux fonds propres des banques, M. le rapporteur général et M. le président de la commission des finances s’étaient déclarés favorables au principe assurantiel, sans aller pour autant jusqu’à accepter qu’il emporte suppression de la taxe sur les salaires. Nous divergeons sur ce point, car nous considérons que, si cette nouvelle taxe devait être neutre, elle n’aurait pas de vertu préventive et ne modifierait donc pas les comportements des acteurs financiers.

La commission considère que l’amendement n° 71 est satisfait par l’article 6 de la loi de finances pour 2010, qui sollicite du Gouvernement un rapport sur l’établissement d’une taxe systémique.
Souvenez-vous de la plaidoirie que nous avions faite alors, souhaitant que cette taxe se substitue à la taxe sur les salaires, qui handicape la compétitivité du secteur bancaire français.
Madame la ministre, vous avez chargé M. Jean-François Lepetit, ancien président, entre autres, de la Commission des opérations de bourse et actuel président du Conseil national de la comptabilité, expert unanimement respecté, de préparer un rapport sur la régulation des acteurs et des marchés systémiques.
Nous serons particulièrement attentifs aux conclusions de ce rapport et nous espérons qu’il sera déposé dans les délais prévus par la loi. Mais peut-être pouvez-vous nous donner quelques informations supplémentaires sur ce sujet, madame la ministre…
Je considère, comme M. le rapporteur général, que l’amendement de Mme Bricq est satisfait. Nous avons en effet décidé, lors de la discussion du projet de loi de finances initiale pour 2010, que la taxation systémique ferait l’objet d’un rapport spécifique remis au Parlement avant le 30 juin.
J’ajoute que l’utilisation de la formule « taxe assurantielle » ne me semble pas opportune, et il n’y a là aucun caprice de ma part. Les réflexions qui sont en cours au Fonds monétaire international, au sein du G20 et, dans une moindre mesure, du conseil Ecofin, montrent l’attention qui est portée – comme le reflétera probablement le rapport qui sera établi par le directeur du FMI – au concept d’aléa moral et au risque que présenterait la mise en œuvre d’un véritable mécanisme assurantiel qui serait financé par tous les établissements financiers mais qui ne bénéficierait qu’aux moins vertueux.
Il me semble donc préférable de raisonner en termes de taxation universelle ou de taxation systémique. Lors de la réunion du G7 à Iqaluit, au Canada, nous nous sommes interrogés sur la manière de cibler au mieux les établissements qui seront redevables de cette taxe et sur les mécanismes de prise en charge du risque susceptibles d’éviter l’aléa moral.
M. Jean-François Lepetit devrait me rendre son rapport suffisamment tôt pour que ses conclusions soient intégrées dans le rapport qui sera remis au Parlement avant le 30 juin.
Il s’agit d’améliorer la lisibilité du paysage financier. Aujourd’hui, nous devons tenir compte à la fois des travaux qui sont conduits par le Comité de Bâle et par le Conseil de stabilité financière, ainsi que des études qui sont menées dans de nombreux domaines – les capitaux propres, la pondération des capitaux en fonction de la nature des risques –, sans même parler des différents forums qui se tiennent sur les mécanismes assurantiels. Nous aurions tout intérêt, dans un souci de clarté, à disposer d’un tableau complet de l’ensemble des mécanismes actuellement envisagés afin de dégager une perspective.

Madame la ministre, au-delà de la question purement sémantique, vous semblez considérer que l’instauration d’une prime d’assurance pourrait être perçue, en quelque sorte, comme la mise en place d’un système où les moins vertueux se verraient finalement récompensés.
Dans notre esprit, il ne s’agit pas de cela. Si une prime d’assurance était instaurée, elle devrait bien entendu être modulée en fonction de la nature des risques. Cela suppose qu’un contrôle prudentiel s’exerce et que soit élaboré un barème sur la base de critères aussi objectifs que possible pour pénaliser les établissements qui prennent des risques excessifs et leur imposer une prime particulièrement lourde. C’est ainsi, madame Bricq, que nous pourrions faire évoluer les comportements et tendre vers une plus grande responsabilité.
S’agissant de la taxe sur les salaires, il faut souligner qu’elle pèse essentiellement sur le secteur de la santé. Elle « encombre » donc le budget puisque, charge pour le système de protection sociale, elle devient recette dans le budget de l’État. Cela gonfle artificiellement le poids tant des dépenses que des recettes publiques.
La taxe sur les salaires pèse également sur le monde associatif qui, pour l’essentiel, dépend de financements publics.
Dans d’autres domaines, entre autres les assurances, les banques, le secteur financier, il est incontestable qu’elle peut être analysée comme un facteur de délocalisation au profit d’autres places financières telles que Londres.
J’espère réussir à convaincre Mme Bricq qu’il n’y a pas d’antagonisme entre la volonté de supprimer la taxe sur les salaires et l’institution d’une redevance ou d’une taxe d’assurance systémique.

Monsieur le président, le mini-débat qui s’est instauré a montré que nous allions être amenés à poursuivre la réflexion et, compte tenu des explications de Mme la ministre comme de la position exprimée par la commission, il ne me paraît pas bienvenu de le maintenir.
Je mets de côté le débat sur la taxe sur les salaires – que les hôpitaux acquittent aussi –, mais j’accepte le débat sur l’assurantiel et le systémique.
Pour ma part, j’estime que, lors de la présentation de notre proposition de résolution européenne, nous avons défendu une position en accord avec celle du président de la commission des finances sur la nécessité d’établir des normes de risques et d’accepter la règle selon laquelle plus on prend de risques, plus cela coûte cher, notamment en termes de relèvement des fonds propres.
Dans le même temps, j’accepte aussi l’argumentation de Mme la ministre, selon laquelle l’existence d’un aléa moral rend peut-être un peu « rustique » un mécanisme qui conduit à faire prendre en charge par les « vertueux » les risques pris par ceux qui ne le sont pas.
La question peut donc se discuter et il existe éventuellement des voies plus subtiles. On nous dit qu’elle est en débat à plusieurs échelons. Attendons donc de connaître les propositions que fera le FMI au mois d’avril et reprenons ce débat au mois de juin, mais je refuse qu’il se fasse en dehors du Parlement : je veux qu’il ait lieu aussi ici, au Sénat.

L'amendement n° 71 est retiré.
L'amendement n° 93 rectifié, présenté par M. Cambon et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au II de l'article 48 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, l'année « 2010 » est remplacée par l'année « 2009 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Au travers de cet amendement, je veux évoquer une excellente disposition de la loi de finances pour 2010 : son article 48 prévoit en effet la compensation à 83 %, pendant quinze ans, de l’exonération de taxe sur le foncier bâti pour les logements sociaux de type PLS, ou prêts locatifs sociaux.
Auparavant, la compensation à 83 % aux communes de l'exonération de taxe, en cas d'acquisition de logements anciens, ne valait que pour les PLAI, les prêts locatifs aidés d'intégration, et les PLUS, les prêts locatifs à usage social ; lorsqu'il s'agissait de prêts locatifs sociaux, il n'y avait aucune compensation.
Toutefois, malgré le nouveau dispositif, les communes, en tout cas certaines d’entre elles, peuvent encore être confrontées à des difficultés.
Je n’ai pas évoqué la question lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2010, mais elle l’a été plusieurs reprises lors de l’examen de textes relatifs au logement, et chacun sait donc qu’ICADE, qui assurait la location de très nombreux logements, notamment dans le Val-de-Marne, a entrepris de vendre son patrimoine.
La vente « en bloc » du patrimoine d’ICADE n'aura effectivement lieu qu'en 2010 et sera donc compensée, mais un certain nombre de ventes immeuble par immeuble se sont déroulées en 2009. Additionnées, ces ventes partielles font perdre aux communes jusqu’à plusieurs centaines de milliers d'euros de taxe foncière chaque année, et évidemment plus encore sur quinze ans.
Le présent amendement vise donc à appliquer l’article 48 de la loi de finances pour 2010 aux décisions de financement intervenues en 2009 et non pas seulement à celles qui seront intervenues ou interviendront en 2010, ce qui serait conforme à l’esprit d’un texte dont l’objet n’était pas de laisser de côté certaines communes.

Comme Mme Procaccia, la commission se référera à l’article 48 de la loi de finances pour 2010, article que nous avions d’ailleurs adopté à l’unanimité et dont l’objectif était de compenser, pour les collectivités territoriales, les effets de la vente du patrimoine d’ICADE, filiale du groupe de la Caisse des dépôts et consignations.
Avec cet amendement, il s’agirait d’aller au-delà en appliquant la même règle aux logements vendus par ICADE en 2009. Seraient donc visés un nombre important de logements, ICADE ayant annoncé son intention d’accélérer le rythme des ventes, qui, dès 2008, auraient porté sur 5 000 logements.
La commission, sensible au souci d’assurer la cohérence avec une disposition déjà votée, s’en remettra à l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement, ému par un même souci de cohérence, émet un avis favorable sur l’amendement proposé par Mme Procaccia, de manière que les ventes réalisées en 2009 puissent bénéficier du même régime que celui qui sera applicable, en vertu de l’article 48 du projet de loi de finances, aux ventes réalisées en 2010.
En conséquence, le Gouvernement lève le gage.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, avant l'article 1er.

L'amendement n° 98, présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1 de l'ordonnance 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les ressources de l'établissement sont assurées par la perception d'une taxe spécifique, l'État peut décider que leur emploi soit assorti de l'émission des prêts ne portant pas intérêt. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus sont compensées par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.

Cet amendement vise à permettre à l’État de décider que l’emploi par OSEO de ressources issues de la perception de taxe spécifique, en l’espèce la taxe sur les bonus bancaires, donne lieu à l’émission de prêts ne portant pas intérêts.
Le principe de la mesure proposée est louable. Cette mesure va même dans le sens d’une meilleure efficacité de certaines actions d’investissement.
Toutefois, j’observe que les conditions d’octroi des prêts par OSEO ne sont pas définies par la loi : elles sont du domaine réglementaire. Il serait donc utile que Mme la ministre nous éclaire sur ses intentions et nous dise s’il est envisageable, pour les financements adossés à la taxe sur les bonus, qu’OSEO soit en mesure de distribuer des prêts à taux zéro.
Malheureusement, monsieur le rapporteur général, OSEO n’a pas vocation à apporter aux entreprises des prêts à titre gratuit. Le rôle de la filiale d’investissement d’OSEO, en particulier, est évidemment de renforcer les financements bancaires dont disposent par ailleurs les petites et moyennes entreprises, mais pas de le faire à taux zéro.
En outre, le droit communautaire nous serait sans aucun doute opposé si d’aventure nous envisagions une telle perspective sur le fondement des aides d’État.
La proposition n’est donc pas recevable et le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, dans sa rédaction issue de l’article 13 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, est ainsi modifié :
1° Au f, le taux : « 36, 28 % » est remplacé par le taux : « 33, 36 % » ;
2° Il est ajouté un i ainsi rédigé :
« i) Une fraction égale à 2, 92 % est affectée au budget général de l’État. »

L'amendement n° 123, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Au 10° du II de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 37, 95 % » est remplacé par le pourcentage : « 33, 36 % ».
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
III. - À la fin de la troisième phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 241-13 du même code, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 58 % ».
IV. - L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au f, le taux : « 33, 36 % » est remplacé par le taux : « 30, 35 % » ;
2° Au i, le taux : « 2, 92 % » est remplacé par le taux : « 5, 93 % ».
V. - Au 10° du II de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 33, 36 % » est remplacé par le pourcentage : « 30, 35 % ».
VI. - Les III, IV et V entrent en vigueur le 1er janvier 2011.
La parole est à M. le rapporteur général.

Cet amendement, plus substantiel que le précédent, nécessite, madame la ministre, quelques explications.
Il relève à la fois d’une exigence budgétaire et d’un impératif économique.
L’article 2 de ce collectif améliore, et c’est une bonne chose, le régime d’embauche des travailleurs occasionnels ou de demandeurs d’emploi – dit « TO-DE » –, en particulier dans le secteur agricole, en prévoyant des réductions supplémentaires de charges sociales.
Je relève que la réforme telle qu’elle nous est proposée conduirait à terme à une aggravation du déficit. Elle se traduirait en effet par un surcoût de 269 millions d’euros, 168 millions d’euros étant imputables à l’extension du dispositif et 101 millions d’euros l’étant à sa compensation intégrale à la sécurité sociale.
Vous faites à juste titre valoir, madame la ministre, que ce surcoût est financé en 2010. Oui, mais comment ? Le surcoût est tout simplement financé parce que le panier de ressources qui permet de supporter les allégements généraux de charges sociales va être surabondant en raison de la crise ; vous trouvez donc dans ce panier de ressources le gage vous autorisant à financer sans difficultés en 2010 un surcoût de 269 millions d’euros.
Plusieurs points me préoccupent cependant.
D’une part, le transfert de fiscalité que vous opérez en affectant une quote-part des droits sur le tabac est une facilité pour l’État et fragilise les ressources de la sécurité sociale. Il est d’ailleurs dommage que mon excellent ami et collègue Alain Vasselle ne soit pas présent, car je suis certain qu’il aurait insisté avec la vigueur qui lui est coutumière sur cet aspect de la réforme.
Sourires

En outre, d’un point de vue « maastrichtien », on ne fait que déplacer le besoin de financement : on creuse le déficit de la sécurité sociale pour combler celui de l’État, ce qui, naturellement, ne sert à rien.
À partir de 2011, dès lors qu’on aura besoin de la totalité des ressources du panier pour compenser les allégements généraux de charges sociales, comment financera-t-on la charge définitive que l’on se sera créée avec cet article 2 ? Comme on sait si bien le faire, par une aggravation du déficit ! C’est tellement simple : il suffit d’inscrire un chiffre dans une case !
Considérant que cette démarche n’est pas acceptable et qu’à une charge permanente doit correspondre une ressource permanente, j’ai donc préparé cet amendement qui permet de dégager 300 millions d’euros de marges de manœuvre budgétaires nouvelles et pérennes.
N’ayant pas beaucoup d’imagination, je préconise simplement d’abaisser – très légèrement – le seuil de sortie du dispositif des allégements généraux de charges sociales de 1, 60 à 1, 58 SMIC, soit une diminution infinitésimale de ce plafond puisque la variation est de 27 euros. Pour autant, un tel dispositif a des effets budgétaires significatifs et permet de se procurer les 269 millions d’euros nécessaires.
Il est précisé que cet amendement entrerait en vigueur au 1er janvier 2011.
En réponse à cette proposition, j’ai reçu, madame la ministre, des argumentaires, en particulier de la part de l’excellent secrétaire d'État chargé de l’emploi, pour qui j’ai beaucoup de considération. Eh bien, c’est une incroyable logomachie stalinienne qu’il m’a ainsi été donné de lire ! La terre allait trembler ! Des dizaines de milliers d’emplois allaient être mis en péril par cette variation de 27 euros…
Or, mes chers collègues, l’amendement qui vous est soumis ne diminue que de 1, 3 % le coût des allégements généraux, afin précisément de ne pas pénaliser la timide reprise économique à laquelle nous assistons actuellement.
La charge moyenne pour chacune des 1 850 000 entreprises bénéficiaires est très limitée. Je l’ai calculée : elle est de 13 euros par mois, ce qui ne me paraît pas justifier les développements emphatiques qu’on m’a infligés sur le sujet ! Cette somme n’est de nature ni à entraver la croissance ni davantage à affecter les plans de recrutement des entreprises.
En abaissant de manière très modérée le seuil de sortie du dispositif des allégements généraux, la commission contribue au contraire à recentrer ce dispositif sur les bas salaires et sur les travailleurs les moins qualifiés, qui sont ceux qui ont le plus souffert de la dégradation du marché du travail.
Je rappelle, à ce stade de mon explication, que la suppression de la taxe professionnelle a permis d’alléger sensiblement la fiscalité sur les entreprises, qui ressortent très largement gagnantes des dernières réformes fiscales et sociales. C’est d’ailleurs une réalité un peu trop vite oubliée du côté des entreprises : quand nous nous promenons dans nos départements, on nous remercie rarement à ce sujet…

J’évoquerai pour finir la question de l’efficacité globale des allégements généraux de charges sociales.
Madame la ministre, chaque année, les finances publiques supportent une charge de plus de 22 milliards d’euros au titre des allégements généraux.

Le Parlement ne dispose d’aucun suivi annuel quant à la performance des allégements généraux, notamment en termes d’emploi, puisque la compensation accordée à la sécurité sociale est totalement débudgétisée. L’information disponible sur l’efficacité de cette somme, qui est pourtant de première grandeur, est plus que lacunaire, alors qu’on utilise tout un luxe de procédures pour des dépenses qui ne représentent que des enjeux extrêmement mineurs, parfois dans l’épaisseur du trait.
Le Gouvernement devait nous remettre un rapport sur le sujet en juin 2009 ; j’ai bien cherché, je ne l’ai pas trouvé, madame la ministre. Je crois que nous l’attendons toujours…
Au moment même où vous adressez à Bruxelles le programme de stabilité, décliné sur trois ans, qui fait apparaître l’ampleur des efforts à réaliser pour revenir à un déficit inférieur à 3 % en 2013, nous avons le devoir de vous demander quel bénéfice l’économie française retire de cet investissement de 22 milliards d’euros par an.
La plupart des études sérieuses estiment que les allégements généraux ont permis de créer des emplois. Combien ? Cela dépend des sources : des milliers ou des dizaines de milliers. Mais une analyse approfondie peut conduire à des conclusions plus ambivalentes.
À différentes reprises, la Cour des comptes avait transmis les résultats de ses analyses sur ce point, et j’ai encore en mémoire la voix de Philippe Séguin, qui s’était exprimé à ce sujet lors d’une séance organisée dans la salle Clemenceau par le président de la commission des finances.
Sourires

La Cour des comptes avait appelé à reconsidérer les allégements généraux pour « mieux les cibler sur les emplois les moins qualifiés et sur les entreprises qui en ont le plus besoin ». Elle avait alors suggéré d’abaisser le seuil d’exonération à 1, 3 SMIC et de n’en faire bénéficier que les entreprises de moins de vingt salariés.
Notre excellent collègue Yves Bur, qui occupe à l’Assemblée nationale un poste équivalent à celui d’Alain Vasselle, mais sans porter le titre de rapporteur général
Sourires

Je voudrais enfin combattre une idée reçue. Le champ des allégements généraux s’étend bien au-delà des bas salaires et du travail non qualifié. On nous dit que les allégements généraux bénéficient au travail non qualifié. Or, mes chers collègues, 1, 6 SMIC c’est le salaire médian. Autrement dit, la moitié des salariés, soit dix millions d’entre eux, entrent dans le champ des allégements généraux. Est-ce que tous sont des travailleurs non qualifiés ? Si c’était le cas, ce serait à désespérer de l’économie et du système de formation professionnelle français !
L’objectif initialement assigné à ces allégements apparaît largement dépassé, et nous avons transformé une politique d’aide à l’emploi en une subvention généralisée à l’économie française, subvention dont nous n’avons plus les moyens.
Ce faisant, je crois que nous opérons un mauvais calcul, et cela pour deux raisons.
D’abord, les allégements généraux conduisent incidemment à maintenir des personnes dans l’emploi non qualifié, ce qui nuit à terme à la compétitivité des entreprises.
Ensuite, comme l’a souligné la Cour des comptes, ce dispositif bénéficie pour l’essentiel à des activités tertiaires, notamment à la grande distribution, qui n’est pas soumise à la concurrence internationale et pour qui c’est un véritable effet d’aubaine.
Madame la ministre, le rapport que le Parlement vous a demandé, sur l’initiative de la commission des finances, devrait nous permettre de clarifier deux enjeux : le recentrage des allégements généraux sur les bas salaires et le redéploiement des moyens vers la compétitivité de nos entreprises.
Pour conclure, j’en reviens à mon amendement, qui est, je le reconnais, un peu facétieux.
Sourires

Parce que, il faut en être conscient, le programme de stabilité de la France pour 2010-2013 ne saurait être comme ceux qui l’ont précédé ! En effet, aucun des programmes précédents n’a été respecté. Chaque année, on présente les mêmes graphes ; le programme est tout prêt, il suffit d’ajouter un programme de stabilité supplémentaire ; il y a le théorique, et puis il y a le réel… Mais, cette fois-ci, c’est différent, en particulier après l’épisode grec, et compte tenu de la nécessaire solidarité de la zone euro : nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des engagements que nous serions incapables de tenir.
Pardonnez-moi d’avoir été un peu long, mes chers collègues, mais je tenais à poser solennellement à nouveau le problème des allégements généraux de charges sur les bas et moyens salaires.
Monsieur le rapporteur général, je vous remercie de votre explication tout à la fois charpentée, détaillée et approfondie. Elle touche à une question majeure puisque la dépense dont il s’agit s’élève à 22 milliards d’euros ; cette question méritait donc vraiment un examen de notre part.
Néanmoins, vous le comprendrez, je ne suis pas favorable à votre amendement ; à cet égard, j’évoquerai les éléments concernant la politique de l’emploi et laisserai à mon collègue Éric Woerth, qui vient de nous rejoindre, le soin de vous répondre sur les aspects strictement budgétaires.
Vous avez raison de poser la question des effets de l’exonération de charges à caractère général sur l’emploi. En revanche, je ne pense pas que le moment soit particulièrement propice pour le faire.
Aujourd’hui, l’allégement général des charges s’applique sur toutes les rémunérations comprises entre 1 et 1, 6 SMIC. On s’adresse donc très clairement au segment du marché de l’emploi sur lequel les salariés sont le moins rémunérés. Mais la propension à l’embauche ou au maintien dans l’emploi se trouve être beaucoup plus forte à ce niveau de rémunération, ainsi que le démontre clairement la mise en place de la mesure « zéro charges » applicable aux très petites entreprises, les TPE. Au cours des douze derniers mois, environ 800 000 embauches ont été réalisées grâce à ce dispositif. Les remontées d’informations du terrain indiquent que les effets de cette exonération de charges sont particulièrement sensibles dans la cible des salaires les moins élevés.
C’est la première raison qui nous porte à émettre un avis défavorable sur l’amendement n° 4 rectifié. Le moment n’est pas opportun, car nous sommes à une étape de notre politique de l’emploi qui nécessite la mobilisation de tous les vecteurs pour encourager à l’embauche et au maintien dans l’emploi.
Quelle que soit leur taille, les entreprises sont évidemment particulièrement sensibles à cette exonération de charges. Faire bouger les curseurs dans un contexte où le taux d’emploi constitue une donnée critique et où l’augmentation du chômage est restée constante chaque mois depuis le début de la crise, à l’exception du mois de décembre dernier, ne nous paraît donc pas judicieux.
Par ailleurs, dès lors que l’on touche au coût du travail, le mécanisme de dégressivité existant sur l’échelon concerné est au moins ébranlé. Les organisations patronales mais aussi les syndicats de salariés sont particulièrement sensibles à l’évolution de ces curseurs. Dans la continuité de la réunion d’agenda social qui a eu lieu à l’initiative du Président de la République le 15 février dernier, ces questions-là seront également examinées.
En outre, dans le cadre du programme de stabilité que j’ai soumis à Bruxelles, il est prévu d’examiner l’ensemble des niches fiscales et sociales existantes, parmi lesquelles figurent évidemment les allégements de charges. À ce moment-là, on devra se poser la question des effets des allégements sur la politique de l’emploi et sur les décisions d’embauche des employeurs.
Telles sont les raisons pour lesquelles, en tout cas au titre de la politique de l’emploi, il ne me paraît pas, à ce stade, souhaitable de ramener de 1, 6 SMIC à 1, 58 SMIC le seuil en deçà duquel s’applique cet allégement de charges à caractère général.
Pour autant, l’examen précis du caractère incitatif ou non de l’allégement de charges doit être effectué, non seulement à l’occasion du rapport que nous devons produire, mais également lors de la revue des niches fiscales et sociales auquel il sera procédé au cours des trois années qui viennent, conformément à l’engagement que nous avons pris vis-à-vis de Bruxelles.

Madame la ministre, vous l’avez reconnu, l’exposé du rapporteur général était assez lumineux.
Vous auriez pu nous objecter que, en nous efforçant de faire passer le seuil d’exonération de 1, 6 SMIC à 1, 58 SMIC, nous n’allions peut-être pas dans le sens de la compétitivité du travail et qu’un jour il faudrait se demander si l’on peut maintenir des cotisations sur les salaires. Cependant, ce qui animait le rapporteur général et la commission des finances, c’était le souci de tenir l’équilibre et de ne pas creuser le déficit. Or la mesure d’exonération fait apparaître un besoin de financement de 300 millions d’euros qui, dans l’immédiat, se traduit par une aggravation du solde budgétaire.
Pour que nous soyons totalement convaincus quant à la volonté du Gouvernement de lutter contre les déficits publics, peut-être serait-il opportun qu’il nous dise de quelle façon sera assuré le financement de ces 300 millions d’euros de dépenses supplémentaires.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vais prendre le relais de Christine Lagarde sur le sujet en discussion, qui revient d’ailleurs régulièrement, à chaque examen de loi de finances.
Reconnaissons-le, c’est un sujet sur lequel on est mal à l’aise. Au fond, c’est la raison pour laquelle on ne parvient pas à prendre de décision.
Vous présentez des amendements, à l’instar de vos collègues de l’Assemblée nationale, et ces amendements sont empreints de créativité.
Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 4 rectifié s’appliquerait à partir de 2011. Ce n’est pas la première fois que vous travaillez de cette manière : c’est une façon d’appeler et, en même temps, de réaliser, ce qui est habile.
Pour autant, je l’ai dit, le Gouvernement n’est pas à l’aise : il met en avant les problèmes que cela poserait en termes d’emploi, à un moment où, c’est le moins qu’on puisse dire, la situation à cet égard est effectivement problématique et il laisse le débat ouvert, mais en souhaitant qu’on y revienne plus tard… Je crois pouvoir résumer ainsi notre position.
Il est malheureusement difficile d’aller plus loin aujourd’hui, pour la simple et bonne raison que l’impact sur l’emploi est difficile à mesurer à 0, 02 point près. Nous disposons d’études, mais entre 1, 6 SMIC et 1, 58 SMIC, il est assez difficile de savoir si ce sont 10 000, 30 000, 40 000 emplois qui sont en jeu, ou aucun. Ce qui est sûr, c’est que l’emploi se trouve fragilisé.
M. le rapporteur général le sait parfaitement, en ramenant le seuil d’exonération à 1, 58 SMIC, on ne touchera pas uniquement les salariés percevant entre 1, 58 SMIC et 1, 6 SMIC. En modifiant le seuil d’exonération, on fait en effet varier la pente de la droite qui décrit la décroissance du taux d’allégement au fur et à mesure que le salaire se rapproche du seuil. Cette diminution aura donc également une incidence sur les rémunérations situées en deçà du seuil, touchant ainsi grosso modo toutes les personnes qui gagnent entre 1, 3 SMIC et 1, 58 SMIC.
Voilà pourquoi nous ne souhaitons pas risquer de dégrader encore la situation de l’emploi en modifiant le seuil d’exonération.
Monsieur le rapporteur général, à travers l’amendement n° 4 rectifié, vous voulez toucher à un tabou, en quelque sorte « marquer le coup ». Le Gouvernement, quant à lui, pense que le présent collectif ne prête pas à une telle mesure, considérant qu’il a essentiellement pour objet de demander au Parlement d’approuver le grand emprunt. Dès lors, on ne peut pas, d’un côté, insister sur l’investissement et, de l’autre, diminuer les aides aux bas salaires. Car c’est exactement ce que veut dire votre amendement puisqu’il aurait pour effet d’augmenter les cotisations patronales sur les bas salaires. Ce serait envoyer un signal négatif aux entreprises au moment où s’amorce la reprise.
Par ailleurs, vous proposez, selon une certaine logique, que cette diminution des allégements de charges permette de financer de façon pérenne les allégements de charges supplémentaires destinés à favoriser l’emploi des travailleurs saisonniers agricoles.
Comme vous le savez parfaitement, l’ensemble de ces allégements supplémentaires destinés aux travailleurs saisonniers agricoles ne coûte pas 300 millions d’euros, ou un peu plus, mais 168 millions d’euros, somme figurant dans la mesure supplémentaire prévue dans le collectif budgétaire. Il ne s’agit donc pas de financer l’ensemble des allégements de charges destinés aux salariés agricoles, mais seulement la mesure supplémentaire figurant dans le collectif budgétaire qui concerne ces travailleurs saisonniers et qui s’ajoute aux allégements déjà consentis pour aider le secteur agricole confronté à la concurrence de plus en plus rude de pays où les salaires sont bien moindres.
Le coût exact de cette mesure supplémentaire figurant dans le collectif budgétaire s’élève donc à 168 millions d’euros. Vous me rétorquerez que cela n’est pas suffisant ; je tiens donc à vous informer que le Gouvernement a gagé cette somme par une annulation de crédits à due concurrence au sein du budget des ministères. Cette mesure ne représente donc pas une charge supplémentaire pour les dépenses publiques.
Il est vrai, monsieur le rapporteur général, que la mesure ne vaut que pour 2010, tandis que la solution que vous proposez est pérenne. Et comme j’ai conscience du caractère éphémère de la mesure gouvernementale, je souhaite que ce sujet soit à nouveau abordé, au printemps ou au début de l’été, lors de la présentation de la programmation pluriannuelle des finances publiques. Il faudra bien, alors, tenir le « zéro volume » ; à défaut, je ne pourrai pas respecter les engagements que j’ai pris, hier, à cette tribune. Cela signifie que les 168 millions d’euros seront intégrés dans ce « zéro volume ».
Seront donc prises des mesures supplémentaires de diminution des dépenses, ou des mesures permettant de respecter cette norme, compte tenu du dispositif « TO-DE » – même si ce n’est pas le seul ! – à hauteur de 168 millions d’euros.
Plutôt que de vous donner une réponse catégorique, je vous donne rendez-vous, non pas au prochain projet de loi de finances, mais lors de la présentation de la prochaine programmation pluriannuelle, en mai, juin ou juillet prochain.
Oui, mais la programmation fixe les plafonds par mission et définit les grandes orientations budgétaires pour trois ans ; on a d’ailleurs vu tout l’intérêt de cette démarche durant la récente crise.
Loin de moi l’idée de vous refaire le « coup des études », mais je vous rappelle tout de même qu’une mission a été confiée à mon ancien directeur de cabinet sur le lien entre emploi et allégements de charges. Ses conclusions doivent être remises dans les jours ou les semaines qui viennent au Président de la République, qui y a fait allusion hier devant les partenaires sociaux. Nous avons souhaité que cette mission permette d’apporter une réponse précise à cette question.
En tant que membre du Gouvernement, je ne souhaite pas que l’on alourdisse les charges des entreprises, même si celles-ci représentent 22 milliards d’euros.
Il existe deux façons d’envisager le problème.
On peut considérer, d’une part, que les charges patronales sur les bas salaires doivent être moins importantes et progressives. Il ne s’agit plus, dès lors, d’un allégement de charges, mais d’une méthode de calcul.
On peut estimer, d’autre part, que les allégements de charges ne sont pas un sujet tabou. Mais ce n’est guère le moment, en période de sortie de crise, de jouer avec le feu, surtout lorsque le chômage repart à la hausse.
Je n’en dirai pas plus, mais je comprends votre logique, d’ailleurs constante.
Je n’irai pas jusque-là !
Je comprends votre logique de recherche d’économies. Comme il est difficile d’en trouver à l’échelle de 100 000 euros, vous vous attachez à des éléments plus importants, ou aux niches. On peut d’ailleurs considérer, en l’occurrence, qu’il s’agit d’une forme de niche sociale.

Je tiens tout d’abord à remercier les ministres, qui ont été tous deux excellents.
Je crois pouvoir dire que j’ai fait mon travail : un travail budgétaire, nécessairement fruste, pas très intelligent, consistant à mettre, en face d’une charge permanente, une ressource permanente. Lorsqu’on ne sait pas où trouver cette ressource, on prend une grosse masse dont on extrait une petite fraction. Je n’ai pas fait autre chose ! C’est, ni plus ni moins, la méthode budgétaire classique, qui a le mérite d’exister, car elle permet à l’État de tenir à peu près debout et nous est utile dans bien des domaines.
J’ai compris que le ministre souhaitait faire entrer, lors de l’examen de la programmation pluriannuelle, les 300 millions d’euros dans le « zéro volume ». Le chiffre exact est en fait de 270 millions d’euros : il comprend les 168 millions d’euros de charge supplémentaire, ainsi que le remboursement à la sécurité sociale, un problème auquel je suis tellement sensibilisé par mon collègue Alain Vasselle que je ne peux m’empêcher de signaler toute dette de cette nature dès que j’en prends connaissance !
Sourires

Le ministre nous a dit que cette somme serait résorbée à compter de 2011, dans le cadre de la norme « zéro volume », car des économies seront dégagées à due concurrence ; je suis donc satisfait.
Enfin, monsieur le président, je propose que l’on reprenne le débat relatif aux allégements de charges lorsque Serge Dassault sera présent, car, sur ce sujet, c’est une grande voix qui nous manque en cet instant.
Dans ces conditions, je retire l’amendement n° 4 rectifié.
L’article 2 est adopté.

L’amendement n° 5, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le tarif : « 24, 78 » mentionné à l'indice 53 est remplacé par le tarif : « 28, 71 ».
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2010.
La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à corriger une scorie qui avait échappé au Conseil constitutionnel.
Exclamations amusées sur les travées de l’UMP.
Je tiens tout d’abord à remercier M. le rapporteur général d’avoir retiré l’amendement n° 4 rectifié.
Je suis favorable au présent amendement, sous réserve que la disposition entre en vigueur, non pas de manière rétroactive à compter du 1er janvier, mais à la date de promulgation du collectif budgétaire.

Je suis donc saisi d’un amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le tarif : « 24, 78 » mentionné à l'indice 53 est remplacé par le tarif : « 28, 71 ».
Je le mets aux voix.
L’amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 2.
L’amendement n° 38 rectifié, présenté par M. Patriat, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Aux premier et troisième alinéas du 2 de l'article 265 du code des douanes, les mots : « à l'indice d'identification 11 » sont remplacés par les mots : « aux indices d'identification 11 et 11 ter ».
II. - Dans le premier alinéa du 4 du même article, après les mots : « indices d'identification 11 » sont insérés les mots : «, 11 ter ».
La parole est à Mme Michèle André.

Depuis le 1er avril 2009, un nouveau carburant, le supercarburant 95-E10, est distribué dans les stations-service. Ce carburant, qui contient jusqu'à 10 % en volume d’éthanol, doit permettre à la France de remplir son objectif d’incorporation de 7 % de biocarburants dans les carburants fossiles d’ici à la fin de 2010. Par conséquent, il a vocation à se substituer aux traditionnels supercarburants sans plomb.
Depuis le 1er janvier 2005, les régions perçoivent des fractions de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP, applicables aux consommations de supercarburant et de gazole, fixées chaque année en loi de finances, en compensation des transferts de compétence prévus par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ces fractions s’appliquent depuis le 1er avril 2009 au supercarburant 95-E10.
Depuis le 1er janvier 2007, les régions ont également le pouvoir de moduler le tarif de TIPP sur les carburants. Or la rédaction en vigueur de l’article 265 du code des douanes ne permet pas aux régions de percevoir le produit de la modulation régionale des tarifs sur ce nouveau supercarburant.
Le présent amendement vise donc à corriger cette rédaction, afin de mettre en cohérence l’assiette sur laquelle s’appliquent les fractions de tarif attribuées à chaque région en loi de finances au titre de la compensation des transferts de compétences et l’assiette sur laquelle s’exerce la modulation régionale.
Le pouvoir de modulation a été attribué aux régions pour leur permettre une meilleure compensation des charges transférées par l’État. Or leur pouvoir fiscal se trouve de fait amputé s’il n’est pas applicable sur le nouveau carburant. La correction que nous proposons est d’autant plus urgente que les volumes de supercarburant classique diminueront à l’avenir au profit du supercarburant 95-E10. Les régions subiront donc une perte de leurs recettes de TIPP si aucune modification législative n’était effectuée.
Au demeurant, la possibilité donnée aux régions par l’article 94 de la loi de finances pour 2010 de majorer le tarif de la TIPP dans le cadre du financement d’infrastructures de transport durable s’applique sur une assiette incluant ce nouveau supercarburant. Par conséquent, dans la situation actuelle, lorsque les régions devront financer les infrastructures de transport à la demande de l’État, elles pourront augmenter la TIPP sur le carburant 95-E10. À l’inverse, cette modulation leur serait impossible dans le cadre d’une meilleure compensation des charges transférées.
C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de permettre aux régions de disposer du pouvoir de modulation sur le carburant 95-E10.

Sous réserve de l’avis du Gouvernement, ce dispositif me semble conforme au droit communautaire. Par ailleurs, il a l’avantage de renforcer un peu l’autonomie fiscale des régions, ...

... pour un total de ressources estimé à 18 millions d’euros. Cette évolution paraît logique puisque ce nouveau carburant devrait progressivement prendre le relais des traditionnels carburants sans plomb. Je me tourne donc vers le Gouvernement avec un a priori plutôt bienveillant.
Cette nouvelle catégorie de carburants n’avait pas été prise en compte, car elle n’existait pas lorsqu’a été décidée la modulation. Il est tout naturel de lui appliquer cette modulation. L’avis est donc favorable.
L’amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 2.
L’amendement n° 66 rectifié, présenté par M. P. Dominati et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le début du premier alinéa de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, ...
le reste sans changement

L’article 155 de la loi de finances pour 2009, qui a remplacé par une taxe la « contribution forfaitaire » à la charge des employeurs de ressortissants étrangers instaurée en 1975, a repris, pour définir le fait générateur, la terminologie de la loi de finances pour 1975. Or, depuis 1975, le détachement de travailleurs étrangers s’est largement développé.
C’est la raison pour laquelle il semble utile de préciser, à l’article L. 311-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la taxe s’applique en matière de détachement et qu’elle est due par l’employeur établi en France qui accueille le détaché. Cet amendement constitue donc une mesure de précision juridique.

Sur cette précision qui lui paraît utile, la commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.
L’amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 2.
AUTRES DISPOSITIONS

L'amendement n° 37, présenté par M. Patriat, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 1er de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La période d'expérimentation prévue au premier alinéa est prorogée jusqu'au 31 décembre 2010. Les schémas régionaux de développement économique sont mis en œuvre par les conseils régionaux jusqu'à cette date ».
La parole est à Mme Michèle André.

La loi du 13 août 2004 a permis aux régions, dans le cadre de leur principale compétence, à savoir le développement économique, d’élaborer un schéma régional de développement économique afin de définir les orientations stratégiques du territoire en matière économique.
Lors de son élaboration, ce document fait l’objet d’une concertation avec les départements, les communes, leurs groupements, ainsi qu’avec les chambres consulaires. Il doit prendre en compte les conventions passées entre les régions, les collectivités territoriales et l’ensemble des autres acteurs économiques et sociaux du territoire. Il confère ainsi à la région un rôle moteur en matière de développement économique, tout en faisant prévaloir sur le tutorat la concertation entre les collectivités sur un même territoire.
Preuve de son utilité et de son succès : toutes les régions ont réalisé un tel schéma, à la suite de discussions et de négociations constructives avec toutes les collectivités infrarégionales volontaires.
Or ces schémas régionaux de développement économique sont arrivés à leur terme à la fin de l’année 2009 ou l’atteindront prochainement, puisque la loi de 2004 avait prévu leur mise en place à titre expérimental pour une durée limitée à cinq ans.
À l’issue de cette période, la loi a prévu la réalisation d’un bilan de ces schémas. Néanmoins, ce bilan quinquennal ne pourra être réalisé, au mieux, avant la fin du premier semestre 2010. Au regard de ses conclusions, il sera possible de pérenniser ce dispositif.
Toutefois, pendant ce laps de temps, les territoires se trouvent dépourvus de schéma de développement et ainsi privés de toute coordination de leurs actions économiques.
Lorsque le schéma est mis en œuvre, il permet une délégation au profit des régions de la gestion des aides directes aux entreprises. La fin de ce dispositif porterait un coup d’arrêt brutal à l’action économique des régions.
Pour le moment, rien ne semble justifier une telle mesure, particulièrement inutile si nous choisissons de reconduire le dispositif, une fois son intérêt démontré par l’évaluation.
C’est la raison pour laquelle, par le biais de l’amendement n° 37, nous proposons de proroger d’une année la période d’expérimentation de ces schémas, autrement dit pendant l’année 2010, au cours de laquelle seront renouvelées les assemblées régionales. Le temps que les nouvelles équipes se mettent en place et que leurs projets puissent voir le jour, il est essentiel de ne pas priver de fondement juridique la coopération entre les collectivités territoriales.
De plus, à l’heure où les cofinancements sont constamment la cible de critiques, ce dispositif permet justement d’encadrer leur mise en œuvre en octroyant aux régions la qualité de chef de file en matière économique.
Enfin, l’article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, examiné tout récemment par le Sénat, prévoit que dans un délai de douze mois après la promulgation de la loi qui sera adoptée, une loi devra préciser « la répartition des compétences des régions et des départements ainsi que les règles d’encadrement des cofinancements entre les collectivités territoriales ». Au mieux, cette loi ne pourra être adoptée avant l’été 2011. Dans l’intervalle, l’adoption de l’amendement n° 37 permettrait de prolonger les mécanismes de concertation actuels, pendant une durée limitée à une année, sans que pour autant cela préjuge les conclusions des débats à venir.

N’ayant jamais siégé dans une instance régionale, j’ai de la peine à me faire une opinion concrète sur ce sujet. Mais, puisqu’il s’agirait de proroger l’expérimentation des schémas régionaux de développement économique, même si le lien avec le projet de loi de finances rectificative est ténu, et que la disposition est assez littéraire, je m’en remets à l’avis du Gouvernement.
Bien que cette mesure n’ait guère de lien avec le collectif budgétaire, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, avant l'article 3.
L'amendement n° 40 rectifié, présenté par Mme Demontès, M. Massion, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :
« Art. 200 quater C. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour réduire la vulnérabilité à des aléas technologiques de leur habitation principale.
« Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement.
« 2. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 3. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de trois années civiles consécutives, la somme de 30 000 €.
« 4. Le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des dépenses.
« 5. Les 60 % du montant des dépenses restants pourront faire l'objet d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées, tel que prévu à l'article 244 quater U.
« 6. Les travaux mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise.
« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des travaux mentionnés au 1.
« 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« 8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme remboursée. Toutefois aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
« 9. Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées dans un délai de quatre ans à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 du code de l'environnement.
II. - L'article 200 quater A du même code est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est abrogé ;
2° Dans le b du 5, les mots : « des travaux mentionnés au b du 1 et » sont supprimés.
III. - Après le 1 de l'article 200 quater du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux dépenses payées ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater C. »
IV. - Après le 3° du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Soit de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. »
V. - Les dispositions des I à IV ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
VI. - La perte de recettes résultant pour l'État de la création d'une réduction d'impôt au titre des dépenses payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires au titre d'un plan de prévention des risques technologiques, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Massion.

Mes chers collègues, nous avons tous en mémoire les images de la catastrophe survenue le 21 septembre 2001 dans l’usine AZF de Toulouse, au cours de laquelle trente personnes ont trouvé la mort, des centaines d’autres ont été blessées et des milliers de logements ont été dévastés.
Si nous ne pouvons récrire l’Histoire, il est néanmoins de notre devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu’un tel drame se reproduise. Tel était notamment l’objet de la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Les membres du groupe socialiste, après avoir émis un vote positif en première lecture, s’étaient abstenus lors du vote final de ce texte en raison du manque d’engagement du Gouvernement.
Plus de six ans après l’adoption de cette loi, force est de constater que nous avions raison et que tous les efforts restent à mener. Ainsi, sur les quatre cent vingt plans de prévention des risques technologiques, PPRT, qui doivent être réalisés, seuls deux cents sont lancés et quatre, approuvés.
À titre d’exemple, sur le territoire de ma commune, est implantée une usine AZF plus importante que celle de Toulouse. Or la procédure du PPRT n’a toujours pas été lancée et les mesures de sécurité ne sont pas adoptées. Localement, on m’explique que cela tient au fait que l’État n’a pas d’argent. Alors, les mesures de sécurité pour les populations concernées attendent…
Une fois défini, le PPRT peut prescrire des mesures foncières, notamment le délaissement et l’expropriation lorsque les personnes sont exposées à de graves dangers. Il peut également prévoir des prescriptions obligatoires sur les habitations et sur les constructions soumises à des aléas importants, même si ces dernières ont été construites avant l’implantation de l’installation industrielle à l’origine des risques.
Pour les personnes concernées par l’obligation de réalisation de travaux, la loi prévoit actuellement un crédit d’impôt sur le revenu, que la loi de finances pour 2010 a d’ailleurs prorogé d’un an. Mais cette mesure paraît particulièrement inadaptée à la situation financière des contribuables résidant dans le périmètre de ces plans.
En premier lieu, le taux de 15 % de ce crédit d’impôt est inadéquat, car les ménages résidant dans le périmètre d’un PPRT sont rarement aisés ; ils ne disposent donc généralement pas des disponibilités financières leur permettant de faire face au financement des travaux prescrits. Or la réalisation de ces travaux est obligatoire.
En second lieu, le plafond du crédit d’impôt, fixé à 5 000 euros pour une personne seule et à 10 000 euros pour un couple, s’avère, lui aussi, inadapté à la réalité des situations. En effet, le coût des travaux peut atteindre 10 % de la valeur de l’habitation.
Enfin, l’expérience des PPRT montre que le système actuel peut être ressenti par les particuliers comme profondément injuste au regard des autres aides susceptibles d’être octroyées. Ainsi, les industriels peuvent bénéficier d’une subvention de l’État ou des collectivités atteignant 67 % des mesures de prévention qu’ils réaliseraient.
C’est la raison pour laquelle nous proposons d’améliorer ce crédit d’impôt en relevant son taux à hauteur de 40 % des dépenses, dans la limite d’un plafond rehaussé à 30 000 euros par logement, sans considération de la composition du foyer. Les 60 % de dépenses non prises en compte pour le bénéfice du crédit d’impôt pourraient être financés via l’éco-prêt à taux zéro.
Tout en restant fidèles à nos convictions – le développement des crédits d’impôt, qui doivent tous être évalués au regard de leur efficacité économique et sociale –, nous vous proposons de moderniser celui qui est ici en question, afin qu’il puisse véritablement bénéficier à l’ensemble de nos concitoyens résidant dans le périmètre d’un PPRT.
Nous nous réjouissons que ce sentiment soit partagé par nombre d’entre nous. En effet, un amendement identique avait été déposé lors de l’examen la loi de finances rectificative par trois collègues de la majorité, mais il n’avait pas été soutenu. Plus récemment, les députés, sur l’initiative du rapporteur, M. Pancher, ont adopté, à l’occasion de l’examen en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire du projet de loi portant engagement national pour l’environnement, un amendement identique à la proposition que nous vous soumettons aujourd’hui. Monsieur le ministre, votre collègue M. Borloo, ministre d’État, s’est déclaré favorable à cette mesure s’il se dégageait un consensus en séance publique.
Nous souhaiterions connaître aujourd’hui votre position sur notre proposition d’un crédit d’impôt rénové.
J’ajouterai pour finir qu’aucune date n’étant pour l’heure prévue pour l’adoption définitive du Grenelle 2, il est sans doute plus sûr, si l’on souhaite sa mise en œuvre rapide, d’adopter cette mesure à l’occasion de la discussion du présent projet de loi.
Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Comment voulez-vous, dans ces conditions, que la commission n’émette pas un avis défavorable ?
Vous passez votre temps à nous expliquer que, tels Diogène avec sa lanterne, vous cherchez 50 milliards d’euros…

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mais, en l’espèce, mon cher collègue, vous êtes en train de creuser le déficit ! D’un côté, vous cherchez de l’argent ; de l’autre, vous le dépensez ! Si on vous laissait faire, vous en dépenseriez plus que vous ne pourriez en trouver ! Nous le savons bien, car vous l’avez prouvé dans le passé.
Marques d’approbationsur les travées de l’UMP.
Il s’agit de l’extension d’un crédit d’impôt. Un travail indéniable a été effectué sur ce sujet. Cependant, la mesure proposée soulèverait un certain nombre de difficultés au regard de l’article 200 quater B du code général des impôts, qui permet la déductibilité d’un certain nombre d’investissements.
En l’espèce, il s’agit d’une dépense obligatoire. Or un crédit d’impôt relatif à une telle dépense correspond à une subvention et non à une incitation, et la différence entre les divers taux serait très élevée.
Cela dit, c’est un sujet dont le Gouvernement se préoccupe. Ainsi, Chantal Jouanno a organisé une table ronde sur les risques industriels dont les travaux seront suivis par un comité stratégique installé auprès du Conseil supérieur des installations classées.
Quoi qu’il en soit, à ce stade, le Gouvernement émet un avis défavorable.

… qui habitent à proximité d’usines dangereuses !
Sur le territoire de ma commune se trouve une usine AZF. Le PPRT n’a pas encore été établi. Cependant, un périmètre Seveso a été défini dans lequel sont implantés un hypermarché, un complexe cinématographique, une brasserie, un bowling, deux écoles.

Et on y trouve aussi 4 000 habitants. Or on ne peut rien faire dans ce périmètre. Les résidants ne savent pas quels travaux effectuer dans leur habitation parce que, depuis la loi de 2003, l’État n’a pas été capable de mettre en place un PPRT.

Que se passera-t-il si le Sénat ne donne pas suite à notre proposition ? Nos concitoyens ont l’obligation d’aménager leur résidence afin de faire face aux aléas technologiques, mais encore faut-il qu’ils puissent assumer les dépenses occasionnées, ce qui n’est pas le cas de la plupart d’entre eux, comme je l’ai indiqué précédemment. Par conséquent, ils vont demander le rachat de leur maison, comme ils en ont le droit. Normalement, l’opération de rachat est réalisée par le biais d’un fonds alimenté par l’industriel concerné, par la commune et par l’État. Pour ce qui concerne le cas particulier de ma commune, on m’a déjà précisé que l’État ne disposait pas de moyens financiers à cette fin. Quant à l’industriel, nul ne sait s’il acceptera de contribuer… La charge financière sera donc, encore une fois, supportée par la collectivité locale.
Je pense que vous ne prenez pas vos responsabilités !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Notre collègue Marc Massion a raison, mais le crédit d’impôt est-il le bon instrument ?
Mes chers collègues, je souhaite vous citer le cas de la commune de Trosly-Breuil, située dans la vallée de l’Aisne, sur le territoire de laquelle un établissement est classé Seveso. Un atelier de menuiserie implanté à proximité de ce site emploie une quinzaine de personnes. Le chef d’entreprise souhaite déménager pour installer sa société 250 mètres plus loin. Son établissement serait toujours dans le périmètre de protection, mais les contraintes seraient allégées. L’administration accepte que son usine continue à fonctionner à proximité immédiate de l’installation dangereuse, mais refuse de lui octroyer le permis de construire lui permettant d’édifier un établissement quelques mètres plus loin. Où est la cohérence ?
Le principe de précaution conduit des agents de l’administration à empiler, empiler, empiler sans fin les procédures.

Les maires ne savent plus comment faire !
Mais est-ce par la création d’un crédit d’impôt supplémentaire qu’il faut traiter ce problème ? Sincèrement, je ne le crois pas. S’il y a une table ronde sur les PPRT – et c’est sans doute utile –, il devrait être possible de dégager des solutions pour des situations comme celle que nous évoquons.
Je connais d’ailleurs d’autres sites où la rigueur est moindre. Tout dépend du service régional et du préfet qui interprètent la réglementation. Quand c’est à Verberie, dans la circonscription du ministre, cela se passe d’une certaine façon
Sourires
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 39, présenté par Mme Demontès, est ainsi libellé :
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1383 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, à concurrence de 15 % ou de 30 % » et les deux dernières phrases sont supprimés.
2° Après les mots : « et fixe un taux », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « d'exonération variable pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa, en fonction de la nature des risques auxquels le foncier bâti est exposé. »
III. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités locales de la fixation d'un taux variable d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les constructions situées dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques, sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - Les conséquences financières résultant pour l'État de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 33 rectifié, présenté par M. Etienne, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du I de l'article 1519 H du code général des impôts est complété par les mots : « et des stations appartenant aux éditeurs des services de radio édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité visés au quatorzième alinéa de l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Etienne, rapporteur pour avis.

Cet amendement vise à exclure les radios associatives dites « de type A », selon la terminologie du Conseil supérieur de l’audiovisuel, du champ des redevables de la taxe sur les stations radioélectriques.
Si je vous fais cette proposition, ce n’est pas seulement parce que ces stations n’étaient pas jusqu’ici soumises à la taxe professionnelle. Naturellement, j’ai bien compris depuis hier soir que ce seul fait ne pouvait pas constituer un argument pour demander que ces radios sortent du champ des redevables, et j’en conviens moi-même.
En réalité, cet amendement me paraît nécessaire surtout parce qu’il s’agit de radios non commerciales, et qu’on ne voit pas la légitimité de fond qu’il y aurait à taxer un service uniquement destiné à une programmation de communication sociale et de proximité. En effet, les ressources de ces radios viennent principalement, et presque uniquement, du fonds de soutien à l’expression radiophonique locale, géré par le ministère de la culture et de la communication !

L'amendement n° 118 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 1519 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « et des stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».
2° Le deuxième alinéa du III est supprimé.
II. La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Le présent amendement porte sur le même sujet. Plus large que le précédent, il vise à exclure l’ensemble des services de communication audiovisuelle du champ des redevables de la taxe sur les stations radioélectriques qui a été instituée à l’article 1519 H du code général des impôts par la loi de finances pour 2010 du 30 décembre 2009 afin de compenser la suppression de la taxe professionnelle.
Je rappelle que le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, le 17 novembre 2009, visait seulement, s’agissant de cette taxe, les opérateurs de téléphonie, et ne concernait pas les services de radio et de télévision. Or le Sénat a adopté un sous-amendement de deux de nos collègues, tendant à inclure ces radios dans le champ de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, l’IFER.
Cette mesure, je le souligne, a été prise sans grande connaissance du modèle économique de ce secteur et sans étude d’impact approfondie, alors même que ces radios devront payer non seulement la contribution économique territoriale, certes plafonnée à 3% de la valeur ajoutée, mais aussi cette imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau qui, j’y insiste, n’était absolument pas prévue à l’origine. Je trouve dommage que ces sous-amendements aient été ainsi adoptés sans étude préalable ni consultation des commissions compétentes qui connaissent bien le secteur.

L'amendement n° 36 rectifié, présenté par Mmes Bricq et Alquier, MM. Le Menn et Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa du III de l'article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les stations destinées à la diffusion de services de radios associatives et de radios locales, régionales et thématiques indépendantes ne sont pas imposées.»
II. - Les conséquences financières résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq.

Cet amendement est dans la même veine que les amendements n° 33 rectifié et 118 rectifié, mais il se situe à mi-chemin. Le premier est très réduit, puisqu’il tend à exclure uniquement les radios de type A ; le deuxième est beaucoup plus large. Quant au nôtre, il vise deux catégories de radios.
Pourquoi poser ce problème maintenant ? En commission des finances, on m’a opposé que, avec la clause de revoyure concernant les conséquences de la loi de finances pour 2010 portant suppression de la taxe professionnelle, il serait toujours temps de se pencher sur le régime des IFER.
Il reste que nous sommes obligés de gérer l’adoption très improvisée de la suppression de la taxe professionnelle, et de le faire sans trop tarder. En effet, on s’aperçoit que ce qui compenserait très partiellement la suppression de la taxe professionnelle – je veux parler de toute la série d’IFER concernant les entreprises de réseau des stations radioélectriques – pénalisera la diffusion des radios associatives et indépendantes, locales, régionales et thématiques « multiville ».
Nous voulons, quant à nous, exonérer ce type de radios. Si nous ne le faisons pas, ces radios se retourneront vers les collectivités locales. Mes collègues me disent d’ailleurs que c’est déjà le cas.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Et les collectivités locales répondront : « Non » !
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Les collectivités locales seront donc encore plus désavantagées. Et si elles se voient imposer une phase d’austérité et de resserrement de leur budget que vous annoncez, ces radios ne diffuseront plus, tant leur situation économique est précaire. Dès lors, on pénalisera la vie locale et tout un réseau qui maintient une certaine cohésion sociale.
C’est pourquoi nous plaidons pour exonérer de l’IFER ces radios de type associatif, comme celles qui couvrent plusieurs réseaux de ville. En Seine-et-Marne, par exemple, nous avons deux radios locales actives et très écoutées, l’une au nord du département, l’autre au sud. Ne prenons pas le risque de désertifier un peu plus le territoire de nos départements !
Nous souhaitons donc, à l’occasion de l’examen du présent projet de loi de finances rectificative, que soit révisé ce schéma qui, d’après ce que j’ai compris, n’est pas encore arrêté par le Gouvernement en ce qui concerne la totalité des IFER.

Je souhaite rappeler deux principes.
Tout d’abord, nous avons fait la réforme de la taxe professionnelle à droit constant, ce qui signifie que les agents économiques qui bénéficiaient d’une exonération ou d’une réduction dans le cadre de la taxe professionnelle ont retrouvé la même exonération ou la même réduction dans le cadre de la contribution économique territoriale. C’est simplement ce qui est demandé par le rapporteur pour avis, M. Etienne, dans son amendement n° 33 rectifié.
Ensuite, le second principe est le renvoi à ce que j’appellerai la « loi de revoyure » de l’ensemble des sujets d’application de la réforme de la taxe professionnelle. Or les amendements n° 118 rectifié et 36 rectifié sont des amendements de fond, qui font évoluer les dispositions qui étaient en vigueur sous le régime de la taxe professionnelle. Pour nous prononcer sur ces propositions, il nous faut une mise en perspective avec des simulations.
Vous le savez, et l’on en entend beaucoup parler dans nos départements, il y aura bien des ajustements à opérer en matière d’IFER, qu’il s’agisse de l’énergie ou des télécommunications. Il faut que nous soyons capables de mettre à plat tout ce sujet. Le traiter de façon parcellaire ne serait certainement pas une bonne méthode.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 33 rectifié.
En revanche, elle demande le retrait des amendements n° 118 rectifié et 36 rectifié, afin que nous puissions débattre à nouveau de cette question à l’occasion de l’examen de la loi de revoyure.
S’agissant de l’amendement n° 33 rectifié, je précise que ne sont redevables de l’IFER que les personnes disposant de stations radioélectriques pour les besoins de leur activité professionnelle.
Dès lors, deux situations doivent être distinguées pour les stations appartenant aux associations accomplissant une programmation de communication sociale dite de proximité.
Dans le premier cas, les radios associatives qui n’étaient pas redevables de la taxe professionnelle car elles n’exerçaient pas d’activité lucrative ne sont pas assujetties à l’IFER, puisqu’elles sont considérées comme ne disposant pas de station radioélectrique pour les besoins de leur activité professionnelle.
Dans le second cas, les radios associatives exerçant une activité lucrative, qui étaient redevables à ce titre de la taxe professionnelle, sont assujetties à l’IFER dès lors qu’elles disposent de stations pour les besoins de leur activité professionnelle.
L’IFER ne pénalisera pas les radios associatives qui n’étaient pas incluses jusqu’à présent dans le champ d’application de la taxe professionnelle. Tel est l’état actuel du droit.
Votre amendement, monsieur le rapporteur pour avis, peut évidemment être adopté, et c’est au Parlement d’en juger, mais il est déjà satisfait.
Quant aux amendements n° 118 rectifié et 36 rectifié, ils visent à changer l’état du droit actuel et, comme M. le rapporteur général l’a très bien dit, ils relèvent du champ de la taxe professionnelle. Le Sénat a particulièrement tenu à une clause de rendez-vous, qui permettra d’aborder ce sujet ; n’allons donc pas dénaturer ce rendez-vous !
Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

J’avoue ne pas bien comprendre le raisonnement qui nous est tenu.
M. le rapporteur général nous affirme qu’il s’agit bien d’une question de fond et qu’il faut tout mettre à plat. Mais c’était précisément avant l’instauration de cette taxe – elle n’était pas prévue à l’origine dans le texte du Gouvernement, je tiens à le souligner – qu’il aurait fallu mettre à plat ce dispositif et examiner ses implications économiques pour l’ensemble du secteur !
En effet, je le rappelle, ces radios qui payaient la taxe professionnelle auront également à s’acquitter de la contribution économique territoriale.

Elles pourront, de ce fait, se trouver encore plus pénalisées.
Je rappelle également que l’IFER porte sur chaque émetteur. On peut donc imaginer que l’instauration de cette taxe pénalisera aussi un certain nombre de radios installées dans des régions montagneuses ou vallonnées, où la couverture est rendue difficile par le relief et où des émetteurs sont nécessaires pour que les émissions puissent être au rendez-vous. À l’heure où nous discutons de la fracture numérique et de l’égal accès de tous aux services audiovisuels, vous mettez en place une taxe qui va pénaliser les radios installées dans ces secteurs isolés ! Et cela, vous le faites à l’heure où le lancement de la radio numérique terrestre est en préparation et où ces radios devront supporter le coût d’une double émission, analogique et numérique, et ce pendant un certain temps !
Je le répète, avant d’adopter le sous-amendement, il aurait fallu « mettre à plat » toutes ces questions. Encore une fois, monsieur le rapporteur général, ce n’était pas un amendement que vous aviez proposé dans le cadre du projet de loi de finances.
Je maintiens donc notre amendement.

Je voudrais tenter de vous convaincre, madame Morin-Desailly.
D’abord, les entreprises en cause seront soumises à la cotisation foncière des entreprises, qui est une fraction très allégée du montant de la taxe professionnelle qu’elles acquittaient jusqu’à la fin de l’année 2009.
Ensuite, elles ne paieront pas la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, car leur niveau de chiffre d’affaires les en exonère ou leur permet un dégrèvement très significatif.
Je crois donc qu’il faut attendre de mesurer les effets de l’IFER, comme cela a été prévu dans le cadre de l’examen de la loi de finances pour 2010 que nous avons votée cet automne.
Nous pourrions donc prendre rendez-vous à l’automne prochain, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011.
Sous le bénéfice de ces observations, peut-être pourriez retirer votre amendement ?

Je ne comprends pas le traitement différencié qui est réservé à ces trois amendements, dont les dispositions participent pourtant de la même philosophie.
Si l’amendement n° 33 rectifié peut être adopté à droit constant, c’est qu’il est satisfait – vous l’avez d'ailleurs souligné vous-même, monsieur le ministre – et, dans ce cas, on pourrait demander à son auteur de le retirer. Si on ne le fait pas, c’est parce qu’il tend à apporter une précision !
Je le rappelle, cet amendement vise les radios associatives de catégorie A, qui bénéficient de ressources commerciales issues de la publicité, de l’exploitation de leur marque ou de parrainages, mais pour des montants inférieurs à 20 % de leur chiffre d’affaires total.
Mme Morin-Desailly, quant à elle, réclame un élargissement total. Sa proposition me pose problème dans la mesure où elle vise les réseaux nationaux, y compris ceux qui bénéficient d’une très large diffusion et qui réalisent des chiffres d’affaires considérables ; je ne les citerai pas, car je ne veux pas leur faire de publicité !
Mon souhait est différent, même si c’est à Mme Morin-Desailly que l’on donne rendez-vous... Pour ma part, je propose seulement d’exempter des radios appartenant aux catégories A et B, ainsi qu’à une partie de la catégorie D, dont les réseaux sont multiville. En effet, bien qu’elles ne soient pas associatives à proprement parler, ces radios seront affectées par le dispositif envisagé ici.
Je puis comprendre l’argument selon lequel il est nécessaire de réviser l’IFER dans le cadre d’une réflexion globale sur les différents secteurs.
Toutefois, monsieur le ministre, dans le cadre de la commission spéciale sur le Grand Paris, dont notre collègue Jean-Pierre Fourcade est le rapporteur, nous avons auditionné vos services chargés de la législation fiscale. Or, en répondant à une question annexe que nous leur posions, ceux-ci ont souligné que la réflexion sur l’IFER applicable aux différents réseaux n’avait pas du tout avancé au sein de votre administration. Certaines grandes sociétés – cette fois encore, je ne donnerai pas de noms ! – qui avaient en principe négocié avec vos services leur contribution regimbent maintenant contre cette dernière.
L’IFER appliqué aux différents réseaux pose donc un problème global, certes, mais il s'agit d’une question de survie pour ces radios. Si nous ne faisons rien, ces dernières seront les victimes des conséquences néfastes de la suppression improvisée de la taxe professionnelle. Au moins sera-t-il démontré que cette réforme, ou du moins la substitution de ressources à laquelle elle donne lieu, en est encore au stade du bricolage !

Monsieur le président de la commission des finances, je vous ai écouté très attentivement et je prends acte de vos propos et de vos promesses.
Comptez sur moi au moment de la « revoyure », d’autant que, vous le savez, le groupe d’études du Sénat « Médias et nouvelles technologies », dont je suis membre, travaille sur l’ensemble des questions posées par la radio.
Au cours de l’année à venir, nous étudierons donc très attentivement ce dossier, notamment pour y revenir le moment venu, avec des chiffres et des données précises grâce auxquels nous pourrons établir si ce dispositif affecte négativement les services qui devaient en être exclus à l’origine.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, avant l’article 3, et les amendements n° 118 rectifié et 36 rectifié n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 35, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la dernière phrase du premier alinéa du III de l'article 1519 H du code général des impôts, les mots : « à compter du 1er janvier 2010 » sont supprimés.
II. - Les conséquences financières résultant pour l'État de l'extension de la réduction de l'imposition forfaitaire applicable aux stations radioélectriques installées avant le 1er janvier 2010, ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe aucune offre haut débit terrestre, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Miquel.

Avec cet amendement, je reviens sur un sujet qui a été longuement évoqué à l’occasion des débats sur la suppression de la taxe professionnelle lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010 : les conséquences pour les collectivités territoriales de la nouvelle imposition forfaitaire pesant sur les stations radioélectriques.
Comme nous le rappelions alors, le Gouvernement, par le biais de son secrétaire d’État chargé du développement de l’économie numérique, a présenté en octobre 2008 un plan de développement dit « France numérique 2012 », dont l’objectif est ambitieux : garantir l’accès de tous les Français à l’Internet haut débit.
Nous nous en étions inquiétés à l’époque et, depuis lors, nos doutes se sont vérifiés. Les collectivités territoriales sont appelées à financer les investissements nécessaires à l’équipement du territoire, parfois pour la totalité de leur coût. Plus le territoire rural se trouve éloigné, plus l’effort demandé à la collectivité est important, puisque de tels investissements massifs ne sont pas rentables pour le secteur privé.
Par conséquent, afin de ne pas pénaliser les collectivités locales qui financent ces investissements, nous avions souhaité, lors des débats sur le projet de loi de finances pour 2010, exonérer les collectivités du paiement de l’IFER lorsque les équipements sont destinés à desservir une zone blanche, c’est-à-dire dépourvue d’offre haut débit.
À la suite de nos discussions, notre proposition a été en partie rejetée, puisque l’exonération mise en œuvre a été limitée aux stations installées à compter du 1er janvier 2010.
Ainsi, les collectivités qui ont consenti des efforts financiers importants pour équiper leurs territoires avant cette date sont pénalisées, puisqu’elles devront, elles, s’acquitter de cet impôt !
De nombreux départements ont investi dans des équipements de ce type ; le mien leur a consacré plus de 10 millions d’euros. Ces collectivités doivent ainsi faire face à une iniquité de traitement inacceptable par rapport à celles qui n’auraient pas encore effectué ces investissements.
Le projet de loi de finances rectificative dont nous discutons aujourd’hui envisage comme des dépenses d’avenir les investissements consacrés au développement des réseaux à très haut débit. Deux milliards d’euros leur sont ainsi impartis, dont une partie, nous l’espérons, pourra servir à attribuer des subventions aux collectivités désireuses d’équiper leurs territoires.
Toutefois, d’ores et déjà, nous savons que cette somme ne suffira pas à atteindre l’objectif fixé par le Gouvernement d’une couverture à 100 % en très haut débit d’ici à 2025, puisqu’un récent rapport d’étude de la DATAR, la délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale, évalue à 8 milliards d’euros le besoin de financement public, sur les 18 milliards d’euros nécessaires au total.
Par conséquent, la participation financière des collectivités sera indispensable. Monsieur le ministre, pouvez-vous continuer à sanctionner ainsi des collectivités territoriales qui ont péché seulement par excès de réalisme, puisque leurs responsables ont pensé, avant le Gouvernement, avant 2010, que le développement du haut débit constituait une dépense d’avenir ?
Pour notre part, nous ne pouvons admettre cette discrimination. C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous vous proposons d’exonérer de l’IFER l’ensemble des stations radioélectriques destinées à résorber les zones blanches, quelle que soit leur date d’installation.

On ne sera pas surpris que je me réfère de nouveau à la clause de revoyure. Ce sujet, comme d’autres, devra être traité en lien avec la réforme de la taxe professionnelle.
Il n’est pas possible d’adopter un amendement parcellaire sachant qu’il faudra accomplir un travail global beaucoup plus considérable. La commission émet donc un avis défavorable.

Monsieur le rapporteur général, j’ai bien entendu votre explication.
Toutefois, je ne comprends pas la raison pour laquelle on a introduit une exception pour les installations à venir.

La logique est pourtant la même. Par conséquent, soit nous exonérons l’ensemble des installations réalisées afin de résorber les zones d’ombre, soit nous n’en exemptons aucune et nous discuterons des dispositifs qu’il convient de mettre en place quand nous examinerons les répercussions de la suppression de la taxe professionnelle.
Le dispositif me paraît d’un illogisme total !
L'amendement n'est pas adopté.
Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret n° 2009-1648 du 23 décembre 2009 relatif à la création d’une redevance océanique de navigation aérienne. –
Adopté.
I. – La gestion des fonds versés à partir des programmes créés par la présente loi de finances rectificative peut être confiée, dans les conditions prévues par le présent article et nonobstant toute disposition contraire de leurs statuts, à l’Agence nationale de la recherche ainsi qu’à d’autres établissements publics de l’État et à des sociétés dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement une majorité du capital ou des droits de vote. La liste de ces autres établissements et de ces sociétés est fixée par décret.
Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut également concourir à la gestion de ces fonds, pour le compte de l’État ou des établissements et sociétés mentionnés au premier alinéa.
II. – Les conditions de gestion et d’utilisation des fonds mentionnés au I font, préalablement à tout versement, l’objet d’une convention entre l’État et chacun des organismes gestionnaires ou, à défaut, d’un décret, qui prévoit notamment :
1° Les objectifs à atteindre et les indicateurs mesurant les résultats obtenus ;
2° Les modalités d’instruction des dossiers conformément à un cahier des charges approuvé par arrêté du Premier ministre ;
3° La création d’un ou plusieurs comptes particuliers et les modalités d’un suivi comptable propre ainsi que de l’information préalable de l’État sur les paiements envisagés ;
4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles les fonds versés sont, pour un montant déterminé, conservés pour produire intérêt par l’organisme gestionnaire ou par le bénéficiaire auquel il les attribue.
Cette convention ou ce décret précise également les modalités selon lesquelles l’État contrôle l’utilisation des fonds et décide en dernier ressort de leur attribution.
Avant leur signature, les conventions prévues au premier alinéa du présent II ainsi que les éventuels avenants à ces conventions sont transmis aux commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Les fonds sont obligatoirement déposés chez un comptable du Trésor, y compris ceux gérés par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l’État ou des autres organismes mentionnés au I ainsi que ceux relevant du 4° attribués par l’Agence nationale de la recherche à leurs bénéficiaires. Le dépôt au Trésor des fonds mentionnés au 4° ouvre droit à une rémunération dont les modalités et le taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.
II bis (nouveau). – Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport décrivant, pour les années précédentes, l’année en cours et les années à venir, les conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes créés par la présente loi de finances rectificative. Ce rapport présente en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées.
III. – Le Gouvernement dépose chaque année jusqu’en 2020, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport relatif aux investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes créés par la présente loi de finances rectificative. Pour chacune des missions concernées, ce rapport présente notamment :
1° Les investissements prévus et en cours de réalisation, en justifiant le choix des projets et en présentant l’état d’avancement des investissements ;
2° Les montants dépensés, les moyens financiers prévus pour les années à venir, les modalités de financement mises en œuvre et, le cas échéant, les modifications apportées à la répartition initiale des fonds ;
3° Les cofinancements publics et privés attendus et obtenus ;
4° Les objectifs poursuivis et les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;
5° Les retours sur investissement attendus et obtenus, ainsi que les méthodes d’évaluation utilisées ;
6° Le rôle des organismes mentionnés au I et au 4° du II, le contenu et la mise en œuvre des conventions prévues au premier alinéa du II, ainsi que les résultats du contrôle par l’État de la qualité de la gestion de ces organismes.
Ce rapport est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours francs avant l’examen par l’Assemblée nationale, en première lecture, des crédits de la première des missions concernées.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 4 porte sur la mise en œuvre du grand emprunt. Il vise à la fois les conditions de versement des sommes qui seront collectées et les critères grâce auxquels on procédera à l’évaluation des dépenses réalisées.
Nous avons eu déjà l’occasion de pointer quelques-uns des problèmes posés par ce grand emprunt, au regard desquels l’importance de sa quotité et la dette publique supplémentaire qu’il crée deviennent assez secondaires.
La question principale que pose le grand emprunt réside bien plutôt dans la conception générale qu’il dessine de l’intervention publique dans notre pays.
En réalité, le grand emprunt constitue le prolongement utilitariste de la loi Pécresse relative aux libertés et aux responsabilités des universités ; les procédures qui sont décrites dans le présent article le laissent clairement entendre.
Ainsi, aux termes de l’article 4, les « conditions de gestion et d’utilisation des fonds » intègrent : « [le] cas échéant, les conditions dans lesquelles les fonds versés sont, pour un montant déterminé, conservés pour produire intérêt par l’organisme gestionnaire ou par le bénéficiaire auquel il les attribue. »
On voudrait pousser les responsables de certaines universités ou organismes d’investigation à chercher dans des placements de trésorerie de court terme les voies de l’autofinancement de leurs investissements que l’on ne s’y prendrait pas autrement !
En effet, tel est bien l’objectif du versement par anticipation des fonds dévolus à telle ou telle dépense de recherche. Le présent texte incite donc, dans une certaine mesure, les présidents d’université à boursicoter, même s’il est fort probable que les ressources mises à la disposition des établissements seront drainées vers des placements obligataires, gérés, par exemple, par la Caisse des dépôts et consignations.
Quant à l’évaluation du grand emprunt, elle semble bel et bien circonscrite à une logique purement comptable !
Quand on lit avec précision le texte, on se rend compte que les dépenses réalisées doivent produire des « retours sur investissement ». Les entreprises doivent y trouver leur compte en termes de valeur ajoutée, tandis que les comptes publics pourraient, pour leur part, bénéficier d’une nouvelle source d’économies.
D’ailleurs, ce qui importe plus que tout dans le débat qui nous occupe, semble-t-il, c’est d’amener les établissements de recherche et les universités à contracter des accords de cofinancement avec des opérateurs et entreprises privés, ce qui permettrait éventuellement à l’État, par le biais des économies budgétaires ainsi réalisées, de s’affranchir de ses propres obligations.
Dans un univers comme celui de la recherche et de l’enseignement supérieur, qui est déjà largement victime du sous-emploi, de la précarisation des conditions de travail de nombreux chercheurs, enseignants et doctorants et des retards qualitatifs accumulés en matière d’équipements et d’infrastructures, une telle démarche va à l’encontre de l’intérêt général.
Segmenter les activités de recherche, en laissant dépérir celles qui n’entreront pas dans les priorités du présent texte et en conditionnant la permanence des autres à l’importance des cofinancements assurés par le secteur privé, ne saurait recueillir notre approbation.
C'est pourquoi, si son contenu n’est pas infléchi, nous ne pourrons évidemment pas voter cet article.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais revenir sur l’un des volets de la mise en œuvre du grand emprunt prévue par ce projet de loi : l’enseignement supérieur, la formation et la recherche.
Sur les 35 milliards d’euros de crédits complémentaires accordés au titre du grand emprunt, 11 milliards d’euros seront attribués à l’enseignement supérieur et la formation universitaire, dont 1 milliard d’euros pour le développement de la formation en alternance et l’égalité des chances. Par ailleurs, quelque 8 milliards d’euros seront impartis à la recherche.
Avec un total de 19 milliards d’euros sur les 35 milliards d'euros accordés, l’enseignement supérieur et la recherche sont en apparence les grands gagnants du grand emprunt. Si nous ne pouvons que nous en féliciter, nous ne devons pas oublier qu’une telle somme n’est nécessaire qu’en raison de l’insuffisance des engagements budgétaires accordés par l’État depuis maintenant plusieurs années. Un retard doit être rattrapé, de l’aveu même du Président de la République...
En outre, si de tels chiffres peuvent de prime abord enthousiasmer, vient ensuite le temps délicat du déchiffrage, et cet exercice est moins réjouissant. En effet, il s’agit non pas d’injecter des fonds dans les domaines qui en ont le plus besoin, mais bien de soutenir certains secteurs jugés stratégiques pour la prospérité future de l’économie française, ce qui traduit une vision purement marchande de la richesse d’un État.
Or s’il est un secteur où la richesse ne doit pas se mesurer uniquement à l’aune de la rentabilité, c’est bien celui de la connaissance et de la formation des esprits.
Ce grand emprunt a de quoi nous inquiéter.
L’enseignement supérieur est abondé à hauteur de 10 milliards d’euros supplémentaires. Ainsi, 7, 7 milliards d’euros sont consacrés à la création de campus d’excellence de visibilité mondiale, 1, 3 milliard d'euros à la poursuite de l’opération Campus, le milliard d’euros restant étant attribué à la constitution du campus scientifique et technologique européen du plateau de Saclay.
L’essentiel de ce grand emprunt sera accordé à un nombre très restreint d’établissements, tout au plus cinq à dix campus universitaires d’excellence, sélectionnés selon des critères préétablis, comme nous l’avons déjà fait remarquer.
L’opération Campus consiste à rénover un certain nombre de locaux d’universitaires, là encore, préalablement sélectionnés. Elle devait être financée à hauteur de 5 milliards d’euros par la vente des actions d’EDF. Celle-ci n’ayant en fait rapporté que 3, 7 milliards d'euros, le grand emprunt est un moyen astucieux d’attribuer à l’opération les fonds manquants.
Quant à la recherche, dotée de 8 milliards d’euros, elle reste ancrée dans la même logique élitiste et utilitaire. Le financement, d’une part, de laboratoires et d’équipements d’excellence, à hauteur de 2 milliards d'euros, et, d’autre part, de la recherche dans le secteur de la santé et des biotechnologies, à hauteur de 2, 4 milliards d'euros, doit permettre de dégager des débouchés économiques importants.
On favorise ainsi la recherche appliquée au service de l’économie libérale et l’on développe le partenariat public-privé dans ce domaine. Le privé n’ayant rien à gagner dans la recherche fondamentale, on marginalise cette dernière. La recherche publique et son armée de CDD de niveau bac + 10 continueront de se partager des queues de cerises, et le service public de la recherche mettra le second genou à terre !
Favoriser à outrance la recherche appliquée sur projets, c’est méconnaître le fonctionnement de la recherche et de l’innovation. Le Gouvernement mise tout sur la recherche incrémentale sur projets, alors que ce n’est pas elle qui est à l’origine des grandes avancées technologiques. Ce n’est pas parce qu’on a décrété vouloir lutter contre le cancer qu’on a inventé la résonance magnétique nucléaire, l’un des équipements les plus importants dans le diagnostic de cette pathologie. On n’a pas plus inventé l’ampoule électrique en cherchant à améliorer la bougie !
Ce grand emprunt reste donc marqué par l’idée de faire émerger des pôles universitaires et de recherche prestigieux, capables de rivaliser avec les grandes universités américaines. On crée des pôles de compétitivité et d’excellence et on les choisit en fonction de leur capacité à faire naître du profit. Ainsi, au nom de la crise, on intègre la logique du privé dans l’université et la recherche, on finance quelques grands pôles au détriment de la formation du plus grand nombre.
En d’autres termes, on creuse les inégalités entre les formations, en laissant de côté la recherche et l’enseignement en sciences sociales, en sciences humaines, disciplines qui, si elles contribuent à l’enrichissement de la pensée, ont le défaut de mal se vendre.
Par ailleurs, ces crédits seront distribués par des fondations qui viendront « doubler » les organismes publics compétents. Ils seront attribués sous la forme de dotations en capital. Par conséquent, les sommes dégagées ne pourront être consommées ; seuls le seront les intérêts, ce qui diminue considérablement l’effet que les sommes annoncées peuvent avoir. Nous sommes donc loin de l’accroissement annuel de 1, 8 milliard d'euros promis par M. Sarkozy. Votre dotation est un trompe-l’œil !
Je tenais à dénoncer ce véritable mirage que crée le grand emprunt. Avantager une minorité au détriment du plus grand nombre n’est en aucun cas un progrès. Ce n’est pas non plus notre conception de la connaissance et de la formation.

L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
II.- A. Pour chaque action du programme d'investissements, les conditions de gestion et d'utilisation des fonds mentionnés au I font, préalablement à tout versement, l'objet d'une convention entre l'État et chacun des organismes gestionnaires. Cette convention, qui ne peut être conclue pour une durée supérieure à dix ans, précise notamment :
La parole est à M. le rapporteur général.

Il s’agit d’un amendement très modeste, qui tend à prévoir que les conventions entre l'État et les organismes chargés de la gestion des fonds d'avenir ne peuvent être conclues pour une durée indéterminée. Certains projets étant envisagés sur le long terme – c’est notamment le cas des campus d'excellence –, il convient de prévoir une renégociation périodique des conventions.
Afin de permettre aux opérateurs de mettre rapidement en œuvre le programme d'investissements, compte tenu de la suite qu’il convenait de donner aux réunions préparatoires avec vos services, monsieur le ministre, j’ai accepté de rectifier cet amendement pour que soit précisé qu'une convention serait signée pour chaque action du programme d'investissements. Cela permettra de démarrer les projets qui sont d'ores et déjà prêts, sans attendre les moins bons élèves, c'est-à-dire sans attendre que l'ensemble du programme d'investissements mis en œuvre par un même opérateur soit déterminé.
Monsieur le ministre, cet amendement n’est pas du pur formalisme ! Le dispositif du grand emprunt, formulé de manière si habile et intéressante, sera scruté de près par tous les observateurs extérieurs. La dette et le déficit de notre pays sont tels que 35 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 2010 pourraient, si les contreparties ne sont pas prévues et gérées de manière extrêmement rigoureuse, entraîner quelques difficultés de compréhension.
Notre souci est donc de montrer que le dispositif est vertueux et que, s’il s’agit, certes, de fonds de dotations en capital allouées à des opérateurs, notamment à des universités, l’État, donc le Gouvernement et le Parlement, ne perd pas son droit de regard : il veille à la bonne affectation des sommes et est susceptible de demander des comptes. Au terme d’une période que la commission a fixée à dix ans pour simplifier, l’État doit être en mesure de renégocier, de confirmer, voire de modifier, le cas échéant, les objectifs et les conditions de rémunération.

Le sous-amendement n° 62 rectifié, présenté par MM. Charasse, Collin et Mézard, est ainsi libellé :
Alinéa 3 de l'amendement n° 6
Après les mots :
à dix ans,
insérer les mots :
est publiée au Journal Officiel de la République française et
La parole est à M. Michel Charasse.

Cet amendement est très simple. Dans un souci de transparence et de clarté, il tend à prévoir que les conventions visées à l’amendement n° 6 rectifié sont publiées au Journal officiel.
Je précise, monsieur le président, pour gagner du temps, que le sous-amendement n° 64 rectifié que j’ai déposé à l’amendement n° 16 qui viendra en discussion dans un instant a exactement le même objet. Je considère donc qu’il est soutenu, et je ne le présenterai pas.

Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 62 rectifié ?
J’émets un avis favorable sur l'amendement n° 6 rectifié, car l’idée de la commission des finances est bonne.
Dans le système de gestion de gouvernance, que je ne rappellerai pas car chacun l’a en tête, il s’agit d’une avancée forte pour deux raisons. D’une part, il est important de considérer que les conventions ne peuvent pas être signées sans visibilité, et, de ce fait, leur donner une durée maximale de dix ans me paraît pertinent. D’autre part, il est utile d’indiquer dans ces conventions les conditions de gestion et les modalités d’utilisation des fonds.
Je m’interroge, en revanche, sur la pertinence du sous-amendement n° 62 rectifié. En effet, les conventions seront transmises au Parlement – je ne doute pas que les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat les examineront avec soin – et mises en ligne. Par conséquent, je me demande si leur publication au Journal , qui risque d’alourdir inutilement ce dernier, est opportune.
Toutefois, par souci de transparence, je ne peux m’y opposer. Aussi, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

Monsieur le ministre, la publication au Journal officiel peut se faire par un simple avis d’information renvoyant à la consultation du dossier dans les services compétents.
Il revient au Gouvernement de déterminer quelle forme prendra la publication. Celui-ci n’est pas obligé de publier l’intégralité de la convention, mais il peut se contenter de la mentionner, comme c’est déjà le cas aujourd’hui pour les fondations reconnues d’utilité publique ou pour l’approbation par la tutelle des budgets de certains établissements publics.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Avant l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A. Le programme d'investissements, présenté par action, et le montant des fonds délégués à cet effet ;
La parole est à M. le rapporteur général.

L'amendement est adopté.

L'amendement n° 99, présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 4 :
Compléter cet alinéa par les mots :
notamment en termes d'emplois, de développement d'équipes de recherche, de respect des normes sociales et environnementales
La parole est à M. Bernard Vera.

L’évaluation du dispositif du grand emprunt est assez nettement orientée par de simples considérations budgétaires. Il suffit de prendre quelques-uns des critères retenus pour s’en rendre compte.
Aux termes du paragraphe II : « Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport décrivant, pour les années précédentes, l’année en cours et les années à venir, les conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits ouverts sur les programmes créés par la présente loi de finances rectificative. Ce rapport présente en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ». Voilà qui réduit singulièrement la portée des investissements à leur seul rendement comptable.
Le paragraphe III, quant à lui, ne comporte que des critères d’évaluation comptable.
Cette logique utilitariste imprègne donc lourdement le débat sur le grand emprunt, alors même que la raison d’être de l’investissement public est non pas de participer à la réalisation d’objectifs plus ou moins arbitraires de réduction des déficits, mais bien plutôt d’apporter à l’ensemble du corps social les moyens complémentaires de son développement.
La recherche en matière d’énergie renouvelable n’a pas de sens si elle se contente de confier à quelque université française le soin d’éprouver tel ou tel mode de production d’énergie solaire ou éolienne, en attendant qu’une entreprise n’acquière et n’exploite le brevet qui découlera de ces travaux.
Elle n’a de sens qu’au regard des objectifs plus généraux des politiques publiques en matière d’indépendance énergétique du pays, de changements de mode de production d’énergie, d’allégement à venir de la facture énergétique des ménages et des entreprises
Dans le même ordre d’idées, engager de l’argent public dans la numérisation de nos archives et bibliothèques publiques n’a pas de sens si elle revient à nous soumettre à la prédominance d’une entreprise américaine bien connue au lieu de faire valoir la réalité de la francophonie au travers d’un mode de numérisation qui nous serait propre.
Nous l’avons souligné, la recherche dans notre pays souffre d’un profond développement de la précarité. Celle-ci affecte autant les doctorants, les assistants, les équipes universitaires en général que les activités de recherche et développement du secteur marchand, largement sous-traitées dans des structures soumises au seul vouloir des donneurs d’ordre.
Tels sont les paramètres que nous souhaitons voir figurer dans le cadre de l’évaluation des dépenses ouvertes au titre du grand emprunt.

Tout cela n’est somme toute que littérature. Respecter les normes sociales et environnementales, c’est tout simplement respecter la loi. Personne ne peut imaginer que des conventions puissent sortir de l’ordre public et transgresser les normes sociales et environnementales. Cela engagerait lourdement la responsabilité de leurs signataires !
Par ailleurs, il semble inutile de préciser qu’il faut mesurer les résultats obtenus en termes d’emploi et de développement d’équipes de recherche : cela va de soi ! Il s’agit d’un objectif tellement évident que l’inscrire dans la loi revient à l’affaiblir.
C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement.
Je partage la position du rapporteur général.
Le projet de loi de finances rectificative ne fixe aucun indicateur précis, le 1° du II de l’article 4 mentionnant « les objectifs à atteindre et les indicateurs mesurant les résultats obtenus. », ce qui a une portée très large. Pour chaque convention sera fixée la qualité des indicateurs qui seront utilisés par le Parlement, le Gouvernement, le comité de surveillance des investissements à venir et le commissariat général à l’investissement.
Si les indicateurs en termes d’emploi me semblent nécessaires, puisque tout le dispositif est orienté vers la croissance, en revanche, des indicateurs relatifs au développement des équipes de recherche me paraissent plus mystérieux : s’agit-il d’augmenter leur nombre ou d’améliorer leurs résultats ?
Par ailleurs, le respect des normes selon la loi va de soi.
La mesure proposée n’est donc pas nécessaire ; elle alourdit le texte tout en le rendant moins clair et, surtout, elle a pour conséquence d’obérer la liberté de choisir les indicateurs adaptés à chaque convention.

Si ces indicateurs vont de soi, comment pourraient-ils obscurcir le texte ? Par conséquent, je ne comprends pas l’argumentation qui consiste à refuser d’inscrire ces termes dans la loi.
Je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 56, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
qui devra, en sus des autres critères, prendre en compte, notamment, l'impact en termes d'attractivité du territoire national ainsi que la comparaison et l'articulation, le cas échéant, avec les meilleures pratiques européennes
La parole est à M. Philippe Adnot.

La réussite du grand emprunt dépendra de notre capacité à l’utiliser par effet de levier, en particulier pour la recherche et sa valorisation.
L’objet de cet amendement est d’attirer l’attention sur la nécessité d’harmoniser les procédures retenues avec les pratiques européennes, afin de faciliter l’accès à des fonds d’investissement internationaux, en particulier à des fonds européens.

Cet amendement est intéressant et très pertinent.
Je m’interroge toutefois au sujet de sa rédaction. Que recouvre la formule : « l’articulation […] avec les meilleures pratiques européennes » et quel est le caractère normatif de cette disposition ?
Le Gouvernement saura certainement nous éclairer sur ce point, et la commission se conformera à son avis.
Pour ma part, je suis également dubitatif.
Certes, on ne peut que partager le souci de M. Adnot d’améliorer l’attractivité des territoires par le biais de la disposition proposée.
Toutefois, cette précision, plutôt que d’être insérée dans la loi elle-même, devrait figurer dans les conventions qui régiront les relations entre le Gouvernement et chacun des opérateurs chargés de la mise en œuvre des projets.
Toutes ces précisions inscrites dans la loi ont tendance à rendre les projets plus lourds, plus administratifs, plus compliqués et moins créatifs. Or il importe de laisser une grande marge de liberté aux opérateurs, dans le cadre très précis qui leur est fixé, avec une convention indiquant le déroulement du processus.
Cela étant, je ne m’oppose évidemment pas de manière absolue à la prise en compte de l’attractivité du territoire au moment de la sélection, et je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

Il s’agit moins de considérer l’attractivité du territoire que d’éviter que les conventions ne contiennent des contre-indications à l’effet de levier escompté avec des fonds ou des appels d’offre internationaux.
Aujourd’hui, loin d’être enfermés dans l’Hexagone, nos laboratoires de recherche participent à des appels d’offre internationaux.
Si M. le ministre s’engage à veiller à la prise en compte de cet aspect, je veux bien retirer l’amendement, car il n’est pas dans mon intention d’alourdir le texte. Cet engagement public me suffirait.
Je reconnais votre sagesse, monsieur Adnot.
Je veillerai à ce que cette précision figure dans le texte de chaque convention, puisqu’il est toujours préférable d’évoquer ce qui semble aller de soi.
Je prends cet engagement. Il sera transmis au commissariat qui a pour mission de coordonner et réaliser les conventions pour le compte du Gouvernement.

L’amendement n° 56 est retiré.
L'amendement n° 9, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que les dispositions prises pour assurer la transparence du processus de sélection ;
La parole est à M. le rapporteur général.

Cet amendement a pour objet de prévoir, dans le cadre de l'instruction des dossiers, la transparence de l'ensemble du processus de décision afin d'éviter toute contestation inutile sur le mode de sélection.
Cette transparence se traduit, notamment, par la publication des recommandations du comité de sélection de l'organisme gestionnaire, la publication de l’avis du commissaire général à l'investissement, ainsi que la motivation de la décision finale lorsque celle-ci diffère des recommandations du comité de sélection.
Cette transparence doit, bien entendu, être assurée dans le respect le plus strict du secret des affaires lorsqu’il s’impose et des autres secrets protégés par la loi.
Ce commentaire de pure information a pour but d’éclairer la nature et le contenu de cet amendement.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement, très utile, car il partage le souci d’assurer et d’inscrire dans le marbre la transparence du processus de sélection des projets. Il est très important que ce processus ne soit pas attaquable et qu’il soit réalisé en toute connaissance de cause.
La transparence est assurée par la publicité des appels à projet, l’association étroite des experts dans la procédure, la publication de l’avis du commissaire général à l’investissement, la motivation de la décision du Gouvernement qui renvoie à l’exercice du pouvoir exécutif, ainsi que par l’action du comité de surveillance.
Nous devons assurer la transparence du processus de décision tout en respectant la répartition des tâches et des responsabilités.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 10, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Les modalités de versement des fonds par l'organisme gestionnaire, ainsi que les conditions selon lesquelles l'État contrôle l'utilisation des fonds et décide en dernier ressort de leur attribution ;
La parole est à M. le rapporteur général.

Cet amendement vise les modalités de versement des fonds. Il s’agit de procéder, autant que possible, par tranche et après évaluation régulière de l’état d'avancement des différents projets.

Je suppose que l’expression « les modalités de versement » dans l’amendement n° 10 couvre les modalités et le rythme de versement des fonds, c'est-à-dire des acomptes.
Je voudrais que le Gouvernement nous confirme bien que l’on exclura, d’une façon générale, le versement des fonds en totalité, en un seul acompte, dès le démarrage de la convention. En effet, si le bénéficiaire ne respecte pas ses obligations, cela donnera sans doute lieu à une demande de reversement des fonds alloués.
Monsieur le rapporteur général, l’expression « les modalités de versement » désigne-t-elle bien les modalités et le rythme de versement des fonds ?
Le Gouvernement confirme également cette interprétation : il s’agit bien des modalités et du rythme de versement des fonds.
Les opérateurs touchent les fonds en bloc, puis ils procèdent à des décaissements par tranche, comme le précise cet amendement, en fonction des projets et selon un échéancier de versement propre à chaque projet.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 11, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Les modalités du suivi et de l'évaluation de la rentabilité des projets d'investissement financés ainsi que les conditions dans lesquelles est organisé, le cas échéant, l'intéressement financier de l'État au succès des projets ;
La parole est à M. le rapporteur général.

L'évaluation de la rentabilité des investissements et le calcul du retour sur investissement constituent des enjeux majeurs.
Les conventions entre l'État et les gestionnaires doivent précisément détailler les procédures d'évaluation, notamment l'organisation du, afin que les informations remontent comme il convient.
Pour que ces informations soient agrégées à l’échelon national, il importe que les indicateurs, comme les procédures d'évaluation, soient, autant que possible, partagés par l'ensemble des organismes gestionnaires. Ces derniers doivent appliquer une méthodologie identique ou, du moins, homogène. Les conventions doivent permettre de garantir cette unité de méthode.
Les modalités d'intéressement financier de l'État au succès des actions conduites devront être intégrées de façon explicite au texte des conventions.
Le Gouvernement, et en particulier le ministre du budget, est très favorable à cet amendement.
Il me semble important de préciser dans les conventions les modalités d’évaluation du projet en termes de rentabilité financière des investissements et de retour sur investissement, ainsi que les modalités d’intéressement financier de l’État à leur succès.

Cet amendement est particulièrement important.
En effet, il fait écho à de nombreuses interrogations sur la portée et les retombées du grand emprunt. Il s’agit tout de même d’investissements qui nécessitent un budget de l’ordre de 35 milliards d’euros.
Selon le dossier de presse du Gouvernement, grâce au surcroît de croissance et de recettes à long terme, l’emprunt national s’autofinancera à l’horizon de onze ans environ.
Cette affirmation suscite quelques interrogations : comment peut-on réaliser une telle anticipation ? Comment l’étude d’impact a-t-elle été menée pour aboutir à la perspective selon laquelle des retombées suffisantes permettront d’équilibrer la situation dans ce délai ?
Nous avons besoin de voir s’afficher rapidement des repères sur le tableau de bord qui permettra d’observer les réalisations concrètes du dispositif.
Par ailleurs, nous nous interrogeons sur le sens exact qui est donné au concept de rentabilité. L’investissement à vocation publique vise, au-delà de la rentabilisation financière, à remplir une mission d’utilité globale et sociale. Dès lors, une question se pose : comment évaluer la rentabilité d’un investissement public dans cette perspective ?
Monsieur le ministre, vous vous êtes engagé à ce que des indicateurs soient précisés et que des informations soient fournies sur la rentabilité. Pourriez-vous nous donner, dès aujourd'hui, des précisions sur la nature et les critères de l’évaluation de la rentabilité globale et sociale, ainsi que sur l’utilité de l’ensemble de ces investissements ? Cela nous permettrait d’avoir une appréciation plus positive de l’ensemble de ces investissements, afin d’éclairer notre vote sur cet amendement.
Monsieur le sénateur, je ne me lancerai pas dans un débat sur la rentabilité globale des investissements prévus, d’autant que Christine Lagarde vous a déjà apporté un certain nombre de précisions, mais sachez que vous trouverez des indications dans les fascicules jaunes qui accompagnent systématiquement les documents budgétaires soumis au Parlement.
Je tiens personnellement beaucoup à ce que cette rentabilité puisse être évaluée, et j’imagine que vous partagez ce sentiment, car tel est finalement l’enjeu du grand emprunt : avoir, au fur et à mesure de la concrétisation des projets, une perspective quant au retour sur investissement prévu et en débattre sur des bases très claires. L’adoption de l’amendement présenté par M. le rapporteur général va d’ailleurs dans ce sens.
Ce type d’informations constitue un élément majeur dans la prise de décision des différents comités d’expert et du comité de surveillance, qui devront se prononcer sur l’éligibilité de tel ou tel projet à l’emprunt.
L’amendement est adopté.

L’amendement n° 12, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
La création d’un ou plusieurs comptes particuliers
par les mots :
L’organisation comptable, en particulier la création d’un ou plusieurs comptes particuliers,
La parole est à M. le rapporteur général.
L’amendement est adopté.

L’amendement n° 13, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
un montant déterminé
par les mots :
un montant et une durée déterminés
La parole est à M. le rapporteur général.

Par cet amendement plus substantiel, nous souhaitons aborder la question du « dénouement » de l’emprunt national, ce qui nécessite de statuer sur le sort des dotations en capital, ou fonds non consomptibles, attribuées dans le cadre de cette opération.
Notre amendement a pour objet d’inscrire dans la loi le caractère « réversible » du financement d’organismes par des revenus versés par l’État en contrepartie du dépôt au Trésor desdits fonds non consomptibles alloués par l’État à ces organismes.
Cette réversibilité inclut une double possibilité : réviser le montant de la rémunération du dépôt des dotations, en fonction, tout simplement, des taux du marché ; reverser ces dotations à l’État lorsque celles-ci ne sont pas transférées en pleine propriété, point qui devra être apprécié à sa juste mesure.
Afin de répondre à cette exigence de réversibilité, l’amendement vise à prévoir que les dotations ne sont versées que pour un montant et une durée déterminés.
Cette précision devrait permettre de garantir la protection des intérêts budgétaires et patrimoniaux de l’État, en considérant les dotations en capital non consomptibles comme des apports temporaires de fonds de l’État à différents gestionnaires.
Monsieur le rapporteur général, au vu des échanges que nous avons depuis déjà de longues minutes, je tiens tout d’abord à saluer le travail approfondi et ô combien appréciable réalisé sur cette question de la gouvernance par la commission des finances, même si, sur cet amendement très précis, le Gouvernement ne vous suivra pas et ne pourra émettre un avis favorable, et ce pour un certain nombre de raisons.
Je commencerai néanmoins par souligner un point d’accord entre nous : il convient en effet de laisser à l’État la possibilité de réviser le montant de la rémunération qu’il octroie sur les dotations non consommables. Le dépôt au Trésor des fonds concernés ouvre en effet droit à une rémunération dont les modalités et le taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.
Grâce à ce mécanisme périodique de révision de la rémunération des dotations, le dispositif gagnera en souplesse et jouera évidemment à plein puisque l’arrêté pourra être modifié si nécessaire. Sur ce volet important de votre amendement, vous avez donc, me semble-t-il, satisfaction.
Vous souhaitez, par ailleurs, consacrer le principe selon lequel les dotations sont versées pour une durée déterminée. Je note que vous avez défendu la même idée sur les niches : elle a d’ailleurs été adoptée et nous sommes en train de la mettre en œuvre.
Pour autant, nous sommes ici dans un domaine quelque peu différent. Si je peux comprendre que vous ne soyez pas favorables à un dispositif totalement figé, il ne me paraît pas souhaitable de poser dès à présent une règle générale en ce sens.
Pour étayer mon propos, je prendrai l’exemple des campus d’excellence, pour lesquels les universités choisies recevront des fonds.
L’idée du Président de la République, qu’il a exposée devant les Français avant que le Gouvernement ne la reprenne, est de faire émerger des campus attractifs sur le plan mondial. Il s’agit d’un objectif que nous sommes nombreux à partager, mais dont la réalisation, à l’évidence, va prendre un certain temps : tout ne se fera pas d’une rentrée à l’autre, et il faudra beaucoup d’opiniâtreté pour y parvenir.
Nous avons prévu dans le texte de loi un encadrement très précis de l’utilisation des fonds, avec un processus de sélection rigoureux et une période probatoire de trois ans préalable à tout transfert de dotations aux campus.
Passé cette période, il est indispensable que les universités concernées puissent s’engager dans des projets de long terme. Pour être durablement compétitives, celles-ci doivent pouvoir offrir des rémunérations pérennes au titre des enseignements et attirer ainsi des chercheurs de très haut niveau. Il ne s’agit donc pas de financer des opérations ponctuelles. Nous ne sommes pas dans la même logique que l’opération Campus, que j’ai eu l’occasion de rappeler hier.
Ces universités doivent également être en mesure d’attirer des cofinancements privés, grâce au fameux effet de levier que j’ai évoqué. Et pour ce faire, il faut évidemment un engagement durable.
Mais il est d’autres cas de figure pour lesquels la situation sera différente.
Dans le cadre du programme « Transports et urbanisme durables », géré par la Caisse des dépôts et consignations, il est ainsi prévu 400 millions d’euros de dotations non consommables. Puisque la propriété de ces fonds, dont la nature juridique exacte devra être précisée, n’est pas transférée, j’imagine que de telles sommes peuvent aisément être reprises : ce qu’une loi de finances fait, une autre peut le défaire.
De même, parmi les fonds que l’Agence nationale de la recherche pourra allouer aux futurs instituts hospitalo-universitaires, il y a 700 millions d’euros de dotations non consommables.
Ces deux exemples le montrent, en réalité, ce que le législateur fait, il peut le défaire. Au cas où les projets ne répondent pas aux attentes, sont trop ambigus et ne produisent aucun résultat tangible, l’argent doit pouvoir être récupérable. S’il est évidemment souhaitable de prévoir de telles voies de sortie, celles-ci ne doivent pas être généralisées, au risque de fragiliser les fonds réservés aux universités.
En réalité, le Gouvernement a fait le choix du pragmatisme. C’est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à cet amendement, dont je comprends l’objectif mais sans en partager les termes, tout du moins pour les raisons et les cas que je viens d’exposer.

Monsieur le ministre, je vous remercie de toutes vos précisions. Au fond, l’État reste propriétaire de ses capitaux, à charge pour lui d’apprécier l’usage qui en est fait. Il est le véritable détenteur des fonds non consomptibles.

Plus que cela, car il les met à disposition, en donne par délégation l’usufruit pour une durée qui n’est pas fixée. Or s’il apparaissait, chemin faisant, que leur usage était détourné de sa vocation première, l’État pourrait, me semble-t-il, remettre en cause cette convention.

Au bénéfice de ces précisions et confirmations, nous pourrions, monsieur le rapporteur général, retirer cet amendement.

L’amendement est adopté.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 15, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
B. Avant leur signature, les conventions prévues au premier alinéa du présent II ainsi que les éventuels avenants à ces conventions sont transmis aux commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Les commissions chargées des finances font connaître leur avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui leur a été faite du projet de convention.
La parole est à M. le rapporteur général.

Il s’agit d’un amendement important pour les trois commissions compétentes que sont la commission des finances, la commission de l’économie et la commission de la culture, puisque celui-ci porte sur les conditions de notre association au suivi de l’opération « grand emprunt ».
En premier lieu, nous proposons d’étendre aux trois commissions la procédure de transmission des projets de convention déjà introduite par l’Assemblée nationale.
En second lieu, nous souhaitons prévoir un avis des commissions chargées des finances sur ces projets. Nous nous sommes en réalité fondés sur le précédent existant en matière de décrets d’avances. Cette procédure nous semble en cohérence avec l’esprit de la loi organique relative aux lois de finances.
Monsieur le ministre, vous vous livrez finalement à une opération non pas de « débudgétisation » – je sais que vous n’aimez pas ce terme ! –, mais de cantonnement : vous créez dans le budget de l’État un canton – juridique, pas électoral !

Il s’agit d’un compte particulier, régi par des règles particulières, mais qui demeure au sein du patrimoine de la personne morale « État ».
En raison de ce cantonnement des fonds de l’emprunt national, une vigilance particulière des commissions des finances est indispensable. À supposer que nous en ayons le goût et les moyens, ce que j’ose espérer, il ne serait pas acceptable que nous disposions sur ces fonds de capacités d’investigation moindres que sur les crédits des missions et des programmes constituant le budget général de l’État.
Les commissions des finances devraient être en mesure de vérifier que les documents contractuels précisent de manière satisfaisante le régime de délégation des fonds aux gestionnaires, les conditions de conservation, les modalités de versement des fonds aux porteurs de projet, le suivi comptable des fonds, l’évaluation des investissements financés, l’intéressement au retour financier.
Bref, comme l’aurait dit en d’autres temps Michel Charasse, notre souhait est d’éviter qu’on ne mange la grenouille ! §Autrement dit, il ne saurait y avoir, à l’intérieur de ce canton, des procédures plus souples, voire plus laxistes que dans le budget de l’État tel qu’il fonctionne en vertu de la loi organique relative aux lois de finances.

L’amendement n° 63 rectifié, présenté par MM. Charasse et Collin, Mme Laborde et M. Mézard, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Les commissions chargées des finances et les autres commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur signature, les conventions prévues au premier alinéa du II, ainsi que leurs éventuels avenants.
Les commissions chargées des finances peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces conventions et de leurs avenants.
La parole est à M. Michel Charasse.

Avec l’amendement n° 15, que M. le rapporteur général vient de défendre, et mon amendement n° 63 rectifié, nous sommes au cœur du contrôle parlementaire sur l’emprunt.
Je crains que l’amendement de M. le rapporteur général, dont je comprends et partage les motivations, n’aille au-delà des limites autorisées par les textes constitutionnels et organiques.
En matière de contrôle parlementaire des lois de finances, c’est en effet la loi organique relative aux lois de finances qui pose les bases. Il faut distinguer deux éléments.
D’abord, il faut distinguer les éléments d’information, que le Parlement peut, librement, exiger et obtenir, y compris dans les lois de finances ou les lois de finances rectificatives, qui ont d’ailleurs le caractère de lois de finances.
Ensuite, il y a les interventions que le Parlement peut demander dans l’exercice et le contrôle du pouvoir réglementaire d’exécution de la loi de finances. Mes chers collègues, monsieur le rapporteur général, permettez-moi de vous le dire, en la matière, les prérogatives des uns et des autres et leurs limites sont très clairement posées par la loi organique elle-même.
Lorsque vous demandez, monsieur le rapporteur général, que les conventions soient transmises aux commissions parlementaires, c’est de l’information : il n’y a pas d’obstacle à votre souhait du côté de la loi organique et, donc, de la Constitution.
Lorsque, en revanche, vous suspendez la signature pendant sept jours, le temps pour les commissions de donner un avis, je crois que vous empiétez sur le domaine que la Constitution réserve à la loi organique.
Monsieur le rapporteur général, vous avez vous-même cité l’exemple des décrets d’avances en indiquant que votre amendement n° 15 est, en quelque sorte, une copie du système retenu par la loi organique pour les décrets d’avances. C’est effectivement la même chose, sauf que, pour les décrets d’avances, les pouvoirs du Parlement sont prévus par la loi organique.
Une décision du Conseil constitutionnel datant, je crois, de février 1968 me fait d’ailleurs craindre qu’on puisse considérer que le législateur interfère dans un pouvoir qui n’est pas le sien : je veux parler du libre exercice du pouvoir réglementaire par le Gouvernement.

Certes, mes chers collègues, on peut toujours prévoir une information des commissions – c’est le premier alinéa de l’amendement n °15, qui ne pose aucun problème. On peut tout aussi bien penser que, en pratique, le Gouvernement prendra l’habitude d’attendre quelques jours, le temps que les commissions réagissent et fassent éventuellement connaître leur opinion.
Mais si la pratique est une chose, la contrainte législative en est une autre. C’est la raison pour laquelle je propose, par mon amendement n° 63 rectifié, que les conventions soient transmises avant signature, conformément au souhait de la commission des finances, aux « commissions chargées des finances et aux autres commissions compétentes » – il n’y a pas de changement par rapport à l’amendement n° 15, sinon une modification rédactionnelle.
Mais il est précisé, dans le deuxième alinéa de mon amendement, que les commissions destinataires « peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles », sans fixer de délai et sans contraindre le Gouvernement à attendre sept jours pour pouvoir apposer sa signature sur la convention. En effet, cher Philippe Marini, le deuxième alinéa de votre amendement me paraît se situer en dehors des limites de l’épure constitutionnelle et organique !
C’est la raison pour laquelle j’ai la faiblesse de considérer que mon amendement, qui va moins loin que celui de la commission des finances mais qui peut aboutir en pratique au même résultat, est beaucoup plus conforme au texte de la Constitution et de la loi organique que l’amendement n° 15 de M. le rapporteur général, étant entendu que nous poursuivons, lui et moi, le même objectif.

Les amendements n° 28 et 46 sont identiques.
L'amendement n° 28 est présenté par M. Etienne, au nom de la commission de la culture.
L'amendement n° 46 est présenté par M. Retailleau, au nom de la commission de l'économie.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 9
Remplacer les mots :
aux commissions chargées des finances
par les mots :
aux commissions compétentes
La parole est à M. Jean-Claude Etienne, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 28.

Cet amendement prévoit la transmission des projets de convention entre l'État et les organismes attributaires des crédits aux différentes commissions parlementaires compétentes, plutôt qu’aux seules commissions chargées des finances. Il importe, en effet, d’associer toutes les commissions concernées à cette information et à ce contrôle.

La parole est à M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 46.

Cet amendement, identique au précédent, exprime un souhait commun aux trois commissions permanentes, des finances, de l’économie et de la culture, de se voir transmettre ces conventions.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements n° 63 rectifié, 28 et 46 ?

Ces amendements, d’une grande valeur, ont pour auteurs d’éminentes personnes, qui les ont travaillés avec beaucoup de soin.
Sourires

Cela rend mon rôle extrêmement difficile à cette heure !
Cela étant dit, nous pouvons nous accorder, me semble-t-il, sur le fait que les différentes commissions doivent recevoir l’information. Il est tout aussi évident que la commission des finances a, en matière de suivi des fonds, des obligations qui sont de sa nature propre et qui correspondent aux responsabilités qu’elle exerce.
Après les explications que j’ai entendues, je me demande si l’amendement le plus synthétique, voire syncrétique ne serait pas l’amendement n° 63 rectifié de M. Charasse. Étayé par une analyse constitutionnelle plus approfondie, il me semble de nature à satisfaire nos trois commissions permanentes. Je suis donc prêt à m’y rallier.
Le parallèle, habile, avec la procédure des décrets d’avance, qui oblige à recueillir un avis de la commission des finances, n’est pas total, et vous le savez très bien, même si vous poussez le raisonnement jusqu’au bout. En effet, le décret d’avance modifie le vote du Parlement, et il est naturel qu’il y ait une procédure au cours de laquelle l’avis formel de la commission est demandé. En l’occurrence, nous ne sommes pas dans ce cas.
Les uns et les autres, nous souhaitons éviter toute confusion entre l’exécutif et le législatif. Le rôle de l’exécutif, c’est de gouverner et de proposer. Celui du législatif, c’est de voter la loi et de contrôler l’exécutif. C’est là un point très important à mes yeux.
C’est pourquoi je n’étais pas favorable au fait d’imposer à une commission de rendre un avis. Elle peut toujours le faire. Pourquoi donc le lui imposer ? Ce qui me gênait, c’était non pas le délai de sept jours, à mon sens tout à fait suffisant, mais le risque de confusion entre la responsabilité de l’exécutif et celle du législatif en ce domaine.
J’en arrive à l’amendement n° 63 rectifié, qui me paraît superfétatoire.
À partir du moment où le Gouvernement envoie les textes des conventions à la commission des finances et aux deux autres commissions compétentes, nul ne peut empêcher ces destinataires de donner un avis et de le faire parvenir à qui bon leur semble au sein de l’exécutif : au Premier ministre, aux ministres concernés. Les commissions peuvent également procéder à des auditions immédiates concernant cette convention. Personne ne peut empêcher la commission concernée d’agir comme elle l’entend.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. De faire une conférence de presse !
Sourires
Elle est libre d’examiner ou non la convention en question, d’inviter rapidement tel ou tel responsable à venir en parler. Nous sommes bien dans une logique du contrôle de l’exécutif.
Je n’ai pas d’opposition de principe à l’encontre de cet amendement, sinon qu’il me paraît assez curieux d’inscrire dans la loi qu’on peut faire des observations au Premier ministre.
Le plus important est que la loi précise, au cas où les amendements identiques n° 28 et 46 seraient adoptés, que les textes sont transmis à vos commissions. Après, elles font ce qu’elles veulent du texte, conformément au rôle du Parlement.

Pour tenir compte de ces observations et dissiper toute ambiguïté dans les relations toujours excellentes et confiantes entre les différentes commissions permanentes compétentes et la commission des finances, je suggère une rectification de l’amendement n° 63 rectifié afin que la rédaction soit la suivante : « Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre […] ».

J’étais sur le point de proposer moi-même cette modification pour aller dans le sens des amendements identiques n° 28 et 46. Il est beaucoup plus simple d’écrire : « Les commissions compétentes peuvent adresser […] ».
Je voudrais faire observer à M. le ministre que la seule contrainte posée au Gouvernement par l’amendement n° 63 rectifié consiste à transmettre les conventions avant leur signature. Cela me paraît compatible avec la loi organique, puisque cela n’interdit pas au Gouvernement de signer, à la limite, le jour où il transmet la convention. De ce point de vue, nous sommes dans le domaine du pur contrôle parlementaire par le biais de l’information.
Ensuite, si les commissions jugent utile d’adresser au Gouvernement des observations – c’est ce que dit le deuxième alinéa de mon amendement –, elles le font. C’est leur vocation, mais on en reste là !
Et, avec la rectification suggérée par M. le président Arthuis, toutes « les commissions concernées » sauront qu’il leur faut transmettre en urgence au Gouvernement toutes observations qui leur paraissent utiles.

Je suis donc saisi d’un amendement n° 63 rectifié bis, présenté par MM. Charasse et Collin, Mme Laborde et M. Mézard, et ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Les commissions chargées des finances et les autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat reçoivent, pour information et avant leur signature, les conventions prévues au premier alinéa du II, ainsi que leurs éventuels avenants.
Les commissions concernées peuvent adresser au Premier ministre toutes observations qui leur paraissent utiles à propos de ces conventions et de leurs avenants.
La parole est à M. le rapporteur général.

L’amendement n° 15 est retiré.
Que pense la commission de la culture de cette rédaction ?

Je suis favorable à cet amendement n° 63 rectifié bis, et, en cas d’adoption de ce dernier, je retirerai l’amendement n° 28.

Je suis également favorable à cet amendement ; en cas d’adoption de ce dernier, je ferai comme M. Etienne et retirerai l’amendement n° 46.
Aux termes de cette nouvelle rédaction, les commissions concernées peuvent faire des observations au Premier ministre sur le fondement d’un texte transmis aux commissions avant signature. Pour moi, l’avis est implicitement entendu par la saisine.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.

Les amendements n° 28 et 46 sont donc retirés.
L'amendement n° 16, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Avant l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
C. Les conditions de gestion et d'utilisation des fonds conservés pour produire intérêt attribués par l'Agence nationale de la recherche font également, préalablement à tout versement et selon les modalités prévues au II, l'objet d'une convention entre l'Agence nationale de la recherche et l'organisme bénéficiaire.
La parole est à M. le rapporteur général.

Il s’agit de préciser le régime des sous-conventions entre l’Agence nationale de la recherche, l’ANR, et les bénéficiaires des crédits qu’elle va subdéléguer.
L'ANR, qui devrait se voir allouer 17, 6 milliards d'euros au titre de l'emprunt national, a vocation à reverser 12, 7 milliards d'euros à d'autres gestionnaires dont on ne connaît pas encore nécessairement la structure juridique précise. Celle-ci pourra être variable d’une opération à l’autre.
L'importance de ce reversement, qui correspond majoritairement à des dotations non consomptibles, montre que la même attention doit être portée aussi bien à la contractualisation entre l'État et les organismes gestionnaires qu’entre ces derniers et les éventuels « opérateurs de second rang ». En effet, il convient notamment de fixer les conditions dans lesquelles les dotations en capital, non consomptibles, leur sont versées et sont rémunérées par l'État.
C’est particulièrement essentiel compte tenu des volumes que je viens d’évoquer et du fait que l’ANR, organisme remarquable, est appelée à vraiment changer d’échelle avec cette opération du grand emprunt. Elle a besoin d’être confortée et de disposer d’un cadre propre à assurer un suivi efficace de ces différents investissements, notamment sur le plan budgétaire.

Le sous-amendement n° 64 rectifié, présenté par MM. Charasse, Collin et Mézard, est ainsi libellé :
Alinéa 3 de l'amendement n° 16
Après les mots :
l'objet d'une convention
insérer les mots :
publiée au Journal Officiel de la République française et conclue
La parole est à M. Michel Charasse.

Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 64 rectifié ?
Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 64 rectifié.
Quant à l’amendement n° 16 concernant les conventions de deuxième rang de l’ANR avec les bénéficiaires de fonds in fine, le Gouvernement émet un avis favorable sous réserve d’une rectification visant à préciser que ces conventions de deuxième rang seront soumises à l’approbation de l’État.

J’y suis favorable, monsieur le président, et je rectifie mon amendement en ce sens.

Je suis donc saisi d’un amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Avant l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
C. Les conditions de gestion et d'utilisation des fonds conservés pour produire intérêt attribués par l'Agence nationale de la recherche font également, préalablement à tout versement et selon les modalités prévues au présent II, l'objet d'une convention entre l'Agence nationale de la recherche et l'organisme bénéficiaire soumise à l'approbation de l'État.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 64 rectifié.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 17, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 10
I. - Faire précéder le début de cet alinéa de la mention :
II bis A. -
II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées trimestriellement de la situation et des mouvements des comptes des organismes gestionnaires sur lesquels sont déposés les fonds.
La parole est à M. le rapporteur général.

Le cantonnement, qui résulte de la délégation des crédits en une seule fois, en 2010, à différents organismes gestionnaires, nécessite pour être contrôlé un suivi comptable strict, afin de garantir l'étanchéité entre ce canton, c'est-à-dire les fonds issus de l'emprunt national, et les autres ressources des opérateurs, qui peuvent eux-mêmes émarger sur différents programmes de crédits de l’État, ou bénéficier de ressources privées. Une telle exigence justifie l'obligation faite à chaque gestionnaire de déposer les fonds reçus au titre de l'emprunt sur un compte particulier au Trésor.
L’amendement vise donc à prévoir que la situation de ces comptes et leurs mouvements soient portés trimestriellement à la connaissance des commissions parlementaires chargées des finances. L'information régulière du Parlement devrait faciliter le contrôle de l'emprunt par ce dernier, en particulier les travaux des rapporteurs spéciaux.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 18, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les redéploiements modifiant la répartition initiale des fonds entre les différentes actions du programme d'investissements sont approuvés par le Premier ministre, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
La parole est à M. le rapporteur général.

Selon l’exposé des motifs du projet de loi, le bilan annuel de l’exécution du programme d'investissements d’avenir pourra conduire, « le cas échéant, à un redéploiement des crédits en cas de performance insuffisante ».
Cet amendement a pour objet de clarifier et d’organiser cette procédure.
L’autorisation parlementaire étant donnée au regard d’une ventilation de l’emprunt national par programme et par action, toute décision de redéploiement significatif des fonds entre les actions du programme d'investissement devrait être portée préalablement à la connaissance des commissions des finances du Parlement, ainsi qu’à celle des autres commissions compétentes.
Je me suis interrogé sur cet amendement, sachant que le présent projet de loi de finances rectificative ne contient lui-même aucune précision sur l’éventuel redéploiement des fonds.
Le Gouvernement émet néanmoins un avis favorable.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 57, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les bénéficiaires de l'Agence nationale de la recherche peuvent, notamment, être des sociétés financières d'innovation. Les règles applicables à l'agrément du capital, au ratio d'emprise, au rythme d'investissement et au renouvellement périodique du portefeuille des sociétés financières d'innovation sont fixées dans des conditions prévues par décret.
La parole est à M. Philippe Adnot.

Le grand emprunt va permettre à la France de se doter de campus et de laboratoires internationaux d’excellence, mais la valorisation des travaux de ces institutions constitue un enjeu majeur. Pour cela, nous devons disposer d’outils en parfait état de fonctionnement.
L’objet de cet amendement est de rendre le plus opérationnel possible l’un de ces outils, à savoir les sociétés financières d’innovation, au moyen d’un léger toilettage des dispositions qui les régissent, ce que vous devriez pouvoir accepter sans difficultés, monsieur le ministre.
Je précise que j’ai travaillé à l’élaboration de cet amendement avec différents organismes tels que l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, l’INSERM, ou l’Institut national de recherche en informatique et en automatique, l’INRIA.

Dans le cadre de l’emprunt national, il est prévu d’allouer un milliard d’euros environ à un fonds national de valorisation de la recherche, afin notamment de financer l’implantation de sociétés de valorisation sur de grands sites universitaires. Il s’agit d’une somme absolument considérable pour de tels outils.
Il semblerait que les conditions juridiques et financières d’intervention de ces sociétés soient toujours en cours d’expertise. La société financière d’innovation est sans doute l’une des voies possibles, mais je souhaiterais que M. le ministre, en réponse à l’amendement présenté par M. Philippe Adnot, nous dise ce qu’il en pense.
En effet, la démarche du grand emprunt est essentiellement celle d’une valorisation de la recherche technologique. Il s’agit de créer un effet de levier grâce à des fonds publics, de susciter des coopérations, mais aussi, sans doute, de faire appel en partie à des ressources issues de l’épargne publique, via les marchés financiers.
Quand on sait ce que furent les péchés de jeunesse de certains outils issus des universités, y compris des meilleures – Philippe Adnot aura compris mon allusion –, il y a lieu d’être prudent, de bien encadrer ce type d’outils et de faire en sorte qu’ils soient entre les mains de professionnels. À l’occasion de ce débat, M. le ministre pourrait donc utilement nous préciser de quelle manière il envisage le lancement de ces actions de financement de la valorisation.
Plus généralement, à propos de ce grand emprunt, nous devons tous réaliser que nous n’avons pas le droit à l’erreur. J’ai la conviction qu’il peut être très vertueux et très utile, à condition d’encadrer les procédures sans pour autant tuer l’initiative et l’innovation, ce qui permettra à ce dispositif de transition entre l’administration de la recherche et le marché de fonctionner de manière efficace et harmonieuse.
Il me semble que nous y avons veillé, mais nous savons tous que c’est non seulement une question d’argent, mais aussi de culture et de disponibilité des moyens humains. Philippe Adnot a mis l’accent sur un point important.
Monsieur Adnot, je vous remercie de l’intérêt que vous portez aux sujets liés à l’innovation.
Nous sommes ici en marge du grand emprunt. Par principe, le véhicule des sociétés financières d’innovation n’est pas exclu des financements de l’Agence nationale de la recherche.
Je crois comprendre que vous nous invitez à revoir le décret de 1992 régissant ces sociétés, notamment en ce qui concerne le capital agréé et la possibilité de le libérer progressivement.
Je prends l’engagement de revoir les dispositions réglementaires qui s’appliquent à ces sociétés, après avoir étudié le dossier avec Christine Lagarde.
En contrepartie, je vous serais reconnaissant de bien vouloir retirer cet amendement.

Compte tenu de l’engagement qui vient d’être pris, je le retire, monsieur le président.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, j’attire toutefois votre attention sur le point suivant : on ne devra pas se contenter de quatre ou cinq organismes de valorisation. Il s’agit non pas de débattre d’une question de périmètre administratif adéquat, mais de s’assurer qu’aucun excellent projet, aucune possibilité de valorisation ne nous échappe.
Nous passerions à côté de notre sujet si nous ne savions pas utiliser tous les bons outils dont nous disposons, qu’il s’agisse des sociétés financières ou des fondations, qu’elles soient partenariales, universitaires ou d’une autre nature. Multiplions les outils et ne nous enfermons pas dans des périmètres qui pourraient nuire à l’efficacité !

L'amendement n° 57 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 19 rectifié est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 29 rectifié est présenté par M. Etienne, au nom de la commission de la culture.
L'amendement n° 45 rectifié est présenté par M. Retailleau, au nom de la commission de l'économie.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Avant l'alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis B.- Le commissaire général à l'investissement veille, sous l'autorité du Premier ministre, à la cohérence de la politique d'investissement de l'Etat. Il est chargé de la mise en œuvre du programme d'investissements d'avenir financé par les crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative.
Le comité de surveillance des investissements d'avenir, qui comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs représentant la commission des finances et les autres commissions compétentes, désignés par le président de leur assemblée respective, évalue la rentabilité des investissements ainsi que leur impact socio-économique et culturel, et dresse un bilan annuel de l'exécution du programme.
Il s'appuie en tant que de besoin sur le commissaire général à l'investissement et sur les organismes chargés de la gestion des fonds consacrés aux investissements d'avenir. Il transmet chaque année au Parlement et au Premier Ministre un rapport sur ses travaux.
Un décret précise les conditions d'application du présent paragraphe.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié.

Cet amendement vise à clarifier la répartition des compétences entre le commissaire général à l'investissement et le comité de surveillance des investissements d’avenir.
Le commissaire général, placé sous l'autorité du Premier ministre, serait chargé de la mise en œuvre du programme d'investissements d'avenir.
Le comité de surveillance comprendrait quatre députés et quatre sénateurs, afin que les commissions compétentes puissent être représentées.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Et pourquoi pas la Délégation aux droits des femmes ?
Sourires
Nouveaux sourires.

Et la commission des affaires européennes ? Et celle des affaires sociales ?
Mêmes mouvements.

Mes chers collègues, sachons raison garder ! Restons-en à la commission saisie au fond du présent projet de loi de finances rectificative et aux deux commissions saisies pour avis.
Selon cet amendement, le comité de surveillance serait chargé de l'évaluation des investissements et du bilan annuel de l'exécution du programme, lequel pourrait conduire, le cas échéant, notamment en cas de performance insuffisante, à des recommandations de redéploiements de crédits.
Afin de remplir sa mission, le comité, dont les réunions devraient au moins être trimestrielles dans un premier temps, s'appuierait en tant que de besoin sur le commissaire général à l'investissement et sur les organismes chargés de la gestion des fonds consacrés aux investissements d’avenir. Outre la rédaction d'un rapport annuel, il devrait pouvoir adresser, à tout moment utile, des recommandations au commissaire général à l'investissement.
Le renforcement du comité de surveillance nous paraît nécessaire, car c’est l’instance à laquelle participe le Parlement et c’est la seule vraie association possible sur le plan institutionnel, en dehors du cadre des contrôles, de la représentation nationale à la gouvernance de l’emprunt national.
La séparation des responsabilités de sélection et d'évaluation permettra d'éviter les conflits d'intérêt. On ne saurait admettre, monsieur le ministre, que le commissaire général à l’investissement ait à la fois un rôle de préparation et d’évaluation de ses propres choix. Ce serait manifestement le mettre en porte-à-faux, ce qu’il a d’ailleurs reconnu au cours de son audition devant la commission des finances. Il faut donc bien séparer les rôles.
Sous réserve des apports, certainement excellents, de nos collègues des commissions de la culture et de l’économie, la rédaction de cet amendement me semble équilibrée.

Le sous-amendement n° 65 rectifié, présenté par MM. Charasse, Collin et Mézard, est ainsi libellé :
Alinéa 3 de l'amendement n° 19
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il n'a pas la qualité d'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'Etat.
La parole est à M. Michel Charasse.

Il faut qu’il soit bien entendu que le commissaire général à l’investissement, quelles que soient ses qualités, que je ne mets pas en doute, ne saurait être l’ordonnateur des dépenses et recettes de l’État.
Évidemment, si M. le ministre nous confirme qu’il n’en est pas question, j’aurai mauvaise grâce à insister. Toutefois, dans le silence du texte, je préfère que les choses soient précisées.

La parole est à M. Jean-Claude Etienne, rapporteur pour avis, pour présenter l’amendement n° 29 rectifié.

Dans l’évaluation telle qu’elle vient d’être excellemment présentée par M. le rapporteur général, il est question de retour sur investissement, sous-entendu par rapport aux contrats de programmation, d’innovation ou de recherche qui avaient pu être déposés.
Or bon nombre de retours sur investissement ont un caractère social ou culturel qu’il conviendrait également de ne pas négliger.
À vouloir trop diaphragmer l’appréciation de l’évaluation, on en oublierait certains attendus qui ont toute leur place dans le cadre de l’évaluation de ce genre de programme.

La parole est à M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 45 rectifié.

Cet amendement, identique aux précédents, s’inscrit dans le même esprit.
La commission de l’économie tient énormément à l’exigence de contrôle démocratique et parlementaire.
La séparation des deux fonctions – d’une part, l’évaluation pour le comité de surveillance et, d’autre part, l’instruction et la sélection pour le commissaire général à l’investissement – va dans le sens d’une clarification des compétences de ces deux instances.
En outre, l’augmentation du nombre de députés et de sénateurs de sorte que l’ensemble des commissions compétentes des deux assemblées soient représentées au sein du comité de surveillance permet de répondre à la nécessité d’un meilleur contrôle parlementaire.

Les amendements de la commission de la culture et de la commission de l’économie sont identiques à l’amendement de la commission des finances. En réalité, il vaudrait mieux parler, monsieur le président, d’un amendement commun aux trois commissions.

M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis. C’est un comité de liaison !
Sourires

En effet, mon cher collègue !
Le sous-amendement n° 65 rectifié me semble, à ce stade, nécessiter un avis du Gouvernement.
En effet, s’agissant de l’engagement des dépenses, les responsables de programmes seront désignés ordonnateurs des dépenses pour les nouveaux programmes créés dans le cadre de la loi de finances rectificative. Au sein des opérateurs et autres organismes gestionnaires des crédits, sous réserve des règles particulières de gouvernance et des dispositifs arrêtés dans le cadre des conventions avec l’État, les ordonnateurs seront, en pratique, les responsables administratifs de ces organismes.
J’avoue ne pas avoir bien perçu la nécessité absolue de ce sous-amendement, et je serai très attentif à l’avis du Gouvernement.
Le sous-amendement n° 65 rectifié de M. Charasse vise à apporter une précision.
Je tiens à souligner que le commissaire général n’a absolument pas le rôle d’ordonnateur. Cette qualité appartient au responsable du programme pour le versement des fonds aux organismes, puis, au sein de chacun de ces organismes, sur des projets bien définis, les responsables administratifs et financiers adéquats.

Je retire ce sous-amendement, monsieur le président, puisque le fait que le commissaire général n’est pas ordonnateur signifie qu’il ne dispose pas du pouvoir de réquisitionner le comptable lorsque ce dernier ne veut pas payer.

Le sous-amendement n° 65 rectifié est retiré.
Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
S’agissant des amendements identiques n° 19 rectifié, 29 rectifié et 45 rectifié, quelle que soit la qualité de leurs auteurs, le Gouvernement émet un avis défavorable, et je le regrette infiniment.
M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le rapporteur général, passé ce choc, je suis certain que mon explication vous ira droit au cœur !
Sourires
En premier lieu, le problème est de savoir qui évalue.
Le projet de loi tel qu’il est rédigé précise que le commissaire général à l’investissement veille à l’évaluation a priori et a posteriori des investissements, ce qui entre d’ailleurs bien dans son rôle et celui de son adjoint. Il exerce, en particulier, les responsabilités suivantes : il prépare les décisions du Gouvernement relatives aux contrats ; il coordonne l’instruction des projets d’investissement et formule des avis et propositions ; il veille à l’évaluation, a priori et a posteriori, des investissements, et notamment de leur rentabilité – cela doit aussi vous aller droit au cœur !– ; enfin, il dresse un bilan annuel de l’exécution du programme. Il s’agit donc bien d’un rôle d’animateur du processus.
Or pour lui permettre de remplir ce rôle de façon cohérente et si possible efficace, il doit évaluer. L’évaluation est une nécessité et la garantie du choix pertinent des investissements a priori et a posteriori. Cela signifie non pas qu’il mène lui-même l’évaluation, même s’il en a la possibilité, mais qu’il veille à ce que chaque dispositif soit correctement évalué à un moment donné dans le cadre d’un processus qui a recueilli son accord.
Je ne vois pas là de conflits d’intérêt. Le commissaire général est en position de gardien au regard des organismes qui engagent les projets sur le plan opérationnel. Ces projets ne sont pas les siens, et ce n’est pas lui qui prend les engagements. Il fait faire, sans agir en direct. Il est, quant à lui, je le répète, l’animateur de l’ensemble de la démarche.
Il doit s’interroger sur l’efficacité des projets. C’est ce qu’on appelle l’évaluation. Il ne faudrait pas lui retirer une partie de ses outils pour le faire !
Par ailleurs, il est chapeauté par le comité de surveillance qui est chargé de donner une opinion, de surveiller le dispositif général, de vérifier notamment que tous les fonds sont engagés dans le droit fil de l’objectif présenté. Ce comité peut, lui aussi, demander une évaluation.
Aucun de ces organismes n’est totalement entravé, car il s’agit de leur permettre d’être mieux éclairés. Ainsi, le commissaire peut demander que l’évaluation soit refaite s’il le juge nécessaire.
Il serait dommage de lui refuser ce rôle d’évaluation. Le commissaire est en effet au cœur du système ; il est responsable. À ce titre, lors des auditions par les commissions parlementaires, il doit être en possession d’évaluations suffisantes ou démontrer qu’il veille à ce qu’elles existent et qu’elles sont suffisamment solides pour étayer une opinion demandée par le Parlement, lequel exercera un contrôle extrêmement actif.
Telles sont les raisons pour lesquelles il me semble logique de laisser la possibilité de l’évaluation au commissaire général.
En second lieu, s’agissant de la composition du comité de surveillance, vous demandez la présence de plus de deux députés et deux sénateurs.
Passer à quatre députés et à quatre sénateurs, comme vous en exprimez le souhait, pousserait probablement à augmenter la taille du comité de surveillance. On serait tenté d’accroître le nombre de personnalités qualifiées, actuellement au nombre de six, hormis le nombre de coprésidents, MM. Michel Rocard et Alain Juppé, personnalités uniques. Le comité de surveillance serait un peu lourd et trop large pour émettre une opinion.
Je préconise une formation restreinte et équilibrée, présidée par les deux anciens Premiers ministres qui ont rédigé le rapport, et comprenant deux députés et deux sénateurs, ainsi que six personnalités qualifiées. Ce comité, composé ainsi de douze membres, aura la capacité d’exercer une surveillance.
Il y aura toujours la tentation d’augmenter son effectif, mais ce serait contre-productif par rapport aux objectifs qui lui sont assignés. Peut-être faut-il d’abord le laisser vivre, avant de se poser la question de sa composition ?

Il faut dans toute discussion parlementaire, si l’on veut qu’elle se déroule bien, des temps pour l’unanimité, des temps pour la convivialité et des temps pour la contradiction. Il faut assumer cette dernière, d’autant qu’elle est provisoire !
Il faut aussi penser à la commission mixte paritaire et la faire vivre !
Sourires

C’est notre souci !
Monsieur le ministre, sans dénaturer votre dispositif dont tous les aspects positifs ont été mis en relief par les différents rapporteurs tout au long de cette discussion, il s’agit d’ouvrir la discussion avec nos collègues députés sur le point concernant l’articulation des compétences du commissaire général et du comité de surveillance.
Je tiens à dire d’emblée que le commissaire général nous inspire une grande confiance. En effet, nous l’avons vu à l’œuvre comme médiateur du crédit dans la phase la plus difficile de la crise. Ceux qui le connaissaient déjà n’ont pas été surpris, et les autres ont pu observer son caractère extrêmement concret, pugnace, qui lui a permis de faire véritablement avancer les choses et de contribuer à sauvegarder des milliers d’emplois dans notre pays. Par conséquent, le commissaire général bénéficie dans cette enceinte d’une cote extrêmement favorable.
Cependant, monsieur le ministre, puisque l’on doit tout se dire, permettez-moi de souligner un fait qui a froissé quelques épidermes au Parlement. Nous nous avons un épiderme, et il faut le ménager ! Or publier le décret le 22 janvier alors même que la loi n’est pas votée, cela provoque une petite brûlure !

Nous en conservons une petite trace, même si elle n’est ni très douloureuse ni dramatique en comparaison de traumatismes bien plus graves.
Puisque les trois commissions ont travaillé d’un commun accord à l’élaboration de cet amendement, laissons au moins vivre ce dernier jusqu’à la commission mixte paritaire !
Je tiens à répondre à M. le rapporteur général pour dissiper tout malentendu entre le Gouvernement et le Sénat.
Il est vrai que le décret a été publié le 22 janvier dernier, mais il confie au commissaire général à l’investissement un rôle plus large que sa mission liée au grand emprunt. Tout en se consacrant essentiellement à ce dernier, le commissaire en sera néanmoins déconnecté, car il assurera la cohérence de la politique d’investissement de l’État.
M. Éric Woerth, ministre. J’espère que cette explication mettra un peu de baume sur votre sensibilité épidermique !
Souriressur les travées de l’UMP.

Monsieur le ministre, c’est une question de gouvernance.
Sans utiliser le terme « débudgétisation », …

le « cantonnement » décrit par M. le rapporteur général risque de priver le Parlement d’une très grande partie de ses moyens de contrôle sur les sommes qui seront déléguées immédiatement après que le Sénat aura voté le projet de loi de finances rectificative, s’il recueille une majorité de voix, ce dont je ne doute pas.
Il s’agit simplement de clarifier la gouvernance en indiquant que le commissaire ne peut être juge et partie, instruire et évaluer ses choix. C’est la raison pour laquelle ces amendements tendent à séparer les fonctions du commissaire et celles du comité de surveillance.
Par ailleurs, je veux souligner un parallélisme des formes. Vous avez bien noté que les trois commissions se sont associées pour déposer certains amendements. Je ne vois donc pas au nom de quoi les commissions compétentes de la culture et de l’économie de l’Assemblée nationale et du Sénat ne pourraient pas être représentées au sein du comité de surveillance.
C’est une façon de renforcer le contrôle du Parlement sur un emprunt important et des investissements décisifs pour notre pays.

M. Philippe Adnot. Mes chers collègues, certains d’entre vous auront remarqué que, ces derniers temps, je n’ai pas beaucoup soutenu le Gouvernement.
Sourires

Nous devons bien comprendre que tout le monde va vouloir un petit bout du grand emprunt, si bien que le risque majeur sera celui du saupoudrage et que la vraie mission du commissaire consistera dans l’arbitrage et le choix. Or, pour pouvoir choisir, le commissaire aura certes besoin d’expertise, mais il devra aussi être en mesure d’évaluer le possible retour sur investissement et la pertinence du choix.
Nous ne pouvons donc pas lui retirer l’évaluation, et ne pouvons pas réduire son rôle. En revanche, bien sûr, nous interviendrons dans le contrôle, dans le suivi des actions à conduire.
Si nous ne procédons pas ainsi, ce sera très lourd et inefficace. Chaque ministère voudra garder sa petite part, chaque organisme voudra avoir son petit bout, et si l’on déshabille le commissaire, il ne pourra pas être efficace.
Je voulais vous apporter mon soutien sur ce point, monsieur le ministre.

Nous contestons le recours à l’emprunt : c’est une position de fond que nous avons essayé de défendre hier, notamment, et encore aujourd’hui en début d’après-midi.
Sur le point précis qui nous occupe en ce moment, je me contenterai de rappeler au ministre les termes du premier alinéa de l’article 24 de la Constitution : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. » Tout est dit.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 19 rectifié, 29 rectifié et 45 rectifié.
Les amendements sont adoptés.

L’amendement n° 100, présenté par MM. Foucaud et Vera, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Rédiger comme suit cet alinéa :
4°. - Les objectifs poursuivis et les résultats obtenus, notamment en termes de développement des équipes de recherche, d’emploi et de respect des normes sociales et environnementales ;
La parole est à M. Bernard Vera.

Le même sujet a été abordé voilà quelques instants à l’occasion de l’examen de l’amendement n° 99, et je crois que celui-ci appelle le même avis défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 4 est adopté.

L’amendement n° 88, présenté par Mmes M. André et Bricq, MM. Marc, Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L’article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le début de l’antépénultième alinéa du 1 du 7° est ainsi rédigé : « de locaux d’établissements mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils assurent l’accueil de jour ou l’hébergement d’enfants mineurs à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu’ils hébergent… (le reste sans changement) » ;
b) Après le mot : « portant », la fin de la première phrase du 7° sexies est ainsi rédigée : « sur les locaux d’établissements mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils assurent l’accueil de jour ou l’hébergement d’enfants mineurs à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu’ils hébergent des personnes handicapées à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu’ils hébergent des personnes âgées à titre permanent ou temporaire s’ils remplissent les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et qui font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département. »
II - Après les mots : « apports de locaux », la fin du 3 septies du I de l’article 278 sexies du même code est ainsi rédigée : « destinés à l’hébergement ou l’accueil de jour dans les établissements mentionnés au 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils assurent l’accueil de jour ou l’hébergement d’enfants mineurs à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu’ils hébergent des personnes handicapées à titre permanent ou temporaire ou, lorsqu’ils hébergent des personnes âgées à titre permanent ou temporaire s’ils remplissent les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et qui font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département. »
III - Les I et II s’appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
IV - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Michèle André.

L’amendement que nous présentons ici vise à réparer un oubli malheureux dans la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
En effet, cette loi, promulguée au cours de l’été dernier, a permis à nombre d’établissements et services sociaux et médico-sociaux de bénéficier du taux réduit de la TVA sur la construction de biens immobiliers nécessaires à leur activité, que ce soit ou non pour l’hébergement de leurs pensionnaires.
Toutefois, la rédaction de la loi mentionnée ci-dessus a abouti à exclure de ce dispositif les établissements accueillant des mineurs handicapés et à n’en faire bénéficier que les seuls établissements accueillant des adultes handicapés ou âgés.
La direction générale des finances publiques, interrogée par telle association de parents de handicapés, a étrangement répondu, sur le seul fondement de la forme du texte législatif, que « l’application du taux réduit [était] réservée aux seuls établissements agissant à but non lucratif, dont la gestion est désintéressée et qui font l’objet d’une convention à cette fin entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département », précisant que « la mesure s’appliqu[ait] aux établissements assurant un hébergement de jour et de nuit permanent ou temporaire » et que « les établissements se limitant à proposer un accueil de jour [n’étaient] pas considérés comme entrant dans le champ de la mesure ».
Pourquoi pas ! Tout cela est bel et bon ! Mais en quoi ces formulations privent-elles du taux réduit de la TVA les établissements accueillant des mineurs handicapés ?
Pourquoi la direction générale de l’action sociale du ministère du travail, se fondant sur les arguments que j’ai cités précédemment, affirme-t-elle que « les établissements hébergeant des enfants handicapés n’entrent donc pas dans le champ d’application du dispositif de TVA à taux réduit prévu par l’article 45 de la loi [instituant le droit au logement opposable], la loi DALO. Ils sont en revanche désormais éligibles, en vertu du II de l’article 124 du projet portant réforme de l’hôpital […], pour les opérations intervenant à l’effet de la loi sur la partie de leurs locaux dédiée à l’hébergement » ?
Pourquoi de telles contradictions ? Pourquoi une telle confusion ? Il est grand temps, mes chers collègues, d’y mettre fin et de clarifier cette situation !
En conséquence, nous vous demandons de voter le présent amendement, qui vise simplement à réparer un oubli malheureux, aux conséquences aussi absurdes qu’inéquitables, et que personne ne peut ni comprendre ni expliquer.

Je suis assez perplexe, car cette demande, déjà formulée à plusieurs reprises par Mme Michèle André, paraît étayée par des arguments de bon sens. Toutefois, lorsque l’on examine l’annexe III de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, on observe que le taux réduit n’est autorisé que dans le cas du logement social ; or la notion d’« accueil de jour » ne relèverait pas de la catégorie « logement social ».
Peut-être, monsieur le ministre, pouvez-vous nous apporter des éléments d’information sur ce sujet ou nous indiquer s’il est possible d’entamer des démarches interprétatives auprès de la Commission de l’Union européenne, ce qui permettrait à Mme André, je l’espère, d’avoir quelques assurances et, à ce stade, de retirer son amendement ?
L’avis du Gouvernement n’est pas favorable, pour la simple raison que la directive européenne l’en empêche. En effet, elle vise le logement, c’est-à-dire les lieux où il est notamment possible de passer la nuit : les accueils de jour ne sont donc pas considérés comme appartenant à cette catégorie.
Les établissements assurant l’hébergement des adultes handicapés ou âgés et des mineurs handicapés, lorsqu’ils permettent un accueil permanent, bénéficient du taux réduit de 5, 5 %. Dans ces cas, madame la sénatrice, votre demande est satisfaite par la législation actuelle.
Pour les accueils de jour, c’est vrai, le taux de la TVA est de 19, 6 %, pour la bonne raison qu’il n’est pas possible d’appliquer le taux réduit.
Vous le savez, celui-ci n’est possible que dans un certain nombre de cas limitativement énumérés. C’est ainsi, et nous ne pouvons rien y faire.

Monsieur le ministre, je pense qu’il n’est pas question seulement d’accueil de jour : il est question d’accueillir des personnes.
Ainsi, alors que le taux réduit est maintenant applicable aux établissements accueillant les personnes adultes, il serait refusé à ceux qui hébergent les enfants, les mineurs ! C’est étrange !
Aussi, monsieur le ministre, je vous demande de nous aider à clarifier le sens du terme « hébergement ». Que les personnes hébergées soient des adultes ou des mineurs, on devrait pouvoir appliquer la même disposition !
Sur le fond, je ne suis évidemment pas opposé à votre amendement. Malheureusement, nous sommes là dans le juridisme.
Si un établissement héberge des enfants handicapés, il pourra bénéficier de la TVA à 5, 5 % pour ses travaux de construction, de rénovation, etc. S’il assure uniquement un accueil de jour, il ne sera pas considéré comme un établissement d’hébergement !
Il m’est tout à fait possible de demander à la direction de la législation fiscale de nous repréciser ce que signifie le terme « hébergement », et c’est bien volontiers que je le ferai. Cela étant, il faut examiner les cas précis que vous visez, et je suis bien sûr prêt à le faire, car chacun pose un problème d’interprétation différent.

Les explications de M. le ministre vont plutôt dans le sens d’un traitement identique des différents cas et, sur la base des échanges qui viennent d’avoir lieu, je pourrais sans doute retirer cet amendement.
Toutefois, les précisions et les assurances que j’ai demandées me sont vraiment nécessaires ; surtout, au-delà de ma personne, les associations qui accueillent des mineurs en ont besoin.
Je retire donc cet amendement, sous le bénéfice du travail approfondi qu’a évoqué M. le ministre.
I. – À l’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III du code de la recherche, après le mot : « atomique », sont insérés les mots : « et aux énergies alternatives ».
II. – Aux articles L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3, L. 332-5 et L. 332-6 du code de la recherche, après les mots : « Commissariat à l’énergie atomique », sont insérés les mots : « et aux énergies alternatives ».
III. – Les mots : « Commissariat à l’énergie atomique » sont remplacés par les mots : « Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives » dans toutes les dispositions législatives en vigueur.

L’amendement n° 20, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Éric Woerth, ministre. Le maire de Chantilly est toujours très sensible à tout ce qui est cavalerie
Sourires
, mais, en l’occurrence, le Gouvernement estime que l’amélioration de la dénomination actuelle du CEA, qui, de « Commissariat à l’énergie atomique », deviendrait « Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives » – CEA², si l’on peut dire !
Nouveaux sourires.

Monsieur le ministre, si vous aviez utilisé dans l’article 4 l’expression « Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives » – personne n’est choqué par cette appellation ! –, par exemple en écrivant : « Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives recevra telle somme », cela n’aurait soulevé aucun problème. Vous pouviez le faire ! Mais, devant un article spécifique qui est de pure dénomination – et même si je le regrette, car je n’ai pas d’hostilité sur le fond –, il est de mon devoir de signaler qu’il s’agit d’un cavalier budgétaire. Si nous l’acceptons pour le CEA, nous devrons l’accepter pour tout et n’importe quoi, et l’on pourra, dans une loi de finances, dénommer une place publique ou que sais-je encore ! On peut avoir beaucoup d’imagination !
Sincèrement, monsieur le ministre, cet article est un cavalier budgétaire.

Monsieur le président, j’ai bien des scrupules à venir discuter l’argumentation du tenant de l’orthodoxie de la doctrine du Sénat qu’est le rapporteur général.

J’ai lu très attentivement le compte rendu de la discussion qui a eu lieu en commission des finances.
Je formulerai deux observations.
La première, qui ne devrait pas soulever de difficulté, porte sur le fait que le nom du CEA relèvebien du domaine législatif, …

Il a été créé par une ordonnance de 1945, signée de la main du général de Gaulle, qui a valeur législative !

… puisque, dans sa jurisprudence, le Conseil d’État considère – c’est d’ailleurs un revirement de sa position – que le CEA constitue à lui seul une catégorie distincte d’établissement public, et donc que toutes les mesures, y compris concernant son nom, relèvent bien de la loi.

C’est en Savoie que, le 9 juin dernier, le Président de la République a choisi d’annoncer sa volonté d’accompagner la politique du Grenelle, mais cette fois-ci dans le cadre concret de la recherche de la filière industrielle, et d’émettre le vœu que le CEA puisse changer de nom. Peut-être est-ce la raison pour laquelle je me crois autorisé à me demander, puisqu’il a, à cette occasion, longuement expliqué son ambition pour le pays, dans quelle mesure il n’avait pas pensé créer un commissariat aux énergies alternatives ou renouvelables distinct du CEA. Mais on ne crée pas une telle structure du jour au lendemain !
Mes chers collègues, nous sommes tous convaincus que le CEA a beaucoup apporté à la France sur le plan nucléaire, qu’il s’agisse du nucléaire militaire ou du nucléaire civil.
Nous nous accordons tous aujourd'hui, je l’espère, à reconnaître que notre pays a commis une erreur majeure voilà vingt ans en suspendant cette filière, plutôt qu’en la mettant, au nom du principe de précaution, sous embargo, dans un cocon. Nos concurrents ont mis ces années à profit pour nous prendre, sur le plan international, des marchés les uns après les autres ; nous avons des exemples récents en la matière.

Pourtant, notre pays existait sur le marché des énergies renouvelables, du solaire notamment – une filière qui me passionne ! – et sur bien d’autres encore. Que s’est-il passé ?
Il y a quinze ans, des dizaines et des dizaines d’entreprises œuvraient dans le secteur du solaire thermique. Mais, aujourd'hui, elles ne sont plus que deux : Giordano, une entreprise située dans le sud de la France qui a été sauvée par EDF, et Clipsol en Savoie, qui l’a tout autant été il y a quelques mois par GDF-Suez. Si ces deux entreprises n’avaient pas été sauvegardées, nous ne compterions plus aujourd'hui, en France, une seule entreprise dans ce domaine.
Voilà également quinze ans, Photowatt était l’une des trois premières entreprises dans le secteur du photovoltaïque. Mais si le CEA et le CNRS ne se mobilisent pas aujourd'hui pour développer le silicium métallurgique, celle-ci disparaîtra !
À cet égard, je suis heureux que vous ayez souligné hier, monsieur le ministre, votre attachement à la filière aluminium lorsque j’ai évoqué la situation du groupe Rio Tinto.
Lorsque Alcan a racheté Pechiney, il a vendu PEM, Péchiney Electrométallurgie, à l’espagnol Villar Mir, qui est actuellement en train de développer une filière vouée à la disparition, en convertissant le silicium métallurgique en silicium photovoltaïque.

En soulignant hier, au cours de la discussion générale, que l’aluminium pouvait être sauvé, je pensais justement à PEM, qui ne disparaîtra pas grâce aux Espagnols. Et s’ils ont investi dans ce domaine, c’est parce la filière va être sauvé par le CEA qui a développé une recherche du CNRS.
Très sincèrement, je veux bien que l’on parle ici d’un cavalier.
J’ai suivi avec beaucoup de passion les débats relatifs au Grenelle de l’environnement et je considère que ce grand emprunt est un outil susceptible de mettre en œuvre cette politique. Aujourd'hui, au cours de notre débat, il a beaucoup été question de gouvernance et de mobilisation de fonds, et j’ai d’ailleurs voté avec une grande retenue nombre d’amendements qui nous ont été présentés. Mais le plus important, c’est la rapidité avec laquelle il faut mobiliser l’argent…

… sur des projets importants. Or, si l’on n’a pas de porteurs de projets, il ne restera rien de ce grand emprunt. Aujourd'hui, seuls le CNRS, le CEA…

… et une poignée de grands industriels – plus de cinq, moins de dix ! – sont capables, en France, de relever le défi.
J’ai terminé mon intervention hier en soulignant qu’il est de la responsabilité du Gouvernement de mobiliser la recherche et les industriels.
Ainsi, ce sont les Allemands – et personne d’autre ! – qui ont lancé le grand projet Desertec dans le désert subsaharien. Lorsque l’Europe a décidé de se fixer comme objectif 20 % d’énergies renouvelables, l’Allemagne a fait adopter, au niveau européen, une modification de la réglementation parce qu’elle savait qu’elle ne pourrait pas respecter cet engagement en se cantonnant sur son propre territoire et qu’elle devrait donc aller à l’extérieur.
Excusez-moi, mes chers collègues, de parler avec tant de passion, mais j’estime que nous devons avoir la même ambition que le général de Gaulle lorsqu’il a créé le CEA ! Si nous ne l’avons pas, nous nous serons simplement fait plaisir en votant une belle loi ; dans le cas contraire, on ne pourra plus parler de cavalier !
Certes, M. le rapporteur général a peut-être raison – je ne dis pas que le Gouvernement a eu tort de présenter cette disposition de cette façon ! –, mais nous devons faire passer un message. Plus de soixante ans après avoir créé le CEA pour relever le défi nucléaire, il s’agit de dire que le Parlement est prêt à s’engager pour relever ce nouveau défi. Nous donnerons ainsi à ce texte une ambition politique ! §

Le rapporteur général n’est pas seulement le gardien des barrières au-delà desquelles les cavaliers ne doivent pas circuler ! Je ne sais pas si vous le savez, mon cher collègue, mais j’ai passé dix ans, de 1979 à 1989, au CEA. Les énergies renouvelables ne sont pas nouvelles pour cet organisme ; celui-ci a beaucoup fait pour ce secteur durant cette décennie. Ayons une certaine mémoire des faits : c’est André Giraud qui fut à l’initiative de cette politique.
Le CEA a assuré, dans les années soixante-dix, une mission de diversification, puis de valorisation industrielle et a consacré, bien avant d’autres, beaucoup d’argent dans l’énergie solaire et… en a aussi perdu énormément ! Il en a été de même pour l’éolien, des équipes étant même devenues spécialistes des structures ruiniformes des grandes éoliennes ! Mais sans doute fallait-il passer par ces stades intermédiaires.
En tout cas, ce n’est pas avec le grand emprunt que le CEA commencera à développer les énergies alternatives ! Cet organisme œuvre dans le domaine du biomédical et est à la pointe de tous les nouveaux matériaux, quels que soient leurs usages, qu’il s’agisse du CEA militaire ou du CEA civil. Alors que l’on ne me dise pas – c’est pour cette raison que je réagis, car nous sommes d’accord à 100 % sur le fond ! – que ces deux mots supplémentaires sont nécessaires pour conclure un accord ! Bon nombre d’accords ont été conclus depuis trente ans !
Mais si vous voulez voter ce cavalier budgétaire, mes chers collègues, je n’en serais pas choqué. Je n’ambitionne pas du tout de siéger au Conseil constitutionnel…
Sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 4 bis est adopté.

L'amendement n° 34, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :
Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le troisième alinéa du a) du 1 du II de l'article 1640 B du code général des impôts, après les mots « délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle », sont ajoutés les mots « et du coefficient de revalorisation des valeurs locatives cadastrales pour 2010 visé au zd) de l'article 1518 bis. ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Paul Alduy.

Certaines informations qui me sont remontées du terrain m’ont conduit à déposer cet amendement.
Un certain nombre d’EPCI ont eu la surprise de constater que les administrations départementales considèrent que le coefficient de revalorisation des valeurs locatives cadastrales pour 2010 – plus 1, 2 % – ne serait pas pris en compte pour la détermination des bases de la taxe professionnelle de 2010, et ne serait donc pas pris en considération pour la compensation relais 2010.
Cette interprétation est fondée sur le fait que la taxe professionnelle de 2010 est calculée « dans les conditions en vigueur au 31 décembre 2009 », alors que le coefficient de revalorisation ne s’applique qu’au 1er janvier 2010.
Je signale, au passage, que cela porte sur près de 17 % des bases totales de taxe professionnelle. Cette non-prise en compte du coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales dans le calcul de la compensation relais pour 2010 n’est donc pas conforme à l’esprit dans lequel le texte a été voté, à savoir une neutralisation de la réforme en 2010 pour les collectivités locales.
Cette situation est d’autant plus étonnante que la revalorisation sera effectivement appliquée à la cotisation foncière des entreprises acquittée par les entreprises et perçue par l’État en 2010. L’État percevra donc une revalorisation de 1, 2 %, mais ne la répercutera pas sur les collectivités locales.
Je ne développerai pas plus longuement mon argumentation, car vous avez compris, mes chers collègues, que cet amendement vise à prendre en compte le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales pour 2010 pour la détermination des bases de taxe professionnelle servant au calcul de la compensation relais.

Cette précision intéressante nous semble indispensable et elle est conforme à l’esprit du texte que nous avons voté en décembre dernier. J’espère que le Gouvernement va nous le confirmer.
Je tiens à remercier Jean-Paul Alduy d’avoir levé ce lièvre, si je puis dire.
Il est parfaitement clair pour le Gouvernement que le coefficient de revalorisation de 1, 2 % des bases locatives cadastrales pour 2010 s’applique aux bases 2010 pour le calcul de la compensation de taxe professionnelle 2010. Je ne sais pas si tel ou tel service a mal interprété les choses. Mais en tant que responsable de ces services je vous indique que l’actualisation de 1, 2 % s’applique évidemment sur les bases 2010. Nous le ferons savoir à la direction générale des finances publiques. Vous avez donc satisfaction, monsieur le sénateur. Dans ces conditions, le Gouvernement lève le gage.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 4 bis.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt-et-une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.